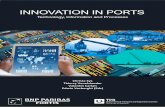Le port de Bizerte ( 1881-1914)
Transcript of Le port de Bizerte ( 1881-1914)
Les confins maritimes, le cas du port de Bizerte (1881-1918)
Noureddine Dougui, Université de TunisJuin 2014
1
1- Une place maritime défendue naturellement L’histoire de Bizerte a été constamment liée à la mer, tour à tour comptoir punique , port de guerre sous les Romains, point d’attache pour les bateaux de Course sous les Ottomans et grande base navale sous le protectorat, Bizerte a constitué, avec son potentiel naturel, une frontière maritime naturelle.
Comparé aux mouillages de la côte nord de la Tunisie, dont l’accès est particulièrement difficile, le port naturel de Bizerte est établi au voisinage d'un lac qui dessine une échancrure abritée qu'on ne rencontre nulle part sur la côte maghrébine.
L’étendue de ce plan d’eau est un atout de plus, couvrant une superficie de 15 000 hectares dont 13 000 sont susceptibles d'être utilisés à des fins militaires, cet immense refuge d'eau salée communique avec la rade extérieure par le biais d'un avant lac appelé goulet, de 6 Km de longueur environ et de 900 m de largeur. Les fonds naturels sont partout supérieurs à 9 m, ils sont parallèles au rivage à une distance de 800 à 1500 m.
3
2- Bizerte au centre d’une rivalité internationale
La position stratégique de Bizerte suscite l’intérêt des puissances européennes à partir de l’occupation de l'Algérie. Dans ce cadre, l’amiral anglais Spratt effectue, en 1845, une mission de reconnaissance dans la région et démontre les avantages de l’établissement d’un port sur la rade naturelle de Bizerte.
En 1878, l’état-major français lui emboîte le pas. Le commandant Perrier est dépêché spécialement à Bizerte pour faire les levées nécessaires à l’établissement d’une carte topographique et collecter les renseignements à même de faciliter un débarquement militaire.
Accusant la France de vouloir reculer la frontière algérienne jusqu'à la vallée de la Medjerda afin d'incorporer Bizerte, les britanniques s’opposent vigoureusement aux visées expansionnistes françaises sur la Tunisie.
A partir de 1860, un nouvel acteur entre dans la compétition : son unité achevée, l'Italie manifeste ouvertement son intérêt pour la Tunisie
L’ouverture du canal de Suez (1869) aidant, les grandes puissances maritimes prennent la pleine mesure de la valeur stratégique de Bizerte.
Prenant les devants, l’Italie demande à l’Etat tunisien de concéder à une société italienne la construction et 1'exploitation d'un port à Bizerte.
5
A la fin des années soixante dix, le véto anglais à l’occupation de la Tunisie est levé. Forte de l’appui anglo-allemand, la France devance l'Italie et coupe court à ses prétentions.
Débarquant à Bizerte le 1 mai 1881, l'Amiral Conrad écrit, au ministre de la Marine: : "L’étendue de la rade de Bizerte et du port est telle qu'il serait facile d'y créer dans l'avenir la base maritime la plus importante de la côte Nord d'Afrique ».
L’idée de créer une base d’opération à Bizerte reprend, en fait, un vieux projet français. Mais celui-ci est resté, des années durant, lettre morte. Constamment reportée , la décision de mettre en chantier un grand port de guerre n’est prise qu’en 1899. La question se pose de savoir pourquoi il a fallu attendre tant d’années pour aménager une base navale à Bizerte ?
La Tunisie occupée, La Grande Bretagne et l’Italie reviennent à la charge en mobilisant leurs moyens diplomatiques pour empêcher la militarisation de Bizerte. Dans l’optique anglo-italienne tout changement de statu quo est susceptible modifier l’équilibre des forces en Méditerranée à l’avantage de la France.
Se prévalant du traité du Bardo qui autorise les troupes françaises à occuper, à titre provisoire, tous les points de la Tunisie, mais sans possibilité d'édifier des fortifications permanentes, ils réussissent à faire reculer les Français.8
3- Difficultés diplomatiques et manœuvres dilatoires
Fortement préoccupée par la création éventuelle d'un port de guerre à Bizerte , l'Italie continue d’orchestrer un concert de récrimination dans l’espoir d’indisposer les puissances contre la France.
Du côté français, l'opinion publique, la presse et les parlementaires demandent à connaître les intentions du gouvernement au sujet de la fortification de Bizerte. Sous l'instigation de l'amiral Aube , doctrinaire de l'école défensive de stratégie navale, le gouvernement français donne en 1887 son consentement pour le curage du vieux port afin rendre le lac accessible aux petits torpilleurs.
Cette action suscite, à nouveau, une levée de bouclier. En janvier 1889, les Cabinets anglais et italiens s'empressent d'aviser la France de leur opposition catégorique à la militarisation de Bizerte. L'Allemagne en fait autant.
Evitant d’affronter ouvertement les puissances européennes ameutées contre elle par l'Italie, la France n'en continue pas moins à poursuivre, discrètement, son programme de fortification de Bizerte . 10
4- Le contournement des difficultés diplomatiques
Une fiction juridique permet de circonvenir les chancelleries européennes. Affectant de donner à l'opération des apparences inoffensives, les autorités du protectorat concèdent, en 1889, à une société privée, la Compagnie Hersent, la création, de toutes pièces, d’un port de commerce à proximité du lac.
L’opération vise, par delà le développement des infrastructures commerciales, à rendre le lac de Bizerte accessible aux vaisseaux de guerre. Aussi, les principaux points du contrat de concession portent-ils sur le creusement d’un canal de 64 mètres de largeur, de 2400 mètres de longueur et de 9,5 de profondeur, à travers les sables qui séparent le goulet de la mer, de manière à faire communiquer la mer avec le lac, et à former des terre-pleins destinés aux quais. .
Commencé en 1890, le travaux de creusement du canal et d’aménagement des quais s’achèvent en 1895. Le 4 juin 1895 les croiseurs cuirassés Suchet et le Wattiguier franchissent, pour la première fois, le canal nouvellement inauguré et vont mouiller dans les eaux de l’avant lac
L’année 1896 est marquée par la conclusion de la convention franco-italienne du 30 septembre , dont l’une des clauses principales est la reconnaissance par l’Italie du protectorat français sur la Tunisie .
12
5- La création d’une base navale L’hypothèque italienne levée, les autorités françaises envisagent la reconversion immédiate de Bizerte en une base navale répondant aux exigences de la guerre moderne.
Ce qui signifie la mise en place d’établissements militaro-industriels capables de ravitailler une flotte énorme en cours d’opération, en charbon, en essence et en munitions et d'assurer éventuellement sa protection et sa réparation à la suite d’opérations de toutes sortes.
L’aménagement du port de commerce terminé, la Marine de guerre s’attaque à la construction d’un abri pour ses torpilleurs et autres vaisseaux de combat. La question s’est alors posée de savoir où installer les établissements de réparation des bateaux ?. On a pensé au début à établir les défenses militaires et les ateliers au sud du goulot sur le littoral de la presqu’île de Menzel Abderrahmane à 6 Km du rivage, mais l'idée a été vite repoussée à cause de la "vulnérabilité" du site . Le choix s’est finalement reporté sur un site retranché au fond du lac.
14
Les travaux de construction de l’arsenal de Sidi Abdallah, baptisé plus tard Ferryville, sont engagés en 1900 . Les plans de l’arsenal prévoient l’établissement d’une usine électrique, d’un atelier de forge mécanique, des défenses sous-marines, des magasins pour matériel et torpilles, un parc à charbon pour 25.000 tonnes, deux bassins de radoub, des casernes d'infanterie de marine et un hôpital militaire.
En même temps, la Marine se voit attribuer le contrôle de tous les plans d’eau avoisinant ses installations, qui acquièrent de facto un statut militaire. Ceci explique sa prise en charge des travaux complémentaires des travaux du port de commerce. En l’occurrence, l’approfondissement de l’avant-port commercial à la cote moins 10 m, sur une surface d’environ 40 ha, l’élargissement du canal d’accès au lac de manière à lui donner une largeur de 200 m et le remplacement du pont transbordeur qui établit la communication entre les deux rives du chenal. Engagés à partir de 1901 ces travaux doivent durer jusqu'en 1905.
Avec l'achèvement de l’édification de l'arsenal la Marine entre en possession d'une base militaire de premier ordre. Cette zone forte est conçue pour servir de base de relais et d'approvisionnement de l'escadre de la Méditerranée, mais sa fonction n'est pas strictement technique, elle est également stratégique. Elle doit assurer le rôle d'une sentinelle de première ligne pour les côtes tunisiennes.
16
Bizerte se voit assigner , dès le début de la Première Guerre Mondiale, le rôle de ravitailler en hommes et en vivres l'armée d'Orient. Aussi quand la guerre sous-marine atteint son paroxysme, elle devient un point de rassemblement des bâtiments de commerce qui se constituent en convois avant de se faire accompagner par des patrouilleurs.
Etant donné les bonnes conditions d'abri et de sécurité du port de Bizerte, celui-ci devient le plus actif des ports d'Afrique du Nord, sa situation sur la route d'Orient en fait une zone d'élection pour le ravitaillement et un excellent refuge pour les navires de commerce anglais désirant se protéger ou attendant la formation d'un convoi. En 1918, 3346 navires font escale dans les eaux du port de Bizerte jaugeant 7.154,000.
18
L'arsenal de Sidi Abdallah tourne alors au maximum de sa puissance. De 1914 à 1918 le nombre des échouages dans les bassins de l'arsenal est de 1050. Le port militaire assure l'approvisionnement en charbon, le renouvellement des effectifs et des unités combattantes et le réarmement de l'armée d'Orient. L'arsenal assure la réparation des avaries par les abordages, les explosions des mines et le torpillage.
La guerre aura montré plus qu'il est permis de le prévoir, l'importance de Bizerte comme port de guerre, base de ravitaillement, base d'opération et comme port de commerce.
20

























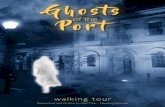



![Godina 1914. u hrvatskom medaljerstvu. [1914 in the Croatian Art of the Medal.]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631c2f8e93f371de190151b7/godina-1914-u-hrvatskom-medaljerstvu-1914-in-the-croatian-art-of-the-medal.jpg)