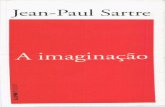Le pas de côté : sortir du "toupolitique" avec Sartre
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Le pas de côté : sortir du "toupolitique" avec Sartre
Le pas de côté : sortir du « toupolitique » avec Sartre1
En hommage à Gérard Bobillier
Pendant sept ans, Sartre et Benny Lévy ont dialogué. Échelonnées selon un rythme variable,
interrompues par les vacances ou les voyages, quotidiennes à certains moments, leurs séances de
travail les ont amené à aborder des thèmes nombreux, étonnants souvent, improbables parfois. De
ces séances de travail commun, il ne reste que de maigres traces – du moins, peu de traces sont
accessibles, si l'on excepte les entretiens publiés peu avant la mort de Sartre dans Le Nouvel-
Observateur sous le titre L'Espoir maintenant2, ainsi que les carnets de notes de Benny Lévy,
publiés voici bientôt deux ans par les éditions Verdier3.
Ces deux « textes » qui n'en sont pas vraiment (l'un revêt la forme d'entretiens, l'autre est
constitué d'un ensemble de notes de travail) permettent cependant, si l'on s'y arrête, de reconstituer
bien des éléments de ce dialogue inédit. C'est donc surtout sur eux que je m'appuierai.
Si ces fragments présentent un intérêt intrinsèque, ils sont aussi liés à une époque
particulière – cela n'est pas sans intérêt pour nous ici. Cette époque – 1972-1980 – est en effet, celle
qui a vu s'auto-dissoudre l'organisation maoïste que dirigeait Benny Lévy, et qui avait réveillé
l'intérêt de Sartre pour la chose politique, qui lui avait plus précisément redonné espoir, par-delà le
pessimisme foncier qui était le sien dans les années 60. « La politique » équivalait pour Sartre,
comme pour nombre de ses contemporains, à « la gauche ». Pour lui, ces deux expressions se
recouvrent intégralement. Or la gauche était morte dans les années 60, aux yeux de Sartre. Puis le
gauchisme et mai 1968 étaient survenus, témoignant d'un sursaut salutaire, d'une forme de
résurrection. Avec la disparition du gauchisme, Sartre le sent bien, ce qui advient à nouveau c'est la
mort de la gauche, qu'il diagnostique dans les entretiens de 19804.
1 Texte prononcé au Banquet du livre, à Lagrasse, le 4 août 2009.2 Jean-Paul Sartre, Benny Lévy, L'Espoir maintenant, Verdier, 1991, 2007.3 Benny Lévy, Pouvoir et liberté (Cahiers), Verdier, 2007.4 L'espoir maintenant, op. cit., p. 46 et 48.
1
Lorsque Sartre et Benny Lévy commencent effectivement à dialoguer (effectivement, car
Benny Lévy avait déjà lu Sartre ; ce dernier n'ignorait pas de son côté l'existence du leader
inhabituel et, semble-t-il quelque peu fascinant pour les intellectuels de l'époque, qu'était Benny
Lévy), la Gauche Prolétarienne existe encore. C'est elle d'ailleurs qui explique leur rencontre
effective. On connaît l'anecdote : le journal de l'organisation gauchiste, La Cause du peuple,
cherchait un directeur suite à l'arrestation des deux derniers. Il fallait trouver le moyen de prendre le
pouvoir à son propre piège, c'est-à-dire fomenter une action dans lequel il s'empêtrerait
immanquablement – soit ce que le langage de l'organisation appelait « action subversive
institutionnelle », dont le principe est énoncé par exemple dans un livre d'entretiens entre Sartre,
Benny Lévy et Ph. Gavi intitulé On a raison de se révolter :
« Il n'y a pas d'un côté l'action purement illégaliste et de l'autre l'action purement légale. Une
action qui comporte un élément de légalité doit comporter en même temps une charge critique pour
le système établi, un indice de subversion ; la combinaison devient instable : les masses se mettent
en mouvement, c'est le pouvoir lui-même qui se charge de dérégler le rapport légalité-illégalité, de
“durcir” le mouvement. »5
Il s'agit donc de confronter le pouvoir à ses propres limites dans le but d'en exhiber la vérité
nue : celle du pur rapport de force. Dans la nomination de Sartre comme directeur de La Cause du
peuple on retrouve une telle combinaison instable. Voici comment Benny Lévy revient sur cette
« action » en 1972 :
« Sartre prenant la direction de la CDP, ne se faisant pas arrêter, puis diffusant la CDP sur les
boulevards, alors que les diffuseurs se faisaient arrêter et récoltaient des mois de prison, tout ça n'est
pas “utiliser Sartre comme vedette ou comme gadget”, c'est Sartre exploitant au maximum une
contradiction propre au pouvoir qui prétendait respecter la loi quand il réprimait les gauchistes. Par
ses interventions, Sartre montrait clairement que le respect de la loi par le pouvoir était relatif,
limité. Dans la mesure où le pouvoir ne s'attaquait pas à Sartre, le pouvoir marquait, par là, que la
5 J.-P. Sartre, Philippe Gavi, Pierre Victor, On a raison de se révolter, Gallimard, 1974, p. 90.
2
répression n'était pas égale pour tous et permettait de comprendre que la répression qui s'abattait sur
les maos pouvait être, elle aussi, illégale. »6
Sartre donc comme révélateur de la justesse d'une idée, condamnée sans lui à rester
clandestine, Sartre relayant l'idée, l'incarnant, lui donnant une chair.
C'est durant les séances de discussion préparatoires à la publication de On a raison de se
révolter, destinée à financer le quotidien Libération, qu'a été prononcée la dissolution de la Gauche
Prolétarienne. Moment-charnière, qui nous intéresse car il témoigne et accomplit en un sens le pas
de côté.
Enfin, le dialogue s'est prolongé jusqu'à la mort de Sartre, tandis qu'explosait l'unité de
façade de ce que l'on a convenu d'appeler la « famille sartrienne » et que l'existence de Benny Lévy
prenait un tour surprenant au regard de ce que l'on croyait savoir de lui.
Puisqu'il s'agit de parler ici du politique, j'aborderai le dialogue de Sartre et Benny Lévy par
ce biais. Tout dans leur dialogue y invite de toute façon. Disons qu'il s'y agissait initialement de
repenser la révolution à partir d'une part du point d'incandescence auquel la Gauche Prolétarienne
avait porté la pensée et la pratique du politique et, de l'autre, du pressentiment, puis du constat, d'un
échec certain de cette forme inédite et intense.
Incandescence : Mao-Tsé-Toung, cité par La Cause du peuple affirmait : « La tâche centrale
et la forme suprême de la Révolution, c'est la conquête du pouvoir par la lutte armée, c'est résoudre
le problème par la guerre. »
Le problème : celui du pouvoir. La solution : la guerre. Commentant Mao, les maos écrivent
alors :
« Ce que nous voulons d'abord, c'est le pouvoir. Avec le pouvoir on peut tout ; sans pouvoir
on ne peut rien. Pour transformer le monde, il faut prendre le pouvoir. 1906, 1920, 1936, 1947,
1968 : à chaque fois dans une explosion de colère et de ressentiment, le prolétariat se lève, entame
6 Michèle Manceaux, Les maos en France, Gallimard, 1972, p. 210 (entretien avec « Victor, dirigeant politique » - enréalité Benny Lévy)
3
la grève générale mais comme il ne prend pas le pouvoir, rien ne change vraiment ; les forces de
répression reprennent peu à peu le dessus. Il faut recommencer. »
La fin du monde, régulièrement pressentie, désirée, attendue, est finalement toujours
ajournée. Et la préhistoire reprend ses droits – faute de prise de pouvoir.
Admettons donc que la révolution pose la question du pouvoir, qu'elle se pose elle-même
dans l'élément de la prise du pouvoir, qu'avec cette prise de pouvoir, elle se confonde. Il en découle
alors nécessairement que penser dans l'horizon de la révolution, c'est penser dans l'horizon du
pouvoir.
Si donc la question essentielle est celle du pouvoir, il faut un Parti. C'est du moins ce que
disait Sartre dans « Les communistes et la paix », par exemple où il croisait Lénine et Mao : « […]
pour obtenir entière satisfaction la foule révolutionnaire doit prendre le pouvoir. »7
L'instrument de cette prise de pouvoir, nous le savons, c'est le Parti qui « d'où qu'il vienne,
tire sa légitimité de ce qu'il répond d'abord à un besoin. Sans lui, pas d'unité, pas d'action, pas de
classe […] En un mot le Parti est le mouvement même qui unit les ouvriers en les entraînant vers la
prise du pouvoir. Comment voulez-vous donc que la classe ouvrière désavoue le PC ? Il est vrai
qu'il n'est rien en dehors d'elle ; mais qu'il disparaisse, elle retombe en poussière. »8
Ainsi l'agrégat, la poussière ne saurait prendre forme qu'au moyen du Parti. La forme qu'elle
reçoit par son biais c'est celle de la classe. L'agent qui confère à la matière atomisée une telle forme,
c'est le Parti, mouvement centripète, ordonnateur, forme formatrice sans laquelle manquera toujours
la permanence que confère la prise du pouvoir. Si la politique, c'est la gauche ; si la gauche est liée à
la révolution, à son espoir et à son désir ; si la révolution, c'est la prise du pouvoir, impossible en
l'absence de l'activité de synthèse du Parti, c'est sur les notions de Parti et de pouvoir que devrait
7 J.-P. Sartre, « Les communistes et la paix », Situations VI, Gallimard, 1964, p. 357. Dès mars 1940, Sartre notaitdans ses carnets que « le premier devoir d'un révolutionnaire qui a fait la révolution, c'est de prendre la pouvoir.Même si cette révolution a été faite pour rendre sa liberté à un peuple. libérer la nation d'un tyran et puis, l'ayantprivée de chef sans lui avoir appris à user de sa liberté, décliner les responsabilités du pouvoir, c'est la livrer pieds etpoings liés à un autre tyran. » Carnets de la drôle de guerre, Gallimard, 1995, p.585-586. On notera la proximité del'idée développée ici avec celle que nous citons, et la différence essentielle : c'est en termes de devoir que Sartreparle ici de la prise du pouvoir.
8 Ibid., p. 248-249.
4
pouvoir se mesurer le plus efficacement l'ampleur du pas de côté que Sartre et Benny Lévy ont
accompli vis à vis de ce que l'on appelait alors le « toupolitique » dont chacun reconnaîtra la
proposition fondamentale : Tout est politique.
Si donc la question essentielle est celle de la prise du pouvoir, la nécessité du Parti s'impose,
disions-nous. Mais si l'on déplace la question, cette nécessité tombe, immédiatement. Ce qui prend
bien davantage de temps, c'est de se défaire de l'adhésion plus ou moins intime à cette idée de
pouvoir.
Autrement dit : de la nécessité logique du Parti, on se défait aisément, pour autant que l'on
conçoive que le Parti n'est au fond qu'un avatar de Grand Sujet unificateur, c'est-à-dire une figure de
la statolâtrie – de l'idolâtrie de l'État, de l'idole politique. Mais de l'idole du pouvoir, on se défait
d'autant plus difficilement qu'on l'a préalablement affermie dans sa pensée et dans ses actes.
Rien n'est plus commun que de quitter une idole pour une autre – c'est le lot de la plus
banale idolâtrie, la forme la plus répandue de religiosité qui sait vivre avec son temps, en adopter
les figures, en épouser les contours. Se défaire de l'idole – devenir sujet par-delà ou en-deça de
toutes les images de Soi – cela implique une dissolution existentielle de l'idole. Qu'est-ce à dire ?
Que celle-ci se moque bien des dénonciations vertueuses, qu'elle est insensible au regard
surplombant qui en dénonce l'inanité. Elle ne redoute pas tant celui qui a raison contre elle que celui
qui, l'ayant érigée en absolu, lui ayant donné vie, la récuse désormais absolument, témoigne de son
néant, de son tohou, comme le dit le prophète Ésaïe (44, 9).
Il n'y a donc rien d'étonnant au fait que Sartre et Benny Lévy, tous deux profondément
engagés dans une pensée et (pour l'un des deux au moins) une pratique révolutionnaire, aient été les
mieux placés pour déconstruire patiemment – mais d'une patience qui n'interdisait point l'ardeur ni
une forme de passion – l'idole à laquelle ils avaient prêté vie. Ce qui est rare, et à mes yeux
précieux, c'est qu'ils l'aient fait ensemble. Car, sortir de la théorie par l'affirmation de la singularité,
c'est là un geste connu. Geste grandiose bien sûr, mais qui peut aboutir aussi à l'égoïsme, à
5
l'égocentrisme ou au ressentiment le plus banal. Mais sortir ensemble du lieu où l'on guettait
fièvreusement l'éclosion de la fraternité, c'est quasiment unique sous cette forme.
Pas de côté. Tâchons d'en prendre la mesure. Voici ce que déclarait Victor, dirigeant de la
Gauche Prolétarienne à Michèle Manceaux, fin 1971 :
« La question de notre dénomination se pose à plus d'un titre. D'abord, est-ce que
l'organisation qui va naître sera appelé parti ? Nous n'allons pas attendre d'être un puissant parti
reconnu par les larges masses de tout le pays pour choisir le terme « parti ». Si on pense que
l'instrument qu'on va construire est relativement adapté à la situation nouvelle, que tout un
ensemble d'individus objectifs l'attestent et qu'il correspond au point de vue, non seulement des
militants mais des masses directement mobilisées, alors incontestablement on choisira le terme
« parti ». C'est une des questions qui sera en discussion dans nos rangs. Et enfin la question du nom
de ce parti. Reprendra-t-on le terme « communiste » dans la mesure où il est assez dévalué pour
une partie des masses, vu ce qu'en fait le parti de Marchais, mais vraisemblablement, on le gardera
parce que ce n'est pas un mot qu'on abandonnera aux salopards. »9
En septembre 1978, dans le cadre du Cercle socratique, Benny Lévy, revenant sur l'épisode
maoïste, fixe un nouveau programme : il s'agit désormais d'« opposer à la métaphysique de
l'organisation une métaphysique de la parole. »10
Dans les sept années qui séparent ces deux citations, c'est la question du pouvoir qui a été au
cœur du dialogue de Sartre et Benny Lévy.
Le 13 décembre 1975, Benny Lévy note dans son carnet les phrases suivantes, qui expriment
à mes yeux le projet même de ce dialogue – condensé par Sartre dans le titre qu'il comptait donner
au livre écrit à deux : Pouvoir et liberté.
« Toute idée, tout principe, toute revendication qui traverse le champ politique perd sa
virginité et est susceptible, de façon constante, de retournement de sens et de contre-retournement.
9 Les maos en France, op. cit., p. 250-251.10 Compte-rendu d'une séance du Cercle socratique, Archives de la Fondation Benny Lévy, p. 10.
6
À une condition : s'ils conservent à leur base l'idée de POUVOIR.
Cela change-t-il si explicitement les principes relèvent de l'IMPOUVOIR ?
Problème : comment une idée dérivée de l'impouvoir peut-elle traverser le champ politique ?
Par explosion ? Laquelle ? Comment ? »11
On mesure déjà l'écart, à titre programmatique : si tout est politique (cela ne semble pas
encore mis en doute car il s'agit bien de traverser le « champ politique »), et que la question par
excellence du politique est la prise de pouvoir, penser une politique de l'impouvoir, c'est au moins
prendre ses distances avec toute la tradition de la philosophie politique et, dans le cas qui nous
intéresse, la relire à partir de cette découverte que le champ politique peut être abordé par deux
biais. Massivement, il l'est à partir de l'idée de pouvoir ; programmatiquement, il pourrait l'être à
partir de celle d'impouvoir. Il faudra donc, pour que la prise de distance ne soit pas pure et simple
désertion, changement d'idole, faire l'effort de reconstituer le champ politique à partir de cette
dualité. C'est ce à quoi Sartre et Benny Lévy se sont employés à en croire les notes de ce dernier.
Tirons-en une proposition : détruire l'idole du pouvoir, sortir du politique cela aura signifié
pour Benny Lévy, accompagné par Sartre, revenir sur la théorie en en reprenant chacune des
articulations dans un sens nouveau. Pour détruire l'idole du toupolitique, il faudra commencer –
toujours dans l'horizon de la politique et de la révolution – par introduire dans l'épaisseur théorique
des distinctions déstabilisant l'édifice de la théorie. Il faudra donc inventer une nouvelle manière de
se rapporter à la pensée – c'est le rôle, peut-être exorbitant, que Sartre et son interlocuteur
attribuaient au dialogue. En effet, penser et dire ce qu'on pense à l'instant en présence de l'autre,
c'est interdire à la pensée de se figer en théorème. Cette pratique de la pensée implique une critique
de la notion d'auteur liée à l'activité d'écriture dont Sartre avait été le génial praticien, jusque dans
les sinuosités mises en scène de sa propre figure d'écrivain dans Les Mots.
Ce que le travail sur la philosophie politique rend manifeste peu à peu aux yeux de Benny
Lévy, c'est que le pouvoir est une force, un mouvement d'homogénéisation, le lieu de l'unification
11 B. Lévy, Pouvoir et liberté (Cahiers), op. cit., p. 22.
7
des hétérogènes. Soit le problème crucial, depuis Platon au moins, de l'un et du multiple. Le cœur
du problème réside dans la conjonction de coordination. Qu'est-ce à dire ?
Admettons que dans la tradition qui constitue le paysage de la philosophie politique, le lieu
de la pensée de l'un se nomme théologie, et que celui de la pensée du multiple ait pour nom
politique, et disons que le pouvoir est le lieu de confusion des deux questions et des deux domaines.
Attention : le fait que les deux questions soient intimement liées ne fait aucun doute. Ce que
découvre Benny Lévy, c'est que leur confusion interdit de penser sérieusement leur lien, leur
articulation.
Que la théologie soit absolue cela n'étonnera personne. Son objet – l'Absolu – l'y contraint.
Que la politique soit absolue, voilà ce qu'a proclamé la génération de Benny Lévy dans le sillage de
Sartre, et voilà ce qui apparut, pour cette génération au moins, comme l'évidence même. Et si
l'évidence est ce qui, à force de crever les yeux, aveugle, disons qu'avec Sartre, Benny Lévy a
partiellement recouvré la vue, ou plutôt la vision. Examiner l'évidence, ne pas s'y laisser prendre –
geste connu, bien que toujours délicat à accomplir car il y faut la conjonction, rarement réalisée, de
deux qualités précieuses : la simplicité et l'intelligence.
Peut-être est-ce là d'ailleurs le secret du dialogue de Sartre avec Benny Lévy. On conviendra
en effet de l'intelligence des deux hommes. Chez chacun d'eux, mais selon des voies bien
différentes, l'intelligence s'est empêtrée. Il fallait alors la libérer en quelque sorte, la délivrer – de la
satisfaction de l'œuvre accomplie pour Sartre, quasiment momifié de son vivant (et la famille
sartrienne n'est pas pour rien dans cet embaumement prématuré) ; de la possession de la vérité grâce
à la théorie pour Benny Lévy. Comme le disait Lénine, cité au début du Meurtre du Pasteur : « La
théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie. »12
La présence d'une intelligence à l'autre a pour effet de les ramener toutes deux à la simplicité
– c'est du moins le pari de Sartre et Benny Lévy., et c'est peut-être le sens de ce que Socrate dit à
12 B. Lévy, Le Meurtre du Pasteur. Critique de la vision politique du monde, Grasset-Verdier, 2002, p. 13.
8
son interlocuteur à la fin de l'Alcibiade 13.
Revenons à la confusion : le pouvoir produit de l'un au cœur du multiple. Les modalités de
cette production peuvent varier de façon significative – l'un peut être imposé, ou suscité par
exemple mais le fond ne varie pas. Absolu, le pouvoir contraint la multitude à adopter la forme une
de l'un – cela n'est que trop connu. Et c'est bien entendu l'un des aspects de la réflexion commune de
Sartre et Benny Lévy, qui se cristallise autour du phénomène de la dissidence en Europe de l'est.
Penser la révolution contre le totalitarisme soviétique, ou chinois, cambodgien, etc.
Mais, plus loin, les formes politiques qui ne se donnent pas pour absolutistes reproduisent le
même geste : elles recherchent l'homogénéité du corps social. De ce fait, elles exaltent l'un en lui
assignant un lieu. Or l'un - voilà ce que découvre Benny Lévy - n'a pas de lieu (voir la méditation
consacrée à cette « notion » de lieu dans le travail sur les textes de Lévinas). La multiplicité se voit
quant à elle réduite à une pure matière, à une pure résistance à réduire – c'est le rôle du contrat sous
ses différentes formes.
Échec – double échec, faudrait-il dire – de la vision politique du monde : elle ne parvient à
penser ni l'un ni le multiple. Elle échoue, en d'autres termes, à distinguer l'Absolu, D., de la
créature, l'homme. D'où la secrète connivence entre la pensée révolutionnaire et les formes extrêmes
du christianisme :
14 janvier 1978 : « L'idée de la révolution vient de l'hérésie, et celle-ci de la catholicité,
donc en ce sens on peut dire : l'idée de la révolution est chrétienne, rigoureusement. »14
D'où également la réflexion sur la figure du « chef » : Sartre comme chef idéologique,
Benny Lévy comme chef de la Gauche Prolétarienne, Napoléon comme figure du chef absolu
(lecture du Mémorial de Ste Hélène de Las Cases).
Il faut donc dans un premier temps séparer, distinguer. D'où l'opposition, constamment13 Platon, Alcibiade, 132 e : « Eh bien, mon cher Alcibiade, l'âme aussi, si elle veut se connaître elle-même, doit
regarder une âme, et, dans cette âme, la partie où réside la faculté propre à l'âme, l'intelligence, ou encore tel autreobjet qui lui est semblable. »
14 B. Lévy, Pouvoir et liberté (Cahiers), op. cit., p. 127-128.
9
reprise de deux mouvements confondus par le « toupolitique » : le travail de la foule, où s'opère une
certaine conjonction des singularités, la production d'un universel « sauvage » en marge de
l'unification politique ; le travail du pouvoir figeant cet universel en absolu – catholicité du pouvoir.
Ce qui s'annonce c'est une nouvelle pensée de l'universel, à l'écart de la catholicité.
Le Parti, visant la prise du pouvoir, se situe de lui-même dans le camp des grands
unificateurs. A ce titre d'ailleurs, il était déjà critiqué par une certaine pensée de gauche, et en
particulier par le gauchisme, qui lui opposait l'organisation léniniste, inspirée de la faction
révolutionnaire. Spontanéité de la foule révolutionnaire contre la planification du Grand Soir, seul
digne de respect dans l'ordre révolutionnaire des choses – contradiction majeure du Parti
communiste, interdisant les mouvements révolutionnaires au nom de la révolution. Le PCF comme
tenant de la « pensée de la révolution différée »15, face au gauchisme de la Gauche Prolétarienne et
au « sentiment d'imminence » qui le caractérisait. La révolution ne saurait être un mythe, résultat
d'une rupture brisant l'histoire en deux. Si elle doit être, c'est ici et maintenant. D'où l'intérêt de la
théorie des micros pouvoirs de Foucault. À défaut de prendre le pouvoir, on accumulera les petites
prises de pouvoir. La logique gauchiste excluait donc le parti bien que les gauchistes effectifs aient
constamment regardé en sa direction.
De cette logique, Sartre aura bien du mal à s'écarter car il y avait trouvé de quoi nourrir sa
réflexion politique. Ainsi propose-t-il, dans L'Espoir maintenant, de réfléchir sur l'échec de la
gauche dont il attribue précisément la responsabilité au Parti faisant sienne la thèse gauchiste selon
laquelle il conviendrait de revenir en-deçà de la sclérose PCF pour retrouver la fraîcheur de l'esprit
révolutionnaire, tel qu'il fut incarné en vérité par les sans-culottes. La réponse de Benny Lévy est
cinglante :
« Ta charge contre l'idée de parti est très équivoque. On peut parfaitement dire non aux
partis et faire une simple régression, comme celle que tu esquisses […] Tu décris en fait le
mouvement même qui a conduit le gauchisme à sa mort. Il a voulu cela, le gauchisme, il a voulu
15 B. Lévy, « Sartre et le gauchisme », La Cérémonie de la naissance, Verdier, 2005, p. 17.
10
remonter en deçà de l'idée communiste ou stalinienne du parti. Et il l'a voulu en s'appuyant à la fois
sur cet ensemble sentimental du XIX° siècle et sur les courants des oppositions de gauche, très
minoritaires tout au long du XX° siècle. Et, bien sûr, le gauchisme a voulu reprendre la référence
du sans-culottes et de sa radicalité de 1793. Rappelle-toi La Cause du peuple et ses rapports
complices avec Le Père Duchesne. C'est ça qui s'est effondré. La tentative de régression en deçà de
l'idée de parti, par le recours à la scène primitive de 1793, c'est cela même qui est mort. »16
Mais la « régression » de Sartre, si l'on admet l'analyse de Benny Lévy contient également
un élément de nouveauté : si en 1965, Sartre critiquait l'abstraction d'une certaine gauche campant
sur des principes au nom de l'action de la base, il cherche à présent à repenser ce qu'il appelle le
« principe de la gauche » - et ce principe n'est pas – n'est plus ? - la prise du pouvoir, mais la
fraternité. Par ailleurs, Sartre insiste dans les entretiens sur l'élément de radicalité qui lui a toujours
semblé décisif : il ne saurait s'agir pour lui de passer dans le camp des réformistes. D'où la tâche, de
son point de vue : penser la fraternité de façon radicale. Tâche qui le contraint à revenir sur sa
propre pensée, puisque la fraternité se trouve au cœur de son deuxième grand opus philosophique :
la Critique de la Raison dialectique. Il faut, y dit-il en substance et du point de vue qui nous
intéresse, distinguer deux sortes de groupements humains : le « collectif sériel » ou « série » et le
« groupe » à proprement parler. La série est impersonnelle : ceux qui la composent reçoivent leur
être-en-commun de l'extérieur : c'est, par exemple, le cas d'une file d'attente à un arrêt d'autobus.
Ce qui unit les gens qui se trouvent-là n'est autre que l'autobus qu'ils attendent et qui est la forme
matérielle que prend pour eux à ce moment-là la structure même de la société. Rien de positif donc
dans ce groupe, rien de libre, pour le dire dans une autre langue sartrienne.
Qu'en est-il du groupe ? Il surgit certes lui aussi sous la pression de circonstances
extérieures, mais reprises intérieurement sous la forme de la colère par ceux qu'il unit. Pour illustrer
cela Sartre étudie longuement la prise de la Bastille. Dans la chaleur des journées de juillet, le
collectif fusionne : une « personne » apparaît :
16 L'espoir maintenant, op. cit., p. 47-48.
11
« Lorsqu’on trouve des chiffons dans les caisses d’armes promises par Flesselles, la foule se
juge dupée, c’est-à-dire qu’elle intériorise la conduite de Flesselles et la saisit non dans la sérialité
mais contre la sérialité comme une sorte de synthèse passive. En effet, la duperie comme procédé se
place dans le cadre d’une relation antagonistique de réciprocité. En la dupant, Flesselles confère à la
fuite en altérité une sorte d’unité personnelle ; et cette unité personnelle caractérise nécessairement
la réaction de colère qui la traduit et, pour le rassemblement lui-même, la découvre : chacun réagit
d’une nouvelle manière. »17
Le groupe naît donc de cette assomption des circonstances extérieures qui est en même
temps leur incorporation sous une autre forme – transmutation réalisée par la fusion, ou
Apocalypse. Le problème saute aux yeux : le groupe risque de se disloquer dès lors que la pression
des circonstances extérieures, et qui a provoqué la colère, se relâche. Il convient donc de renouveler
la pression, de la transformer en caractéristique du groupe lui-même, d'en faire une sécrétion de la
personne nouvelle. C'est le serment qui joue ce rôle et noue la fraternité à la terreur. Sartre est on ne
peut plus clair sur ce point : l'invention du serment, écrit-il, est « le projet de substituer une peur
réelle, produit du groupe lui-même, à la peur externe qui s'éloigne […] Et cette peur comme libre
produit du groupe […] c'est la Terreur. »18 Quel est le contenu du serment ? « […] je réclame qu'on
me tue si je fais sécession »19. Par celui-ci chacun accepte le « droit absolu de tous sur chacun »20.
Les hommes sont désormais frères dans le groupe en vertu d'une « sollicitude mortelle »21. En clair :
la fraternité peut à tout moment et du fait du serment se transformer en « lynchage et en
extermination »22, revivifiant le « lien pratique d'amour entre les lyncheurs »23.
Il faut, c'est le programme fixé par Sartre dans notre citation, ne rabattre en rien sur la
17 J.-P. Sartre, Critique de la Raison dialectique, 2° édition, Gallimard, 1985, p. 460-461. La description del’Apocalypse par Sartre renvoie, outre les analyses théoriques, à une expérience : celle de la Libération de Paris.Voir les extraits du reportage effectué à la demande de Camus dans Combat, du 28 août au 4 septembre 1944, in : M.Contat, M. Rybalka, Les Écrits de Sartre, op. cit., notamment p. 104 : « Toute la matinée, c’est la colère qui soufflesur la ville. »
18 Ibid., p. 529.19 Ibid., p. 530.20 Ibid., p. 531.21 Ibid., p. 533.22 Ibid., p. 538.23 Ibid., p. 537.
12
radicalité mais en finir cependant avec la fraternité-terreur. D'où la nécessité de déplacer la
radicalité : de l'action à l'intention dira Sartre dans L'Espoir maintenant.
Pour le dire dans les termes de Benny Lévy :
« Il nous faut désormais considérer que cette solution de l’insurgé de 1793, et donc du gauchiste, est unefausse solution. »24
Il y avait certes quelque chose de vrai dans la radicalité de l’intention, dans la découverte de
la fraternité, mais ce quelque chose s'est perdu dans l’action politique qui visait pourtant à
l’éterniser. Il faut donc revenir aux intentions :
« J.-P. S. : « […] très souvent, dans l’Histoire, nous rencontrons des individus ou des groupes sociaux quiparaissent poursuivre la même fin, qui s’unissent, qui disent les mêmes choses, et, petit à petit, on s’aperçoitqu’ils poursuivent des fins très différentes. C’est que les intentions étaient différentes. Elles sont différentesparce que, derrière ce qu’elles paraissent avoir de commun pour les différents groupes, il y a leurs vérités, eton s’aperçoit que c’est une formulation plus ou moins incertaine, qui est commune à tous les groupes, maisnon pas la fin elle-même.
B.L. : C’est très important. Ça veut dire que les conjonctures révolutionnaires, jusqu’à maintenant, ça a étédes malentendus.
J.-P. S. : Très souvent. »25
Sur la base de la fusion originaire – en ce sens qu'elle constitue l'origine du groupe -
s’élevait l’illusion d’une fraternité acquise, d’une fraternité qui ne posait plus problème, qui ne
faisait plus question. Détruire cette illusion, revenir aux intentions, c’est réinterroger le lien qui s’est
manifesté dans la fusion :
« B.L. : […] ce que nous cherchons en essayant de repousser l’idée d’une conjoncture qui soit simplementune conjonction dans l’élément du malentendu […] c’est une conjoncture qui soit réellement uneconjonction des intentions. Autrement dit, être radical, ce serait poursuivre radicalement, jusqu’àl’unification adéquate, le rassemblement des intentions éparses. »26
L’erreur consistait donc dans la formulation approximative de la fin favorisant la confusion
des intentions. Cette confusion se redoublait d’une confusion concernant la pensée de l’application
24 L’Espoir maintenant, op. cit., p. 52.25 Ibid., p. 50-51.26 Id.
13
des moyens. Pour sortir de cette confusion, il s'imposait dès lors de repenser fin et moyen
radicalement. Dès 1975, en effet, le problème essentiel qui apparaît dans les notes de Benny Lévy
est le suivant : le champ politique, dont la révolution est le condensé, le point d’incandescente
intensité, s’est révélé être le lieu d’un renversement totalitaire qu’il s’agit de penser. Ce
renversement est lié au désir de pouvoir ou, mieux, au « travail du pouvoir » initié par le
phénomène révolutionnaire ou insurrectionnel.
Il faut par conséquent souligner une césure dans le champ politique, autour de la notion de
pouvoir. C’est le sens de l'annotation du 13 décembre 1975 que j'ai déjà citée. J'ai dit qu'alors, en
1975, Benny Lévy prenait encore appui sur la figure des sans-culottes :
« Les sans-culottes, dans leur désir, ont imaginé un législatif de démocratie directe. Une assembléelégislative nationale PRÉSENTE, indique, propose. Les assemblées primaires décident. Le statut del’exécutif échappe à cette idée. “S’il était permis aux sections de divaguer ainsi, il n’y aurait plus rien destable dans la République” (Soboul, p. 528) Schème mouvant/stable. Schème décisif. Pour nous : commentest-il possible de penser une instabilité discrète ? »27
Comme l’indique cette note, Sartre et Benny Lévy lisaient en 1975 le livre d’Albert Soboul,
Les sans-culottes parisiens en l’An II, auquel les notes de Benny Lévy font très souvent référence.
En voici quelques passages qui explicitent l’annotation que je viens de lire :
« L’exercice de la souveraineté populaire ne saurait souffrir de restriction : les sans-culottes entendent enjouir dans sa totalité et dans tous les domaines […] Le 2 novembre 1772, l’assemblée générale des Piquesadoptait […] un projet “sur le mode de la sanction des lois” : la souveraineté étant inaliénable, “nous devonsseuls dicter nos lois, leur unique besogne [des représentants] est de nous en proposer”. »28
La radicalité sans-culotte repose sur un déplacement du lieu du pouvoir. Le pouvoir législatif
n’appartient pas en vérité à une institution, mais au pouvoir instituant lui-même, qui est celui du
peuple assemblé. C’est le principe de la démocratie directe, revendiqué par les maoïstes de la
27 LÉVY, B., Pouvoir et liberté (cahiers), op. cit., p. 22-23, 13 décembre 1975. Voici le contexte de la citation du livred’A. Soboul, dont nous utilisons la version abrégée, publiée en 1968 au Seuil : « Le Conseil général de la Communeagita, le 23 août 1793, la question de savoir si un commissaire pouvait être révoqué par la section qui l’avait nommé,et finit par se prononcer par la négative : “s’il était permis aux sections de divaguer ainsi, il n’y aurait plus rien destable dans la République” » (p. 119).
28 SOBOUL, Albert Les sans-culottes, Seuil, 1968, p. 102-104.
14
Gauche Prolétarienne aussi bien que par Sartre29. En effet, le lieu du problème, c’est le pouvoir qui
produit une sclérose, un arrêt du mouvement révolutionnaire dont il est cependant issu. Autrement
dit : constamment, la Révolution menace de se figer :
« La révolution est glacée. Concept de “moment glaciaire de la révolution” : moment où le pouvoir seretourne contre son origine. Exemple : répression de Germinal An II ou bien Cronstadt. Conséquence : lepouvoir se transforme : son côté “sommet tournant” disparaît. L’institution fondante se fige : c’est cela, laglaciation. »30
En termes de philosophie politique, cela signifie qu’il faut reprendre l’analyse de
l’institution (au sens actif) de l’État, afin d’y surprendre le moment de glaciation de l’intuition vive
de l’insurrection. À partir de juillet 1976, Sartre et Benny Lévy entreprennent à cet effet la relecture
systématique de Hobbes, de Locke et de Rousseau, la théorie du contrat étant considérée comme
l’un des avatars de cette glaciation de la révolution. La lecture du Léviathan permet la formulation
de l’hypothèse suivante : « le lieu du pouvoir serait une “contre-foule” »31 se constituant à partir de
la fusion32, qui dissout l’hétérogénéité de la foule insurrectionnelle en la ressaisissant dans l’élément
de l’homogène33 (le pouvoir, comme principe d’unification). L’effet de cette fusion n’est autre que
la constitution d’un « Grand Sujet », dont le modèle est le souverain hobbien, défini ainsi par
Hobbes dans les premières pages du Léviathan : « […] un homme artificiel, quoique d’une stature
et d’une force plus grandes que celle de l’homme naturel »34. La souveraineté repose chez Hobbes
29 Cf. par exemple, On a raison de se révolter, op. cit., p. 75 : « C’est votre conception de la démocratie directe qui meparaît le lien essentiel entre vous et moi. Parce que, finalement, c’est à établir cette démocratie que doit tendre unécrivain qui comprend un peu le sens de son métier. »
30 LÉVY, B., Pouvoir et liberté (cahiers), op. cit., p. 32, 5 janvier 1976. Dans un texte intitulé « Apocalypse », publiéen 1979, « P. Victor » reprendra cette expression, venue de Saint-Just (« Institutions républicaines », in : Œuvrescomplètes, Gallimard, 2004, p. 1141) de glaciation de la révolution. Cf. Cahier NL1, Fondation Benny Lévy, p.R11 : dans ce cahier de notes de lecture, B. Lévy recopie la phrase suivante, citée par Daniel Guérin, La lutte declasses sous la première République. 1793-1797, Gallimard, 1968, p. 101 : « La démocratie, si elle n’est pasimmobilisée comme un bloc de glace, si elle reste à l’état fluide et mouvant, ne peut pas ne pas aboutir à l’égalité defait ». Sartre avait lu le livre de Guérin depuis longtemps, comme en témoignent les pages qu’il lui consacre dans lesQuestions de méthode. Cf. J.-P. Sartre, Critique de la Raison dialectique, op. cit., p. 41, note 1.
31 Pouvoir et liberté (cahiers), op. cit., p. 55, 17 juillet 1976.32 En janvier 1977, la lecture du Mémorial de Sainte-Hélène produira des analyses similaires à propos de Napoléon :
« Le pouvoir de type napoléonien conjoint, fusionne les contraires (Napoléon fait du principe de l’amalgame leprincipe clé de son système). Autrement dit, il y a dans l’idée de synthèse (léguée par la dialectique) une logique depouvoir. Notre problème : tenir compte du conflit, de l’ambiguïté, sans la synthèse et sa logique clandestine depouvoir. »
33 Les notions d’homogénéité et d’hétérogénéité sont vraisemblablement inspirées à B. Lévy par la lecture de Bataille.Cf. notamment BATAILLE, Georges, « La structure psychologique du fascisme », dans Œuvres complètes, t. 1,Gallimard, 1970, p. 339-371.
34 HOBBES, Thomas, Léviathan, Sirey, 1971, p. 5.
15
sur une théorie de la représentation : c’est en effet dans la personne du représentant que la
multitude des hommes est faite une35. Ainsi le pouvoir repose-t-il sur le glissement des petits sujets
multiples au Grand Sujet36 leur imposant, tel un sceau, l’unité.
Il convient donc de distinguer radicalement, contrairement à ce que fait Locke par
exemple37, ce qui, dans l’événement comme dans la pensée révolutionnaires, relève de la logique
des petits sujets et ce qui relève de celle du Grand Sujet38 :
« Souligner l’importance que revêt le petit sujet pour démasquer le Grand Sujet : le roi est nu. Déterrer lepetit sujet à la place du Grand Sujet = rôle révolutionnaire de la subjectivité (la petite) pour faire craquer lediscours du Maître. Continuons : le travail propre de la fusion des hétérogènes, générateur de la puissance,consiste dans la production d’un “universel sauvage”, c’est-à-dire un universel qui ne se conforme pas à laNorme (universel du pouvoir). »39
Ainsi donc, tracer la ligne de démarcation entre le double travail qui s’effectue dans la
révolution revient à mettre en cause l’universel lui-même et à envisager une pensée de l’universel
qui le lie à la subjectivité ou à la singularité. Dans le champ politique, le seul lieu de cet universel à
l’écart du pouvoir, c’est la démocratie40. On saisit ainsi le mouvement esquissé par Sartre dans
L’Espoir maintenant. La démocratie y est le nom politique de cet universel à repenser. Ce que je
voudrais montrer, c’est que le dialogue de Sartre et de Benny Lévy fait signe, mystérieusement,
confusément vers autre chose, vers une pensée non politique de l’universalité. Dans les notes
35 Ibid., p. 166, note 45 : « A Multitude of men, are made One Person, when they are by one man or one Person,Represented. » Au fond Sartre restait proche de cette position lors de son compagnonnage de route avec lescommunistes, à la substitution du Parti à l’État près. Voir « Les communistes et la paix », art. cit., p. 248-249 : « […]le Parti, d’où qu’il vienne, tire sa légitimité de ce qu’il répond d’abord à un besoin. Sans lui, pas d’unité, pasd’action, pas de classe […] En un mot le Parti est le mouvement même qui unit les ouvriers en les entraînant vers laprise du pouvoir. Comment voulez-vous donc que la classe ouvrière désavoue le P.C. ? Il est vrai qu’il n’est rien endehors d’elle; mais qu’il disparaisse, elle retombe en poussière. »
36 Pouvoir et liberté (cahiers), op. cit., p. 68, 4 novembre 1976 : « Persona : concentration unitaire (cogito impérial).Grand Sujet. Insurrection : multiplicité de petits “sujets”. Dispersion du sujet. »
37 Cf. Ib., p. 60, 31 juillet 1976 : « La faiblesse de cette théorie [celle de Locke], la voici : elle réduit à un acte, et uncommencement : le travail de la foule (travail de révolution, de conjonction de puissance) et le travail du pouvoir. »
38 Cf. Ib., p. 69, 7 décembre 1976 : « Distinguer la logique de s et de S. S : Sujet de droit, l’Ego, la persona, le Chef, leSalaud, le sujet grammatical ; s : sujet comme être diasporique. Irrécusable point de départ insurrectionnel. Seloncette hypothèse, il faudrait creuser ontologiquement la différence s≠S ; de là naîtrait la forme conflictuellefondamentale en histoire : Rebelle≠Pouvoir. Si cette hypothèse est vraie, alors la Critique de la Raison dialectiquerecèle à la base une erreur : elle part de l’individu qui est un mixte s/S […] Rectifier l’erreur : - distinguer s et S ; -de s établir le développement des formes de l’insurrection comme puissance de désintégration. ». Le 8 janvier 1977(op. cit., p. 81), on trouve ce parallèle au sujet de la conscience : « […] il faut penser la conscience comme milieu,puissance de désagrégation du monde. ». - ce que B. Lévy appelle à cette époque le caractère insurrectionnel ducogito.
39 Ib., p. 57, 17 juillet 1976.40 Ib., 100, 16 mai 1977. Voir aussi L’Espoir maintenant, op. cit., p. 53.
16
personnelles de Benny Lévy, ce mouvement apparaît nettement durant l’année 1978 : en effet, petit
à petit s’impose la distinction du faire politique, apocalyptique, et du faire prophétique41, dont on
retrouve la trace dans L’Espoir maintenant.
Factuellement, deux événements ont fait l’objet d’analyses permettant d’espérer une telle
pensée de la « démocratie » : Lip, d’une part entre 1973 et 1976, et, de l’autre, vers 1977, la
dissidence politique en Europe de l’est. Ces deux événements sont accueillis par Benny Lévy, et par
Sartre dans une moindre mesure, comme des appels à une nouvelle pensée du politique.
L’expérience de Lip, comprise comme la tentative de mise en œuvre d’une vie politique
déconnectée du pouvoir, et échappant de ce fait au schéma léniniste, a partie liée avec la
problématique qui a mené à la dissolution de la Gauche Prolétarienne. Ce que Lip a montré aux
dirigeants de la Gauche Prolétarienne c’est, selon Benny Lévy, que la radicalité pouvait s’exprimer
hors du pouvoir d’État autrement que par la violence terroriste. Il faut ici rappeler que le seul
exemple de groupe échappant à la sclérose bureaucratique, qui s’achève en culte de la personnalité,
comme à la rechute dans la sérialité, donné par Sartre dans la Critique de la Raison dialectique, est
« une très petite “unité de combat” dont tous les membres vivent et luttent ensemble. »42
« […] on a trouvé dans l’événement social qu’était Lip la preuve que ça pouvait se révolutionner en dehorsde nos schémas. Je pense qu’on a quand même eu la lucidité d’en prendre acte. On disait très clairement àl’époque : avec Lip – qui s’épanouit en 1973 – grosso modo on a fini notre boulot. Cela nous permettait desortir en beauté. Et c’est important parce que la sortie contraire, la sortie en laideur, c’était la sortieterroriste. »43
Sortie du « toupolitique », grâce à un événement inattendu depuis la vigie théorique
gauchiste, censée anticiper les mouvements sociaux appréhendés à partir d’une théorie que l’on
avait cru avoir dépassé44. La réflexion autour de l’événement Lip s’étale de 1973 à 1977, date de
41 Ib., p. 136, 29 avril 1978.42 Critique de la Raison dialectique, op. cit., p. 362.43 « Arguments », émission du 16-03-1986 sur Radio-Trois (Bruxelles).44 Cf. On a raison de se révolter, op. cit., p. 244 : « Le phénomène qui me frappe le plus, c’est comment la théorie de la
révolution, la théorie dominante, implicite disons, dans tous les esprits, est profondément bousculée par l’événementLip. Je pense que l’événement Lip remet en question tout le système de concepts traditionnels de la théoriegauchiste ; ce système, c’est : luttes revendicatives, accumulation de luttes revendicatives, qui se terminent, selon lalogique syndicale, par un compromis, puisqu’il faut tenir compte du rapport de forces et, à un moment, à partir d’unconcours de circonstances [on se souvient de l’importance des « circonstances » dans l’événement de la fusion telque le décrivait Sartre dans la Critique de la Raison dialectique – nda], de tout ce qui a été accumulé comme
17
publication d’un entretien avec Jean Raguenès et Denis Clodic dans Les Temps Modernes, suivi
d’un bref texte de « Pierre Victor », intitulé « Lip acéphale », qui tente de formuler, après coup, le
sens de l’événement. Durant cette période, plusieurs textes publiés dans les Temps Modernes ainsi
que dans On a raison de se révolter, reviennent sur Lip. La constante de ces textes est de lire
« l’événement Lip » comme signifiant la fin du discours gauchiste45. Ce qui s’instaure à Lip c’est
une « communauté », lieu d’une action collective non sérielle, mais dont le caractère fusionnel
n’implique ni violence ni visée du pouvoir :
« Une figure d’action de la multiplicité s’ébauche : unité ouverte (et circulante), morale (et colorée),dynamisé (et exubérante), bref une union communielle. À Lip, on dit : communauté. »46
Le propre de cette union communielle serait d’ignorer la statolâtrie, autrement dit de ne pas
impliquer la réduction homogénéisante qui toujours pervertit la fraternité initiale des insurgés. Ainsi
donc, Lip est, aux yeux de Benny Lévy à ce moment-là, l’anti-Léviathan47. L’événement Lip frappe
la théorie politique à la tête, au lieu même de la centralisation totalisante. Il met, ce faisant, en
question le discours gauchiste parce que, plus généralement, il oppose un démenti à la philosophie
politique comme telle, en pensant une « totalité acéphale », à l’écart de « la politique comme
gestion centralisée du rapport de forces. »48 Ainsi c’est la nécessité de la persona, comme
représentant du souverain qui s’estompe :
« Lip a perdu la tête. Nous entendons ici qu’à Lip une pensée décapitée s’esquisse : une logiquecommunautaire s’affirme subtilement contre la pensée qui remonte à la tête comme au centre, à l’Étatcomme au grand sujet de l’action sociale. Pensée que nous nommerons statolâtrie. Soit une usine liquidéepar le patron ; que dit tout de suite le statolâtre ? Nationalisation. Nationaliser, c’est signer un décret. Quisigne ? L’État en personne, c’est-à-dire la personne à la tête de l’État. Voici ce que fait en permanence lestatolâtre : réduire l’action d’une multiplicité d’hommes à celle d’une seule personne. »49
combativité par les luttes revendicatives, il y a une situation de crise révolutionnaire ; ça se traduit dans un payscomme la France par un mouvement de grève générale : la question du pouvoir central est posée. »
45 On a raison de se révolter, op. cit., p. 246 : « […] je vois dans l’événement Lip l’agonie d’un discoursrévolutionnaire qui bon an, mal an, s’en était tiré de Mai 1968. S’il s’en est tiré, de Mai 1968, ce n’est pas un hasard.C’est que Mai 1968 a été à la fois une révolution moderne et une révolution ancienne. »
46 « Lip acéphale », in : Les Temps Modernes, n° 367, février 1977, p. 1269 47 Ib., p. 1264 : « Le premier principe de la communauté consiste à frapper de nullité le raisonnement de base du
Léviathan : la logique de la communauté suspend l’État pour concevoir l’action comme action de la multiplicité. » 48 « Lip acéphale », art. cit., p. 1267.49 Ib., p. 1263-1264.
18
Ce que Lip signifie, c’est que « la révolution n’est pas politique »50, qu’elle ne saurait
prendre sens que dans un « espace métapolitique »51 - celui de la communauté, d’une communauté
fraternelle non politique. L’entretien avec Jean Raguenés, qui introduit « Lip acéphale », ne laisse
aucun doute sur l’espace métaphysique dans lequel s’inscrit cette « union communielle » :
« Lip, il est vrai, est communauté très chrétienne. »52
D'où la question qu'on ne peut pas ne pas poser : sort-on du politique vers le religieux ? Ce
serait aller beaucoup trop vite. Ce qui se passe au fond c'est le retour du politique à sa source
métaphysique, puisque, après tout, le travail sur la révolution mené conjointement par Sartre et
Benny Lévy leur avait également montré qu’au fond la révolution est chrétienne, je l'ai dit.
Ainsi donc, la communauté vécue de Lip ne saurait constituer le dernier mot de la « critique
de la vision politique ». À l'occasion du Cercle socratique, Benny Lévy souligne que penser la
communauté d'un point de vue métaphysique implique de se poser la question de l'identité ultime de
l'Occident, de sa détermination chrétienne.
Cette interrogation sur l’être-chrétien53 de l’Occident, sur son être métaphysique, en appelle
une autre, que Benny Lévy qualifie alors de « vieille question interne à l’Occident », et qui est celle
de la judéité. Reconnaissant à l'occasion de la crise du « toupolitique » la vérité de la communauté
chrétienne, Benny Lévy s’en écarte du même coup54, et entrevoit un autre espace…
En 1977, les articles publiés dans Les Temps Modernes abordent le phénomène de la
dissidence politique à la lumière de ce que Mai 1968 permet, selon, lui de penser :
50 Ib., p. 1267. Je souligne.51 Idem.52 Idem.53 Les cahiers de Benny Lévy révèlent qu’en 1978, Sartre et son interlocuteur ont lu le livre de Hans Küng, intitulé
Être chrétien (Seuil, 1978). Cf. Pouvoir et liberté, op. cit., 25 octobre (p. 141) et 4 novembre 1978 (p. 145).54 Voir l'analyse de J.-C. Milner (L'Arrogance du présent. Regards sur une décennie, 1965-1975, Grasset, 2009, p. 137-
138) sur Lip : « À Lip, les portes s'ouvrirent, comme autrefois, selon les Évangiles, un certain tombeau. Mai, lagauchisme et l'usine étaient enfin unis, dans la paix et le concert des bonnes volontés. Mais ce retour miraculeuxannonçait aussi la fin d'une séquence. La Gauche Prolétarienne ne servait plus à rien. Le christianisme sociall'emportait sur toute la ligne. Le maoïsme avait été vaincu par le Galiléen. Le règne de l'Esprit saint pouvaitcommencer. »
19
« Voici des textes rigoureusement politiques dont le propos central est : ne pas prendre le pouvoir. Voici unequestion neuve : comment se déprendre du pouvoir ?
Le 24 mai 1968 en France, les manifestants, longeant les ministères, n’y firent pas même attention. Cettevacuité de la question du pouvoir fit illusion : on parla de vacance du pouvoir. Cette équivoque persisteencore, paralysant la pensée politique : Mai 68 immature ? infrapolitique ? puisque “la questionfondamentale de toute révolution : le pouvoir” (Lénine) n’a pas été posée ? Ou bien au contraire Mai 68commençant de poser une question neuve, celle qu’articulent aujourd’hui les dissidents de l’Europe de l’Est :comment penser une politique dont la référence essentielle ne soit pas le pouvoir ? »55
Nous le savons, tout le problème est de sortir de la torsion que le travail du pouvoir,
l’unification impose à l’élan fraternel du travail de la foule. Confrontés au pouvoir du Parti, les
dissidents sont contraints d’inventer une forme nouvelle – celle-là même qu’il fut, selon Sartre et
Benny Lévy, possible d’entr’apercevoir en mai 1968 :
« Quel est pour nous le principal problème tactique du mouvement issu de Mai ? Trouver une formed’association qui ne ressemble pas à la forme étatique à laquelle on s’oppose. Trouver une manière d’agir quine soit pas une réplique de l’action de l’Autre : ils sont organisés, alors je m’organise, centralisés, alors je mecentralise. Inventer donc un style irrégulier qui rompe avec cette redoutable symétrie. Depuis la Conspirationde Babeuf jusqu’à notre gauchisme, nous avons buté sur ce problème. À l’Est, comment s’y prennent-ils ? »56
L’interview de Jacek Kuron, publiée en juin 1977 par Les Temps Modernes offre un début de
réponse à la question que se pose Benny Lévy. Elle témoigne d'une forme inédite d’opposition
consistant en somme à accomplir une action civique en dehors du pouvoir, à agir non pas contre le
pouvoir, mais comme s'il n'existait pas, à refuser de lui donner une consistance. Conséquence :
« La vision sociale se modifie : l’antique analogie de la société et de l’homme, l’idée de la société comme“corps social” sont écartées. Depuis le 21 janvier 1793, on a surtout cru qu’il fallait couper la tête, royale, ducorps social. Erreur : c’est le corps qui est royal ; il faut se débarrasser du “corps social”. La tête repoussecomme le chiendent… »57
Ainsi donc, c’est à nouveau le Léviathan de Hobbes (et sa théorie de la représentation), qui
est entamé par l’action des dissidents. Celle-ci invalide en effet l’analogie du corps politique et du
corps individuel, elle désarme le pouvoir de la tête en libérant la multiplicité jusque là « partout
55 « Pierre Victor », « Présentation », Les Temps modernes, n° 372, 1977, p. 2157.56 « Pierre Victor », « À l’est rien de nouveau », Les Temps modernes, n° 369, 1977, p. 1736.57 « Pierre Victor », « Présentation », art. cit., p. 2158.
20
pénétré[e] de l’âme du Chef. »58 Elle engage – et c’est en cela que réside sa radicalité – à renoncer à
toutes les formes de résurrection de la tête, c’est-à-dire non seulement au Parti hégémonique, mais
aussi, plus profondément, à l’idée même d’organisation :
« […] le point de vue organisationnel lui-même, comme réduction à l’activité de l’Un de l’action multiple,ce point de vue est désormais à dissoudre. »59
Le « toupolitique » est clairement rejeté comme une « illusion »60, comme statolâtrie61. Il
restera à Benny Lévy à revenir sur la guérilla imaginaire qui constituait en un sens le cœur du
gauchisme. Il le fait cette même année dans un texte consacré au Cambodge, à l’occasion de la
parution de deux livres qu’il commente dans un article intitulé « Page blanche »62. Il y montre
comment ce qui se passe à l’époque au Cambodge est au fond l’ultime avatar d’une logique, d’une
vision du monde trouvant son origine dans la pensée révolutionnaire du XVIII° siècle :
« Dissoudre le guérillero brandissant le fusil ; retenir juste le fond : un peuple secret et irréductible. Oublierune certaine idée de la radicalité, se dégager de cette tradition que Sylvain Maréchal résume en une prophétieaujourd’hui lugubre : “Nous consentirons à tout [pour l’égalité], à FAIRE TABLE RASE POUR NOUS ENTENIR À ELLE SEULE. Périssent, s’il le faut, tous les arts, pourvu qu’il nous reste l’égalité réelle” »63
Ce peuple « secret et irréductible », Benny Lévy l’entendait dans l’horizon politique, grâce
aux Dissidents, soudés par le « cogito insurrectionnel »64, principe du pluralisme opposé au
totalitarisme65. En deçà de la volonté de « sauver » la vérité de l’insurrection pointait déjà
cependant, dans la confusion, quelque chose d’autre, qui allait se révéler peu à peu :
« L’alternative dans sa forme ultime : secret d’État ou secret de la personne. De sa correspondance, de sa vieprivée. Plus fondamentalement : de la personne dans son secret. Tout juif soviétique qui refuse de devenir“juif d’État” se découvre un secret bouleversant : une histoire obscure qui le rattache au lieu symbolique “dela terre des ancêtres”. Ce lieu n’est pas fait de savoir, pas même de croyance le plus souvent. Résister aupouvoir, affirmer sa “liberté intérieure”, c’est naturellement publier ce secret. Moi, ici, qui suis juif et fusréfugié, moi qui suis resté presque sourd à cette expérience, cela me brûle. »66
58 « Pierre Victor », « De la libre circulation des biens et des personnes », Les Temps modernes, n° 371, 1977, p. 2123.59 Ibid., p. 2127.60 « À l’Est rien de nouveau », art. cit., p. 1739.61 Id., p. 1737.62 « Pierre Victor », « Page blanche », Les Temps Modernes, n° 370, 1977, p. 1928-1936.63 Ibid., p. 1936.64 « À l’Est rien de nouveau », art. cit., p. 1738.65 « De la libre circulation des biens et des personnes », art. cit., p. 2120.66 Ibid., p. 2129-2130.
21
En janvier 1978, Benny Lévy publiait dans Les Temps Modernes un article intitulé « Ce
jour-là » en réaction au voyage d’Anouar el-Sadate à Jérusalem, le 19 novembre 1977. Il interprétait
cet événement, surprenant à bien des égards, notamment pour la gauche progressiste, comme
manifestation de la dimension « métapolitique », ou « éthique » (ceci est écrit à une époque où le
mot d' « éthique » ne constituait pas encore un obstacle à la pensée), nécessaire au renouvellement
de la pensée « politique ». Il cite dans cet article (pour la première fois, à ma connaissance) les
Quatre lectures talmudiques d’Emmanuel Lévinas. Dix-huit mois plus tard, Lévinas lui-même
publia dans les mêmes Temps Modernes un texte consacré au même voyage67 dont la conclusion
consonne absolument avec celle de Benny Lévy :
« Nous l’avons dit, le voyage de Sadate a ouvert l’unique voie de la paix au Proche-Orient, si cette paix doitêtre possible : ce qui est “politiquement” faible en elle est probablement l’expression de ce qu’elle ad’audacieux et, en fin de compte, de fort. Et peut-être ce que, partout et pour tous, elle apporte à l’idée mêmede paix : la suggestion que la paix est un concept qui déborde la pensée purement politique. »68
Dans l’espace politique, il semble impossible de penser la fraternité sans la violence, car,
dans cet espace la fraternité est une notion mythique. Ce que révèle en toute clarté le langage de
Sartre dans la Critique de la Raison dialectique : dans l’Apocalypse, les frères s’auto-engendrent.
Cela signifie qu’ils sont aussi leurs propres pères. La confusion entraîne la violence, en ce sens que
cette fraternité politique sera sans cesse tentée de se fonder en s’opposant à la fraternité réelle – car
il y a un réel de la fraternité qui toujours rappellera à la fraternité politique son caractère
problématique, louche, trouble. Entre parenthèses, et puisque j'ai parlé de Lévinas, j'attire votre
attention sur une lecture basse possible de ce que dit Lévinas et qu'a dit aussi peu ou prou Benny
Lévy pour la récuser immédiatement. Ne pas lire le rejet de la vision politique du monde comme
dépassement du politique par l'éthique, car au fond, la fraternité éthique n'est en rien moins
imaginaire que la fraternité politique. Pour une lecture haute, lire et étudier ce que Lévinas a écrit de
la fraternité dans Totalité et Infini surtout.
67 LÉVINAS, E., « Politique, après ! », repris dans L’au-delà du verset, Minuit, 1982, p. 221-228.68 Ibid., p. 228.
22
On peut, bien entendu, concevoir une politique qui fasse l’économie de la référence à la
fraternité : elle devra renoncer à toute radicalité politique, c’est-à-dire qu'elle devra considérer que
le politique ne dit pas la vérité de l’existence, qu'il est affaire de gestion.
Quant à celui qui ne se contenterait pas d’un tel abandon de la radicalité, la voie lui est
indiquée : c’est hors de l’espace politique qu’il devra en faire l’épreuve.
Pas de côté, disions-nous. Et pas à deux. Et bien qu'effectué ensemble, le pas n'alla pas
exactement du même côté, finalement. Sartre sommé à nouveau de tout repenser, se donnait le
programme de revivifier la révolution grâce au messianisme juif69, soit de trouver un terrain
commun à l'homme de gauche et à l'homme juif. La réponse de Benny Lévy à ce programme
montre son scepticisme :
« N'oublie pas que le juif a une longue expérience des faux messianismes : la conjonction de l'homme juif etde l'homme de gauche, même en supposant la redéfinition de ce dernier, ne va certes pas de soi. »
Dans un exposé du Cercle socratique, Benny Lévy a développé cette difficulté. Qu'est-ce qui
a caractérisé l'intellectuel de gauche depuis la seconde guerre mondiale ? La tentative de « trouver
un “lieu” d'où critiquer, c'est-à-dire sortir de l'occident ». Côté noble de l'intellectuel de gauche, qui
peut certes constituer une base commune avec le juif se retrouvant. Cette tentative de sortie a fait
feu de tout bois, déclare Benny Lévy :
« […] le damné de la terre, le colonisé, le prolétaire, c'étaient autant de tentatives – il y a même eu celle dechercher dans le “fou” [allusion à la schizo-analyse de Deleuze et Guattari] cette sortie de l'occident. »70
Ce qui se découvre alors, c'est que l'homme de gauche est en termes métaphysiques celui qui
parle au nom de et bientôt celui qui parle à la place de… à la place du damné de la terre, à la place
du colonisé, du prolétaire, du fou… aujourd’hui, comme Foucault à l'époque de la révolution
69 Cf. L'Espoir maintenant, op. cit., p. 78-79.70 Archives de la Fondation Benny Lévy.
23
islamique, à la place des Iraniens.
Une autre voie se dessine donc pour Benny Lévy, qui le mène d'un autre côté, sur une autre
scène. Sur celle-ci (au-delà ? en deçà ?) il a poursuivi à sa façon le travail entamé avec Sartre. En
2002, installé à Jérusalem, il publie Le Meurtre du Pasteur, dont le sous-titre est le suivant : Critique
de la vision politique du monde. D'aucun, empêtrés dans cette vision du monde, liront ce sous-titre
comme un aveu : Benny Lévy aurait changé de camp. Il suffit pour tenir cette position de ne pas lire
son livre, de rester dans la plus lourde ignorance.
Un mot, sinon pour dissiper l'ignorance (il faudrait étudier l'intégralité du livre), du moins
pour en faire entendre l'indignité, et peut-être donner envie d'en sortir. Dans Le Meurtre du Pasteur,
Benny Lévy s'interroge, textes à l'appui (ceux de Hobbes encore et de Spinoza surtout sur cette
question), sur ce qui bien que structurant toute la philosophie politique, y est comme refoulé. Bref,
il revient sur la confusion des questions de l'un et du multiple depuis un autre horizon que l'horizon
politique. Au récit mythologique fondant la puissance souveraine, le pouvoir – car tout récit
mythologique vise au fond la légitimation d'un pouvoir – se substitue le récit prophétique du Sinaï,
lu avec Maïmonide. C'est à partir de ce récit que Benny Lévy travaillera à élucider la
« métaphysique de la parole » dont la formule lui était venue à la fin des années 70.
Je voudrais pour finir vous faire entendre simplement quelques mots de ce texte qui posent
une alternative radicale. Il s'y agit non pas d'aller au-delà du politique mais de revenir en-deçà –
mais d'un retour qui ne soit pas régression :
« Si on n'entend plus la prophétie, on n'entend que les voix de la vision politique du monde ; si on s'écarte dela vision politique du monde, de la figure du politique absolu, alors on peut réentendre ces voix, car ces voixsont inscrites pour toutes les générations. Le Sinaï est une scène qui n'a rien d' « historique ». Elle institueIsraël pour toujours. Chaque Israël fait cette expérience des voix – éveillées par l'étude ou mortes sous lesdécombres. »71
L'égalité de chacun implique ici la hauteur de l'enseignement. Chacun a entendu la voix
selon sa propre puissance. Seul Moïse, le maître, a su articuler clairement la voix (kol) en paroles
71 B. Lévy, Le Meurtre du Pasteur, op. cit., p. 250.
24
(dibourim). Or la philosophie politique a voulu voir en Moïse la figure du pouvoir, de la maîtrise
comme pouvoir :
« Le politique absolu s'érige sur la forclusion du Maître. On ne connaît plus que le maître politique. À partirde là tout est possible. »72
Tout, c'est ici le pire. La vision politique dans son déchaînement totalitaire.
Retour donc à Moïse, retour à l'enseignement, seul capable d'articuler la voix en paroles.
Retour à l'étude, aux textes juifs. Mais en quoi ces textes concernent-ils tout homme ? Benny Lévy
aurait-il oublié son problème de départ : celui du tous ? Mais qui a dit que la voix ne parlât qu'aux
600 000 ? Le Talmud enseigne que toutes les générations étaient présentes au Sinaï, que tout juif s'y
trouve. Un Midrach rapporté par Benny Lévy raconte que toutes les nations ont entendu la voix du
Sinaï : nouvelle manière de poser la question de l'un – Israël, nation une – et du multiple : les
soixante-dix nations.
Il y a là quelque chose à penser, hors du champ politique, quelque chose à comprendre
patiemment – mais encore une fois non sans ardeur. On peut certes préférer continuer à vénérer
l'idole du pouvoir. Le prix est le suivant : ce qui une fois a eu lieu dans un certain tragique –
illusoire, vraisemblablement – ne se répète que comme farce : à l'illusion d'imminence de la Gauche
Prolétarienne, se substitue l'illusion d'imminence de l'élection d'un président américain, par
exemple, pour ne rien dire de ce qui se passe chez nous.
72 Ibid., p. 251.
25