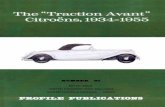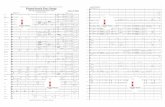Visionary Film: The American Avant-Garde 1943–2000, Third ...
Le pacifisme de Jaurès et les faux-semblants du bellicisme militaire en France avant 1914
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Le pacifisme de Jaurès et les faux-semblants du bellicisme militaire en France avant 1914
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
Le pacifisme de Jaurès et les faux-semblants du bellicisme
militaire en France avant 19141.
OLIVIER COSSON
La question du pacifisme est de celles qu’un spécialiste
de l’armée rencontre bien peu souvent. Or, Jaurès et d’abord
son Armée nouvelle2, ouverte comme lui aux enjeux militaires de la
Belle Époque, semblent montrer à eux seuls que c’est un tort.
Car l’étude du phénomène guerrier, un champ déterminant
profondément notre compréhension du militaire, a beaucoup à
voir avec le temps de paix et surtout avec ceux qui se
consacrent à sa fragilité et au basculement possible dans le
temps de guerre.
En ce sens, le pacifisme occidental du début du XXe siècle
constitue certes un mouvement de pensée et d’action (qui se
structure tant bien que mal) mais on le considérera ici comme
un champ intellectuel précieux pour la compréhension d’un
siècle marqué, quelle qu’en soit la manière, par le Premier
Conflit mondial.
1 On s’inspire ici d’un titre de William Serman, « Les faux-semblants del’apolitisme militaire », voir William Serman, Les officiers français dans la nation,1848-1914, Paris, Aubier Montaigne, 1982, p. 65.2 Voir sa réédition récente : Jean Jaurès, L'Armée nouvelle, éd. établie parJ.-J. Becker, Œuvres de Jean Jaurès, t. 13, Paris, Fayard, 2013 et lesactes du colloque qui fut consacré à son centenaire, « Lire l’Arméenouvelle », Cahiers Jaurès, n° 207-208, janvier-juin 2013.
1
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
Interroger la guerre depuis le temps de paix, c’est donner
forme à la guerre future. En œuvrant pour l’éviter, on
l’imagine, on lui donne un visage, on jauge les potentialités
du temps face à la violence et à la mort. En la préparant au
contraire, ce que font constamment les militaires, en
envisageant qu’elle ait lieu et interrompe la durée du temps
de paix, on façonne la réalité technologique, humaine et
finalement culturelle du champ de bataille futur, on détermine
le cadre de l’événement guerrier.
De ces deux projections vers un horizon guerrier, rappelons-
le, peut résulter une intention pacifique, pacifiste ou encore
belliciste, dernière option qui est le plus souvent attribuée
aux militaires, sans qu’ils s’en défendent et sans trop de
nuance. Mais puisqu’il est question ici de repenser le
pacifisme de Jaurès – qu’on est allé jusqu’à croire intégral
alors qu’il avait développé une pensée essentiellement
pacifique –, on voudrait dans le même sens questionner le fait
que les militaires, français en l’occurrence, soient associés
à un bellicisme « intégral » dont on connaît presque
familièrement les principales facettes : xénophobie et
exaltation de la patrie, enthousiasme va t’en guerre et
cocardier, indifférence coupable vis-à-vis des conséquences
sociales, politiques et humaines du « grand événement » qu’ils
appellent ardemment de leurs vœux.
Qu’on le comprenne, notre propos ne s’inscrit pas dans un
champ d’abord politique, il ne porte pas sur la question de la
responsabilité des militaires dans le déclenchement de la
2
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
guerre mais plutôt sur l’appréhension qu’ils en avaient, sur
le plan intellectuel et en tant que groupe professionnel. Sur
ce terrain, l’étude du militaire pourrait être à même
d’éclairer le reste du champ social. Durant quarante-trois
années, l’écrasante masse des cadres de l’armée française
consacre sa vie à préparer la guerre, certains en pure perte,
comme l’illustre si bien le fameux roman de Dino Buzzati, Le
Désert des Tartares ou encore Zangra, le personnage pathétique de
la chanson de Jacques Brel. Chacun connaît la confiance voire
l’enthousiasme affichés par le commandement français à la
mobilisation : l’heure du bellicisme avait bel et bien sonné.
Mais avant cette soudaine libération de la condition
militaire, alors que la guerre n’était qu’une éventualité, si
souvent évaporée par le passé, qu’en était-il du rapport
militaire à la guerre future ? Sans aller jusqu’à interroger
la possibilité que le corps militaire, ou même un seul
officier puisse être pacifiste ou même pacifique, on voudrait
simplement nuancer l’idée reçue d’un bellicisme aveugle et
surtout la croyance que ce dernier ne soit fait que de
négligence ou d’une simpliste envie d’en découdre détachée de
ses conséquences.
Cet enjeu sera ici mis en regard de la situation militaire
française au début du XXe siècle, qui fit coïncider plusieurs
crises touchant l’armée et, surtout, ses cadres. Une crise
politique d’abord, une crise des anticipations ensuite, moins
perceptible, face aux mutations de la guerre moderne et,
enfin, une crise fonctionnelle touchant le commandement et
3
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
l’instruction de la troupe.
On évoquera donc dans un premier temps un paysage militaire
marqué par le marasme, l’amertume voire la révolte contenue
parmi les officiers qui préparent et anticipent un basculement
dans la guerre. Mais ce sera pour en venir à une question
centrale qui est la suivante : comment alors être un militaire et
préparer à la guerre moderne une armée dont les soldats, massivement, et le
gouvernement, avec constance, sont pacifiques dans le cadre européen ?
L’Armée Nouvelle de Jaurès, par la place importante faite à
l’avenir des officiers, pose cette question très directement,
comme Lyautey vingt ans auparavant dans son Rôle social de l’officier3.
Et justement, au-delà des vagues de réforme lancées par le
pouvoir civil, il nous encourage à interroger réellement le
défi de préparer la guerre de masse au sein d’une société qui
s’ancre dans la paix européenne décennies après décennies,
malgré des crises et la conquête coloniale.
On en viendra ainsi, dans un second temps, à la nécessité pour
les militaires du temps de paix d’entretenir la capacité des
Français à faire face à un conflit en tenant compte, au sein
des anticipations, de la violence d’une guerre en mutation.
Quels liens avec le bellicisme ou le nationalisme
entretiennent certaines notions centrales de la culture
militaire du temps comme l’enthousiasme, le sacrifice
héroïque, la foi en la victoire ? Que signifiaient ces mots
avant 1914 ? Avant les guerres du XXe siècle ? Leur sens nous
échappe souvent aujourd’hui, sans être pour autant étranger,
3 Lyautey, (maréchal), Le rôle social de l’officier, Paris, Albatros, 1891, rééd.1984.
4
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
loin de là, aux représentations des officiers de nos armées
contemporaines.
On proposera en conclusion quelques pistes sur le terme de la
période et le déclenchement de la guerre. Malgré les
stéréotypes encore vivaces de la « fleur au fusil » et de la
Revanche, on sait beaucoup de choses sûres aujourd’hui sur ce
basculement, mais une part de son mystère reste néanmoins
entière.
Préparer la guerre : de la crise des certitudes à l’offensive
à outrance
Préparer la guerre avant 1914. C’est un objet central de nos
recherches, depuis la thèse, à partir du relèvement de l’armée
française et de l’installation progressive du régime
républicain4. Tout au long de la période, et jusqu’en 1914,
l’armée est rivée à un défi principal (malgré la conquête
coloniale qui n’est pas sans rapport avec lui) : préparer un
conflit en Europe c’est-à-dire, au fond, faire face à l’armée
allemande. Ce défi justifie la rénovation progressive des
structures de l’armée, il justifie les moyens considérables
dont elle est dotée, les fortifications, la recherche de ses
ingénieurs, la reconstruction d’une doctrine capable de
rivaliser avec celle de l’ennemi. Il s’agit, au début, à la
fois de laver l’affront de 1870 et de pouvoir faire face à une
nouvelle invasion.
4 On se permet de renvoyer ici à Olivier Cosson, Préparer la Grande Guerre. L’arméefrançaise et la guerre russo-japonaise (1899-1914), Paris, Indes Savantes, 2013.
5
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
Mais dès les années 1890 et surtout le nouveau siècle,
s’approfondit la confiance dans la supériorité française en
cas de conflit, s’instaure une approche de l’affrontement dans
laquelle les Français mèneraient la guerre, sans la subir.
D’« affronter » l’armée allemande, on en est venu résolument à
« vaincre » l’armée allemande. En 1900, la confiance de
l’armée est fondée sur les moyens dont elle dispose (son
fameux 75, ses cadres, ses soldats) et sur sa cohésion
doctrinale, à l’échelle d’une institution massifiée par le
service de 3 ans de 1889.
La crise des certitudes (1902-1911)
On pourrait s’étonner de lire une description si positive de
l’armée française de cette époque. Celle-ci évoque en effet,
et d’abord, des images assez négatives : « l’arche sainte »
décrite par Raoul Girardet5 est bien loin lorsque surviennent
l’Affaire Dreyfus et l’Affaire des Fiches, la crise des
inventaires, la répression sociale, ou encore lorsqu’est
dénoncée avec véhémence la routine écrasante et débilitante
des casernes. Mais on ne reviendra pas ici sur cette grande
décennie de crise politique (1894-1906) qu’on pourrait
qualifier de « crise de maturité de l’armée républicaine »,
après 25 ans de reconstruction. Elle atteint profondément le
moral des officiers et a été l’objet de nombreux travaux6. Elle5 Raoul Girardet, La société militaire de 1815 à nos jours, Paris, Perrin, 1998,p. 121.6 Voir notamment André Bach, L’armée de Dreyfus. Une histoire politique de l’armée françaisede Charle X à « l’Affaire », Paris, 2004, et Olivier Forcade, Éric Duhamel, PhilippeVial (dir.), Militaires en République, 1870-1962. Les officiers, le pouvoir et la vie publique enFrance, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999.
6
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
n’est qu’indirectement liée à la guerre future. Surtout, il
faut en venir à une crise moins perceptible hors de l’armée,
mais qui la travaille en profondeur, celle des certitudes
quant à son avenir et à celui de la guerre. À ce chapitre, on
peut dessiner grossièrement trois champs de tension principaux
entre 1905 et 1911.
La première dimension relève des anticipations de la guerre
future ou plutôt de la bataille future. L’appréhension rénovée
du combat et de la bataille hérités des années 1890 subit lors
de la seconde guerre anglo-Boers (1899-1902) un premier
ébranlement changé en crise ouverte des anticipations par la
guerre russo-japonaise en Mandchourie (1904-1905). Le feu des
armes modernes menace la capacité des armées à manœuvrer et
surtout à remporter rapidement une victoire décisive. Celle
des Japonais en Mandchourie n’a rien d’éclatant en effet. Elle
est arrachée dans des tranchées, au terme d’interminables
batailles aussi meurtrières qu’indécises. Heureusement pour le
Japon, exsangue, la Flotte russe fut anéantie dans le détroit
de Tsoushima. Ce désastre naval est d’une telle ampleur qu’il
provoqua la fin du conflit en confirmant, aux yeux longtemps
incrédules du pouvoir tsariste, les succès terrestres bien
réels de l’armée nippone.
Mais les observateurs militaires occidentaux, très nombreux
sur place, se trouvèrent au retour face à un problème. La
bataille décisive, pièce majeure de l’imaginaire militaire
occidental, resta un but ardemment recherché mais jamais
atteint au cours de la campagne terrestre, même lors de son
7
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
ultime paroxysme, la bataille de Moukden, où s’affrontèrent
près d’un demi-million d’hommes. En France, les observateurs
échouèrent à contrôler l’impact déstabilisateur dans les rangs
de l’armée de ce conflit qui fut le plus important de
l’époque. Dès 1905, il fut l’objet de très nombreuses
recherches et donna naissance à d’interminables débats
militaires. Notons au passage que la fragilisation de l’unité
doctrinale qu’ils entraînèrent dans les milieux militaires fut
peut-être salutaire pour l’armée pendant la Grande Guerre,
lorsqu’elle fut contrainte, après des mois d’échec, à remettre
en cause les paradigmes fondamentaux de son approche du
combat7.
La fragilisation des certitudes militaires touche ensuite à la
stratégie française face à un contexte qui évolue au début du
nouveau siècle. Aux mutations possibles du combat, qui
relèvent de la tactique, vient s’ajouter le doute concernant
la conduite de la guerre : dès 1904 on sait que l’Allemagne
envisage d’attaquer par le nord (par la Belgique), mais les
plans stratégiques, en France, ne le reflètent pas avant le
plan XVI de 19118. Un dernier essai a lieu cette année-là, sous
l’impulsion du général Michel, pour équilibrer attaque et
défense face à la menace d’une frontière béante au nord. Puis
on aboutit au plan XVII (1913-1914), porté par Joffre (auquel
7 Michel Goya, La chair et l’acier. L’invention de la guerre moderne 1914-1918, Paris,Tallandier, 2004.8 Voir Robert A. Doughty, « France », in Richard Hamilton, Holger Herwig(dir.), War Planning 1914, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p.143-174.
8
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
on interdit tout mouvement offensif initial en Belgique) et
tout le mouvement, à la fois tactique et stratégique, de
« l’offensive à outrance ».
Enfin, l’armée française fait face à un troisième champ
d’incertitude, celui de commandement et de l’instruction des
conscrits. C’est une dimension fondamentale, qui explique
largement que le projet de Joffre (et les théories du colonel
de Grandmaison ou du général Foch qui le sous-tendent
globalement) ait reçu un accueil si favorable dans les
casernes et les écoles militaires.
La massification des armées, dans les années 1890, soulève
ainsi de vastes débats liés d’abord au commandement : comment
conduire au combat des masses de conscrits qui, à la
mobilisation, viendront « noyer » sous le nombre des unités de
temps de paix déjà mal encadrées ? Autre aspect, que se
passera-t-il lorsque seront confrontés à la guerre ces civils
qui vivent à l’abri de la guerre depuis des décennies ?
Obéiront-ils ? Sauront-ils manœuvrer, se conduire en soldats ?
L’armée française dispose-t-elle dans ses annales, en
remontant même à la Révolution chère à Jaurès, d’une
expérience comparable, concernant des effectifs aussi
considérables ? La « guerre moderne » est ainsi, d’abord, une
guerre de masse. En outre, comment conduire la bataille et
exploiter les vertus de l’exemplarité de l’officier si, comme
en Mandchourie, le feu des armes modernes entraîne
l’éparpillement des soldats sur le terrain et parfois, selon
l’expression militaire, la « rupture des liens tactiques »
9
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
c’est-à-dire la perte de contact entre troupes, officiers et
sous-officiers transmettant encore leurs ordres à la voix ?
Cette mutation des représentations de l’univers combattant
apparaît à plusieurs reprises dans l’Armée nouvelle, ce qui
montre bien sa sensibilité dans les rangs militaires, au moins
parmi les élites intellectuelles fréquentées par le tribun
socialiste9. L’armée rejoint là d’autres institutions
(entreprises, partis, écoles) confrontées aux masses, aux
« foules10 », et à leur structuration accélérées dans les
années 1890. Comment imposer l’obéissance ? Faut-il réprimer
l’initiative ou au contraire la favoriser (pour la contrôler,
l’orienter) ?
À ce débat difficile sur le commandement, s’ajoute à partir de
1905 (vote du service court de 2 ans) une crise de
l’instruction. Elle relève alors aussi de la psychologie
naissante mais cette fois d’avantage de la pédagogie. Comment
apprendre la guerre à des conscrits de plus en plus nombreux,
hétérogènes (service universel égalitaire), tout en disposant
de moins de temps encore que par le passé ? Ajoutons que ces
soldats sont des citoyens, qu’on peut espérer les motiver pour
la défense de leur pays, de leur droit ou de la démocratie.
Mais il y a là un espoir qui se résume le plus souvent, dans
9 Voir les actes du colloque du centenaire cité précédement et GillesCandar, Christophe Prochasson, « Jaurès et le milieu des officiersrépublicains », in « Jaurès et la défense nationale », Cahier Jaurès, 3, 1993,p. 63-79.10 Le succès d’estime des théories de Gustave Lebon dans les milieuxmilitaires n’étonnera pas à ce titre, même s’il fait plus souvent office defaire-valoir que de méthode d’instruction. Voir Benoît Marpeau, Gustave LeBon. Parcours d’un intellectuel, 1841-1931, Paris, CNRS Éd., 2000.
10
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
les rangs militaires, au mot sacralisé de « Patrie », inscrit
sur les murs des salles d’exercices et des chambrées. Les
Français entendent-ils encore leur engagement dans ce sens
traditionnel, qui semble s’affaiblir avec le nouveau siècle ?
De cette crise professionnelle des soldats de métiers au cours
de la période 1905-1911, comment en est-on arrivé aux
audacieux projets offensifs du généralissime en 1913 ?
L’offensive à outrance (1906-1914) : l’impasse et le « retour aux fondamentaux »
Tous les plans tablaient sur la capacité de l’armée française
à manœuvrer sur son sol et aux frontières, grâce notamment à
son réseau ferré. Mais une conception de plus en plus violente
et brève de la bataille s’était imposée entre 1906 et 1911
(n’oublions pas qu’on pensait alors la guerre comme une grande
bataille de quelques jours, ou comme plusieurs engagements
décisifs s’étalant sur quelques semaines au plus). Plus la
guerre future est brève et violente, plus la nécessité de
l’offensive est grande pour prendre l’avantage. Ne pas subir
et attaquer d’emblée, fut-ce par le terrain difficile de la
Lorraine, permettrait de prendre l’ennemi de vitesse, de
porter la guerre sur son sol et d’éviter les destructions de
la guerre précédente et l’invasion. À la veille de 1914, c’est
une option que l’on sait ou que l’on suppose, parmi les chefs
de l’armée française, avoir la faveur du généralissime dont
les pouvoirs ont été étendus. Les dévastations apportées par
la guerre dans les Balkans, en 1912-1913, confortent
puissamment cette volonté de ne pas « recevoir » l’assaut de
l’ennemi mais de le précéder. Il restait à presser les Russes
11
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
d’attaquer aussi au plus vite, ce qui est l’objet d’une
intense activité politique, diplomatique et militaire qu’a
étudiée Gerd Krumeich11. C’est, en somme, le projet que le
généralissime Joffre se donne la possibilité d’appliquer le
moment venu.
Sur le plan du commandement, à l’approche de la Grande Guerre,
l’armée évolue ainsi au sein d’un champ intellectuel
extrêmement riche12, même s’il s’agit, dans l’armée, d’un front
pionnier qui concerne quelques dizaines ou centaines
d’officiers. Comme le souligne la principale étude sur le
sujet dans la Grande Guerre13, face aux incertitudes de
l’obéissance passive, un certain Paul Simon enseigne dans les
années 1900 aux élèves de Saint-Cyr les vertus appliquées de
l’initiative, d’autres écrivent des traités la valorisant ou
se déclarent en sa faveur, jusqu’à l’Ecole Supérieur de
Guerre. Mais ces approches « modernes » du commandement
peinent à toucher la masse des officiers engagés dans la
carrière (dont la moitié n’a pas fréquenté d’école
d’officier), souvent peu attirés par l’étude et,
naturellement, par la remise en question de leurs acquis.
Concernant l’instruction, à ce qui relève de plus en plus
(bien que depuis longtemps pour certains) d’un travail
d’éducation, qui signifie la transmission du savoir militaire
11 Gerd Krumeich, Armaments and Politics in France on the Eve of the First World War. TheIntroduction of Three-Years Conscription 1913-1914, Leamington Spa, Berg, 1984.12 Yves Cohen, Le siècle des Chefs, Paris, Amsterdam, 2013, p. 165-184 notamment.13 Emmanuel Saint-Fuscien, À vos Ordres ? La relation d’autorité dans l’armée française de laGrande Guerre, Paris, EHESS, 2011.
12
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
et l’éclairage des enjeux du combat moderne, nombre
d’officiers préfèrent renoncer, plus ou moins consciemment,
même après le rétablissement du service de trois ans en 1913.
Se fiant un peu paresseusement aux qualités attendues d’une
puissante armée d’active (composée de soldats plus jeunes
supposés plus malléables), et sans manquer ouvertement à leurs
obligations professionnelles puisqu’on y consent au plus haut
niveau de l’armée, ils s’en remettent à la sécurité d’un autre
pratique d’instruction qui pourrait, plus sûrement, faire ses
preuves sur les champs de batailles du futur : le
conditionnement et l’automatisme.
La « posture » offensive systématique, au seuil de la guerre,
est aussi porteuse d’une charge positive, il ne s’agit pas
seulement de l’expression d’un rejet de la modernité, alors
que sortent des cadres les anciens de la guerre de 1870. Au
contraire, elle représente pour de nombreux officiers une
manière d’appréhender la modernité, de la dominer en opérant
une sorte de « retours aux fondamentaux » relativisant les
enjeux exacerbés d’une guerre industrielle et de masse en
Europe. C’est une façon de faire face à l’inconnu à partir
d’éléments connus. Si l’offensive frontale « par défaut » doit
être prescrite aux lieutenants, aux capitaines, comme aux
colonels, si elle apparaît comme la meilleure manière de faire
la guerre, c’est ainsi parce qu’elle est jugée par beaucoup
comme la plus française, d’abord : on glorifie les soldats de
Jemmaps et surtout ceux de Malakof, vainqueurs d’une terrible
guerre de siège qui n’est pas sans ressemblance avec les
13
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
champs de bataille contemporains. L’offensive n’est-elle pas,
en outre, la clé de la victoire des Allemands de 1870 ?
L’histoire montre qu’ils furent vainqueurs à Woerth-
Frœschwiller, Spicheren ou Saint-Privat en risquant souvent
très gros, dans des batailles déclenchées depuis le terrain,
sans ordre du stratège, et surtout sans « soucis des
pertes »14. Enfin, elle semble la plus à même de doter
l’infanterie d’une unité de doctrine minimale, associée à un
emploi des batteries de 75 tout aussi téméraire et sidérant
pour l’ennemi.
En prenant du recul par rapport à cette période d’avant-
guerre, on voudrait à présent en venir au second volet de
notre propos, qui a trait aussi bien aux représentations du
temps qu’aux nôtres, un siècle plus tard.
II ANTICIPER LA VIOLENCE DE GUERRE, ANCRER LA VICTOIRE DANS LE
TEMPS DE PAIX
« L’offensive à outrance », aussi frappante et radicale
qu’elle nous paraisse, mérite mieux qu’une caricature. Elle
paraît violente et sommaire en effet (au-delà de ses résultats
désastreux dont nous devons faire abstraction). C’est une
doctrine de guerre volontairement audacieuse et provocante,
agressive. Doit-on pour autant penser que l’armée d’une
société aussi riche et avancée culturellement réduirait ainsi
la guerre à une mêlée confuse, sans plus y réfléchir ? Sans
envisager le carnage ou même, simplement, la défaite qui14 Roth (François), La guerre de 70, Paris, Fayard, 1990, p. 49-119.
14
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
pourrait résulter de son parti pris ? L’aurait-on cru à
l’époque, en France ou en Allemagne ? Oui et non. Certes, on
peut s’étonner d’un argument tel que celui-ci, par exemple,
pour justifier la posture offensive : « En réalité – et il
serait facile de montrer qu’il en a toujours été ainsi — la
sûreté d’une troupe dans l’attaque est basée sur ce fait : un
homme qu’on tient à la gorge et qui est occupé à parer les
coups ne peut pas vous attaquer de flanc ou par derrière.
[...] La valeur de la méthode dépend de la rapidité avec
laquelle vous lui sautez à la gorge et de la solidité de votre
étreinte15. » On le doit au fameux colonel de Grandmaison, qui
porte trop souvent seul le fardeau de la dérive doctrinale
française de l’avant-guerre 1914 mais l’exprima avec un talent
singulier. Le simplisme, sans doute, est ici frappant, de même
qu’une forme de « crânerie » militaire à laquelle on
reviendra. Mais concernant l’offensive à outrance, on ne doit
pas négliger d’ajouter la violence, qui est peut-être encore
plus éclatante. Sauter à la gorge de l’ennemi, immédiatement,
sans autre souci que l’abattre, immédiatement, il y a là une
escrime qui peut manquer de panache ou de subtilité pour
figurer le combat de l’infanterie et de l’artillerie. Le
succès, dans les rangs militaire, du mouvement et du « ton »
que lança Grandmaison, malgré son approximation (historique
notamment), montre que l’armée n’envisageait plus alors une
défaite comme possible et à quel point elle anticipait
l’extrême violence d’une guerre en Europe. La question était,
15 Colonel Grandmaison, Deux Conférences faites aux officiers de l’état-major de l’armée (février1911), Paris, Berger-Levrault, 1911, p. 27.
15
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
avant guerre : comment s’y préparer et y préparer les
Français. Comment confronter l’univers des conscrits à cette
violence du champ de bataille moderne (sans doute
incomparable) en vue non seulement de combattre, mais de
vaincre ?
L’enthousiasme
Un premier moyen réside dans l’idée d’enthousiasme. Non pas
celui, qui fascine nos contemporains et que l’on sait
largement imaginaire, des mobilisés de 1914, dans les gares et
les rues de France. Il s’agit au contraire de l’enthousiasme
du temps de paix, que ces mobilisés ont appris, mimé et
assimilé dans les casernes ou sur les terrains de manœuvre
dans les années 1890 et 1900. C’est l’exaltation que les
officiers attendent des soldats au moment de mettre la
baïonnette au canon et de charger.
Cet enthousiasme-là n’a pas été inventé à la veille de la
Grande Guerre et n’a rien à voir avec le bellicisme ou
l’aveuglement militaire. Il s’inscrit profondément dans la
culture de l’armée républicaine du temps de paix, il est
inséparable dans l’armée de la discipline que les soldats ont
durement acquise, même imparfaitement, dans l’accomplissement
de marches harassantes et sans autre objet qu’elles-mêmes,
dans la soumission aux brimades, aux ordres ou aux
intempéries16. Dans les casernes, sur les champs de manœuvre,
on vante le « cœur » du troupier français comme on stimule son16 Voir Odile Roynette, Bons pour le service. L’expérience de la caserne en France à la fin duXIXe siècle, Paris, Belin, 2000 et le stimulant essai de Alain Ehrenberg, Lecorps militaire, politique et pédagogie en démocratie, Paris, Aubier, 1983.
16
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
« en avant », son allant. « Bons soldats », les fantassins
français seraient, au « moment suprême », à la hauteur de la
Furia francese qui est bien connue en Europe.
Les soldats russes de Mandchourie, le plus souvent débordés
dans leurs tranchées à cause de l’incurie de leur
commandement, surent faire preuve, aux yeux des Français, de
cet enthousiasme ultime de la charge en terrain ouvert,
jusqu’au corps-à-corps. Souvent très meurtrières face aux
mitrailleuses et aux fusils nippons, ces actions d’éclat
permirent plusieurs fois le repli du gros des troupes et
maintinrent l’ennemi en haleine, l’empêchant de poursuivre et
de vaincre. Il démontrait, pour l’observateur français, la
valeur intacte du soldat russe et le fourvoiement total de ses
chefs dans une approche défensive du combat voué à l’échec.
L’étymologie du mot enthousiasme indique une exaltation de
l’esprit mettant l’individu entre les mains de Dieu. Si on le
considère comme une nécessité pour combattre (et non seulement
en France), c’est qu’il constitue un moyen concret d’anticiper
et de faire face à la violence du champ de bataille dès le
temps de paix. S’il signifie remettre sa vie entre les mains
de Dieu, renoncer instantanément aux secours de
l’intelligence, cet enthousiasme militaire presque routinier,
« fonctionnel », est naturellement lié à la mort. Là encore,
on ne prépare pas au combat en ignorant sa principale action,
produire la peur, et sa principale conséquence concrète, la
blessure, la mort.
Or, on a vu que les plus éclairés des officiers de l’armée
17
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
française avaient perçu l’accroissement ou au moins la
mutation de cette violence mortelle. Le champ de bataille
immense, noyé d’obus et de balles, la mort à grande
distance et, à l’échelle tactique, les pertes massives : il
faudra aux civils de la veille beaucoup d’inconscience pour
s’y jeter, et sans doute un premier aguerrissement pour
apprendre à y manœuvrer.
L’héroïsation du sacrifice et la foi en la victoire nécessaires pour combattre
Les officiers sont exhortés à ne pas perdre de vue cette
menace de mort qui, dans leur écrasante majorité, les concerne
directement (physiquement). Au cœur de leur métier du temps de
guerre, elle doit rester familière, au prix parfois,
paradoxalement, d’un déni rassurant. Citons une fois encore
Grandmaison et une remarque qu’il formula devant un parterre
d’officiers de haut rang en 1911, à propos de la « notion de
sûreté » mais surtout de ce moment délicat de la prise de
contact avec l’ennemi (qui sera pour tous les officiers de
contact à l’exclusion des coloniaux un baptême du feu) :
On a un peu honte d’être obligé de s’expliquer
si longuement sur des choses aussi évidentes.
Les anciens, ceux de Rivoli et ceux d’Iéna,
n’auraient certainement pas compris.
Ceux de Magenta non plus, eux qui n’avaient pas
pensé à se faire un front défensif sur le canal
pendant que Mac-Mahon faisait le tour. Ils ont
passé leur journée à se faire tuer, tout
18
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
bonnement, en attaquant avec acharnement le
Ponte Vecchio ; réalisant ainsi la plus haute
conception de la sûreté bien innocemment. Les
Autrichiens étaient de l’autre côté de l’eau ;
personne chez nous n’avait l’idée qu’on pût
voir un Autrichien sans sauter dessus17.
La valorisation de cette « crânerie » militaire et du mépris
de la mort, leur inscription dans un temps long qui fait
tellement défaut aux officiers de 1900 constituent des
ressorts fondamentaux de la « nouvelle » doctrine offensive.
Leurs pendants sont le mépris de la « sûreté », concept
moderne dénué de sens et jugé illusoire au combat, mais aussi
l’opposition de principe au camouflage ou à la tranchée18.
On ne s’étonnera donc pas que l’héroïsation du sacrifice au
combat soit aussi placée au cœur de la préparation du soldat
et de son édification de temps de paix. « Si vis pacem, para
bellum », « si tu veux la paix, prépare la guerre ». La
sentence justifie généralement aux yeux des civils l’existence
des armées sur le pied de paix. Voici la lecture étonnante
qu’en donne l’un de ces officiers « éclairés » en 1909 :
« N’en déplaise aux apôtres du pacifisme, le vieil adage latin
est toujours de mise : si vis pacem, para bellum. À celui-là
seul la victoire est assurée, qui aura d’avance fait le17 Colonel de Grandmaison, Deux Conférences, op. cit., p. 28.18 Cette approche frontale de la violence du combat entraînera ladisparition de très nombreux d’officiers dès l’entrée en guerre ; d’autreseront contraints d’accepter leur incapacité à faire leur métier dans lesconditions nouvelles (sensorielles et techniques) du combat. Voir DamienBaldin, Emmanuel Saint-Fuscien, Charleroi, 21-23 août 1914, Paris, Tallandier,2012, p. 132 et suiv.
19
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
sacrifice de sa vie19. » L’officier, tirant les leçons de la
Mandchourie, affirme que la mort à la guerre doit rester, à la
conscience des Français du service militaire et même au-delà
(femmes et enfants), un horizon individuel et collectif.
Comment préparer au combat des soldats craignant la mort ?
Pour eux, plus que tous autres, l’épreuve sera rude : l’armée
allemande est la plus puissante du continent et ses moyens de
destructions écrasants, nul ne l’ignore.
Il faut ainsi noter que l’officier, dans sa lecture de l’adage
latin, ne place pas la « paix » au cœur de la préparation de
la guerre. Il parle de remporter la victoire. Il y a là un
trait essentiel : on ne fait pas la guerre pour se battre,
mais pour gagner. C’est une évidence, peut-être, mais qui est
très largement perdue de vue aujourd’hui au sujet des
militaires mais aussi des mobilisés de 1914. Elle est martelée
par les officiers de l’avant-guerre de 1914.
Aux incertitudes sur l’issue d’un conflit avec l’Allemagne,
l’armée oppose littéralement la foi en la victoire. La
victoire (ou la vie du combattant sur le champ de bataille)
sera donnée par Dieu (ou le sort) à ceux qui croiront le plus
en elle et donc en leur patrie. Telle est l’eschatologie qui
sous-tend la foi professée dans les casernes (et on rejoint là
l’enthousiasme évoqué précédemment) : elle est essentielle au
fonctionnement de l’armée, à son action même. C’est un outil
tactique, si l’on veut, bien davantage qu’un trait politique
19 Lieutenant-colonel Bardonnaut, Du Yalou à Liao-yang, études sur la guerre russo-japonaise, préf. général Langlois, Paris, Berger-Levrault, 1908, p. 172-175.
20
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
caractérisant l’institution. Le corps des officiers, en effet,
est largement sécularisé dans sa masse depuis des décennies,
malgré d’intermittente crises cléricales dans l’armée dont la
nature, essentiellement politique, est sans réel rapport avec
la foi individuelle et même les pratiques religieuses réelles
des officiers20.
En conclusion, comment comprendre la résolution des mobilisés
de 1914 et de leur famille, sans même évoquer la suite, sans
peser leur consentement à une préparation concrète
(particulièrement lourde) à l’éventualité d’une guerre ?
L’hypothèse d’un conflit franco-allemand n’a jamais vraiment
été levée dans la société française de la Belle Époque. Son
armée extrêmement étendue, même malmenée ou dévouée à la
conquête coloniale, en est la preuve concrète. Mais l’anticipation
d’un conflit franco-allemand a pu susciter chez certains
l’engagement pacifiste, chez d’autres (plus nombreux sans
doute) l’indifférence, pacifique ou non. Cela n’empêche
nullement que la guerre et plus encore sa violence était
maintenues au cœur de l’imaginaire et de la vie des hommes du
temps de paix avant 1914. C’était le rôle de l’armée et
l’armée, à l’époque, était partout et l’affaire de tous. La
soumission massive et non démentie des Français à ce qu’Annie
Crépin a appelé le « devoir de défense » montre que c’était
aussi celui de chaque citoyen.
20 William Serman, Les officiers français dans la nation, op. cit., p. 85-92.
21
Texte à paraître dans la publication aux éditions Privat des actes duColloque « Jaurès pacifique et pacifiste », Castres, 8-9 novembre 2013
Tous droits réservés (usage scientifique uniquement) © O.Cosson / MN J. Jaurès 2014
La société française du temps de paix, aussi pacifique qu’elle
ait été globalement en 1914, a non seulement toléré mais
entretenu chez des millions d’hommes une forme « d’ardeur
guerrière pacifique » dont l’armée était le creuset. Cet
oxymore interroge la valeur de la notion politique de
bellicisme pour rendre compte du rapport militaire à la guerre
dans le temps de paix : la guerre, en tant que phénomène
humain, n’était pas exclue de l’horizon du continent européen
et de la masse de ses habitants, on s’y préparait et c’est
dans ce cadre que les militaires en dessinaient les contours,
technologiques et culturels, dans l’attente du « grand jour »,
certes, mais conscients pour la plupart du risque d’en perdre
le contrôle sous l’effet conjugué de la massification des
armées et du progrès industriel. La guerre européenne
anticipée, la guerre en mutation, dans la France des années
1900, posait ainsi surtout problème aux militaires, bien
qu’ils s’en soient défendus et l’ait attendue parfois comme
une libération.
Jaurès est bien celui qui l’avait senti et compris : d’abord
parce qu’elle était déléguée, en tant que question technique,
au monde clos des militaires ce qui heurtait sa conception de
la démocratie moderne. Ensuite, parce que des décennies de
paix n’avaient guère affaibli la probabilité qu’elle
réapparaisse. Non sans contradiction, il pensait « la suite »,
c’est-à-dire la manière de faire que la guerre ne soit plus
une opportunité de « gagner » quelque chose. Il voulait abolir
l’idée de victoire qui donnait, pour ses contemporains comme
pour les militaires, une légitimité entière et plus encore un
22