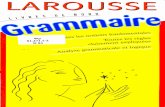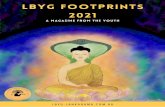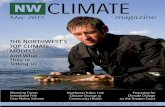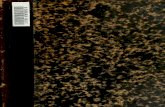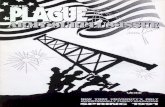Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]
Culture
Médias
Pédagogie
p.5
p.36
p.32
Lʼaffaire Dumont de Daniel GrouCinéma :
Société
Livre
Passion
p.19p.21
p.23
p.18
p.10
p.13
p.16p.15
p.8
p.7
La Renault 4
De la Sainte Flanelle au ballon...
Le bic cristal
Au loup !
Le dernier pays de mes mots de Pascale Léon
Portrait :
Mécanique :
Sport :
Objet :
Nabil
Histoire d’une marque : Louis Vuitton
Chanson : Quand les hommes vivront dʼamour
Société : Un Québec multicolore
Rendez-vous à : Le Québec, un pays en or
Gastronomie
Langue
Voyages
p.40p.42p.44
p.29
p.38
p.47p.45
p.26
p.24
Vin :
Recett e :
Produit régional :
Des vignobles du Québec...
Le pancake
Escapade gourmande
Auteur :
Eloquence :
Georges Feydeau
TV5 monde
antépénultième, échalas, subrepticement
Solution des exercices
Le voyage de Sophie :
Correspondants :
Jeux Le Brésil
Héloïse
p.49p.50
Cuisine :Jʼaime pas le homard !
Grammaire:Lʼinterrogation
p.25 Apprendre autrement :
Édito
Notre correspondant à Qu ébec
Le magazine LCF est entièrement téléchargeable sur
www.lcf-magazine.fr Les articles sont adaptés à des niveaux B1 à C2. La diffi -culté de l’article est représentée par le pictogramme en forme de livre en haut de la page.
Retrouvez les articles en version audio sur htt ps://soundcloud.com/lcf-magazine
Le lexique explique les mots diffi cilesen français et dans le contexte du document. Il ne cherche pas à être exhaustif des diff érents emplois du mot.
Florence Teste, rédactrice en chefFlorence Teste, rédactrice en chef
Bonjour à toutes et à tous,Ce mois-ci, LCF Magazine met à l’honneur le Qu ébec. L’Abitibi, le homard, le hockey sur glace, l’interculturalisme québécois, les produits locaux, la litt érature : un regard sur le Qu ébec, proposépar un Qu ébecois (que nous remercions chaleureusement ici !). Nous avons ajouté quelques éléments vus de France : la recett e des pancakes, une chanson mythique, et les vins québécois (si si, on cultive la vigne au Qu ébec ‼ !).Vous retrouverez également vos rubriques préférées : « Cinéma » (L’aff aire Dumont), « Histoire des marques » (Vuitt on), « Gram-maire » (l’interrogation), « Mécanique » (la Renault 4). « Apprendre autrement » vous présente le nouveau site de TV5 Monde ; Sophievous emmène au Brésil ; notre correspondante, ce mois-ci, est Héloïse, une jeune Hongkongaise qui a suivi une semaine de cours de français à Paris à l’école France Horizons grâce au ti-rage au sort que LCF Magazine avait mis en place pour son projet de fi nancement participatif.En préparation : les prochains numéros auront pour fi l rouge les villes de Strasbourg, puis Ho-Chi-Minh Ville (au Vietnam), ensuitece sera Toulouse. N’hésitez pas à nous proposer vos contributions, tout spécialement pour les villes qui sont hors de la France mé-troplitaine.En préparation également : un numéro hors série prévu pour le mois de mars qui vous aidera à choisir votre cours de français pour l’été 2014.
Bonne lecture !
Vidéo avec « Destination francophonie »
p.34 Radio avec« Le jeu nʼen vaut pas la chandelle »
Le coin des profs :Quand la radio devient libre...
Litt érature de jeunesse :
Litt érature francophone :
André Magny est actuellement conseiller aux communica-tions au Centre de la francophonie des Amériques à Qu ébec. Il a également vécu pendant 8 ans en France. Il y travaillait à la communication pour la Délégation générale du Qu ébec à Paris, ainsi qu’à l’Association France-Qu ébec.
L’aff aL’aff aL’aff aire Dumire Dumire Dumonononttt,,,t,ttt,t,t,ttt,tde Daniel Grou (alias Podz), de Daniel Grou (alias Podz), de Daniel Grou (alias Podz), Qu ébec, (2012)Qu ébec, (2012)Qu ébec, (2012)Par Alex Flacoute
lcf - Cinéma
Cinéma
© Y
an T
urco
tte
Au début des années 90, Michel Dumont est livreur dans une petite épicerie, et mène une vie paisible avec sa compagne et ses deux enfants. Un jour, tout bascule2 quand une femme le désigne comme étant l’homme qui l’a violée3. Bien qu’il clame4 son in-nocence, la machine judiciaire se met en marche, et Michel Dumont perd tout. Son amie le quitt e, ses enfants sont placés en famille d’accueil. Et le pire reste à venir lorsqu’il est emprisonné.Mais l’espoir renaît quand il rencontre Solange Tremblay, une jeune femme qui va tomber amou-reuse de lui, et surtout croire en son innocence. Dès lors, Solange va se batt re pour prouver que Michel n’est pas l’auteur du crime.
Pour son troisième long-métrage, Daniel Grou nous off re un véritable chef d’œuvre.Et cela est dû en grande partie aux acteurs : Marc-André Gron-
din est magistral5 dans son interprétation de Michel Dumont. Malgré tout ce qui lui arrive, il reste calme et semble ne jamais baisser les bras6. En cachant ses émotions, Grondin nous livre une performance
d’acteur incroyable. Et l’empathie7 du spectateur par rapport au personnage de Dumont en est ren-forcée. Qu ant à Marilyn Castonguay, elle est par-faite dans le rôle de Solange, qui se bat pour l’hom-me qu’elle aime. Puisque personne ne veut l’aider, elle est obligée de s’occuper de tout. Grâce à une détermination8 sans limite, elle va se lancer dans une bataille juridique qui durera presque 10 ans.
Et durant tout ce temps, MichelDumont passera plus de trois ans en prison pour un crime qu’il n’a pas commis. Le systè-me pénal est complexe, et les démarches prennent énormément de temps. Il a été acquitt é en 2001, mais pas innocenté. Chose incroyable, quand on sait dès le début qu’il ne correspond absolument pas au profi l du véritable agresseur9 : il ne fait pas le même poids ni la même taille ; et le coupable a un tatouage sur le bras, alors que Dumont n’en a pas.
On peut penser qu’avec cet acharnement10 de la justice, Michel Dumont abandonne tout espoir. Surtout que pendant son incarcération11, il est maltraité par ses codétenus (il est mal vu d’être un criminel sexuel en prison). Mais c’est grâce au soutien inconditionnel de Solange qu’il continue à lutt er contre le sys-tème et les institu-tions. D’ailleurs, il se marie avec elle dans l’enceinte de la prison, au milieu des surveillants.
5
Au programme ce mois-ci, un fi lm inspiré de faits réels. Le destin tragique d’un homme ordinaire, victime d’une erreur judiciaire. Une histoire incroyable et dramatique, mais passionnante de bout en bout1.
© Y
an T
urco
tt e
© Y
an T
urco
tt e
© Y
an T
urco
tt e
LEXIQUE
1. de bout en bout (expression) : du début jusqu’à la fi n
2. bascule (v. basculer) : tombe, change brutalement,
se transforme
3. a violée (v. violer) : a agressée sexuellement
4. clame (v. clamer) : déclare avec énergie, crie
5. magistral (adj. m.s.) : parfait, tel un maître
6. baisser les bras (expression) : abandonner, renoncer
7. empathie (n. f.s.) : capacité à s’identifi er et à comprendre
l’autre
8. détermination (n. f.s.) : forte volonté
9. agresseur (n. m.s.) : personne qui att aque
10. acharnement (n. m.s.) : obstination
11. incarcération (n. f.s.) : emprisonnement, temps passé
en prison
12. dénouement (n. m.s.) : issue, fi n
13. dévoré (adj. m.s.) : mangé sauvagement, avalé
Le cinéma québécois débarque dans votre région ! Du 10 octobre au 6 décembre 2013
Pour consulter le calendrier des projections : http://francequebec.fr/tournee-cinema/
Le cinéma québécois débarque dans votre région ! Du 10 octobre au 6 décembre 2013
Pour consulter le calendrier des projections : http://francequebec.fr/tournee-cinema/
Le Le Le dernier paysdernier paysdernier pays de de de
dernier pays de
dernier paysdernier paysdernier pays de
dernier pays de
dernier pays de
dernier paysdernier paysdernier pays de
dernier pays mes mots mes mots mes mots de mes mots de de de mes mots de mes mots de mes mots de de de mes mots de
de Pascale Léon de Pascale Léon de Pascale Léon
© Tim Wang
lcf - Litt érature francophone
7
Littérature francophone LEXIQUE
1. à la plume (n. f.s.) : au style, qui a un style
2. renouer (v.) : se rapprocher
3. immersion (n. f.s.) : lieu où on est plongé dans
un environnement spécifi que
4. maudissant (v. maudire, participe présent) : étant
en colère contre, appelant le malheur sur
5. séparatistes (adj. f.p.) : qui souhaitent l’indépendance
(terme politique)
6. errance (n. f.s.) : vagabondage, marche sans but
Pascale Léon n’est pas écrivaine. Elle a un doctorat en Sciences de la vie et de la santé, spécialisée en recherche sur le cancer. Et pourtant, le récit qu’elle vient de publier aux Éditions Mille et une Vies nous fait découvrir une auteure à la plume1 assurée, qui sait raconter une histoire. La sienne. Et sa volonté de renouer2 avec la francophonie.
Née en France, elle quitt e à 25 ans la patrie de Victor Hugo. En 1987, l’amour lui fait traverser l’Atlantique pour retrouver un bel Américain. Après un séjour aux États-Unis, le couple s’installe à Toronto, la mé-tropole du Canada. Les enfants naissent, au nombre de quatre. La routine s’installe. À l’exil du pays, s’ajoute l’exil de la langue. Jusqu’à ce qu’une remarque de sa mère en visite au Canada la fasse sursauter : « Tes enfants ne parlent plus français. Tes fi lles parlent anglais entre elles, elles me comprennent encore apparem-ment, mais me répondent en anglais. » . Elle réalise alors que sa mère dit vrai. « Le plus troublant est que non seulement je ne me suis rendu compte de rien, mais que j’ai moi-même commencé à leur parler anglais de plus en plus souvent. » C’est ce qu’on appelle l’assimilation.
On est en 1995 à la veille du deuxième référendum au Qu ébec qui déchirera tant les Qu ébécois et met-tra les Canadiens en colère contre ceux qui voulaient casser leur pays. C’est à ce moment-là que Pascale Léon décide d’envoyer ses enfants en immersion3
française tout « en maudissant4 les Qu ébécois et leurs idées séparatistes5 ridicules ».
Il faudra « dix ans d’errance6 émotionnelle et cultu-relle » à la scientifi que française pour s’apercevoir que c’est au Qu ébec qu’elle est « génétiquement connectée ». Et à partir de 2005, elle fait de fréquents voyages au Qu ébec comme on fait des visites à un amant.
par André Magny
« Alors, sachez-le, oui, pour moi l’herbe est réellement plus verte ici. Même lorsqu’elle est encore recouverte de neige en avril. »
L'histoire
Le dernier pays de mes mots est un formidable chant d’amour à la culture, à la musique du Qu ébec. Mais c’est aussi un livre qui montre le parcours d’une fem-me qui va jusqu’à déménager à Montréal au début de 2013 pour vivre pleinement sa francophonie.
lcf - Cinéma
A la fin du film, on est soulagé par le dénouement12
positif de l’histoire, mais il est tout de même ef-frayant de se dire que cela s’est vraiment passé. Et c’est là toute la force du réalisateur : nous raconter avec intensité et émotion un simple fait divers. Le combat d’un innocent, qui se retrouve sali par de fausses accusations et dévoré13 par la machine ju-diciaire.Une histoire bouleversante, pour un film prodigieux et plein d’émotion. Bref, une réussite totale.
© Y
an T
urco
tte
Au loup !Au loup !Au loup !Cruel et eff rayant, le loup s’invite dans les contes de notre enfance. On le connaît féroce1, sournois2, glouton3 et amateur de chair4 fraîche !Certains auteurs et illustrateurs nous « croquent5 » cet animal avec humour et fantaisie. Avec Lara, partons à la découverte de ce personnage aux multiples facettes et avançons à pas de loup6 dans les histoires.
Un loup naïfLe loup sentimental
Editions ECOLE DES LOISIRS. Texte et illustrations : Geoff roy de Pennart.
A partir de 7 ans.
Un loup protecteur
L’hiver des loupsEditions Gallimard Jeunesse
Collection Folio Junior. Texte : Évelyne Brisou-Pellen Illustrations : Nicolas Wintz.
A partir de 11 ans.
par Myriam Baudic
« J’adore les histoires qui parlent du loup. Qu elque-fois, elles me font peur, mais ça m’amuse quand il lui arrive des problè-mes parce qu’il est bête
et qu’il tombe dans les pièges7. Qu and il croque des gens tout crus8, beurk ! je n’aimerais vraiment pas être à leur place ! Je n’ai jamais vu de loup en vrai et je n’aime pas trop me promener dans la forêt, sauf pour ramasser des châtai-gnes »
Lara, 5 ans.
Un loup tendreGrand loup et
petit loup Editions PERE CASTOR FLAMMARION
Texte : Nadine BRUN - COSME Illustrations : Olivier TALLEC.
A partir de 4 ans.
Petit Loup arrive un jour sur le territoire de Grand Loup. Une très jolie rencontre aux couleurs de l’imi-tation, de la diff érence, du partage, de l’absence et de l’att achement.Une histoire pleine de tendresse et de poésie.
Ce roman historique plonge les lecteurs au coeur du Moyen Age. A la mort de sa mère,
Jordane, 12 ans, élève seule ses petites sœurs pen-dant l’absence de son père parti en pélerinage11. L’hiver est très rude et les loups encerclent le vil-lage, terrifi ant les habitants. Jordane, amie avec les loups, est considérée comme une sorcière12. Les villageois imaginent qu’en la chassant, les loup vont la suivre. Enigme et mystère pour frissonner.
Il est temps, pour Lucas de-venu grand, de quitt er sa fa-
mille de loups et de vivre sa vie. Son père lui donne la liste des bons aliments pour se nourrir. Lucas se laisse attendrir9 par tous ceux qu’il rencontre et son estomac crie famine10. Cett e his-toire très amusante permet de retrouver de nombreux personnages de contes bien connus.
lcf - Litt érature jeunesse
8
Littérature jeunesse LEXIQUE
1. féroce (adj. m.s.) : cruel
2. sournois (adj. m.s.) : pas franc, malhonnête
3. glouton (adj. m.s.) : vorace, qui a toujours faim
4. chair (n. f.s.) : viande
5. croquent (v. croquer) : dessinent, décrivent,
parlent de
6. à pas de loup : très doucement
7. pièges (n. m.p.) : dispositifs pour att raper
les animaux sauvages
8. crus (adj. m.p.) : non cuisinés
9. attendrir (v.) : émouvoir, toucher
10. crie famine : manifeste sa faim
11. pélerinage (n. m.s.) : voyage pour des raisons
religieuses
12. sorcière (n. f.s.) : femme qui pratique la magie
(terme négati)
27NOV. 2DÉC.SUPERSALONDU LIVRE ETDE LA PRESSE
JEUNESSESEINE-SAINT-DENIS
MONTREUIL
www.slpj.frwww.seine-saint-denis.fr
© P
otag
ers d
’ant
an
« C’est un beau pays, neuf, vaste… Il y a bien des mouches en été et les hivers sont pénibles; mais je suppose que l’on s’y habitue à la longue3. »La citation est de Louis Hémon, l’auteur français du célèbre roman Maria Chapdelaine, écrit au début du XXe siècle. Bien que le roman se passe à Péribonka, au Lac-Saint-Jean, cett e description pourrait aussi s’appliquer à une autre région plus à l’ouest et au nord : l’Abitibi-Témiscamingue. Située à 650 km au nord-ouest de Montréal, c’est une immense région peuplée de lacs et de forêts.
Pays de démesure4
Dans ce vaste territoire qui s’est surtout dévelop-pé il y a tout juste 100 ans, on cultive l’or comme d’autres cultivent des pommes de terre ! Le dévelop-pement abitibien s’est fait à travers les découvertes des prospecteurs, ces hommes qui cherchent où se cache l’or !
Pour plusieurs familles, l’aventure a commencé au moment de la Première guerre mondiale. C’était l’époque de la conscription, c’est-à-dire le moment où les jeunes hommes étaient obligés d’aller à l’ar-mée. C’était aussi une époque de grande misère éco-nomique. Le gouvernement du Qu ébec avait promis des terres en Abitibi à ceux qui iraient défricher5 et labourer ces champs souvent pleins de roches. C’est ainsi que des familles entières sont allées s’installer en Abitibi, véritable pays peuplé d’épinettes6. Alors qu’au tournant du XXe siècle, c’était en canot7 que les premiers colons étaient arrivés dans «la Terre de Rupert», c’est plus tard le train qui amène les nou-veaux arrivants vers cett e région où la température descend facilement entre -30 et -40° l’hiver !
Ce sont les coups de hache1 dans les arbres, les souches2 qu’on tire du sol et la terre souvent pleine de cailloux qu’on retourne pour y planter des légumes qui ont fait le Qu ébec d’aujourd’hui à travers ses nombreuses régions.
Un pays en or
Rendez-vous au
Un pays en orQu ébec
par André Magny
© C
anda
ce S
haw
© D
2Gal
lery
lcf - Rendez-vous à
10
Rendez-vous à
BORDEAUX
«L’Abitibi a une histoire fascinante, sanglante, inquiétante. Rien que des voies d’eau…» Ou presque, car l’Abitt à tibi comme l’a chantée le poète Raoul Duguay, c’est aussi celle des « Canadiens anglais qui y défrichent le sol pour lui soutirer des métaux précieux comme l’or et le cuivre », pendant que les Canadiens fran-çais « suivent derrière comme des oiseaux suivent des carnassiers8, pour cultiver la terre laissée en friche9…» comme l’écrivait Paule Doyon, une écrivaine native de la région.
L’Abitibi, ce sont des noms de villages et de villes qui, pour une fois au Québec, ne commencent pas par le prénom d’un saint ou d’une sainte ! Malartic, Val d’Or, Rouyn, Bar-raute, Guyenne, Cadillac, Rochebeaucourt, La Corne, des noms à donner envie d’aller voir d’un peu plus près la ri-vière Harricana qui traverse Amos.
Mais l’Abitibi, c’est aussi, et peut-être surtout le sang de ce pays qui coule dans les veines de nos pères et grands-pères. Ce pays où les arrière-grands-mères aux prénoms impossibles comme Obéline se changeaient en loup-ga-rou10. Ce pays où les orignaux11 étaient plus gros dans l’imaginaire des gens que des grizzlis12. Et surtout ce pays aux nombreuses mines qui a trop souvent tué ces hommes à l’immense courage, lors d’accidents miniers.
LEXIQUE
1. hache (n. f.s.) : outil pour couper le bois
2. souches (n. f.p.) : parties de l’arbre dans la terre, avec
les racines
3. à la longue (expression) : à cause de la durée (très
longue durée)
4. démesure (n. f.s.) : excès, qu’on ne peut pas mesurer
5. défricher (v.) : rendre cultivable
6. épinettes (n. f.s.) : forêts de sapins
7. canot (n. m.s.) : barque, canoë, petit bateau sans voile
8. carnassiers (n. m.p.) : animaux mangeurs de viande
9. friche (n. f.s.) : non cultivé, à l’état sauvage
10. loup-garou (n. m.s) : bête imaginaire mi-homme,
mi-loup
11. orignaux (n. m.p. singulier : orignal) : animal
proche de l’élan
12. grizzlis (n.m.p.) : gros ours
© y
egui
La Renault 4 La Renault 4 La Renault 4
lcf - Mécanique
13
Mécanique
© D
aveM
ontP
hoto
grap
hy
La Renault 4, que l’on appelle aussi la 4L, a été créée pour faire concurrence à la 2CV de Citroën (voir LCF N°4). Comme elle, elle a transporté un très grand nombre de familles françaises et laisse souvent un souvenir joyeux dans les mémoires.
par Pit Cévenol
La 4L est une petite voiture populaire, de conception simple et pratique. Elle a été construite de 1961 à 1992, en France mais aussi en Espagne, en Italie, au Maroc et en Slovénie. Elle a été vendue à plus de 8.000.000 d’exemplaires, ce qui en fait la deuxième voiture française la plus vendue. Elle a connu plusieurs versions, plus féminine (la Parisienne), plus sportive (la GTL), plus luxueuse (la Luxe), plus travailleuse (fourgonnett e) et même une version décapotable1 (la Plein Air) !La 4L a aussi été une voiture de course ! Ainsi, elle a participé au fameux rallye Paris-Dakar et a même fi ni en troisième position en 1980. Il faut dire que ce modèle était équipé d’un moteur d’Alpine…
Grâce à son espace intérieur, la 4L a été particulière-ment appréciée des artisans2. Et surtout, elle a été la voiture de nombreuses administrations françaises comme La Poste, France Télécom, EDF (Electricité de France) ou encore la gendarmerie3. Pour cett e der-nière, la 4L avait une qualité supplémentaire : son
plafond était assez haut pour que les gendarmes p u i s s e n t garder leur képi4 sur la tête, même au volant !
Et dernièrement, le pape François a reçu un cadeau peu commun : une 4L avec laquelle un prêtre italien roulait depuis plus de 30 ans. En sillonnant5 la cam-pagne dans l’exercice de son sacerdoce6, il a fait plus 300.000 kilomètres !
Actuellement, il est encore possible de trouver une 4L en bon état de marche. Elle continue à être re-cherchée, spécialement par les étudiants puisqu’elle est très robuste7 et peu chère. De plus, sa mécani-que simple en fait un véhicule facile à réparer par soi-même si on a un minimum de connaissances en mécanique.Chaque année, le 4L Trophyparcourt le Maroc pour une course humanitaire. Les concurrents, par équi-page de 2 étudiants, doi-vent apporter avec eux du matériel scolaire et sportif qu’ils vont distribuer dans les écoles locales. En 2013, le rallye a compté 1446 équipages, 2892 étudiants. La prochaine édition aura lieu en février 2014.
La 4L fait, encore aujourd’hui, l’objet d’un véritable culte de la part de certains amateurs. Un magazine lui est même entièrement destiné, 4L Magazine.
© V
oyag
es e
tc
© A
llSpo
rtA
uto.
com
- cm
onvi
lle
LEXIQUE
1. décapotable (adj. f.s.) : à laquelle on peut enlever le toit
(le capot)
2. artisans (n. m.p.) : travailleurs indépendants exerçant
un métier manuel, souvent traditionnel
3. gendarmerie (n. f.s.) : équivalent de la police, mais
appartenant à l’armée
4. képi (n. m.s.) : chapeau de certains corps de l’armée
et de la police
5. sillonnant (v. sillonner, participe présent) :
parcourant
6. sacerdoce (n. m.s.) : fonction des prêtres
7. robuste (adj. f.s.) : solide
Le bic Le bic Le bic cristal cristal cristal
lcf - Objet
15
Objet
Cette nouvelle rubrique met à l’honneur les objets de notre quotidien sortis de l’esprit visionnaire1 de Français ou de francophones.
Notre premier objet a plus de 64 ans et reste une des meilleures ventes dans le monde
de l’écriture. Je veux bien sûr parler du « Bic cristal ».
Par Rémi Orzalesi
Son histoire commence en 1945 où la société PPA débute en France. Ses initiales signifi ent « Porte-plume, Porte-mines et Accessoires ». La société est créée par Marcel Bich et Edouard Biff ard pour fabriquer des pièces détachées de porte-plume2 et porte-mines3 alors seuls moyens d’écrire. Mais ceux qui se souviennent des lignes d’écriture au porte-plume doivent aussi avoir souvenir de l’inévi-table buvard4 qui empêchait de tâcher sa feuille. Pas
vraiment pratique ! En 1943, un Hon-grois, László Biró, invente le stylo-bille. Conçu à partir d’un cylindre servant de réserve d’encre5 et d’une bille6 délivrant juste la bonne quanti-té d’encre, elle-même étudiée pour avoir la bonne viscosité7. Biró vend ses droits à plusieurs entreprises à travers le monde et
c’est à partir de ce nouveau concept que l’entreprise PPA décide de fabriquer un stylo-bille jetable.
L’entreprise sera renommée BIC en référence à son directeur généralMarcel Bich, mais en enlevant le Hpour rendre la pro-nonciation simple dans toutes les langues.
Ce stylo n’a quasiment pas changé depuis sa créa-tion. Son niveau d’encre est visible à travers son tube translucide, les facettes8 autour du stylo per-mett ent une bonne préhension9 et son bouchon de
la couleur de l’encre est composé de plastique plus souple et n’at-tend que d’être mordillé10.
C’est une recett e qui marche : Bic est présent sur les cinq continents et vendu dans plus de 162 pays. Depuis sa créa-tion, le stylo a été réa-lisé à plus de 100 mil-liards d’exemplaires.
Ce stylo représente bien le passage aux
années soixante où le jetable fait son apparition et dicte de nouveaux codes de consommation. Mais il signifi e avant tout l’effi cacité d’une forme simple au service d’une idée novatrice11.
© Carlos Delgado
© T
roun
ce
C’est une recett e qui marche : Bic est présent sur les cinq continents et vendu dans plus de 162 pays. Depuis sa créa-tion, le stylo a été réa-lisé à plus de 100 mil-liards d’exemplaires.
© B
reve
t Lás
zló
Bir
ó
Marcel Bich, mais en enlevant le H
LEXIQUE
1. visionnaire (adj. m.s.) : qui imagine le futur
2. porte-plume (n. m.p.) : outil d’écriture composé
à l’origine d’une plume d’oiseau
3. porte-mines (n. m.p.) : outil d’écriture
4. buvard (n. m.s.) : papier qui absorbe le liquide de
l’encre5. encre (n. f.s.) : liquide de couleur (souvent noir ou bleu)
utilisé pour écrire
6. bille (n. f.s.) : petite boule métallique
7. viscosité (n. f.s.) : propriété d’une matière plus
ou moins liquide
8. facettes (n. f.p.) : multiples petites surfaces d’un objet
9. préhension (n. f.s.) : capacité à attraper, à tenir
10. mordillé (v. mordiller, participe passé) : mordu
légèrement et de nombreuses fois
11. novatrice (adj. f.s.) : qui apporte quelque chose
de nouveau
© M
arce
l Bic
h -
Usi
ne C
lichy
195
3
© JEAN-MARIE LIOT / ASO
De la Sainte Flanelle De la Sainte Flanelle De la Sainte Flanelle au ballon rond au ballon rond au ballon rond de l’Impact de l’Impact de l’Impact de l’Impact de l’Impact de l’Impact
© H
amel
in Je
an-F
ranç
ois
© Hamelin Jean-François
lcf - Sport
Sport
16
Sport
Les Canadiens de Montréal sont, depuis leur nais-sance en 1909, la seule équipe à permett re aux fran-cophones de s’identifi er vraiment à une équipe pro-fessionnelle de hockey sur glace.Bien sûr, il y a eu aussi les Nordiques de Qu ébec en 1979, mais ils n’ont passé que 16 ans dans la Ligue nationale de hockey (LNH) – le circuit professionnel nord-américain, avant de déménager à Denver, au
Colorado.Avec le temps, l’unifor-me1 bleu, blanc, rouge des Canadiens de Mon-tréal allait devenir la Sainte Flanelle !
Au fi l des décennies2, les succès se sont accumulés. Les Canadiens sont l’équipe la plus titrée au monde dans l’univers du hockey avec 24 Coupes Stanley, le symbole par excellence du hockey professionnel nord-américain. Mais au-delà des victoires, un nom a fait vibrer la nation québécoise : Maurice Richard.
Le RocketEn 1943, Maurice Richard signe son premier contrat avec le Club de hockey des Canadiens de Montréal. Deux ans plus tard, le« Rocket » (la fusée)devient le premier joueur de la LNH à inscrire 50 buts en 50 matchs ! À cett e époque de l’histoire du Qu ébec, la seule lueur3 de fi erté au Qu ébec provenait du numéro 9. Il était un dieu ! Il y a même eu une émeute4 à Montréal en son nom : on est en 1955. Cett e année-là, Maurice était au premier rang des pointeurs de la LNH. À la mi-mars, le Canadien aff ronte les Bruins à Boston. Comme toujours, Maurice Richard se fait bousculer. On va jusqu’à lui donner un coup de bâton. Richard veut se venger5. Mais un juge de ligne retient ses deux bras. Un adversaire en profi te alors pour frapper le Rocket. Il se retourne et donne un grand coup de poing à l’arbitre. Clarence Campbell, unilingue anglophone et président de la LNH, suspend6 Maurice pour le reste de la saison ainsi que pour les séries éliminatoires, l’empêchant ainsi de remporter le championnat des marqueurs. La décision de Campbell provoquera la colère dans tout le Qu ébec.Qu elques jours plus tard, à Montréal, n’écoutant pas les conseils de la police, Campbell prend place au Forum. Une bombe lacrymogène7 explose. À l’extérieur, la rue Ste-Catherine, grande artère commerciale du centre-ville, est victime des gens qui
Jusqu’au début des années 1960, l’histoire du Qu ébec a été dominée par son étroite relation avec la religion. Puis ce fut la séparation au moment de ce qu’on a appelé la Révolution tranquille,à compter de 1963. Une « religion » a toutefois survécu : celle du hockey !
par André Magny
LEXIQUE
1. uniforme (n. m.s.) : vêtement offi ciel de l’équipe
2. décennies (n. f.p.) : périodes de 10 ans
3. lueur (n. f.s.) : petite lumière
4. émeute (n. f.s.) : manifestation violente
5. se venger (v.) : vouloir faire du mal en réponse
à une mauvaise action
6. suspend (v. suspendre) : interdit de jouer
7. lacrymogène (adj. f.s.) : contenant des produits
chimiques qui irritent fortement les yeux
8. persécuté (adj. m.s.), opprimé (adj. m.s) : mal
traité
brisent tout. Des pancartes sont au sol. On peut y lire : « Injustice aux Canadiens français », « Richard persécuté8 ». Ce soir-là, Maurice Richard devient le symbole d’un peuple opprimé8. Si désormais les
Québécois ont les arts, l’économie, le cirque ou la production de jeux vidéo pour faire leur marque, l’amour du hockey persiste. D’autres sports attirent cependant l’attention.Après les succès des sportifs québécois dans des sports comme le ski acrobatique ou le patinage de vitesse et même le vélo comme David Veilleux au Tour de France 2013, le football est en train de gagner en popularité au Québec. En fait, les petits Québécois et petites Québécoises jouent maintenant plus au ballon rond qu’avec une rondelle de hockey. À Montréal, l’Impact (nom de l’équipe de football) compte dans ses rangs des Français, des Québécois, des Argentins, des Espagnols et quelques Italiens dont l’excellent Marco Di Vaio, que l’Impact est allé chercher du côté du FC Bologna. Tout ce beau monde est en train de séduire une bonne partie de la population. Des succès qui ont… de l’impact !
lcf - Sport
© S
avar
d C
hris
tian
Place au foot
Un Un Un Qu ébec Qu ébec Qu ébec multicolore multicolore multicolore
lcf - Société
18
Société
Des Qu ébécois «tricotés1 serrés» et «de souche»2, autrement dit «des pure laine». Autant d’expres-sions typiques pour décrire un Qu ébec qui n’existe plus depuis 40 ans. Et puis, comme le dit le grand poète et chanteur de l’indépendance du Qu ébec, Gilles Vigneault, «un pays fait de souches, ce n’est pas très grand !».
© Huard Jean-Pierre
© H
amel
in J
ean-
Fran
çois
© S
avar
d C
hris
tian
Par André Magny
Le Qu ébec d’aujourd’hui a changé de visage. Aux cô-tés des Tremblay, Gagnon, Roy ou Johnson (les noms de famille traditionnels), on retrouve des N’guyen, des Diouf, des Ben Simon ou des Cohen.
Vivre l’interculturalismeAfi n de réduire le rôle de la province du Qu ébec, pen-dant longtemps la politique canadienne a parlé de multi-culturalisme. Une idéologie basée sur le développement des diverses communautés culturelles, mais chacun dans son coin, sans vérita-bles échanges avec l’autre. Au Qu ébec, on parle de plus en plus d’interculturalisme.
C’est une manière de penser qui permet de partager la culture des uns et des autres dans le respect des valeurs de la majorité francophone.
Qu ’ont en commun des écrivains comme Dany Lafer-rière, Kim Th uy, ou encore l’humoriste Boucar Diouf ou le mett eur en scène Wajdi Mouawad ? Ils sont tous Qu ébécois, nés ailleurs, que ce soit en Haïti, au Vietnam, au Sénégal et au Liban. Le Qu ébec y gagne grâce à leur pensée et leur travail. En échange, leur nouvelle terre leur sert de source d’inspiration3.
Mais att ention, cela ne se fait pas sans ajustement4. Au moment où le gouvernement du Qu ébec se pré-pare à lancer un projet sur les valeurs québécoises, certains critiquent cett e idée avant même d’avoir vu le texte. En principe, ce que visera cett e charte5, c’est à affi rmer le caractère laïc6 des institutions pu-bliques et le droit absolu de l’égalité hommes/fem-mes. Pas question d’une chasse aux sorcières, mais simplement de préciser qu’aucune religion et ses signes distinctifs7 n’auront le droit d’être visibles à l’école, dans les cours de justice ou à l’Assemblée nationale du Qu ébec.
Si dans son his-toire, le Qu ébec s’est distingué en faisant élire au début du XIXe siècle le premier député juif en Amérique du Nord, Ézékiel Hart, il est fi er de compter aujourd’hui sur un ministre de la culture et des communications d’origine camerounaise, Maka Kott o, comédien et économiste de formation. Là aussi, il s’agit d’une première pour le Qu ébec.
Et comme une image vaut mille mots, je vous conseille d’aller regarder le clip Les ailes d’un ange. Au départ, c’est une chanson de Robert Charlebois qui a été re-vue et reprise en rap par plusieurs artistes québécois.
Cliquez sur :http://www.youtube.com/watch?v=mvouNbW9T60vous aurez là un joyeux aperçu du Qu ébec d’aujourd’hui : festif, multicolore et francophone !
LEXIQUE
1. tricotés (adj. m.p.) : assemblés
comme des fils de laine d’un pull
2. de souche (expression) : dont l’origine est pure
3. inspiration (n. f.s.) : souffle créateur
4. ajustement (n. m.s.) : réglage
5. charte (n. f.s.) : règle, loi
6. laïc (adj. m.s.) : indépendant de toute religion
7. distinctifs (adj. m.p.) : qui identifient, qui permettent
de reconnaître
© L
avoi
e Je
an-G
uy
NabilNabilNabilNabilNabilNabil
lcf - Portrait
19
PortraitLEXIQUE
1. à peine (adv.) : seulement, tout juste
2. confi ant (adj. m.s.) : avait confi ance
en lui-même
3. trompeuse (adj. f.s.) : fausse
4. pris une claque (expression) : été choqué,
surpris
5. converser (v.) : parler, tenir une conversation
6. ébouriff ées (adj. f.p.) : mal coiff ées, dont
la coiff ure est en désordre
7. aff ectionne (v. aff ectionner) : aime, porte
de l’aff ection à
par Julie Boudillon
Nabil est britannique et professeur d’anglais à Paris, où il s’est installé il y a 2 ans et demi. Avant de poser ses valises en France, il a vécu sur 4 continents diff érents…
Le travail de son père a fait voyager la famille de Nabil dans diff érents pays :les Emirats Arabes Unis, où il est né, l’Angleterre, puis le Bengladesh. Après le lycée, il est parti étudier aux Etats-Unis, puis il est retourné en Angleterre faire son master. «Il y a 10 ans, j’ai rencontré ma femme en Angleterre… ça fait bizarre de dire ma femme, car on s’est mariés il y a 10 jours à peine1 !» Nabil a rencontré Camille, étudiante française à l’université de Manchester. Séparés après leurs études, ils ont fi nalement décidé de s’installer ensemble… à Paris.
Pour préparer son arrivée, Nabil a pris des cours de français à Daka. Il trouvait le français très facile… Il était confi ant2 mais c’était une idée un peu trompeuse3 : «Qu and je suis arrivé à Paris, j’ai pris une claque4 : c’était impossible de parler, de trouver mes mots, de construire des phrases complètes pour être compris et comprendre !». Il y avait un monde entre les cours et la vraie vie ! Alors, il a pris 3 mois de cours à Paris. Mais c’est surtout en parlant aux gens, en les écoutant, qu’il s’est senti de plus en plus à l’aise. D’ailleurs, il remarque aujourd’hui qu’il lui reste du chemin à faire, car il ne parle pas français tous les jours : ni au travail, ni avec sa femme avec qui ils ont gardé l’habitude de converser5 en anglais.
En arrivant à Paris, mis à part cett e «claque» linguistique, Nabil a remarqué… les crott es de chien sur les trott oirs ! Mais il a aussi aperçu quelque chose de beaucoup plus agréable :
la manière dont se coiff ent les femmes. Elles sont, dit-il, souvent ébouriff ées6, et il aime beaucoup ce mélange de chic et de naturel !Il y a aussi les repas des Français, la manière dont ils mangent : ils arrêtent leurs activités, éteignent la télévision, s’assoient en famille autour de la table … Et enfi n, il y a le pain, selon lui le meilleur pain du monde. Et surtout, cett e habitude typiquement française qu’il aff ectionne7 : «J’aime beaucoup le rituel, après
le boulot, de sortir du métro, faire la queue dans ma boulangerie préférée, acheter une baguett e, rentrer à la maison en mangeant un bout de pain sur le chemin, me mett re de la farine sur les vêtements… » Ce rituel, il l’accomplit désormais chaque jour !
« J’aime beaucoup le rituel, après le boulot, de sortir du métro, faire la queue dans ma boulangerie préférée, acheter une baguett e, rentrer à la maison en mangeant un bout de pain sur le chemin, me mett re de la farine sur les vêtements… »
© B
anga
li Ill
ustra
tion
Louis Vui� onLouis Vui� onLouis Vui� on
Connu dans le monde entier, véritable icône1 au Japon, Louis Vuitton fait partie de ces marques que l’on ne présente plus. Fleuron2 du groupe LVMH, elle est aujourd’hui la première maison de luxe mondial. Fondée il y a près de 160 ans, elle est devenue avec Marc Jacobs une fi gure incontournable de la mode.
Comme beaucoup de grandes marques, Louis Vuit-ton est à l’origine une aff aire familiale. Son fonda-teur naît en 1821 à Anchay, dans une petite commu-ne du Jura. Alors qu’il n’a que 14 ans, l’adolescent décide de quitt er son père et sa belle-mère pour re-joindre Paris. Après une longue marche (il fait plus de 460 kilomètres à pied !), il est employé en 1837
comme apprenti chez maître Maréchal, un des meilleurs « laye-t iers 3-embal leurs-malletiers » de la capi-tale. À ses côtés, Louis apprend l’art d’em-baller4 les aff aires des
riches voyageurs. Habile et astucieux, on lui confi e rapidement les plus gros clients. En 1852, l’impéra-trice Eugénie ne jure plus que par lui5!
Encouragé par ce succès, il crée sa propre entreprise en 1854. Décidé à faire de ses coff res6 des produits de luxe durables, il présente en 1856 sa première grande innovation : la malle6 grise Trianon. Légère et élégante, elle est recouverte d’une toile imperméable7. Mais Louis ne s’arrête pas là. Devinant le développement des transports, il veut imposer la mode d’une malle plate, plus facile à empiler que les malles arrondies de l’époque.
Reconnue pour son savoir-faire, la maison Vuitt on s’agrandit. En 1859, Louis fonde une usine à Asnières-sur-Seine. Plein d’idées, il fabrique toutes sortes de coff res composés de plusieurs compartiments8.
Certains se transforment même en de véritables meubles de voyage comme la malle-lit (en 1868) ou la malle-armoire.Présent sur toutes les grandes expositions universelles à partir de 1867, il gagne ses premières médailles. Après Eugénie, Louis Vuitt on devient le fournisseur9 offi ciel d’Ismaïl Pacha, le vice-roi d’Égypte en 1869. En 1875, il sera celui d’Isabelle II d’Espagne.À l’occasion du mariage de son fi ls, en 1880, Louis vend offi ciellement son aff aire à Georges. Formé à Jersey, celui-ci pousse son père à développer la marque à l’étranger. Puisqu’il insiste, Louis Vuitt on ouvre une boutique à Londres.
Face au développement de la contrefaçon10, la maison adopte en 1888 un nouvel imprimé. Après s’être essayé aux rayures, elle lance la célèbre toile à damier11 qui alterne carreaux bruns et beiges ! Afi n d’assurer la sécurité des malles, une serrure spéciale est inventée en 1890, il faut alors une clé diff érente pour chaque client. Mais les réalisations de Georges étant à nouveau copiées, il crée en 1896 la toile Monogram, aujourd’hui emblématique12 de la marque. Constituée de 4 motifs répétés à l’infi ni, cett e toile serait inspirée par le japonisme, à moins que ce ne soit par les carreaux de faïence13 qui décorent la cuisine de la famille à Asnières !
par Cécile Josselinla marque française de luxe par excellence
© Kumagai Naotaka pour Louis Vuitt on
lcf - Marques
21
Marques
© Patrick Gries. collection Louis Vuitt on
© P
atri
ck G
ries
- c
olle
ctio
n Lo
uis
Vui
tt on
© A
rchi
ves
Loui
s V
uitt
on
Rayonnement de Vuitt on dans le monde
LEXIQUE
1. icône (n. f.s.) : vedett e, mythe
2. � euron (n. m.s.) : plus belle pièce
3. layetier (n. m.p.) : professionnel spécialiste
de l’emballage des objets fragiles
4. emballer (v.) : protéger dans une matière qui enveloppe
5. ne jure que par lui (expression) : adore ses produits,
veut acheter uniquement ses produits
6. co� res (n. m.p.) ; malle (n. f.s.) : grosse(s) valise(s),
bagage(s) de voyage
7. imperméable (adj. f.s.) : étanche, qui n’est pas traversé
par l’eau
8. compartiments (n. m.p.) : petits espaces de rangement
à l’intérieur
9. fournisseur : (n. m.s.) : personne qui vend des
marchandises
10. contrefaçon (n. f.s.) : copie illégale, imitation
11. damier (n. m.s.) : nom du jeu de dames (carré
composé de carreaux de 2 couleurs diff érentes)
12. emblématique (adj. f.s.) : représentative,
symbolique
13. faïence (n. f.s.) : carrelage décoré
14. enduite (adj. f.s.) : couverte d’un produit
15. fusionne (v. fusionner) : s’unit, se regroupe avec
16. prospérité (n. f.s.) : développement économique
très positif
17. déluge (n. m.s.) : très longue période de fortes pluies
Dès 1901, l’usine passe le cap des 100 ouvriers. Avec le «steamer bag», commence l’ère du bagage souple.
Avec Gaston (le fi ls de Georges) à sa tête, l’entreprise traverse la guerre sans trop de diffi cultés. En 1959, la maison met au point une nouvelle toile enduite14 à base de lin, de coton et de PVC.En 1970, à la mort de Gaston, c’est Henri Racamier, le gendre de Gaston qui prend le pouvoir. En 7 ans, il passe de simple fabricant d’articles de voyage à une multinationale. En 1987, il fusionne15 avec Moët & Chandon pour devenir LVMH (Louis Vuitt on Moët Hennessy), le leader mondial dans le domaine du luxe.Deux ans plus tard, la marque est dirigée par Ber-nard Arnault. Celui-ci fait appel au créateur new-
yorkais Marc Jacobs. Un pari gagnant qui fait entrer en 1997 la célèbre maison dans le milieu de la mode chic et branchée que l’on connaît aujourd’hui. A l’aube de l’an 2000, après le prêt-à-porter, Vuitt on investit les chaussures, l’horlogerie, les cosmétiques et les parfums. C’est sûr, la postérité16
de Louis est assurée pour de nombreuses années encore !
Parmi les sacs classiques de Louis Vuitt on, Noé a une histoire peu banale. Créé en 1932, il a été spécialement imaginé sur la demande d’un producteur de champagne qui voulait un sac pour contenir quatre bouteilles de champagne debout et une cinquième tête en bas, au milieu. Il a été baptisé Noé en référence
au personnage biblique qui après le déluge17, était parti pour planter des vignes sur le mont Arafat. Très prisé par les étudiantes dans les années 80, il revient ces jours-ci sur le devant de la scène.
Aujourd’hui présent dans près de 60 pays, Louis Vuitt on possède 465 boutiques dans le monde. Premiers marchés pour la marque : les USA (où on compte 126 magasins), le Japon (56 magasins) et la Chine. En Europe (98 points de vente, 21 pays), la France compte 19 magasins.
Histoire d’un produit phare
de la marque : le sac Noé
© B
runo
Ass
elot
pou
r Lo
uis
Vui
tt on
yorkais Marc Jacobs. Un pari gagnant qui fait entrer en
© M
azen
Sag
gar
pour
Lou
is V
uitt
on
22
Qu andQu andQu and les hommes les hommes les hommes Qu and les hommes Qu andQu andQu and les hommes Qu and les hommes Qu and les hommes Qu andQu andQu and les hommes Qu andvivront d’amour vivront d’amour vivront d’amour
lcf - Chanson
Chanson
23
En 2002, les auditeurs de Radio Canada choisissent Qu and les hommes vivront d’amour comme la plus belle chanson canadienne de tous les temps.
Rerouver la vidéo sur internet : http://www.youtube.com/watch?v=UZOM4koItSk
Un succès que personne n’a oublié et qui a permis de rassembler sur scène pour un soir, vingt-huit ans plus tôt, Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois. Ce soir-là, trois générations de chan-teurs québécois sont réunies sur une scène pour chanter Qu and les hommes vivront d’amour à l’oc-casion de la Superfrancofête à Qu ébec devant plus de 130 000 spectateurs. Le concert a lieu sur les plai-nes d’Abraham, où s’étaient déroulées1, au XVIIIe siècle les célèbres batailles franco-britanniques qui avaient mis fi n à la domination française en Nou-velle-France.
Le spectacle est organisé pour soutenir le mouve-ment indépendantiste. Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois interprètent chacun quelques chansons issues2 de leur répertoire3. Pendant plus
de trois heures, la foule chante à tue-tête4 et ne veut pas quitt er les plaines. Qu elques minutes avant la fi n du spectacle, en coulisses5, nos trois chan-teurs cherchent une chanson à interpréter tous ensemble. Un titre qui n’appartiendrait à aucun de leur répertoire et qui serait comme un générique de fi n6. La femme de Gilles Vigneault propose cett e chanson qui fait immédiatement l’unanimité7. Aux première notes, le public hurle de joie, l’instant est
magique et le 13 août 1974 restera une date majeure dans l’histoire de la chanson québécoise.
Mais l’histoire de cett e chanson commence véri-tablement en 1956. Le poète québécois Raymond Lévesque se produit dans les cabarets de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Tous les soirs, après le spectacle, il retrouve ses copains dans les bars à la mode et ils refont le monde, parlant de tout et de rien. Et souvent la phrase «Qu and les hommes vi-vront d’amour» revient. Raymond la note sur son paquet de cigarett es. Le lendemain, il écrit la chan-son en moins d’une heure. Il l’enregistre et autorise ses amis Eddie Constantine et Cora Vaucaire à la re-prendre mais elle tombera dans l’oubli total, jusqu’à ce fameux soir d’août 1974 où Leclerc, Vigneault et Charlebois en feront un succès planétaire8.
par Fabien Lecoeuvre
© L
ecoe
uvre
Pho
toth
èque
© Dianetell
LEXIQUE
1. s’étaient déroulées (v. se dérouler) : s’étaient passées
2. issues (adj. f.p.) : venues de, sorties de, tirées de
3. répertoire (n. m.s.) : ensemble des chansons d’un chanteur
4. chante à tue-tête (expression) : chante très fort
5. coulisses (n. f.p.) : lieux dans lesquels les artistes se préparent,
derrière ou sur les côtés de la scène
6. générique de fi n : musique qui fi nit un spectacle ou une
émission de télévision, un fi lm
7. fait l’unanimité : est acceptée par la totalité des
participants
8. planétaire (adj. m.s.) : sur toute la planète
Eloquence
par Maxime Roy www.lemotpourlafri.me
Vous retrouvez dans chaque numéro une sélection de quel-ques mots que les Français n’ont plus l’habitude d’enten-
dre : un mot oublié des conversations, un verbe délaissé de l’usage, un réfugié du dictionnaire qui n’attend que sa sortiedans les bouches, sur le papier et les écrans.
Ces mots sont assez diffi ciles à placerdans la conversation quotidienne maissi vous voulez briller en société, n’hésitez pas à les employer !
Qu i précède l’avant-dernier.
Exemple : Le dernier arrivé remercia l’antépénultième. Synonyme : avant-avant-dernier
adj. (du latin ante : avant , paene : presque et ultimus : dernier)Antépénultième
D’une manière cachée, illicite.
adv. (du latin subripere : dérober, voler)
Exemple : Il a emprunté subrepticement ce livre à la bibliothèque.Synonymes : sournoisement, illicitement
Subrepticement
Exemple : Cet échalas brun devait la surveiller toute la soirée, sur l’ordre de son père.Synonyme : escogriff e
Personne grande et maigre (c’est également un long bâton qui sertde tuteur à certains plantes, notamment à la vigne).
n.m. (du grec kharax : pieu)
Echalas
LEXIQUE
1. selon que… ou… : si… ou si… (indique qu’il y a
plusieurs possibilités)
2. optimiser (v.) : rendre meilleur, plus performant
3. n’a rien à prouver en ce qui concerne :
a déjà montré
4. a été initié (v. initier, passé composé passif) :
a été réalisé, commencéhttp://www.tv5.org/
TV5 Monde
Type : site webSupport : ordinateur, smartphone, tabletteObjectif : sʼentraîner à la compréhension écrite et orale Niveau : de A1 à B2Prix : gratuit
Notre avis :
TV5 Monde vient de mettre en ligne de nouvelles pages pour la partie de son site « Langue française ». On peut maintenant choisir « Apprendre le français » et « Enseigner le français », selon que1 lʼon est apprenant ou enseignant.
Note de lʼéquipe LCF :
TV5 Monde nʼa rien à prouver en ce qui concerne3 la qualité du contenu de ses pages dʼapprentissage du français. Pourtant, un énorme travail a été initié4 pour donner encore plus de variété et dʼintérêt à lʼapprentissage.
par Florence Teste
Pour les apprenants :Première nouveauté, les consignes elles-mêmespeuvent être traduites. 7 langues sont pro-posées : le français, lʼanglais, lʼallemand, le chinois, le coréen, lʼespagnol, le vietnamien. Cʼest une aide considérable pour ceux qui ont du mal à comprendre ce quʼon leur demande.
De plus, même lorsque vous affi chez les consi-gnes dans votre langue, vous pouvez obtenir une aide supplémentaire : en cliquant sur le mot que vous ne connaissez pas, une petite fenêtresʼouvre pour traduire ce mot en français et lʼexpliquer dans votre langue.Vous pouvez choisir votre niveau de diffi culté :
les exercices sont adaptés au niveau A1 (débutant), A2 (élémentaire), B1 (intermédiaire) et B2 (avancé). Desvidéos, par exemple, vous permet-tent de répondre à des exercices de compréhension.De plus, vous pouvez vous entraîner au TCF en répondant
à des séries de questions et en vous plaçant dans les mêmes conditions que celles de lʼexamen.Une rubrique vous donne également quelques conseils de méthode pour optimiser2 votre apprentissage : « aides pour mieux apprendre ».
Il faudra encore un peu de patience : le nouveau site a été ouvert il y a peu et tout nʼa pas encore été mis en ligne. Le nombre dʼexercices disponibles devrait augmenter rapidement.-
+
vidéos, par exemple, vous permet-
lcf - Apprendre autrement
25
Apprendre autrement
Mais n’te promène donc Mais n’te promène donc Mais n’te promène donc pas toute nue ! pas toute nue ! pas toute nue ! de de de Georges FeydeauGeorges FeydeauGeorges Feydeau
par Florence Teste
26
Auteur
L’histoireVentroux reproche à sa femme, Clarisse, de passer son temps en tenue légère, même devant son fi ls, le domestique ou encore les visiteurs. Un jour, M. Hochepaix vient solliciter une faveur pour ses
administrés1. La tenue de Clarisse met Ventroux très en colère. Elle se fait piquer à la fesse par une guêpe. Elle demande à son mari de sucer la plaie2 pour enlever l’aiguillon3 mais il refuse. M. Hochepaix refuse également. Arrive alors un journaliste qui doit interviewer Ventroux. Clarisse le prend pour le médecin et lui demande d’examiner la plaie. Mais Ventroux arrive à cet instant.
lcf - Auteur
CLARISSE, surgissant en coup de vent4 de sa chambre. Elle est en chemise de nuit, mais elle a son chapeau et ses bott ines5. Descendant vers son mari - Ah ça ! veux-tu me dire ce qui t’a pris6 ? après qui tu en as7 ?VENTROUX, le coude droit sur la table, le menton sur la paume de la main, sans se retourner- Apparemment après qui le demande ! (Se retournant vers sa femme et apercevant sa tenue8) - Ah ! non ! non ! tu ne vas pas aussi te promener dans l’appartement en chemise de nuit !… avec ton chapeau sur la tête !CLARISSE. - Oui, eh bien ! d’abord, je te prie de9 m’expliquer… J’enlèverai mon chapeau tout à l’heure.VENTROUX. - Eh ! ton chapeau ! je m’en fi che pas mal10 de ton chapeau ! C’est pas après lui que j’en ai !CLARISSE. - Enfi n, qu’est-ce que j’ai encore fait ?
VENTROUX. - Oh ! rien ! rien ! tu n’as jamais rien fait !CLARISSE, remontant vers le canapé. - je ne vois pas !… VENTROUX, se levant. - Tant pis, alors ! car c’est encore plus grave, si tu n’as même plus conscience de la portée11 de tes actes.CLARISSE, s’asseyant sur le canapé. - Qu and tu voudras m’expliquer ! … VENTROUX. - Alors, tu trouves que c’est une tenue pour une mère d’aller changer de chemise devant son fi ls ?CLARISSE. - C’est pour ça que tu fais cett e sortie12 ?VENTROUX. - Evidemment, c’est pour ça !CLARISSE. - Eh bien, vrai ! J’ai cru que j’avais commis un crime, moi.VENTROUX. - Alors, tu trouves ça naturel ?CLARISSE, avec insouciance13. - Pffeu ! Quelle importance ça a-t-il ? Auguste est un enfant... Si tu crois seulement
qu’il regarde, le pauvre petit ! Mais, une mère, ça ne compte pas. VENTROUX, tranchant14. - Il n’y a pas à savoir si ça compte ; ça ne se fait pas15. Il remonte au-dessus du canapé.CLARISSE. - Un gamin16 de douze ans.VENTROUX, derrière elle. - Non, pardon, treize !CLARISSE. - Non, douze !VENTROUX. - Treize, je te dis ! il les a depuis trois jours.CLARISSE. - Eh ! bien, oui, trois jours ! ça ne compte pas.VENTROUX, redescendant au milieu de la scène. - Oui, oh ! rien ne compte avec toi.CLARISSE. - Si tu crois qu’il sait seulement ce que c’est qu’une femme !VENTROUX. - En tout cas, ce n’est pas à toi à le lui apprendre ! Mais, enfi n, qu’est-ce que c’est que cett e manie que tu as de te promener toujours toute nue ?
Mais n’te promène donc pas toute nue ! est une pièce de théâtre en un seul acte qui a été écrite par Georges Feydeau, auteur dramatique, en 1911.
ACTE I, SCENE II - VENTROUX, CLARISSE
L’extrait Tailleur pour dames : 1886
Un fi l à la patt e : 1894
Le dindon : 1896
La dame de chez Maxims : 1899
La puce à l’oreille : 1907 Occupe-toi d’Amélie : 1908
On purge bébé : 1910
Bibliographie choisie
Biographie
htt p://www.ibibliotheque.fr(enregistrez-vous gratuitement), cliquez sur «lecture intégrale»
Lisez
htt p://www.ibibliotheque.fr(enregistrez-vous gratuitement), cliquez sur «promenade sonore»
Ecoutez l’extrait
LEXIQUE
1. administrés (n. m.p.) : personnes qui dépendent
d’une administration
2. plaie (n. f.s.) : blessure
3. aiguillon (n. m.s.) : dard, pointe avec laquelle un insecte
pique4. surgissant en coup de vent (v. surgir; participe
présent) : sortant soudainement
5. bottines (n. f.p.) : petites bott es (chaussures)
6. ce qui t’a pris : ce qui t’arrive, ce qui se passe
7. après qui tu en as ? : avec qui as-tu un problème ?
(en avoir après quelqu’un = avoir un problème
avec quelqu’un, être fâché contre quelqu’un)
8. tenue (n. f.s.) : ensemble des vêtements que porte
une personne
9. je te prie de : s’il te plaît, peux-tu
10. je m’en fi che pas mal : ça m’est totalement égal
11. portée (n. f.s.) : conséquence
12. sortie (n. f.s.) : scène de colère
13. insouciance (n. f.s.) : absence de stress, désinvolture,
nonchalance
14. tranchant (adj. m.s.) : direct, ferme, strict
15. ça ne se fait pas : c’est mal considéré,
c’est indécent
16. gamin (n. m.s. familier) : enfant
17. illégitime (adj. m.s.) : hors mariage
18. jeunesse dorée : enfance facile
19. noctambule (n. m.s.) : personne qui vit la nuit
20. dépeint (v. dépeindre) : décrit, raconte
21. médiocrité (n. f.s.) : caractère de ce qui est banal,
insuffi sant
22. moeurs (n. f.p.) : habitudes de vie
Georges Feydeau est né à Paris en 1862 et il est mort en 1921. Il est le fi ls de l’écrivain Ernest Feydeau
(on dit parfois qu’il est le fi ls illégitime17 de Napoléon III ou du duc de Morny). Il vit une jeunesse dorée18 mais il commence très tôt à écrire des pièces de théâtre. La première qui a du succès est créée en 1886, Tailleur pour dames, et lui vaut les encouragements d’Eugène Labiche (un auteur déjà reconnu). Il se marie et a 4 enfants et fi nit par divorcer en 1916 car il vit une existence de noctambule19, joue, se drogue et trompe sa femme. Il att rape la syphilis (maladie sexuellement transmissible) qui l’amène à être interné dans un hôpital pour troubles psychiques. Il y meurt à l’âge de 58 ans.Ses pièces lui valent d’être très aimé du public. Il y dépeint20 avec brio la médiocrité21 des moeurs22 dans la société bourgeoise.
Les didascalies sont les indications de jeu que l’auteur donne aux acteurs. Ces précisions peuvent concerner le ton sur lequel les répliques doivent être dites, ou la tenue du personnage, ou encore les déplacements sur la scène. Elles sont notées en italique.
Exemple : CLARISSE, surgissant en coup de vent de sa chambre. Elle est en chemise de nuit, mais elle a son chapeau et ses bott ines. Descendant vers son mari.
Biographie
22. moeurs (n. f.p.) :
Georges Feydeau est né à Paris en 1862 et il est mort en 1921. Il est le fi ls de l’écrivain Ernest Feydeau
27
lcf - Auteur
L’interrogationL’interrogationL’interrogationpar Florence Teste
Il existe 3 façons de poser une question :
• la plus simple : On utilise la forme affi rmative, il n’y a pas de forme grammaticale spécifi que. C’est l’intonation montanteen fi n de phrase qui marque l’interrogation.C’est la forme la plus fréquente à l’oral. Elle est souvent sentie comme fautive à l’écrit.Ex : Tu viens avec moi ? C’est pour ça que tu fais cett e sortie ? (Feydeau)
• l’intermédiaire : On ajoute est-ce que, seul ou avec un mot interrogatif : qu’est-ce que, où est-ce que, … Ex : Est-ce que tu es d’accord ? Où est-ce qu’ils habitent ? Enfi n, qu’est-ce que j’ai encore fait ? (Feydeau)
• la plus soutenue : On place le sujet après le verbe.Cett e forme est utilisée plutôt à l’écrit ou marque à l’oral un niveau de langue soutenu.Ex : Qu e mett rais-je dans ma théière, dans mon sucrier et dans mon pot à crème ? (comtesse de Ségur) Et pourquoi a-t-il pris cett e échelle ? (Victor Hugo, Les misérables)
Remarques :- Lorsque le sujet est un nom, on le reprend après le verbe par le pronom personnel correspondant.Ex : Pourquoi Pierre est-il venu si tôt ?- Lorsque le verbe fi nit par une voyelle et que le pronom personnel commence lui aussi par une voyelle,on ajoute un t entre les deux pour faciliter la prononciationEx : Lui a-t-il demandé si elle acceptait de l’épouser ?
Les mots interrogatifsMot interrogatif � estion sur Exemple
qui le sujet Qu i c’est ?
que le complément d’objet Qu e fais-tu ?
où le lieu Où travaille-t-il ?
quand le temps Qu and est-ce que la réunion aura lieu ?
pourquoi la cause Pourquoi n’est-il pas d’accord ?
combien la quantité Combien ça coûte ?
comment la manière Comment fait-il pour réussir aussi bien ?
lcf - Grammaire
29
Grammaire
BON DECOMMANDE
LCF magazine est maintenant disponible en version papier.
Offre exceptionnelle
Règlement par :
6 mois (soit 6 numéros) pour 42,5 € au lieu de 51 € - 1 numéro offert !1 an (soit 12 numéros) pour 85 € au lieu de 102 € - 2 numéros offerts !!
Vous pouvez télécharger ce formulaire dʼabonnement sur http://www.lcf-magazine.fr/documents/abonnement.jpg
Vous recevrez « LCF Magazine » au format A4. Vous recevrez votre premier numéro dans un délai de 4 à 6 semaines après enregistrement de votre règlement.
Si cet abonnement ne vous satisfait pas, vous pouvez demander le remboursement des numéros non reçus. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez dʼun droit dʼaccès et de rectification aux données vous concernant. Conditions générales dʼabonnement sur http://www.lcf-magazine.fr/documents/CGA.jpg
Chèque libellé à lʼordre de :LCF MAGAZINE
OU Virement bancaire LANGUE ET CULTURE FRANCAISESIBAN : FR76 1005 7192 1900 0923 7550 117BIC : CMCIFRPP
Identité sociale : …………………………………………….. Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….. Adresse postale :(Merci dʼindiquer votre adresse complète : lieu-dit, rue, bâtiment, entrée, étage, résidence…)
………………………………………………… ………………….. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Code postal : ………………………………………………….. Ville : ……………………………………………………………..Pays : ……………………………………………………………..Téléphone : ……………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………..
Mlle Mme M.
Ecole/Centre de formation Autre :………………
Oui, je mʼabonne au magazine LCF pour une durée de :
Oui, je commande le prochain numéro du magazine LCF.
frais postaux
frais postaux
frais postaux
Si paiement en dollars US ou en £ GB, veuillez ajouter 7 € pour frais bancaires.
6 numéros 42,50 €
Europe 15 € Hors Europe 30 €
12 numéros 85 €
Europe 25 € Hors Europe 50 €
ou
1 numéro 8,50 €
Europe 3 € Hors Europe 6 €
+
+
+
Date et signature obligatoires :
à envoyer à lʼadresse postale :LCF Magazine Service abonnement 25 quai du verdanson, 34090 Montpellier, FRANCE
ou par mail : [email protected]
Testez votre niveau de françaisavec la certification TFI TM !Ce test, développé par Educational Testing Service, leader mondial des certifications en langues, est reconnu par le ministère de l’Intérieur et par de nombreuses entreprises et universités francophones en France, au Canada et en Suisse. Un score TFI vous permet de :
· Connaître votre niveau de compréhension orale et écrite en langue française,· Valoriser vos compétences grâce à une certification reconnue.
Plus de 33 000 tests TFI sont administrés chaque année.
Copyright © 2013 by Educational Testing Service. All rights reserved. ETS and the ETS logo are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS), and used Under license. TFI is a trademark of ETS.
Retrouvez tous nos centres de test sur www.etsglobal.orgPlus d’informations : 0 891 676 860 (0.225 �/ min)
Pour certifier vos compétences en langue française, vous aussi, choisissez le test TFI.
L'A
GE
NC
E
03
28
32
12
12
L'A
GE
NC
E
03
28
32
12
12
sur les petits docs type A5sur doc type A4
FLYER TFI 150X210.indd 1 05/07/13 17:21
quel, quelle, quels, quelles (adjecti) + nom : Quel fruit aime-t-il ?lequel, laquelle, lesquels, lesquelles (pronom) : Laquelle de ces deux montres préférez-vous ?préposition + qui (personnes) ou quoi (choses) : Avec qui viendra-t-il à la cérémonie ? Pour quoi faire ? Chez qui va-t-il habiter ? Dans quelle ville elle est née ? Par où est-ce qu’il va passer ?
L’interrogation directe / indirecteDans l’interrogation directe, la question se termine par un point d’interrogation.Ex : Est-ce que tu veux venir avec moi ? Qu’est-ce que tu veux manger ?Dans l’interrogation indirecte, il n’y en a pas. De plus, certains mots interrogatifs changent de forme.Ex : Je me demande si tu veux venir avec moi. (Tu veux venir avec moi ?) Je voudrais savoir ce que tu veux manger. (Qu’est-ce que tu veux manger ?)
La place des mots avec l’inversion du sujet et du verbe- Avec un temps simple :Mot interrogatif + (négation) + verbe + pronom sujet + (négation) + (compléments) Pourquoi (ne) dit - il (pas) ce qu’il pense ?Mot interrogatif + nom sujet + (négation) + verbe + pronom sujet + (négation) + (compléments) Pourquoi l’herbe ( n’ ) est - elle (pas) verte ?- Avec un temps composé :Mot interrogatif + (négation) + auxiliaire + pronom sujet + (négation) + participe passé Pourquoi (n’) est - il (pas) venu ?Mot interrogatif + nom sujet + (négation) + auxiliaire + pronom sujet + (négation) + participe passé + (compléments) Pourquoi la réunion (ne) s’est - elle (pas) terminée à l’heure ?
Exercices
1. Posez toutes les questions que vous pouvez à propos de cette image (essayez de varier les formes).
Grammaire
lcf - Grammaire
30
2. En vous basant sur la réponse, imaginez la question qui a été posée.
- ……………………………………………………………………………………………………………- Je m’appelle Marcel Dupont.- ……………………………………………………………………………………………………………- Je suis né le 14 octobre 1959 à Lille.- ……………………………………………………………………………………………………………- J’habite au 16, rue Pasteur à Marseille.- ……………………………………………………………………………………………………………- Je suis boulanger.- ……………………………………………………………………………………………………………- Le 30 septembre à 22h, je regardais la télévision chez moi.- ……………………………………………………………………………………………………………- Oui, ma femme était avec moi.- ……………………………………………………………………………………………………………- Oui, je le savais, je l’ai lu dans le journal.
Vous pouvez continuer l’interrogatoire.
3. Posez une question sur chaque groupe de mots soulignés.a) Le frère de Gilles est arrivé du Canada en avion mardi dernier à 7h du matin.b) Tous les samedis après-midi, Isabelle rejoint un groupe d’enfants pour les aider à faire leurs devoirs.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
lcf - Grammaire
Destination Destination Destination Espace ! Espace ! Espace !
lcf - Vidéo
VidéoVidéo©
NA
SA
Ce mois-ci, nous partons dans l’espace, découvrir que le français ne se parle pas que sur terre mais aussi dans les airs !
Vidéo
Emission de Ivan Kabacoff pour TV5 Mondeexploitation pédagogique par Alice Goy-Billaud
En partenariat avec TV5 Monde,
votre magazine vous propose
cette chronique, qui vous
aide à mieux comprendre une
vidéo avant de la regarder sur
www.tv5mondeplus.com
Accédez à la vidéo :
ou :
Pour parler du moment où une fusée quitte la terre ferme, quel mot emploie-t-on ?1
a. un décollage
b. un décolage
c. des collages
Dit-on des « questions …
« Gage de progrès scientifi que et d’indépendance technologique, on sait moins que les activités spatiales contribuent à la diff usion internationale de la langue française. »Le mot « gage » a 3 sens. Choisissez la défi nition qui correspond au contexte :
2
4
a. spatials »
b. spatiales »
c. spatiaux »
a. garantie de paiement
b. action que l’on doit faire quand on perd à un jeu
c. preuve, témoignage
Regardez la vidéo une première fois. Puis répondez aux questions :
Un ingénieur. Des ingénieurs. Silvia Casalino, elle, est …………………….. (mettez au féminin !)3
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Destination-
Francophonie/Episodes/p-25145-Destination-l-Espace.htm
Choisissez la phrase qui a le même sens :
Faites la différence entre les termes suivants. Lesquels désignent des personnes occupantun vaisseau spatial et que signifient les autres ? Reliez les lettres aux chiffres.
Qu’est-ce que le CNES ?
« Au moins dans le monde de la technologie de l’espace, le français est une …………………. ». L’expression manquante veut dire « la base, le fondement ». Trouvez l’expression appropriée :
« Le français en apesanteur ? Le CNES le permet chaque année lors de la semaine de la langue française où sont conviés les francophones du monde entier ». Trouvez ce que remplace le pronom complément « le » :
a. Les activités spatiales sont synonymes de progrès concernant la diffusion internationale
du français.
b. Oui les activités spatiales sont un gage du progrès scientifique mais elles contribuent aussi
à la diffusion de la langue française.
c. La langue française est un gage du progrès scientifique et technologique et la diffusion
du français aide les activités spatiales.
a. L’astrologue
b. L’astronaute
c. Le spationaute
d. L’internaute
e. Le cosmonaute
a. Centre National des Etudes Spatiales
b. Centre National des Evénements Spatiaux
c. Centre Numéral des Etudes Spatiales
a. pierre angulaire b. pierre circulaire c. pierre triangulaire
a. Le CNES permet que les francophones soient invités.
b. Le CNES permet qu’on parle français dans le monde entier.
c. Le CNES permet que le français soit parlé dans l’espace.
1. est envoyé dans l’espace par la Russie.
2. fait partie d’une mission américaine (États-Unis).
3. est un voyageur de l’espace français.
4. détermine le caractère et le destin des personnes
par l’influence des planètes.
5. utilise le réseau, surfe sur des sites.
5
6
7
8
Réponses page 50
lcf - Vidéo
33
Le jeu n’en vautLe jeu n’en vautLe jeu n’en vaut pas la chandelle pas la chandelle pas la chandelle pas la chandelle pas la chandelle pas la chandelle
© K
onfo
urie
r
lcf - Radio
Radio
Chronique par Yvan Amar de et exploitation pédagogique par Florence Teste
Radio France Internationale (RFI) met à disposition chaque semaine, sur son site Internet (htt p://www.rfi .fr/lff r/statiques/accueil_apprendre.asp), une émission radiophonique de une à deux minutes destinée à éclairer l’étymologie et/ou le contexte d’utilisation d’un mot lié à l’actualité. Vous trouverez ici une transcription exacte du texte avec des exercices d’écoute pour entraîner votre oreille à reconnaître les sons et pour découvrir le sens de cett e émission.
Chaque mois, nous vous proposons un extrait des Mots de l’actualité, une émission animée par Yvan Amar. Ce document audio vous permet de travailler et de tester votre compréhension orale.
Rubrique en partenariat avec
Le jeu n’en vaut pas la chandelle. Vaut, c’est le verbe :
1
aller
valoir
voir
«Ça ne vaut pas la peine» et «Ça ne vaut pas le coup» ont le même sens.
Vérifi ez les réponses des 4 questions précédentes ( page 50 )
3
Dans quel pays se trouve Lisbonne ?2
en Espagne
en Italie
au Portugal
Qu ’est-ce qu’une chandelle ?4
Vrai Faux une bougie
un aliment
un animal
Répondez à ces questions AVANT d’écouter le document audio.
Lisez les questions suivantes, écoutez le document audio et répondez aux questions.
5 Partir en vacances «en semaine»,cela signifi e :
partir pour une durée d’une semaine
partir la semaine prochaine
partir entre le lundi et le vendredi
de luxe
de lustre
de lucre
6 Complétez : La bougie, c’étaitun genre de chandelle …
© Linderhof
lcf - Radio
35
7 Quel est l’avantage et quels sont les inconvénients à partir en vacances en semaine ?
Avantage : ………………………………………….
..................................................................
..................................................................
Inconvénients : ……………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
La bougie La bougie
La chandelle La chandelle
8 Qu’est-ce qui éclaire le plus ? Qu’est-ce qui fait le plus de fumée ?
9 Relevez 5 mots comportant le son /u/ (ou) et 5 mots comportant le son /y/ (u)
Réponses page 50
Le jeu n’en vaut pas la chandelleLa transcription du texte :
Fernando Farao est un auditeur portugais qui nous écrit de Lisbonne pour nous demander le sens de l’expression « le jeu n’en vaut pas la chandelle ». C’est une expression française, bien française d’ailleurs, et assez courante. Cela veut dire qu’il n’est pas très intéressant de faire une chose. Ce qu’on peut y gagner, ben… c’est pas assez… assez intéressant, justement. Surtout si on pense à tout ce qu’on va risquer, ou si on pense à tout le temps, à tout le travail, que ça va demander. Pour utiliser d’autres mots, « le jeu n’en vaut pas la chandelle », ça signifie « ça ne vaut pas la peine », « ça ne vaut pas le coup ». Ça ne vaut pas la peine au sens propre, hein, ça ne vaut pas, ça ne mérite pas toute la peine qu’on prend pour faire ceci. Un exemple : partir en vacances en semaine pour avoir une réduction sur le billet de train, c’est moins cher. Seulement, ça oblige à prendre un jour de congé en plus, les enfants vont manquer l’école, tout ça, c’est bien compliqué ! Décidément, le jeu n’en vaut pas la chandelle.Alors on voit bien que l’expression est ancienne, puisqu’il est question de chandelles. Les chandelles, on ne s’en sert plus aujourd’hui pratiquement, hein. Il y a quelques siècles, on s’éclairait avec des chandelles. Notamment pour jouer aux cartes, ou à n’importe quel jeu, hein. Ben… il fallait bien s’éclairer. Souvent, ce sont des jeux du soir, des jeux de la nuit ! Alors on s’éclairait à la chandelle. Une chandelle, ce n’est pas exactement une bougie. Ça éclaire moins bien que la bougie et ça fait plus de fumée. La bougie, c’était un genre de chandelle de luxe, hein. Mais même si la chandelle n’est pas trop chère, il faut quand même l’acheter. Donc, on va la brûler si ça vaut la peine d’y voir clair. Si le jeu est sans intérêt, si on n’a aucune chance de rien gagner, ben… c’est inutile. C’est que le jeu ne vaut pas la chandelle.
© Matthew Bowden
http://www.rfi.fr/lffr/articles/105/article_2618.aspou sur :
Accédez à l’enregistrement :
En suivant ce lien, vous pouvez choisir d’écouter l’émission en ligne ou de la télécharger sur votre ordinateur :
Le coin des profsLe coin des profsLe coin des profs� and la radio devient � and la radio devient � and la radio devient libre en Francelibre en Francelibre en France
36
lcf - Pédagogie
Pédagogie
© BiblioArchives / LibraryArchives
Exploitation pédagogique par Alice Goy-Billaud
A travers la rubrique de ce mois-ci, vous pourrez parler de la radio de long en large mais aussi parler des médias en général et de l’utilisation qu’en font les apprenants.
Je vous propose pour une fois une compréhension écrite et, comme toujours, la possibilité d’ouvrir la discussion. Ensuite, donnez la parole aux étudiants et faites-en des chroniqueurs radio : à vous les studios !
Matériel :
Objectifs et compétences mobilisées : Lexique : les médias
CE – restituer et reformuler les événements chronologiques d’un texte
EO – parler des ses habitudes (individuelles et culturelles) sur la consultation des diff érents medias
et dans le prolongement :
Lexique – les expressions idiomatiques
CO – comprendre une émission de radio
EE/EO – créer un texte destiné à être lu à voix haute
* CE : compréhension écrite CO : compréhension orale EE : expression écrite EO : expression orale
Durée : 40 minutes + 30 à 45 minutes pour le prolongement
Effectif : Une petite classe est suffi sante (possible en cours particulier comme en grande classe)
Niveau : B1/B2
- La rubrique « société » du LCF n°7 p.15/16
- La rubrique « Les mots de l’actualité » du LCF n°6 p.32/33
- Un enregistreur (souvent les élèves en ont un sur leur téléphone portable !)
Le coin des profsLe coin des profsLe coin des profs� and la radio devient � and la radio devient � and la radio devient
A travers la rubrique de ce mois-ci, vous pourrez parler de la radio de long en large
N’hésitez pas à faire
des suggestions et des
commentaires à l’équipe
pédagogique de LCF
Magazine sur la mise en
pratique de cett e fi che !
37
lcf - Pédagogie
Prolongement
Conseil
Qu elle était la revendication qui a fait naître la loi de 1981 ?
Réponse : la volonté des radios de ne plus être les porte-parole de l’Etat.
Qu elle est la conséquence de cett e loi ?
(question simplifi ée : Juste après le passage de la loi, quels sont les deux courants qui se distinguent ?)
Réponse : les radios indépendantes qui veulent être plus professionnelles doivent faire appel à la publicité (radios commerciales). Les autres radios considèrent que la publicité empêche l’indépendance alors pour « survivre »,elles doivent faire appel à l’Etat (radios associatives).
Qu elle est la problématique actuelle ?
Réponse : il y a trop de radios. Il faut donc passer au numérique mais cela menace les petites radios car cela coûte cher.
Avant de proposer ce� e activité, vous pouvez vous appuyer sur une compréhension orale d’une
des rubriques les mots de l’actualité (j’ai personnellement déjà exploité « Y’a pas photo » du n°6 en oc-
cultant la question n°4) et proposer aux apprenants de choisir, comme dans l’émission, une expression
française qu’ils aiment et qu’ils peuvent expliquer aux autres « à la radio ».
Le brainstorming (ou remue-méninges) peut, au choix, précéder ou suivre les questionsde compréhension écrite. Il est basé sur les questions suivantes :
Qu e savez-vous de la radio dans votre pays ? (combien de stations ? quelles thématiques ? privées/
publiques ? …)
Ecoutez-vous beaucoup la radio ? (A quel moment de la journée ? Pour la musique, les infos, des émissions
en particulier ?)
2
Selon le temps dont vous disposez, vous pouvez faire préparer une courte rubrique à vos appre-
nants (individuellement ou en groupe de 2 maximum) qu’ils liront à haute et intelligible voix, dos aux
autres élèves (dans un enregistreur si vous en avez un sous la main). N’oubliez pas de corriger le scrip.
Pour obliger les apprenants à être a� entifs aux autres, vous pouvez leur demander plusieurs
choses : relever une erreur, trouver une question à poser, transcrire une phrase complète… etc. Vous
pouvez ensuite retravailler la diction des apprenants en réécoutant les enregistrements et en ayant dis-
tribué le script de l’émission à chaque élève.
Répondez aux questions de compréhension écriteRetracez l’histoire de la radio en associant les événements aux dates qui correspondent :
1
1960-70
1964
1977
1981
1984
a. 1ère radio française à émett re sans autorisation
b. La publicité est autorisée pour fi nancer les radios qui le veulent
c. Les radios sont la parole de l’Etat
d. 1ère radio anglaise à émett re sans autorisation
e. Loi sur l’indépendance des radios
Réponse : dans l’ordre chronologique : c., d., a., e., b.
J’aime pasJ’aime pasJ’aime pas le homard ! le homard ! le homard !
lcf - Cuisine
39
CuisineLEXIQUE
1. se plaindrait (v. se plaindre, conditionnel présent) :
ne serait pas heureux
2. archipel (n. m.s.) : groupe d’îles
3. chair (n. f.s.) : viande, pulpe
4. courbe (n. f.s.) : forme ronde
5. carapace (n. f.s.) : enveloppe très dure du corps
6. portion (n. f.s.) : partie, morceau, part
7. fi n fond (n. m.s.) : profondeur extrême
Bien sûr, je ne vais pas essayer de vous faire croire que je déteste le homard. Qu i se plaindrait1 d’avoir dans son assiett e un pâté aux fruits de mer des Îles-de-la-Madeleine, cet archi-pel2 situé en plein golfe du Saint-Laurent ? Ou quelques patt es de homard grillées dans un beurre parfumé aux fi nes herbes comme on en sert parfois à Marseille ? La question n’est pas là.
Qu and vous avez faim, que votre estomac ne tient plus en place et qu’on vous sert bêtement cet ho-marus gammarus (nom latin) d’un kilo dans sa dure coquille, dites-moi où est le plaisir de manger ce roi de la mer ?
Évidemment, certains diront que l’att ente de décou-vrir cett e chair3 rosée, sortant d’une patt e toute en courbe4, vaut à elle seule le plaisir. Att ention, ouvrir une patt e de homard n’a rien d’un strip-tease ! Il faut tout d’abord bien maîtriser les pinces, cet outil qu’on nous donne pour nous batt re avec le homard. Une fois, la carapace5 du homard ouverte, il faut aller chercher la chair qui, le plus souvent, arrive sur votre fourchett e en mille morceaux. Bref, on met quinze minutes pour sortir une seule patt e et trente secondes pour manger ce qu’il y a à l’intérieur.
Il y a aussi la queue. Plus large elle est, plus abon-dante sera la dégustation. Mais à part cett e portion6 appréciée du homard, que reste-t-il de mangeable du iseebi comme disent les Japonais ou de l’astakos pour les Grecs? Certainement pas les espèces d’oeufs de couleur verte qu’on retrouve dans le ventre de la bête marine. Je n’ai jamais su si c’était bon, telle-ment les avis dif èrent sur la question.
Et que dire des mains qui ressortent toute collées de l’expérience « gastronomique » ? Et du liquide qui
risque à tout moment de s’échapper du homard comme si c’était un pistolet à l’eau ! Je n’en parle même pas.
Ah ! Le jour où je retrouverai dans des menus des plats off rant plus souvent le homard sans sa co-quille, je serai tout à fait heureux ! À moins que je me décide tout simplement à manger des petites crevett es de Matane ou le très délicieux crabe des neiges qu’on pêche sur la Côte-Nord, à Natashquan, le pays du grand Gilles Vigneault !
Mais au fi n fond7 de moi, vous l’aurez de-viné, que les homards viennent de la Gas-pésie ou des Îles de la Madeleine, qu’ils se présentent à moi en sushi ou en salade, bon joueur, je ne refuserai pas en bout de ligne de les manger !
par André Magny
© Raphaël Labbé
©B
iodi
vers
ity
Her
itag
e Li
brar
y ©Je
rem
y C
outu
re
©T
Q,R
enau
d Ph
ilipp
e
Des vignobles du Qu ébec, Des vignobles du Qu ébec, Des vignobles du Qu ébec, je me souviens… je me souviens… je me souviens…
lcf - Vins
40
Vins
par Nathalie Mailhac
Lorsque, en 1535, Jacques Cartier explore le fl euve Saint-Laurent, il note la présence de vignes sauvages sur l’Île d’Orléans, en Nouvelle-France et c’est pour cett e raison qu’il lui donne le nom de L’Isle de Bacchus, une référence au dieu romain de l’ivresse.
En 1608, lorsque Samuelde Champlain s’ins-talle sur le site de la future ville de Qu ébec, il y plante des cépages français et constate qu’ils ne survivent pas à l’hiver du pays. Qu elques colons1 continuent de faire du vin à partir de raisinssauvages et d’autres baies2. Au XVIIIe siècle, la mau-vaise qualité de ces breuvages3 pousse les religieux qui cherchent du vin de messe, autant que les auber-gistes pour d’autres raisons, à importer des vins de France. Lors de la conquête par l’Angleterre et jusqu’à la Confédération en 1867, les Anglais interdisent ce commerce. Puis, à la fi n du XIXe et au début du XXe siècle, les échanges avec la France reprennent, en-couragés par la Prohibition4 aux Etats-Unis qui in-terdit d’autres voies d’approvisionnement5.
C’est dans les années 70, que le vignoble du Qu ébec connaît un nouvel épisode de replantation. D’ailleurs, Joseph-O Vandal est considéré comme le père de la viticulture moderne : avec quelques collaborateurs, il fonde en 1979 l’association des viticulteurs du Qu ébec.
A l’origine de cet intérêt, se trouve aussi le désir de renouer6 avec l’histoire même du pays de la « Belle Province », car le vin est considéré comme un lien fort avec l’héritage culturel français. Il relie le Qu ébec à l’image que celui-ci se fait des cultures européennes et françaises. A ce jour, la référence pour tout ce qui relève de la vigne et du vin reste toujours la France.
Le vignoble de l’extrêmeLe Qu ébec comprend 8 régions où l’on cultive la vigne : les Cantons-de-l’Est, la Montérégie, la région de la Capitale-Nationale, les Basses-Laurentides, Lanaudière, les Bois-Francs, l’Outaouais et le Témiscamingue. Il y a aussi quelques vignobles dans les régions nordiques de Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. On compte près de 70 domaines sur plus de 300 hectares.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, Montréal est situé sur la même latitude que Bordeaux ! Néanmoins, la vigne doit faire face à des conditions climatiques extrêmes. Les hivers sont longs et froids, avec des températures pouvant descendre jusqu’à moins 35℃ . Pour ces raisons, le travail de la vigne se concentre sur une période raccourcie7 de 6 mois par an.
La vigne réussit à survivre aux gels profonds de l’hiver grâce à une tech-nique originale de « butt age ». Elle s’inspire de la cultu-re des rosiers ! Il s’agit d’enfermer les pieds de vigne sous une grosse butte8 de terre afi n de maintenir une température correcte autour de la plante. Et comme dans tous les vignobles du monde, les cépa-
© V
igno
ble
Ste-
Pétr
onill
e
© Vignoble de l’Orpailleur
© V
igno
ble
de l’
Orp
aille
ur
© V
igno
ble
la C
hape
lle S
te-A
gnäs
lcf - Vins
41
ges les plus résistants face à ces conditions de culture très particulières ont été sélectionnés. Ici, ce sont des cépages hybrides et plus rustiques9, dont les princi-paux sont le Frontenac, le Vandal-Cliche du nom de ses deux créateurs, le Sainte-Croix et le Saint-Pépin ! Sans complexe, le Québec produit des vins rouges, blancs, rosés, effervescents10, des vendanges tardi-ves et des vins de glace.
Vins de glace au pays des neiges
Dans l’hiver, une fois les vendanges « classiques » terminées, on commence la récolte des raisins en sur-maturité11. Ils sont laissés à l’extérieur et placés dans des filets suspendus aux ceps de vigne. Le but est de les concentrer encore un peu plus en sucre par l’action du vent et du froid sec de
l’hiver. En janvier, février, quand les températures s’approchent de moins 10 degrés, ils sont ensuite pressés. A cette température, l’eau des fruits est gelée, alors que le jus extrêmement concentré en sucre ne l’est pas encore. Alors, quand le raisin est pressé, seul ce jus, comme un sirop, passe dans le pressoir et les cristaux d’eau sont retenus avec la pulpe de la baie.
C’est un procédé12 technique appelé « cryoextrac-tion ». Ce vin de glace contenant 40% de sucre, peut être rouge ou blanc. Il peut être servi à l’apéritif, sur un fromage ou au dessert. Ses arômes sont miné-raux, de fruits jaunes et de miel.
Sites pour aller plus loin : http://www.vinsduquebec.com/frhttp://www.advvq.com/http://www.vignobleorleans.com/http://orpailleur.ca/http://www.vindeglace.com/vignoble.htm
© V
igno
ble
la C
hape
lle S
te-A
gnäs
LEXIQUE
1. colons (n. m.p.) : habitants des colonies (venus
d’autres pays)
2. baies (n. f.p.) : petits fruits
3. breuvages (n. m.p.) : boissons
4. Prohibition (n. f.s.) : période de l’Histoire des États Unis
où l’alcool était interdit
5. voies d’approvisionnement : moyens de se fournir
6. renouer (v.) : recréer un lien qui a déjà existé
7. raccourcie (adj. f.s.) : plus courte
8. butte (n. f.s.) : petit tas de terre, motte
9. rustiques (adj. m.p.) : résistants, pas fragiles
10. effervescents (adj. m.p.) : pétillants, avec des bulles
de gaz
11. sur-maturité (n. f.s.) : état des fruits qui sont trop mûrs
12. procédé (n. m.s.) : façon de faire, mode de fabrication
© V
igno
ble
de l’
Orp
aille
ur
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération
Le pancakeLe pancakeLe pancake
lcf - Recett e
Recette LEXIQUE
1. grumeaux (n. m.p.) : petites boules mal mélangées
2. torchon (n. m.s.) : serviett e spéciale pour la cuisine
3. louche (n. f.s.) : grande cuillère qui sert principalement
à servir les liquides
1/ Séparez le blanc et le jaune des œufs dans deux saladiers.
2/ Fouettez les jaunes avec le lait, la farine, la levure et un pincée de sel.
3/ Ajoutez le sucre et fouettez jusqu’à obtenir une pâte sans grumeaux1.
4/ Mettez une pincée de sel dans les blancs d’œufs et battez-les pour les monter en neige.
5/ Déposez les blancs en neige sur le mélange précédemment réalisé et mélangez délicatement l’ensemble en faisant attention de ne pas faire re-tomber les blancs.
6/ Recouvrez la préparation d’un torchon2 propre et laissez-la repo-ser au moins 1 h pour que la levure fasse gonfl er la pâte. Pour les plus patients, la pâte réalisée la veille et conservée au réfrigérateur est encore meilleure.
7/ Pour la cuisson, il suff it de graisser une poêle et de la placer sur feu moyen, puis de verser l’équi-valent d’une petite louche3 de pâte. Retournez-les à mi-cuisson (environ 1 minute) pour faire dorer les deux faces.
Il ne vous reste plus qu’à déguster avec un peu de confi ture, de miel ou du si-rop d’érable (du Québec, bien sûr !).
Le pancake, que l’on pourrait traduire litt éralement en français par « gâteau à la poêle », est dégusté dans de nom-breux pays au petit déjeuner. Spéciale-ment apprécié en Amérique du nord, il aurait été importé par les colons ve-nus d’Europe, notamment d’Allema-gne et des Pays-Bas. Très réputé aux Etats-Unis, on l’appelle « hotcakes »,
« griddlecakes » ou « fl apjacks ». Les Britanniques le mangent traditionnellement pour le Mar-di gras et le nomment « Panca-ke Tuesday ». Même si le nom dif ère, tout le monde s’accorde sur le plaisir de sentir l’odeur d’un pancake chaud au réveil.
Au Canada, d’où nous vient cett e version de la recett e, on l’appelle « crêpe ». Mais pas de risque de le confondre avec une précédente recett e de LCF (numéro sur Lorient). Il ne ressemble pas du tout à la crêpe bretonne : d’un diamètre de 5 à 10 cm, il est deux à trois fois plus petit que la spécialité bretonne. La levure ajoutée à sa pâte lui donne un moelleux incontestable.À vous de comparer !
Par Rémi Orzalesi
Rece� e pour 12 pancakes
© J
anin
e
© Th e culinary geek
2 oeufs
2 pincées de sel
15 cl de lait
120 g de farine
1 cuillère à café de levure chimique
2 cuillères à soupe de sucre en poudre
20 g de beurre pour la cuisson
Ingrédients : Pour 12 pancakes
© J
ack
and
Jaso
n’s
panc
akes
542
Escapade Escapade Escapade gourmande gourmande gourmande gourmande gourmande gourmande
lcf - Produit régional
44
Produit régional
L’Outaouais est située à moins de 200 km à l’ouest de Montréal avec comme principale voisine Ott awa, la capitale nationale des Canadiens. Profi tant d’un climat plus chaud que d’autres régions au Qu ébec, l’Outaouais off re à ses nombreux visiteurs de magni-fi ques produits du terroir.
Avec près de 400 kilomètres d’espaces verts, le Parc de la Gatineau est une belle invitation à la dépense de calories que ce soit par le vélo, la course ou les randonnées pédestres. Au bout du compte, cett e dé-pense d’énergie mé-rite bien une petite récompense !
À Chelsea, petit village à 20 km de Gatineau, on trouve le fumoir2 de La Boucanerie. Insti-tution vieille d’une trentaine d’années, on y propose l’un des meilleurs saumons fumés de tout l’ouest du Qu ébec. Héritage du savoir-faire autochtone3, le fu-mage de poisson notamment au bois d’érable est l’une des spécialités québécoises, que ce soit, non seulement pour le saumon, mais aussi les pétoncles, la truite, l’anguille ou le maquereau (tous produits de la mer).
Un peu plus au nord, le romantique village de Wa-kefi eld propose de vous sucrer le bec4 grâce aux nombreux produits de la Confi serie Wakefi eld. En regardant la rivière Gatineau coulant juste en face de la confi serie, vous dégusterez confi tures, condi-ments5, chocolats, fudge6 et sucre à la crème. Sucre
à la crème ? Il s’agit d’une sucrerie tradition-nelle ; elle est faite à partir de sirop d’érable7, de crème et d’un peu de beurre. On laisse bouillir le tout, on brasse8 de façon énergi-que jusqu’à épaississement, on met au frigo, on découpe en carré et… on savoure9 ! Il y a aussi un bonbon datant de l’époque de la Nouvelle-France : la tire Ste-Catherine. Au XVIIe siècle, Marguerite Bourgeois, religieu-se fondatrice de la congrégation Notre-Dame de Montréal, avait inventé, pour att irer les petits autochtones à l’école, ce bonbon fait
pour la première fois un 25 novembre, jour de la fête de la Sainte-Catherine. Mais pourquoi « tire » ? Parce qu’une fois le mélange fait principalement de mé-lasse10, de sucre et de beurre, on l’étire11 longuementaprès un lent bouillonnement12 afi n qu’il prenne une belle couleur dorée.
Par André Magny
© jean-louis zimmermann
Traversée par la rivière du même nom, la région de l’Outaouais a toujours été une voie de communication importante, depuis l’époque où les coureurs des bois de la Nouvelle-France parcouraient les forêts à la recherche de peaux de castor. C’est peut-être pour cela que les échanges avec les diff érentes cultures qui l’ont façonnée1 ont joué un rôle si important dans son développement.Y compris les échanges alimentaires.
© P
er P
ett e
rsso
n
© C
écile
Ben
oit
LEXIQUE
1. façonnée (v. façonner, participe passé) : fabriquée,
composée
2. fumoir (n. m.s.) : lieu pour faire des poissons
ou des viandes fumées
3. autochtone (adj. m.s.) : local
4. bec (n. m.s.) : «bouche» des oiseaux
5. condiments (n. m.p.) : assaisonnements
6. fudge (n. m.s.) : caramel au chocolat
7. érable (n. m.s.) : arbre, symbole du Canada
8. brasse (v. brasser) : mélange
9. savoure (v. savourer) : déguste, prend plaisir à manger
10. mélasse (n. f.s.) : sirop
11. étire (v. étirer) : étend, allonge
12. bouillonnement (n. m.s.) : cuisson
13. pacanes (n. f.p.) : noix de pécan
14. tartinade (n. f.s.) : pâte à tartiner
15. gibiers (n. m.p.) : animaux sauvages que l‘on chasse
Cours de français Cours de français Cours de français à Paris à Paris à Paris
lcf - Correspondants
45
Correspondants
En mai 2012, LCF avait mis en place un projet de fi nancement participatif. Chacun pouvait participer à un tirage au sort qui permettait de gagner une semaine de cours de français à Parisà l’école France Horizons. C’est Guillemette,une enseignante de français de Hong Kong qui l’avait remporté.
Je m’appelle Guillemett e, j’habite et j’enseigne le fran-çais à Hong Kong depuis presque 7 ans maintenant. Pour moi, enseigner le français, c’est la possibilité d’un échange : non seulement mes étudiants viennent à la rencontre de ma langue et de ma culture, mais c’est aussi leur langue, leur culture, leur histoire qui sont en jeu. Aimer le français, c’est pour moi aimer les autres langues et cultures en même temps !
Guillemette a gentiment fait cadeau de ce séjourà l’une de ses étudiantes : Héloïse.Je m’appelle Héloïse. Je suis étudiante à Hong Kong mais je viens de la province du Hunan en Chine. Je suis entrée en contact avec le français au lycée parce qu’il y avait une professeure française qui est arrivée à mon lycee pour nous apprendre cett e langue. Donc j’ai commencé mes études de français et j’ai eu mon nom français : Héloïse. J’aime la culture française. En parti-culier, j’aime la litt érature française et la critique litt é-raire française. Pendant mes loisirs, je regarde des fi lms français et je vais aux programmes du French May chaque année. Mais je dois plus pratiquer le françaiset j’avais vraiment hâte d’aller en France cet été.
Et voilà ce qu’Héloïse nous a confi é à son retour :Le premier jour où je suis arrivée, j’ai marché dans des rues incon-nues à Paris en portant une grosse valise. Je ne connaissais person-ne, mais en suivant les instruc-tions données par France Hori-zons, je me suis trouvée devantune maison à Simplon et bientôt dans
une chambre très agréable avec des meubles en bois où j’ai passé mes 4 nuits à Paris. Ensuite, j’ai ren-contré les professeurs et les autres étudiants et je me suis toujours bien sentie avec eux. Chaque soir, on mangeait dans le petit jardin de la maison. Grâce aux autres étudiants, il y avait toujours des variétés de vins à déguster. Après le dîner, Benoit jouait de la guitare et Noé du tambour. C’était comme un cours de civilisation parce qu’on avait aussi les pa-roles des chansons et on pouvait les apprendre. La nuit tombait quand on chantait. C’était vraiment sympa.
Qu and on est allé au centre Pompidou, on a reçu une feuille de papier qui nous a donné la mission de choi-sir notre œuvre préférée et de la présenter. J’adore les œuvres d’art et les expositions que j’ai vues là-bas. J’ai aussi beaucoup apprécié que chaque personne présente son œuvre préférée et celle qu’il détestait. C’était très drôle d’entendre les critiques créatives et intéressantes. Nous avons beaucoup ri.
On a fait la traversée de Paris à pied sur une journée. J’ai vu les aspects diff érents de Paris et j’ai décou-vert son histoire avec les explications des professeurs. Qu and on att endait le train ou quand on faisait une pause dans un café ou dans un parc, on avait toujours le plaisir de faire de petits jeux en français. J’étais obligée de me forcer à parler français tout le temps, mais j’ai vécu des moments très agréables. C’était plus qu’une expérience touristique :elle m’a off ert les connaissances culturelles, l’amélio-ration de la langue et de bons souvenirs avec mes nou-veaux amis.
Merci à LCF et France Horizons de m’avoir fait profi ter de ce séjour !
Et voilà ce qu’Héloïse nous a confi é à son retour :Le premier jour où je suis arrivée, j’ai marché dans des rues incon-nues à Paris en portant une grosse valise. Je ne connaissais person-ne, mais en suivant les instruc-
une maison à Simplon et bientôt dans
jeux en français. J’étais obligée de me forcer à parler français tout le temps, mais j’ai vécu des moments très agréables. C’était plus qu’une expérience touristique :elle m’a off ert les connaissances culturelles, l’amélio-ration de la langue et de bons souvenirs avec mes nou-veaux amis.
Merci à LCF et France Horizons de m’avoir fait profi ter de ce séjour !
une chambre très agréable avec des meubles en
Le voyage de Le voyage de Le voyage de Sophie Sophie Sophie Sophie Sophie Sophie Sophie Sophie Sophie
lcf - Le voyage de Sophie
47
Le voyage de Sophie
par Sophie Trintignac
Après la visite de Bélem, Sao Luis et Fortaleza, je poursuis la descente du littoral brésilien et arrive à Récife. Je pars m’instal-
ler quelques jours chez Yuri et sa grande famille, dans un quartier sur les hauteurs de la ville.
x
Yuri est un jeune garçon de 17 ans qui apprend le français à l´école. Lorsque j’arrive chez lui, sa grand-mère que l’on appelle “Tia” att end sur le pas de la porte1. À la minute où j’entre dans leur maison, je suis étonnée. En eff et, il y a beaucoup de gens qui dis-cutent et préparent le repas dans la petite cuisine. Je fais la connaissance avec la soeur de Yuri, sa maman, ses tantes, ses oncles et plein d’autres fem-mes, voisines et amies. Qu elle grande famille !
On m’installe à table avec Yuri, il y a plein de nourriture : feijao, riz, saucisses, jambon, gâteau de manioc… Tout le monde m’observe, soucieux2 que je ne manque de rien. On me sert à manger, on m’apporte de l’eau dès que mon verre est vide. Yuri m’apprend que je suis la premiere Française que lui et sa famille rencon-trent !
Les repas sont très animés, tout le monde est très sympathique et souriant. Yuri s’amuse à faire répéter des mots français à ces personnes qui ne connaissent pas d’autre langue que le brésilien : “bonjour”, “mer-ci”… Lorsque j’essaie de parler en portuguais, toute la famille rit car on ne me comprend pas toujours. Qu and Yuri est présent, il peut traduire mais quand il n’est pas là, il faut utiliser le mime3, l’imitation, ce qui donne lieu à des situations cocasses4. Yuri est un garçon très drôle. Son rêve est de venir
passer une année en France et il voudrait in-tégrer l’école du cirque. Je le vois très bien tra-vailler dans ce domai-ne. Il aime rire et faire rire, il aime danser.
Sa grand-mère m’étonne chaque jour par son éner-gie débordante. Chaque matin de bonne heure5, elle nett oie le linge de toute la famille, y compris6 le mien ! Après seulement quelques jours, tout le mon-de me fait sentir que je fais partie de la famille. C’est dimanche. Nous sommes invités à la «baby show» de la demi-soeur de Yuri. Nous partons à pied en passant par des ruelles minuscules aux escaliers étroits7. La fête se passe au coeur du quartier. Les tables sont installées dehors. Dans la salle, il y a les gâteaux et les dragées8. Bientôt, toutes les femmes sont invitées à participer à des jeux. On forme une ronde9 et on se fait passer un ananas, comme une “bombe”. Qu and la musique s’arrête, celle qui porte l’ananas tire au sort10 un morceau de papier et doit faire ce qui est y écrit. L’ambiance est bon enfant11. On continue la séquence jeux par les chaises musica-les : je fi nis troisième ! Me voir ainsi participer fait beaucoup rire toute la famille. En quitt ant la fête, je reçois comme tous les autres mon petit paquet de dragées que je garde précieusement en souvenir ! Avant de partir pour de nouvelles aventures, des voi-sines et amis de Yuri me confi ent12 qu’elles vont ap-prendre le français pour qu’à mon retour, on puisse mieux discuter !
Je suis heureuse de tous ces bons moments passés en leur compagnie.
Sophie Sophie Sophie Sophie Sophie Sophiepar Sophie Trintignacpar Sophie Trintignac
Après la visite de Bélem, Sao Luis et Fortaleza, je poursuis la descente du littoral brésilien et arrive à Récife. Je pars m’instal-
ler quelques jours chez Yuri et sa grande famille, xarrive à Récife. Je pars m’instal-xarrive à Récife. Je pars m’instal-
LEXIQUE
1. pas de la porte : seuil, partie qui se trouve devant
la porte d’une maison
2. soucieux (adj. m.s.) : inquiet, préoccupé
3. mime (n. m.s.) : geste qui permet d’exprimer
quelque chose, discussion avec les mains
4. cocasses (adj. f.p.) : comiques, amusantes
5. de bonne heure (adv.) : tôt
6. y compris (expression) : incluant
7. étroits (adj. m.p.) : pas larges
8. dragées (n. f.p.) : sucreries off ertes lors de grands
évenements
9. ronde (n. f.s.) : chaîne que forment des personnes
en se tenant par la main
10. tire au sort : choisit au hasard
11. bon enfant (adj. invariable) : sympathique, simple
12. confi ent (v. confi er) : disent
et Alias présentent
infos, billetterie et programmation : lesinrocks.com. Locations : Fnac, Carrefour, Géant, fnac.com, sur l’appli Tick&Live et lesinrocks.com
Carte Blanche au label Domino - Kitsuné Maison En Vrai! #14
MAJOR LAZER � FOALS � SUEDE � AUSTRA VALERIE JUNE � BRETON � SUUNS � LAURA MVULA
ALUNAGEORGE � THESE NEW PURITANS CHRISTINE AND THE QUEENS � LONDON GRAMMAR
PETITE NOIR � MATTHEW E. WHITE � TEMPLES � DRENGE � PAPA TROUMACA � YOUNG FATHERS � PORTLAND � EVERYTHING EVERYTHING � LUCIUS
ARTHUR BEATRICE � SWIM DEEP � SOHN � CASUAL SEX � JACCO GARDNER YEARS & YEARS � SIVU � DEPTFORD GOTH � FINDLAY � SIR SLY � MØ � ROCKY
TELEMAN � HOLLYSIZ � THE AMAZING SNAKEHEADS � HALF MOON RUN
Paris - Tourcoing - Caen - Nantes - Bordeaux - Nancy - ToulouseDu 6 au 12 novembre 2013ph
oto :
Oliv
ia Fr
emin
eau
/ tat
ouag
es :
Sailo
r Rom
an
Trouvez des homonymes pour les mots suivants (homonyme = mot qui a la même prononciation mais pas le même sens).
1. CONTRAIRES
4. PRONONCIATION
5. ANIMAUX
par Florence Teste
Solutions des jeux page 51
crédits photos : 1-manumilou, 2-fidber, 3-New Brunswick tourism, 7-goingslo; 9-La case photo de Got, 10-Philippe Guillaume, 11-zigazou76
1 2
7 8 9 10 11
3 4 5 6
2. HOMONYMES
attendu ≠ .....................................................normal ≠ ......................................................habituel ≠ ....................................................buvable ≠ ....................................................légal ≠ ...........................................................vaincu ≠ .......................................................limité ≠ .........................................................politique ≠ ..................................................amical ≠ .......................................................poli ≠ ...........................................................
Entourez en rouge les mots qui se prononcent avec le son /j/ (comme dans «yeux») et en bleu ceux qui se prononcent /il/.
Reliez le nom de ces animaux à leur photo :
Ecrivez les adverbes qui correspondent aux adjectifs suivants et déduisez-en la règle de for-mation des adjectifs en -ant/-ent.Ex : constant => constamment
3. ADVERBES
bacille �lle tranquille bille docile
quille mille Gilles pile ville
castor b ison angui l le saumon chèvre pétoncle
p intade sangl ier maquereau or ignal gr izz l i
cour : ............................. ..................................................................
mais : ...............................................................................................
cou : ............................. ..................................................................
f réquent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .courant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bruyant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v io lent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .incessant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prudent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .conscient : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . apparent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d i f férent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .récent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Donnez le contraire des adjectifs suivants :
lcf - Jeux
49
Jeux
Réponses « Grammaire » (page 29)Qui est-ce ? C’est qui ?
Que fait-il ? Qu’est-ce qu’il fait ? Il fait quoi ?
Pourquoi travaille-t-il dans cette cour ?
Pourquoi est-ce qu’il travaille dans cette cour ? Pourquoi il travaille dans cette cour ?
Depuis combien de temps travaille-t-il ?
Depuis combien de temps est-ce qu’il tra-vaille ?
Depuis combien de temps il tra-vaille ?
Quand a-t-il commencé sa journée de travail ?
Quand est-ce qu’il a commencé sa journée de travail ?
Quand il a commencé sa journée de travail ?
A quelle heure va-t-il s’arrêter ? A quelle heure est-ce qu’il va s’arrêter ? A quelle heure il va s’arrêter ?
Où est-il ? Où est-ce qu’il est ? Où il est ?
Dans quel pays cela se passe-t-il ? Dans quel pays est-ce que cela se passe ? Dans quel pays ça se passe ?
Quel âge a-t-il ? Quel âge est-ce qu’il a ? Quel âge il a ?
Comment s’appelle-t-il ? Comment est-ce qu’il s’appelle ? Comment il s’appelle ?
Est-il marié ? Est-ce qu’il est marié ? Il est marié ?
Combien y a-t-il de pierres empilées ? Combien est-ce qu’il y a de pierres empilées ? Combien il y a de pierres empilées ?
A quoi cette machine sert-elle ? A quoi est-ce que cette machine sert ? A quoi sert cette machine ?A quoi cette machine sert ?
2. - Comment vous appelez-vous ?- Je m’appelle Marcel Dupont.- Quelle est votre date de naissance et où êtes-vous né ?- Je suis né le 14 octobre 1959 à Lille.- Quelle est votre adresse actuelle ?- J’habite au 16, rue Pasteur à Marseille.- Quel est votre métier ?- Je suis boulanger.- Que faisiez-vous le 30 septembre dernier à 22h ?- Le 30 septembre, je regardais la télévision chez moi.- Quelqu’un peut-il le confirmer ?- Oui, ma femme était avec moi.
- Saviez-vous que votre voisine avait été assassinée ?- Oui, je le savais, je l’ai lu dans le journal.
a) Qui est arrivé du Canada ?D’où vient le frère de Gilles ?Comment le frère de Gilles est-il arrivé ?Quand est-il arrivé ?A quelle heure est-il arrivé ?
b) Avec quelle fréquence / tous les combien Isabelle rejoint-elle le groupe d’enfants ?
Que fait Isabelle tous les samedis après-midi ?Qui Isabelle rejoint-elle tous les samedis après-midi ?Pourquoi Isabelle rejoint-elle ce groupe d’enfants ?
1.
3.
- Le «lucre» signifie le profit, le gain.
7. Avantage : le billet de train est moins cher Inconvénients : il faut prendre un jour de congé en plus
les enfants doivent manquer l’école
8. La bougie éclaire plus.
La chandelle fait plus de fumée.
9. /u/ : nous, courante, surtout, tout, coup, jouer, bougie
/y/ : portugais, justement, utiliser, réduction, plus, fumée, luxe, brûler, inutile
1. Valoir : je vaux, tu vaux, il vaut…
2. Lisbonne est la capitale du Portugal
3. C’est vrai
4. Une bougie
5. Partir entre le lundi et le vendredi. «En semaine» s’oppose à «en week-end».
6. La bougie, c’était un genre de chandelle de luxe.
- Un «lustre» est un luminaire que l’on suspend au
plafond; c’est aussi le caractère d’un objet brillant.
Réponses « Radio » (page 34)
R1 : un décollage
R2 : Le mot « question » est féminin. Donc « questions spatiales ».
R3 : Même si Silvia est peut-être « ingénieuse » (un synonyme de « intelligente »), elle est surtout « ingénieure » !
R4 : c. et b.
Réponses « Vidéo » (page 32)R5 : a. 4., b. 2., c.3., d.5., e.1.
R6 : a.
R7 : a.
R8 : c.
50
Langue et Culture FrançaisesISSN : 2267-4705n° CPPAP : 0715 G 91889SIRET : 795 238 658 00012Siège : 34, rue du Major Flandre34090 [email protected] Magazine, association loi 1901, enregistrée en préfecture de l’Hérault sous le numéro W 343014632.
Directrice de publication : Florence TESTE - [email protected]
Assistante de publication : Mélanie HERNANDEZ
Directeur artistique : Rémi ORZALESI
Directrice commerciale : Clarisse MARATCHIA - [email protected]
Rédactrice en chef : Florence TESTE
Comité de relecture : Florence TESTE Mélanie HERNANDEZ Claire BILLIET
Rédacteurs : Myriam BAUDIC Julie BOUDILLON Pit CÉVENOL Alex FLACOUTE André GAGNY Alice GOY-BILLAUD Cécile JOSSELIN Fabien LECOEUVRE Nathalie MAILHAC Rémi ORZALESI Florence TESTE Sophie TRINTIGNAC
Illustration : Bangali illustration
Maquett e : Rémi ORZALESI Amélie PRINS - a! création
Publicité : La régie du FLE - laregie.fl [email protected]
Imprimerie : MOON-IMPRESSION Rue des pommiers - Avèze - 30120 Le Vigan
Voix : Marion PREITÉ
Ingénieur son : Aymeric GARDEIL
Remerciements : Héloïse VUITTON Ivan KABACOFF - TV5 MONDE Yvan AMAR - RFI Maxime ROY - www.lemotpourlafri.me
Jeu 1 : LES CONTRAIRES
cour (jardin en ville) : - court (contraire de long)- cours (classe)- cour (du roi)
mais (opposition) : - mai (mois)- mets (plat, nourriture)- met (verbe mettre)
cou (partie du corps) : - coût (prix, valeur)- coup (geste violent)- coud (verbe coudre)
fréquent : fréquemment courant : couramment bruyant : bruyammentviolent : violemment incessant : incessamment prudent : prudemment conscient : consciemment apparent : apparemment différent : différemment récent : récemment
les adjectifs qui fi nissent par -ant ont leur adverbe en -amment
les adjectifs qui fi nissent par -ent ont leur adverbe en -emment
pour former le contraire dʼun adjectif, on peut ajouter devant le mot le préfi xe «a-», «in-», «im-» ou «il-»- im- devant la lettre p et b- il- devant la lettre l
Les mots qui sʼécrivent -ill se prononcent /j/ sauf mille, tranquille, ville, bacille et Gilles (qui se prononcent /-il/)Les mots qui sʼécrivent -il se prononcent toujours /il/
en bleu : bacille, ville, tranquille, docile, mille, Gilles, pileen rouge : fi lle, bille, quille
Jeu 4 :
Jeu 5 :
PRONONCIATION
ANIMAUX
Solutions des jeux de la page 49
Jeu 2 : HOMONYMES
Jeu 3 : ADVERBE
attendu inattendunormal anormalhabituel inhabituelbuvable imbuvablelégal illégalvaincu invainculimité illimitépolitique apolitiqueamical inamicalpoli impoli
==========
castor pétoncle pintade
chèvreanguillegrizzlisaumonbison
maquereausanglierorignal
En produisant sa version papier, LCF Magazine veut participer à la protection de la planète. Pour cela, nous avons choisi de faire confi ance à un imprimeur local qui travaille dans le respect des labels écologiques :
![Page 1: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Le magazine LCF N° 12 [langue & culture fançaise]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013121/6314c8ed6ebca169bd0af3b5/html5/thumbnails/27.jpg)