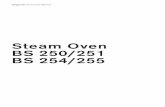"Le discours scientifique de Panurge", Seizième siècle 8 (2012), p. 255-272.
-
Upload
orient-mediterranee -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of "Le discours scientifique de Panurge", Seizième siècle 8 (2012), p. 255-272.
SEIZIÈME SIÈCLE 8 / 2012 p. 255-272
Marie-Laure MonfoRt / CnRS/uMR 8167. Laboratoire de Médecine grecque
LE dISCouRS SCIEntIfIquE dE PanuRGE
’établissement d’une Bibliographie des éditions cornariennes réalisée dans le cadre de ma thèse de doctorat soutenue en 1998 sous la direction de Jacques Jouanna, intitulée L’apport de Janus Cornarius (ca. 1500-1558) à l’édition et à la tra-duction de la collection hippocratique, m’avait permis de dé-couvrir deux ouvrages de Janus Cornarius passés jusqu’alors
inaperçus, une édition grecque des Aphorismes d’Hippocrate publiée à Ha-guenau vers 1527, et un discours in laudem peregrinationis prononcé à Wit-tenberg à une date incertaine, publié en 15311. L’examen de ces textes montre d’une part que l’édition de Haguenau fut le modèle principal du texte grec des Aphorismes d’Hippocrate publié par Rabelais en 1532, et d’autre part que le discours in laudem peregrinationis comporte quelques détails autobiogra-phiques représentant l’orateur sous les traits d’un jeune vagabond polyglotte contraint de s’adapter aux langages des pays traversés pour assurer sa pitance, un personnage évoquant aussitôt le compagnon de Pantagruel lors de sa pre-mière apparition dans l’œuvre littéraire du médecin français2. Tels sont les premiers indices qui m’ont conduite à examiner l’hypothèse selon laquelle un certain Johann Haynpol de Zwickau, dit Janus Cornarius, auteur d’une traduction latine des œuvres d’Hippocrate publiée en 1546 à Bâle par Hie-ronymus Froben, qui représente une étape majeure dans la transmission du corpus hippocratique, pouvait avoir fourni à Rabelais le modèle historique de Panurge. Bien qu’aucune affirmation explicite de la part de ces deux médecins humanistes ne vienne jusqu’à présent confirmer cette identification inédite, supposant la rencontre effective des deux étudiants en médecine quelque part
1 M.-L. Monfort, L’apport de Janus Cornarius (ca. 1500-1558) à l’édition et à la traduction de la Col-lection hippocratique, Thèse Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 1998 ; Quarum artium ac linguarum cognitione medico opus sit. Præfatio ante Hippocratis aphorismorum initium, per ianum Cornarium zuic-cauiensem, habita Rostochii. Aphorismi Hippocratis græce, Haguenau, Secerius, s. d., VD16 C. 5140, BnF T 21.17 ; in peregrinationis laudem Præfatio ante D. Hippocratis de ære, aquis et locis libellum, per ianum Cornarium zuiccauiensem habita Vuittembergæ dans Parthenii Nicænsis, de amatoriis affectionibus liber iano Cornario interprete, Bâle, Froben, 1531, VD16 P 788, BnF Y2. 6023, p. 57-76 ou BSB A. gr. b. 2395 (numérisé, en ligne).
2 « Comment Pantagruel trouva Panurge, lequel il ayma toute sa vie. », Pantagruel, ch. IX dans F. Ra-belais, Œuvres complètes, édition établie, présentée et annotée par M. Huchon avec la collaboration de F. Moreau, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1994, p. 246. Par commodité, les références à Rabe-lais dans ce qui suit renverront à cette édition désignée ci-après OC ; M.-L. Monfort, Janus Cornarius et la redécouverte d’Hippocrate à la Renaissance, Turnhout, Brepols, 2012, en cours de publication.
Marie-Laure Monfort256
en France vers 1527-1528, cette hypothèse, qui trouve quelques échos dans la saga pantagruélienne, éclaire certains aspects toujours énigmatiques du per-sonnage de Panurge, en raison de l’originalité de la doctrine médicale de Janus Cornarius, inconnue des spécialistes de Rabelais, et que l’on peut résumer en disant qu’elle se fonde sur la thèse d’un Hippocrate pneumatiste, relativement nouvelle à cette date de l’histoire des sciences3.
cueiLLeuR de pommes
On n’ignore pas, bien sûr, que Panurge est avant tout une création littéraire, distincte du ou des personnages réels dont elle s’inspire, et l’on connaît la mise en garde du fondateur des études rabelaisiennes, promoteur des enquêtes sur les réalités historiques reconnaissables à l’arrière-plan de la fantaisie littéraire, qui déconseille de « vouloir découvrir, par exemple, dans les deux géants du Gargantua ou dans Frère Jean, ou encore dans Panurge, au livre suivant, une image exacte d’un individu unique »4. Les spécialistes de Rabelais reconnais-sent néanmoins à l’unanimité, et quasiment depuis toujours, l’existence d’une énigme Panurge, dans la mesure où le compagnon de Pantagruel ne peut pas prétendre au statut de caractère ou de type, n’est jamais devenu l’équivalent d’un Don Quichotte, d’un Dom Juan, d’un Figaro ou d’un Faust, au point de s’attirer à juste titre la qualification d’« Homme sans qualités » proposée par Myriam Marrache-Gouraud dans sa récente étude monumentale sur Panurge, qui nous assure qu’aucun modèle historique de l’ami de Pantagruel n’a jamais été identifié ou seulement suggéré5.
Le plurilinguisme de Panurge est généralement lu, à juste titre, comme une imitation des divers langages de Maistre Pierre Pathelin à partir du v. 834 de la Farce anonyme du XVe siècle, qui lui servent à feindre la maladie mentale (je feray semblant de resver v. 780) puis l’agonie (il se mourra / tout parlant v. 969-970) pour éviter de payer le drapier auquel il avait soutiré six aunes de drap bleu clair. Ces idiomes de Pathelin, si souvent cité par Rabelais, sont empruntés aux patois limousin, picard, normand et breton, puis à un latin ap-proximatif grâce auquel il gagne son affaire, avant de conseiller stupidement à son propre client le berger de s’en tenir en toute circonstance à Bee pour
3 A. Lefranc, Rabelais. Études sur Gargantua, Pantagruel, le Tiers Livre, Paris, Albin Michel, 1953, p. 263-315 ; É. Aron, « Ce que Rabelais doit à la médecine et ce que la médecine lui doit », Rabelais en son demi-millénaire, Études rabelaisiennes XXI, éd. J. Céard et J. C. Margolin, Genève, Droz, 1988, p. 87-95 ; A. Gouazé, « Rabelais et l’anatomie », ibid., p. 97-101.
4 A. Lefranc, op. cit., 1953, p. 75.5 L. Schrader, « Panurge : théories récentes – observations méthodologiques – conséquences possibles »,
Études rabelaisiennes, t. 21, op. cit., 1988, p. 145-156 ; M. Marrache-Gouraud, « Hors toute intimidation ». Panurge ou la parole singulière, Études rabelaisiennes, t. 41, Genève, Droz, 2003.
Le discours scientifique de Panurge 257
renverser à son tour « le droit de ta partie adverse »6. Rien de ces tromperies malhonnêtes dans les discours d’une autre étendue linguistique de Panurge, qui est au contraire, dès son apparition au chapitre IX de Pantagruel, non pas le πανοῦργος « méchant » et « fourbe » dépeint par Michael Screech, mais un homme « adroit » et « inventif » – sens premiers de l’adjectif grec – au point d’ouvrir à un savant anglais « le vrays puys et abisme de encyclopédie »7, et plus tard de ranimer le pédagogue Épistémon « qui avoit la coupe testée »8. Pa-nurge qui en tout cas, dans toutes les langues de la culture européenne ou non qu’il pratique, et même dans les jargons fantaisistes jadis étudiés par É. Pons, ne demande jamais que du pain9. Le discours de Janus Cornarius in peregri-nationis laudem, prononcé à l’Université de Wittenberg entre 1527 et 1531, tenait ce propos très comparable à celui de Panurge en demandant à son audi-toire, au retour de son voyage dans une grande partie de l’Europe, en Livonie, Ruthénie, Flandre, Angleterre et France :
Je vous en prie, Très distingués messieurs et jeunes étudiants, écoutez-moi patiem-ment, moi qui manque d’entraînement en éloquence et qui vais parler parfois avec ignorance et dans un discours assez clairement non travaillé. Que m’excuse auprès de vous ce voyage même dont je parlerai, qui a fait que nous n’avons pas toujours eu grand soin du choix des mots, quand il fallait changer de genre universel de langage autant de fois que l’on arrive dans une autre région. Et si l’on préfère en gardant le débit perpétuel de sa propre langue passer en public pour ridicule, et rapidement pour odieux, plutôt que de s’accoutumer familièrement, selon le moment et l’habitude des lieux, à ceux chez qui l’on est arrivé, par imitation de l’alimentation et des mœurs, et aussi de la langue10.
Le voyage en France de Johann Haynpol, fils de cordonnier, né vers 1500 à Zwickau en Saxe, diplômé de médecine à Wittenberg en décembre 1523, a eu lieu entre le début de l’été 1527 et le mois de septembre 1528, et prit fin à Bâle dans l’imprimerie de Jérôme Froben, fils et successeur de Johann Fro-
6 maistre Pierre Pathelin, farce du XVe siècle, 2ème éd. revue par R. T. Holbrook, Paris, Champion, 1970, v. 879, 842, 859, 905, 940, 970, 993, 1122-1124.
7 OC, p. 290.8 OC, p. 321.9 M. Screech, Rabelais, trad. de l’anglais par M. A. de Kisch, Paris, Gallimard, 1992 (19791). Les langues
parlées par Panurge dans la première édition de Pantagruel (Nourry 1531 ou 1532) ne sont d’abord que 9, à savoir 1) l’allemand, 2) l’antipodique, 3) l’italien, 4) le néerlandais, 5) l’espagnol, 6) l’hébreu, 7) le grec, 8) un grec macaronique et 9) le latin ; É. Pons, « Les langues imaginaires dans le voyage utopique. Les jar-gons de Panurge dans Rabelais », Revue de littérature comparée n° 11, 1931, p. 185-218, p. 200, 215 et 216 pour la traduction des jargons ; K. Campbell, « Notes sur l’hébreu de Rabelais : La rencontre avec Panurge (Pantagruel, ch. 9) », Études rabelaisiennes t. 25, Genève, Droz, 1991, p. 95-105.
10 « Rogo uos, Ornatissimi uiri, ac studiosi adolescentes, me in arte dicendi inexercitatum, indoctius in-terim ac clarius inelaborata oratione dicturum patienter audite. Excuset me apud uos illa ipsa de qua loquar peregrinatio, quæ fecit ut uerborum selectorum minor nobis semper fuerit cura, quum toties immutandum sit uniuersum dictionis genus, quoties quidem ad aliam regionem peruenitur. Nisi quis malit perpetuum suæ linguæ tenorem seruans uulgo ridiculus, et non longe post exosus haberi, quam pro tempore et locorum consuetudine, cum his ad quos perueneris, et uictus et morum, sic linguæ etiam imitatione familiariter con-suescere », J. Cornarius, in peregrinationis laudem Praefatio, p. 59 de l’édition décrite ci-dessus n. 1.
Marie-Laure Monfort258
ben, l’imprimeur d’Érasme. De ce voyage en France, dont les dates coïncident exactement avec une des lacunes les plus notoires dans la biographie de Ra-belais, dont on sait seulement qu’il décide d’entreprendre des études de méde-cine, nous savons que Janus Cornarius y a, selon ses dires, exercé une activité médicale appuyée sur l’abrégé de médecine grecque publié ensuite par Froben en 1529, Universæ rei medicæ ἐπιγραφή, qu’il y a peut-être, d’après ses bio-graphes, obtenu un titre de docteur en médecine à Valence, et enfin qu’il en re-vient fatigué, totalement dépourvu de ressources et désireux de se fixer quel-que part quand il arrive chez Froben, venant de Strasbourg muni d’une lettre de recommandation de son compatriote Eppendorf décrivant cette situation11. Sa première publication chez Froben, après les Aphorismes grecs imprimés à Haguenau, précédés d’un discours intitulé Quarum artium ac linguarum co-gnitione medico opus est, est une édition bilingue, grecque et latine, des traités hippocratiques De aere, aquis et locis et De flatibus, datée d’août 1529, qui figure dans la bibliothèque de Rabelais, un cas jugé exceptionnel par Roland Antionioli, spécialiste de Rabelais médecin12. Les autres publications de Janus Cornarius qu’il est utile de mentionner ici sont les premiers titres de la traduc-tion latine intégrale d’Hippocrate annoncée dès les epistolæ et les Libelli de 1542-1543, cette même traduction intégrale en 1546, plaisamment désignée Hippocrates togatus par Janus Cornarius, contemporaine d’une bruyante po-lémique avec Leonhart Fuchs en 1545 et 1546, ainsi que d’importants travaux de patristique permettant de le situer dans le parti minoritaire du catholicisme réformateur13. Rappelons que dans ces mêmes années Rabelais publie notam-
11 R. Antonioli, La médecine dans la vie et dans l’œuvre de François Rabelais, Thèse Paris IV 1974, Université Lille III, Service de reproduction des thèses, 1977, p. 36 ; Universæ rei medicæ ἐπιγραφή seu enumeratio, compendio tractata, Cornario zuiccauiense autore, Basel, Hieronymus Froben, 1529, BnF Rés. P.T.80 (1) ; « Et hoc institutum iam uiginti annos, uelut dixi, annos sequor : quibus peregrinatus, fortunæ fluctibus uariis, Deo ita uolente, iactor : primis quidem ex his, per multas præclaras Germaniæ ac Galliæ, Liuoniæ item ac Rutenorum urbes, ac principum aulas medicatus » [Tel est le plan que j’applique, établi comme je l’ai dit depuis vingt ans déjà : au cours desquels, voyageant au gré des flots du sort, je suis balloté selon la volonté de Dieu : les premières années, j’ai pratiqué la médecine dans de nombreuses villes illustres de Germanie et de Gaule, et dans des villes et des cours princières de Livonie et chez les Ruthènes], Hippocratis libelli aliquot […] Hippocrates siue Doctor uerus, oratio habita marpurgi […] per ianum Cornarium medicum physicum […], Basel, Johann Oporinus, 1543, BnF T23.121, p. 74 ; A. Hartmann, Die Amerbachkorrespondenz (1481-1558), 10 vol., Basel, Verlag der Universitätsbibliothek, 1942-1991, vol. 3, p. 353, 359 et suivantes, ainsi que M.-L. Monfort, Janus Cornarius …, op. cit.
12 Ἱπποκράτους Κωίου Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων. Περὶ φυσω'ν. Hippocratis Coi, De aëre, aquis et locis libellus. eiusdem, de Flatibus. Græce et Latine iano Cornario zuiccaviensi interprete, Basel, Hieronymus Froben, 1529 ; R. Antonioli, op. cit., p. 13 n. 46 : il s’agit sans doute de l’exemplaire BnF Rés. Tc 3.1.
13 Hippocratis Coi […] epistolæ elegantissimæ […], Köln, Johann Gymnik, 1542, BSB A.gr. b. 296/2 ; Hippocratis […] libelli aliquot, Basel, Johann Oporinus, 1543, BnF T 23.131 ; Hippocratis Coi […] opera quæ ad nos extant omnia […], Basel, Hieronymus Froben, 1546, BnF T 23.4. En patristique citons seule-ment ici Omnia Diui Basilii magni archiepiscopi Cæsareæ Cappadociæ, quæ extant opera […], Basel, Hieronymus Froben, 1540, BU Sorbonne Rés. R. XVI.383 ; Diui epiphanii episcopi Constantiæ Cypri, Contra octoginta hæreses opus […], Basel, Robert Winter, 1543, RSB Zwickau 17.3.1 ; De obedientia oratio habita coram publica schola uniuersitatis marpurgensis, per Janum Cornarium in Rectoratu suo, Marburg, s. n. s. d., ÖNB 80.X.63.
Le discours scientifique de Panurge 259
ment un Tomus secundus des epistolæ medicinales de Giovanni Manardi en juin 1532, des Hippocratis ac Galeni libri aliquot contenant le texte grec des Aphorismes en juillet 1532, et d’après M. Screech la première version de Pan-tagruel après 1531, puis en 1534 ou 1535 la première édition de Gargantua, suivie d’un premier Tiers Livre avant Pâques 1546 et une seconde version en 1552, Le Quart Livre en 1548 et une seconde version en 155214.
Outre la coïncidence de cette édition grecque des Aphorismes d’Hippo-crate, que Rabelais reprend pour l’essentiel à Cornarius, comme je l’ai montré ailleurs, on doit signaler celle qui saute aux yeux quand on compare la célèbre lettre de Gargantua à Pantagruel traçant le programme encyclopédique des études conformes à l’idéal humaniste15 avec le discours Quarum artium de Janus Cornarius, en particulier pour ce qui concerne la connaissance des cho-ses naturelles, désignées dans une très longue énumération, dont le texte de Rabelais n’est plus qu’un résumé :
La partie de la philosophie qui traite de la nature des choses tombe aussi toute entière sous la considération du médecin, au point même qu’il semble même qu’elle ne concerne vraiment que lui. C’est un champ très large qui s’ouvre alors, rempli d’un fécond savoir en tout genre : herbes, fleurs, graines, fruits, feuilles, bois, écorces, racines, liqueurs, sucs, gommes, résines, sèves, le futur médecin a tout à cueillir, à collectionner et à conserver avec un soin diligent. Non loin de là se dresse une forêt très dense, où des animaux quadrupèdes de toute espèce viennent pour suivre avec acharnement des traces, et dont il faut, une fois qu’ils ont été capturés et mis en pièces, ce que font d’ordinaire les chasseurs compétents, examiner les membres un à un, et qu’il faut rendre propres un jour pour un meilleur usage : graisses, matières adipeuses, saindoux, et même les os […], les oiseaux aux chants divers, dont je crois nécessaire de connaître non pas les voix, mais les natures en nombre infini membre par membre dans chacune de leurs parties. Puis il faut entrer dans la grotte, la visiter et extraire tous les minéraux, métaux, gemmes, pierres précieuses et variétés des diverses terres […], les champs, les jardins et les vignes […], les troupeaux, le bétail, les bêtes de somme […], il ne faut pas négliger non plus les eaux dormantes, les lacs, les mers et les rivières : et les bassins eux-mêmes suscitent aussi la sollicitude opposée du futur médecin, au cas où un petit poisson très commun voudrait être bien traité de lui et en rapport avec sa dignité16.
14 Voir G. Demerson et M. Marrache-Gouraud, François Rabelais, Bibliographie des Écrivains Français, Paris, Éditions Memini, 2010, n° 26, 24, 4, 12, 17, 18, 19, 20.
15 OC, p. 241-245.16 « Porro ea quæ naturas rerum tractat philosophiæ pars, tota in Medici consideratione consistit, ut uere
ad nullos alios spectare uideatur. Hic uero latissimus campus se aperit omni genere frugiferæ eruditionis refertus. Hic herbæ, flores, semina, fructus, folia, ligna, cortices, radices, liquores, succi, gummi, resinæ, lachrymæ quæ omnia futuro Medico diligenti cura decerpenda, colligenda ac conseruanda sunt. Non procul hinc densissimus se obiicit saltus, in quo acri indagatione, peruestiganda ueniunt, omnis generis quadru-peda animantia, quibus captis ac euisceratis, quod prudentes uenatores facere solent, inspicienda membra singula, reponendaque sunt usui futura aliquando maximo. Adipes, pinguedines, aruinæ, ossa etiam ipsa […] uolucrium genus, quarum non uoces quidem, sed membratim singularum partium naturas innumerato habendas necessarium puto. Post uero specus ipse ingrediendus, lustranda ac eruanda quoque Mineralia omnia, metallica, gemmæ, lapides preciosi, ac uariarum species terrarum […]. Agri, horti, uineæ curam expectantes tuam, non negligendi sunt : mox numerandum pecus, armenta, iumenta […]. Nec prætereunda stagna, lacus, maria, flumina : ipsæ quoque piscinæ opposam curam medico futuro exhibent, ut uelit etiam
Marie-Laure Monfort260
Tous les motifs développés dans Quarum artium ne sont pas des lieux com-muns, et cette source probable de la lettre de Gargantua, attestée en même temps que celle de ses Aphorismes grecs, peut bien entendu résulter de la dis-ponibilité commerciale, difficile à apprécier, de la première édition cornarien-ne, qui est contemporaine du voyage en France de l’étudiant de Wittenberg, sans impliquer la rencontre personnelle des deux hommes. D’autres indices paraissent plus probants, et ils sont même en si grand nombre qu’on doit se contenter de n’en citer que quelques uns. Panurge a d’abord deux ou trois caractères physiques qui correspondent à ceux de Janus Cornarius que l’on peut connaître, à savoir, outre son âge, pas loin de la trentaine vers 1527, une haute taille (« un homme beau de stature ») et un nez « un peu aquillin, faict à manche de rasouer »17. Dès sa première apparition, Panurge est comparé, pour sa mise vestimentaire « tant mal en ordre qu’il sembloit estre eschappé aux chiens », à un cueilleur de pommes du pays de Perche18, une image qui décrit une allure analogue à celle de Janus Cornarius arrivant à Bâle avec « une cas-sette vidée par un long voyage » et des « vêtements et autres effets, en partie usés en partie vendus et abandonnés comme charges pour la route »19. L’image originale du cueilleur de pommes se retrouve dans le Prologue du Tiers Livre à propos de Diogène contemplant les préparatifs des Corinthiens résolus à soutenir le siège que projette contre eux Philippe de Macédoine :
Diogenes, les voyant en telle ferveur mesnaige remuer et n’estant par les magistratz employé à chose aulcune faire, contempla par quelques jours leur contenence sans mot dire. Puys, comme excité d’esprit Martial, ceignit son palle en escharpe, recoursa ses manches jusques es coubtes, se troussa en cuilleur de pommes, bailla à un sien compaignon vieulx sa bezasse, ses livres et opistographes20.
Le récit montre le cueilleur de pommes Diogène se débarrassant de son ma-tériel livresque auprès d’un « sien compaignon vieulx », d’où une possible analogie avec la situation de notre hypothèse, quelle que soit la date de nais-sance de Rabelais entre 1483 et 1494, qui fait de lui l’aîné des deux d’au
uilissimus quisque pisciculus, ab hoc recte ac pro dignitate tractari », Quarum artium …, p. Av[a-Avb] de l’édition citée ci-dessus n. 1 ; et pour mémoire un passage de Pantagruel chap. VIII : « qu’il n’y ayt mer, riviere ny fontaine, dont tu ne congnoisse les poissons, tous les oyseaulx de l’air, tous les arbres, arbustes et fructices des foretz, toutes les herbes de la terre, tous les metaulx cachez au ventre des abysmes, les pierre-ries de tout Orient et Midy, rien ne te soit incongneu », OC, p. 245. Sans entrer dans le détail, précisons que l’on ne peut plus affirmer que ce programme « popularise les idées de son temps » comme le fait F. Rigolot, Les langages de Rabelais, Genève, Droz, 2009, p. 57.
17 OC, p. 246 et 272. Une anecdote connue par Simon Riquinus appelle la comparaison de Janus Cornarius avec un éléphant, et ce commentaire : « Cornarius war eine Kolossalfigur. », O. Clemen, « Janus Cornarius », Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumkunde, n° 33, 1912, p. 36-76, p. 42 ; portrait à l’huile de Janus Cornarius : http://www.deutschefotothek.de/obj70252022.html.
18 OC, p. 246.19 « Longa peregrinatione exhaustos loculos […] et uestitum aliamque suppellectilem partim detritam,
partim divenditam, ac uelut uiæ onus relictam », Lettre dédicace à Michel Meienburg datée du 1er avril 1555 de Pauli Æginetæ totius rei medicæ libri Vii […], Basel, Johann Herwagen, 1556, BnF T 23.113.
20 OC, p. 347.
Le discours scientifique de Panurge 261
moins six ans, puisque Rabelais semble bien avoir en effet lui aussi récupéré quelques feuillets de théorie médicale tombés de la besace de Johann Hayn-pol entre 1527 et 1528. La suite de l’apologue de Diogène au début du Tiers Livre est un éloge du courage, au nom duquel Rabelais refuse, tout comme Diogène, de rester « spectateur ocieux de tant vaillans, disers, et chevalereux personnaiges »21 qui combattent en Europe pour la prospérité de la France. « Car peu de gloire, [dit-il plus loin], me semble accroistre à ceulx qui seu-lement y emploictent leurs œils, […] et par mines en silence signifient qu’ilz consentent à la prosopopée », en d’autres termes aux spectateurs muets, qui sont pour lui les vrais lâches. Diogène en cueilleur de pommes, le modèle que l’auteur Rabelais se donne à lui-même au seuil de son Tiers Livre, est par son courage civique le contraire de Panurge, premier et sauf erreur seul autre « cueilleur de pommes » dans toute la geste rabelaisienne, Panurge le froussard, dont la paour si fréquente étonne, mais s’explique toujours de la même manière (« Je ne entends couraige de brebis. Je diz couraige de loup, asceurance de meurtrier. Et ne crains rien que les dangiers »22) par l’existence d’un danger bien réel. L’inversion de la qualité brouille à peine la piste, et fournit même une sorte de grammaire de l’invention rabelaisienne, souvent notée dans l’exégèse. Rabelais aurait donc pris modèle, pour lui-même, d’un cueilleur de pommes, mais cette détermination, qui n’a qu’une valeur des-criptive, reste allusive.
Le premier chapitre du Tiers Livre, qui paraît la même année que l’Hip-pocrates togatus de Janus Cornarius, traite du peuplement d’Utopie, « oppo-site » de celui de la Saxe par Charlemagne, « lequel feist d’un diable deux, quand il transporta les Saxons en Flandre, et les Flamens en Saxe »23. Panurge ne porte plus, à partir du chapitre VII, sa « magnificque braguette »24 qui lui avait permis de venir à bout de « l’Anglois qui arguoit par signes »25, et s’ha-bille dorénavant d’une « robbe longue à simple cousture » et s’en explique en ces termes : « Voyez moy davant et darriere : c’est la forme d’une Toge, anti-que habillement des Romains on temps de paix »26, accoutrement qui a donné lieu comme toujours à de nombreux commentaires, mais qui pourrait aussi s’entendre comme une allusion au nouveau costume de l’Hippocrates togatus plus ou moins taillé depuis la Saxe27. Dans le Quart Livre on dirait même par-fois que le secret se dévoile et que les allusions deviennent transparentes pour
21 ibid., p. 349.22 ibid., p. 595.23 ibid., p. 356.24 ibid., p. 371.25 ibid., p. 286.26 ibid., p. 372 et 373.27 Ces observations ne contredisent pas nécessairement d’autres analyses du personnage, comme par
exemple celle de P. Maréchaux, « Les noces de Panurge et de Mercure », Rabelais pour le XXie siècle, éd. M. Simonin, Études rabelaisiennes, t. 33, Genève, Droz, 1998, p. 161-175, ou celle de M. Jeanneret, « La sémiotique sauvage de Panurge », ibid. p. 339-347, en particulier p. 340 à propos de la toge de Panurge.
Marie-Laure Monfort262
des contemporains avertis. Le second prologue du Quart Livre rédigé pour l’édition de 1552 met en scène un pauvre villageois « abateur et fendeur de bois »28 qui supplie Jupiter de lui rendre sa « coignée » perdue, mais celui-ci se dit débordé par la gestion des conflits mondiaux, au nombre desquels figure la toute récente prise de Magdebourg par Maurice de Saxe29, personnage de tout premier plan parmi les dédicataires des éditions cornariennes, de même que Philippe de Hesse, mentionné au chapitre XVII dans une allusion aux dé-mêlés du Landgrauff d’esse avec Charles Quint en 154730. Dans ces deux cas, choisis parmi d’autres, on cherche en vain quelle résonance des événements politiques avant tout germano-germaniques, mais qui ont beaucoup retardé les projets personnels de Janus Cornarius, pouvaient avoir alors en France, et ce d’autant plus que les autres exemples de chaque série d’événements sont en général antiques, exotiques ou fantaisistes. Panurge, omniprésent dans ce livre dont la première publication de 1548 intervient vingt ans après le voyage de Johann Haynpol en France, manque d’être écorché par Frère Jean, qui vante son cuir comme le meilleur « guaban contre la pluie »31, ajoutant : « Laissez-moy ces manteaulx de Loup et de Bedouault. Faictez escorcher Panurge, et de sa peau couvrez vous », ce qui évoque la bruyante polémique qui vient de retentir dans le monde savant, opposant Janus Cornarius et Leonhart Fuchs, au cours de laquelle ce dernier fut menacé, comme l’indique le titre du pamphlet de Cornarius Vulpecula excoriata, des mêmes sévices que ceux que Frère Jean veut faire subir à Panurge32. On trouvera encore quantité de petits détails, comme par exemple le fait que Panurge parle allemand au plus fort de la tem-pête (« tout est frelore bigoth » [verloren bei Gott !]33) ; qu’il connaît bien les manuscrits (« Decretales, avons prou veu en papier, en parchemin lanterné, en velin, escriptes à la main et imprimées en moulle »34) ; qu’il envisage de faire son testament et s’adresse pour cela en particulier à « monsieur l’abstracteur », Rabelais en personne, qu’il appelle « mon amy, mon Achates »35, surnom déjà donné par Pantagruel à Panurge dès leur première rencontre, qui est aussi le
28 OC, p. 526.29 ibid., p. 527.30 ibid., p. 581. Maurice de Saxe (1521-1553), qui assiège Zwickau le 7 novembre 1546, est le dédicataire
des Galeni […] opera omnia, Basel, Hieronymus Froben, 1549 en 9 volumes, Wolfenbüttel HAB 2.3-2.6 med 2°, et des Platonis […] dialogi iV, Basel, Froben et Episcopius, 1549, BnF R 46840 ; Philippe de Hesse (1504-1576) est le dédicataire des Commentarii medici accompagnant Galeni […] de compositione pharmacorum localium, Basel, Froben et Episcopius, 1537, Montpellier BIUM Ea 64 – 2°, et de Artemidori Daldiani […] De somniorum interpretatione […], Basel, Froben, 1539, Zwickau RSB 2.6.26(1).
31 OC, p. 596.32 Vulpecula excoriata per ianum Cornarium medicum physicum, Frankfurt a. M., Christian Egenolff,
mars 1545, BnF Te 142.37 ; Nitra ac brabyla, pro uulpecula excoriata asseruanda, per Janum Cornarium […], Frankfurt a. M, Christian Egenolff, août 1545, BnF Te 142.38, et Fuschseides iii […], Frankfurt a. M., Christian Egenolph, 1546, BnF Te 142.40.
33 OC, p. 583.34 ibid., p. 653.35 ibid., p. 588.
Le discours scientifique de Panurge 263
prénom d’un des fils de Janus Cornarius ; ou encore que l’épithète d’Hercule alexicacos mentionnée dans la lettre dédicace du Quart Livre au Cardinal de Châtillon, datée de janvier 1552, ne s’explique que grâce au lexique de la Briefve declaration36 et par sa présence dans la lettre dédicace de l’édition grecque d’Hippocrate donnée par Janus Cornarius en 153837.
Mais c’est en fait tout le grand thème du cocuage qui contient à mon avis la solution, peut-être trop évidente, du mystère Panurge. À force de le redouter, arrivera-t-il à Panurge ce que lui prédit Frère Jean au chapitre XIV du Tiers Livre : « tu seras coqu, home de bien, je t’en asceure : tu auras belles cornes. Hay, hay, hay, nostre maistre de Cornibus »38 ? Sa seule « paour » de la tempête le fera encore traiter dans le Quart Livre de « coqu cornard »39, voire de « veau coquart, cornart, escorné »40. Le nom propre et véritable de Cornarius était probablement tissé en toutes lettres dans la trame des aventures de Pantagruel, bien lisible à travers des qualifications telles que « maistre de Cornibus » ou dans l’ancien vocable « cornart », et il aurait suffi pour s’en apercevoir d’avoir en tête que ce nom d’humaniste allemand Cornarius, qui était loin d’être in-connu dans le petit monde des humanistes et studiosi contemporains de Ra-belais, prête toujours à sourire aujourd’hui en français, tant il évoque le topos farcesque du cocu qui fait l’obsession de Panurge. Mais il faut ajouter que dans la langue de Goethe en revanche, ce même nom d’humaniste allemand, Cornarius, se prête à un autre jeu de mots, non plus sur corn mais sur nar, homonyme de der Narr, le fou, ce qui autorise le calembour CornaRRius dont use et abuse dans son pamphlet Cornarrius furens son ennemi juré, luthérien patenté, Leonhart Fuchs41. Or der Narr est aussi l’appellation anonyme dont usa, comme on sait, Luther pour désigner à mots couverts l’audacieux person-nage ayant osé introduire à Wittenberg la théorie de Copernic, et tout indique que cet événement se produisit à peu près à l’époque du voyage en France de Janus Cornarius, lequel était en outre déjà muni d’un corps de doctrine
36 ibid., p. 704.37 Achates Cornarius, magister à Wittenberg en 1554, docteur puis professeur de médecine à Iéna en 1558,
est l’auteur de la préface des Platonis […] opera […] omnia, per ianum Cornarium […] lingua Latina conscripta, Basel, Hieronymus Froben, 1561, Paris BIUM 1340 bis. Le fidus Achates de Virgile « a arraché une étincelle au caillou » (en. I, 174 : silici scintillam excudit Achates), et ces mots sont probablement à l’origine de l’image citée de mémoire par Janus Cornarius dans sa lettre dédicace à Albert, archevêque de Mayence, des Opera omnia de Basile de Césarée, pour expliquer l’intérêt de retraduire sans cesse les textes grecs : « Atque sic tandem ex repetitis ictibus ueritas, uelut ex silice ignis extunditur. [Et ainsi enfin, par des coups répétés, jaillit la vérité, comme le feu du caillou] ; Hercule alexicacos ou « qui écarte les maux » (qui semble un écho d’Aristophane, Guêpes, v. 1043 plutôt que des Nuits attiques mentionnées dans la Briefve declaration) est cité dans la lettre dédicace de l’édition grecque d’Hippocrate publiée par Froben en 1538, adressée à Matthias Held, bras droit de Charles Quint.
38 OC, p. 394.39 ibid., p. 586.40 ibid., p. 590.41 Cornarrius <sic> furens, per Leonhartum Fuchsium Basel, Xylotectus, 1545, BnF Te 142 39.
Marie-Laure Monfort264
hippocratique relativement cohérent42. Le jeune Janus Cornarius qu’aurait pu, selon notre hypothèse, rencontrer Rabelais, était donc porteur d’un message scientifique réellement dangereux.
physioLoGie de LA dette
À la date de son voyage en France, Janus Cornarius connaissait en effet très probablement déjà la théorie copernicienne, si ce n’est Copernic lui-même, et il est assez notoire que cette théorie disqualifie la physique aristotélicienne, sur laquelle repose la physiologie des humeurs et des qualités, et par suite tou-te la doctrine nosologique galénique transmise au monde médiéval par l’inter-médiaire d’Avicenne. Les premières observations critiques sont perceptibles dès les epistolæ medicinales de Giovanni Manardi, en particulier dans celles qui portent sur la temperatura et sur la mélancolie43. Ce sont précisément ces lettres que Rabelais publie à Lyon en 1532, sans que l’on sache au juste par quelle voie elles lui sont parvenues. On a parfois suggéré de voir en Sympho-rien Champier l’intermédiaire entre Rabelais et Manardi, mais cette hypothèse est contredite par la teneur d’un échange épistolaire publié dans les Annota-tiunculæ Sebastiani montui parues à Lyon en 1533, selon toute apparence à la gloire de Symphorien Champier, dont deux lettres à Manardi sont éditées dans cet ouvrage, d’où il ressort que Champier n’avait pas eu de contact personnel avec Manardi avant la publication du Tomus secundus qu’il a découvert une fois imprimé44. Les Annotatiunculæ mentionnent en revanche, dans un Ca-thalogus illustrium medicorum ac nouitiorum, qui temporibus nostris scripse-runt, quorum scripta ad manus nostras peruenerunt Symphoriano Campegio authore, un certain ianus Coruanus Germanus à la fin d’une liste de 14 noms mêlant ceux de médecins versés dans les lettres grecques et latines – qui in medica arte uera demonstrant, et falsa improbant, ac soluunt ambigua, et
42 M. Lerner, « ‘Der Narr will die gantze kunst Astronomiæ umkehren’ : sur un célèbre Propos de table de Luther » dans Nouveau ciel, nouvelle terre. La révolution copernicienne dans l’Allemagne de la Réforme (1530-1630), éd. M. A. Granada et E. Mehl, Paris, Les Belles Lettres, 2009, p. 41-65 ; M.-L. Monfort, Janus Cornarius et la redécouverte d’Hippocrate …, I, 2.
43 A. Herczeg, « Johannes Manardus, Hofarzt in Ungarn und Ferrara im Zeitalter der Renaissance », Janus n° 33, 1929, p. 52-78 et p. 85-130 ; P. Zambelli, « Giovanni Manardi e la polemica sull’astrologia », dans L’opera e il pensiero di Giovanni Pico della mirandola nella storia dell’umanesimo, éd. Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, Firenze, 1965, t. 2, p. 205-279 ; M.-L. Monfort, « Le sens de temperatura dans les epistolæ medicinales de Giovanni Manardi », dans mélanges, crases, tempéraments : la chimie du vivant dans la médecine et la biologie anciennes, Colloque organisé par l’Institut universitaire romand d’histoire de la médecine et de la santé (Lausanne-Genève, 6-8 mai 2004), en cours de publication ; Janus Cornarius et la redécouverte d’Hippocrate …, II, c. 1.
44 R. Cooper, « Les dernières années de Symphorien Champier », Bulletin de l’Association d’études sur l’Humanisme, la Réforme et la Renaissance n° 47, 1998, p. 25-50, p. 35 ; epistolæ physicales manardi, Campegii et Coronæi dans Annotatiunculæ Sebastiani montui artium ac medicinæ doctoris in errata recen-tiorum medicorum […], Lyon, B. Bounyn, 1533, BnF 8-T5.2, f° 26[a]-32[b], f° 26.
Le discours scientifique de Panurge 265
obscura patefaciunt – et ceux écrivent communi sermone45. Comme les 13 autres noms de la liste sont ceux d’érudits très illustres, et qu’aucun de ceux dont les bibliothèques ont gardé le souvenir ne répond à ianus Coruanus Ger-manus sinon le ianus Cornarius zuuicauiensis éditeur et traducteur des deux traités hippocratiques De aere, aquis, locis et De flatibus publiés en 1529, on se demande si la forme Coruanus à corriger en Cornarius s’explique par une double coquille (n pour u et n pour ri) ou par un jeu de mots, cor uanus, c’est-à-dire « vide quant au cœur », au sens propre et figuré. Cette dernière signifi-cation, toujours possible, qui peut aussi éventuellement évoquer la « paour » permanente caractérisant Panurge, avait donc probablement une résonance polémique dont les enjeux et les termes exacts nous restent en partie obscurs, Symphorien Champier demeurant à ce jour un personnage mal connu.
Outre la mention souvent relevée du « Campi clysteriorum, per §. C. » dans le catalogue de la librairie Saint-Victor46 et les allusions à deux ouvrages du médecin lyonnais relevées par Richard Cooper, il existe sans doute une autre relation entre Champier et Rabelais, ayant pour commun dénominateur le per-sonnage de Michel Servet, dont la théorie médico-théologique, comme l’a très bien noté J.-J. Dreifuss, est clairement reflétée à travers les quelques mots fameux de Panurge : « La vie consiste en sang. Sang est le siege de l’âme »47,) prononcés au cours de son éloge des « debteurs » du Tiers livre, et facile-ment hérétiques en tant que composantes d’une « théorie médicale de l’Incar-nation », selon l’excellente formule d’Irena Bakus, sachant que d’anciennes études, pas totalement invalides, donnent également Symphorien Champier comme un des inspirateurs de la théorie dite de la « petite circulation » long-temps attribuée au supplicié de Genève, mais qui serait, comme on dit, dans l’air du temps48. Rappelons comment Panurge décrit, au cours de son fameux éloge de la dette dans les chapitres III et IV du Tiers livre49, les échanges pré-sidant au renouvellement du sang :
le Cœur. Lequel par ses mouvements diastolicques et systolicques le subtilie et enflambe, tellement que par le ventricule dextre le mect à perfection, et par les venes l’envoye à tous les membres. Chascun membre l’attire à soy, et s’en alimente à sa guise : pieds, mains, œilz, tous : et lors sont faictz debteurs, qui paravant estoient presteurs. Par le ventricule gausche il le faict tant subtil, qu’on le dict spirituel : et l’envoye à tous les membres par ses arteres, pour l’autre sang des venes eschauffer
45 ibid., f°. 48[a]-49[b]. Le nom de Rabelais ne figure pas dans cette liste, ni dans le reste de l’ouvrage.46 OC, p. 241.47 ibid., p. 365.48 J.-J. Dreifuss, « Michel Servet a-t-il effectivement contribué à la découverte de la circulation san-
guine ? », dans Hérésie et pluralisme du XVie siècle au XXe siècle, éd. V. Zuber, Paris, Champion, 2007, p. 73-85 ; I. Bakus, « Michel Servet et les pères anté-nicéens », ibid., p. 129-167 ; J. Audry, « Michel Servet et Symphorien Champier », Lyon médical n° 36-37, 1935, p. 1-19 ; ou entre autres Ch. Laubry dans une étude de 1950 citée par Dreifuss, op. cit., p. 79.
49 OC, p. 360-367.
Marie-Laure Monfort266
et esventer. Le poulmon ne cesse avecques ses lobes et souffletz le refraischir. En recongnoissance de ce bien le Cœur luy en depart le meilleur par la vene arteriale50.
En proposant de comparer ce passage du Tiers livre aux termes de la Chris-tianismi restitutio sur lesquels se fondent les critiques attribuant à Michel Servet l’intuition de la « petite circulation », Dreifuss suggère, avec il est vrai l’extrême prudence que suscite la complexité de la théorie des souffles dans la littérature galénique, que le texte de Rabelais comportait lui aussi, à une date où l’ouvrage de Servet circulait probablement déjà sous forme manuscrite, les principaux éléments d’une description de ce mécanisme dit de la « petite cir-culation » également reflété par Servet, connu sous l’appellation trompeuse de « circulation pulmonaire », et selon lequel le sang passe à travers les poumons du ventricule droit vers le ventricule gauche en effectuant :
un long trajet à travers les poumons. Il y est modifié, devient rouge doré, et passe de l’artère pulmonaire à la veine pulmonaire. Là, il est mélangé avec l’air inspiré et, durant l’expiration, nettoyé de sa suie. Enfin ce mélange, ainsi dûment préparé pour se transformer en esprit vital, est attiré dans le ventricule gauche du cœur51.
Cet éloge de la dette mis dans la bouche de Panurge aux chapitres III et IV du Tiers Livre fait donc écho aux débats médicaux contemporains les plus récents et surtout les plus sensibles aux regards des diverses autorités religieu-ses, catholiques ou réformées, puisque Dreifuss conclut son article en disant que la découverte de la « circulation pulmonaire » s’est « vraisemblablement faite en Italie du Nord, vers ou peu après 1545 ». Le discours de Panurge ne si-gnifie évidemment pas que Rabelais souscrive à la théorie proto-économique qu’il caricature à travers son exposé physiologique, qui a lui aussi une portée manifestement satirique, et sonne au contraire comme une critique d’autant plus claire qu’elle est relayée dès le chapitre V par la réfutation bien connue de Pantagruel52. Le rapprochement avec le cas Michel Servet opéré par Dreifuss met en évidence l’ambiguïté d’une satire qui perçoit sans doute les implica-tions des débats contemporains sur le sang et le souffle suscités par les apories de la théorie médicale traditionnelle, mais touche aussi la physique ancienne, Panurge fondant son rejet d’un « monde sans debte » sur un résumé de la phy-siologie « académique », comprenons celle des disciples plus ou moins directs
50 ibid., p. 366.51 Dreifuss reprend ici la description de la circulation pulmonaire de Laubry, et considère que le Tiers
Livre et la Christianismi restitutio sont sur ce point « de même nature », p. 74 et n. 2 pour la traduction de Servet.
52 Je remercie Jeanne Semin de m’avoir signalé le commentaire économique récent de cet éloge de la dette dans L. Fontaine, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’europe préindustrielle, Paris, Gallimard, 2008, p. 49-50. L. Fontaine y affirme étrangement que « Pantagruel se fait le porte-parole de l’autre logique qu’il observe : celle du désir de gain, de profit et de l’individualisme qui se développent », tout en renvoyant à N. Zemon Davis, essai sur le don dans la France du XVie siècle, traduit de l’anglais par D. Trierweiler, Paris, Seuil, 2003, p. 186-190, qui oppose un peu différemment la « réciprocité ‘catholique’ » (du côté de Panurge) à la « gratuité ‘protestante’ » (incarnée par Pantagruel), en s’autorisant de l’étude de F. Rigolot, Les langages de Rabelais, Études rabelaisiennes, t. 10, Genève, Droz, 1993, p. 137-143.
Le discours scientifique de Panurge 267
de Platon, Aristote, Galien et Avicenne, encore enseignée dans les écoles de médecine. Parce qu’elle associe créancier et débiteur dans une relation com-binant l’intérêt du premier et le devoir du second, et d’autant plus solide que chacun s’y retrouve, comme on vient de le voir, alternativement en position de créancier et de débiteur, la dette, explique Panurge, est la « grande ame de l’univers ». Le compagnon de Pantagruel décrit alors en quelques phrases à la fois justes et drôles l’ensemble des échanges régissant le système physique aristotélicien depuis la sphère des fixes jusqu’aux éléments premiers. Sans la dette :
La Lune restera sanglante et tenebreuse. A quel propous luy departiroit le Soleil sa lumiere ? Il n’y estoit en rien tenu. Le Soleil ne luyra sus leur terre : les Astres ne y feront influence bonne. Car la terre desistoit leurs prester nourrissement par vapeurs et exhalaisons : desquelles disoit Heraclitus, prouvoient les Stoiciens, Ciceron main-tenoit estre les estoilles alimentées. Entre les elemens ne sera symbolisation, alterna-tion, ne transmutation aulcune. Car l’un ne se reputera obligé à l’autre, il ne lui avait rien presté. De terre ne sera faicte eaue : l’eau en aër ne sera transmuée ; de l’aër ne sera faict feu ; le feu n’eschauffera la terre53.
Or c’est précisément sur la question de la « transmutation » des éléments, si souvent évoquée par Frère Jean, Épistémon, Pantagruel ou Panurge, que porte aussi la critique de Manardi, qui met en doute le dogme aristotélo-galénique de l’instabilité essentielle des éléments, des humeurs et des qualités, soumis selon cette doctrine à un perpétuel échange. « Rien n’est plus ancien que la vé-rité » répétait Manardi, congédiant par cette phrase les autorités traditionnelles au profit d’un rationalisme restreint à la recherche des causes, évoqué par exemple au chapitre VI du Tiers Livre, quand Panurge termine son discours sur l’exemption de la guerre pour les jeunes mariés : « Je ne l’ay demandé sans cause bien causée : ne sans raison bien resonnante. Ne vous desplaise »54, juste après une citation du De difficultate respirationis, qui est comme par hasard l’un des premiers traités galéniques traduits par Janus Cornarius, avec le De semine alias De spermate cité un peu plus loin au chapitre VIII55, dont l’interprétation peut remettre en cause bien des dogmes, puisqu’ils montrent, comme le dira Janus Cornarius dans son dernier ouvrage publié en 1556, me-dicina siue medicus, que Galien n’a pas défini la substance de l’âme56.
Le point de vue de Rabelais sur la dette est sans aucun doute exprimé à travers la position de Pantagruel, et la satire des « debteurs » vise à faciliter son expression. Ainsi manger « son bled en herbe » et devoir par suite toujours vivre à crédit, c’est selon Pantagruel une « hæresie » dont l’exemple remonte à
53 OC, p. 362 et 363.54 ibid., p. 371.55 ibid., p. 375.56 « Quæ vero sit animæ substantia, Galenus indefinitum relinquit », dans Jani Cornarii medici physici
medicina sive medicus, liber unus. ejusdem orationes duæ, altera Hippocrates sive doctor verus, altera de rectis medicinæ studiis amplectendis, Basel, Johann Oporinus, mars 1556, BnF 8° T21.24, p. 25.
Marie-Laure Monfort268
Caligula, lequel renouait néanmoins, du fait de ses gaspillages, explique le roi des Dipsodes en ces temps de Réforme, avec les anciennes lois somptuaires romaines commandant de « rien ne reserver au lendemain », voire de sacrifier un éventuel surplus, « sacrifice tel que l’aigneau Paschal entre les Juifz »57. Pantagruel admet finalement, après avoir cité Platon : « Lors seulement de-bvroit on (scelon mon jugement) prester, quand la personne travaillant n’a peu par son labeur faire guain »58, et l’on sait que cette analyse de Pantagruel rejoint les préoccupations de Thomas More accusant les industriels lainiers de semer la misère, ou calculant la répartition optimale du travail entre tous les citoyens. La satire de Panurge vise à montrer pourquoi le crédit financier est en passe de remplacer les quatre vertus cardinales, Prudence, Justice, Force et Tempérance59, les trois vertus théologales « Foy, Esperance et Charité. Car les homes sont nez pour l’ayde et secours des homes »60, et même le premier com-mandement chrétien, que rappelle Pantagruel : « Rien (dict le sainct Envoyé) à personne ne doibvez, fors amour et dilection mutuelle »61, même si l’hérésie de la « debte », car c’en est une, a maintenant l’Histoire pour elle, dans la mesure où elle semble anticiper certains traits de l’économie financière, ou « justice : Commutative, en achaptant cher (je diz à credit) vendant à bon marché (je diz argent comptant) »62. Autrement dit, il s’agit non seulement de condamner toute forme de simonie au sens large, mais également de montrer que la phy-siologie développée par Panurge à l’appui de l’éloge de debteurs est elle aussi à sa manière une forme d’hérésie, ce qui se comprend très bien grâce à l’étude de Dreifuss, et encore mieux si l’on prend en compte une autre physiologie développée à l’époque, beaucoup moins connue que celle de Servet, en l’oc-currence celle de Janus Cornarius.
La dette est en effet une obligation comparable à celle qui lie Panurge à Pantagruel, son suzerain, qui l’a fait « chastellain de Salmiguondin en Dip-sodie », et qui au contraire la condamne comme le premier des vices, à la manière des Perses « estimans le second vice estre mentir : le premier estre debvoir. Car debtes et mensonges sont ordinairement ensemble ralliez », la première vertu étant par conséquent la vérité63. Aussi Pantagruel efface-t-il les dettes de Panurge (« du passé je vous delivre »), argument suprême, sans réplique, opposant à l’obligation seulement financière, à savoir celle qui lie le « debteur » à son créancier, un amour « hors le dez d’estimation, il transcende tout poix, tout nombre, toute mesure : il est infiny, sempiternel ». L’allégorie contenue dans ce geste d’effacement de la dette se poursuit en renouant avec
57 OC., p. 360.58 ibid., p. 368.59 ibid., p. 358-359.60 ibid., p. 363.61 ibid., p. 367.62 ibid., p. 358.63 ibid., p. 368.
Le discours scientifique de Panurge 269
le lexique farcesque, puisque Panurge n’est pas heureux de se trouver quitte, et craint désormais de mourir « tout confict en pedz »64. La signification de cette crainte est perceptible ici ou là, à travers les innombrables plaisanteries sur les flatuosités, mais par excellence à partir du chapitre du Quart Livre intitulé « Comment Pantagruel descendit en l’isle de Ruach »65, île ainsi nom-mée d’après un terme hébreu signifiant « vent ou esprit », nous dit la Briefve declaration. Ce chapitre illustre en effet parfaitement bien la théorie médicale exposée dans le traité hippocratique De flatibus édité par Janus Cornarius dès son retour de France en 1529, qui enseigne comme le dit Rabelais que « toute maladie naist et procède de ventosité », ce qui fait que dans l’île de Ruach « meurent les hommes en pedent, les femmes en vescent. Ainsi leur sort l’ame par le cul »66. Dans l’île de Ruach, le siège de l’âme n’est donc pas le sang, comme le voudrait la physiologie de la dette selon Panurge dans le Tiers Livre, mais le souffle ou l’esprit, et en ce sens l’île de Ruach est à peu près cornarienne.
Nous avons en somme, avec d’une part l’éloge des « debteurs » et d’autre part l’île de Ruach reflétant sommairement divers aspects du discours physio-logique grec ancien, un diptyque assez clair, où sont illustrées deux théories sinon concurrentes du moins difficiles à concilier, celle du monde de la dette que la satire associe à une théorie scientifique « académique » revisitée par les nouveaux théoriciens de la « petite circulation », et celle de l’amour, chrétien ou autre (agapè), que les jeux narratifs ajustent à un résumé, voire à un résidu de la doctrine hippocratique cornarienne. Le dernier discours de Janus Cor-narius, prononcé à Iéna en 1557, in dictum Hippocratis, Vita breuis, ars vero longa, peu de temps avant sa mort, et donc à valeur testamentaire, confirme en effet l’orientation pneumatiste de sa lecture d’Hippocrate adoptée dès ses premiers travaux médicaux, car il ne retient de toute la collection médicale mise sous le nom du médecin de Cos que les quelques mots transmis par la parua tabula d’epidémies VI, 8, 7 : « τὰ ἰσχόντα, ἢ ἰσχόμενα, ἢ ἐνορμῶντα σώματα : aut continentia, aut contenta, aut intus permeantia corpora : nimi-rum per continentia solidas partes insinuans : per contenta, humores : per intus permeantia, spiritus », dans une leçon qui conserve en particulier la cor-rection σώματα ou corpora finalement adoptée par lui pour ce passage67. Der-rière cette leçon, qui à vrai dire lui est propre, le contexte et le reste de l’oeuvre de Janus Cornarius permettent de déceler une option scientifique précisée un
64 ibid., p. 369.65 ibid., p. 638.66 ibid., p. 639, et p. 709 pour le sens de « Ruach » dans la Briefve declaration.67 « Corps ou contenants, ou contenus, ou passant au-dedans : signifiant évidemment par contenants : les
parties solides, par contenus : les humeurs, par passant au-dedans : les souffles », in dictum Hippocratis, Vita breuis, ars vero longua est. Oratio habita Genæ, coram publicæ scholæ Professoribus ac Studiosis, per ianum Cornarium medicum Physicum, et Publicum Professorem, Jena, [s. n.], 1557, UB Leipzig Med. gr. 35, p. [Aviij]. Pour les autres leçons du passage et les enjeux de celle-ci, M.-L. Monfort, Janus Cornarius et la redécouverte d’Hippocrate … op. cit., III, 4, 3 « Histoire de l’ἐνορμῶν ».
Marie-Laure Monfort270
peu plus haut dans ce discours, mais que ses autres textes laissaient pressentir, et qui est selon lui celle des Physiciens :
Les Physiciens revendiquent pour eux-mêmes le traitement des choses qui sont en commun pour toutes les choses naturelles, tant que n’importe quoi est lié avec la matière et ne peut en être séparé, l’appellant physique, c’est-à-dire corporel, ils l’exposent très abondamment dans de grands livres, et dans des commentaires encore plus longs68.
Suivant la doctrine hippocratique cornarienne, les souffles dont il s’agit dans la parua tabula seraient donc matériels ou corporels, et ne sauraient être envisagés comme le siège ou la substance de l’âme que par caricature. Cette physiologie est néanmoins tout aussi dangereuse, hérétique, que celle qui situe l’âme dans le sang, et ceux qui en avaient connaissance le savaient pertinem-ment.
La tempête, décrite au chapitre XVIII du Quart Livre comme « l’antique Cahos, on quel estoient feu, air, mer, terre, tous les elemens en refraictaire confusion »69, est ensuite analysée par Panurge en ces termes : « bous bous bebe be bou bous. Je naye. Je ne voy ne Ciel, ne Terre. Zalas, zalas ! De qua-tre elemens ne nous reste icy que feu et eau. »70. Le feu et l’eau, dans le Tiers Livre, sont aussi ce qui manque au monde des humains quand la physiologie de la dette cesse de fonctionner, car ils réclament alors : « A l’aide ! A l’eau ! Au feu ! Au meurtre ! »71, si bien que la tempête peut aussi avoir quelque chose de salutaire. Panurge du reste ne doit pas craindre de se noyer, car l’eau est son élément, grâce à sa peau de loup imperméable, bien utile face au « dangier » qu’un « monstrueux Physetere » souffleur d’eau – et non de feu, « flammivome » – fait courir à l’armada dipsodique au chapitre XXX du Quart Livre, mais il doit en revanche redouter son contraire le feu, qui émanerait d’on ne sait quel bûcher72. On se souvient que par son adresse toute française à l’arc aussi bien que par son sens inné de la géométrie Pantagruel délivre ses hommes de la monstrueuse baleine réduite à une scolopendre gi-sant au fond des mers, depuis une flotte elle aussi mathématique, car guidée par le Y de Pythagoras, évoquant éventuellement le fameux mathemata ma-thematicis scribuntur de Copernic, de sorte que la victoire de Pantagruel sur le physétère pourrait s’entendre comme une allusion plus ou moins codée à l’action diplomatique d’un Rabelais très bien informé des dangers qu’allaient
68 « Physici eorum, quæ in communi omnibus naturalibus rebus adsunt, tractationem sibi uendicant, dum quicquid cum materia coniunctum est, et ab ipsa separari non potest, physicum, hoc est corporeum appel-lantes, magnis libris, et longioribus adhuc commentariis fusissime exponent », ibid., [Aviib]
69 OC, p. 582.70 ibid., p. 598.71 ibid., p. 363.72 ibid., p. 617. L. D. Kritzman, « Représenter le monstre dans le Quart Livre de Rabelais », dans Rabelais
pour le XXie siècle, Études rabelaisiennes t. 33, Genève, Droz, 1998, p. 349-359.
Le discours scientifique de Panurge 271
rencontrer les nouvelles théories scientifiques en train de s’élaborer hors de France, non seulement en Italie du Nord mais également outre-Rhin73. Il est sûr aussi que l’ambivalence propre aux signes, les renversements auxquels s’amuse Rabelais et par-dessus tout « la transmutation des elements, le facile symbole qui est entre roust et bouilly, entre bouilly et rousty »74 court-circui-tent toujours assez vite l’interprétation trop précise d’un langage allusif et en partie crypté.
Les signes d’une rencontre entre Janus Cornarius et François Rabelais dans les années 1527-1528, reflétée par la création du personnage littéraire de Panurge, dont les traits principaux évoquent la forte personnalité, longtemps méconnue, du médecin de Zwickau, sont néanmoins suffisamment nombreux. Il y a donc lieu de prendre en considération l’hypothèse selon laquelle une telle rencontre peut avoir exercé une influence significative sur la vocation de médecin et la formation scientifique de Rabelais. Les multiples référen-ces scientifiques et médicales qui émaillent ses récits, loin de puiser dans un stock de banalités scolaires ou de lieux communs, témoignent d’une attention exceptionnelle à l’actualité en ces matières, et renvoient à des problématiques nouvelles, suscitées par la découverte de textes encore peu connus à l’époque, dont la diffusion toute récente, en grec ou en traduction néo-latine, bouscule l’autorité. Dans la lignée d’un Giovanni Manardi, Janus Cornarius et Rabelais à sa suite ont soutenu une critique des raisonnements médicaux hérités de la philosophie naturelle grecque, et en particulier celle de la physiologie humo-rale, trop souvent impuissante à traiter les maladies même les plus répandues, avec une pleine conscience des implications idéologiques de leurs observa-tions75. Les résistances institutionnelles pouvaient appeler un repli stratégique du discours scientifique le plus novateur sur les positions de la satire et de la caricature. Vue sous cet angle, l’œuvre de Rabelais peut alors être considérée comme un utile adjuvant polémique de la révolution scientifique qui marque la période, et donc comme une source d’informations inédites en histoire des sciences, comme l’a déjà montré J.-J. Dreifuss. C’est ainsi, par exemple, dans une autre perspective, que la physiologie de la dette exposée par Panurge met en lumière, par la caricature, les insuffisances de la théorie galénique, notoi-rement inadaptée à l’explication des maladies infectieuses. Et ce n’est pas un hasard si Pantagruel considère le « debteur » comme un redoutable fléau à l’arrivée duquel « plus seront les citoyens en effroy et trepidation, que si la
73 R. Cooper, « Rabelais, Jean du Bellay et la crise gallicane », dans Rabelais pour le XXie siècle, op. cit., p. 299-325.
74 OC, p. 617.75 M.-L. Monfort, « La question épidémique dans le traité De peste de Janus Cornarius (1551) : un as-
pect de la vulgate hippocratique », Archives internationales d’histoire des sciences, vol. 59, n° 162, 2009, p. 53-72.
Marie-Laure Monfort272
Peste y entroit en habillement tel que le trouva le Philosophe Tyanien dedans Ephese »76, Rabelais citant ici une anecdote savante, rapportée par Philostrate, révélatrice de cette impuissance médicale que Janus Cornarius, avec quelques autres, avait entrepris de combattre.
76 OC, p. 368.



























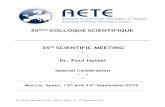



![Microsoft Word - \256]\255}\277o\275\327\244\345final](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334cc342532592417003b0e/microsoft-word-256255277o275327244345final.jpg)