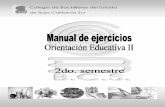Le départ de Bellérophon sur un cratère campanien de Genève
-
Upload
univ-lyon2 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Le départ de Bellérophon sur un cratère campanien de Genève
JEA\-MARC MORET
LE DÉ,PART DE BELLÉROPHONSLR UN CRATÈRE CAMPANIEN DE GENÈVE
Une collection pdvée de Genève abrite, parmi d'autres ceuvresd'art, un cratère campanien dont la destinée semble avoir étémarquée du sceau de l'odginalité: attesté dès la fin du XYI["siècle, il est resté inédit jusqu'à ce jour, et, même après avoitpassé de la collection de J.-G. Bynard dans celle de l'actuel pro-priétaite, il a échappé complètement à l'attention des archéo-logues.
r. LE VÂSE
Forme: cratèt'e en cloche dont le pied, moulê, est ptofilé en sco-tie, ayec filet saillant à la base.
Dimeuions: hauteur 49,J cmi diamètte à l'embouchurc 47 cmidiamètre sous les anses , , ,7 cm; diamètre du pied zo,4 ctrt.Etat de conseraation: Cassé en quatre grands morceâux et tecollé,le vase n'a toutefois pas été tepeint. Le pied lui-même se com-pose de plusieurs ftagments recollés. Le vase a subi une festâu-ntion importante à la jointute du pied et de la panse: la tige aété tempüe de plâtre et une vis placée à I'intérieur, afin de con-solider le récipientr.Techniqrc: figure rouge réservée, avec latge emploi du rehautblanc et jaune.
Décor Çpl. z4ry).' Sur le col, branche de laurier avec baies, orientéà gauche. Au-dessous, guitlande d'oves et de points, remplacésà la hauteur des anses par de simples languettes. Coutonnesd'oves et de points à l'attache des anses, interrompues par lerectangle réservé. En bas, méandre à gauche, entrecoupé de rec-tangles bamés de diagonales. La tépartition de ces rectânglescorrespond à peu ptès à l'emplacement des personnages dans lascène 6gurée, d'où l'irrégulatité des intervalles qui les séparent.Sous les anses, deux palmettes superposées; des rinceaux s'en
LCS suPPI'r :;:îi#-i:,H:::"T11ffiïï;i"i
schauenburg,Bererophon :ilïlÏ":iî;ï:i:;ffiïï':Lï-teritalischen Vasenmalerei, Jü 1r, 1916,
Schauenburg, Belletophonsage : ii. J"l"r""rurg, Neue Darstellungen aus
Sichtermannder Bellerophonsage, AA ry58, zr-37
: H. Sichtermann, Gtiechische Vasen inUnteritalien (r966)
' Ceftaines parties réservées sont d'une teinte plus otangée que les autres:il s'agit apparemment de taches organiques qui ont pénéré dans la surfaceà la suite du séiour du vase dans la tetre. Je remercie M. Hartmann, du Muséed'Art et d'Histoire, d'avoir bien voulu me communiquer ce renseignement.
détachent, déroulant leurs vdlles parmi des feuilles séparées. Lavolute tetminale et la feur, en forme d'éventail, sont ornées delignes blanches. Le même motif, simplifié, est répété au-dessous,posé à même le méandre, tandis que des points blancs com-plètent la décoration.Faæ A Qpl. 24, r et 2 t, r) : La face principale représente le départde Bellérophon; le jeune homme reçoit le message des mains duroi, en ptésence de la reine2. Celle-ci est assise à gauche sur unsiège recouvert d'une peau de panthère; d'un bras, elle soutientsa tête inclinée, l'autre tepose sur ses genoux. Elle est vêtue d,unpéplos et d'un himation qu'elle a rabaüu sut sa tête. Un collierpend à son cou, et un diadème, représenté par une rangée depoints blancs dont deux sont encore bien visibles, orne ses che-veux bouclés qui retombent sur ses épaules. Les chairs sontpeintes en blanc, ce qui explique l'altération des traits du visage.On les devine cependant, et ce qui en reste montre que les yeuxn'étaient pas baissés, mais que le regard se portait en avant, versla scène du départ. Une servante à cheveux blancs, probablementla nourrice, se tient debout devant Sthénébée. Un himation dontles deux pafls se rejoignent sous le bras gauche, est drapé pat-dessus son péplos. Elle tient un miroir levé dans une main et,dans l'autre, un flabelhtru en forme de palme trilobée, dont lesnefvures se sont quelque peu effacées.
IJne autre servante, toute jeune celle-ci, est assise aux pieds deSthénébée. Elle a les cheveux courts, comme la nourrice, et tientune coupe dans la main gauche. De la droite, dont l,index esttendu, elle semble s'amuser avec cet objet; tout entière absorbéepar cette distraction improvisée, elle ne prête aucune attentionau drame qui se joue autour d'elle.Proitos se trouve au centre de la composition. Solidement campésur la jambe gauche, il s'appuie d'un bras sur sa lance, et tend del'autre le message à Bellérophon. Passé sur l,épaule, l,himationlaisse apparaître la tunique brodée dont le roi est vêtu; la partieinférieure de la manche est ornée de points blancs, mais le peintrea laissé nu le bras gauche, sans doute par inadvertance. proitos
1 Sur la légende de Bellérophon, voir L. preller et C. Rober, Die griechischeHeldensage z, t (r9zo) 179-85. On connaît l,histoire: Sthénébée, épouse dePtoitos, roi de Corinthe, s'éprend du jeune hôte Bellérophon; se voyanrrepoussée, elle accuse le ieune homme d,avoir voulu la séduire. pour sevenger, Proitos charge Bellérophon de porter une lettre à son beau_pèreIobatès, roi de Lycie, dans laquelle il lui enioint de mettre à mort le messager.Mais Bellérophon affronte victorieusement la chimère et les autres épreuvesqü lui sont imposées, et il 6nit par épouser la tlle de lobatès.
9t
pofte lâ batbe et sa tête est ceinte d'une coutonne de feuillage,peinte en blanc, comme la lance et la ceinture qui serre la tuniqueà la taille. Bellérophon et sa montule occupent toute la pattiedroite de la composition. Le héros porte l'équipement otdinairedu voyageur, avec bottes et pétasos, et la chlamyde que retientune agrafe plaquée contre la poitdne. Il tend le btas droit en
direction de Proitos, afin de tecevoir la lettre; le gauche disparaltpresque entièrement derrière l'encolute de l'animal. Ptêt à bon-dir dans les airs, Pégase pia$e et déploie ses ailes, tournant la tête
du même côté que son cavalier. Les couleurs claires dominentdans cette partie de la scène: le blanc pour la robe de Pégase et
la coiffe du cavalier; le jaune pour le trait qui marque le botdsupérieur des ailes.
Divers accessoires comblent les vides du champ: fenêttes, demi-boucliet, coupes et rosaces; deux ou trois tangées de pointsblancs marquent la ligne du sol.
Face B (pl. 24, z et z 1, z) : Â gauche, une femme coiffée du saccos
et vêtue du péplos, offre une libation à deux guerriers; elle porteun skyphos dans la main dtoite, dans l'âutre une cenochoé peinteen blanc. Le guerrier du centre rappelle, pât son vêtement, le
Proitos de l'autre face: même tunique brodée, retenue à la taillepar une large ceintute, même himation drapé autour du bras.
D'une main, il s'appuie sur sa lance; de l'autte il tend un casque,
sutmonté de trois plumes monumentales, à son compagnon.Celui-ci est assis sur une butte; il ptésente un équipement sem-
blable, saufque le bandeau à pointe qui ceint sa tête s'est quelquepeu effacé. Un ruban est suspendu derière lui. Comme sur l'autreface, üfférents objets se détachent sur le fond du vase. Outre les
points blancs marquânt les lignes du tertain, on voit sur le solquelques cailloux de plus grande dimension, traités en surface
réservée.
Z. LA PLÀCE DU CRÀTÈRE DE GENÈVEDANS LA CÉRÀMIQUE CAMPANIENNE
D'origine campanienne, le cratère de Genève prend place dans
le gtoupe désigné du sigle ÂV par Beazley et, plus précisément,
dans celui que Trendall a nommé «de la Libation)), groupantautour du peintre de ce nom un certain nombte de pièces appa-
rentées3. Toutes présentent une grande uniformité de style et
3 J.D.Beazley, Groups of Campanian Red-6gure, JHS 63, t943, 66-rrr,notamment 76-79; Trendall LCS lSl-SS,198-426 etpl.r5y-7o; LCS Suppl.
t, 7z-76 et pl. r9-zo.
96
une remarquable unité de sujets. La scène figutée au revers ducratère de Genève est l'une de celles qui y apparaissent le plusfréquemment, d'où la dénomination du groupe. Divets acces-
soires du costume sont caractéristiques et petmettent de mul-tiples rapprochements. Lié, par définition, aux représentations
guerrières, le casque à plumes fait rarement défaut ; ici les éphèbes
le portent à la main, car ils ont la tête ceinte du bandeau à pointe,autre marque distinctive de l'école. Lalarge ceinture blanche est
le complément habituel de la tunique à dessins fantaisistes et,
semble-t-il, multicolores. Les nombreuses représentations con-tenant des guetders indigènes expliquent pourquoi les décota-
teurs ont fait un si large usage du costume osque, même dans
des scènes dont le sujet n'imposait pas ce caractère local. Son
emploi est particulièrement signi6catif sur notre vase et sur lectatète du Louvre K r4t, puisque dans un cas c'est un dieu,Dionysos, dans I'autre un héros de la mythologie, Proitos, quisont vêtus de la tunique samnitea. Le même motif brodé appa-
raît sur d'autres vases, dus à des peintres di-fférents, ce qui prouveune collaboration étroite ou des traditions d'école bien fixées5.
Dans le dessin de la draperie, on relèvera comme caractéristiques
les plis patallèles qui en marquent le mouvement transvetsal,ainsi que le pan ovale qui recouvre, sur un de ses côtés, la partieinférieure du péplos. La pratique consistant à jeter çà et là surl'étoffe de l'himation de petits plis en forme de crochet est large-
a Cratère en cloche du Louvre K 245: Ttendall LCS 4ro,33r pl.163,r et164,r. Sur les costumes indigènes dans la céramique italiote, voir: A.D.Trendali, Gli indigeni nella pittura italiota (r97r) 9-ro, avec bibl,p.rr. Ilfaut imaginer que, sous l'himation, la tunique de Proitos, comme celle des
éphèbes du revers, a la forme typique en U évasé. Le port simultané de cettetunique courte et de l'himation est attesté par plusieurs âutres vases dugroupe, notamment le cratère en cloche du Louvre K z6r: LCS 4o6,299pl. r59, r.3; Trcndall op,c. €g.5o. La manche inférieure à points blancs n'estqu'un travesti superficiel de ce costume indigène, destiaé à tehausser le catac-tère omemental du vêtement du roi. Voir aussi A. Alfôldi, Die monarchischeReprâsentation im tômischen Kaiserreiche (r97o) XIVsq.5 Par le peintre de la Libation, voir, outre les vases cités note préc. : le cratèreen cloche de S.M. Capua Vetere 7z (Trendall LCS 4o6, po p1.t59,4. y), ainsique les hydries du Louvte K 276 (LCS 4o6, 3ot pl.t6o,z; Trendall op.c.
[note préc.] frg.52) et K 277 (LCS 4o6,3o2p1.r59,2 et 16o,r: sous-titresinvetsés avec le vase précédent; Trendall o1.c. Ag.jri même inversion). -Par le peintre de Déttoit: cratère efl cloche de Naples inv. r 47979:LCS 4o1,294, - Pat le peintre d'Astarita : amphore à anneau du Vatican A 5 7, ex Asta-dta y7 (LCS 4oo,z66 pl.rll,l.Z); hydrie du Vatican A 56, ex Astarita 56(LCS 4oo,z7z pl.rILl).
ment iépandue dâns le groupe; elle est même abusive chez cer.-
tains peintres. Un autre élément de décor typique est la peau de
panthère sur lâquelle les petsonnages, ici Sthénébée, sont assis 6.
Dans le gtoupe de la Libation, c'est avec le cratère de Madridu o95 Çpl. z6rr. e) que notre cratère est le plus étroitement appa-renté7. Il s'agit, dans les deux cas, de pièces monumentales, etleurs dimensions sont à peu près équivalentess. L'appareil déco-ratif est le même, mais l'ornementation est encore plus riche surle cratère de Genève, puisque une frise d'oves sépare le laurierà baies de la scène figurée et qu'une couronne de même typeremplace les simples languettes à l'attache des anses 9. Un schéma
identique a été utilisé pout le méandte qui court au-dessous des
scènes figurées: sur la face ptincipale, les rectangles marqués de
diagonales ne soflt pas ornés de traits, coupant les côtés en leurmilieu, mais de petits triangles dont le sommet est orienté versle centre. Cette caractéristique, dont l'emploi n'est pas systéma-tique puisque le même rectangle peut contenir les deux motifs,est telativement rareto.
Outre les accessoites de remplissage, qui sont reptésentatifs dugroupe en général, on aperçoit, sur le cratète de Maddd, deuxpatcelles réservées, de part et d'autre du bras de Niké. La mêmepaticularité apparalt au revers du cratère de Genève, entre les
6 Par le peinme de la Libation: cratète en cloche du Louvre K 245 $upranote 4), de Newark 5o.325 (Trendall LCS 4ro,33z pl.fi3,z) et de Cam-bridge, Fitzwilliam Museum GR z9/r952 (LCS 4ro,154p1.û;3 et fi4,2).Pat le peintre d'Astarita: cratère en cloche de Naples H.8rr (inv.82583):LCS 4or,279,7 Cratère en cloche de Madrid r r o95 (L. 37o): Ttendall LCS 4lr, 34o pl.t64,y. 6, Dans LCS, il est placé immédiatement après les vases du peintre de laLibation, mais laissé à part en raison des retouches qu'il a subies. J'avaisd'abord pensé que le cratère de Genève confirmait son attribution au peinmede la Libation. Mais le ptofesseur Trendall a eu I'amabilité de me dire que
les deux vases, indéniablement du groupe de la Libation, devaient plutôtêtte tapptochés du groupe de Naples H,3zz7 (inv.811lt): LCS 4oz, z8rpl.tt7,r.t 49,t "-
de hauteur pour le catère de Genève et rr,, cm pour celui dcMadrid. Le cratère de Naples H. 3zz7 mesure 46 cm.9 Sur le ctatète de Naples H,3zz7, on trouve aussi les couronfles d'oves à
l'attache des anses, mais seulement sur la face principale; en revanche, lelautiet est sans baies.
'o Elle apparaît une fois sut le cratète de Naples H.1zz7, sous l'anse, et surquelques auties vases du groupe AV 2, notamment: deux fois sut le cratèreen cloche de Naples H. 776 (inv. 8z 5 73), du peintte d'Astarita (Trendall LCS
4ot,z77),unefois sous l'anse du cratère encloche duBrit.Mus. r gtr.4-zg.t,du peintre de Détroit (LCS aq,zg), trois fois sur l'hydrie du Brit.Mus.F z17, qui a donné son nom au peintre (LCS 417,384 pl. 169, r.z).
pieds de l'éphèbe qui est debout. S'agit-il de tochets ou de négli-gence du peintre, qui a oublié de remplir ces sutfaces âprès avoirmarqué d'un large contour la silhouette des figures " ?
Le traitement de la face permet aussi des rapprochements. L'ceila une expression figée qui n'est pâs sans rappeler certaines figuresdu peintre de la Libationr2. Le contour est marqué par deux
traits, rectiligne en haut, incurvé en bas; la pupille, replésentée
pat une ligne verticale, donne au regard quelque chose de fixe.Chez plusieuts personnages, oo retrouve le nez légèrement relevé
et le menton fuyant; cette pârticularité, jointe à l'absence de
lèvres fortemert marquées, suggère patfois l'impression d'unebouche édentée. Deux des protagonistes du cratète de Genève
ont la tête tournée de trois quarts; le détail médte d'êtte sou-
ligné, car une telle pratique n'est pas fréquente dans le groupeAVz. En ce qui concerne Sthénébée, le rapprochement s'im-pose, typologiquement, âvec la femme en lamentation, assise surun monument funéraire; car elle apparaît fréquemment de troisquarts 13. Appliqué à Bellérophon, le procédé est plus inattendu;d'otdinaire, dans la scène de la remise de la lettre, les deuxhommes se font face et sont représentés de profil'a. En revanche,
dans l'épisode du combat contre lâ Chimère, il n'est pas târe que
Bellérophon soit présenté de trois quârts, et l'on peut d'ores et
déjà présumer que le peintre aura transposé d'un motif à l'autrece mode de présentation inhabituel dans la scène du départ'S.
Le dessin de la draperie offre d'autres points de comparaison.
L'himation de Ptoitos et celui de Poséidon présentent les mêmes
plis, groupés pâr deux, et la même saillie en forme de Signa darrs
" La seconde éventualité paraît plus probable, car de semblables patcelles
rêservées apparaissent le long de la branche de lautier, au col du cratère de
Genèvc. S'il s'agit de rochcrs, la comparaison s'impose avec la coupe deDourisau Louvre G r r 5 (BeazleyARVz434,74).Yokàcepropos C.Robert,Ârchâologischc Hermeneutik Q9r9) zo5.
'1 On comparera le jeune satyre de gauche, sur le cratère du Louvre K 245
(cf. cupra note 4), avec la femme offrant la libation sur notre vase et le guer-riet qui est devant elle. L'exptession de l'éphèbe assis tappelle davantagecelle de Pan sur le cratère du Louvre.
'3 Voit les amphores à col de: New Haven, Yale University 335, du groupede la Face Blanche (Trendall LCS 397,265 pl. r54,6); ltrüinterthour
363, dwpeintre d'Astatita (LCS 4oo,27t p1.r56,2.); Budapest 5r.34 @CS Suppl.r, 7o, 248 a pl. 18, 3). Voit aussi infra note 39.'a Exception: stamnos de Bostoo oo.349, du peinue d'Ariadne (d. infranote
49), mais les têtes de ttois quâits sont précisément une des caractéristiques
du peintre (voir Cambitoglou and Trendall APS r7).t5 De même sur Ie cratère de Hillsborough (cf. inJra note 36), Bellérophon,monté sur Pégase, est présenté de trois quarts.
97
le bas du dos. L'étoffe drapée sur les jambes de l'éphèbe assis
derrière Athéna, sur le cratère de Madrid, et sur celles de la 6gurecorrespoodante, au revers du cratère de Geoève, présente uoe
remarquable uniformité lpl.26, r et 2t,2).Sur le cmtère de Madrid, la fe-me du revers reproduit la posi-tion du Poséidon de l'autre face; de même, sur celui de Genève,l'éphèbe du revers rappelle Proitos. Saas doute des schémas
d'école se cachent-ils derrière ces corïespoodances, car l'éphèbedu cratète de Naples H.3zz7 et celui du cratère de Genève sem-blent calqués l'un sur l'autre.Les cratères de Genève et de ltadrid presentent, en outre, deuxéléments à tel point ideotiques, qu'oo peut pader de composi-tions jumelles: il s'agit d'une part des têtes barbues et couron-nées de laurier, d'autre part du cheval ailé. Alors que la cheveluredes éphèbes du revers forme une masse compâcte, au contourptécis, barbe et cheveur, sur la face principale, sont dessinés paftraits ondulés et nerveux. Des interstices clairs apparaissent dansles entrelacs de la barbe, tandis que des mèches rebelles et des
boucles plus souples débordent sut la ligne téservée qui marquele contour de la tête. Quant au cheval, il est présenté de ttoisquarts sur les deux images, animé du même mouvement de latête et des pattes antérieures. L'usage de reptésenter Pégase enblanc est attesté, tant dans la céramique âttique que dans celled'Italie méridionale'6. Le plus souvent, les ailes sont de la mêmecouleur que la robe, éventuellement rehaussées de traits ou depoints blancs, si l'animal est traité en figure rouge. Il arrivecependant que des peintres apuliens associent des ailes blanchesà un corps en surface réservée'7. Le peintte campanien des cta-tètes de Maddd et de Genève, de même que l'un de ses collègues,le peintre de Manchester, procèdent à l'inverse: la robe est
blanche et les ailes sont réservées, ce qui permet une facture de
détail plus poussée'8.
'6 Exemples attiques: cratère eo calice de Gêoes r9rr. 161 (Schauenburg,Bellerophon 69.9); cratère en calice de Lecce 453o (M.Bernardini, Vasiattici di Lecce ÿ96fl 67-7t, avec ill.); fragment de Corinthe (F,Brommer,Marburger \Tinckelmann-Ptogïamm ryjzlj4 pl. 3). Les exemples italiotessoot assez nombreux. Voir Schauenburg, Bellerophonsage ro,t7.'7 Exemples: enochoé de Tarente 524(ca (Sctauenburg, Bellerophon âg.r-3); fragment de New Yotk, coll.J.V.Noble (Schauenburg, Belletophon-sagefrg.4).
'8 Voir le cratère en cloche de \ÿinterthour $4 @1. infra note 5 r). La diffé-rence de technique ne correspond pas à la distinction enüe le dessus et ledessous des ailes, car Pégase les tient tantôt dressées parallèlement, tantôtdéployées en éventail, Parfois une aile est levée et l'autre baissée. On remar-
98
Quelle est la fonction du cheval ailé sur le cratète de Madrid?La ptésence delatd,.1ærtor, symbolisée par une seiche et par unautre animal madn, interdit de reconnaitre en lui le p,aqtôpr,ou
ptoduit par Poséidon19. Cette version de la légende n'est d'ail-leurs attestée que par des témoignages beaucoup plus tardifs2o.
Est-ce «la monture qui a amené le dieu sur le rocher de l'Acto-pole » 2r ? Une telle hypothèse serait corroborrée pâr l'hydrie de
Kertch, où Poséidon tient un cheval par la bride, et par la pélikéde Policoro, où l'une des faces le montre chevauchant vers lelieu de rencontre, alors que sur le côté opposé, on voit Athénas'approcher sut un attelage2z. Cependant, sur aucun de ces vases
le cheval a'est ailé. Cela est d'autant plus étonnant que, dans lamythologie grecque, les ai-les étaient l'attribut par excellence des
chevaux divins: Homère et Platon y font allusion précisément
à propos de Poséidon, et tel document figuré atteste que les
peinttes avaient une conception anâlogue23. Mais dans tous ces
exemples, il s'agit d'un attelage: c'est sur un cha( que le dieu voleau-dessus des étendues marines24. La seule image couespon-
quera toutefois que la présentation des ailes parallèles est plus fréqueote que
celle des ailes en éventail, læs deux tlrpes sont utilisés, sur le cratère deMadrid, pour le cheval et pour Niké.'e C'est pourtant I'opinion de F. Àlvarez-Ossorio, Vasos gtiegos . . , Museoarqueol6gico nacional (r9ro) 73.ro Voit C.Robert, Der Streit der Gôtter um Athen, Hetmes 16, r88r, 64 et
J.G.Ftazet, Apollodorus (Loeb t. z, tg16) 78-79, n.r." M. Collignon, La dispute d'Àthéna et de Poséidon, Comptes Rendus, Àca-démie des Inscriptions et Belles-Lettres r9n,146.'? Hydrie de Leningrad (K.Schefold, Untersuchungen zu den KertscherVasen [1934] zr,16r pl.z8 et 69.y8; H.Metzger, Les représentations dansla céramiquc du IVe siècle j95rl 324,4o; Â.B.Cook, Zews 1lr94o)752fr,g.13,8) et péliké de Policoro (Trendall LCS yy, z8zpL.z5,3.4; N.Degassi, Ilpittore di Poücoro, Boll. d'Àrte 5o, ry65,4-q frg.3518; bibl. dans LCSSuppl. r,4. L.lÿeidauer, AntK 12, ry69,9t-97 pl.4r, r-z). De même, Poséi-don à cheval dans la Gigantomachie sur l'amphore à col du Louvte S 1677(Beazley ARV2 r344, r).23 Iliade t3, z1-y;Pleton, Critias r r6d-e. Voir aussi l'hydrie de Compiègner o 5 6 @eazley ABV 3 64, 5 3 ; CVA pl. 7, 5 et 9, z). L'attelage est conçu commecelui d'Hélios ou de Séléné. Pour Hélios: K. Schauenbutg, Helios (rSS ù $et 7o,3zo, et Gestimbilder in Âthen und Unteritalien, AntK 5, ry62, 5r,Pour Séléné: A.Cambitoglou, TheBrygos Painter (1968) z1-25. Surles atte-lages ailés en général, voir P. de La Coste-Messelière, Àu Musée de Delphes
Qy6) 4o1,5.{ Voir aussi Euripide, Andromaque roro-r r. De même, au fronton Ouestdu Parthénon, dans Ia scène de la dispute, Poséidon comme Athéna étaitflanqué de son attelage, voir F.Brommer, Die Skulpturen der Parthenon-Giebel (1963) 16o et 163.
dante qu'on puisse mentionner est celle d'un cratète apulien de
Naples: derrière le dieu, qui s'entretient avec Amymone, on voitle même cheval ailé que sur le cratère de Madtid. Sa présence
dans deux épisodes légendaires dilférents ne peut être le fait duhasard, et il faut admettre qu'il âppartient à Poséidon. Mais il est
significatif que les imagiets n'aient jamais teprésenté le dieu che-vauchant la monture ailée"S. Si l'on songe que quelques décen-nies plus tôt, le peintre d'Àriadne avait introduit Poséidondans l'épisode du combat contre la Chimère, on s'étonneta en-cote moins de rencontrer le cheval ailé dans la scène de la disputeopposânt Athéna à Poséidon26. Je préféretais ne pas padet de
Pégase dans un tel contextezT, mais je croirais volontiers que lepeintre s'est souvenu de lui en dessinant le cheval du dieu28.
Tout se passe comme s'il avait procédé par association d'idées,ou, plus précisément, d'images, et les interfétences qu'on relèveentre les cratères de Madrid et de Genève montrent que les deux
'5Voit le cratère en cloche de Naples H.69o (inv.8r946): J.Overbeck,Griechische Kunstmythologie 3 fi87-78) 384; V.Macchioto, Jdl 27, rgrz,z8 5 frg, r zb ; K. Schauenburg, Antike und Abendland r o, r 96r, 84, z, Sur lacoupe de Siana du Cabinet des Médailles y4 @eazley ABV 65,4r; A.DeRidder, Catalogue des vases peints r [r 9oz] 2o8,3t4fr,g.76;CVÀ pl. a5, r-5),le trident a patfois fait songer à Poséidon (De Ridder l.c.; Collignor. l.c.
[note zr]). Mais Beazley, ABY 65,4r, a montré qu'il s'agit de Bellérophon.Sur le tddent comme alme de Bellétophon, voir Schauenburg, Bellerophon
73 et 75-76. Sur le lécythe à fond blanc d'Oxford 247 (C, H, E. Haspels, AtticBlack-figured Lekythoi lty6l 255,19 pL.44,4i E.Simon, Die Gôtter derGtiechen 1t96fl 84 fig.8o), le cheval monté pat Poséidon a des ailes, maisc'est un cheval matin, dont l'atrière-train est en fotme de queue de poisson.Un cheval ailé, avec ou sans cavalier, âgure encore sur quelques images apu-liennes tardives, dont le sens est aussi énigmatique que f identité des person-nages qui les composent: sans cavalier, sur le cratète à volutes de NaplesH.149 (ir,8zz6z);.une fois avec et une fois sans cavalier, sur le cratère à
solutes de Naples H. 325 z (inv. 8z z6r).'6 Cratère à colonnettes de Ruvo J. rogr (Cambitoglou and Trendall APS
ry , 5 pl. 4 fr.g, r 5 ; Sichtermann 19, K 46 pl. 78) où il fait précisément pendantà Àthéna, Schauenbutg, Bellerophon 75-76, cite d'autres exemples, mais oùPoséidon figute patmi d'autres divinités.
'i Comme le foflt Alvârez-Ossotio l.c, (ruprd note r 9) et Degrassi l. c. (tapranote 22) r1, lequel ne iustiâe d'ailleuts pas son intetprétation.
'E N'oublions pas qu'entre Pégase et Poséidon, il existait des liens étroits:le dieu passait pour I'avoir engendré (Hésiode, Théogonie 278-8t;Apollo-dore, Bibliothèqte 2,3,2); on disait aussi qu'il était le père de Bellérophon(Hésiode, fu,245 Pizachl), et qu'il lui avait fzit don du cheval ailé (Hésiode,k.1b et 245 Rzach3). Voir L.Preller et C.Robert, Griechische Mythologie r(r894) 588-92, et N.Yalouris, Athena als Hertin der Pferde, Museum Hel-set.icum 7, g Jo, r 9-ror, notamment z9-3o. 5 7. $-64 et 94.
comPositions ne sont Pâs seulement §ceufs Par le style, maisqu'elles sont aûimées d'une seule et même inspiration.
1. LE CRATÈRE DE GENÈVE ET LES AUTRES IMÀGESDU DÉPART DE BELLÉROPHON"
Suivaot de près la découverte de I'hydrie d'Astéas (pl,z7rt)3o,celle du cratère de Genève vient enrichit aujourd'hui l'iconogra-phie d'un nouveau document d'égale importance. Le hasard a
bien fait les choses: sortis respectivement des ateliets de Capoueet de Paestum, les deux vases preflnent place aux côtés du cratère
de Ruvo Çpl.z7,z)31, âttestant ainsi l'existence d'une ttadition6gurée commune à des écoles différentes par le style et assez éloi-gnées les unes des autres géographiquement. La répartition des
personnages en deux groupes est constânte: d'un côté Belléro-phon et Proitos, de l'autre la reine, assise à l'écart, et sa sui-vante32. L'accessoire catactéristique du klismos ou do, flabelhmpermet d'établir d'une scène à I'autre un lien encore plus précis.
Le peintre apuüeo Çpl. z7, z) a telégué les protagonistes aux ex-trémités, laissant à Pégase la place d'honneur. I1 y a dans ce
Pârti Pris une recherche ornementale, que trahissent lâ couleurblanche et les ailes déployées du cheval. Celui-ci ne se trouve pas
exactement âu centre; Iégèrement déporté vers la gauche, il suit
'e Sur I'iconographie de Bellérophon eo général voir, outre les deux articlescités de K. Schauenburg: F.Brommer, Bellerophon, Marburger §(inckel-mann-Progtamm ry52154, et, plus anciennement H.Fischer, Bellerophon(r 8 5 r) ; R. Engelmann, Bellerofonte e Pegaso, Ànnali dell'Instiruto 46, :,814
t-rl; H.ÿ. von Prittwitz und Gaffron, Bellerophon in der antiken Kunst(Diss.Munich r888). Pour les représentations archaiques, on se reportera à:K.Schefold, Frühgriechische Sagenbildet (1964) passim; H. von Steuben,Frühe Sagendarstellungen in Korinth und Athen (1968) r r-r3; K.Fittschen,Untersuchungen zum Beginn der Sagendarstellungen bei den Griechen(t969) 47-6r. Sur le thème dans l'at tomain, voir: S.Hiller, Bellerophon,ein gtiechischer Mythos in der rômischen Kuost (r97o), avec survol de l'artgrec (r4-zo) et listes des monuments (9r-rrt; vases italiotes: 97-roo). Lemotifdu départ de Bellérophon ou de son arrivée chez Iobatès a peu retenules exégètes. Voit cependaot: L. Séchan, Etudes sur la tragédie dans ses rap-ports avec la céramique (l 9e6) 494-5o2, et Schauenburg, Bellerophon 8z-87.3o Hydrie de Paestum ir,,zozoz: Â.D.Trendall, Archaeological Reportsfor ry69-7o (Suppl. de JHS) 36-37 fig.7; M.Napoli, Il Museo di Paestum(rs6ÿ pl.$.3' Ctatère à volutes de Ruvo J.t4gg: Sichtermann 36,K 4t pI.66-68; Sé-
chan op.c. (tupra note zg) frg. r45;Hiller op.c. (supra note 29) frg.t.3' Compater le gtoupe féminin sur le cratère de Ruvo et I'hydrie de Paestum:même geste de la teine, même pose des bras de la suivante, bien qu'ici ellearrange le bandeau de sa maîttesse, alors que là elle tientle flabelkm. Sur les
deux vases, en outre, elles ont le regard dirigé vers Bellérophon.
99
de ptès son maîtte, mais tourne la tête en direction de Sthénébée.
Centre de convergence, il opère la fusion entre les deux groupeshumains et assure l'unité de la composition.Ce parfait équilibre n'est pas conservé sur les deux autres vases,
où le centre de gravité se déplace du côté de Bellérophon et de
Proitos. C'est le roi qui est au centre, et les deux hommes oc-cupent à eux seuls plus de la moitié du champ. Cette mise en évi-dence est encore soulignée, sur le cratère de Genève, par le faitqu'ils apparaissent au ptemier plao, alors que la nourrice, et plusencore Sthénébée, sont représentées en retrait. Si le cratère de
Ruvo offre l'exemple d'une scène fermée, fortement structutée,on a ici une composition ouverte, avec «fuite » des personnages
vets la dtoite33. La frise se déroule er sers cootraire sur l'hydriede Paestum (?l.r7,.r), où l'ordre de succession est iûversé: tousles visages sont tournés à gauche, saufcelui de Bellérophoo quileur fait face. Il y a ruprure de continuité: I'i-oterçalle qui sépare
les deux hommes, rendu plus large par le mouyement des bâtons
qui s'écartent, semble traduire l'hostilité entre l'hôte calomoiéet la maison dont le séjour lui est devenu impossible.L'hydde de Paestum présente un certair nombre de particulari-tés qui lui donnent une place à part dans l'iconogtaphie: r) Bel-lérophon est représenté à gauche du roi, alots que partout ail-leurs il s'avance de la droite yers son interlocuteur, qu'il s'agisse
de Proitos, de Iobatès ou même d'une femme seule. La raisonen est sans doute que le peintre n'a pas voulu séparer Proitos dugroupe de la reine et de sa suivante. z) Pégase est absent de lacomposition. Manque de place? C'est une explication admis-sible, mais quel qu'ait pu être le motif d'Âstéas, son option est
significative. Contrairement à la plupart des imagiers, il a pré-féré renoncet à Pégase plutôt que de sacrifier le groupe de Sthé-
nébée et de sa nourtice. Le contraste ne pourrait être plus fote-ment marqué avec le cratère de Genève, où toute la compositionest conçue en fonction du cheval ailé. ) Reptésentées en bustes
dans la loggia qui constitue le registre supérieur de l'image,Aphrodite et deux Furies regardent les humains accomplir ledestin qu'elles leur ont ptépaÉ. 4) Les inscriptions qui désignenttoutes les figures du vase confirment l'interptétation qu'otavait
33 Ouvert et fermé au sens de H.§7ômin, Principes fondamentaux de l'His-toire de I'Art (trad. C. et M.Raymond, coll. Idées-Arts, Gallimard [1952])trt.34 L'uoe des Furies s'appelle Allectô; le nom de l'autre s'est complètementeffacé. Sur le nom d'Astyanassa, cf. infra note 46.
toujouts donnée du cratère de Ruvo, et nous aPPreffrent le nomde Ia nourrice de Sthénébée: Astyanassa3a.
Sut le cratète de Genève, l'élément inédit consiste dans la tepté-
sentation du héros à cheval. Pégase fait rarement défaut dans la
scène de la remise de la lettre, mais, d'ordinaire, Bellérophon est
debout et le conduit par la bride. Le peintre s'est manifestementinspiré des représentations du combat contre la Chimète, car
c'est presque touiours sur le dos de Pégase que le héros afrontele monstre35. Le rapprochement s'impose avec le cratère de
Hillsborough (pl. z9,z), où le motif de la chevauchée est appli-qué à une scène encore différente, apparemment l'arrivée chez
Iobatès36. On ne relève pas trace du message, mais Bellérophonporte une lance dont la pointe est visible près de l'æil droit ducheval. Les réminiscences de la scène du combat, à laquelle le
gloupe du cavalier et de sa monture a été emprunté à peu près
tel quel, rendent l'interprétation délicate. Que penset de l'atti-rude du roi ? Sur un vase perdu de l'ancienne collection Hamil-toa Çfg. dans h texle r), Iobatès téagit par un geste semblable à
l'affrontement du héros et de la Chimère37. La ressemblance est
rendue encore plus frappante par la présence d'Athéna, à quicotrespond le garde du cotps sur le cratère de Hillsborough. Detelles interfétences sont pour le moins curieuses. Mais ici, con-trairement à l'épisode du combat où le principe de dextéralitéest respecté38, Bellérophon chevauche vers la gauche; or, on 1'â
vu, c'est le sens communément observé dans la scène de la remise
de la lettre.
35 Les exceptions sont rarissimes: ctatère à volutes apulien de Berlin F 325 8
(E.Gerhard, Apulische Vasenbilder [r8a1] pl.8); fragment apulien, Bâle,coll. Cahn; stamnos étrusque de Florence inv.7z748 (Schauenbutg, Belleto-phon frg.32-14). Voir aussi Brommet l. c. (tapra note z9) 7. Sur ce point latradition littérake s'accorde avec la tradition figurée. Voir Hésiode, Théo-gonie 3zy etft.TbRzach3i Pindare, Olympique ry, t23-zgi Àpollodote,Bibliothèque 2,3,2. Homère, toutefois, ne pade pas de Pégase (Iliade 6,
t55-zoz): voit à ce propos: A.Lesky, Der Mythos im Verstiindnis der An-tike, GymnasiumT3, ry66,34 (: Gesammelte Schriften j966) 4z).36 Cratère à colonnettes de Hillsborough: I.K.Raubitschek, The HearstHillsborough Vases (r 969) g3-g7, no z7 et Ag. z7a-c; Schauenburg, Belleto-phonsage z7-29.37 §(/. Tischbein, Collection of Engravings from Ancient Vases r (r79r) pl. r ;C.A.Boettiger, Gtiechische Vasengemâlde t (r7g;.) r17; Roschet r.a. Bel-letophon, 763-64 avec ill, (,t. Rapp),38 Voir Schauenburg, Bellerophot 77-78. Pour les monuments archaiques,
voit Fittschen op,c. (supra note z9) t79,78o, Sur le principe en général, onse repoftera notamment à de La Coste-Messelière op, c, (tupra r,ote 4) 3r6-t 9,et aux ouvrâges cités par Schauenbutg, Bellerophon 78, 5 3.
Fig. r
Le groupe est à terre, sur le cratère de Genève, et il n'est pâseni6{ ds 66*e élan. Le détail du bras passé devant l'aile n'a pas
d'équivalent dans la scène du combat, où le héros le tient levépour brandir sa lance. Bellérophon est sur le point de se saisir duxressage: on ne saurait dire par conséquent, que le peintre a
choisi un moment postérieur de l'action; il a plutôt inversé lasuccession des préparatifs. Ici, Bellérophon a enfourché sâ mon-iure aÿant de recevoir la lettre, contrairement à lâ tradition do-minante. Il ne s'agit pas d'ignorance de la part du peintre, maisd'une recherche délibérée de l'odginalité et des efets frappants.Contrairement âu crâtère de Ruvo, où le maximum de tensionest obtenu avec le minimum de moyens, le pathétique, sur le cra-tère de Genève, s'exprime plutôt par les gestes et par les poses
théâtrales des personnages. L'exemple de Sthénébée n'est pas
moins significâtif. Tout, en elle, exprime la langueur et I'abatte-ment: le geste las du bras posé sur les genoux, celui de la main
qui soutient la tête devenue trop pesânte39, l'himation qu'elle a
rabattu sut celle-ci en signe d'affiiction. Sans doute, éprouvera-t-elle des remords, mais plus tard, quand l'absence de Belléro-phon et la crainte de son trépas auront rendu son amour plusfort que sa vanité blessée. L'attitude de Sthénébée, sur les deux
3e C'est lc type traditionncl dc la fcmme affiigée, notammcnt cclui dc Péné-lope et d'Electre, mais son application à Sthénébée o'est attcsté, pour I'ins-tânt, que sur le cratère de Genève. Sur le type en général, voir: P. Jacobsthal,Die melischen Reliefs (r93r) rgz-98; sut Pénélope en parriculier, voir:J.Dôrig, JdI 72, rgj7, 16 et E.Langlotz, Zur Deutung der «Penelope », JdI76, ry6r,72-gg,r;iota;mment 82 et 89. Dans la statuaire, et sur les reliefs mé-liens, le bras qui ne soutient pas la tête retombe verticalemcnt, appuyé surle bord du siège; dans la céramique italiote, au conttaire, il repose sur lcsgenoux. Autre différence: sur les vases, comme dans la statuaire, la feomcest toumée généralement à gauche, non à droite conune sur les reliefs mé-liens; à cet égard, le cratère de Genève constitue une cxceptioo.
autres iûrages (pl.z7,r.z), correspond mieux à la situation:seule la main qui
^ffalnge la parure ou froisse l'étofe du voile
trahit l'embarras et la nervosité. La vanité de la femme et ladignité de la reine l'emportent encore sur le désespoir de
l'amante.La Stbédbée d'Euripide est-elle susceptible d'éclairer les docu-
ments iconographiques{o ? La question se pose pour l'hydrie de
Paestum, dont les inscriptioos poutraient désigner les person-
nages de la tragédie, mais aussi pour le ctatère de Genève, catl'intervention de la vieille nourrice y est attestée par le pro-logue4r. A vrai dire, Astâs me paraît pêcher pat excès de zèle,
et les inscriptions soot iustement ce qui me fait douter de l'ori-gine <<littéraire» des figures. Chez les mythographes, Allectô est
l'une des trois Erinnyes, dont les sceuts se notnment Mégaira et
Teisiphoné+'2. Ces deux dernières, Astéas les a inttoduites dans
une autre de ses compositions mythologiques, rePrésentant
Oreste à De$hes43. En I'occurence, la conftontation avec la tra-gédie est possible, et la réponse est claire: ni par le nombte, nipat le nom, elles ne correspondent à la donnée d'Eschyle dans
les Ewhides. En Italie méridionale, les Erinnyes appataissent
dans des scènes si nombreuses et si vadées qu'il est impossible
d'admettre pout chacune d'elles ufle source littétaire ptécisea+.
Astéas, qui affuble volontiers ses personnages de noms fantai-sistes45, les a manifestement introduites ici par analogie avec
d'autres motifs légendaires. La présence d'Âphrodite n'impliquepâs davantage qu'elle jouait un rôle dans la tragéüe. On songe
immédiatement au prologu e d' II ippo ÿ te, mais ptécisément, dans
Sthédbée,le npoloy[laÿ étâit Bellérophon, non pas Cypris. Le
ao Voit Séchan op. c. (stpra rroæ zg) 494-5oz; T. B. L. §7ebster, MonumentsIllustrating Ttagedy and Satyr-playr 1Bull. of the Institute of Classical
Studies, Suppl.zo, ry6) fiy64; id,,The Tragedies of Euripides (1967)
80-84 et ,or-oz.{' Euripide, Sthénébée ro-r4 (D,L.Page, Litetary Papyri Poetry [Loeb t.3,r95ol rz8-29).a2 Le nombre 3 est attesté en premier lieu chez Euripide, Oreste 1610 etTroyennes 45 7; sut les noms, voir Apollodore, Bibliothèque r, r, 4 (voir REsuppl.S [r956] t22-24s.ÿ. Erinys [E.Vüst]).a: Lécythe de Paestum: À,D.Trendall, Paestan Àddenda, Papers of theBritish School at Rome 27, r9tg, z, A3; P.C.Sestieri, Rifessi di drammieschilei nella ceramica pestana, Dioniso zz, rgtg,4j-ÿ frg,1-j,aa La liste des motifs est donnée par §7üst l, c. (supra note 4z) r 3 8 sq.a5 Voir notamment les noms des Hespérides sut le lécythe pansu de Naples
H.2873 (inv.81847): A.D.Trendall, Paestan Pottery ÇyG) zo p1,4; id.,Paestan Pottery-a Revision and a Supplement, Papers of the British Schoolat Rome zo, r9t2, j,42,
702
nom d'Astyanassa ne doit pas susciter moins de méfiance, car lanoutrice est touiours un personnage anonyme dans le dramegrec{6. La présence même de la reine ne signifierait pas néces-
sairement, d'après §7ebster, qu'elle figurait sur le théâtre dans
la scène correspondante47. Lr concession est d'importance, sil'on songe que deux tentatives ont été faites récemment pourdémontter que la tragédie s'ouvrait non sur le départ de Belléro-phon, mais sur son retour de Lycie+8. Dans un tel cas, les vases
peints n'auraient plus de tappott direct avec Euripidel tout auplus celui-ci aurait-il relancé un thème oublié et sollicité ainsil'intérêt des imagiets.
Quelle relation existe-t-il entre ces trois vases et les autres repté-sentations du départ de Bellérophon ? Sur quelques images, lafemme joue un rôle légèrcment différent. Au lieu d'être assise
à l'écart, elle se tient debout près du roi et semble participer plusdirectement à l'action Qpl.28, r. z)+r. 5ot le stamnos de Boston,elle sort précipitamment du palais, comme si elle voulait inter-venir dans la discussion. Le décot architectural, commun auxdeux images, est une autre particularité inconnue des représenta-tions précédentes. Bellérophon s'est déjà saisi du message, alorsqu'ailleuts celui-ci est encote dans la main de Proitos 50. Momentdifférent de l'action ? Autre version de la légende ? Tout ce quenous pouvons dite, c'est que ces transformations vont de pairavec l'emploi d'un schéma iconographique différent, mais rienne permet d'affirmer que l'identité des petsonnages a changé etqu'il ne s'agit plus de Proitos ni de Sthénébée.
16 Voit les Trachiniennes de Sophode, l'Hippolyte, l'Andromaque, la Médéed'Euripide. Une seule exception: les Choéphores d'Eschyle (732),maislanourrice d'Oreste a touiours porté uo oom dans la légende (voir scoliesd'Eschyle, Choéphores 73 3). Et il oe s'agit, chez Eschyle, que du nom d'ori-gine, propre aux esclaves (Ki).ooa). De même, la nourrice du cratere deGenève est désignée comme une esclave par ses cheveux coupés court.17 T. B. L. Vebster, The Tragedies of Euripides (tgi) Sz.lt VoirB, Zühlke, Euripides'Stheneboia, Philologus ror, 196r, r-r, et r98-22r; et D.Korzeniewski, Zum Prolog der Stheneboia des Euripides, Philo-logus ro8, 1964,45-65. Contra: §flebster ap.a. (note précéd.) 8r et A.Lesky,Die tragische Dichtung der Hellenen3 (tg7z) 326,{e Stamnos de Boston oo.349, du peintre d'Ariadne: Cambitoglou and Tren-dall APS 17,r; À.D.Trendall, Frühitaliotische Vasen (1938) pl.z3, et am-phore de type panathénaîque de Naples H,z4r8 (nv.\zz$), du peintred'Amykos: Trendall LCS 44,218; Schauenburg, Bellerophoo 69.24; Sé-
chaa op. c. (rupra tnte z9) frg. 46.50 A moins que les deux hommes n'aient la main sur lui, comme sur l'hydriede Paestum et le catère de Ruvo. Le cratère de Genève est endommagé àcet endroit,
Une femme apparalt encore dans une attitude semblable sut lecratère de§üinterthour(p/. z 6, 7), qui tppartient au même groupestylistique que celui de Genève5'. Le roi est assis: la mitré phry-gienne et les tablettes ouvertes qu'il est en train de lire désignentiafailliblement Iobatès. Mais qui est la femme qu'on voit deboutdertière lui? Pas son épouse, dont il n'est fait mention nullepârt; or on sait que Iobatès avait une fille doat il accordait lamain à Bellérophon au terme de ses exploits52. Assistait-elle,dans la légende, à la lecture de la lettre et à la première tencontrede son père avec le bel étranger ? C'est douteux, et je me demandesi la figure, loin d'avoir une fonction légendaire précise, ne s'ex-plique pas plutôt par une suryivance iconographique. Commela Sthénébée de plusieurs images, elle a la tête voilée de son hima-tion. Tout se passe comme si le peintte, après avoir transportéla scène de Tirynthe en Lycie et substitué Iobatès à Ptoitos,o'avait pu se résoudre à suppdmet la femme qu'il était habituéà voir dans la scène du départ de Bellérophon. Sur la fresquepompéienne du Musée de Naples, le même schéma avec le roiassis et la femme debout est appliqué à la scène du départ, et c'estSthénébée qu'on a unanimement reconnue dans la figure qui se
tient detrière le trône, le regard petdu dans le lointain53.Poutquoi ce flottement dans l'imagerie ? J'en vois deux taisons:r) La répétition, dans la légende, de la remise de la lettre à deuxmomerits distincts - d'abord de Proitos à Bellérophon, puis de
Bellérophon à Iobatès - était une source de confusions inévi-tables. Il ne semble pas qu'on puisse citer un âutre mythe grecdont deux épisodes aussi peu diffétenciés aient fait l'objet de
représentations figurées. z) L'épisode du départ de Bellérophon,inconnu dans la céramique attique, n'a pas été teptésenté avantle quatrième siècle. L'absence d'une ttadition figurée dûmentétablie explique peut-être l'embarras des décorateurs italiotes.L'utilisation de schémas difétents pour la scène du départ, ou,invetsement, d'un même schéma pour la rencontre avec Proitoset celle avec Iobatès, trahit une certaine instabilité des imagiers.L'enseignement de la scène à deux personnages n'est pas diffé-rent. L'ambiguïté estinsurmontable, quand des signes extétieurs
j' Cratère en cloche de §ÿinterthour 364, du peintre de Manchester: Tren-dall LCS 4t1,16o p1.fi7,5.6; H.Bloesch, Àntike Kunst in der Schweiz(tg+» ÿ pI.49. On remarquera que les manches de Iobatès sont omées des
mêmes points blancs que celles de Proitos sut le cratère de Genève.r' Homère, Iliade 6, r9z; Apollodore, Bibliothèque 2,3, z.::Pompéi IX z, 16 (Naples inv.rr5399). Voir K.Schefold, Die rJflânde
Pompejis (tg5) z4z; HBr pl. zo4; Hillet op,c. (tupra note z9) z811o frg,rc.
ne Permettent pas de trancher: ainsi sur le lécythe de Naples, oùla coiffe orientale et les tablettes ouvertes désignent Iobatès5a.
Ailleuts, aucun indice ne vient à l'aide de l'exégète: ni les traitsdu toi - il porte toujours la barbe -, ni son costume - partout ilest vêtu de l'himation -, ni ses attributs - il tient invariablementle sceptre55. Sur l'hydrie de Capoue Çpl.29, r),la position assise
pourrait faite songer à lobatès, par analogie avec les images oùil lit les tablettes; mais ici, elles sont scellées, preuve que nous
avons affaire au mandataire, Proitos. En l'absence de tout cri-tère, le doute me semble êüe en faveur de Proitos, car la remise
de la lettre à Bellérophon avait, en soi, une portée dramatiquequi justifiait le choix d'un tel moment, et le nombre nettementsuPérieur des documents qui nous sont parvenus de cette scène,
Par fapport à l'âutre, montre que les imagiers l'entendaient ainsi.
C'est pourquoi j'inclinerais à reconnaître Proitos plutôt que
Iobatès sur le cratère de Bonn (Pl. ,g, r), où, d'ailleurs, le sens de
l'échange correspond à celui de la plupart des images56. Il est
des cas où l'échec de l'intelprétation ptocède de notre ignorancedes mythes représentés. Ici, l'ambiguïté est imputable aux pein-ttes eux-mêmes, qui n'ont pas pris soin de distinguer entre deuxmoments légendaires précis. On a l'impression gue le motif les
intéressait comme tel, indépendamment de son contenu, d'oùl'emploi d'un schéma invadable pour les deux scènes - la seule
vatiante consistant dans la position assise ou debout, mais qui,on l'a yu, ne modifie nullement la signification. On peut même
se demander si les peintres avaient toujours une idée claite de lascène qu'ils représentaient. Sut le cratère d'Eton (pl.z9,$lamain de Bellérophon va à la rencontre de celle du roi, mais lemessage n'est pas représenté. On en a déduit que le héros prenaitcongé non de Proitos, mais de Iobatès, au moment de s'envoler
5a Lécythe pansu, inv. r47 868, du peintre d'Àvetsa: Trendall LCS y4,78tpl, r 3o,8; }lillet op.c. (otpra note zÿ fr,g,6, Pour une autle interprétâtion:Schauenburg Belletophon 87. Sur le bonnet phrygien: A.Alfoldi, Die tro-ianischen Urahnen der Rômer (rS:Z) 8,55 Hydrie de Capoue, du peintre de Caivano (Trendall LCS 3o8, y7r; CVA rpl. 9); cmtère en cloche de Bonn 8o, du peintre de Hearst (Cambitoglou andTrendall APS r4,9; Schauenbutg, Bellerophonfrg.z); cratète en cloche de§flindsor, Eton College, ex Hope 324, du peintre de Iobatès (LCS 326,746;E.M.§ü.Tillyard, The Hope Vases [1923] pl.4r,2). On ne sait ce qu'estdevenu le skyphos iadis dans une collection privée à Naples, du peintre deLaghetto (LCS 3oz, 5 37).56 lobatès, d'après Schauenbutg, Bellerophon 83; Proitos, d'après T.B.L.\Webster, Monuments Illustrating Tragedy and Saÿr-play2 (rapra rtote 4o)fiJ.
pour combattre la Chimère57. En fait, les deux hommes n'échan-gent pas une poignée de mains; le geste est vide de sens, et toutlaisse croire que l'imagier n'afait que reproduire, en le dénatu-rant, un modèle qu'il ae comprenait pas58.
Dans l'interprétation, faut-il donnet la primauté au schéma de
compositioa et coasidérer l'ensemble des documents d'une ma-
nière globale, ou faut-il ioterpréter chaque image pour elle-même? Engelmano a defeodu la premiète méthode, proposantde reconnaltre Proitos sur toutes les illustrations, même sur lecratère de §7interthour59. Saos doute a-t-il raison d'attacher une
grande importance à la tradition 6gurée e1 2ua analegiss de com-position. Un exemple le prouve: que Bellérophon s'apprête àpartir ou qu'il soit arrivé au terme de son vovage, Pégase est tou-jours teprésenté piafant, avec l'uoe des panes aotérieures levée,
parfois aussi une patte postérieure. Ce détail mootre que les im,-giets procédaient à partir de modeles 6gures et qu'ils re teoâieûtpas compte de la situation parriculière dan5 laquqlls les person-nages étaient impüques. Ce qu'on pourrait teprocher à Eagel-tnann, en revanche, c'est de o'avoir pas yu que I'iatér& i"A"i-sable de l'imagerie résidait précisémeot dans 12 liberté qu'avaitle peintre de déborder le schéma et d'exprimer au travers de
celui-ci une situation ioédite. Par leur complexité même, les
représentations italiotes de la légende de Bellérophon illustrentadmirablement le jeu réciproque des formes et des significationsqui est, en définitive, celü de toute iconogtaphie.
4. L'HISTOIRE DU VASE
Dans son ouvrage intitulé Griechische Vasengemiilde, paru en
1797, C.A.Boettiger écrit ceci: «... Le héros (Bellérophon) fi-gure en outre sur plusieurs vases qui n'ont pas encore été portés
5, Tillyard op.c. (raprarote 5) t61-66.5E En revanche, il semble bien que sur le cratère en calice étrusque du LouvreK 4or (Schauenburg Bellerophon fr,g, zG), le roi tienne le message dans sa
main droite baissée. C'est cn vain que Ia sagacité des interprètes s'est exercée
à l'endroit de deux documents où Bellérophon se trouve seul en face d'unefemme: cratère cn cloche de Compiègne ro57 (Treodall LCS ro5,5 yo; CVÀpl,z6,;.ro et z8,r) et cratère en cloche de Naples H.r89r (Schaueoburg,Bellerophon 69. z5 ; Séchan op, c, Isilprd rLote z9) frg. 47 ; Hillet op. c. lsuprunote 291 69.4). Nymphe, Philonoé ou Sthénébée, le peintre ne s'est peutétrepas même posé la question, et I'algument mythologique n'est ici qu'un pré-texte. Inversément, sur le cratère à volutes du Brit. Mus. F r 5 8 (Â. Cambito-glou et À.D.Trendall, Addenda to Ap,.tlidn Red-fgure Vasc-painhrs of the
Phin St1lc, AJL n, ry69, 424; FR 3, 34t frg.fi), on hésite à reconnaltreBellérophoo, car le cheval n'est pas ailé, mais toute la composition cor-tespond au schéma habituel (voir Schauenburg, Bellerophon 86,8o),
to4
àla connaissance du public. Les amateurs seront heureux de trou-ver ici quelque information à leur sujet, tirée de la correspon-dance de Mr.Tischbein: <<Dans la collection royale de Capo diMonte se trouve un vase sur lequel on voit une femme assise
dans une attitude de tristesse, une autre debout devant eUe, etun ieune gârçon âssis sur le sol, accroupi. Bellérophon, montésur Pégase, tient deux lances à la main. Proitos est debout à côtéde lui et lui remet, dans un rouleau, le message destiné à sonbeau-père, Iobatès ... »6o. Il n'y a pas le moindre doute: le vase
décrit pat Tischbein et le cratère de Genève ne font qu'un. Nonseulement le nombre et I'identité des petsonnages sont les
mêmes, mais leurs attitudes coocordent parfaitement. La posi-tion de Bellérophon, déjà monté sur Pégase, constitue un ârgu-meot décisif, et les rares divergeoces, portaot sur des points de
d6rail, s'expliquent aisément. Tischbein pade d'un jeune garçon,alors que nous reconfirissoos plutôt une petite seflrante dans lafigure accroupie sur le sol. Il en va de même pour les deux lances
que Bellérophon aurait tenues à la main: on n'en relève pas lamoindre trace sur le vase, et il est peu probable qu'elles se soieote&cées. Mais Tischbein peut avoir confondu avec une âutrereprésentation du héros, peut-être celle du crâtère de NaplesH. 1243, qu'il décritprécisément àla suite du nôtre. Et n'oubüonspas qu'il citait de mémoire.La lettre de Tischbein à Boettiger, dont ce passage est tiré, n'est
59 Voir Engelmant l. c. (atpra note 29) r r et , r, avcc certaioes réserves, toute-fois, pour le cratère dc \trÿintethour.6o P.3z-13: «. . . Âber der Hcld erschcint noch auf mehrercn Vasen, die bis
ietzt noch nicht dcm Publikum mitgeteilt worden sind. Es wird dcn Lieb-habem angenehm sein, aus Hrn.Tischbein's Briefen hier einige Nachdchtdarüber zu tnden: In der kôniglichen Sammlung zu Capo di Monte befindetsich eine Vase, woraufeine Frau in einer traurigen Stellung sitzt, eine anderesteht vor ihr, und cin kleiner Knabe sitzt gebückt an der Erde. Bellerophonhat den Pegasos bestiegen, und hiilt zwei Lanzen io der Hand. Proetus stehtneben ihm, und übergibt ihm in einer Rolle die Kundschaft an seiocnSchwiegervater, den Iobates». Et Tischbein continue: «Eine andere Vase,die der Kônig von Neapel erst vor kurzem gekauft hat, stellt den Bellero-phon gerade so im Kampf mit der Chimiira begriffen vor, wie auf unsererVase. Darneben sind noch mehtere Personen gezeichnet, die mit Steinenund anderen rJüaffen gleichfalls gegen das Ungeheuer streiren. Eine dtitteVase, die sich in der Sammlung des Marchese del Vasto be6ndet, enthiilt denKampf des Bellerophon mit det Chimâra auf die obige Art, aber ohne alleweitere Neben6guren. Àusser diesen erinnere ich mich, ooch einige andereVasen, gleichfalls mit Vorstellungen des Bellerophon, gesehen zu haben ».
Le second des vases ici décrits n'est autre que le cratère en cloche de NaplesH. 3243: Beazley ÂRVr 1439, z.
pas publiée dans l'ouvrage de von Alten, si bien que sa date pré-cise nous échappe6'. Il est toutefois possible de la rétablir ap-
proximativement. En efet, très vite après la patution du premiertome de la collection Hamilton, Tischbein cooçut le projet de
donnet une version allemande de l'ouvrage, où ses grâvuresseraient accompagnées du commentaire scientiÊque que ni Ha-milton, ni son associé Italinski n'avaient été à même de réaliser6'.Au début de 1791, il n'avait pâs encore trouvé Ie collaborateurdésité63, mais en mars de la même année, une lettre de la grande-duchesse Amalia lui apptenait que le Consistorial-Rat C. A. Boet-tiger, de W'eimar, était disposé à éctire le texte de l'édition alle-mande6{. Le premier fascicule de l'ouvrage parut en r797, sous
le titre Gdechische Vasengemâlde, et c'est à propos de la pte-mière planche de Tischbein, reptésentant le combat de Belléro-phon contre la Chimère (fg. dans le texte r), que Boettiger cite ladescdption du vase de Capodimonte. Tandis qu'il en pÉpataitl'exégèse, il aura vraisemblablement demandé un complémentd'information à Tischbein sur d'autres illusttations du mythequ'il était susceptible d'avoir eues sous les yeux. D'où la descrip-tion que le peintre lui envoya des trois yases se trouvant dans les
collections toyales et dans celle du matquis del Vasto65.
Autrement dit, notre vâse se trouvait à Capodimonte en t796,quand fut établi le premier catalogue des antiquités conservées
à Naples, et dont Tischbein, directeur de l'Académie de pein-
" Fr. von Alten, Aus Tischbein's Leben und Briefwechseln (1872), quidonne une partie de la cotrespondance échangée par Boettiget et Tischbein.
" Tischbein loue néanmoins ces deux diplomates-archéologues dans sa lettreà Boettiger du 5 iarliet r 796, citée dans les Griechische Vasengemâlde (6o),
ct publiée pat von Alten (0p.c.76-7ÿ, où la date supposée de rSoo est évi-demment erronée.
'3 Dans la lettre à Ramdohr, du ro ianvier qg5, il est encore question del'édition otiginale, avec le texte de Hamilton, dont les dépositaites allemandsétaient Bettuch à \Teimat et Jâger à Francfort (voir von Alten op.c.7z).
'r Voir la lettre à la duchesse Âmalia, du 17 mars r795 (von Alten op.c. $);«Die vielen Briefe, welche Sie die Gnade haben, mir zu überschicLen, sindmir auch sehr angenehm ge'wesen. Besondets das Vorhaben des Hrn.Cons.Rat Boettiger, det willens ist, eine deutsche Abhandlung zu meinen Kupfemder griechischen Gefâsse zu schreiben, willens wat ich immer, dieses §7erkden deutschen Landleuten nùtzlich zu machen, auch Hamilton's Meinungist, den Gelehrten Stoffmit diesem §ferk zu geben, um darüber zu schreiben,was er nicht vermôgend zu schreiben ist».5J Sur l'activité en général de Tischbein à Naples de 1789 à 1799, voir ses
mémoites: Aus meinem Leben, ed.L.Btieger (tgzz), notamment les deuxchapires intitulés: Der Akademiedfuektor et Das Vasenvrerk und der Ho-
ture, était l'un des quatre rédacteurs66. Le cratère de Genève n'yest pas mentionné, car les collections de Portici et de Capodi-monte ne figurent pas dans cet inventaire6T. En revanche, dans
le second catalogue, celui de r 8o5, Haus enregistra tous les vases
qui avaient survécu à la tourmente de la révolution68: le nôtren'y apparaît pas davantage, preuve qu'il avait disparu entre-temps. Comment ? Naples était tombée aux mains de Champion-net en r 799 et les occupants opérèrent des razzias spectaculaires
dans les galeries royales6g. On sait, par le témoignage précis dusurintendant Haus, que les collections de vases de Capodimonteet de la mânufacture de porcelaine eurent particulièrement à
souffrir de ces exactions?o. Il y a de fortes chances pour que lecratère de Genève soit sorti de Naples âu temps de la «soi-disantrépublique», même si d'étmnges récits donnent à croire que les
prélèvements frauduleux, dans les musées royaux, avaient com-mencé dès avant l'occupation française7r.
66 Ce catalogue a été publié par G.Fiorelli, Documenti inediti per servirealla storia dei Musei d'Ialia (Florence-Rome, r 878-8o) r, r 66-74 e t 4, t z 4-6 1.Il se termine ainsi: «Napoli, 3r dicembre 1796. Cav.Domenico Venuti-Nicola Ignarra-Ciro Sevetino Minervini-Guglielmo Tiskbein ("r?). » Voiraussi A. De Franciscis, Il Museo Nazionale di Napoli ('.96) 9-4o,67 Voir Fiorelli op.c.t,Pref.Yl: «inventario generale delle antichità esistitein Napoli nel r 796, fuori dei Musei di Portici e di Capodimonte ». A la 6n duXVIIe siècle, les vases étaient exposés en partie dans le «Real Museo diCapo di Monte », en partie à la «Real Fabbrica di porcellana r» (cf. aussi Boet-tiget op.c. lsupra note 37] ro-rr). La plupart des pièces énumérées dans lecatalogue de q96 sont suivies de la mention: <«ed esiste ivi», c'est-à-dfue à
la manufacture de porcelaine. Exceptionnellement, on tiouve cités quelquesvases de Capodimonte (Fiorelli op.c. t54,37 et r55,49).6t Ce nouvel invenafue, publié par Fiotelli op.c, 4, fi4-273, comprenait:«tre cataloghi separati ... in terzo luogo quello dei vasi antichi greci 6gu-lini», selon les tetmes de Haus, qui aioute: «Queste due raccolte, situâte inprimo a Capo di Monte e alla Fabbrica della porcellana, aveano piri d'altrespetimentato l'infausta sorte, di essere assai spoliate e saccheggiate nei tempidella sedicente repubblica» (cité par Fiorelli op.c. 4, Pref,VI-V[).6g VoL à ce propos le rapport établi le 4 août r 793 et intitulé: «Breve memo-tia sopta la Quadtaria di Capo di Monte pet S.M. it Re» (publié par Filan-gieri di Candida, Napoli Nobilissima 7, û95,94-9).7o ÿoir tuprunote 68, Unautrevasecélèbre,le cratère en cloche duBrit. Mus.F r49, de Python: Â.D.Trendall, Paestan Pottery (1936) 56 pl.r5 et r9a;id. l.c. (sapra note 45) 9,46; ù1., South Italian Vase-Painting (r966) pl.D,reptésentant Àlcmène sur le btrcher, est vraisemblablement sorti de Naplesdans les mêmes conditions quc celui de Genève. Il est, en effet, mentionnédans le catalogue de qg6 (Fiorelli op.ô. fril?ra note 66) 4,t33,rrg), mais neâgure plus dans celui de r8o5. Voir aussi Trendall, Paestan Pottery 56, r,?! Un cettain comte de Patois, dont Millin visita Ia collection patisienne à laât de qg7, prétendait que ses vases provenaient de la collection royale de
Nous perdons toute ttace du vase iusqu'à son séjour dans la col-
lection de J.-G. Eynard, d'où il passa ditectement dans celle du
propriétaire actuel. Bien sûr, il serait intétessant de savoit où le
philhellène genevois l'avait acquis: peut-être sa correspondance
nous le révèleta-t-elle un jour7z? En attendant, la redécouverte
du ctatère de Capodimonte permet de faire connaître un docu-
ment capital de l'iconographie italiote, que les études consacrées
à la légende de Bellétophon n'omirent jamais de mentionner au
XIX" siècle, même si leurs auteurs étâient incapables d'estimer
à sa iuste valeur une représentation dont le hasatd des circons-
tances a tetatdé pendant près de deux siècles la publicationT3.
Naples; son fournisseur napolitain lui aurait dit qu'«on avait pro6té dumoment de la mot du gouvetneur de Capo di Monte pour les sousttakel»(lettre de Millin à Boettiger du rz décembre 1797, citée par ce dernier dans
Griechische Vasengemiilde z [1798] z9-3o). Peut-être le scepticisme de Mil-lin est-il de rigueur (voir Mon.ant.inéd. r [r8oz] r33, r).7' Sur le pied du vase, on lit le numéro 3z peint en blanc: d'où provient-il?Il n'a pas été aiouté pat l'actuel propriétaite et les vases de I'ancienne collec-
tion Eynard, conservés aujourd'hui au Musée de Genève, ne comportentpas de semblables numéros peints.7: Voir, outre Boettiger, Fischer op.c. (*pra note 29) 6o; Engelmann /'c.
(sapra tote z9) rz,r7; von Prittwitz und Gafftorr op.c. (ttpra note 29) 31,1 ;
Roscher rt t9,4.i. !. Stheneboia @uslepp).
ro6
TÂBLE DES PLANCHES
Pl.z4.z1 Cratère en cloche campanien. Genève, coll. ptivée. Phot.
G. Borel-Boissonnas, Genève.
Pl.z6,r.z Ctatere eo cloche campanien. Maddd, Museo Àrqueol6gico
inv. rro95 (L. lt"). Phot.Musée, né9.644114.
Pl,26,3 Cratère en cloche campanien. \Wintelthour' Musée 364 fiadis
Pl.z7,t
Pl.z7,z
Pl.28, r
Pl. 28, z
Pl.29, r
Pl.z9,z
432). Phot.H.Bloesch.Hydrie d'Àstéas. Paestum, Museo Nazionale inv.zozoz.Phot. J. P. §flade.
Ctatère à volutes apulieo. Ruvo, Museo Jatta J. 1499. Phot.Inst. atch, allemand de Rome, ré9,64.1177.Amphore à col lucanienne. Naples, Museo Nazionale H. z4r8(inv. 82263). Phot. J.-M. Moret.Stamnos apulien. Boston,Museum ofFineAtts oo.349. Phot'Musée, nég. C 73 34.Hydtie campanienne. Capoue, Museo provinciale campano.
Phot. Musée.
Cratere à colonnettes apulien. Hillsbotough, Coll. R. À'Hearst. Phot. Stanford Univ. photographic Dept., nég.
tGjgg.PI.z9,3 Cratère à colonnettes apulien. Bonn, Akademisches Kunst-
museum inv. 8o. Phot. Landesbildstelle Rheioland.
PL,zg,4 Cratète en cloche campanien. rVindsor, Eton College (iadis
Hope 324). Couttesy of the Provost and Fellows of EtooCollege.
Fig. dans Vase petdu de l'ancienne collectioo Hamilton. D'après §fl.
le texte r Tischbein, Collection of Engravings from Àncient Vases r(r79r) pl. r.
Je remetcie vivement M.B.Naef de I'empressement avec lequel il a autorisé
la publication de ce vase et de toutes les facilités qu'il m'a accotdées à cet
effet. Qu'il me soit petmis aussi de dire ma profonde gratitude à mes maîtres
Henri Metzger et Oüvier Reverdio: ma dette envers eu:( est immense etdépasse les limites de cet article qui, sans eux, n'eût pas vu le iour. C'est le
professeut Reverdin qui a eu l'obligeance de me signaler l'existence du vase.
Le professeur A. D. Trendall m'a foumi, avec la plus grande générosité, tous
les renseignements qui m'étaient nécessaires, et i'ai eu le privilège de m'enüe-tenit avec lui de plusieurs questions touchant à cette publication. J'ailarge-ment teflu compte aussi des suggestions que les ptofesseurs Paul Collart,
José Dôrig et Katl Schefold m'ont présentées aptès avoir lu mon manuscrit.
Mue Chiistiane Dunant, conservattice au Musée d'Art et d'Histoire de
Genève, après avoir examiné l'original, m'a aidé à résoudte plusieurs pro-blèmes. A tous, i'exprime ma vive reconnaissance.
Pour I'envoi de photographies et l'autorisation de les reproduire, ie suis
redevable à: Dr Michael Ballance (Eton) ; Prof. Hansiôtg Bloesch (Zurich) ;
Prof. Àlfonso De Franciscis (Naples); Dr Fraocesco Garofano Venosta (Ca-
poue); Dr Chtistiane Grunwald (Bor*); Dr Matia Luz Navarro (Madtid);Prof. Mario Napoü (Salerne); Prof. Anton E. Raubitschek (Palo Âlto) ; Prof.Hellmut Sichtermann (Institut allemand de Rome); Ptof. À' D. Trendall(Bundooa); Prof. Emily Vetmeule @oston).