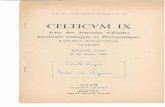A-venir des paysages : décor ou événement ? Planche images et son
Le calcul économique peut-il venir au secours d'une politique de lutte contre l'effet de serre ?
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Le calcul économique peut-il venir au secours d'une politique de lutte contre l'effet de serre ?
Sylvie FaucheuxJean-François Noël
Le calcul économique peut-il venir au secours d'une politique delutte contre l'effet de serre ?In: Revue française d'économie. Volume 7 N°1, 1992. pp. 35-84.
RésuméAvec l'émergence des menaces planétaire, la nature des risques auxquels est confronté l'environnement du fait de l'activitéhumaine a changé au cours des années 1980. La gestion de ce type de pollution, en particulier celle représentée parl'accroissement de l'effet de serre dû aux émissions de CO2, représente un défi pour l'analyse économique standard del'environnement. Seuls des instruments articulant calcul économique et calcul énergétique sont susceptibles d'agir efficacementdans le cadre d'une politique de lutte contre l'effet de serre. Notre proposition de taxe assise sur le potentiel optimal d'économiesd'énergie permet d'atteindre avec le maximum d'efficience économique un objectif de réduction de la consommation énergétiquedonné par le calcul énergétique.
AbstractIn the mid 80s, with the emergence of planetary threats, the type of envi- ronmental risks from anthropic activities has changed.The management of this global pollution, particularly the greenhouse effect due to CO2 emissions, appears as a challenge forstandard environmental economics. Only instruments linking economic calculation and energy calculation are able to be helpfulfor a greenhouse regulation policy. Our proposal of an excise tax on optimal potential energy savings allows reaching a target ofenergy consumption decrease. This target is given by energy calculation and the economic calculation is used to get it withmaximum economic efficiency. Une première version en langue anglaise de cet article a fait l'objet d'une communication desauteurs le 13 juin 1991 à Stockholm (Annual Meeting of the European Association of Environmental and Resource Economists).
Citer ce document / Cite this document :
Faucheux Sylvie, Noël Jean-François. Le calcul économique peut-il venir au secours d'une politique de lutte contre l'effet deserre ?. In: Revue française d'économie. Volume 7 N°1, 1992. pp. 35-84.
doi : 10.3406/rfeco.1992.1301
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfeco_0769-0479_1992_num_7_1_1301
Sylvie FAUCHEUX
Jean-François NOËL
Le calcul économique
peut-il venir au secours
d'une politique de lutte
contre l'effet de serre ?
'évolution de l'ampleur des problèmes d'environnement a été parallèle à celle des questions économiques qui, de nationales, sont devenues progressivement internationales, puis mondiales1. En effet, les pollutions, après avoir longtemps constitué de simples nui-
36 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
sances locales ou nationales (smog urbain, pollution d'une rivière...), se sont hissées dans les années quatre-vingt, d'abord à l'échelle internationale avec l'apparition des pollutions transfrontières (pluies acides), puis à l'échelle mondiale à la suite de l'émergence des pollutions globales (diminution de la couche d'ozone stratosphérique par les chlorofluorocarbones, accroissement de l'effet de serre par l'émission de toute une série de gaz, parmi lesquels le carbone (CO2) et le méthane (CH4) sont les plus répandus)2 (Faucheux & Noël [1990]).
La nature des risques auxquels est confronté l'environnement du fait de l'activité humaine a donc changé au cours des années quatre-vingt. Ils ne concernent pour l'instant que l'atmosphère, mais on peut imaginer que les autres milieux pourraient à leur tour être touchés. Il s'agit de risques planétaires, dans la mesure où ce sont les régulations de la biosphère qui sont susceptibles d'être atteintes; irréversibles, au moins à l'échelle de plusieurs générations ; mal identifiables, car ils nécessitent un appareillage sophistiqué pour être mis en évidence et pour lesquels règne une grande incertitude scientifique, sinon sur leur réalité, du moins sur l'importance de leurs conséquences (Cline [1991]).
Leur élimination relève avant tout de mesures préventives à prendre rapidement parce que, d'une part, aucune technologie d'épuration n'existe à leur propos, et que, d'autre part, les temps de réaction de la biosphère sont si longs qu'on ne peut se permettre d'attendre la certitude scientifique pour agir.
C'est la raison pour laquelle une politique de lutte contre la diminution de la couche d'ozone a été décidée en 1987 avec le Protocole de Montréal, première réglementation environnementale à l'échelle planétaire, établie avant même de disposer de toutes les certitudes scientifiques quant à l'ampleur et aux conséquences de ce phé-
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 37
nomène (Faucheux & Noël [1988]). C'est la voie qui devrait également être suivie dans la lutte contre l'accroissement de l'effet de serre. Toutefois, si l'échelle des risques environnementaux s'accroît, il en va de même pour celle des enjeux économiques impliqués par ces derniers. Ce sont, dans le cas de l'accroissement de l'effet de serre, les émissions de CO2 en provenance de la combustion d'énergie fossile qui apparaissent comme les principaux responsables. L'ensemble du développement industriel est donc en cause, ce qui met en jeu des intérêts non seulement économiques mais aussi géopolitiques. L'accroissement de l'effet de serre constitue en ce sens un enjeu planétaire à la fois du point de vue environnemental et du point de vue économique, ce qui réduit évidemment les chances de succès des futures négociations internationales sur une politique de lutte contre cette pollution (Benhaim et alii [1991]).
Par ailleurs, avec l'émergence des pollutions globales, l'analyse économique de l'environnement connaît un profond bouleversement. En effet, depuis les années quatre-vingt, s'affrontent les tenants d'un nouveau courant de pensée qualifié d'« Ecological Economies» né aux Etats- Unis (Costanza [1989]) et les représentants de l'économie de l'environnement standard. Les premiers pensent que les méthodes conventionnelles de gestion des pollutions telles que l'internalisation des effets externes ou les analyses coût-avantage, reposant sur une valorisation monétaire des dommages, accordent une trop grande importance au marché et ne tiennent pas assez compte des interactions entre biosphère et économie, ce qui les rend inaptes à gérer les pollutions globales. Les seconds ont tendance à radicaliser leurs positions, comme nous pourrons le constater à propos de Nordhaus, et à faire preuve d'un «économicisme» croissant.
En fait, il semble que la solution soit plutôt à cher-
38 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
cher à mi-chemin : le fait que l'analyse économique ne puisse pas traiter de la même façon pollutions globales et pollutions classiques ne signifie pas qu'il faille la rejeter en bloc. Elle doit subir une «mutation» pour s'adapter à ces types de pollution qui constituent, comme le reconnaissait Nordhaus lui-même en 1977, « la forme la plus extrême de déséconomie externe qu'on puisse imaginer» (Nordhaus [1977], p. 342).
En effet, les pollutions globales et en particulier l'accroissement de l'effet de serre sont à la source d'une véritable situation de « crise » au sens que donne à ce mot l'économie historique (Dockès & Rosier [1991]), dans la mesure où le règlement de cette dernière passe, à notre avis, par une mutation non seulement technologique (nouvelles sources énergétiques), mais également économique (bouleversement des hiérarchies économiques et géopolitiques actuelles), sociale (modification des systèmes de fiscalité avec l'apparition d'une fiscalité énergétique alourdie), culturelle (changement des comportements gaspilleurs d'énergie). Ceci implique aussi une mutation de l'outil traditionnel d'aide à la décision en matière environnementale que représente le calcul économique.
Un certain nombre de travaux insistent déjà sur le fait que cette mutation réside essentiellement dans une ouverture de l'analyse économique standard à d'autres domaines, qu'il s'agisse du phénomène entropique3, du social ou de l'histoire4, ou encore du technique.
C'est l'ouverture sur le technique que nous avons choisi de privilégier en montrant que, dans le cas d'une politique de lutte contre l'accroissement de l'effet de serre, l'articulation du calcul économique et du calcul énergétique est susceptible d'offrir une aide non négligeable à la décision.
A cet effet, nous expliquons dans une première partie que le calcul énergétique peut aider, conformément
Sylvie Faucheux /Jean-François Noël 39
à l'approche de Baumol & Oates [1971], à fixer l'objectif environnemental à respecter, en passant par un objectif subrogé qui relève du technique.
Dans une seconde partie, nous montrons que le calcul économique permet, quant à lui, d'atteindre de la façon la plus efficiente possible, cet objectif déterminé par un calcul énergétique.
Une détermination énergétique
d'une norme environnementale
Le CO2 est considéré comme le principal gaz responsable de l'accroissement de l'effet de serre au vu des émissions passées, présentes et attendues, tout en étant le plus facilement contrôlable (avec les CFC qui font déjà l'objet d'une réglementation) par le biais d'une maîtrise des consommations énergétiques. Dans ces conditions, il apparaît que le premier stade de l'élaboration d'une politique de lutte contre l'accroissement de l'effet de serre passe par la fixation de normes de réduction des émissions de CO2. Mais comment peut-on déterminer ces dernières de la façon la plus objective ?
A la recherche d'une norme objective
L'analyse économique standard dispose d'un certain nombre de techniques de fixation de normes environnementales à respecter. Il s'agit alors de s'interroger sur leur pertinence dans le cas de l'accroissement de l'effet de serre et sur les conséquences de l'impossibilité de les déterminer à partir de critères objectifs.
40 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
L'analyse économique: de l'optimum économique à l'absence de fixation d'objectifs
Si l'on suit la théorie conventionnelle de l'économie de l'environnement, il n'est pas nécessaire de choisir au préalable des objectifs. Celle-ci nous enseigne en effet qu'une situation d'optimum est atteinte lorsque l'externalité associée à une situation de pollution est internalisée, c'est- à-dire lorsqu'on se trouve au point où le coût marginal de réduction des émissions est juste égal au coût marginal des dommages. Il suffit de choisir une procédure d'internali- sation (taxe, subvention, négociation directe ou vente de droits d'émission) et la mise en œuvre de celle-ci conduit automatiquement, du fait du calcul économique propre des agents, à l'optimum, qui correspond donc à une pollution optimale. L'objectif se trouve ainsi, en quelque sorte, co-déterminé par le processus même de l'internalisation. Cette méthode est régulièrement employée en tant qu'aide à la décision en matière environnementale par de nombreux gouvernements5.
Les économistes de l'environnement les plus orthodoxes considèrent avec Nordhaus [1991] que «l'effet de serre représente un cas classique de bien public pour lequel les émissions de gaz à effet de serre constituent une externalité» dont l'internalisation s'effectue au point d'intersection des courbes représentatives de deux fonctions, l'une représentant les coûts marginaux des dommages infligés par l'effet de serre et l'autre les coûts marginaux de réduction des émissions de ces gaz. Cependant, comme le souligne Nordhaus [1991], ce type de méthode dépend crucialement de trois éléments, du coût de diminution des émissions de gaz à effet de serre, du coût des dommages dus au changement climatique, et du taux d'actualisation censé refléter l'aspect dynamique du problème. Or, si l'on peut connaître les premiers, l'évaluation des dommages
Sylvie Faucheux /Jean-François Noël 41
reste problématique6. D'ailleurs, parmi les tenants de cette approche, on note des évaluations de dommages assez divergentes. Ainsi pour Ayres & Walter [1991], les dommages dus à l'effet de serre seraient de l'ordre de 30 à 35US$ par tonne d'équivalent-CO2 et non pas de 3,3 à 36,9 US $ par tonne d'équivalent-CO2, comme indiqué par Nordhaus [1991] . Quant au taux d'actualisation, son niveau et son influence en matière de choix portant sur des longues durées sont actuellement controversés (Pearce [1989])7.
En fait, pour évaluer de tels dommages, la littérature économique préconise le recours à des évaluations monétaires fondées sur les préférences individuelles ou sociales, c'est-à-dire l'extension de l'évaluation monétaire traditionnelle aux biens libres (Pearce & Turner [1990]). Ceci impose d'introduire des concepts tels que la valeur d'option, la valeur de legs, ou encore la valeur d'existence. Cependant, les évaluations faites sur la base de ces concepts font appel à des méthodologies particulières telles que le consentement à payer du consommateur (Faucheux & Noël [1990]). Or, Pearce [1976] a montré les limites de telles méthodes pour les pollutions dynamiques ou ayant des effets biologiques, deux caractéristiques qui se retrouvent dans le problème de l'effet de serre à côté de l'irréversibilité et de la globalité.
D'ailleurs, si l'on appliquait cette méthode à un tel problème, global et dynamique, cela voudrait dire que l'optimum d'émission devrait se situer au point où le coût marginal de réduction des émissions de chaque période serait égal à la valeur actualisée du coût marginal du dommage attendu pour chaque période future. Une unité de CO2 émise aujourd'hui aura en effet des impacts différents pour chacune des périodes futures, dans la mesure où ceux-ci sont fonction du stock de CO2 existant à un moment donné et non du flux émis à cet instant même.
42 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
L'analyse économique conventionnelle, sur les limites de laquelle en matière de pollutions classiques certains ont depuis longtemps insisté (Passet [1979]), semble extrêmement délicate à appliquer dans le cas des pollutions globales, notamment en ce qui concerne l'accroissement de l'effet de serre. On est alors amené à établir des objectifs de réduction des émissions de CO2 puis à choisir les instruments susceptibles de les faire atteindre au moindre coût. Une telle dissociation entre objectifs et moyens de les atteindre a été introduite par Baumol & Oates [1971]. Ils proposent de fixer de manière exogène un objectif de réduction de pollution, le calcul économique ne servant qu'à l'atteindre au moindre coût. On a affaire à une optimisation économique sous une contrainte définie par ailleurs. Telle était la démarche suivie par Nordhaus [1977], lorsqu'il proposait, face à l'incertitude scientifique, d'imposer une limite à la croissance des concentrations de CO2 (doublement de la concentration de CO2 atmosphérique) avant d'optimiser le fonctionnement du système énergétique en déterminant les «shadow-prices» des émissions de CO2, en l'occurrence le niveau d'une taxe (correspondant à l'atteinte au moindre coût d'une croissance de 100 % des émissions de CO2).
Cette approche qui mêle réglementation et incitation économique apparaît particulièrement adaptée aux pollutions globales pour lesquelles on ne connaît pas les courbes de coût. Elle a d'ailleurs été utilisée pour le règlement du problème de l'ozone stratosphérique dans le cadre du protocole de Montréal : celui-ci fixait les objectifs à atteindre en matière de réduction de consommation des CFC et chaque pays était libre d'adopter les mesures économiques les plus efficientes pour y parvenir (Faucheux & Noël [1988]). Contrairement à la méthode traditionnelle, qui repose sur une démarche implicite d'analyse coût- bénéfice, celle issue des travaux de Baumol et Oates ap-
Sylvie Faucheux /Jean-François Noël 43
paraît plutôt fondée sur une analyse coût-efficacité (Hour- cade & Baron [1991]).
Dans ce cas, le coût du dommage (le dommage évité représentant le bénéfice attendu de l'action) et les problèmes qui lui sont liés (dans le cas du CO2, échelonnement dans le temps des effets, équité intergénération- nelle) disparaissent complètement. En effet, le seul coût sur lequel elle repose est le coût de réduction des émissions qui doit être confronté à un signal de prix (Noël [1977]), donné soit par une taxe ou une redevance, soit par un marché de droits d'émission.
Une décision abandonnée au libre jeu des acteurs
Conformément à l'approche de Baumol & Oates [1971], l'objectif est donc fixé de façon extra-économique. Toutefois, il risque de l'être de façon subjective, en particulier dans le domaine du changement global, où trop d'incertitudes subsistent, sinon sur sa réalité du moins sur son ampleur, pour que les experts se prononcent objectivement8.
Ainsi des propositions ont été faites au niveau international, sans que leur fondement ait été véritablement assuré. Tels semblent être les niveaux fixés pour servir d'objectif par la Conférence de Toronto en 1989 ( — 20% en 2005) ou ceux qui pourraient l'être par la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (UNCED) de 1992 sur la base des recommandations faites par I.P.C.C. Q.T. Houghton et alii [1990]).
D'une part, les niveaux de réduction ou de stabilisation proposés par les différents pays divergent. Vis-à-vis des réductions d'émissions de CO2, les pays se répartissent en trois groupes. Un premier groupe est partisan de réductions relativement importantes (mais qui ne seront pas suffisantes à terme pour régler le problème) : il comprend l'Allemagne ( — 25% en 2005), le Danemark, l'Australie, la
44 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
Nouvelle-Zélande (-20% en 2005) et les Pays-Bas (-5% en 2000) . Le second a décidé de stabiliser les émissions en 2000 : Autriche, Belgique, Canada, Finlande, France, Japon, Norvège, Suisse, Grande-Bretagne. Le troisième groupe comprend les Etats-Unis, l'U.R.S.S. et les pays de l'Est, les pays en développement. Ces pays s'opposent pour le moment à toute régulation restrictive pour des raisons qui varient d'un pays à l'autre.
D'autre part, le caractère arbitraire de la fixation des objectifs est encore souligné par le fait qu'ont été avancées des propositions différentes au sein d'un même pays. Une commission du Bundestag et le gouvernement allemand ont proposé une réduction des émissions de CO2 de 25 % en 2005 par rapport à 1987, valable aussi pour l'ex- Allemagne de l'Est. Cet objectif, jugé trop ambitieux, est contesté par le Ministère Fédéral de l'économie et par les industries énergétiques. Aux Etats-Unis, la majorité démocrate du Sénat a demandé en août 1990 une diminution de 20% d'ici 2005, mais l'administration Bush et les Républicains font la sourde oreille.
Le type de réglementation adopté en matière de lutte contre l'accroissement de l'effet de serre risque alors d'être le résultat d'une négociation entre divers acteurs : organisations non gouvernementales (défenseurs de l'environnement et/ou des pays en voie de développement), scientifiques, Etats, firmes, etc., pouvant se regrouper en différentes coalitions, comme l'a montré une recherche récente en termes d'analyse de données (Benhaim et alii [1991b]). Ceci est d'autant plus vraisemblable que, pour ces formes de pollutions, il existe des éléments de controverse et d'incertitude scientifique, favorisant, de la part des différents acteurs impliqués, une tendance à l'instrumen- talisation du problème de l'effet de serre au service de leurs propres intérêts (Faucheux & Noël [1991]).
Afin d'éviter que l'issue de la négociation ne soit
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 45
dictée par la «loi du plus fort», qui signifie dans ce cas la loi du plus puissant économiquement, il faudrait probablement créer une nouvelle organisation au niveau mondial, indépendante des divers intérêts économiques nationaux et capable de représenter l'intérêt général présent et futur en matière d'environnement et de gérer, en fonction de cet intérêt général, les pollutions globales.
Bien qu'elles puissent présenter un risque de perte de souveraineté nationale pour les Etats, voire de «dictature» mondiale, la création de telles institutions semble être inéluctable, y compris dans le domaine économique. En effet, comme nous le remarquions en commençant, systèmes économiques et pollutions se sont mondialisés parallèlement alors que la crise du système monétaire international et celle du G.A.T.T. rendent nécessaire un renouvellement de leurs propres institutions. Une telle organisation mondiale de régulation aurait en toute hypothèse besoin d'établir la norme à respecter en matière de réduction des émissions de CO2.
Le problème de la détermination objective de cette norme reste alors entièrement posé. La norme économique se ramène à l'optimum économique. Extra-économique, elle manque de base objective, en étant déterminée par le rapport de forces au sein du jeu d'acteurs ou dictée a priori par une organisation mondiale.
Les économies d'énergie : une norme technique
Devant l'impossibilité de déterminer de façon satisfaisante l'objectif, aussi bien à l'aide de l'analyse économique qu'au moyen du jeu spontané des acteurs dans la société, nous proposons d'explorer la possibilité de fixer une telle norme en référence à des considérations techniques.
En fait, la justification d'un objectif défini en termes de diminution des émissions de CO2 est à chercher dans la volonté de faire baisser à terme plus ou moins
46 Sylvie Faucheux /Jean-François Noël
lointain la concentration du CO2 dans l'atmosphère. Il est plus facile en effet d'agir sur les flux que sur le stock, mais la contrepartie en est un délai plus long avant que cette action porte ses fruits. La liaison existant entre consommation d'énergies fossiles et émissions de CO2 amène alors à définir l'objectif en termes de baisse de cette consommation.
Dès lors le problème se ramène à trouver les moyens d'une telle baisse. Parmi ceux-ci, on peut penser a priori à des substitutions internes aux énergies fossiles, à la recherche de nouvelles filières énergétiques ne faisant pas appel aux combustibles fossiles, ou enfin aux économies d'énergie.
On passe ainsi de l'objectif primaire, faire baisser la concentration de CO2 directement à la source du renforcement attendu de l'effet de serre, difficile, comme nous l'avons vu, à déterminer, à des objectifs subrogés, plus aisés à établir.
L'absence de «backstop technology»
De nombreuses propositions sont faites en faveur du remplacement des énergies fossiles à fort contenu en carbone par des sources primaires, en l'occurrence le gaz, à plus faible teneur en carbone9.
Une telle substitution nous paraît être d'un avenir limité, même si elle permet des gains à court terme sur les taux d'émission de CO2. Contenant du CO2, certes en moindre proportion que les autres combustibles fossiles, le gaz naturel semble devoir représenter au mieux une solution transitoire et coûteuse, condamnée à terme10. De plus, son exploitation peut occasionner des pertes en méthane, autre substance incriminée dans l'accroissement de l'effet de serre (Skea [1991]).
D'autres pensent que la solution réside dans l'exploitation de nouvelles filières énergétiques ne faisant pas
Sylvie Faucheux /Jean-François Noël 47
appel aux combustibles fossiles. Dans ce domaine, plusieurs solutions ont été proposées : nucléaire, énergies renouvelables (incluant le solaire).
Le potentiel technique pour la génération d'électricité électronucléaire est large mais il y a des barrières institutionnelles et économiques à son développement, sans parler de la difficulté de son acceptabilité sociale après la catastrophe de Tchernobyl et de l'identification des moyens d'entreposer pour des périodes extrêmement longues les déchets radio-actifs.
Bien que l'énergie nucléaire soit un système énergétique pauvre en émissions de CO2, ce n'est pas l'outil universel pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions : le CO2 ne provient pas seulement du secteur électrique mais aussi de celui des transports, usager captif des hydrocarbures, en ce qui concerne les transports routiers et aériens qui connaissent la plus forte croissance. De plus, étant donnés les délais de planification et de construction des installations, le développement du nucléaire demande un temps relativement long et est très coûteux, notamment en endettement à long terme (Keepin & Kats [1988], Pasz- tor [1991]). Toutes ces raisons font que les scénarios de prospective n'accordent qu'une place modeste à l'énergie nucléaire dans le bilan énergétique mondial11.
Par ailleurs, un recours accru aux énergies renouvelables est difficile à mettre en place dans le court et moyen terme, car elles ont pour le moment une contribution modeste aux bilans énergétiques et reçoivent un faible budget de recherche-développement. Mais indépendamment de cet aspect, il existe des problèmes environnementaux liés à la mise en place de ces formes énergétiques. Elles ont souvent besoin d'espace (énergie solaire, énergie éolienne ou hydroélectricité). Dans les pays en voie de développement, la mise en place d'installations hydroélectriques a parfois entraîné le déplacement de centaines de
48 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
milliers de personnes. Ce besoin d'espace est de plus localement en conflit avec celui de l'agriculture.
Le recours au photovoltaïque entraîne pour la fabrication des équipements l'utilisation de produits chimiques nécessitant des traitements. La géothermie et la biomasse augmentent la production de résidus. L'utilisation du bois entraîne la deforestation, lourde de conséquences environnementales (International Energy Agency [1990]).
C'est pourquoi, il ne semble pas exister actuellement, du moins sur le court et moyen terme, une technologie susceptible de se substituer aux énergies fossiles et de produire de l'énergie renouvelable et non émettrice de CO2, à coûts certes élevés mais sur une base inépuisable, c'est-à- dire ce que l'on appelle, depuis Nordhaus [1973], [1989], une «backstop technology».
D'ailleurs, une innovation technologique n'a jamais un caractère de nécessité : elle n'est jamais prédictible dans sa contingence et son contenu à l'instar du progrès scientifique selon K. Popper [ 1957] . A supposer qu'une telle « backstop technology» survienne dans l'avenir, ceci ne constitue pas un argument en faveur de la passivité, contrairement à ce qu'affirme Nordhaus [1991]. Il resterait à aménager la phase de transition qui, du point de vue économique, relève du long terme. Inversement, il serait nécessaire de ne pas se précipiter sur la première technologie candidate pour éviter de s'enfermer dans une impasse technologique verrouillant la possibilité de développement d'une autre technologie éventuellement plus performante12. Disposer d'un «temps d'apprentissage» suffisant serait alors indispensable, (Hour- cadeetalii [1989a], [1989b]).
Les économies d'énergie: l'objectif subrogé
A cet égard, l'amélioration de l'efficience énergétique apparaît un choix adéquat. D'une part, elle évite les irréversibilités contraignant les choix technologiques, d'autre
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 49
part, elle présente l'avantage supplémentaire d'être justifiée par d'autres considérations que celle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre: par exemple, la réduction de la pollution par d'autres substances que le CO2 associées à l'utilisation de combustibles fossiles (SO2, NOX, poussières, etc.), l'allongement de la durée d'exploitation des ressources énergétiques épuisables, le gain monétaire résultant pour les consommateurs d'une moindre dépense énergétique. Il s'agit par excellence d'une «no regret policy», c'est-à-dire d'un ensemble de mesures «qui s'avéreraient économiquement, politiquement, socialement et environnementalement bénéfiques même dans le cas improbable où l'effet de serre se révélerait bénin dans le futur» (Daily et alii [1991]).
L'importance de ces économies d'énergie est d'ailleurs attestée par la déconnexion de la demande énergétique vis-à-vis de la croissance économique de 1973 à 1985. Cette baisse de l'intensité énergétique est manifeste pour l'ensemble des pays de l'O.C.D.E. (Baron [1990]). Ces derniers, en effet, ont réduit leur consommation énergétique grâce à une plus grande efficience énergétique d'environ 32 EJ (soit 16 millions barils/jour d'équivalent pétrole) de 1972 à 1985 (Schipper [1987]).
On doit souligner que si les pays riches peuvent économiser beaucoup plus d'énergie que les pays pauvres en adoptant des techniques plus performantes, des potentialités importantes existent néanmoins pour les pays en voie de développement (J. Goldemberg et alii, [1987]). Des transferts de technologie, dont les modalités sont actuellement sujettes à discussion, permettraient d'accroître ce potentiel sans poser de problème d'équité.
Par ailleurs, dans la mesure où la part des énergies fossiles dans l'offre énergétique commerciale globale est de l'ordre de 90% (et les 10% restants se partageant de façon égale entre le nucléaire et l'hydraulique), il semble
50 Sylvie Faucheux /Jean-François Noël
beaucoup plus facile d'obtenir rapidement des résultats par le biais d'économie d'énergie que par celui des autres solutions présentées ci-dessus. Cela permet en plus de gagner du «temps d'apprentissage» et de reculer par la même occasion l'échéance de l'épuisement des ressources fossiles.
Il se dégage d'ailleurs aujourd'hui très nettement un consensus sur la priorité à accorder à cette stratégie préventive d'économies d'énergie face au problème de l'accroissement de l'effet de serre (Skea [1991]).
Ajoutons que plusieurs études ont mis en évidence la rentabilité économique des investissements anti-énergétiques (c'est-à-dire des investissements économiseurs d'énergie) : une dépense d'investissement initial permet de diminuer la consommation énergétique des années suivantes. On peut donc calculer un taux de rendement d'un tel investissement et/ou sa période de récupération (temps qu'il faut pour que les gains en consommation énergétique remboursent la dépense initiale). A cet égard, on peut noter avec Ayres & Walter [1991] que la période de récupération en matière d'investissement en économies d'énergie est comprise en général entre 6 mois et 2 ans, soit un taux de rendement annuel situé entre 200 % et 50 %. Le rendement de tels investissements, notablement supérieur à celui existant dans l'industrie, et en particulier à celui des centrales électriques, qu'elles soient hydroélectriques, thermiques ou nucléaires, susceptibles d'augmenter l'offre, oblige à se demander pourquoi ils ne sont pas plus répandus. F. Sios- hansi [1991] comme Ayres & Walter [1991] relèvent plusieurs causes à cette situation.
— Le haut niveau des coûts de transaction concernant les économies d'énergie atteignables : les agents ont du mal à obtenir une information adéquate et fiable pour opérer leurs choix.
— L'influence des taux d'actualisation implicites
Sylvie Faucheux /Jean-François Noël 51
des agents : les investissements en économie d'énergie sont le fait en partie de consommateurs finals d'énergie, dont le taux d'actualisation implicite est notablement plus élevé (jusqu'à 90 % pour les catégories de revenu les plus basses aux Etats-Unis) que celui des plus grandes firmes (8%, voire 5 %)• Le peu d'attention porté au futur par les consommateurs les plus pauvres peut représenter un facteur limitant de l'investissement en économie d'énergie.
— L'existence de prix faux : les prix de l'énergie s'apparentent toujours plus ou moins pour le consommateur final à des tarifs émanant d'une autorité réglementaire. Ces tarifs n'internalisent pas la totalité des effets externes créés par la production et la distribution de l'énergie (coûts environnementaux, coûts de transports, etc.). La tarification, de plus, ne suit généralement pas le coût marginal. La rentabilité économique des investissements en économie d'énergie est obérée par des prix de l'énergie insuffisamment élevés. Sur un plan plus généralj. Burgess [1990] a insisté sur la nécessité d'une tarification efficiente de l'énergie — notamment parla suppression des subventions — pour la réduction des émissions de CO2.
— Le manque d'incitation financière pour les compagnies productrices et distributrices d'énergie à promouvoir les économies d'énergie : la réduction de consommation consécutive aux économies d'énergie réduit en général davantage leurs profits que ne les augmente la baisse des coûts de production qui en découle. De plus ces firmes peuvent plus aisément augmenter l'offre d'énergie par une politique massive d'investissements dans la production financée par l'endettement auquel elles ont souvent accès à des conditions plus avantageuses que les autres agents. C'est par exemple le cas d'EDF en France.
— Toute une série d'arguments relevant du marketing: zèle des vendeurs d'appareils électro-ménagers pour lesquels la consommation énergétique n'est pas pré-
52 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
cisément le souci essentiel, consommateurs prisonniers des caractéristiques de leur logement choisies par le promoteur immobilier ou le propriétaire ou de celles des véhicules choisies par le constructeur d'automobiles, etc.
Si l'objectif subrogé, dont on parlait précédemment, est bien lié à la recherche d'économies d'énergie, il paraît indispensable d'une part de mesurer les potentialités de ces dernières, d'autre part de contrecarrer les blocages qui vont à rencontre des investissements économiseurs d'énergie. Or, le calcul énergétique semble en mesure d'apporter des réponses satisfaisantes dans ces deux domaines.
La fixation de l'objectif subrogé par le calcul énergétique
La comptabilité énergétique s'est développée tant à l'échelle micro-économique que macro-économique dans les années soixante-dix. Elle décrit la totalité des flux énergétiques entrant et sortant d'un processus de production. Sa méthodologie est proche de celle des bilans matières (Ayres, Kneese, d'Arge [1970]) et de celle des écobilans qui se développent actuellement dans l'industrie. Elle utilise une évaluation énergétique purement quantitative qui se réfère au premier principe de la thermodynamique, celui de la conservation de l'énergie. Les différentes formes d'énergie sont agrégées en fonction de leur seul contenu en chaleur, sans tenir compte de leur qualité (barème enthalpique) . C'est le cas des bilans énergétiques traditionnellement établis en termes de Т.Е. P. (tonne d'équivalent pétrole), c'est-à-dire en termes d'un étalon au pouvoir calorifique donné.
Le calcul énergétique, quant à lui, issu de la tradition des «ingénieurs thermodynamiciens » (Vivien [1991]) a l'ambition de dépasser la simple description des flux énergétiques pour devenir un outil d'aide à la décision. Il a recours à des évaluations reposant à la fois sur le
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 53
premier et le deuxième principe de la thermodynamique. La prise en compte des aspects qualitatifs, et non plus seulement quantitatifs, de l'énergie nécessite en effet l'utilisation d'un barème exergétique, c'est-à-dire conforme au deuxième principe de la thermodynamique, la loi d'entropie. Toutes les énergies, du point de vue de leur utilité, ne sont pas substituables les unes aux autres, à cause de l'irréversibilité due à l'entropie. On peut donc classer toutes les énergies depuis l'énergie mécanique, transformable en toutes les autres formes d'énergie utile, jusqu'aux formes les plus dégradées, et partant inutilisables, tel le rayonnement de la terre dans l'espace'. Toutes les énergies utiles vont donc se trouver normées en termes d'énergie mécanique, à laquelle est affectée conventionnellement la valeur 1, l'énergie dissipée dans l'espace ayant la valeur 0. Ceci revient à exprimer toutes les énergies selon leur contenu potentiel en travail mécanique appelé exergie (Faucheux [1990])13.
Le calcul énergétique peut, selon nous, aider à remédier aux imprécisions des définitions concernant le potentiel d'économies d'énergie, en fournissant des indicateurs permettant de déterminer les objectifs à atteindre pour une politique de lutte contre l'accroissement de l'effet de serre.
La potentialité d'économie d'énergie: une notion imprécise
Lorsque l'on parle de potentialité d'économie d'énergie ou de réserve d'économie d'énergie, on ne sait pas très bien de quoi il est question. Aucune définition précise n'est assignée à ce terme. Une homogénéisation, notamment au niveau international, semble indispensable afin d'utiliser ce concept en tant qu'aide à la décision.
Ainsi, dans le cas de la France, l'A.F.M.E. a calculé les gisements d'économie d'énergie tant statiques que dynamiques14 à l'horizon 2000 selon deux scénarios (M :
Illustration non autorisée à la diffusion
54 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
croissance faible des prix de l'énergie et politique modérée de maîtrise de l'énergie et A croissance forte des prix de l'énergie et politique vigoureuse de maîtrise de l'énergie).
Tableau n°l
Gisements d'économies d'énergie à l'horizon 2005 en France en M tep
Industrie Habitat & Tertiaire Transport Ensemble
Gisement statique M 4 6,5 4
14,5
A 5 9 5
19
Gisement dynamique M 2,5 7 2,5
11
A 3 9 3
15
TOTAL M 6,5
13,5 6,5
26,5
A 8
18 8
34 Source: k$ ME.
Toutefois, les définitions comme les critères de référence restent pour le moins obscurs : on sait rarement, par exemple, si un potentiel d'économies d'énergie donné est accessible théoriquement, techniquement, économiquement ou socialement.
Par ailleurs, c'est par un abus de langage que l'on désigne souvent par le terme de gisement d'économies d'énergie ce qui est en fait un flux annuel potentiel d'économies d'énergie attaché à une mesure technique et à un parc de matériel donné. Le concept de gisement s'applique à un stock et non pas à un flux. Si l'on veut approcher la notion de réserve d'économie d'énergie d'une branche donnée, puisque les objectifs de réduction à atteindre doivent être fixés en termes de stock, il devient indispensable d'intégrer les flux d'économie d'énergie considérés sur la durée de vie des parcs de matériels. C'est pourquoi on peut reprendre la définition suivante : « La réserve d'économie d'énergie associée à une mesure d'amélioration de
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 55
l'efficacité énergétique d'un parc de matériel est égale au produit du flux annuel d'économies d'énergie observé ou attendu par la durée de vie de cette mesure. » (B. Dessus [1991]) Cette réserve varie donc au fur et à mesure du renouvellement du matériel et doit être appréhendée dans une vision dynamique.
Il nous semble indispensable à ce stade de recourir au calcul énergétique afin de déterminer et d'affiner cette notion.
Le potentiel optimal d'économies d'énergie: un indicateur énergétique d'aide à la décision
Pour toute forme de convertisseur énergétique il est possible de calculer des rendements du type input énergétique / output énergétique, dans la mesure où le numérateur et le dénominateur peuvent être exprimés de façon homogène. Il s'agit d'une mesure de l'efficacité réelle de cette conversion. A cet égard le rendement de Carnot15 sert de limite supérieure aux rendements atteignables en très longue période, donc en tenant compte des changements technologiques futurs (non encore connus). On peut, en rapprochant le rendement de Carnot des rendements effectifs, déterminer pour les transformations énergétiques un potentiel théorique maximal d'économies d'énergie, simple potentialité qui dépend du progrès technique pour devenir effective.
Les rendements obtenus dans les conversions énergétiques à l'aide de la meilleure technologie existante définissent quant à eux la limite supérieure atteignable dans les conversions énergétiques sans changement technologique, par simple généralisation de la meilleure technologie connue. La différence entre les deux définit ce que l'on peut appeler le potentiel optimal d'économie d'énergie.
L'étude des rendements différentiels dans les
56 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
conversions énergétiques constitue l'objet de la «Net Energy Analysis» (Spreng [1988]). Une telle analyse est obligatoire aux Etats-Unis depuis 197416 en matière de décision portant sur les investissements dans la « production d'énergie» (par exemple le choix entre énergies alternatives et énergies conventionnelles). L'élaboration de tels ratios s'avère difficile pour les secteurs industriels dont l'output n'apparaît pas comme directement exprimable énergétiquement : un tel output possède seulement un contenu énergétique, résultat de la dépense énergétique totale effectuée pour le produire.
Dans ce cas on peut calculer la quantité d'énergie minimale théoriquement nécessaire à la production en question, en raisonnant sur des équipements productifs convertisseurs d'énergie fonctionnant tout au long de la chaîne énergétique à leur rendement maximal de Carnot. Là encore, le calcul de la quantité d'énergie minimale nécessaire à la production atteinte à l'aide des meilleures technologies existantes et sa comparaison à la quantité d'énergie effectivement nécessaire à la production permet de déterminer une valeur du potentiel optimal d'économie d'énergie. Un tel travail sur les contenus énergétiques des biens repose sur les définitions et les concepts adoptés par l'International Federation of Institutes of Advanced Studies [1974], [1975], et recourt, pour sa généralisation à l'ensemble des biens, aux techniques input-output développées dans ce domaine par Herendeen & Bullard [1974].
Au niveau global, le résultat en termes de potentiel optimal d'économie d'énergie issu de l'étude des conversions énergétiques et celui obtenu à partir du contenu énergétique des biens et des services devraient coïncider. En réalité, les lacunes de la comptabilisation en matière énergétique, l'existence de doubles emplois, l'utilisation de tableaux input-output «énergétiques» provenant de la transformation de tableaux input-output établis initiale-
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 57
ment en valeurs monétaires (Pillet et alii [1991]), font que les deux évaluations ne concordent pas. Il apparaît cependant plus commode d'utiliser la méthode s'appliquant aux conversions énergétiques, qu'il s'agisse du secteur «producteur d'énergie» (centrales thermiques, par exemple) ou du secteur des biens «consommant» de l'énergie (appareils ménagers, automobiles, etc.).
Plusieurs auteurs ont utilisé cet indicateur afin de mettre en évidence les potentialités d'économies d'énergies d'une filière à l'intérieur d'un même pays ou au travers d'une comparaison internationale.
Ainsi Berry & Fels [1972] , dans leurs travaux pionniers en cette matière, avaient calculé le minimum d'énergie nécessaire à chaque étape de la production d'une automobile, depuis l'extraction du minerai de fer et de bauxite jusqu'à l'assemblage, en tenant compte de la meilleure technologie disponible. Ils avaient alors constaté que l'industrie américaine de l'automobile consacrait au moins cinq fois plus d'énergie que cela n'était technologiquement nécessaire, soit 32 millions de KCal au lieu de 6 millions de KCal.
Plus récemment, Jochem [1991] a pu montrer dans le cas de l'Allemagne, qu'en 1989 la relation entre énergie primaire, énergie finale et énergie utile était évaluée à 3:2:1 c'est-à-dire que seulement un tiers de la consommation énergétique primaire ou environ la moitié de la consommation d'énergie finale était convertie en énergie utile17.
Cette même étude allemande souligne que dans la mesure où l'on doit s'attendre à des pertes dans n'importe quel processus de conversion énergétique, l'analyse, basée sur l'état actuel de la meilleure technologie, du potentiel technique conduit à la conclusion que l'usage rationnel de l'énergie doit permettre en Allemagne une amélioration de 35 à 45 % de l'efficience énergétique. L'auteur
58 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
ajoute que, suivant les secteurs, le potentiel d'économies disponible varie entre 70 et 90 % pour les économies dans les bâtiments et 10 à 20 % pour les centrales thermiques, les raffineries et les usages industriels de l'énergie.
La somme de tous les potentiels optimaux d'économie d'énergie à un instant t d'une filière ou d'une économie représente donc le potentiel d'économies d'énergies techniquement accessible dans la filière ou dans l'économie à l'instant t. Le potentiel optimal d'économie d'énergie doit évidemment être envisagé en dynamique. Il évolue dans le temps, en fonction du renouvellement de l'équipement productif et de l'innovation technologique améliorant l'efficience énergétique. Il est donc nécessaire de le réestimer tous les 10 ou 12 ans, ce qui correspond à la durée de vie moyenne des équipements. Les rendements énergétiques obtenus à l'aide des technologies les plus performantes apparaissent quant à eux comme les objectifs subrogés à atteindre en matière de développement d'économies d'énergie dans le cadre d'une politique active de lutte contre l'accroissement de l'effet de serre, objectifs techniques qui eux aussi font l'objet d'une réévaluation au cours du temps. Le calcul énergétique permet ainsi de déterminer à la fois les potentialités d'économies d'énergie et l'objectif subrogé à respecter.
Une atteinte efficiente de la norme
environnementale par les
instruments économiques
Conformément à l'approche de Baumol & Oates [1971], combinant édiction de normes et utilisation d'instruments
économiques, la deuxième étape dans l'élaboration d'une
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 59
politique, une fois l'objectif fixé, consiste dans le choix d'un instrument.
Dans la littérature économique taxe et permis négociables sont souvent opposés quant à leur adéquation à la gestion de ces problèmes globaux d'environnement18. Ainsi Nordhaus [1977] adhérait au système de taxes, celui- ci permettant, selon lui, une application plus décentralisée que la création d'un marché de droits à polluer qui doit, dans ce cas, être planétaire, puisque les effets que l'on veut éviter par l'atteinte d'un objectif de réduction des émissions de CO2 le sont. Il faut noter qu'actuellement le même auteur (Nordhaus [1991]) tend à justifier la position atten- tiste du gouvernement américain en matière de lutte contre l'effet de serre en refusant toute utilisation d'instruments économiques, tels que taxes ou permis, dans la mesure où une analyse coût-avantage du problème montre à l'évidence, selon lui, que les effets négatifs d'une politique de réduction du CO2 l'emporteraient largement sur les bénéfices attendus, en particulier en raison du caractère incertain et futur des impacts. La taxe sur le carbone ne lui apparaît pas comme une option de politique efficace, sauf pour de faibles niveaux de réduction de CO2, son coût excédant ses bénéfices.
Pour notre part, nous pensons que les justifications du choix de la taxation face aux permis peuvent être brièvement résumées de la façon suivante.
Tout d'abord, les coûts administratifs des systèmes d'échanges de permis sont élevés. Aux Etats-Unis en particulier, où de tels systèmes ont été mis en place dans le cadre du Clean Air Act, ces coûts de gestion du système ont parfois dépassé le prix des permis eux-mêmes. L'apparition de courtiers indépendants montre également que le système d'échange des permis d'émissions représente une lourde charge tant pour l'administration que pour les firmes (Ops- choor & Vos [1989]). Ces coûts sont en toute hypothèse
60 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
plus élevés que ceux de la perception d'une taxe nouvelle qui peut se faire par le canal des administrations fiscales existantes et n'entraîne par conséquent que des coûts d'administration réduits.
Ensuite la différence essentielle dans le fonctionnement des deux systèmes est que, dans le système de la taxe, le taux de celle-ci est fixé a priori par l'autorité de tutelle, tandis que dans le cas des permis négociables, c'est le jeu du marché qui va déterminer le prix d'équilibre du marché. De ce fait, ce dernier permet un plus grand automatisme dans l'atteinte d'un certain niveau de réduction d'émissions, puisque ce sont alors les quantités à émettre qui sont directement fixées par l'autorité lors de l'allocation initiale des permis. Cependant, la portée de cet argument souvent cité en faveur des marchés de droits d'émissions est réduite s'il ne s'agit pas, dans un cas comme dans l'autre, d'atteindre un optimum mais seulement d'atteindre une norme à un coût minimum. Dès lors, le fait qu'une taxe, fixée a priori à un taux inadéquat à l'objectif poursuivi, puisse être révisée dans le sens nécessaire, suffit. Il faut rappeler en effet, que les émissions de CO2 agissent par l'intermédiaire du stock de CO2 accumulé et non pas par le flux annuel d'émissions. On dispose donc de temps pour adapter le niveau d'une taxe sans perdre en efficacité.
Ce qui retiendra par conséquent notre attention ici est la recherche du système de taxe le plus adéquat pour lutter contre l'effet de serre. Pour cela, il faut d'abord nous interroger sur l'objectif que vise cette taxe. Il s'agit ensuite de choisir l'assiette satisfaisant à la condition de l'atteinte de l'objectif au moindre coût. Nous montrerons en quoi le système de taxe que nous proposons articule calcul économique et calcul énergétique.
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 61
Le problème du choix de l'assiette de la taxe
Plusieurs modalités d'assiette ont été proposées qui peuvent se ramener aux grandes catégories suivantes.
Taxe assise sur le contenu en carbone des énergies fossiles
Le fait que les émissions de CO2 soient clairement reliées à la consommation de combustibles fossiles, puisqu'on ne peut en l'état actuel de la technologie «dépolluer» en termes de CO2 les rejets des combustions, permet de faire porter une taxe sur les combustibles fossiles eux-mêmes au prorata du contenu de ceux-ci en carbone, ce qui fournit une assiette plus accessible et plus fiable que les émissions de CO2 elles-mêmes.
Il s'agit donc d'une taxe sur les diverses consommations d'énergies primaires effectuées à titre de consommation finale ou intermédiaire, dont le montant est modulé en fonction du contenu en carbone de l'énergie primaire utilisée. Le plus souvent l'assiette et le taux sont donnés conjointement sous la forme d'un montant monétaire par tonne de carbone émise. Telle est par exemple la position française du groupe interministériel sur l'effet de serre qui propose une taxe de 1 000 F par tonne de carbone (groupe interministériel sur l'effet de serre [1990]). La Suède a déjà adopté une taxe de 0,5 SKr par kilogramme de CO2 émis pour toute énergie fossile. En Norvège et aux Pays-Bas une telle taxe modulée s'applique essentiellement aux carburants. Dans ce type de taxe, les consommations d'énergie sans contenu en carbone, telle l'énergie nucléaire, ne sont pas soumises à la taxe. Notons qu'une taxe «à la tonne de carbone» aboutit seulement à différencier les taux qui s'appliquent aux différentes énergies primaires et reste en moyenne équivalente à une taxe proportionnelle à la consommation énergétique.
L'effet d'une telle taxe doit être de substituer des
62 Sylvie Faucheux /Jean-François Noël
énergies à moindre contenu en carbone aux énergies primaires à fort contenu en carbone, plutôt que de conduire à des économies d'énergie en tant que telles19.
Par ailleurs, si l'énergie nucléaire n'est pas également taxée, le risque existe dans certains pays d'entraîner une substitution énergétique au bénéfice de cette seule source énergétique.
Dans le cas français, on peut considérer (B. Dessus [1991]), qu'une taxe sur les énergies fossiles, dans la mesure où elle aboutit par la hausse de prix qu'elle entraîne à augmenter la valeur future de l'énergie, équivaut à une baisse du taux d'actualisation implicite s 'appliquant à ces secteurs, les investissements dans le nucléaire, pour leur part, continuant d'être opérés sur la base d'un taux d'actualisation de 8%. Les coûts environnementaux respectifs des deux filières énergétiques (coût en émissions de CO2 pour les combustibles fossiles, coûts de retraitement et stockage des déchets et coûts de démantèlement de la filière nucléaire) sont évalués de manière dissymétrique : les coûts futurs du CO2 sont surévalués relativement à ceux du nucléaire. Cela risque de favoriser l'investissement présent dans le nucléaire, ce qui n'est pas l'objectif recherché. Un traitement égal des deux filières nécessiterait un mode de gestion unique: soit une internalisation20 des coûts externes, soit une taxe, mais portant alors également sur toutes les filières.
Des taxes dites «mixtes» c'est-à-dire comportant une partie proportionnelle au contenu en carbone et une partie frappant indistinctement toutes les formes d'énergie sont un moyen de se rapprocher d'un tel objectif. Telle est la taxe additionnelle européenne proposée par la Commission de la C.E.E. le 25 septembre 1991. Cette taxe progressivement croissante, établie au niveau de 9 ECU par tonne de pétrole et 9 ECU pour le contenu en carbone du pétrole au 1er janvier 1993, atteindrait (en croissant de 3ECU par
Sylvie Faucheux /Jean-François Noël 63
an par tonne de pétrole et de 3 ECU par an pour le contenu en carbone) pour le pétrole 60 ECU en 2000. A cette même date, elle serait de 70 ECU par t.e.p. de charbon, 53 ECU par t.e.p. de gaz et 30 ECU (soit la moitié du taux portant sur le pétrole) pour la t.e.p. produite dans l'électronu- cléaire et l'hydroélectricité.
Taxe assise sur la consommation énergétique
Une autre catégorie de taxe regroupe toutes les propositions de taxe sur la consommation d'énergie. Le principe de ces taxes consiste à renchérir l'énergie par le biais de l'impôt, ce qui, étant données les caractéristiques de la demande énergétique, est censé amener une diminution de la consommation énergétique. L'objectif d'économies d'énergie serait donc atteint.
Il faut distinguer parmi ces propositions deux modalités.
L'une vise à établir une taxe unique sur l'énergie primaire, ayant vocation à se substituer à l'ensemble de la fiscalité existante — à l'instar du célèbre impôt unique sur le produit net agricole prôné par les Physiocrates. De tels projets ne sont pas nouveaux (Schueller [1956]) mais ont connu récemment un regain de vigueur (Slesser [1989]). Outre la critique inhérente à tous les impôts uniques, il peut sembler dangereux d'accorder à l'énergie un rôle exclusif dans la perception des recettes de l'Etat, même si l'énergie constitue à l'évidence une base d'imposition adéquate, puisqu'il s'agit d'un bien pour lequel n'existent que peu de substituts et dont la consommation est générale.
L'autre ne pourrait être qu'un simple prélèvement sur la consommation énergétique destiné à orienter les choix et les décisions intertemporels en forçant les prix de marché à refléter la vraie valeur des «shadow prices», comme le préconisaient Webb et Pearce [1977] .
Une taxation proportionnelle à la consommation
64 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
énergétique, si elle favorise les économies d'énergie, peut entraîner des résultats contraires à l'équité. Des entreprises appartenant à une branche fortement consommatrice d'énergie, telle que la sidérurgie ou la chimie, seraient fortement taxées, même si elles réalisent des économies d'énergie21. D'autres, en revanche, faibles consommatrices d'énergie, telles l'électronique ou l'informatique, seraient avantagées même si elles génèrent des gaspillages.
Taxe assise sur le potentiel optimal d'économies d'énergie
Une taxe efficace en ce qui concerne les économies d'énergie est, selon nous, une taxe conduisant à une réduction des consommations énergétiques là où existent des gaspillages et non pas à une diminution uniforme de la consommation énergétique.
L'assiette de la taxe pourrait être fournie en termes physiques par la différence à l'instant t entre le rendement énergétique effectif et le rendement optimal représenté par le rendement énergétique de la meilleure technologie disponible, ou, ce qui revient au même, par la différence à l'instant t entre la consommation énergétique effective et la consommation optimale obtenue en utilisant les meilleurs rendements énergétiques tout au long de la filière considérée, c'est-à-dire par ce que nous avons défini comme le potentiel optimal d'économie d'énergie. Ainsi une entreprise qui gaspillerait de l'énergie verrait s'ajouter au surcoût représenté par ce gaspillage celui correspondant à cette taxe. Contrairement aux taxes assises sur les consommations énergétiques, une telle taxe tient compte des besoins énergétiques différenciés des branches.
La détermination de l'assiette doit bien entendu tenir compte du progrès technique dont le rôle est fondamental, comme nous l'avons vu, dans l'évolution temporelle du potentiel optimal d'économie d'énergie. L'assiette
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 65
suivra donc la dynamique de cette grandeur, assurant ainsi au système le maintien de son caractère incitatif.
L'atteinte efficace de l'objectif par la taxe assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie
On peut montrer qu'une taxe assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie présente des caractéristiques proches de celles de la taxe assise sur la consommation énergétique. Toutefois, elle offre, d'un point de vue économique, un certain nombre d'avantages par rapport à cette dernière dans la mise en œuvre d'une politique de lutte contre l'accroissement de l'effet de serre.
Un coût de réduction minimum dans les deux cas
On peut montrer (Figure n°l) que, quelle qu'en soit l'assiette (consommation énergétique ou potentiel optimal d'économie d'énergie), une taxe assure toujours la réduction des consommations énergétiques au moindre coût.
Supposons 3 firmes ayant chacune des coûts marginaux propres de réduction de leur consommation d'énergie à partir de leur niveau initial de Qo de consommation. Face à un niveau unique de la taxe (le taux unitaire est par définition le même pour toutes les firmes), chaque firme va opérer la réduction de consommation énergétique dont le coût marginal est égal au montant unitaire de la taxe. La firme A aux coûts marginaux de réduction les plus bas réduira davantage sa consommation énergétique que la firme С aux coûts marginaux de réduction élevés.
L'assiette de la taxe n'intervient pas ici22, puisque c'est le taux unitaire de la taxe et non le montant global qu'elle rapporte qui s'égalise au coût marginal de réduction. La réduction de consommation énergétique se répartit donc entre les firmes en fonction du niveau de leurs coûts de réduction. A cet égard, les deux types de taxes
66 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
Figure n°l
Réduction de consommation énergétique en fonction des coûts de cette réduction
coût marginal de réduction
coût + marginal
de réduction
coût ^ marginal
de réduction
Taxe
Ql
Consommation énergétique
Firme A Firme В Firme С
aboutissent l'un comme l'autre à une réduction de la consommation énergétique de chaque firme au coût minimum pour chaque firme, et donc au coût minimum pour l'ensemble des firmes.
Un gain net identique en termes d'économies d'énergie avec un montant de taxe inférieur
Le gain net en termes d'économies d'énergies réalisées est le même avec une taxe assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie qu'avec une taxe de même taux unitaire assise sur la consommation énergétique, qu'il s'agisse de
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 67
la forme la plus simple de cette dernière ou d'une taxe différenciée en fonction du contenu en carbone, puisque, comme nous l'avons vu, cette dernière peut se ramener à la précédente.
Soit le cas d'une taxe à taux uniforme assise sur la totalité de la consommation énergétique23. On suppose la demande énergétique inchangée. L'élasticité de la courbe de demande énergétique étant comprise entre 0 et — 1 va d'une part élever le prix de l'énergie et d'autre part réduire les quantités d'énergie consommées. On peut certes raisonner sur la seule courbe de demande pour arriver à ce résultat, mais si le couple prix-quantités initial PoQo est un équilibre de marché résultant par conséquent de l'intersection des courbes d'offre S et de demande Dn, l'existence de cette offre d'énergie supposée inchangée2 (la taxe est une taxe à la consommation et non à la production) nécessite que l'on raisonne en tenant compte des deux courbes. Si l'on suppose, pour simplifier, qu'offre et demande sont des droites, l'intervention d'une taxe d'un taux t va entraîner une translation vers le bas, parallèlement à elle-même, de la courbe de demande, d'une distance t (mesurée verticalement), soit le passage de Do à Dj25. Le nouveau couple prix-quantités d'équilibre PiQi est déterminé par l'intersection de la courbe de demande D1 et de la courbe d'offre S. Le prix taxe comprise Pt correspondant s'établit alors à P: + t.
Il en est exactement de même pour la taxe de même taux unitaire t assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie, dans la mesure où c'est le montant marginal de la taxe (qui n'est autre que son taux unitaire) qui opère la réduction de consommation énergétique.
Dans les deux cas on est amené à établir la valeur de l'énergie consommée hors taxe et taxe comprise. •Taxe sur la consommation énergétique : Valeur de l'énergie consommée avant impôt = OP0M0Q0
68 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
Figure n°2
Taxe sur la consommation énergétique
Valeur de l'énergie consommée après impôt hors taxe = OPiMjQj < OP0M0Q0 Valeur de l'énergie consommée après impôt taxe comprise = OPtMtQt > OPjMiQj > OPqMoQo en raison de la valeur de l'élasticité-prix de la demande d'énergie comprise entre 0 et — 1, qui fait que t < DQ • Taxe sur le potentiel optimal d'économie d'énergie : Valeur de l'énergie consommée avant impôt = OP0M0Q0 (identique au cas précédent) Valeur de l'énergie consommée après impôt hors taxe = OPjMjQ! < OP0M0Q0 (identique au cas précédent, puisque la réduction de prix et de quantités est la même hors taxe) Valeur de l'énergie consommée après impôt taxe comprise = OPiMjQj + NjNtMtMj.
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 69
Figure n°3
Taxe sur le potentiel optimal d'économie d'énergie
Qmin Qo
Comme OPtMtQ! = OPjMjQi + Р^ДМ^ et que P^M^v^ > NjNjMjMj, on en conclut que la valeur de l'énergie consommée taxe comprise après impôt est inférieure dans ce cas.
Le montant global de la taxe payée est donc bien inférieur dans le cas du potentiel optimal d'économie d'énergie à ce qu'il est dans le cas de l'assiette sur la consommation énergétique pour une réduction de consommation énergétique identique dans les deux cas.
Il est clair qu'existe une valeur tmax du taux unitaire de la taxe susceptible de faire atteindre directement la Qmjn aux prix Pmin hors taxe et Ptmax taxe comprise26. Ceci amène à poser une distinction concernant le caractère incitatif des deux types d'assiette. La taxe assise sur la totalité de la consommation énergétique doit nécessairement être éta-
70 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
blie à un niveau de taux unitaire relativement modique et est donc moins incitative que la taxe assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie, qui, ne portant que sur une partie de la consommation énergétique, peut être fixée sans inconvénient à un taux unitaire plus élevé.
Une différence dans l'équité
La grande différence entre les deux modes de fixation de la taxe est que le montant global de taxe payé par les agents est inférieur dans le cas de la taxe assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie. Le montant de la taxe payée est en grisé sur les deux schémas précédents (Figure n°2 etn°3).
Dans la situation de taxe sur la consommation énergétique, la taxe payée est due pour l'intégralité de la consommation énergétique subsistant après adaptation à la taxe. Cependant la consommation énergétique de la meilleure technologie disponible, bien qu'elle ne serve pas ici de référence, représente une limite en dessous de laquelle la consommation ne peut être réduite. Le choix de la firme est alors : diminuer sa consommation énergétique et payer moins de taxe ou ne pas la réduire (ou la réduire moins) et payer plus de taxe.
Dans le cas de la taxe sur le potentiel optimal d'économie d'énergie, l'atteinte de la norme que représente le niveau de consommation correspondant à la meilleure technologie disponible dispense la firme de toute taxe, contrairement à la situation précédente. La firme est donc placée devant un choix : adopter la meilleure technologie disponible ou payer une taxe.
On peut donc considérer que, puisque le gain net en économie d'énergie est le même dans les deux cas et que la taxe prélevée est moindre dans le deuxième cas, c'est ce dernier qui apparaît préférable en termes de bien- être social.
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 71
II faut comprendre à cet effet qu'une taxe sur l'énergie présente des caractères particuliers par rapport aux autres taxes environnementales (éco-taxes).
On considère généralement que l'instauration d'une taxe en vue de réduire une activité polluante constitue une action conforme au principe pollueur-payeur (O.C.D.E. [1975]). L'instauration de cette règle de responsabilité particulière n'est pas suffisante en matière d'énergie. En effet, alors qu'une réduction de pollution allant jusqu'à obtenir un niveau zéro de pollution est concevable (même si la pollution «optimale» ne correspond jamais à ce niveau) et justifie la taxation sur l'ensemble de la production polluante, on ne peut imaginer un processus de production ne comportant aucune consommation énergétique. Le seul objectif atteignable à un moment donné est celui représenté par la meilleure technologie disponible. C'est la raison pour laquelle le principe pollueur- payeur ne peut s'appliquer qu'au «gaspillage» correspondant au potentiel optimal d'économie d'énergie et non pas à l'ensemble de la consommation énergétique.
Une taxation ne portant que sur l'écart de consommation entre la situation effective et celle de la meilleure technologie disponible apparaît donc plus conforme à l'équité en matière énergétique que le simple principe pollueur-payeur. Contrairement à ce dernier, elle évite de taxer lourdement les industries structurellement grosses consommatrices d'énergie dès lors que leur consommation se situe au voisinage de ce qu'autorise la meilleure technologie disponible. Cette question des industries grosses consommatrices d'énergie met tout projet de taxe assise sur la consommation énergétique globale devant un dilemme : un taux élevé d'une telle taxe risque d'être insupportable pour ces industries, ne serait-ce que pour des raisons de concurrence internationale, obligeant à prévoir des abattements ou des dérogations qui risquent alors de
72 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
faire échapper une part importante des émissions de CO2 à toute réduction. De ce point de vue, une taxe assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie ne présente pas le même inconvénient. Son taux peut sans dommage être élevé même pour les industries grosses consommatrices d'énergie, puisqu'il ne porte que sur l'écart des consommations effectives à celles correspondant à la meilleure technologie disponible.
Enfin nous pensons que la taxe assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie présente un caractère incitatif en ce qui concerne la propagation des innovations. En effet, la meilleure technologie disponible peut être supposée librement accessible en statique à toutes les firmes. Toutefois, en dymanique, afin d'éviter le caractère sclérosant inhérent à toute norme, une incitation à améliorer encore cette technologie pourra être donnée en instaurant des éléments de monopole transitoires sur ces innovations, par exemple par l'intermédiaire de brevets (Romer [1990]).
Sur quelques modalités pratiques d'une taxe assise sur le potentiel optimal d'économies d'énergie
L'instauration d'une taxe sur l'énergie ne va pas sans poser des problèmes d'ordre pratique, dont les uns sont communs à tous les types d'assiette, tandis que d'autres sont spécifiques de la taxe assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie.
Le recours à un taux croissant pour la rapidité du résultat
La taxe assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie, comme la taxe proportionnelle sur les consommations énergétiques, peut être conçue avec un taux croissant dans le temps et non plus constant27, ce qui permet d'obtenir plus rapidement l'atteinte de l'objectif et de faciliter les adaptations nécessaires.
Sylvie Faucheux /Jean-François Noël 73
Mesures fiscales d'accompagnement
Les effets négatifs d'une fiscalité sur l'énergie (rejet d'un impôt nouveau venant accroître la pression fiscale, effets macro-économiques négatifs sur les prix et l'activité économique, éventualité d'effets redistributifs pervers des ménages les plus pauvres vers les plus riches) peuvent être compensés par des réductions portant sur d'autres postes de la fiscalité ou plus généralement des prélèvements obligatoires. On peut penser par exemple à une réduction de la T.V.A., de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, ou bien à une baisse des cotisations sociales des employeurs, cette dernière cherchant à compenser en moyenne l'impact de la fiscalité énergétique sur les coûts des entreprises. Il s'agit d'aboutir à une minimisation des conséquences macroéconomiques de la taxe.
Si la nécessité de rendre une telle taxe aussi acceptable que possible par l'opinion est évidente — les «bons impôts» sont ceux qui passent inaperçus, pensent en général les pouvoirs publics — il faut être conscient que le redéploiement fiscal accompagnant l'instauration d'une fiscalité énergétique est nécessairement limité. Il serait en tout cas d'autant plus facilement praticable que le montant prélevé par la taxe au bénéfice des finances publiques serait plus faible. A cet égard, une taxe assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie, dont le montant prélevé est plus faible que celui d'une taxe proportionnelle à la consommation énergétique, apparaît plus facilement compensable que cette dernière.
Quelques repères méthodologiques
La taxe assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie, dans la mesure où elle porte sur une différence de consommations et non sur la consommation énergétique
74 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
dans son ensemble, implique la connaissance de données beaucoup plus détaillées que celles nécessaires à l'établissement d'une taxe proportionnelle à la consommation énergétique.
D'une part, il faut connaître la consommation énergétique de chaque firme ou secteur, ce qui implique l'existence généralisée de comptabilités énergétiques d'entreprise ou la confection au niveau macro-économique de tableaux entrées-sorties établis directement en termes énergétiques. Ceci implique donc un coût d'organisation qu'il s'agirait d'analyser plus avant.
D'autre part, la définition de la meilleure technologie disponible qui sert de référence pour évaluer la position de chaque firme ou secteur, nécessite qu'on établisse à la fois des comparaisons par pays et des études détaillées des technologies utilisées, actuellement en développement ou encore au stade de la recherche. Un choix s'impose : c'est celui de la technologie la plus performante sur le plan de la consommation énergétique parmi les technologies déjà commercialisées28. Etant donnée la durée de vie des équipements (une dizaine d'années), des prévisions peuvent aussi être faites à partir de l'utilisation future de technologies actuellement en développement mais non encore commercialisées.
Ceci suppose, entre autres, un développement et un perfectionnement des modèles technico-économiques, tels que MEDEE (Chateau & Lapillonne [1977]) en France, susceptibles de calculer les consommations énergétiques à partir d'une évolution de la demande finale et des technologies disponibles.
De telles études sont relativement faciles à obtenir pour le secteur industriel. Une généralisation d'audits énergétiques dans les entreprises permettraient à celles-ci de se situer par rapport à la technologie de référence et d'apporter la preuve des améliorations en matière de consom-
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 75
mation énergétique. En ce qui concerne le secteur résidentiel — qui, avec le tertiaire, représente en France, selon 1'A.F.M.E., l'une des principales sources potentielles d'économie d'énergie — cela apparaît beaucoup plus difficile, dans la mesure où les technologies mises en œuvre dans le domaine du chauffage et de l'isolation des bâtiments sont peu identifiables et isolables. Toutefois, des tentatives d'audit énergétiques par ménage ont été récemment réalisées aux Etats-Unis, avec, il est vrai, un succès pour le moment mitigé (Sioshansi [1991]). Dans ces conditions, une fiscalité assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie apparaît dans l'immédiat difficile à mettre en œuvre dans ce domaine. Le secteur des transports, quant à lui, est hétérogène, puisqu'il comprend à la fois le secteur des transports collectifs, dont le comportement vis-à-vis des économies d'énergie se rapproche de celui du secteur industriel, et le secteur du transport automobile individuel, dans lequel les performances en matière énergétique sont entièrement définies par la branche de l'automobile. C'est donc plutôt sur les branches industrielles correspondantes que devrait en cette matière porter une fiscalité assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie et non sur le consommateur final.
En ce qui concerne l'application, le recours à des procédures de « tiers-payant» consistant à faire financer les investissements d'économies d'énergie par des sociétés de services énergétiques qui se remboursent sur les économies réalisées (Hourcade et alii [1989]), pourrait permettre à un plus grand nombre de firmes (ou de ménages une fois que ce système serait étendu à eux) de bénéficier d'une fiscalité réduite sur l'énergie. Par ailleurs, ces sociétés spécialisées pourraient fournir une information immédiate et quasi parfaite des investissements économiseurs d'énergie les plus performants, c'est-à-dire sur l'état des meilleures technologies disponibles. Ces dernières enfin pourraient
76 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
être établies en fonction des informations recueillies par les divers organismes nationaux chargés de l'aspect économie d'énergie (l'A.F.M.E. par exemple en France). L'organisation mondiale chargée de la gestion des pollutions globales, dont nous parlions dans la première partie, aurait à recueillir ces différentes normes de rendement énergétique et à établir un système de normalisation mondiale, du moins pour les transformateurs énergétiques les plus répandus, comme l'a déjà préconisé Goldemberg [1987].
En effet, une fiscalité sur l'énergie, quelle qu'elle soit, doit être définie sur une base internationale, afin d'éviter les perturbations trop importantes du commerce international (distorsions de concurrence, délocalisations injustifiées d'activités). On peut redouter en effet — comme conséquence d'une taxation de l'énergie qui ne serait pas uniforme dans tous les pays — un accroissement des importations en provenance de pays, à la fiscalité inexistante en la matière, de produits ayant impliqué une forte consommation énergétique pour leur fabrication ou ayant un contenu élevé en carbone. De même, les rapports Nord- Sud devront être pris en compte par tout projet de fiscalité de ce type. Les modèles technico-économiques par exemple, permettent de définir pour certaines productions et pour certains pays des «raccourcis technologiques» adaptés à la situation particulière de tel ou tel pays en développement (Goldemberg, [1987])29.
Quant à la réalisation des cadres comptables énergétiques nécessaires à la mise en œuvre d'un tel système de taxation, même si elle semble difficile, elle n'en demeure pas moins faisable. L'élaboration actuelle de la comptabilité nationale a été une lourde tâche, le développement actuel de la comptabilité patrimoniale également. L'essentiel est de savoir si l'on veut véritablement se donner les moyens de mettre en œuvre une politique efficace de lutte contre l'accroissement de l'effet de serre. Toutefois, il paraît in-
Sylvie Faucheux / Jean-François Noël 77
dispensable de pouvoir évaluer les implications macroéconomiques par rapport à celles des systèmes de taxation énergétique le plus souvent proposés (Direction de la Prévision [1991]).
La politique de lutte contre l'accroissement de l'effet de serre que nous préconisons repose sur une articulation entre calcul économique et calcul énergétique. Celle-ci constitue d'ailleurs un retour aux origines, puisque ces outils d'aide à la décision ont été tous deux forgés en France au XIXe siècle sous l'impulsion des «ingénieurs économistes» (Walliser [1990], Vivien [1991]).
C'est donc plutôt dans le sens d'une complémentarité avec le calcul énergétique que doit s'opérer la «mutation» du calcul économique dont nous parlions en commençant.
Plus généralement, l'analyse énergétique, recourant notamment aux techniques d'évaluation énergétique (en- thalpique, exergétique, emergétique, entropique) (Faucheux [1990]), dont le calcul énergétique est une composante, peut être utile dans la détermination d'un grand nombre d'objectifs écologiques. L'analyse économique permet pour sa part d'atteindre ces objectifs au moindre coût. Cette démarche est d'ailleurs tout à fait conforme à l'approche préconisée par Baumol & Oates [1971] , consistant à dissocier la fixation, à l'aide d'une norme, d'un objectif, de l'atteinte efficiente de ce dernier à l'aide des instruments économiques habituels, en particulier d'une taxe.
Il ne s'agit donc plus d'une opposition entre l'économie standard de l'environnement et l'« ecological economics», auquel se rattache l'analyse énergétique, mais plutôt d'une complémentarité. Une première version en langue anglaise de cet article a fait l'objet d'une communication des auteurs le 13- 6. 1991 à Stockholm (Annual meeting of the European association of environmental and resource economists)
78 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
Notes
l.Nous ne prendrons pour exemple que la mondialisation du capital ou du système financier.
2. On ne peut que constater avec Daily que l'interconnection est désormais totale : « le monde est maintenant tellement interconnecté politiquement, économiquement et particulièrement physiquement à travers l'atmosphère, que penser, même si l'on est riche, pouvoir échapper aux conséquences de l'augmentation des gaz à effet de serre serait pure folie» (trad, de Daily etalii [1991], p. 6) 3. Ceci constitue le propos de la «bioéconomie » dont l'instigateur est N. Georgescu-Roegen [1971]. 4. Les problèmes d'environnement globaux constituent aujourd'hui l'une des branches de la socio-économie et sera même au centre de la prochaine conférence annuelle de Society for the Advancement of Socio-Economies à Irvine en Californie en mars prochain. 5. Aux Etats-Unis, cette technique s'est même vu reconnaître un statut officiel, puisque depuis le décret exécutif n° 12291 de 1981 toute réglementation nouvelle doit nécessairement être accompagnée d'une analyse coût-avantage. C'est évidemment le cas pour toute politique environnementale. 6. Comme le reconnaît Nordhaus [1991] quand il note à propos de l'estimation des dommages « nous passons maintenant de la terra infirma du changement climatique à la terra incognita des impacts socio-économiques du changement climatique. » trad. p. 930. 7. Cette question constitue un des
axes de réflexion du séminaire ECLAT sur les problèmes du très long terme organisé par le Ministère de l'Environnement sous la direction de M. Beaud. 8. Nordhaus soulignait ce problème, lorsqu'il déterminait la contrainte de son modèle : «Malheureusement, bien que de considérables inquiétudes scientifiques aient été exprimées au sujet des tendances futures de concentrations en carbone, il n'y a pas d'essais pour suggérer quels peuvent être les standards raisonnables », Nordhaus [1977], trad. 344. 9. Teneur du gaz naturel en carbone : 570 kg de СЯЕР, pétrole 795 kg de C/ TEP, charbon 1 024 kg de C/TEP. 10. Un parallèle pourrait être fait avec l'évolution rencontrée en matière de CFC, au cours de laquelle les CFC «les moins nocifs » pour l'ozone ont fini par être incriminés et réglementés au même titre que les CFC 11 et 12, les plus utilisés et les plus dangereux pour la couche d'ozone. Cf. Theys et alii [1988]. 11. Les scénarios présentés au 14° Congrès de la Conférence Mondiale de l'Energie de 1989 (Frisch, [1989]) donnent à l'horizon 2020 une part du nuclaire dans l'énergie primaire comprise entre 7,09 % (scénario croissance économique faible) et 8,22 % scénario croissance économique modérée), même si ses taux de croissance sur la période 1985-2020 restent élevés (respectivement + 153 % et + 243 %). 12. Deux exemples de ces phénomènes de «lock in» ont été étudiés: celui du clavier de machine à écrire QWERTY par David [1986] et celui de la filière nucléaire à eau pressurisée
Sylvie Faucheux /Jean-François Noël 79
par Cowan [1990] cf. Foray [1991] et Ayres& Walter [1991] 13. La pluralité de barèmes (enthal- pique et exergétique) existant dans le calcul énergétique permet de guider les choix en matière d'investissement dans les économies d'énergie. Par exemple, si l'on a le choix pour obtenir de telles économies entre récupérer des chaleurs résiduaires et améliorer le rendement d'échangeurs thermiques, tout va dépendre de l'objectif poursuivi. Valoriser des chaleurs résiduaires qui contiennent peu d'énergie utilisable, (c'est-à-dire peu d'énergie thermique mécanisable), ne présente aucun intérêt, si le but est de disposer de d'avantage d'énergie sous forme mécanique. Dans ce cas, il faut plutôt chercher à améliorer le rendement des échangeurs thermiques. Si en revanche, l'objectif est d'obtenir de l'énergie sous forme thermique, alors il faut connaître la quantité d'énergie perdue et où se font les pertes. Dans la première situation, c'est un calcul fondé sur le premier principe de la thermodynamique qui nous permettra de trancher, alors que dans la seconde c'est le barème enthalpique. (Le Goff, [1979]) 14. Au sens de l'A.F.M.E. le gisement statique d'économie d'énergie est déterminé à partir des techniques «connues et éprouvées», tandis que le gisement dynamique correspond à l'emploi de «techniques et de matériaux nouveaux dont les caractéristiques économiques sont encore mal connues». 15. Lorsqu'il s'agit de machines thermiques, le concept de base en matière thermodynamique est le rendement ou coefficient de Carnot, rendement théorique découlant directement de la différence de température de la source
chaude et de la source froide, représentant le rapport entre la quantité de chaleur transformée en travail et la quantité de chaleur mise en œuvre (et puisée à la source chaude) et comme tel nécessairement inférieur à 1. Ce rendement théorique n'est qu'approché à des degrés divers par les machines thermiques concrètes. 16. Public Law 93-577, section 5 (A) 5 du Non Nuclear Energy Research and Development Act de 1974. 17. L'énergie primaire mesure les inputs énergétiques initiaux dans leurs diverses formes matérielles : charbon, lignite, pétrole, gaz naturel, électricité primaire. L'énergie finale résulte des transformations énergétiques au sein de la filière énergétique et on y retrouvera à ce titre l'électricité, que celle-ci soit produite en tant qu'électricité primaire ou à partir de charbon, de pétrole ou de gaz naturel. Les premières transformations s'accompagnent évidemment de pertes dont les rendements du type énergie finale/énergie primaire permettent de mesurer l'impact. L'énergie utile est l'énergie appliquée à la satisfaction d'un besoin énergétique déterminé. Elle est de nature essentiellement qualitative. Sa mesure nous donnera les quantités d'énergie utilisées en tant que force motrice, source de chaleur de haute ou de basse température, force électromagnétique, énergie chimique. Lors des opérations de transformation énergétique correspondant à la production de biens, des pertes ont également lieu et toute l'énergie finale, pourtant consommée, ne se retrouve pas dans la somme des énergies utiles. De nouveaux rendements du type énergie utile/énergie finale peuvent être calculés pour en rendre compte. Cette tâche implique une décomposi-
80 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
tion technique complète des transformations matérielles et énergétiques effectuées au sein d'un procès de production. 18. Ceci est le cas également pour un autre problème global, celui de la détérioration de l'ozone stratosphérique par les chlorofluorocarbones, (Noël [1988]). 19- On peut noter en fonction de ce que nous avons vu précédemment qu'une telle taxe, dont l'objectif essentiel est l'incitation à la substituabilité intra-énergétique, nécessiterait d'être complétée par un calcul exergétique pour mettre en évidence les limites d'une telle substitution. 20. Celle-ci est rendue obligatoire par la puissance publique, dans le cas des producteurs électronucléaires, qui sont tenus de prendre en compte une série de coûts futurs inhérents à leur activité. 21. Ainsi le projet de taxe européenne sur l'énergie prévoit-il des dérogations (allégements, voire exemptions) pour les secteurs gros consommateurs d'énergie situés en concurrence internationale (sidérurgie, chimie, ciment, verre, papier). 22. La taxation assise sur le potentiel optimal d'économie d'énergie introduit seulement une limite à la réduction de consommation énergétique. Si QjA correspond à Qmin, la firme A ne sera pas taxée. 23. И n'est pas nécessaire à cet égard de distinguer taxe sur les énergies primaires (taxe à la production) et taxe sur les énergies finales (taxe à la consommation intermédiaire ou finale) dans la mesures où les producteurs d'énergie sont caractérisés par des comportements de « price
kers» et peuvent par conséquent reporter le poids de la taxe sur les consommateurs. 24. La taxe proposée portant en toute hypothèse sur des consommations énergétiques, on peut supposer qu'elle n'influera pas sur les coûts de production des différentes formes d'énergie et que par conséquent la courbe d'offre énergétique S restant inchangée, seule la demande d'énergie (la consommation énergétique, en fait) est affectée. 25. Cette courbe Dx est déterminée par les prix hors taxe et les quantités réduites à un niveau correspondant au prix taxe comprise. 26. On remarque également que si les prix hors taxe de l'énergie décroissent lorsque le taux de la taxe s'élève, les prix taxe comprise, qui sont ceux que payent effectivement les consommateurs d'énergie, sont, eux, croissants lorsque le taux de la taxe s'élève. 27. Telle est par exemple la proposition faite en France par le Rapport Martin « d'une fiscalité progressivement croissante sur l'énergie fossile. [...] A titre indicatif, nous pourrions proposer une taxe qui s'accroîtrait au rythme de 150 F par tonne de carbone. Cette croissance se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire pour obtenir les résultats voulus, compte tenu des adaptations intervenues, de l'évolution des prix de marché de l'énergie et de l'amélioration de nos connaissances sur l'effet de serre et ses conséquences.» Groupe Interministériel sur l'effet de Serre [1990], p. 69-70. Il en est de même du taux de la taxe dans la proposition de la Commission de la Communauté économique européenne. 28. Une telle étude a été faite par J.
Sylvie Faucheux /Jean-François Noël 81
Goldemberg et alii [1987], en ce qui concerne une comparaison Suède- Etats-Unis portant sur la consommation énergétique des diverses technologies de la production d'acier.
Références
29. Notre propos ne porte pas sur les modalités des transferts technolo
giques Nord/Sud qui doivent être envisagés pour tout système de taxation énergétique.
R. U. Ayres, J. Walter [1991] : The Greenhouse effect: damages, costs and abatement, Environnemental and resources economics, vol 1, n°3. R. Baron [1990] : Discussion méthodologique des travaux de prospective énergie-économie-environnement à long terme à partir du dossier de l'effet de serre. CIRED, EHESS, Paris, novembre. W. Baumol, W. Oates [1971] : The use of standards and prices for the protection of the environement, Swedish journal of economics. 73. J. Benhaim, A. Caron, F. Levarlet [1991] : Analyse économique des pro
positions et stratégies développées par les acteurs publics et privés nationaux et internationaux face au problème du C02, Rapport pour le Groupe de Prospective du Ministère de l'Environnement, Cahiers du Centre Eco- nomie-Espace-Environnement, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. J. Benhaim, A. Caron, F. Levarlet [1992] : La maîtrise des émissions de CO2: un accord international est-il possible? A paraître dans Monde en développement. R.S. Berry, M.F. Fels [1972] : The production and consumption of automobiles: an energy analysis of the manufacture, Institute of Environmental quality, University of
Chicago, Chicago. B. Chateau, B. Lapillonne [1977] : La prévision à long terme de la demande d'énergie. Le modèle ME- DEE, Collection énergie et société, Editions du C.N.R.S., Paris. W. R. Cline [1991] : Scientific basis for the greenhouse effect, Economic journal, n°l, july. R. Costanza [1989] : What is ecological economics?, Ecological economics, vol 1, n° 1, february. R. Cowan [1990] : Nuclear power reactors: a study in technological lock, Journal of economic history, 3. G.C. Daily, P.R. Ehrlich, H.A. Mooney, A.H. Ehrlich [1991] : Greenhouse economics: learn before you leap, Ecological economics, vol 4, n° 1, October. P. David [1986] : Understanding the economics of QWERTY: the necessity of history, in Parker (Edr) Economic history and the modern economist, Oxford, Blackwell. B. Dessus [1991] : Les réserves d'économie d'énergie : nature, caractéristiques et coûts d'accès, Revue de l'énergie, n°431, juin. Direction de la prévision [1991] : Effet macro-économiques à 5 ans d'une hausse de la fiscalité sur l'énergie fos-
82 Sylvie Faucheux /Jean-François Noël
sile accompagnée d'un redéploiement fiscal, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Note de la Direction de la Prevision, juin. P. Dockers, B. Rosier [1991] : Histoire raisonnée et économie historique, Revue économique, vol 42, n°2, mars. S. Faucheux [1990] : L'articulation des évaluations monétaires et énergétiques en économie, Thèse de Doctorat es Sciences Economiques, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. S. Faucheux, J.F. Noël [1988] : Enjeux économiques, techniques et écologiques de différentes politiques alternatives de contrôle de l'évolution de la couche d'ozone, Rapport pour le Groupe de Prospective du Ministère de l'Environnement, Cahiers du Centre Economie-Espace-Environne- ment, Université de Paris I Panthéon- Sorbonne. S. Faucheux, J. F. Noël [1990] : Les menaces globales sur l'environnement, Collection Repères, n°91, La Découverte, Paris. S. Faucheux, J. F. Noël, [1991] : Controverses scientifiques et économiques face aux problèmes globaux d'environnement inj. Theys (Edr) Environnement, science et politique, Cahier n° 13, GERMES, Paris. D. Foray [1991] : Dynamique économique et nouvelles exigences de l'investigation historique : learning to love multiple equilibria, Revue économique, mars. J. R. Frisch [1989] : Horizons énergétiques mondiaux 2000-2020, Editions Technip. N. Georgescu-Roegen [1971] : The entropy law and the economic
cess, Harvard University Press, Cambridge (MA). J. Goldemberg et alii [1987] : Energy for a sustainable world, World Res- sources Institute, Washington DC. Groupe interministériel sur l'effet de serre [1990] : Rapport (Rapport Yves Martin), Paris. R. A. Herendeen, С W. Bullard [1974] : Energy costs of goods and services, 1963 and 1967, Document 140, Centre for Advanced Computations, University of Illinois, Cham- paigne, Urbana (ILL). J.T. Houghton, GJ. Jenkins, J.J. Ephrams [1990] (Eds) : climate change : the I.P.C.C. scientific assessment, Cambridge U.P., Cambridge U.K. J. С Hourcade, G. Megie, J. Theys [1989] : Politiques énergétiques et risques climatiques. Comment gérer l'incertitude .'Futuribles, n° 135, septembre.
International energy agency [1990] : Energy and the environnement: policy overview, O.E.C.DTIEA, Paris. International federation of institutes for advanced studies [1974] : Energy analysis: workshop on methodology and conventions, Workshop Report n° 6, Stockholm, august.
International federation of institutes for advanced studies [1975] : Workshop on energy analysis and economics, Workshop Report n°9, Stockholm, august. E. Jochem [1991] : Reducing CO2 emissions — the West German plan, Energy policy, vol 19, n° 2 march.
B. Keepin, G. Kats [1988] : Greenhouse
Sylvie Faucheux /Jean-François Noël 83
warming : Comparative analylis of nuclear and energy efficiency abat- ment strategies, Energy policy, vol 16, n° 6, dec. P. Le Goff [1979] : Energétique industrielle, tome 2, Editions Technique et Documentation, Paris. J. F. Noël [1977] : Le mode de traitement de l'environnement dans la théorie et la pratique économique, thèse de Doctorat d'Etat es Sciences Economiques, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. J. F. Noël [1988] : Sur quelques instruments micro-économiques d'une politique de protection de la couche d'ozone, Communication aux 5e Journées de Micro-économie appliquée, Toulouse, 9-10 juin 1988, 16 p, multi- graphié. W. D. Nordhaus [1973] : The allocation of energy resources, Brookings papers on economic activity, n°3. W. D. Nordhaus [1989] : The economics of the greenhouse effect, Yale University, MA. W.D. Nordhaus [1991] : Toslowornot to slow : the economics of the greenhouse effect, Economic journal, n° 1, july. O.C.D.E. [1975] : Le principe pollueur-payeur: définition, analyse, mise en œuvre, O.C.D.E., Paris. J. B. Opschoor, H. B. Vos [1989] : Instruments économiques pour la protection de l'environnment, O.C.D.E. Paris. R. Passet [1979] : L'économique et le vivant, Payot, Paris. J. Pasztor [1991] : What role can nuclear power play in mitigating global
warming? Energy policy, vol 19, n° 2, march. D. W. Pearce [1976] : The limits of cost- benefit analysis as a guide to environmental policy, Kyklos. D. W. Pearce [1989] : Blueprint for a green economy, Earthscan, London. D. W. Pearce [1991] : (Edr), Blueprint for a green economy, Earthscan, London. D. W. Pearce [1991] : The role of carbon taxes in adjusting to global warming, Economic journal, n° 1, july. D. W. Pearce, R. K. Turner [1990] : Economics of natural resources and the environment, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead, Herts. G. Pillet, S. Faucheux, F. Levarlet, J. F. Noël [1991] : Revue critique du modèle «ECCO» et proposition d'un module environnement, Papier TM-52- 91-01, Paul Scherrer Institute, Villin- guen, Suisse, juillet. К. Popper [1957] : Préface de 1957 à Misère de l'historicisme, Pion, Paris, [1988]. P. M. Romer [1990] -.Endogenous technical change, Journal of political economy. L. Schipper [1987] : Energy saving policies of O.E.C. D. countries: did they make a difference? Energy policy, vol 15, n° 6, december. E. Schueller [1956] : L'impôt sur l'énergie, La première grande réforme de structure qui doit entraîner toutes les autres, en même temps que la révision des concepts de notre vie, SEMP, Paris. F. P. Sioshansi [1991] : The myths and
84 Sylvie Faucheux / Jean-François Noël
facts of energy efficiency : survey of implementation issue, Energy policy, vol 19, n°3, april. J. Skea [1991] : Editor's introduction, Energy policy, Special issue : Climate change: policy implications, march. M. Slesser [1989] : Unitax, an alternative national and local tax, Fletcher paper, Longforgan by Dundee. D. T. Spreng [1988] : Net energy analysis and the energy requirements of energy systems, Praeger, New York. J. Theys, S. Faucheux, J. F. Noël
[1988] : la guerre de l'ozone, Futu- ribles, n° 125, octobre. F. D. Vivien [1991] : Sadi Carnot économiste, enquête sur un paradigme perdu : Economie - Thermodynamique - Ecologie. Thèse de Doctorat es Sciences Economiques, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. B. Walliser [1990] : Le calcul économique, Collection Repères, n°90, La Découverte, Paris. M. Webb, D. W. Pearce [1971] : The economics of energy analysis in J. G. Thomas (Edr), Energy analysis, IPC Science and Technology Press, West- view Press, New York.