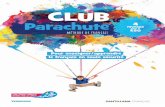Countering NATO Expansion: A Case Study of Belarus-Russia Rapprochement
L’Anteposition des Déterminants et les Adjectifs Epithètes Anteposés en Français : un...
Transcript of L’Anteposition des Déterminants et les Adjectifs Epithètes Anteposés en Français : un...
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
Editör
Yrd. Doç. Dr. Muhammet KUZUBA�
Danı�ma Kurulu
Doç. Dr. M. Yavuz ERLER - Doç. Dr. Kemalettin �AH�N Yrd. Doç. Dr. Bekir ���MAN - Yrd. Doç. Dr. Salih DEM�RB�LEK
Yönetim Kurulu
Sami BASKIN - Ahmet DA�LI - Nuh DO�AN - Yılmaz IRMAK - Yunus KAPLAN – Esra KARA Cafer ÖZDEM�R - Yakup POYRAZ - Ömer SARAÇ - Kadir YALINKILIÇ - M. Fatih YILMAZ
Yayın Kurulu�
Prof. Dr. Walter ANDREWS - Prof. Dr. Necati DEM�R - Prof. Dr. Ramesh DEOSARAN� Prof. Dr. Pavel DOLUKHANOV - Prof. Dr. Norbert FRIES - Prof. Dr. Shih-chung HSIEH�
Prof. Dr. Maimunah ISMAIL, Prof. Dr. Atabey KILIÇ - Prof. Dr. Nebi ÖZDEM�R � Prof. Dr. Maria Pia PEDANI - Assoc. Prof. Dr. Norhasni Z. ABIDDIN �
Assoc. Prof. Dr. Rainer CZICHON - Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAA�AÇ� Yrd. Doç. Dr. Ya�ar BARUT - Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÇIBLAK �
Yrd. Doç. Dr. Emine KOLAÇ - Yrd. Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL � Dr. Francis A. ADESOJI - Dr. Sotiris KOUKOULAS - Dr. Irvin SCHICK �
Dr. Gülim �AD�YEVA - Dr. Fatih USLUER�
ULUSLARARASI SOSYAL ARA�TIRMALAR DERG�S� THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
Issn: 1307-9581 Volume: 2 Issue: 8 Summer 2009 www.sosyalarastirmalar.com
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2/8 Summer 2009
4
Hakem Kurulu
Prof. Dr. Mehmet AÇA Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Ali AKAR Mu�la Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma AL�S�NANO�LU Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Cengiz ALYILMAZ Atatürk Üniversitesis
Prof. Dr. Walter ANDREWS University of Washington (ABD)
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Gaziosmanpa�a Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz ASLAN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. �smihan ARTAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Erman ARTUN Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Mahir AYDIN �stanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Rıza AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice AYNUR Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Kubilay AYSEVENER Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Pakize AYTAÇ Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. �srafil BALCI Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ingeborg BALDAUF Humboldt Universität zu Berlin (Almanya)
Prof. Dr. Fuzuli BAYAT Bilimler Akademisi (Azerbaycan)
Doç. Dr. Ahmet Ali BAYHAN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Fuat B�LKAN TOBB Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. �eref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Erdo�an BOZ Eski�ehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Meherrem CAFERL� Milli �limler Akademisi (Azerbaycan)
Prof. Dr. Mustafa CEM�LO�LU Uluda� Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Ali CENG�Z Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Adem CEYHAN Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Ömür CEYLAN �stanbul Kültür Üniversitesi
Doç. Dr. Rainer CZICHON Berlin Freie Universität (Almanya)
Doç. Dr. Önder ÇA�IRAN Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Ali ÇEL�K Karadeniz Teknik Üniversitesi
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2/8 Summer 2009
5
Prof. Dr. Yakup ÇEL�K Ba�kent Üniversitesi
Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAA�AÇ �stanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Necati DEM�R Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Özcan DEM�REL Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ramesh DEOSARAN University of the West Indies (Trinidad and Tobago)
Prof. Dr. Pavel DOLUKHANOV University of Newcastle (�ngiltere)
Doç. Dr. Dilaver DÜZGÜN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Charlyn DYERS University of the Western Cape (Güney Afrika)
Prof. Dr. Metin EK�C� Ege Üniversitesi
Doç. Dr. �lhan EK�NC� Ordu Üniversitesi
Doç. Dr. Erdo�an ERBAY Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. M. Yavuz ERLER Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Ramile ESXADULLAKIZI Tatar Devlet Gumanitar-Pedogogika Üniversiteti
Prof. Dr. Norbert FRIES Humboldt Universität zu Berlin (Almanya)
Doç. Dr. Ramazan GÜLENDAM Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet GÜN�EN Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Gürer GÜLSEV�N Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Do�an GÜNAY Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Umay GÜNAY YÖDAK Üyesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
Prof. Dr. Osman GÜNER Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Emine GÜRSOY-NASKAL� Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Galibe HACIYEVA Nahcıvan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)
Prof. Dr. Shih-chung HSIEH National Taiwan University (Tayvan)
Prof. Dr. Maimunah ISMAIL Universiti Putra Malaysia (Malezya)
Prof. Dr. Ahmet �NAM Orta Do�u Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan �NAN Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Cabbar ��ANKUL Özbekistan �limler Akademisi (Özbekistan)
Prof. Dr. K. P. JAYASANKAR Tata Instute of Social Sciences (Hindistan)
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇAL�N Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Adalet KANDIR Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut KAPLAN Celal Bayar Üniversitesi
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2/8 Summer 2009
6
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KARA Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Necati KARA Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer KARA Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Songül KARAHASANO�LU ATA �stanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Cahit KAVCAR Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan KAVRUK �nönü Üniversitesi
Prof. Dr. Mevlüt KAYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Levent KAYAPINAR Abant �zzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Barbara KELLNER-HEINKELE Freie Universität Berlin (Almanya)
Prof. Dr. Atabey KILIÇ Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz KILIÇ Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. M. Ali K�RMAN Sütçü �mam Üniversitesi
Prof. Dr. George M. KORRES University of the Aegean (Yunanistan)
Doç. Dr. M. Fatih KÖKSAL Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. M. Emin KÖKTA� Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Nerin KÖSE Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Arzu KUNT �stanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet KUTALMI� Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Fırat KUTLUK Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Wan-I LIN National Taiwan University (Tayvan)
Prof. Dr. Ali Mahafzah The University of Jordan (Ürdün)
Prof. Dr. Muhammad K. MAJALI The University of Jordan (Ürdün)
Prof. Dr. Ahmet MERMER Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Makbule MUHARREMOVA Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Christoph K. NEUMANN Ludwig-Maximilians-Universität München (Almanya)
Prof. Dr. Ahmet N��ANCI Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. M. Öcal O�UZ Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ali �hsan ÖBEK Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof.. Dr. Nebi ÖZDEM�R Hacettepe Üniversitesi
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2/8 Summer 2009
7
Doç. Dr. Oktay ÖZEL Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Emine ÖZMETE Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Maria Pia PEDANI Universita' Ca' Foscari Di Venezia (�talya)
Prof. Dr. Kadir PEKTA� Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Erkan PER�EMBE Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Karl REICHL Bonn Universität (Almanya)
Doç. Dr. Gülden SARIYILDIZ �stanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Sedat SEVER Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet SEYHUN Winnipeg University (Kanada)
Prof. Dr. Bilge SEY�DO�LU Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Byoungduk SOHN Chongshin University (Kore)
Prof. Dr. Vagıf SULTANLI Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)
Prof. Dr. Hatice �AH�N Uluda� Üniversitesi
Doç. Dr. Kemalettin �AH�N Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Faruk �EN Duisburg-Essen Universität (Almanya)
Prof. Dr. Esma ��M�EK Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Baha TANMAN �stanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Zeki TA�TAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Burhanettin TATAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. �brahim TELL�O�LU Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet TEZCAN Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Semih TEZCAN Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Arslan TOPAKKAYA Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ali TORUN Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Zehra TOSKA Bo�aziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Enver TÖRE Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK Atatürk Üniversitesi
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2/8 Summer 2009
8
Prof. Dr. Vahit TÜRK Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Ülkü Eser ÜNALDI Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Gholam VATANDOUST American University of Kuwait (Kuveyt)
Prof. Dr. Robert VIVIAN Alma College, Michigan (ABD)
Doç. Dr. Hanifi VURAL Gaziosmanpa�a Üniversitesi
Doç. Dr. Ertu�rul YAMAN Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Metin YASA Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Bahaeddin YED�YILDIZ Hacettepe Üniversitesi
Prof. Sabri YENER Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Emine YEN�TERZ� Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Harun YILDIZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Musa YILDIZ Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Netice YILDIZ Do�u Akdeniz Üniversitesi (KKTC)
Doç. Dr. Ali YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Kazım YOLDA� �nönü Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet YÜKSEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz ZEYREK Orta Do�u Teknik Üniversitesi
YAYIN �LKELER�
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research yılda dört sayı (güz, kı�, bahar ve yaz ) olarak internet üzerinden yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergimiz, EBSCO, DOAJ, Scientific Commons, Ulrichsweb, Index Copernicus, Public Knowledge Project (PKP), ICAAP, Journal Seek vb. uluslararası indeksler tarafından taranmakta; University of London, Arizona State University, The City University of New York, The University of North Carolina, Indiana Earlham College, York University, Georgetown University, John Brown University, University of Regensburg, Reading University, The University of Hong Kong gibi bir çok üniversitenin kütüphanesinde listelenmektedir.
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, dil, edebiyat, halkbilimi, tarih, co�rafya, e�itim bilimleri, din bilimleri, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi vb. sosyal alanlara ait ara�tırmaya dayanan, sahasına katkı sa�layacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlamaktadır. Adı
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2/8 Summer 2009
9
geçen alanlarda hazırlanan bilimsel kitaplara ait de�erlendirme yazıları da derginin yayın kapsamı içindedir.
Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamı� olması gerekmektedir. Ulusal veya uluslararası sempozyumlarda sunulan bildiriler, yine ba�ka bir yerde yayınlanmamı� olması ve dipnotta belirtilmesi ko�uluyla dergimizde yayınlanabilir. Bu konuda tüm sorumluluk yazara aittir.
Dergide Türkçe makalelerin yanı sıra �ngilizce, Almanca, Fransızca ve �talyanca makaleler de yayınlanabilir.
Dergiye gönderilen makale, dergi editörleri tarafından yayına uygunluk açısından incelendikten sonra iki hakeme gönderilir. Hakemlerin de�erlendirmeleri sonucunda iki yayınlanabilir raporu alan makale, dergi yönetimince uygun görülen bir sayıda yayınlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, di�erinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.
Yayınlanan makalelerin uluslararası indekslere eklenmesinde sorun ya�anmaması için özet ve anahtar kelimeler gerekmektedir. Bu nedenle dergiye gönderilecek makalede mutlaka Türkçe-�ngilizce özet ve anahtar kelimeler-key words bulunmalıdır. Ayrıca makalenin �ngilizce ba�lı�ı, Türkçe ba�lı�ın altına eklenmelidir.
Makale word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni �u �ekilde olmalıdır:
Metin boyutu
Dipnot boyutu
Paragraf aralı�ı
Paragraf girinti
Üst kenar bo�lu�u
Alt kenar bo�lu�u
Sa� kenar bo�lu�u
Sol kenar bo�lu�u
Satır aralı�ı
11 punto 8 punto 6 nk 1.25 cm 5 cm 5 cm 4 cm 4 cm Tek
Yazım esnasında özel font kullanılmı� ise, bu fontlar makale ile birlikte gönderilmelidir.
Makalede atıf yapılan kayna�ın dipnotta gösterimi a�a�ıdaki �ekilde olmalıdır :
Kitaplarda: Yazarın Soyadı, Adı. Kitabın Adı. (çev.: Adı Soyadı). Yayınevi. Baskı Yeri, Yılı. Sayfa Numarası.
Makalelerde: Yazarın Soyadı, Adı. "Makale Adı". Dergi Adı, Sayı. Yayınevi. Baskı Yeri, Yılı. Sayfa Numarası.
Tezlerde: Hazırlayan. Tezin Adı, (Yüksek Lisans-Doktora Tezi, Tarihi), Üniversite ve Enstitü Adı.
E�er kullanılan kaynak metin içinde gösterilmek isteniyorsa, yazarın "soyadı baskı yılı-sayfa numarası" (Kaplan 1967: 76) yazılmalıdır. Ayrıca, kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "Kaynakça" adı altında verilmelidir.
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2/8 Summer 2009
10
Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle de�erlendirilmeye alınmayacaktır.
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, gönderilen makaleleri yayınlayıp yayınlamama, gerekli gördü�ü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Gönderilen yazıların yayınlanma hakkı dergi yönetimine, bilimsel ve hukukî sorumlulukları yazarlarına aittir. Dergide yayınlanan yazılar, -bilimsel etik açısından- dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir �ekilde ço�altılamaz ve ba�ka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayınlanamaz.
Makaleler,
[email protected] veya
[email protected] adresine gönderilmelidir.
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
L’ANTEPOSITION DES DETERMINANTS ET LES ADJECTIFS EPITHETES ANTEPOSES EN FRANÇAIS : UN RAPPROCHEMENT SYNTAXIQUE ? ∗∗∗∗
PREPOSING OF DETERMINERS AND PREPOSED EPITHET ADJECTIVES IN FRENCH: A SYNTACTIC SIMILARITY?
Mehmet Ç�ÇEK∗∗∗∗∗∗∗∗
Özet
Fransızcada sıfatlar niteledikleri isimden hem önce hem de sonra gelebilmektedir. Bu çalı�mada bir taraftan Fransızcada sıfatın yeri sorununa de�inilirken öte yandan isimden önce gelen sıfatların özellikleri sorgulanacak; bu özelli�in aslında onları isimlerden önce kullanılan tanımlık ya da belirteç adıyla da bilinen sözdizimsel birimlere yakla�tırdı�ı konusu tartı�ılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Fransızcada sıfatın yeri sorunu, Tanımlık, Belirteç, Sözdizimi.
Abstract
As is known, adjectives in French may both precede and follow the nouns they qualify. In this study, the position of adjectives in French is analyzed on one hand and the characteristics of the adjectives that precede nouns are highlighted on the other. It is discussed that this characteristic makes us consider that they are in fact similar to syntactic units, also called determiners and/or articles.
Key Words: Problem of adjective position in French, Articles, Determiners, Syntax.
0. Introduction
Dans la pratique, la plupart des francophones, en utilisant le français, suivent des automatismes. La maîtrise parfaite de multiples systèmes conventionnels leur permet d’éviter naturellement le traitement conscient de nombreuses opérations linguistiques tels que, par exemple, l'utilisation correcte du genre des articles, le rôle des prépositions ou bien la place des adjectifs épithètes, etc. Ils sont en fait dans leur langue maternelle. Par contre, pour un étranger privé de la connaissance intime de la langue due à l'habitude, le français offre beaucoup de subtilités à maîtriser, et l’une de ces subtilités est de savoir placer correctement les adjectifs épithètes vis-à-vis des substantifs qualifiés. Ceci dit, pour un linguiste, l’important est de savoir comment fonctionne l’organisation syntagmatique des énoncés ; d’où ce travail qui essayera de cerner les tenants et aboutissants de la place de l’adjectif épithète en français : dans un premier temps, nous étudierons les éléments constitutifs du syntagme nominal tel que nous l’étudierons (en l'occurrence le déterminant, le nom et l'adjectif). Nous prêterons plus particulièrement attention aux rapports fonctionnels entre ces éléments : pour bien délimiter la double possibilité de placement de l'adjectif épithète, nous relèverons rapidement quelques différences entre l'apposition, l'attribut et l'épithète.
En ce qui concerne nos analyses linguistiques, nous adopterons un point de vue –une méthode– qui se rendra compte essentiellement de la structure de l’axe syntagmatique1 pour autant qu’elle concerne l’antéposition ou la postposition des adjectifs épithètes (cf. une vraie histoire vs une histoire vraie).
∗ Ce travail a été présenté au cours du Ve Congrès National de la Francophonie qui eut lieu le 25-26 Octobre 2007 à Erzurum. Ce
papier inspiré directement de notre monographie -et soumis tel quel- n’a pas pris sa place parmi les autres communiqués du congrès par une erreur involontaire de la part de l’éditeur.
∗∗ Maître de conférences à l’Université de Gaziantep ([email protected]).
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
Preposing of Determiners and Preposed Epithet Adjectives in French: A Syntactic Similarity 139
1. Définitions: les notions de base
1.1. Le Syntagme Nominal
Selon Le Nouveau Petit Robert (1994: 2193), Le syntagme en tant qu'unité minimale de la phrase est un groupe de mots qui se suivent avec un sens. Et, d'après une autre définition que nous trouvons chez M. Grevisse (1986 : 7), on appelle le syntagme un groupe de mots formant une unité à l'intérieur de la phrase, un groupe ayant une fonction dans la phrase. Ainsi, une phrase comme "La femme marchait dans un jardin" comporte deux types de syntagme où un nom est mentionné : i) le syntagme nominal "la femme" (Déterminant + Nom commun), et ii) le syntagme prépositionnel "dans un jardin" (Préposition + Déterminant + Nom commun2) où il existe déjà un syntagme nominal "un jardin" (Déterminant + Substantif).
Dans un syntagme nominal nous considérerons que figurent le substantif lui même (élément principal ou noyau) et le déterminant (élément subordonné) qui l'accompagne. Voyons maintenant de plus près ces deux derniers.
1.1.1. Les déterminants
Commençons par une citation du Guide Alphabétique de Linguistique française (1986: 218) :
On réserve aujourd'hui le terme de déterminant à un ensemble de morphèmes dont le rôle essentiel est de permettre l'introduction du nom dans le discours. Le caractère indispensable du déterminant est reflété [...] par le fait qu'il représente un constituant obligatoire dans la règle de réécriture du syntagme nominal : SN → Dét. + N.
Comme on le voit, le rôle essentiel des déterminants est de permettre au nom de s'actualiser, de se réaliser dans une phrase. Voyons cela dans l'exemple suivant que nous reprenons –avec un petit changement– à notre travail de D.E.A. (Çiçek 1995 : 4) :
i) ... pomme ... : un substantif (il signifie un objet du monde matériel).
ii) ... pomme est rouge : une phrase incomplète (le sens est inadéquat, parce qu'il manque le déterminant).
iii) Cette pomme est rouge : une phrase complète (le sens est complété par l'intervention introduction du déterminant cette).
En considérant un syntagme nominal du type "cette pomme", on y distingue classiquement sa tête syntaxique "cette" et sa tête sémantique "pomme". Cette distinction est fondée sur le double fait que, syntaxiquement parlant, "cette pomme" se comporte en première analyse comme "cette + S" et sémantiquement parlant "cette pomme" se comporte comme "D + chaise". Dans ce cas-là, on observe deux classes différentes :
i) La classe des commutants possibles de "pomme" dans une distribution phrastique du syntagme "cette pomme" est pratiquement infinie ou plus exactement, elle n'est jamais clôturable, car tout substantif féminin singulier peut s'y substituer sans détruire la correction syntaxique de la phrase; la classe est dite alors "ouverte".
ii) La classe des commutants possibles de "cette" dans une distribution phrastique du syntagme "cette pomme" n'est pas infinie et contient un très petit nombre d'éléments, (cf., un, le, mon, ton, son, notre, votre, leur, quelque, certain, maint); la classe est dite alors "fermée".
On distingue cependant deux sous-ensembles de déterminants :
a) Les déterminants qui ont la propriété de ne pouvoir se combiner entre eux : par exemple, *"ta
1 Ici, rappelons-nous que « l’interprétation de toute unité linguistique met en œuvre à chaque instant deux mécanismes
intellectuels indépendants : comparaison avec les unités semblables (= qui pourraient donc lui être substituées, qui appartiennent au même paradigme), mise en rapport avec les unités coexistentes (= qui appartiennent au même syntagme). Ainsi le sens d’un mot est déterminé à la fois par l’influence de ceux qui l’entourent dans le discours, et par le souvenir de ceux qui auraient pu prendre sa place » (DUCROT Oswalt & TODOROV Tzvetan, (1972 : 145).
2 Désormais, le nom commun sera appelé "substantif".
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
140 Mehmet Ç�ÇEK
cette la voiture" où il s'agit des adjectifs possessifs, des adjectifs démonstratifs et des articles.
b) Les déterminants qui autorisent divers types de combinaisons, à la fois avec ceux cités dans a) et entre eux-mêmes : il s'agit alors des adjectifs indéfinis (cf. quelques voitures) et les adjectifs numéraux (cf. trois voitures). En ce qui concerne la possibilité de combinaison avec les déterminants cités dans a) contentons-nous de donner des exemples suivants : les trois premières voitures, toutes les autres voitures, ces deux voitures, etc.
Aussi est-il possible de considérer comme déterminants les adjectifs exclamatifs (cf. quelle chance !) et les adjectifs interrogatifs (cf. quelle voiture ?), etc.
Notons encore que tous les déterminants cités ci-dessus ont une place fixe à l'égard du substantif qu'ils accompagnent : ils sont toujours antéposés.
A notre avis, ce qui rend les déterminants importants, c'est qu'ils peuvent jouer un rôle sur l'acceptabilité d'un syntagme : si, par exemple, "la blanche magie" est acceptable, il n'en est pas de même pour "une blanche magie".
1.1.2. Le substantif
Quand on essaye de trouver des critères formels pour sa définition, la notion de substantif3 paraît un peu problématique. Le substantif est défini dans les livres de grammaire comme une unité qui désigne des êtres (cf. l’agneau), des actions (cf. la chute), des choses (cf. un sac), des qualités (cf. la beauté) etc., et comme porteur de genre et de nombre (cf. un élève, une élève; un cheval, des chevaux etc. ). Alors qu'il existe d'autres unités qui admettent plus ou moins la même définition. Par exemple, il y a des adjectifs qui expriment la qualité (cf. beau, belle) et qui varient également en genre et en nombre (cf. Un intérêt national, la défense nationale, les intérêts nationaux) aussi bien que le substantif. De même, les déterminants aussi peuvent varier en genre et en nombre.
Donc, du point de vue de la nature, seul le fait que le substantif en attente de détermination (la possibilité de combinaison avec les déterminants qui le précèdent, cf., 1.1.1.) est à retenir comme distinction car, le substantif est la seule catégorie de mots qui, en français, exige la présence de déterminants.
Mais du point de vue des fonctions, le substantif est tout à fait différent des autres unités :
[...] seul le substantif peut servir de support à la proposition comme SUJET, COMPLEMENT D'OBJET et COMPLEMENT D'AGENT ...4
Voici, des exemples illustrant diverses fonctions des syntagmes nominaux :
• La fille aime un garçon. ("sujet").
• Le garçon a abandonné la fille. ("complément d'objet").
• Le garçon avait été aimé par la fille. ("complément d'agent").
En bref, le substantif a des propriétés syntaxiques et par exemple, l'une de ces propriétés est de permettre tout facilement une pronominalisation dans le courant du contexte linguistique :
• Le directeur se trouve dans son bureau les lundis matins; mais la semaine dernière, il n'était pas là.
Ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'une fois précédé d'un déterminant (qui s'antépose toujours) un substantif permet à un adjectif (dit qualificatif) de pouvoir se placer soit avant soit après (cf. une ancienne voiture ou une voiture ancienne).
1.2. L'adjectif
En considérant le rapport qualifié / qualifiant dans un exemple du type un homme raisonnable, 3 Dans la mesure du possible, nous n'allons pas parler des propriétés du nom propre. C'est seulement celles du nom commun qui
nous intéresseront ici. 4 Pour les détails, voir Larousse Grammaire du Français contemporain (1988 : 162).
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
Preposing of Determiners and Preposed Epithet Adjectives in French: A Syntactic Similarity 141
nous trouvons un adjectif qualifiant ("raisonnable") et un substantif qualifié ("un homme"). Dans les lignes suivantes, nous allons essayer d'étudier le dit rapport sous différents angles.
1.2.1. La nature de l'adjectif
Selon la définition la plus ordinaire, l'adjectif est un mot susceptible d'être adjoint directement (épithète) ou indirectement (attribut) au substantif avec lequel il s'accorde, pour exprimer une qualité (qualificatif) ou un rapport (déterminatif)5...
De ce fait, les adjectifs possessifs, démonstratifs, indéfinis, numéraux, exclamatifs et interrogatifs sont déjà classés (Grevisse 1986: 525-527) parmi les déterminants étant donné qu'ils sont toujours antéposés. (Voir supra 1.1.1.).
Rappelons-nous que dans les syntagmes nominaux (où il existe une tête sémantique qui est le substantif) il n'y a pas que l'adjectif comme expansions subordonnées au substantif : en fait, nous y trouvons :
i) Un déterminant placé avant le substantif : l'article, l'interrogatif, l'indéfini, le démonstratif, etc. :
• Une femme, le livre → (*Femme une, *livre le).
• Quelle femme ? → (*Femme quelle).
• Quelques garçons → (*Garçons quelques).
• Ce jouet → (*Jouet ce), etc.
ii) Un syntagme nominal complément placé après le substantif :
• Les fenêtres de la classe. → (*de la classe les fenêtres).
• La Dame aux camélias. → (*Aux camélias la dame).
• Un café sans sucre. → (*sans sucre un café), etc.
iii) Une proposition conjonctive ou relative placée après le substantif :
• L'idée qu'il pourra réussir le consolait. (Conjonctive).
• La femme qui parlait était sa mère. (Relative).
iv) L'adjectif placé avant ou après le substantif :
• Un agréable séjour ↔ Un séjour agréable.
• Une pauvre fille ↔ Une fille pauvre.
• Un sale type ↔ Un type sale, etc.
Nous constatons donc qu'il y a bien une opposition de l'adjectif comme expansion à d'autres expansions.
1.2.2. Fonctions de l'adjectif
On reconnaît généralement deux fonctions à l'adjectif qualificatif : la fonction d'attribut et la fonction d'épithète. À ces deux fonctions, il est possible d'ajouter une troisième qui est celle d'apposition, appelée également "épithète détachée".
Ici, il convient, nous semble-t-il, de reprendre une définition que nous trouvons assez nette pour éclairer ce qu'est la fonction essentielle de l'adjectif :
L'adjectif est l'une des parties du discours qui sert à qualifier et à déterminer le
5 La définition est tirée du dictionnaire Le Nouveau Petit Robert (1994: 29).
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
142 Mehmet Ç�ÇEK
substantif (ou le pronom). En général il a pour rôle de dégager le substantif des limbes du général pour le camper sur le socle du particulier : possédant le double pouvoir d'individualisation, il caractérise à la fois l'objet décrit parce qu'il en signale un aspect significatif et l'écrivain [énonciateur (le sujet parlant)] parce qu'il nous renseigne sur sa vision. (BOILLOT 1952: 93).
1.2.2.1. L'adjectif en apposition
D'emblée, nous constatons une similarité entre la fonction d'apposition et la fonction d'attribut6 de l'adjectif (dans cette dernière, il existe un verbe qui intervient (voir infra) entre le substantif et l'adjectif) :
• La fille, pauvre et malheureuse, se sentait très perturbée.
�
• La fille, [qui est] pauvre et malheureuse, se sentait très perturbée.
Enfin, il faut noter qu'il ne s'agit pas d'une construction immédiate7 pour la fonction d'apposition ni pour celle d'attribut de l'adjectif.
Ici, considérons la fonction d'apposition8 au cas où celle-ci se présente sous la forme du type :
i) SN + virgule + adjectif 9+ virgule + expansion phrastique :
• Le maire, bien heureux, est parti en vacances.
ii) L'adjectif + virgule + SN + expansion phrastique :
• Furieuse contre son patron, la secrétaire a quitté le bureau.
Au vu des exemples, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une construction indirecte qui se traduit par l'existence d'une virgule à l'écrit et d'une pause (ou d'un accident intonatif) à l'oral.
Quant à quelques particularités de l'adjectif apposé; nous constatons que :
l'adjectif apposé est mobile :
• Content de son sort, Paul ne protesta pas.
• Paul ne protesta pas, content de son sort.
• Paul, content se son sort, ne protesta pas.10
il n'est pas possible de mettre un adjectif de relation en fonction d'apposition :
• *Musicale (de musique), la critique a fait l'objet de nombreuses discussions.
6 Il arrive parfois aux grammairiens de donner le nom "attribut implicite" à la fonction d'apposition de l'adjectif. Voir
(BÉCHADE 1986: 168). 7 La construction immédiate avec le substantif auquel l'adjectif est en rapport s'explique pour nous sous forme du type Dét. + Adj.
+ Subs. ou bien Dét. + Subs. + Adj. où ne doit figurer ni une virgule ni un verbe introductif. 8 En fait, la fonction d'apposition n'est pas d'ailleurs tout à fait réservée à l'adjectif. Par exemple, la même fonction peut être
accomplie par un nom : • Le préfet, un colosse, sortit de la voiture. Pour plus d'informations voir La Grammaire d'aujourd'hui (1986: 69).
Notons encore que l'adjectif construit en apposition peut, à la différence de l'adjectif épithète, qualifier la plupart des pronoms : pronom personnel : • Menteur, je me suis vanté de mes calomnies. [...]; formes composées du pronom démonstratif : • Celui-ci, travailleur, sera récompensé; pronom possessif : • Le mien, paresseux, sera puni. (Les exemples sont tirés de Larousse Grammaire du Français
contemporain 1988: 203). 9 L'adjectif en question peut admettre, bien entendu, les adverbes d'intensité tels que très, beaucoup etc., et un complément.
Quant au substantif qui lui sert de support, il peut se présenter également sous la forme d'un nom propre. 10 Les exemples sont ceux de D. MAINGUENEAU (1994: 80).
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
Preposing of Determiners and Preposed Epithet Adjectives in French: A Syntactic Similarity 143
1.2.2.2. L'adjectif attribut
Dans la Grammaire de l'Académie citée par J.BOUDREAU (1981: 159), l'attribut, en tant que fonction de l'adjectif, est défini comme ceci :
Attribut, il exprime la manière d'être d'un nom ou d'un pronom sujet ou complément, auquel il est joint par un verbe : La pièce était intéressante.
Il s'ensuit qu'il existe deux sortes d'attributs :
i) Attribut du sujet dans les exemples suivants :
• Ma sœur est laborieuse.
• Ma voisine est très pauvre.
Laborieuse et pauvre sont attributs d'un sujet avec lequel ils sont mis en rapport par l'intermédiaire du verbe être ou d'un verbe similaire (paraître, devenir, sembler) d'une part et représentent une qualité qui fait partie intégrante du sujet (Grevisse 1986: 346-348) d'autre part.
ii) Attribut du complément11 dans « Je trouve cette question épineuse ». Épineuse est alors attribut du complément d'objet direct.
A partir de la paraphrase possible12 pour ii), nous pouvons dire que l'attribut du sujet est plus central que celui du complément.
Enfin, l'adjectif attribut, à la différence de l'adjectif apposé, est toujours introduit par un verbe dit copule13 (tels que être, paraître, devenir, sembler, trouver, tomber etc.) et dont la place est fixe : toujours entre l'adjectif et le substantif (ou un élément équivalent) :
• Ma surprise fut grande.
• Grande fut ma surprise.
Cependant, il faut noter qu'un substantif14 peut également servir d'attribut aussi bien que l'adjectif :
• Son frère est médecin.
1.2.2.3. L'adjectif épithète
L'adjectif épithète, à la différence de l'adjectif en apposition et de l'adjectif attribut, mérite, bien entendu, une attention plus particulière : en fait, au sens strict du terme, il s'agit d'une unité purement qualifiante et d'une une unité qui peut faire corps avec son qualifié. Par conséquent, nous trouvons dans "Dictionnaire de Linguistique"15 :
On appelle épithète toute unité qui détermine sans mot de liaison un substantif ou un équivalent du substantif.
Selon cette définition; ce qui est important c'est que la détermination doit avoir lieu sans mot de liaison, alors qu'il ne s'agit pas, soit pour la fonction de l'adjectif en apposition soit pour celle de l'adjectif attribut, d'une détermination qui se réalisera ainsi : pour la première, comme nous l'avons déjà vu, on a
11 Pour d'autres aspects de l'adjectif attribut voir M. RIEGEL (1988: 69-87). 12 Je trouve cette question épineuse = Je trouve que cette question est épineuse. 13 On l'appelle aussi "verbe attributif" qui est le plus souvent le verbe "être". Enfin, ce dernier est le verbe copule par excellence.
Il est pur lien sans contenu sémantique, de là son omission facile que nous avons vue dans 1.2.2.1. supra. Voir aussi M. GREVISSE (1986: 356-359), op.cit. § 242.
14 Comme le substantif, un pronom (cf. Soyez moi), un infinitif (cf. Ne rien dire est peut-être tout dire), un adverbe employé adjectivement (cf. Mes principes étaient ainsi.) peuvent également servir d'attribut.
15 Larousse Dictionnaire de Linguistique et des sciences du langage (1994: 184), il est également possible d'y trouver une distinction sémantique faite sur les épithètes.
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
144 Mehmet Ç�ÇEK
besoin d'une virgule et pour la deuxième, d'un verbe dit copule.
Voyons dans le tableau ci-dessous la différence de fonctions de l'adjectif qualificatif "pauvre" :
Tableau -1-
La fonction d'Apposition La fonction d'Attribut La fonction d'Épithète
• Pauvre depuis longtemps, la fille détestait sa vie.
• La fille, pauvre depuis longtemps, détestait sa vie.
•La fille qui était pauvre depuis longtemps détestait sa vie. (La fille était pauvre depuis longtemps).
• La fille pauvre détestait sa vie.
• ?La pauvre fille détestait sa vie
Comme l'indique le tableau ci-dessus, nous avons une alternative pour la fonction d'épithète de l'adjectif : la pauvre fille vs la fille pauvre et on observe un changement de sens de l'adjectif. Par contre, comment expliquer la possibilité de bi-placement de l'adjectif "remarquable" dans l'exemple suivant où il ne s'agit pas d'un changement de sens comparable à celui de l'adjectif "pauvre" ?
• Pierre a préparé un remarquable exposé.
vs
• Pierre a préparé un exposé remarquable.
Nous lisons d'ailleurs chez WAGNER et PICHON (1962: 154) :
Dans bien des cas, l'antéposition ou la postposition d'un adjectif épithète n'ont pas de valeur particulière.
1.2.3. L'alternative de la place de l'adjectif épithète
La faculté qu'a le français d'antéposer ou de postposer l'adjectif épithète pose vraiment, semble-t-il, un problème qui est propre à cette langue. On a donc, ici, pour la place de l'adjectif épithète, une alternative que les autres expansions ne connaissent pas. (Voir supra 1.2.1.).
Du point de vue du placement et du sens, nous distinguons en gros quatre catégories d'adjectifs :
1) Les adjectifs placés ordinairement avant le substantif :
• Il a une petite voiture. • Le professeur avait un gros nez, etc.
2) Les adjectifs placés ordinairement après le substantif :
• Il a les cheveux bruns. • Un garçon français. • Un pays communiste. • Une rue étroite. • Vous aurez besoin d'un objet rond, etc.
3) Les adjectifs ayant un sens nettement différent selon qu'ils sont placés avant ou après le substantif :
• A-t-elle dit "un sale type" ou "un type sale" ? • Pauvre homme! Il n'espérait pas rencontrer un paysan pauvre. • C'est il y a un certain temps qu'il a eu un courage certain, etc.
4) Les adjectifs placés avant ou après le substantif sans différence de sens nette :
• Une affaire difficile / une difficile affaire. • Un délicieux repas / un repas délicieux. • Une paisible vie / une vie paisible, etc.
La question qui se pose évidemment est de savoir ce qu'est la place normale de l'adjectif épithète. Cette question en entraîne d'autres, par exemple, celles exprimées par P. WUNDERLI :
... Et si l'on arrive à fixer une certaine norme, est-elle valable pour tous les adjectifs, voire pour tous les substantifs par rapport à un adjectif donné ? Et s'il faut distinguer deux classes d'adjectifs différentes, une série qui tend vers l'antéposition et une série qui tend vers la postposition, comment peut-on justifier l'existence de ces deux comportements contradictoires ? Et même s'il y a vraiment deux classes d'adjectifs
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
Preposing of Determiners and Preposed Epithet Adjectives in French: A Syntactic Similarity 145
différentes, comment expliquer le fait que pour les deux classes, on est toujours de nouveau confronté avec des infractions à leur comportement "normal" ? Et finalement : que faire de ce groupe déroutant d'adjectifs qui changent de sens [...] selon la place qu'ils occupent ? ... (WUNDERLI 1987: 221).
La mobilité de l'adjectif épithète est constatée par la plupart des grammairiens.
Pour la plupart des adjectifs épithètes, on peut dire qu'en déplaçant l'adjectif on ne risque de ni changer complètement le sens de la phrase ni de la priver entièrement de sens16 :
• Le Président est conscient du fait qu'il faut mener une politique intelligente (ou une intelligente politique), en fait il est un politique habile (ou un habile politique).
Après tout, l'adjectif épithète peut se placer en français soit devant soit derrière le substantif qualifié. Mais alors, n'existe-t-il pas des facteurs qui poussent à antéposer ou à postposer un adjectif épithète? Bien entendu, notre réponse sera affirmative. Nous ne considérons aucun phénomène linguistique comme étant dépourvu de signification.
A ce propos, de nombreuses questions se posent :
S'il y a différence de forme (antéposition vs postposition), il semble qu'il doit y avoir différence de sens : cette différence est-elle nette ? Est-elle dans le système de la langue ou relève-t-elle seulement de choix individuels du sujet parlant (énonciateur) ?
Ici, il nous faut définir au préalable ce que nous entendons par le système de la langue et les choix individuels de l'énonciateur pour autant qu'ils sont concernés par la place de l'adjectif épithète.
Il ne s'agit du système de la langue qu'au niveau des syntagmes nominaux, qu'on pourrait appeler ici des fragments d'énoncés, c'est-à-dire des énoncés privés de contexte linguistique, mais aussi dépourvus de tout ancrage situationnel, et de fonction communicative. Donc, dans ce type de cas de figure, sans avoir besoin d'aucun contexte linguistique, le changement de sens de l'adjectif devrait être bien précis et net. Alors, tout francophone pourrait saisir sans grande difficulté le changement de sens de l'adjectif en question.
Nous appelons les adjectifs épithètes dont le sens propre change d'une manière précise et nette (selon la place qu'ils occupent) les adjectifs épithètes dont la différence de sens relève du système de la langue. De même, nous appelons les autres adjectifs épithètes, (c'est-à-dire, ceux dont le changement de place ne signifie qu'une faible nuance) les adjectifs épithètes dont la différence de positionnement relève de choix individuels de l'énonciateur.
Pour les adjectifs du premier groupe où il s'agit d'un syntagme nominal (constitué d'un déterminant et d'un substantif) et d'un adjectif épithète qui (les) accompagne, nous pouvons considérer le tableau suivant où figurent quelques adjectifs épithètes dont la différence de sens relève, d'après nous, du système de la langue :
Tableau -2-
ADJECTIFS ANTEPOSITION POSTPOSITION Brave Un brave homme Un homme brave Certain Une certaine idée Une idée certaine Cher Un cher dentiste Un dentiste cher Chic Un chic type Un type chic Curieux Un curieux bonhomme Un bonhomme curieux Fameux Un fameux gâteau Un gâteau fameux Fier Une fière allure Une allure fière Grand Un grand homme Un homme grand Gros Un gros commerçant Un commerçant gros Honnête Un honnête homme Un homme honnête
16 Nous sommes inspiré de HUTCHINSON J.H., (1969: 15).
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
146 Mehmet Ç�ÇEK
Jeune Une jeune fille Une fille jeune Joyeuse Une joyeuse assemblée Une assemblée joyeuse Maigre Un maigre repas Un repas maigre Mauvaise Une mauvaise personne Une personne mauvaise Moyen Le moyen âge L'âge moyen Net Une nette vision Une vision nette Nouveau Un nouveau vin Un vin nouveau Pauvre Une pauvre fille Une fille pauvre Riche Un riche homme Un homme riche Sacré Une sacrée histoire Une histoire sacrée Sale Un sale type Un type sale Seule Une seule femme Une femme seule Unique Un unique homme Un homme unique
Venons-en à quelques autres adjectifs dont le changement de place, d'une part, exprime une faible nuance (de sens) et d'autre part relève, à notre avis, de choix particuliers de l'énonciateur :
Tableau -3-
ADJECTIFS ANTEPOSITION POSTPOSITION Actuelle L'actuelle majorité La majorité actuelle Affreux Un affreux bonhomme Un bonhomme affreux Apparente Une apparente franchise Une franchise apparente Brillant Un brillant garçon Un garçon brillant Brusque Une brusque détonation Une détonation brusque Complète Une complète ignorance Une ignorance complète Court Un court passage Un passage court Dur Un dur travail Un travail dur Entière Une entière confiance Une confiance entière Étroit Un étroit passage Un passage étroit Faux Un faux personnage Un personnage faux Formidable Une formidable erreur Une erreur formidable Fragile Une fragile puissance Une puissance fragile Franche Une franche amitié Une amitié franche Généreuse Une généreuse idée Une idée généreuse Grave Une grave affaire Une affaire grave Juste Une juste cause Une cause juste Malheureuse Une malheureuse tentative Une tentative malheureuse Sérieux Un sérieux type Un type sérieux Sévère Un sévère homme Un homme sévère
Ici, nous nous sommes contentés d'établir les éléments préliminaires en ce qui concerne l'alternative de la place de l'adjectif épithète.
2. Les enjeux de l'antéposition de l’adjectif épithète
Avant toute chose, le fait que, pensons-nous, la postposition soit la place normale, attendue de l'adjectif épithète ne signifie pas que l'antéposition traduise toujours une place inattendue, anormale pour l'adjectif épithète. On peut dire quand même que c'est le cas pour tous les adjectifs épithètes qui, normalement, ne s'antéposent pas au substantif.
Il faut donc examiner à part les adjectifs épithètes dont la place normale est l'antéposition : il s'agit en fait des adjectifs assez cours (en générale monosyllabiques) et qu'on appelle courants tels que beau, bon, gros, mauvais, vieux, petit, grand, joli, vilain etc.
Pour l'instant, si l'on met à part ces adjectifs, il reste donc à expliquer le pourquoi de
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
Preposing of Determiners and Preposed Epithet Adjectives in French: A Syntactic Similarity 147
l'antéposition des adjectifs normalement postposés et de ceux qui sont indifférents à l'une ou l'autre place. Enfin, il faut noter que tous les linguistes et les grammairiens dont nous avons étudié les idées et les approches sont d'accord sur deux faits :
i) La postposition est presque toujours possible,
ii) Étant donné l'extrême régularité de la postposition, c'est l'antéposition qui mérite une attention plus particulière et qui exige donc une explication multiparamétrique. Pour la suite de notre travail, c'est ce deuxième volet qui constituera notre point de départ.
2.1. Le changement de sens de l'adjectif épithète
Il est manifeste que la place préférentiellement attestée des adjectifs épithètes qui sont susceptibles de changer de sens est l'antéposition.
En ce qui concerne le changement de sens en question, nous distinguons en gros trois cas de figures principaux :
i) Certains adjectifs n'ont pas le même sens selon le substantif qui les accompagne17. Ainsi, un ancien château (= quelque chose qui était autrefois un château et qui pourrait être maintenant autre chose) s'oppose à un ancien article (= qui est vieux).
À propos de cette opposition (un ancien château ≠ un château ancien versus un ancien article = un article ancien) on pourrait soutenir que c'est “la qualité d'objectivité du substantif” qui semble jouer un rôle : un château est un bâtiment que tout le monde peut voir en attribuant une date de construction; un article, quant à lui, —à moins d'être un très vieux document— ne peut être qualifié d'ancien que par quelqu'un qui possède des informations non directement visibles (par exemple, comme la date de la rédaction communiquée par l'auteur).
De même, un rire léger est différent (du point de vue du sens) d'un léger rire (respectivement ‘un rire très peu appuyé’ et ‘un rire bref’), alors qu'un chatouillement léger a la même signification qu'un léger chatouillement, étant donné qu'un chatouillement est toujours ressenti par quelqu'un de la même manière.
ii) Les adjectifs épithètes dont le sens relève du système de la langue. Il faut noter que pour un certain nombre d'adjectifs de ce type, il ne s'agit pas, en antéposition, d'un sens qui renvoie à celui du substantif morphologiquement associé :
— Une pauvre fille : *il s'agit de la pauvreté.
— Un sale type : *il s'agit de la saleté.
— Un certain monsieur : *il s'agit de la certitude.
iii) Les adjectifs épithètes dont le changement de place induit à notre avis un faible changement de sens du type "nuance énonciative", alors que beaucoup de grammairiens et de linguistes déclarent que leur position vis-à-vis du substantif qualifié est indifférente. En voici quelques exemples :
— la lettre précédente = la précédente lettre,
— un tas gros = un gros tas,
— une voix agréable = une agréable voix,
— un poids énorme = un énorme poids,
— de prisonniers nouveaux = de nouveaux prisonniers, etc.
17 Sur ce sujet, il ne nous a pas été possible de trouver des informations satisfaisantes. Pourtant, voici ce qu'en dit HUTCHINSON
(1969, p. 16) : « Il faut également cesser de considérer l'adjectif seul, hors de son contexte. Sa position dépend dans une certaine mesure du nom qu'il qualifie (...). Un adjectif peut très bien précéder un premier nom avec une valeur qu'il ne pourrait avoir devant un autre nom»; notons également que STORZ-HEBMANN (1995), au long de sa monographie, a essayé d'établir un certain nombre de rapports entre l'adjectif épithète et la nature du nom qualifié; ce qui reste en effet comme un autre travail à accomplir, et que nous ne nous proposons pas de faire ici.
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
148 Mehmet Ç�ÇEK
On voit qu'il ne s'agit pas, dans ce cas, d'un notable changement de sens. Citons à ce propos FORSGREN (1997: 120) :
Certains adjectifs ne semblent pas subir, avec changement de position, aucun changement de sens : magnifique, étonnant, étrange, important.
Ici, il nous semble nécessaire de souligner, comme le notent également à peu près tous les chercheurs, que la qualification apportée par l'antéposition est quelque chose de banal, d'attendu, et de traditionnel. Il faut également indiquer que l'adjectif, au sens figuré et affectif, se place devant le substantif et exprime un jugement subjectif. Au sens d’exister comme une unité complexe disponible, on peut même dire que la séquence ADJECTIF + SUBSTANTIF est en voie de lexicalisation, et cette lexicalisation pourrait permettre en fait une locution figée qu’on pourrait rapprocher d’ailleurs de la possibilité de placer les adjectifs épithètes devant les noms propres dans des exemples du type l’incorruptible Robespierre etc.
Il importe de ne pas perdre de vue que l'adjectif antéposé entre dans une intime union phonétique avec le substantif qu'il qualifie. Ainsi se constitue une nouvelle unité —parfois irréductible— qu'on pourrait appeler ici une tête sémantique complexe et que nous allons essayer de voir ci-dessous de plus près.
2.2. Une tête sémantique complexe
Pour l'adjectif antéposé, il faut surtout insister sur le fait qu'il s'agit, à quelques exceptions près, d'une intégration stricte au substantif qualifié dont on dit (MOLINIÉ 1986, pp. 63-64) que "la valeur de l'adjectif est ainsi avalée par le substantif".
En tout cas, le même adjectif peut se présenter de manière très différente suivant sa position.
Du point de vue phonétique, il est évident que l'adjectif antéposé entre dans "une intime union phonétique" (BARRI 1975: 209) avec son substantif. Et, il constitue en quelque sorte, avons-nous déjà signalé, une nouvelle unité. Donc, comme l'indique également H. BÉCHADE (1994: 239), des adjectifs placés avant le substantif font corps avec celui-ci. Ainsi, l'antéposition semble contribuer à amalgamer les deux termes, d'où en fait le jeu de liaison que nous trouvons dans ces exemples :
un grand _homme,
un ennuyeux _endroit,
un savant _amoureux,
un intelligent _enfant,
les belles _histoires plutôt que les histoires intéressantes.
En fait, reprenons ici la constatation de P. CAHNÉ (1972: 123) sur un savant anglais :
[...] la corrélation phonologique voyelle couverte voyelle nue oppose l'ordre substantif-adjectif à l'ordre adjectif-substantif. Nous prononçons en effet : œ savã ãgle’e si savant est pris comme substantif, et nous aurons deux accents d'intensité, et nous prononcerons œ savã tãgle si savant est pris comme adjectif, et il n'y aura alors qu'un seul accent tonique.
Phonétiquement parlant, il est possible de séparer le substantif de l’adjectif qui le suit et de placer deux accents dans un groupe comme un tableau magnifique,18 mais on ne pourra pas séparer l’adjectif du substantif qui le suit, et un groupe comme un magnifique tableau ne pourra porter qu’un accent sur le dernier mot; ce qui permet également des levées d’ambiguïté : par exemple, dans le groupe un savant anglais, selon que le substantif est savant ou anglais l’accent sur savant sera possible ou non. Donc, l'opposition phonétique entre l'ordre A+S et celui S+A montre qu'il faut surtout faire attention à la combinaison A+S qui représente alors une unité phonétique.
Tout comme P. CAHNÉ, il y a d'autres linguistes qui, notamment, attirent l'attention sur le fait
18 Les exemples sont ceux de GARDES-TAMINE (1990: 21).
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
Preposing of Determiners and Preposed Epithet Adjectives in French: A Syntactic Similarity 149
que l'adjectif antéposé constitue un tout avec le substantif. À notre avis, cette nouvelle unité déborde les limites de la phonétique.
Voici quelques citations qui semblent expliciter ce cas :
L'épicatathèse [l'antéposition], exprimant une qualité substantivale, combine le sémième de l'adjectif avec celui du substantif, pour former une nouvelle entité substantielle qui, quoique limité au reste de la période, prend en cette occasion une existence indépendante. [DAMOURETTE et PICHON cité par BARRI (1975: 209)].
Préposé, l'adjectif se trouve plus étroitement lié avec le substantif; il fait corps avant lui; on pourrait dire qu'il s'agit d'un concept nouveau, d'un tout. Nous disons donc une grande maison, ce qui ne veut pas seulement dire que la maison est grande, mais qui propose une idée nouvelle, du même ordre que le substantif diminutif une maisonnette. (HUTCHINSON 1969: 17).
(...) le qualificatif apparaît souvent attaché au substantif qu'il est appelé à qualifier comme par destination; il constitue avec lui une locution qu'on n'analyse pas19 (de bons offices, de libres propos, une grave erreur, un franc parler ...). (MAROUZEAU 1953: 242) :
Il ressort de toutes ces citations que, puisqu'il s'agit, pour l'antéposition, d'une qualité substantivale visant un concept nouveau20 et donc qu'on n'analyse pas, nous nous trouvons alors dans le cadre syntaxico-sémantique d'une toute nouvelle entité du même ordre que les unités lexicales ayant un trait d'union du type un timbre-poste, un peut-être, un après-midi, un laissez-passer, un petit-déjeuner ou le Moyen-Âge etc.
On sait qu'il est impossible d'analyser par décomposition les exemples du type esquissé ci-dessus, ce qui est justement le cas, semble-t-il, pour un certains nombres de constructions du type A+S :
Un ancien château ≠ un château qui est ancien21.
Un grand fumeur ≠ un fumeur qui est grand.
Une pauvre fille ≠ une fille qui est pauvre.
Un sale type ≠ un type qui est sale.
Un gros mangeur ≠ un mangeur qui est gros.
Ici, il semble qu'il s'agit d'un nouveau concept qui est catégorisé de manière irréductible comme ‘ancien château’, ‘grand fumeur’, ‘pauvre fille’, ‘sale type’, et ‘gros mangeur’ (alors que, notons-le, pour gros et grand l'antéposition est la règle!). On peut dire donc que nous sommes vis-à-vis de deux mots qui s'appellent l'un l'autre.
Ce qu'on vient de voir nous invite presque à mettre un trait d'union entre les deux constituants lexicaux du syntagme construit sur la base de ce type d'antéposition.
D'ailleurs, nous voyons l'antéposition représenter une certaine homogénéité :
En cas d'antéposition, en effet, l'homogénéité se traduit par le fait que rien ne s'interpose entre déterminatif et nom : celui-ci et celui-là absorbent tout ce qui s'introduit entre eux (...) FAUCHER (1971: 126).
Or, dès qu'on va un peu plus loin, on constate que l'antéposition contribue à amalgamer les deux termes : la récurrence de la collocation (les deux mots l'un s'appelant l'autre) nous fait venir à l'esprit des exemples où il existe une soudure complète entre l'adjectif et le substantif (cf. bonhomme, vraisemblance etc.).
19 C'est nous qui soulignons. 20 On peut repenser ici à l'observation de HUTCHINSON (Ibid.) : une 'grande maison' rapproché de 'une maisonnette'. 21 Notons au passage que contrairement à l'antéposition, la postposition peut accepter la décomposition par une relative : un
château ancien = un château qui est ancien; par contre un ancien château signifie quelque chose qui n’est plus actuellement château.
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
150 Mehmet Ç�ÇEK
Il faut noter également que "les noms de parenté" lorsqu'ils mentionnent un adjectif l'antéposent toujours (cf. petit-fils, belle-fille, petit neveu, beau-père, belle-mère, grand-père etc.). Nous constatons d'emblée qu'il s'agit pour ces adjectifs et leurs semblables des marques de qualités particulièrement inséparables dans des indications substantivales. En fait, un petit neveu n'est pas un neveu qui est petit, et de même ma belle-sœur ne signifie pas que ma sœur est belle (ou jolie). Pour les noms de parenté construits avec des adjectifs, citons la constatation de WAGNER et PINCHON (1962: 152) :
On peut considérer que dans ces syntagmes l'adjectif et le substantif constituent presque un nom composé. L'adjectif y a perdu son autonomie; il ne peut pas porter d'accent d'insistance.
Pour les auteurs, les syntagmes en question ne sont que des noms composés. Par conséquent, si l'on admet a priori que le couple adjectif + substantif fonctionne à peu près comme un unique substantif, la reprise pronominale pourra alors être éclairante, car on sait que le pronom prend sens dans son rapport au verbe (ou plus généralement au prédicat constitué autour du verbe) qui le régit.
Prenons d'abord des exemples où sont utilisés les adjectifs épithètes en postposition et essayons de séparer la qualification de la substance :
Marie est une fille pauvre = C'est une fille pauvre :
→ C'est une fille et elle est pauvre.
Ce monument est un château ancien = C'est un château ancien :
→ C'est un château et il est ancien.
On constate qu'il peut être possible de considérer le substantif et l'adjectif épithète comme deux entités différentes qui, à l'aide d'une reprise pronominale, peuvent se séparer l'une de l'autre.
Alors que dans le cas inverse, à savoir celui où sont employés les adjectifs épithètes en antéposition, nous observons un résultat tout à fait différent :
Cet homme est un grand fumeur = C'est un grand fumeur :
→ * C'est un fumeur et il est grand.
Marie est une pauvre fille = C'est une pauvre fille :
→ *C'est une fille et elle est pauvre.
Pierre est un sale type = C'est un sale type :
→ *C'est un type et il est sale.
Cet enfant est un gros mangeur = C'est un gros mangeur :
→ * C'est un mangeur et il est gros.
Ce monument est un ancien château = C'est un ancien château :
→ * C'est un château et il est ancien.
On voit donc qu'il n'est pas possible de dissocier les syntagmes ci-dessus. Or, d'après la définition de l'épithète qualificative, celle-ci était une qualification qu'on peut ajouter au substantif et qui puisse donc s'en séparer sans problème, mais ce qui, comme le montrent les reprises pronominales ci-dessus, n'est toujours pas le cas. Alors, nous pensons qu'ici on ne pourrait même pas parler d'une qualification proprement adjectivale puisqu'il ne s'agit pas d'un rapport respectif de composition et de décomposition entre l'adjectif et le substantif. Le couple adjectif + substantif fonctionne à peu près comme un substantif et qu'en cas de reprise par un pronom on reprend l'ensemble.
Nous constatons entre autres que dans le cas d'antéposition, l'effacement de l'adjectif pourrait poser problème, à savoir qu'on perdra une information liée à la substance du substantif. Ainsi, à propos d'une rue étroite (postposition), on peut dire qu'il s'agit d'une rue; qu'elle soit étroite ou large, elle est encore et toujours une rue; alors que pour un ancien château (antéposition) on ne peut pas dire; qu'il soit ancien ou restauré, qu'il est encore et toujours un château.
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
Preposing of Determiners and Preposed Epithet Adjectives in French: A Syntactic Similarity 151
Nous voulons donner les syntagmes suivants que nous reprenons à notre corpus et qui ont, plus ou moins, les mêmes caractéristiques que les exemples cités-ci dessus :
— Une bonne âme,
— Un bon moment,
— Le petit doigt,
— Le grand jeu,
— Le bon sens,
— Une simple question,
— Un vrai visage,
— Un grand ennemi,
— Deux bonnes minutes.
Pour finir, notons qu'il paraît que presque tous les adjectifs peuvent s'antéposer au substantif, puisque l'énonciateur peut toujours modaliser son énoncé, et le modifier pour introduire une nuance de sens qui ne dépend que de lui :
(...) tout en refusant d'accepter l'idée de place fixe, nous [admettons] que, pour n'importe quel adjectif, la place est libre (...) (HUTCHINSON 1969: 15).
En principe, n'importe quel adjectif peut —sous des conditions à définir— être antéposé. (WUNDERLI 1987: 224).
Ce qui, déjà, semble constituer une certaine réponse à la question formulée par STORZ-HEBMANN (1995) :
La place est-elle indifférente, pas vraiment indifférente, ou alors comme le soutiennent Damourette et J.Pichon (1911-1930), tous les adjectifs peuvent-ils être préposés"? (souligné par nous).
Nous adopterons sur ce sujet le point de vue de SUTTER (1988: 43) : « le choix ou de préposition ou de postposition est entièrement libre dans le sens où l'auteur décide librement laquelle des deux attitudes mentales possibles ».
CONCLUSION
En ce qui concerne les adjectifs épithètes, on peut dire que la postposition est toujours considérée comme une place normale du fait qu'il s'agit effectivement de qualifier un substantif par un adjectif : la place est « normale » car elle est celle des autres expansions du syntagme nominal (cf. la voiture rouge, la voiture du doyen ou la voiture qui pétarade etc.).
Partant de l'idée que, dans le cas de postposition, on pose d'abord le substantif pour lui attribuer une qualité par la mention d’un adjectif, nous avons essayé de montrer l'indépendance de l'adjectif — considéré comme un corps étranger — après le substantif et la possibilité d'étudier, dans ce cas, le syntagme par décomposition. C’est cela qui nous a conduit à utiliser le fait que l'adjectif postposé fonctionne, en première approximation comme les relatives et les compléments du nom qui suivent le substantif (cf. une fille pauvre → une fille [qui est] pauvre).
En fait, la postposition de l'adjectif épithète ne demande aucune explication spéciale. Soit les enchaînements textuels suivants :
— « Un ancien château, devenu une ferme, a brûlé. On a pu sauver tout le bétail et le matériel agricole »,
ou bien;
— « Un ancien château a brûlé. On a pu sauver le mobilier et les collections entreposés dans les appartements ».
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
152 Mehmet Ç�ÇEK
Alors qu'on n'a pas la même double acceptabilité pour les enchaînements du type :
— «*Un château ancien, devenu une ferme, a brûlé. On a pu sauver tout le bétail et le matériel agricole »,
ou bien;
— « Un château ancien a brûlé. On a pu sauver le mobilier et les collections entreposés dans les appartements ».
Or, nous avons constaté qu'il n'est pas possible, pour certains cas d'antéposition, de détacher les indications qualificatives de l'objet. Elles s'amalgament d'ailleurs à l'objet désigné par le substantif, « le pénètrent ». On pourrait presque dire que, dans ce cas, des fragments de l'objet ont encore la propriété ; les morceaux d'une luxueuse voiture, par exemple, seraient chacun pour eux-mêmes luxueux. Il n’est pas indifférent de se rappeler ici que c'est l'antéposition qui permet une liaison phonique entre l'adjectif et le substantif (cf. un intelligent_enfant, un savant_amoureux etc.).
Finalement, nous pouvons dire que les adjectifs antéposés se comportent en première analyse comme des déterminants introducteurs, à tel point qu'il semble qu'il est possible de les rapprocher des déterminants que nous trouvons dans les syntagmes du type "un deuxième projet", "ces trois voitures" etc. Il semble qu’il reste donc à savoir ce qu'apporterait sémantiquement l'adjectif antéposé qui se rapproche syntaxiquement des déterminants.
BIBLIOGRAPHIE
BARRI N., (1975), "Adjectifs antéposés et adjectifs postposés comme signes linguistiques différents" dans Folia Linguistica, VII, 3/4, pp. 209-220.
BÉCHADE H.-D., (1986), Syntaxe du français moderne et contemporain, PUF, 332 p., Paris.
BOILLOT F., (1952), "Du rôle de l'adjectif en français" dans Le Français moderne, pp.93-100, 188-200, 267-265.
BOUDREAU J., (1981), "La définition des fonctions apposition et épithète en grammaire traditionnelle" dans Langues et Linguistique Sainte Foy No : 7, pp. 157-181.
CAHNÉ P., (1972), "Place, valeur et adverbialisation de l'adjectif" dans Revue des Langues romanes, 80, pp. 117-128.
Ç�ÇEK M., (1995), "Reprises définies et Reprises démonstratives", mémoire de DEA sciences du langage, Université de Reims.
DAMOURETTE, J., et EDOUARD P., (1911-1950), Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française. II tomes, Paris.
Dictionnaire Le Nouveau Petit Robert (1994), Paris.
DUCROT Oswalt & TODOROV Tzvetan, (1972), Dictionnaire Encyclopédique de Sciences du Langage, Editions du. Seuil, 468 s., Paris.
FAUCHER E., (1971), "La place de l'adjectif, critique de la notion d'épithète", dans Le Français Moderne No : 39, pp. 103-118.
FORSGREN M., (1997), "Un classique revisité : la place de l'adjectif épithète", dans Etudes linguistique française, médiévale et générale offertes à Robert Martin à l'occasion de ses 60 ans; G. Kleiber & M. Riegel (Eds.), DUCULOT (Champs linguistiques) LOUVAIS-LA-NEUVE, pp. 115-126).
GREVISSE M., (1986), Le Bon Usage, XIIe édition, Duculot, Paris.
HUTCHINSON J. A., (1969), "Le désordre des mots, la place de l'adjectif" dans Le français dans le monde No : 62, pp. 15-23.
MAROUZEAU J., (1953), "Encore la place de l'adjectif" dans Le Français moderne, pp. 241-243.
MOLINIÉ G. (1986), Éléments de stylistique française, (linguistique nouvelle), PUF, Paris.
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
Preposing of Determiners and Preposed Epithet Adjectives in French: A Syntactic Similarity 153
PINCHON J., (1980), "Syntagme prépositionnel et adjectif de relation", dans Cahiers de Lexicologie, VOL : 37.
STORZ-HEBMANN F., (1995), "L'antéposition et la postposition des adjectifs 'ancien', 'simple', 'pur', et 'sacré' dans La Recherche du Temps perdu de Marcel Proust", These du troisième cycle soutenue à Paris le 26 Janvier 1995.
SUTTER M. DE, (1988), "Vers un traitement unifié de l'ordre relatif et absolu des mots dans la phrase nominale française" dans Travaux de Linguistique No : 16, Duculot, pp. 27-55.
WAGNER R. L. et PINCHON J., (1962), Grammaire du français classique et moderne, Hachette.
WUNDERLI P., (1987), "La place de l'adjectif : norme et infraction à la norme" dans Travaux de Linguistique, pp. 221-235, No : 14-15, Belgique.
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
CONTENTS
Major Challenges to the Effective Management of Human Resource Training and Development Activities
Haslinda ABDULLAH
11-25
Desirability and Existence of HRD Structure in Malaysian Manufacturing Firms
Haslinda ABDULLAH
26-35
Embracing Prejudices in Cultural Fieldwork: A Gadamerian Approach
Che Mahzan AHMAD
36-41
Constructing “Multiple” Conceptions of Blackness: A Case Study of How African American Students Contest Identity at a Predominantly White Liberal Arts College in the United States
Diana ARIZA - Len BERKEY
42-59
Background of Malaysian Private Institutions of Higher Learning and Challenges Faced by Academics
L. AROKIASAMY – M. ISMAIL – A. AHMAD – J. OTHMAN
60-67
Yabancı Dil Ö�retiminde Otonom Ö�renme: Neden ve Nasıl?
Cihan AYDO�DU
68-74
Urban Transformation in Slum Districts through Public Space Generation and Cable Transportation at Northeastern Area: Medellin, Colombia
Carolina BLANCO - Hidetsugu KOBAYASHI
75-89
Antropolojik Karar Kav�a�ında Haysiyet, Haklar ve Hukuk Felsefesi
Winfried BRUGGER – (Çev. : Muhammed �kbal �MAMO�LU)
90-108
1642 Tarihli Avarız Defterine Göre �spir Sanca�ı
�brahim Etem ÇAKIR
109-122
Saklı Kalmı� Kültürel Bir Mirasın Co�rafyası: Batı Anadolu’da Deve Güre�leri
Vedat ÇALI�KAN
123-137
Preposing of Determiners and Preposed Epithet Adjectives in French: A Syntactic Similarity
Mehmet Ç�ÇEK
138-153
Görme Engelli Ö�rencilerin Çe�itli De�i�kenler Açısından Ö�renme Sitilleri Üzerine Bir Ara�tırma
Tazegül DEM�R - Ülker �EN
154-161
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında “Resim” ve “Mimarî”
Ertan ENG�N
162-168
Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-ı Canik (1837)
M. Yavuz ERLER
169-190
Greek Teacher’s Perceptions about “Efficient” and “Non-Efficient” Students Development of an Attribution Questionnaire for Teachers in the North Aegean Region
Panagiotis GIAVRIMIS - Efstratios PAPANIS
191-199
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
Karamanlıcada i/e Meselesi
Hayrullah KAHYA - Mustafa KILIÇARSLAN
200-211
Ya�ayan Eski Türk �nançları �tibariyle “Türk Mitolojisi” ve Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL
Ya�ar KALAFAT
212-220
Dini ve Psikolojik Açıdan Ba�ı�layıcılı�ın Terapötik De�eri
Elif KARA
221-229
Anne-Babaların Kız ve Erkek Çocuklarına Uyguladıkları Psikolojik Saldırganlık Davranı�ları
Hülya KARTAL - Asude B�LG�N
230-241
Teachers’ Perceptions on Corporal Punishment as a Method of Discipline in Elementary Schools
Songül K�L�MC�
242-251
Küresel Bir �irketin Üst Düzey Yöneticileri ile Türkiye’de �� Yapmayı Tercih Etme ve Etmeme Nedenlerini Ortaya Çıkarmaya Yönelik Bir Görü�me
Hamide KOCADORU
252-258
E. Kolduell ve A. Malts’ın Sanatkarlık Özellikleri
Kuliyeva Ceyran MANAFKIZI
259-264
Human Capital Development and Its Impact on Firm Performance: Evidence from Developmental Economics
M. MARIMUTHU – L. AROKIASAMY – M. ISMAIL
265-272
Can Demographic Diversity in Top Management Team Contribute for Greater Financial Performance? An Empirical Discussion
M. MARIMUTHU – I. KOLANDAISAMY
273-286
Improving Pupils Quality Throuh Community Advocacy: The Role of School-based Management Committee (SMBC)
J. Adebayo OGUNDELE - Modupe A. ADELABU
287-295
Teacher Education Curriculum in Nigeria in the Perspective of Lifelong Education
S. N. OSUJI
296-301
Toplumsal Cinsiyet ve �ktidar: Güneydo�u Anadolu Bölgesi’nin Toplumsal Cinsiyet Düzeni
�evket ÖKTEN
302-312
Parent-Young Adult Conflict: A Measurement on Frequency and Intensity of Conflict Issues
Emine ÖZMETE - Ay�e Sezen BAYO�LU
313-322
Çok Partili Hayata Geçi� Sürecinde Kır�ehir (3)
Ya�ar ÖZÜÇET�N
323-339
Exploring the Entrepreneurial Mindset of Students: Implication for Improvement of Entrepreneurial Learning at University
Z. A. Lope PIHIE – A. S. A. SANI
340-345
18. Yüzyıl Dîvân �airi Hâkim’in �iirlerinde Maddî Kültür ve Sosyal Ya�amdan �zler
Yakup POYRAZ
346-374
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009
A Conversation Analytical Study of Telephone Conversation Openings of Iranian Speakers
Mohsen REZAZADEH
375-384
Popüler Müzik ve Müzik E�itimi
Mümtaz Hakan SAKAR
385-393
Ethnic Heterogeneity in the Malaysian Economy: A Special Reference to the Ethnic Group Participation in Financial Planning Activities
Z. SHAFII – N. Z. ABIDDIN – A. R. AHMAD
394-401
Cumhuriyetin Kurulu�undan Günümüze Türkiye’de Hayat Bilgisi Dersi Programlarının Geli�imi
Mustafa �AH�N
402-410
The Importance of Cultural Competency for Agricultural Extension Worker in Malaysia
Neda TIRAIEYARI
411-421
Metinlerin Tutarlılık Özelliklerine �li�kin Olarak Ö�rencilere Geri Bildirim Sunmada ��birli�i �lkelerinin Kullanımı
Hakan ÜLPER
422-429
Tokat �ehrinde Mala Kar�ı Suçlar
Alper UZUN - Alpaslan AL�A�AO�LU
430-444
Milli Mücadele Dönemi Do�u Cephesi’nde Kurulan E�itim Kurumlarında Uygulanan Beden E�itimi ve Spor Faaliyetleri
Mustafa YILDIZ - Bayram Ali S�VAZ - Murat TEK�N
445-451
Satılık Havalar: Batı Türkiye Roman Topluluklarında Bir Müziksel Zanaatkârlık Biçimi Olarak “Çalgıcılık”
�brahim Yavuz YÜKSELS�N
452-463
Book Reviews:
DO�AN GÜNAY, SÖZCÜKB�L�ME G�R��”, (Multilingual Yayınları, �stanbul, 2007, 311 s.,)
Talip DO�AN
464-465
BEK�R ���MAN, "AVRASYA KÜLTÜR TAR�H�NE �L��K�N ÖZGÜN B�R KAYNAK: CENG�ZNAME (HAZA KISSA-� Ç�NG�Z HAN)" (Etüt Yayınları, Samsun, 2009 ISBN: 978-975-8217-86-1, 200 s.)
M. Yavuz ERLER
465-468
SAL�M RAZI, “OKUMA BECER�S� Ö�RET�M� VE DE�ERLEND�R�LMES�” (Kriter Yayınları, �stanbul, 2008, 196 s.)
Özlem GENCER
469-471
AYSU ATA, “PROF. DR. SAADET ÇA�ATAY’IN YAYINLANMI� TÜM MAKALELER� C.1, C.2” (Ayaz Tahir Türkistan �dil Ural Vakfı Yayınları, Ankara 2008.)
Pınar VURSUN - �ahabettin GED�K
472-478