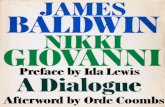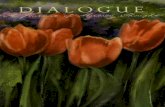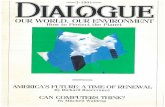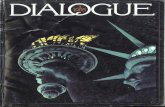La version arménienne du Dialogue d'Athanase et Zachée
Transcript of La version arménienne du Dialogue d'Athanase et Zachée
LA VERSION ARMÉNIENNE DU DIALOGUE D'ATHANASE ETZACHÉE
DU PSEUDO-ATHANASE D'ALEXANDRIE.ANALYSE LINGUISTIQUE ET COMPARAISON
AVEC L'ORIGINAL GREC*
1. Le Dialogue d'Athanase et Zachée
L'importance accordée par les Arméniens aux œuvres d'Athanased'Alexandrie est bien connue, surtout depuis les études de R.W. Thom-son et de R.P. Casey1. Plusieurs traités authentiques ou pseudo-épigraphi-ques de ce grand défenseur de l'orthodoxie nicéenne ont été traduits en ar-ménien à des époques différentes2. Parmi ces traductions, il faut compterégalement la version arménienne du Dialogue d'Athanase et Zachée (AZ).
Cette œuvre appartient au genre classique de la controverse doctrinaleexposée sous forme de dialogue. Elle suit donc un modèle littéraire quifut utilisé aux IIe et IIIe siècles déjà par l'apologétique anti-juive et anti-païenne et qui connut un développement important au IVe siècle, époqueà laquelle il prit des formes différentes: la controverse dogmatique, sou-vent polémique (altercatio), utilisée surtout dans le débat anti-arien; ledialogue philosophique, adopté par exemple par Augustin; le dialoguedidactique, articulé sous forme de quaestiones et responsiones. Dans AZ,en utilisant l'arme des citations bibliques, le chrétien Athanase répondaux questions et aux attaques du juif Zachée au sujet de l'Incarnation etde la divinité du Fils et conduit progressivement son adversaire à accep-
* Une première version, réduite, de cette contribution a été présentée au Colloque in-ternational de l'Association Internationale des Études Arméniennes «Classical Culture inthe Oriental Languages: Text and Transmission», qui a eu lieu auprès du NetherlandsInstitute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), à Wassenaar(Pays-Bas), du 13 au 16 mai 1998.
1 Pour une bibliographie sur les traductions arméniennes des œuvres d'Athanase, cfrR.W. THOMSON, A Bibliography of Classical Armenian Literature to 1500 AD, Turnhout,1995, p. 36 s.
2 Pour une liste des œuvres d'Athanase traduites en arménien, cfr G. ZARBHANALIAN,Matenadaran haykakan ¯argmanou¯eanw naxneaw (dar D-JG), Venise, 1889,p. 278-288 (désormais ZARBHANALIAN 1889) et A.S. ANASYAN, Haykakan Mate-
nagitou¯youn, vol. 1, Erevan, 1959, col. 321-368 (désormais ANASYAN 1959). Sur l'his-toire de la formation des corpora d'Athanase en arménien, cfr R.P. CASEY, ArmenianManuscripts of St. Athanasius of Alexandria, dans Harvard Theological Review, 24(1931), p. 43-59 et notamment p. 58 s. (désormais CASEY 1931).
126 V. CALZOLARI
ter ses arguments. À la fin du texte arménien, dans un extrait absent engrec, Zachée reconnaît que Jésus était bien le Messie attendu par lesJuifs et que, en le crucifiant, ceux-ci ont détruit leur propre espérance.Après avoir ainsi reconnu l'impiété de ses ancêtres3, Zachée demande àAthanase le moyen d'atteindre le salut. Athanase lui répond en l'exhor-tant à se repentir et à recevoir le baptême; il cite ensuite — il s'agit desderniers mots du texte arménien — le Ps. 32, 1: «Bienheureux ceuxdont les iniquités ont été remises et les péchés cachés». Le texte grec,quant à lui, se termine par une discussion sur le sacrifice des animaux:après avoir souligné que les sacrifices sanglants, qui étaient pratiquésauparavant, ont cessé avec la venue du Christ, signifiant par cela le dé-but d'une ère nouvelle, Athanase cite le Ps. 50, 13-14: «Je ne mange pasla viande des taureaux, ni je ne bois le sang des boucs. Offre à Dieu lalouange comme sacrifice!». Cette citation constitue le dernier passaged'AZ grec tel que nous le connaissons. Cet échange de répliques sur lessacrifices a également été traduit en arménien; dans le texte arménien, ilprécède l'extrait de la conversion de Zachée absent du grec.
Il est difficile de préciser quelle était la fin du texte original. Si la con-clusion abrupte du texte grec laisse supposer qu'il a été mutilé, on pour-rait en revanche soupçonner le passage supplémentaire de l'arméniend'être une adjonction de la part du traducteur (ou du copiste de son mo-dèle grec) visant à souligner plus nettement la victoire remportée par lehéros de ce traité chrétien sur son adversaire juif. Toutefois, après la dis-cussion sur les sacrifices et avant l'extrait sur la conversion de Zachéerésumés plus haut, on peut remarquer que le texte arménien atteste éga-lement d'autres citations bibliques, absentes du grec et ayant pour sujetune fois encore le sacrifice (Ps. 141, 2) et la nouvelle alliance établieentre Dieu et son peuple (Ier. 31, 31-33). Ces citations s'ajoutent ainsiau Ps. 50, 13-14, conservé en grec et en arménien. Si l'ajout de l'ac-quiescement final de Zachée en arménien pourrait dénoncer une inter-vention sur le texte dictée par des raisons doctrinales, l'adjonction de cescitations supplémentaires paraît en revanche moins justifiable. Cela iraitpar ailleurs à l'encontre de l'usus vertendi du traducteur arménien d'AZ,qui ne manifeste pas de tendances à multiplier ni à allonger les citationsde la Bible. Il est impossible de trancher ici la question. Pour exclure ouau contraire prouver l'origine primitive de la section finale du texte ar-ménien (entière ou partielle), il faudrait l'étudier dans le cadre plus gé-néral du genre polémique anti-juif et de ses topoi littéraires. Il faudraitégalement vérifier sa cohérence et son homogénéité, du point de vue de
3 Cfr Hauanewouwer zis amenayn ouste≤, e¯è har≤n mer ampar˙tewan
z≥ristos xacelovn «à partir de tout cela, tu m'as persuadé que nos pères commirentune impiété en crucifiant le Christ».
VERSION ARMÉNIENNE DU DIALOGUE D'ATHANASE ET ZACHÉE 127
la langue, du style et du contenu, par rapport au reste de l'œuvre. Cetteenquête pourra être menée d'une manière plus solide, lorsque l'on auraexaminé les caractéristiques linguistiques et la technique de traduction dutexte arménien d'AZ, ainsi que la valeur du témoignage de la version ar-ménienne pour la restitution de l'original grec. Le but de cette étude estprécisément de fournir quelques jalons pour cette investigation en repé-rant quelques paramètres qui pourront permettre d'évaluer la nature (pri-mitive ou secondaire) non seulement du passage final de la version armé-nienne, mais aussi d'autres extraits conservés uniquement en arménien.
Après une analyse linguistique, qui se propose entre autres d'établirdes critères utiles pour déterminer l'époque de traduction du traité, j'exa-minerai dans la deuxième partie de l'article deux passages attestés seule-ment en arménien qui remontent vraisemblablement au texte primitif.Mais, tout d'abord, quelques mots sur la tradition manuscrite et les édi-tions du texte grec et de sa version arménienne.
Le texte grec d'AZ
L'editio princeps du texte grec d'AZ a été publiée en 1898 par F.C.Conybeare, sur la base d'un manuscrit de la Bibliothèque Nationale deVienne (codex theol. gr. 307 du XIIIe s.)4. Il est intéressant de savoir que,en vue de l'établissement du texte grec, Conybeare avait également col-lationné l'édition de la version arménienne qui était, à l'époque, en coursde publication chez les Mékhitaristes de Venise (voir infra). L'édition deConybeare demeure jusqu'à présent la seule accessible. Une nouvelleédition critique est actuellement préparée par P. Andrist (Université deGenève) dans le cadre de son travail de dissertation de doctorat; l'édi-tion d'Andrist sera basée sur le manuscrit de Vienne ainsi que sur troisnouveaux témoins grecs5.
Le texte arménien d'AZ
Le texte arménien d'AZ a été édité dans le recueil des œuvres d'Atha-nase publié par le Père E. Tayec‘i à Venise en 18996, sur la base de deuxmanuscrits de la Bibliothèque de Saint-Lazare:
4 Cfr F.C. CONYBEARE, The Dialogues of Athanasius and Zacchaeus and Timothy andAquila, dans Anecdota Oxoniensia. Classical Series, Part VIII, Oxford, 1898 (désormaisCONYBEARE 1898).
5 Je tiens ici à remercier M. Andrist qui m'a laissée prendre connaissance de cette édi-tion en cours et encore inédite.
6 Cfr E. TAYEC‘I, S. A¯anasi A¬e≤sandrioy Hayrapeti. ©a®≤, ¯ou¬¯≤ eu
∂nddimaswou¯iun≤, Venise, 1899, p. 191-234 (désormais TAYEC‘I 1899). La publicationde ce recueil fut rendue possible grâce à l'aide financière accordée par Conybeare, quiétait tout particulièrement intéressé au texte d'AZ (cfr CONYBEARE 1898, p. X).
128 V. CALZOLARI
V 818, Corpus Athanasianum (copié par Nerses de Lambron, XIIe s.),fol. 30r-37r (incomplet au début)7;
V 218 (ex 739), car¢ntir no 19 (XIXe siècle), fol. 250r-262v, copie du ma-nuscrit 2679 d'Erevan (voir infra).
Le ms. 818 a été utilisé comme manuscrit de base pour l'édition dutexte, le ms. 218 comme manuscrit auxiliaire pour combler les lacunesdu ms. 8188. Ces lacunes correspondent aux p. 191, l. 1-200, l. 6 etp. 230, l. 24-233, l. 13 de l'édition de Tayec‘i. Par ailleurs, les variantesdu manuscrit auxiliaire ont été signalées dans les notes en bas de page et,parfois, introduites dans le texte.
À cette liste il est désormais possible d'ajouter cinq nouveaux té-moins:
J 3494, Corpus Athanasianum (an 1816), no 13, fol. 253r-297v9;
W 629, Corpus Athanasianum (XIXe s.), no 12, fol. 131v-154v10. Ces deuxtémoins de Jérusalem et de Vienne sont des copies d'un même manuscritarménien d'Isfahan de l'an 1726, comme l'indique, pour chacun desmanuscrits, le colophon final, identique dans les deux cas11.
M 2679, zo¥ovacu (an 981)12, no 71, fol. 126v-145r13;
M 6228, zo¥ovacu (XIXe siècle), fol. 124r-135r (copie de M 2679);
M 3506, zo¥ovacu (an 1615, 1697), fol. 18v-22v (incomplet à la fin)14.
Le texte du ms. 3506 s'arrête brusquement à l'endroit qui correspond àla p. 200, l. 3 de l'édition de Tayec‘i, c'est-à-dire en correspondanced'une partie du texte arménien où l'édition témoigne d'une omission parrapport au grec15; dans le folio suivant (fol. 23r) est conservé un textedifférent, acéphale. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que lapartie du texte conservée dans le ms. 3506 correspond, à quelques lignes
7 V = Bibliothèque des Mékhitaristes de Venise, Monastère de Saint-Lazare.8 Cfr TAYEC‘I 1899, p. IX s. de l'introduction.9 J = Patriarcat arménien de Jérusalem, Monastère de Saint-Jacques.10 W = Bibliothèque des Mékhitaristes de Vienne. Manuscrit signalé dans CASEY
1931, p. 47.11 Transcrit dans H. OSKIAN, Katalog der armenischen Handschriften in der
Mechitharisten-Bibliothek zu Wien, vol. 2, Vienne, 1963, p. 113 et dans N. BOGHARIAN,Grand Catalogue of St. James Manuscripts, vol. 10, Jérusalem, 1990, p. 463 s.
12 Cfr A Book of Knowledge and Belief by the Priest David, fac-similé par A. MAT‘E-
VOSSYAN, Erevan, 1995.13 M = Matenadaran (Bibliothèque et Institut des manuscrits anciens) d'Erevan.14 Les manuscrits M 6228 et M 3506 ont été signalés dans ANASYAN 1959, col. 346.15 Cfr CONYBEARE 1898, p. 20, l. 13-p. 21, l. 6 (de e÷rjtai jusqu'à fobßqjti).
VERSION ARMÉNIENNE DU DIALOGUE D'ATHANASE ET ZACHÉE 129
près, à la section omise dans le ms. 818 de Venise, au début du dialogue.On peut supposer que dans une certaine branche de la tradition directearménienne a eu lieu un déplacement ou une chute de folios qui auraitprovoqué, ensuite, la transmission séparée des deux parties du texte at-testées respectivement dans les manuscrits 818 et 350616.
2. La datation et la langue de la version arménienne d'AZ
La datation des traductions arméniennes des œuvres attribuées à Atha-nase est restée longtemps liée à un colophon, d'origine inconnue, citépar Zarbhanalian dans son catalogue des anciennes traductions armé-niennes17. Le colophon énumère tout d'abord dix-sept œuvres transmisesen arménien et ajoute que celles-ci ont été traduites du grec par les pre-miers traducteurs (Ve siècle); parmi ces écrits, il mentionne la versionarménienne d'AZ. Ensuite, il cite encore cinq œuvres, en précisant qu'el-les ont été traduites par Step‘annos Siwnec‘i sur l'ordre de YovhannesOjnec‘i (VIIIe siècle). Il a toutefois été observé que les renseignementsd'ordre chronologique fournis par ce mémorial ne sont pas dignes deconfiance. Une première lecture des versions qui appartiendraient selonle colophon à l'âge d'or démontre qu'une partie d'entre elles présente aucontraire des caractéristiques linguistiques difficilement admissiblespour une telle époque18. Nous ne saurions donc nous rapporter avec con-fiance à ce colophon pour la datation d'AZ.
Faute de critères chronologiques externes, l'analyse linguistique dutexte arménien constitue un outil important pour déterminer l'époque desa traduction. À ce propos, on rappellera tout d'abord les remarques fai-tes par Conybeare dans sa traduction anglaise du texte arménien parueen 189719. Dans l'introduction à cette traduction, le savant anglais écri-
16 Le même accident pourrait être à l'origine de l'omission de l'arménien par rapportau grec signalée supra (note précédente).
17 Cfr ZARBHANALIAN 1889, p. 287 s.; le colophon a été cité et traduit en anglais parCASEY 1931, p. 52 s.; cfr aussi R.W. THOMSON, The Transformation of Athanasius inArmenian Theology (A Tendentious Version of the Epistula ad Epictetum), dans LeMuséon, 78 (1965), p. 47-69 et notamment p. 60-63 (réimprimé dans R.W. THOMSON,Studies in Armenian Literature and Christianity [Variorum], Great Yarmouth, 1994,no XIII).
18 C'est l'argument de CASEY 1931, p. 57.19 Cfr F.C. CONYBEARE, Questions and Answers; or, an Interchange of Arguments
between Athanasius, Bishop of Alexandria, and Zacchaeus, a Jew, dans The Expositor, 5,London, 1897, p. 302-320 et 443-463; introduction: p. 300-302 (désormais CONYBEARE
1897).
130 V. CALZOLARI
vait: «The Armenian version… seems to have been made in the sixth orseventh century, and is in a pure and classical style»20. S'il ne considé-rait pas la version arménienne comme issue de la première école de tra-duction, Conybeare croyait tout de même que le texte, tout en apparte-nant à l'époque postclassique, avait été écrit dans un «pur style classi-que»21. L'année suivante, dans la préface à son édition du texte grecd'AZ, il revenait sur la question. Se fiant au jugement du colophon men-tionné plus haut, il concluait: «Already therefore in that age (scil. Ve s.)the dialogue with Zacchaeus had found its way into the MSS. ofAthanasius»22.
À quels résultats l'examen des caractéristiques linguistiques de la ver-sion arménienne d'AZ nous conduit-il? L'évaluation de Conybeare, quipar ailleurs n'argumente pas son propos, résiste-t-elle à une analyse dé-taillée de la langue? Peut-on vraiment parler d'un «pur style classi-que»? J'en viens tout de suite aux résultats de mon analyse linguistiquedu texte arménien d'AZ pour remarquer que cet examen révèle, au con-traire, plusieurs aspects morphologiques, lexicaux et syntaxiques égale-ment attestés dans les œuvres des Écoles dites pré-hellénisante et hellé-nisante (en arménien Naxayunaban et Yunaban Dproc‘).
2.1. Morphologie
Parmi les aspects morphologiques postclassiques de la langue de laversion arménienne d'AZ, nous pouvons citer l'emploi fréquent de l'infi-nitif gol (§1, 11, 22, 55, 8723, etc.), notamment à l'instrumental golov
(§4, 17, 21, 31, 74, etc.); de l'infinitif el, construit à partir de em, (§1, 52,120), notamment à l'instrumental elov (§23) et à l'ablatif yeloy (§11)24;de l'infinitif passif en -il qui, comme on le sait, n'existait pas à l'époque
20 Cfr CONYBEARE 1897, p. 301.21 Il serait intéressant d'étudier la conception de l'«arménien classique» que se fait ce
savant de la fin du XIXe siècle qui ne pouvait encore connaître ni les travaux des spécialis-tes arméniens de l'École hellénisante, ni ceux sur la langue classique issus de l'École desMékhitaristes de Vienne (années 30), ni ceux sur l'histoire de la langue arménienne parH. Acaryan (années 50).
22 Cfr CONYBEARE 1898, p. XI.23 Pour ne pas alourdir les pages de l'analyse linguistique avec un système de renvois
trop complexe, je me limite à donner l'indication des paragraphes de l'édition du textegrec par Conybeare, suffisante pour pouvoir retrouver les exemples cités.
24 Ces formes d'infinitif du verbe em sont employées également dans des œuvres is-sues de l'École hellénisante telles que le Girk‘ Pitoyic‘ et les versions arméniennes deDavid l'Invincible, Timothée Aelure, Socrate.
VERSION ARMÉNIENNE DU DIALOGUE D'ATHANASE ET ZACHÉE 131
classique: cfr grauoril25 (gr. stoixeiwq±nai, §13), xacil (gr. stau-roÕsqai, §36 et staurwq±nai, §37), ∑nanil (gr. genn¢sqai, §48 etgennjq±nai, §73), kocil (gr. kale⁄sqai, §57), à∑anil (gr. ö xrió-menov26, §63), etc.
2.2. Lexique
L'examen du lexique et notamment de la traduction des mots com-posés grecs avec préfixe27 permet de tirer d'autres considérations inté-ressantes. Le traducteur d'AZ alterne des procédés de traduction dif-férents: les mots composés grecs ont été traduits parfois par des motsarméniens simples de sens équivalent, seuls ou accompagnés d'unadverbe, conformément à l'usage de l'âge d'or. Dans d'autres cas, ilsont été traduits par des mots composés arméniens, dans lesquels onremarque l'utilisation de préfixes typiques des œuvres de l'École hel-lénisante, tels que ver-, baw-, tar-, ˙ar-. Nous pouvons le constaterdans les exemples suivants, classés par ordre alphabétique, selon les dif-férents préfixes grecs; dans la plupart des cas, il s'agit de formes verba-les:
âna- a) préverbe arménien ver-28:âná-gnwqi: ver-∑aneá (§81, 98, 99)âna-pempómenov: ver-a®a≤eal (§11)ân-égnwn: ver-∑anewi (§99)ân-egráfjsan: ver-ta®ewan (§110)
b) verbe simple arménien:âna-baínein: z-elanel-n (§54)
25 Le verbe grauoril (gr. stoixeiwq±nai) est construit à partir du substantif armé-nien gir, normalement avec le sens de «lettre» (d'alphabet), qui est utilisé dans le même§13 pour traduire le grec tà stoixe⁄a.
26 Infinitif arménien face au participe substantivé grec (légetai ö xriómenov =à∑anil asi).
27 À ce sujet, cfr A. SIRINIAN, La traduzione dei composti verbali greci nelle versioniarmene delle Orazioni di Gregorio di Nazianzo e delle Regole di Basilio di Cesarea, dansA. VALVO (éd.), La diffusione dell'eredità classica nell'età tardoantica e medievale.Forme e modi di trasmissione, Trieste, 1997, p. 199-210.
28 Il s'agit d'un préfixe utilisé dans les œuvres de l'École hellénisante: cfr V. CAL-
ZOLARI, Particolarità sintattiche e lessicali della versione armena del Martirio di Andrea,messa a confronto con Teone armeno, dans Le Muséon, 106 (1993), p. 283 (désormaisCALZOLARI 1993); G. LAFONTAINE, La traduction arménienne des «Catégories d'Aris-tote» par David l'Invincible, dans Le Muséon, 96 (1983), p. 134 (désormais LAFONTAINE
1983); Ch. MERCIER, L'École hellénistique dans la littérature arménienne, dans Revuedes Études Arméniennes, N.S., 23 (1978-1979), p. 65 (désormais MERCIER 1978-1979).
132 V. CALZOLARI
âna-gn¬nai: ∂n¯e®noul (§13; cfr §35)29
(t¬n) âna-pneustik¬n: ˙ncakan-n30 (§11)âna-st±sai: yarouwanel (§72)âna-tétalke: ∑ageaw (§71)
Le verbe composé ver∑anel «lire»31 avait déjà attiré l'attention deCh. Mercier qui le répertoriait parmi les formes utilisées dans les œuvresde l'École hellénisante. Le savant avait remarqué en particulier que lestraducteurs de cette École n'avaient pas hésité à créer ce néologismemalgré l'existence en arménien du verbe simple ∂n¯e®noul, ayant lemême sens que le grec ânagignÉskw «lire»32. Dans la version d'AZ, onconstate encore un flottement entre la forme classique ∂n¯e®noul et lenéologisme ver∑anel.
âpo- a) préverbe arménien baw-33:(to⁄v) âpo-kjruxqe⁄sin: baw-a≤arozeal-n (§52)
b) verbe simple arménien:ãp-elqe: ér¯ (§63, cfr §64, 70)âpo-tassoménouv: hrajareal≤ (§71)
dia- a) préfixes arméniens tar-34 et yar-35:dia-ménei: yar-amnay (§10536)diáforon: z-tar-berakan (§114)
b) adjectif simple arménien:dia-fórouv: zanazanaditak (§114)
29 Cfr aussi le substantif arménien ∂n¯erwoumn-n (avec article) face à l'infinitif subs-tantivé grec t¬ç âna-gn¬nai (§26).
30 Adjectif arménien face au participe parfait grec.31 Formé par le préverbe ver- et par le radical de l'aoriste supplétif du verbe ©ana-
cem = gignÉskw «connaître».32 Cfr MERCIER 1978-1979, p. 63 s.33 Ce préfixe, qui est issu de la locution prépositionnelle classique i baw, est souvent
utilisé dans les œuvres de l'École hellénisante: cfr CALZOLARI 1993, p. 284; LAFONTAINE
1983, p. 134; MERCIER 1978-1979, p. 65; A.N. MURADYAN, Hounaban Dprow∂ eu nra
der∂ hayereni ≤erakanakan terminabanou¯yan ste¬∑man gor∑oum, Erevan, 1971,p. 141 (désormais MURADYAN 1971).
34 Il s'agit encore une fois d'un préfixe typique de l'École hellénisante (cfr CALZOLARI
1993, p. 284; LAFONTAINE 1983, p. 134; MERCIER 1978-1979, p. 66; MURADYAN 1971,p. 148), utilisé surtout dans les traductions les plus récentes: cfr Y. MANANDEAN,Younaban dprow∂ eu nra zargawman ˙r∆anner∂, Vienne, 1928, p. 113 (désormaisMANANDEAN 1928).
35 Préverbe attesté dans les œuvres de l'École hellénisante face aux préfixes grecspara-, dia-, êpi-, pro-, sun-: cfr MURADYAN 1971, p. 144.
36 Le passage d'AZ où figure le verbe composé yaramnay est une citation du Ps. 71,17; à cet endroit, dans la Bible arménienne on lit le verbe simple è (voir infra, n. 43).
VERSION ARMÉNIENNE DU DIALOGUE D'ATHANASE ET ZACHÉE 133
eîs- a) locution adverbiale + verbe arméniens:eîs-érxetai: i ner≤s … gay (§23)
b) verbe simple arménien:eîs-elqe⁄n: mtanel (§124)
êpi- a) préverbe arménien vern-:êpi-grafómeqa: vern-agrem≤ (§51)
b) locution prépositionelle + verbe arméniens:êp-agagóntov: i veray a∑elov (§32)
c) mot simple arménien:(to⁄v) êpi-kalouménoiv: xostovano¬aw (§2)
pro- a) préverbes arméniens ya®a∆-, nax-, kanx-37:pró-djlon: kanx-ayayteal (§71)pro-eirjménjÇ: nax-asaweal (§47)pro-koptétw: ya®a∆-ateswè (§13)
b) adverbe + verbe arméniens:pro-eírjtai: ya®a∆agoyn èr … asaweal (§112)pro-ljfqénta: ∂mb®neal kanxau38 (§120)
pros- a) verbe + adverbe arméniens:pros-feroménouv: gan a®a∆i (§71)
b) verbe simple arménien:pros-éqjken: yauel (§18)pros-etátteto: hramayeaw (§125)pros-éxwn: zgou˙anal (§40)pros-teqßsontai: yauelwin (§53)pros-férontav: matouwanelov (§71)
sun- a) préverbes arméniens ham- (classique)39 et ˙ar-40:súg-keitai: ˙ar-adreal è (§40)sum-fwnía: ham-aøaynou¯iun (§19)
b) suffixe arménien -kiw (classique)41:sun-ergoúv: gor∑a-kiws (§6)
37 Le préverbe nax- est attesté dans les œuvres de l'École hellénisante et pré-helléni-sante: cfr MURADYAN 1971, p. 145; LAFONTAINE 1983, p. 136; G. LAFONTAINE —B. COULIE, La version arménienne des Discours de Grégoire de Nazianze. Tradition ma-nuscrite et histoire du texte (C.S.C.O., 446; Subsidia, 67), Louvain, 1983, p. 135 (désor-mais LAFONTAINE — COULIE 1983). Les préverbes ya®a∆- et kanx-, quant à eux, sontissus des adverbes classiques ya®a∆ (cfr aussi ya®a∆agoyn) et kanxau.
38 Cfr LAFONTAINE — COULIE 1983, p. 135.39 Cfr LAFONTAINE — COULIE 1983, p. 135.40 Préverbe typique de l'École hellénisante (cfr CALZOLARI 1993, p. 285; LAFONTAINE
1983, p. 136; MANANDEAN 1928, p. 120; MERCIER 1978-1979, p. 67; MURADYAN 1971,p. 146), mais déjà attesté chez Lazare de P‘arp: cfr J.J.S. WEITENBERG, LinguisticContinuity in Armenian Hellenizing Texts, dans Le Muséon, 110 (1997), p. 447, note 5(désormais WEITENBERG 1997).
41 Cfr MERCIER 1978-1979, p. 67; MURADYAN 1971, p. 150.
134 V. CALZOLARI
c) verbe simple arménien:sun-ana-strafeív: ˙r∆eal (§21, 26)sun-omile⁄: xàsi (§13)
üper- préverbe arménien ver-42:üper-arqßsetai: ver-ambarøwi43 (§105)
2.3. Syntaxe
L'examen de la syntaxe aussi nous permet de repérer des tournuresnon classiques. Un exemple évident est offert par la traduction du génitifabsolu grec.
Génitif absolu
Comme on le sait, dans les textes de l'époque classique, par exempledans la version des Évangiles, les traducteurs se sont efforcés de ne pasreproduire cette tournure étrangère à la langue arménienne et ont utiliséle plus souvent des propositions circonstancielles (temporelles ou causa-les)44. Dans la traduction d'AZ, on trouve un seul exemple de propositioncirconstancielle face à un génitif absolu grec; il s'agit, par ailleurs, d'unecitation scripturaire (Dan. 9, 20)45:
kaì ∂ti mou laloÕntov kaì proseuxoménou: eu mincde® es xàsèi
eu a¬à¯èi (§121).Remarquons pourtant que les deux participes grecs au génitif qui setrouvent dans la suite du même passage ont été traduits en arménien parl'infinitif-instrumental (voir aussi infra):
kaì êzagoreúontov tàv ämartíav toÕ laoÕ mou îsraßl· kaìÅíptontov tòn ∂león mou katénanti toÕ qeoÕ: patmelov zme¬s
42 Cfr MURADYAN 1971, p. 147 s.43 Le passage d'AZ où figure le verbe composé verambarøwi est une citation du Ps.
71, 15; dans la Bible arménienne, on lit le verbe simple barøraswi (voir supra, n. 36).44 Cfr V. BANATEANU, La traduction arménienne des tours participiaux grecs, Buca-
rest, 1937, p. 111-118; G. ULUHOGIAN, Tearn aselov; la traduction du génitif absolu grecdans la version arménienne de Basile le Grand, dans L. HOVSEPIAN — N. PARNASIAN —S. SIMONIAN (eds.), The Second International Symposium on Armenian Linguistics (21-23September 1987). Proceedings, vol. 2, Erevan, 1993 (traduction française de l'article pu-blié en arménien dans Patmabanasirakan Handes, 124 [1989], p. 167-176), p. 50-52(désormais ULUHOGIAN 1993).
45 Une comparaison exhaustive entre le texte des passages bibliques cités dans AZ ar-ménien et la Bible arménienne reste à faire; un premier sondage m'a permis néanmoinsd'observer que, dans plusieurs cas, le traducteur arménien semble avoir traduit la citationtelle qu'il l'a lue dans le texte grec au lieu de citer de mémoire ou de copier le texte de laBible arménienne; c'est le cas de ce passage (voir infra, note suivante). Malgré cela, onne peut pas exclure la possibilité que, pour ces citations scripturaires, le traducteur aitpeut-être voulu reproduire des tournures propres au style classique.
VERSION ARMÉNIENNE DU DIALOGUE D'ATHANASE ET ZACHÉE 135
jo¬ovrdean imoy Israyè¬i, ∂nkenlov zgou¯ im a®a∆i Astou∑oy
(§121)46.Un deuxième procédé de traduction également attesté dans la version
des Évangiles face au génitif absolu avec valeur temporelle est repré-senté par la préposition i + infinitif (avec article) et sujet au génitif47.Dans la version arménienne d'AZ on trouve trois exemples de ce genre:
gennjqéntov aûtoÕ: i ∑naneln nora? (§76);xristoÕ gennjqéntov: i ∑naneln ≥ristosi? (§97);cfr aussi, malgré les divergences, sumfqásantov toÕ qaumastoÕ: i
hasanel jamanakin? (§121).L'exemple tiré du §97 est suivi par deux autres génitifs absolus qui ontété traduits, eux, par des propositions coordonnées à la principale:
(xristoÕ gennjqéntov) kaì t±v eîdwlolatreíav luoménjv, kaìt±v mageíav katargouménjv. (kaì oï seboeìm ãndrev êpˆ aûtòndiébjsan): zi (i ∑naneln ≥ristosi?) k®apa˙tou¯iunn lou∑au, eu
mogou¯iun≤ xafanewan, (eu Sabayawi≤? ar≤ barøoun≤ i na anwin)
(§97).Dans quatre cas au moins, le génitif absolu est traduit par le participe
en -eal avec sujet au génitif, c'est-à-dire avec une tournure propre à lalangue arménienne classique qui se rapproche, du moins partiellement,de la tournure grecque48:
keiménou … aûtoÕ: bazmeal nora (§33);kaì t¬n mágwn kaì t¬n êpaoid¬n legóntwn: eu mogouwn eu gitaw
asaweal (§114);t±v graf±v legoúsjv: grow asaweal (§1 et 128).Reste isolé le cas d'un génitif absolu grec traduit par un substantif ar-
ménien de sens équivalent:âpolluménwn t¬n ânqrÉpwn: vasn korstean mardkan (§21).Si les procédés relevés jusqu'ici sont attestés dans la langue armé-
nienne classique, la traduction du génitif absolu grec par l'instrumentalde l'infinitif49 avec sujet au génitif, souvent utilisée dans la version ar-
46 Dans le texte de Dan. 9, 20 de la Bible arménienne, tous les génitifs absolus grecsont été traduits par des propositions coordonnées (eu mincde® eu xàsèi eu ya¬à¯s kayi
eu xostovan linèi zme¬s im, eu zme¬s jo¬ovrdeann Israye¬i. eu arkanèi zgou¯s);le traducteur d'AZ n'a donc pas suivi le texte de la Bible dans cette citation scripturaire.
47 Cfr M. MINASSIAN, Tournures infinitives temporelles en arménien classique, dansLe Muséon, 98 (1985), p. 169-196; ULUHOGIAN 1993, p. 51.
48 Cfr WEITENBERG 1997, p. 455.49 Sans vouloir entrer dans les détails d'une analyse des procédés de traduction du par-
ticipe grec dans la version arménienne d'AZ, il me semble important de souligner lagrande quantité de formes d'infinitif-instrumental face au participe grec, cet aspect consti-tuant un des traits postclassiques de la langue du texte arménien d'AZ.
136 V. CALZOLARI
ménienne d'AZ, est au contraire quasiment étrangère aux versions del'âge d'or50. Il s'agit d'un procédé très fréquent dans les textes issus del'École pré-hellénisante51:
toÕ qeoÕ légontov… kaì toÕ profßtou eîrjkótov… kaì diàtoÕto êpagagóntov: Astou∑oy aselov … eu margarèin aselov … eu
vasn aysorik i veray a∑elov (suivi par le participe asaweal) (§32);toÕ nómou légontov: aselov àrinawn (§41);t¬n mágwn êlqóntwn kaì legóntwn: mogouwn galov eu aselov (§76);prÉtwn t¬n ägíwn qusiasántwn t¬ç qe¬ç: a®a∆now srbown52
zohelov Astou∑oy (§128);toÕ qeoÕ … bo¬ntov: Astou∑oy gocelov (§129).Le calque, très répandu surtout dans les versions de l'École helléni-
sante53, est également attesté dans la version arménienne d'AZ54:t±v g±v üm¬n êrjmwménjv, kaì t¬n pólewn üm¬n purikaústwn
gegenjménwn, (kaì âeì dià toÕto paqe⁄n ôfeilóntwn): erkri øeroy
anapataweloy, eu ≤a¬a≤aw øerow hrkèz e¬elow. (vasn oroy part è
manauand mi˙t sgal55) (§67).
Infinitive
Dans les œuvres de l'École hellénisante, la traduction des propositionsinfinitives grecques par l'infinitif arménien avec sujet à l'accusatif estégalement fréquente. Comme on le sait, ce procédé constitue un calquedu grec. Plusieurs exemples de ce genre sont attestés dans AZ, à côtéd'autres où le sujet de l'infinitif est au datif, c'est-à-dire au cas habitueldu sujet de l'infinitif en arménien classique.
Exemples d'accusatif + infinitifnomíhete kaì ëtérouv qeoùv e¤nai: kar∑è≤ ay¬ Astoua∑ gol (§1);(t±v graf±v … legoúsjv,) ∏na e¤nai qeón: (grow … asaweal,) oc
el ayl56 Astoua∑ (§1);
50 Comme l'a relevé J.J.S. Weitenberg dans son exposé présenté au même Colloquede Wassenaar (cfr note initiale de ce travail), un exemple d'infinitif-instrumental + génitifse trouve chez Lazare de P‘arp.
51 Cfr ULUHOGIAN 1993, p. 57-62.52 Sur la base du gr. t¬n ägíwn «les saints», j'adopte la variante du ms. 218 de Ve-
nise srbown «les saints» à la place de la leçon éditée ardarown «les justes».53 Cfr MERCIER 1978-1979, p. 73.54 On doit peut-être voir le reste d'un calque également dans arm. eu jo¬ovewelow
(àrhneaw zYouday naxasawealn àrhnou¯eamb) face au gr. kaì sunaxqéntwn aût¬n,(tòn îoúdan eûloge⁄ t±Ç proeirjménjÇ eûlogíaç) (§47).
55 Le troisième participe grec au génitif (ôfeilóntwn) a été traduit en arménien parune locution impersonnelle avec verbe conjugué (part è «il faut» + infinitif).
56 Je suis le ms. 3506 de Erevan qui atteste l'adjectif ayl «autre» avant Astoua∑
«Dieu».
VERSION ARMÉNIENNE DU DIALOGUE D'ATHANASE ET ZACHÉE 137
taútjn t®n dúnamin sofían toÕ qeoÕ e¤nai ö profßtjv e¤pe:zzàrou¯iunn zayn? imastou¯iun Astou∑oy asè gol margarèn (§11);
Oï prof±tai stauroÕsqai aûtòn eîrßkasin: margarè≤n zna
xacil asawin (§36);toùv profßtav êpoíjse … eîpe⁄n: zmargarèsn arar … asel
(§74);tòn îwánnjn skirt±sai ên âgalliásei êpoíjsen: zYovannès
arar xaytal eu wn∑al (§74, voir aussi infra, §75);m® génoito ceude⁄v eîpe⁄n tàv profjte⁄av57 (v.l.): mí liwi sout
asel zmargarèou¯iunsn (§90, voir aussi infra, §90);ºti dè o∆te lógov dià fwnjtjríwn ôrgánwn ânapempómenov,
o∆te pneÕma dià t¬n ânapneustik¬n d±lon ºti êk toÕ âsÉmatone¤nai tòn qeón: eu zi oc ban i øe®n øaynakan gor∑eaw vera®a≤eal, eu
óc ogi darøeal i øe®n ˙ncakann gor∑eaw ya®a∆ xa¬aweal, yayt
yanmarminn eloy è zAstoua∑ (§11).
Exemples de datif + infinitif™ dè profjteía légei, ∏wv tóte e¤nai toùv ãrxontav toÕ
îoudaíwn ∂qnouv: bayw margarèou¯iunn asè minceu waynjam linel
i˙xanaw Hrèiw azgid (§48);… ºte xristòv êpoíjsen aûtòn ên âgalliásei skirt±sai:
yorjam ≥ristos arar nma wn∑al eu xaytal (§75, voir aussi supra,§74 bis);
m® génoito ceude⁄v eîpe⁄n toùv profßtav: mí varkanir sout
asel margarèin (§90, voir aussi supra, §90).
Consécutive avec infinitif
Pour finir, parmi les tournures syntaxiques de la version arménienned'AZ rares dans la langue classique, mais au contraire souvent em-ployées dans les œuvres hellénisantes, on remarquera la traduction de laproposition consécutive grecque avec ¿ste + infinitif par une consécu-tive arménienne avec infinitif au lieu d'un verbe conjugué58:
¿ste légein toùv ör¬ntav: orpès zi asel teso¬awn (§36);¿ste kaì toùv âpò ÖkeanoÕ katˆ êniautòn ∂rxesqai eîv ïerou-
salßm: ibr zi eu zaynosik? or≤ a® ovkianosiun bnakeal≤ en? gal am
∂st amè yerousa¬èm (§54; à relever aussi le sujet de l'infinitif à l'accu-satif);
57 L'arm. zmargarèou¯iunsn «les prophéties» confirme la variante gr. tàv pro-fjte⁄av «les prophéties» (signalée par Andrist dans son édition en cours, cfr supra) aulieu de toùv profßtav «les prophètes» de l'édition de Conybeare.
58 Il s'agit d'une tournure fréquente dans les traductions hellénisantes: cfr MERCIER
1978-1979, p. 72.
138 V. CALZOLARI
¿ste kaì ântist±nai mwse⁄: ibreu zi eu Movsisi ∂nddimanal
(§72);∏wv … e¤nai toùv ãrxontav: minceu … linel i˙xanaw (§48).Bien que non exhaustifs, les procédés de traduction recensés jusqu'ici
nous permettent de conclure que la langue de la version arménienned'AZ n'est pas celle d'un style «pur et classique», comme le prétendaitConybeare; au contraire, elle présente plusieurs aspects proches de lalangue des œuvres issues des Écoles pré-hellénisante et même helléni-sante. Cette analyse confirme ainsi les doutes que Casey avait exprimés,sans les argumenter, quant à une datation au Ve siècle telle que l'indi-quait le colophon publié par Zarbhanalian (voir supra) pour la plupartdes traductions arméniennes des œuvres d'Athanase. Si une datationhaute semble ainsi exclue, comme Conybeare l'avait d'ailleurs parado-xalement soutenu dans la préface à sa traduction anglaise du texte armé-nien, le manque de critères chronologiques externes ne nous permet pasde proposer une datation plus précise pour la version arménienne d'AZ.En effet, jusqu'à présent, on ne connaît pas d'écrits qui citent le textearménien d'AZ et qui pourraient constituer un terminus ante quem. Uneinvestigation de ce type dépasse les limites de cette présentation59.
3. La valeur de la version arménienne pour la restitution du texte grec
Dans la deuxième partie de cette étude, je voudrais faire une premièreestimation de la valeur de l'arménien pour la restitution du texte grec.Cet aspect est très important surtout dans le cas des extraits qui ne sontattestés qu'en arménien et qui pourraient conserver des passages primi-tifs perdus en grec. Comme observation préliminaire, on peut releverqu'un critère de jugement important pour répondre à cette question estreprésenté par le fait que la version arménienne est, d'une manière géné-
59 Je me contenterai de remarquer qu'aucun extrait d'AZ ne figure parmi les citationspatristiques du Sceau de la Foi signalées par Lebon et par Thomson, ni parmi les citationsd'Athanase du Florilège Galata 54 signalées par Renoux: cfr J. LEBON, Les citationspatristiques grecques du «Sceau de la Foi», dans Revue d'Histoire Ecclésiastique, 25(1929), p. 5-32; Ch. RENOUX, Athanase d'Alexandrie dans le florilège arménien Galata54 (Ire partie), dans Mélanges Antoine Guillaumont. Contributions à l'étude des christia-nismes orientaux (Cahiers d'orientalisme, 20), Genève, 1988, p. 163-171; ID., Athanased'Alexandrie dans le florilège arménien Galata 54 [deuxième partie], dans HandesAmsorya, 103 (1989), p. 7-27; R.W. THOMSON, The Fathers in Early ArmenianLiterature, dans Studia Patristica, 13 (1975), p. 462-465 (réimprimé dans R.W. THOM-
SON, Studies in Armenian Literature and Christianity [Variorum], Great Yarmouth, 1994,no XII); ID., Quotations from Athanasius in the Root of Faith, dans M.E. STONE (ed.),Armenian and Biblical Studies, Jérusalem, 1976, p. 182-203.
VERSION ARMÉNIENNE DU DIALOGUE D'ATHANASE ET ZACHÉE 139
rale, très fidèle au modèle grec, même dans l'ordre des mots. Le souci defidélité est tellement fort que le traducteur en arrive parfois à commettredes non-sens en arménien, tant il se soucie de ne rien perdre du grec,comme au §10.
a) §10
Ce paragraphe se trouve à l'intérieur d'un long extrait dans lequelAthanase essaie de persuader Zachée que le Fils, en tant que Logos, estégalement mentionné dans l'Ancien Testament, où il est appelé entreautres sofía «sagesse» (arm. imastou¯iun «sagesse»). Dans le pas-sage en question, Zachée donne la réplique à Athanase en argumentant àpartir du genre féminin du mot grec sofía et en affirmant d'une manièreprovocatrice: (C 7, 660) oûkoÕn qeà êstìn ö xristóv = (T 193, 3561)isk apa astoua∑ouhi è ≥ristos «le Christ est donc une déesse».Athanase répond en expliquant qu'il ne faut pas utiliser pour les êtres in-corporels les mêmes catégories de féminin/masculin utilisées pour lesêtres corporels; à ce propos, il donne l'exemple du mot cuxß «âme»:
C 7, 7-10 qeóv, eîpé· kaì m® Üv îouda⁄ov nómihe, êpì t¬n âswmátwn tàqjlukà ônómata kaì tà ârrenikà ömoíwv légesqai, Üv kaì êpì t¬nswmátwn· êpeì kaì ™ cuxß sou qjluk¬ç ônómati kékljtai cuxß· kaìoûk ∂sti qßleia kaì ãrrjn cuxß «Dis plutôt Dieu, et ne pense pas,comme un Juif, qu'au sujet des êtres incorporels les noms sont dits fémi-nins et masculins comme au sujet des être corporels; car ton âme aussi estappelée «âme» (cuxß), avec un nom féminin, mais l'âme n'est pourtant niféminine ni masculine».
Ce passage grec a été traduit en arménien de la manière suivante:T 193, 36-194, 5 Astoua∑ asá, eu mí hrèabar kar∑er ya¬ags an-
marmnown? zarouakan eu zigakann anouanakocou¯iuns: Nmanapès62
asel, orpès eu saks marmnow, zi eu anøn ≤o igakann anouamb koci
anøn, eu oc è arouakan kam igakan «Dis plutôt Dieu, et ne pense pas, àla manière d'un Juif, qu'au sujet des êtres incorporels les noms63 sont ditsféminins et masculins comme au sujet des êtres corporels, car ton âmeaussi est appelée «âme» (anøn), avec un nom féminin, mais elle n'est pour-tant ni masculine ni féminine».
Comme on peut le constater, le passage grec a été traduit mot à mot enarménien. Or, le manque de distinction du genre grammatical dans la
60 Le sigle se réfère à la page de l'édition de CONYBEARE 1898 (= C).61 Le sigle se réfère à la page de l'édition de TAYEC‘I 1899 (= T).62 Je ne suis pas la ponctuation de l'édition de Tayec‘i; sur la base de la comparaison
avec le grec et tenant compte de la cohérence du contenu, j'élimine le point final avantnmanapès.
63 Litt. «le fait d'appeler par (son) nom».
140 V. CALZOLARI
langue arménienne rend complètement inutile, voire incompréhensible,en arménien l'exemple du mot «âme» (anøn) en tant que «nom fémi-nin». Malgré cela, le traducteur n'est pas intervenu sur le texte et n'a pasjugé opportun de couper cet extrait64. En gardant à l'esprit cette consta-tation (la fidélité extrême à l'original grec), essayons maintenant d'éva-luer l'apport que l'on peut tirer de la version arménienne d'AZ dans lecas des passages qui n'existent qu'en arménien en commençant parl'exemple du §41.
b) §41
Le §41 se trouve à l'intérieur de la section du dialogue dans laquelleAthanase veut démontrer à Zachée que le Christ est né d'une femme,qu'il a reçu une nature mortelle et qu'il n'est pas du tout honteux decroire qu'il a subi la mort sur la croix. Il argumente à partir du Ps. 22,17-18 («ils m'ont percé les mains et les pieds») ainsi que d'Is. 53, 3-12(au sujet du Serviteur opprimé par les hommes et exalté par Dieu). Dansle passage indiqué ci-dessous, Athanase cite le verset 12 d'Is. 53:
C 29, 20-30, 2 ânq ˆ ˜n paredóqj eîv qánaton ™ cux® aûtoÕ, kaì ên to⁄vânómoiv êlogísqj <…>65 toÕ nómou légontov· êpikatáratov p¢v ökremámenov êpì zúlou «c'est pourquoi sa vie fut livrée à la mort et (lui-même) fut jugé parmi les impies; <…> puisque la loi dit: Maudit quicon-que (est) pendu au bois»66.T 205, 28-32 “Foxanak zi i mah matnewau anøn nora, eu ∂nd anàrèns
hamarewau”. vasn zi i mè∆ erkouw auazakaw kaxeal? orpès zanàrèn
hamarewau67. aselov àrinawn? ¯è “Ani∑eal amenayn? or kaxeal kaywè
zfaytè” ««C'est pourquoi sa vie fut livrée à la mort et (lui-même) fut
64 Il convient de rappeler que les traités grammaticaux médiévaux se soucient d'expri-mer la différence de genre grammatical, absente de la langue arménienne; à ce sujet, cfrR. ERVINE, Yovhannes Erznkac‘i Pluz's Compilation of Commentary on Grammar as astarting point for the study of Medieval Grammars, dans J.J.S. WEITENBERG (ed.), NewApproaches to Medieval Armenian Language and Literature (Dutch Studies in ArmenianLanguage and Literature, 3), Amsterdam — Atlanta, 1995, p. 156. Le même souci estégalement présent dans la version arménienne de la Grammaire de Denys de Thrace, is-sue de l'École hellénisante: cfr R. SGARBI, Studio contrastivo sull'adattamento strutturalearmeno della «Téchne» dionisiana, dans Memorie dell'Istituto Lombardo — Accademiadi Scienze e Lettere. Classe di Lettere — Scienze Morali e Storiche, 39, fasc. 7 (1991),p. 564. Dans les deux cas, toutefois, les procédés adoptés pour exprimer la différence en-tre masculin et féminin sont différents; dans aucune de ces deux œuvres, il n'est questiondu mot arménien anøn «âme».
65 J'indique entre crochets obliques la lacune qu'on peut supposer sur la base de lacomparaison avec l'arménien.
66 En suivant l'édition de Conybeare, je signale en italique les allusions et citationsscripturaires.
67 J'indique en gras le passage conservé uniquement en arménien.
VERSION ARMÉNIENNE DU DIALOGUE D'ATHANASE ET ZACHÉE 141
jugé parmi les impies», car, pendu au milieu de deux larrons, il fut jugécomme un impie, puisque la loi dit: «Maudit quiconque se trouve penduau bois»».
Comme on peut le constater, l'arménien a, en plus du grec, la phrasevasn zi i mè∆ erkouw auazakaw kaxeal? orpès zanàrèn hamarewau
«car, pendu au milieu de deux larrons, il fut jugé comme un impie» quipermet de supposer une lacune en grec par saut-du-même-au-même deên to⁄v ânómoiv êlogísqj (= ∂nd anàrèns hamarewau) «il fut jugé parmiles impies» à <Üv ãnomov êlogísqj·> «il fut jugé comme un impie»qu'on peut restituer sur la base de l'arménien orpès anàrèn hamarewau
«il fut jugé comme un impie». La lacune avait été remarquée parConybeare qui avait intégré dans son édition du texte grec la traductionlatine du passage attesté seulement en arménien:… ânq ˆ ˜n paredóqjeîv qánaton ™ cux® aûtoÕ, kaì ên to⁄v ânómoiv êlogísqj <quia interduos latrones suspensus quasi impius reputatus est> toÕ nómoulégontov. Un témoin grec de Turin récemment collationné par Andrist68
confirme l'origine primitive du passage arménien en plus du grec. Eneffet, il atteste la partie du texte grec perdu dans le manuscrit de Vienneutilisé par Conybeare, mais avec une corruption de ãnomov en ãmnov:…ânq ˆ ˜n paredóqj eîv qánat[non leg.]ux® aûtoÕ, [non leg.] ênto⁄v ânómoiv êlogísqj· metà gàr dúo [non leg.] kremasq [non leg.]êpì zúlou, Üv âmnòv êlogísqj69 toÕ nómou légontov· ktl. Grâce àl'arménien, Andrist a pu corriger la corruption du codex de Turin et réta-blir le texte grec de la manière suivante:... ânq ˆ ˜n paredóqj eîvqánaton ™ cux® aûtoÕ, kaì ên to⁄v ânómoiv êlogísqj· metà gàr dúokakoúrgouv kremasqeìv êpì zúlou70, Üv ãnomov êlogísqj· toÕnómou légontov· ktl71.
Si dans le §41 l'arménien garde un passage perdu dans une branchede la tradition manuscrite grecque mais conservé dans une autre, dansd'autres extraits, la version arménienne est le seul témoin à garderdes passages complètement perdus en grec. D'où son importance. C'estle cas notamment de cinq omissions par saut-du-même-au-même qu'onpeut relever aux §53, 66-67, 77, 83 et 90 du texte grec. Toutes cesomissions ont été signalées par Conybeare, qui les a également com-blées, dans son édition du texte grec d'AZ, à travers une rétroversiongrecque à partir de l'arménien72. Il serait inutile de les indiquer à
68 Cfr cod. B. IV. 22 (= 200, b. III. 11, Pasini; = 185, Cosentini).69 J'indique en gras la partie attestée uniquement dans le manuscrit de Turin.70 L'arménien n'a pas l'équivalent du gr. êpì zúlou «sur la croix».71 Ces informations m'ont été données par P. Andrist, que je remercie.72 Sauf au §90, où il insère la traduction anglaise du texte arménien.
142 V. CALZOLARI
nouveau ici73. Il me semble en revanche plus intéressant d'examiner unautre passage attesté seulement en arménien, dont l'origine est plus diffi-cile à établir. Il s'agit d'un long extrait attesté aux §60-6274.
c) §60-62
Dans les paragraphes qui précèdent (§58-59), Zachée et Athanase dé-battent au sujet de l'onction du Christ. Pendant cette discussion, Atha-nase cite le Ps. 45, 875 et établit une distinction entre l'«huile de joie» —c'est-à-dire l'huile qui vient de l'Esprit de Dieu et avec laquelle David aété oint — et l'«huile terrestre» avec laquelle ses compagnons ont étéoints. Il cite également Is. 61, 1 («l'esprit du Seigneur est sur moi; eneffet, il m'a oint et m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux humi-liés»76), tout en prétendant que ce verset se réfère au Christ. Zachée ré-plique que c'est Isaïe qui a prononcé ces mots, ce qui interdit de les attri-buer au Christ77. Dans tous les manuscrits connus du texte grec, Atha-nase oppose à l'objection de Zachée une question sur le nom du Christ78,question sur laquelle il obtient l'accord de son adversaire79. Il invite en-suite Zachée à se rendre à Jérusalem pour se renseigner à ce sujet80.
73 Ajoutons seulement que, dans le texte restitué par Conybeare aux §66-67 (C 39, 5-13 = T 213, 33-214, 12), on peut supposer également la présence de l'adjectif aîwníwç«éternelle» devant le substantif eûfrosúnjÇ «avec joie» (C 39, 8) sur la base de l'arm.ouraxou¯eamb yauitenakanau «avec une joie éternelle» (T 214, 5 s.).
74 En plus de la section finale d'AZ, l'arménien présente un texte plus étendu égale-ment aux §95 et 108.
75 C 36, 4 s. dià toÕto ∂xrisén se ö qeóv ö qeóv (sic) sou ∂laion âgalliásewvparà toùv metóxouv sou «pour cela Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie, de pré-férence à tes compagnons».
76 C 36, 10 s. pneÕma kuríou êpˆ êmé· oœ eÿneken ∂xrisé me, eûaggelísasqaiptwxo⁄v âpéstalké me.
77 C 36, 12 ¨Jsaíav ö taÕta légwn· m® gàr ö sòv xristóv «c'est Isaïe qui dit cela;ce n'est donc pas ton Christ» (je suis la ponctuation proposée par Andrist qui élimine lepoint d'interrogation après Xristóv).
78 C 38, 11 Xristòv oû légetai ö xriómenov ên pneúmati ägíwç; «n'est-il pas ap-pelé Christ celui qui a été oint par le Saint-Esprit?».
79 C 38, 12 Naí «oui».80 C 38, 13-16 ‰Apelqe oŒn eîv ïerousalßm, kaì máqe ên aût±Ç êrwtßsav, poÕ
kat±lqen <pneÕma> †gion kaì êpì tína, kaì póte [póte Andrist: tóte ed.], ÿnaâkoúsjÇv, ºti ên t¬ç îordánjÇ êpì tòn êk maríav gegennjménon êpì kaísarovaûgoústou. «va donc à Jérusalem et apprends-y, en posant des questions, où est des-cendu le Saint-Esprit, et sur qui, et quand, afin que tu entendes que c'est dans le Jourdain,sur celui qui a été engendré par Marie, sous l'empereur Auguste» (l'intégration du gr.pneÕma «esprit» est confirmée par l'arm. hogin «l'esprit», qui présuppose égalementl'article devant le substantif grec; l'émendation d'Andrist póte est également confirméepar l'arm. Érb «quand»).
VERSION ARMÉNIENNE DU DIALOGUE D'ATHANASE ET ZACHÉE 143
Après l'objection de Zachée à propos d'Is. 61, 1 et de la possible attri-bution au Christ de ce propos, et avant la question d'Athanase sur lenom du Christ, le texte arménien conserve un long extrait complètementabsent du grec (T 211, 18-213, 5). S'agit-il d'un passage primitif, tombéou coupé dans la tradition manuscrite grecque, ou bien d'un passage se-condaire, ajouté dans l'arménien? La succession des péricopes en grecne présente pas d'obscurités ni de désordre manifestes. Néanmoins,l'examen de ce passage arménien permet de repérer des indices qui plai-dent en faveur de sa nature primitive et qui étayent l'hypothèse d'uneomission dans la tradition directe grecque telle que nous la connaissons.Dans l'impossibilité de le reproduire en entier, je résumerai le texte ar-ménien, en le commentant au fur et à mesure et en citant les extraits quiprouvent la cohérence de ce passage par rapport au contexte.
Is. 61, 1-8: la «joie éternelle»
Si l'on suit le texte arménien, après l'objection de Zachée concer-nant Is. 61, 1 («c'est Isaïe qui dit cela; ce n'est donc pas ton Christ»),Athanase insiste en affirmant qu'Isaïe a prononcé ces mots, mais «àpropos du Christ»81. Il invite donc Zachée à écouter la suite de la pro-phétie sur le Messie qui avait été interrompue au verset 182 et il citeIs. 61, 1-8.
Un élément de la citation d'Is. 61, 1-8 retient l'attention de Zachée.L'allusion au fait que la «joie éternelle» sera l'apanage de ceux qui se-ront appelés ≤ahanay≤ Tea®n «prêtres du Seigneur» et pa˙tàneay≤
Astou∑oy meroy «officiants de notre Dieu» (T 212, 5 s.)83 est interprétéepar le Juif comme une allusion à son peuple84. Athanase réplique alorsd'une façon polémique, en affirmant d'une manière péremptoire: «Lajoie éternelle n'a pas été ni sera sur vous»85. À ce nouveau trait de polé-mique anti-juive — on en relève d'autres dans AZ — Zachée répond
81 T 211, 18 s. ay¬ zor asèrn Esayias? yeresaw ≥ristosi asèr «mais ce qu'Isaïedisait, il le disait à propos du Christ».
82 T 211, 19-22 lóur apa norin isk bolor margarèou¯eann, zi ∑aniwes ¯è óc
ayloum oume≤ margarèou¯iunn pat˙a©i, bayw ≥ristosi miayn. ≤anzi asè ayspès…
«écoute ensuite la même prophétie en entier, afin que tu reconnaisses que la prophétie neconvient à personne d'autre qu'au Christ; il s'exprime en effet ainsi…».
83 Cfr T 212, 9 s. ouraxou¯iun yauiteniw i veray glxow nowa «la joie (sera) éter-nellement sur eux (litt. sur leurs têtes)».
84 T 212, 13 s. ayd amenayn vasn jo¬ovrdean meroy asi «tout cela est dit au sujetde notre peuple».
85 T 212, 15 s. ouraxou¯iun yauitenakan i veray glxow øerow óc e¬eu eu óc
lini:
144 V. CALZOLARI
vexé: «personne ne peut insulter au moyen de querelles verbales»86. Surces mots, tout en soulignant qu'il n'entend insulter personne87, Athanasedemande à Zachée de quelle manière il peut démontrer qu'il est possiblede parler d'une joie éternelle à propos des Juifs, eux qui ont connu de sigrandes quantités de malheurs (ruine de la ville, du temple, du pays,etc.)88. Zachée répond en soutenant que l'accomplissement de la prophé-tie n'a pas encore eu lieu; il n'est donc pas faux d'attribuer cette allusionaux Juifs à condition qu'on attende le moment désigné pour que la pro-phétie s'accomplisse89.
Remarquons que le thème de la joie éternelle, mentionné dans cet ex-trait conservé uniquement en arménien, trouve un parallèle plus loin, au§67 qui est attesté, lui, également en grec. Dans ce paragraphe aussi,Zachée insiste sur le fait que la joie éternelle est un apanage des Juifs90.Athanase le relance alors: «et de nouveau (pálin) je (te) dis: quelle estvotre joie éternelle?». Et une fois encore il énumère les malheurs qui ontfrappé les Juifs (perte du pays, incendie de la ville, deuil perpétuel)91. Leterme pálin «de nouveau» du §67 n'est justifiable que si l'on admetqu'Athanase a déjà tenu des propos semblables. Or, de tels propos ne se
86 T 212, 17 óc o≤ banavi©ou¯eamb ¯˙namanè.87 T 212, 18 oc ¯˙namanem, or ≤au eu mí liwi «je n'insulte pas, loin de cela!».88 T 212, 19-23 apa ¯è ounis wouwanel? ¯è e¬eu øez ouraxou¯iun yauitena-
kan, orow eu z≤a¬a≤n korouseal eu zta©ar, eu zàrinauorou¯iun, eu zgaua®, eu
ztapanak, eu zsrbou¯iuns, eu z≤erovbès, eu z≤auarann, eu orcaf dou isk ousar,
asá «(je n'insulte pas), pourvu que tu puisses démontrer que vous avez bien eu unejoie éternelle, vous dont la ville et le temple ont été ruinés, ainsi que la loi, le pays,l'arche, les saints, les chérubins, le lieu d'expiation et tout ce que tu connais bien; dis-moi!».
89 T 212, -24 ay¬ handerøeal è ays amenayn linel, bayw ceu è jamanak «tout celava arriver, mais ce n'est pas encore le temps».
90 C 39, 10 Jûfránqjmen ™me⁄v êpì kúrion = T 214, 7 ouraxaweal≤ me≤ em≤ i
Tèr «c'est nous qui nous sommes réjouis dans le Seigneur».91 C 39, 11- 13 <… Kaì pálin légw· üm¬n tív eûfrosúnj ™> aîÉniov; t±v g±v
üm¬n êrjmwménjv, kaì t¬n pólewn üm¬n purikaústwn gegenjménwn, kaì âeì diàtoÕto paqe⁄n ôfeilóntwn; = T 214, 8-11 eu darøeal asem. ouraxou¯iun yauite-
nakan øer Õr è, erkri øeroy anapataweloy, eu ≤a¬a≤aw øerow hrkèz e¬elow. vasn
oroy part è manauand mi˙t sgal «et de nouveau je te dis: quelle est votre joie éter-nelle? étant donné que votre pays se dépeuple, que vos villes brûlent et qu'il faut être tou-jours en deuil à cause de cela?». Les mots grecs entre crochets ont été restitués parConybeare à travers une rétroversion à partir de l'arménien; ils font partie d'un bref pas-sage sûrement tombé en grec par saut-du-même-au-même, comme on peut facilement leconstater en lisant en entier l'extrait grec dans l'édition de Conybeare, à laquelle je ren-voie. Il convient également de remarquer que l'arm. sgal «être en deuil» confirme la va-riante gr. penqe⁄n, attestée dans le ms. de Turin mentionné supra (note 68), à la place dugr. paqe⁄n «souffrir».
VERSION ARMÉNIENNE DU DIALOGUE D'ATHANASE ET ZACHÉE 145
trouvent que dans la partie du texte qui n'est attestée qu'en arménien(§61). Ce renvoi interne suggère donc que cette première partie de lasection conservée uniquement en arménien remonte vraisemblablementau texte primitif d'AZ.
La suite du §67 nous offre un deuxième argument du même genre: àla question d'Athanase («et de nouveau je dis: quelle est votre joie éter-nelle?»), Zachée répond à son tour: «Mais je (t') ai dit que cela va arri-ver, et que la ville sera rétablie»92. Dans ce cas aussi, le renvoi de Za-chée à des mots déjà prononcés auparavant serait incompréhensible sansle témoignage du passage attesté uniquement en arménien au §62 et danslequel, comme on l'a vu, Zachée affirme précisément que l'accomplisse-ment de la prophétie aura lieu dans le futur («tout cela va arriver, maisce n'est pas encore le temps»).
La prophétie d'Isaïe se réfère au Christ
Après la discussion d'Athanase et de Zachée au sujet du thème de lajoie éternelle, le texte arménien contient un échange de répliques où ilest question de la présence de l'Esprit Saint dans la personne des pro-phètes; ce passage aussi n'est attesté qu'en arménien (§62). Athanase ditqu'Isaïe, tout en étant lui-même rempli de l'Esprit Saint, se réfère danscette prophétie à un autre; Zachée refuse d'admettre que cet «autre» estle Christ93. C'est à ce moment qu'Athanase lui demande: «N'est-il pasappelé Christ celui qui a été oint par le Saint-Esprit?»94. Ensuite, Atha-nase exhorte Zachée à se rendre à Jérusalem, comme nous l'avons déjàvu plus haut. À partir de cet extrait, qui correspond au début du §63, lesdeux textes recommencent à se superposer avec un agencement parfaite-ment cohérent entre les deux parties.
Continuons l'analyse du texte. Après l'exhortation à se rendre àJérusalem, au §64 Athanase cite le Ps. 4, 7. Puis, il continue en di-sant: «Écoute le reste de la prophétie»95. Il est important de remar-
92 C 39, 14 s. ˆAllˆ e¤pon ºti méllei gínesqai taÕta kaì oîkodome⁄sqai ™póliv = T 214, 13 s. ay¬ asawi ¯è handerøeal è linel, ay¬ eu ˙inel ≤a¬a≤in. Remar-quons au passage que l'arm. asawi «j'ai dit» confirme l'émendation de Conybearee¤pon «j'ai dit» à la place de e¤pen «il a dit» du manuscrit de Vienne.
93 T 213, 4 s. eu es asem? ¯è ya¬ags ayloy ouroumn asaw, ay¬ oc vasn ≥ristosi
≤oy «et moi, je dis qu'il a parlé au sujet d'un autre, mais non pas au sujet de ton Christ».94 C 38, 11 Xristòv oû légetai ö xriómenov ên pneúmati ägíwç; = T 213, 6 s.
≥ristosi (corruption pour ≥ristos?) apa≤èn à∑anil asÛ i Hoguoyn srboy.95 C 38, 26 ‰Akouson t¬n ëz±v t±v profjteíav = T 25 s. Loúr eu or i kargin
margarèou¯eann.
146 V. CALZOLARI
quer que, après ces mots, il ne cite pas la suite du Psaume (qui,d'ailleurs, ne peut pas être considéré comme une prophétie), mais lasuite d'Is. 61, exactement à partir de l'endroit où il avait interrompusa citation dans l'extrait attesté uniquement en arménien au §60, c'est-à-dire à partir du verset 8. Ce troisième indice, qui relève de la co-hérence interne au contexte, contribue également à prouver que le longextrait de l'arménien absent en grec est un extrait primitif, perdu dansl'original grec. Il est difficile de déterminer les raisons de cette lacunegrecque; on pourrait supposer la perte d'un folio dans l'hyparchétyped'où dépendent les branches connues de la tradition manuscrite grec-que.
La présence, en arménien, d'extraits perdus dans la tradition directegrecque constitue un élément très important. Cela démontre en effet quele texte arménien appartient vraisemblablement à une recension textuelledifférente de celle(s) des manuscrits grecs connus. Cette indépendancefait de la version arménienne de AZ un témoin privilégié pour l'établis-sement de l'original grec.
4. En guise de conclusion
Cette première investigation sur le texte arménien d'AZ nous montrel'importance de cette version pour la restitution de l'original grec et nouspermet maintenant d'ouvrir quelques perspectives de recherche nouvel-les.
Après avoir prouvé l'indépendance du témoin indirect arménien parrapport à la tradition directe grecque telle que nous la connaissons, il se-rait intéressant de vérifier ce résultat sur une base manuscrite armé-nienne plus élargie et à travers une comparaison ponctuelle et exhaustivedes variantes du grec et de l'arménien, dans le but de repérer toutes lesconcordances et divergences entre les deux textes et d'établir ainsi laposition de l'arménien, témoin indirect, à l'intérieur du stemma de la tra-dition grecque. Par ailleurs, l'analyse philologique ne devrait pas êtredisjointe d'une recherche des intentions doctrinales éventuellement dé-noncées par le texte arménien, afin de vérifier si, malgré la fidélité géné-rale à son modèle, le traducteur n'a pas ressenti parfois la nécessité d'in-tervenir sur le texte pour le corriger. Dans cette perspective, il serait par-ticulièrement profitable d'étudier le langage christologique utilisé en ar-ménien. Cet examen pourrait fournir des critères pour déterminer l'épo-que de traduction de AZ en arménien (à côté de la recherche des citationsd'AZ dans la littérature postérieure) et, en même temps, des jalons pour