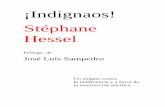Isabelle Chalier, Fabrice De Backer, Françoise Laroche-Traunecker, Stéphane Lebreton et Aksel...
Transcript of Isabelle Chalier, Fabrice De Backer, Françoise Laroche-Traunecker, Stéphane Lebreton et Aksel...
La campagne de fouilles de Porsuk ou ZeyveHöyük (Fig. 1), grâce aux crédits alloués par laSous-direction de l’Archéologie et des Sciences so-ciales du Ministère français des Affaires Etrangèreset Européennes, malheureusement toujours limités,a eu lieu de la fin de juillet au début de septembre2009. Les opérations de fouille se sont déroulées,comme lors des campagnes précédentes, dans lessecteurs Est (chantier IV) et Ouest (chantier II),pour compléter les informations recueillies précé-demment sur les différents niveaux attestés sur lesite, de la période romaine tardive jusqu’à la périodehittite du second millénaire (Bronze Récent)1.
Avec l’accord des autorités turques, une partiedes efforts de la mission a consisté à réexaminer,grâce à la présence, pendant une quinzaine de jours,de l’ancien directeur de la Mission, le ProfesseurOlivier Pelon, les données des fouilles anciennes enprévision d’une prochaine et bien nécessaire publi-cation. Il a été décidé de préparer ainsi la mise enchantier d’une monographie consacrée aux niveauxdu Bronze et du Fer (jusqu’au Fer Moyen inclus),fouilles anciennes mais aussi campagnes récentes,dans la mesure où ces travaux récents, sous ladirection de Dominique Beyer, ont complété, préciséou parfois corrigé les résultats des premières opéra-
tions. La réalisation de cette publication exige encore,dans la mesure du possible, des compléments defouille et un certain nombre d’analyses archéomé-triques, Carbone 14 en particulier, en parallèle auxséries plus nombreuses, effectuées depuis des annéesen dendrochronologie par nos collègues américains.Ces travaux préparatoires expliquent que les résultatsdes fouilles proprement dites de certains chantierssoient plus limités que d’habitude.
I. CHANTIER IV (Fig. 2)
1. Nord : carrés H41 et I41 (Isabelle Chalier)
L’aire fouillée tout au Nord du chantier IV a bé-néficié d’une large extension vers l’Ouest couvrantainsi l’entièreté des carrés H41 et I41, ce jusqu’auxmarges d’I40. Cette stratégie s’imposait. Il nousfallait compléter la compréhension des niveaux su-périeurs repérés en H42 et I42 afin de les raccorderaux éléments relevés dans les sondages que CatherineAbadie avait effectués plus à l’Ouest en 19922. Ils’agissait aussi, de manière plus prosaïque, de pareraux problèmes d’évacuation auxquels nous condui-saient inéluctablement les opérations en profondeurau cœur du carré H42. Enfin, nous voulions surtout
*) Institut d’Histoire et Archéologie de l’Orient ancien, Université de Strasbourg, UMR 7044 CNRS-UdS-UHA. Adresse : Maisoninteruniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace, 5 allée du Général Rouvillois, CS 50008, F- 67083 Strasbourg cedex. Courriel :[email protected]
1) Le chantier IV NE (carrés H41-I41) a été ainsi confié à Isabelle Chalier et Françoise Kirner, tandis que Stéphane Lebretonassurait plus au Sud la direction du secteur J41-K41. Dans ce dernier secteur, Dominique Beyer a opéré un sondage profond jusqu’à labase des couches archéologiques du höyük.
Le chantier II était, comme lors des dernières campagnes, sous la responsabilité d’Aksel Tibet. Fabrice De Backer a consacré sesefforts aux opérations menées sur le rempart nord, dans les carrés G06-G07.
Julie Patrier, empêchée de même que Mustafa Bilgin, avait comme d’habitude la charge des dossiers archéométriques. La responsabilité des relevés d’architecture incombait, comme d’habitude, à Françoise Laroche-Traunecker qui consacre
également une grande partie de ses efforts à la gestion de la documentation. Elle a pu bénéficier cette année de l’aide d’Alexandre Kahlpour les relevés sur le terrain.
Mme Seda Başar représentait avec efficacité la Direction Générale du Patrimoine culturel et des Musées. Comme l’an dernier, laMission a bénéficié du concours talentueux de Mme Ayşe Özkan pour le dessin du matériel archéologique.
Il nous est enfin particulièrement agréable de remercier la directrice de l’IFEA d’Istanbul, Nora Şeni, pour le prêt du toujoursvaillant Ford Transit rouge, sans lequel nos activités n’auraient pas été possibles.
2) Les résultats n’avaient pas été publiés.
Anatolia Antiqua XVIII (2010), p. 215-242
Isabelle CHALIER, Fabrice DE BACKER,Françoise LAROCHE-TRAUNECKER, Stéphane LEBRETON, Aksel TİBET
sous la direction de Dominique BEYER*
CAMPAGNE 2009DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE
DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK)
préparer la prochaine exploration, la plus vaste et laplus à l’intérieur possible, des niveaux anciens duFer et du Bronze.
Sous une couche végétale assez peu épaisse etdont l’altitude supérieure culminait à 107,08 m, sedessine maintenant un grand bâtiment dont le longmur 01089 orienté est-ouest forme l’extrémité mé-ridionale (Fig. 3). Ce mur, ainsi que FrédériqueBlaizot le suggérait3, forme la limite septentrionalede la nécropole. Au-delà de ce tracé, plus aucunesépulture n’a été découverte. Il appartient à uneconstruction rectangulaire que cernent les murs01089, 01086, 01576 et 01618 et qui aurait été re-maniée au Nord-ouest (une fermeture de passage ?).Elle était couverte d’une toiture de tuiles en terrecuite dont au moins une dizaine d’exemplaires(01593) jonchaient un sol 01594 (altitude : 105,62 m).Les tuiles découvertes sont soit des tegulae, plates àrebord, soit des imbrices demi-rondes et couvre-joints (Fig. 4). L’étude qui s’annonce devrait en pré-ciser la typologie et, par là même, la datation. Sur lesol emprisonné sous les tuiles reposait un fond d’as-siette en sigillée orientale A. D’ailleurs, la céramiqueassociée à cet ensemble architectural comprend à lafois des exemples de céramique fine importée(presque uniquement de la sigillée orientale A) desIer s. av - Ier s. ap. J.-C. et de la céramique commune
3) F. Blaizot, “L’ensemble funéraire tardo-antique de Porsuk : approche archéo-anthropologique (Ulukışla, Cappadoce méridionale,Turquie). Résultats préliminaires”, Anatolia Antiqua VII (1999) : 179-218.
216 DOMINIQUE BEYER et alii
Fig. 1 : Localisation du site de Porsuk (Zeyve Höyük).
Fig. 2 : Chantier IV. Localisation desfouilles et sondages 2009.
CAMPAGNE 2009 DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 217
Fig. 3 : Chantier IV. Nord-Est. Plan du niveau 1.
régionale, voire locale, qu’il est difficile de dater etque l’on fait habituellement remonter aux I-IIe etIIIe s. ap. J.-C4. Ce bâtiment aurait donc connu uneassez longue existence ainsi que tend à le prouverune monnaie de bronze (01582.2) découverte àl’angle des murs 01576 et 01086. Il s’agit d’unfollis de l’empereur Maximien, membre de laTétrachie et qui fut Auguste de 286 à 305 ap. J.-C.(Fig. 5a-b). A l’avers figure le buste lauré de
Maximien et sa titulature (IMP MAXIMIANUSAUG), au revers le génie du peuple romain deboutdevant un autel. Cette pièce (il conviendra d’en ap-profondir l’analyse pour en déterminer l’atelier d’ori-gine et la date d’émission) serait donc contemporainede la nécropole que l’on date au plus tôt du IIIe
s. ap. J.-C. et notre édifice aurait ainsi continué àfonctionner en lien avec l’espace funéraire.
Contre le mur oriental 01086, qui s’interromptvers le Nord, venait probablement s’appuyer lebassin rectangulaire 01571 (Fig. 6a-b). L’enduit trèsépais (souvent plus de 5 cm) qui le constituaitreposait sur un lit de galets de taille moyenne quel’enduit venait noyer. Fissuré et feuilleté, il montraitmaintes traces de recharge. A l’Est il remontait surle mur 01170 et venait s’adosser au Sud contre unpetit massif de briques percé d’une conduite elle-même enduite. Celle-ci couverte par une dalle plateaboutissait à une jarre 01611 enterrée jusqu’au colet calée de pierres, d’une forme atypique. Le liquide,
4) C. Abadie-Reynal, “La céramique du Haut-Empire à Porsuk”, in C. Abadie-Reynal (éd.), Les céramiques anatoliennes auxépoques hellénistiques et romaines. Actes de la table ronde d’Istanbul, 23-24 mai 1996, Varia Anatolica XV, Paris, 2003 : 101-111.
218 DOMINIQUE BEYER et alii
Fig. 4 : Tuiles : imbrices et tegulae.
Fig. 5 : Monnaie de bronze de l’empereurMaximien : a) face ; b) revers.
CAMPAGNE 2009 DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 219
Fig. 6 : L’installation hydraulique : a) vue vers l’Est ; b) plan et coupe.
de l’eau a priori, que recueillait le bassin inclinévenait rebondir, au sortir de la conduite, sur unressaut enduit pour aboutir au réceptacle profond de60 cm. A cet aménagement hydraulique (Fig. 3 et 6)venait s’ajouter une surface de travail égalementenduite en grande partie calcinée. Dans cette couchede destruction a d’ailleurs été mise au jour une jolielampe à huile hellénistique (01587.1) entière, mouléeet ornée d’un cerf bondissant (Fig. 7). Nos prochaineslectures devraient en préciser l’analyse. Un aména-gement hydraulique similaire a pu être installé del’autre côté du mur 01170 à l’Est, ainsi que lelaissent supposer les relevés même si aucune conduiten’avait été notée en 1971, lors des premières obser-vations dans ce secteur.
Ce niveau 1, ainsi que nous l’avions observé àmaintes reprises en H42 et I42, s’est établi souventdirectement sur les vestiges du niveau 2, ce qui enrend parfois complexe la distinction. Par exemple,le mur 01086 surmonte un mur 01603 plus ancien etau tracé presque parallèle (Fig. 8). C’est un murparticulièrement impressionnant, dont la largeur dé-
passe le mètre et composé de très grands blocs degrès et de gypse. Il présente au moins un retour01597 est-ouest. Un autre semble filer sous la bermeoccidentale que nous espérons explorer en 2010. Depart et d’autre du mur 01603, au Nord du secteur,avaient été installées deux grandes jarres dont l’une,01614, avait été réparée avec de l’enduit. A cet en-semble on peut associer un petit four circulaire01620 en terre, calé par des pierres et des tessonsdont deux cols de jarre posés de champ. Ce type defour à pain est très bien connu dans le secteur(fours 01179, 01153 et 01226 en 2005) mais cedernier est pour l’instant le mieux conservé. A ce ni-veau conséquent, correspond une céramique des Ier
et IIe s. av. J.-C. dont de nombreuses bases d’un-guentaria hellénistiques de type fusiforme.
Partir du point culminant du chantier IV etfouiller une zone jusque-là inexplorée ont ainsipermis d’éclaircir quelques points en suspens (laquestion de la couverture des édifices, de la gestiondes ressources hydrauliques…) et d’ouvrir de nou-velles perspectives sur l’articulation entre la nécropoleet le bâti ou encore sur la datation des niveaux 1 et 2et leur transition.
2. Sud : carrés J41 et K41 (Stéphane Lebreton)
La campagne de 2008 consacrée au chantier IV,pour le secteur K41, s’était arrêtée sur deux niveauxdistincts.
Dans la partie sud-est de K41, la fouille s’étaitterminée à une altitude de 103,07 m (00595). A cetendroit, aucune structure bien assurée n’était décelable.Les tessons devenaient rares et étaient plutôt carac-téristiques de l’Age du Fer. En conséquence, nousavons laissé à Dominique Beyer la poursuite destravaux dans la partie de ce secteur cette année.
Dans le reste du carré K41, les opérations de2008 avaient permis de dégager ici six niveauxd’occupation. Ceux-ci pouvaient être datés du IVe
s.-IIIe s. av. J.-C., pour le niveau le plus ancien, audébut du IIIe s. ap. J.-C. pour la dernière phase d’ha-bitation. Le dernier sol fouillé, le plus ancien, étaitsitué à une altitude de 104,62 m dans ce secteur(00594)5.
Nous avons repris cette année la stratégie adoptéeen 2008 en nous concentrant sur la fouille en pro-fondeur d’une même zone d’étude. Ainsi, nous avonspoursuivi l’étude de K41, tout en étendant la zonede travail au Nord, en J41. Il s’agissait en effet demieux comprendre l’organisation de l’espace pour
5) Voir D. Beyer et alii, “Zeyve Höyük (Porsuk). Rapport sur la campagne de 2008”, Anatolia Antiqua XVII (2009) : 330-339.
220 DOMINIQUE BEYER et alii
Fig. 7 : Lampe à huile hellénistique,face décorée d’un cerf bondissant et coupe.
CAMPAGNE 2009 DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 221
Fig. 8 : Chantier IV. Nord-Est. Plan du niveau 2 et vue du four 01620.
chaque niveau dégagé en essayant de mettre enrelation des aires cohérentes. Or, pour les phases lesplus récentes, les pièces dégagées en K41 semblaients’étendre en J41 entre les murs 01034, 01111 et01137-01049. C’est donc cet espace que nous avonsfouillé en J41 cette année. Cette surface avait com-mencé à être dégagée par C. Abadie-Reynal. Lestravaux ont été poursuivis en 2004. Cependant, lesrecherches se sont arrêtées sur la dernière phased’habitation, avant l’installation de la nécropole6.
3e phase en J41 (Fig. 9a)
Le deuxième niveau d’habitation (phase 3),fouillé en 2008 en K41, a pu être dégagé en J41cette année. Le sol 00513 en K41 se prolonge enJ41 à une altitude moyenne située entre 105,41 m et105,52 m (00621). Cet espace n’est alors fermé quesur sa partie est en J41 par le mur 01137-01049. AuNord, cette zone s’étend au-delà de la zone fouilléecette année. Il en est de même à l’Ouest. Le sol00621 passe sous le mur 01034. D’ailleurs, ce mur01034, lors de son installation a écrasé un pithos(00731), dégagé dans la coupe ouest du sondage, etun four (00681). Ce pithos 00731 et ce four 00681ont fonctionné lors de ce deuxième niveau d’habitation.Le four 00681 est encastré dans un amas construitde pierres et de briques en terre crue (Fig. 10). Cetteconstruction paraît s’organiser autour du four 00681.Un enduit, posé verticalement par couches successives,semble limiter le massif au Sud. Ces blocs séparenten partie, à l’Ouest, l’espace dégagé en 2009 en J41(00621) du sol fouillé en 2008 en K41 (00513)7.Dans cette phase a été retrouvée dans un petit troucomblé une série de vingt-neuf osselets (00621), enpartie percés (Fig. 11).
4e phase en J41 (Fig. 9b)
Le troisième niveau d’habitation (4e phase)fouillé cette année en J41 ne se différencie pas gran-dement du niveau supérieur. Cet espace n’est limitéqu’à l’Est, par le mur 01137-01049. Là encore,l’aire définie pour la fouille de 2009 n’a pas permisd’établir les limites de cette zone d’occupation àl’Ouest et au Nord. Le sol 00659-00685, à unealtitude moyenne de 105,25 m, continue vers le
Nord le niveau dégagé en K41 l’année dernière :00552 (105,10 m-105,14 m).
5e phase en J41 (Fig. 9c)
Lors du quatrième niveau d’habitation (phase5), l’espace fouillé en J41 a été scindé en deuxparties par le mur (00632) d’orientation ouest-est.Au Nord du mur 00632, un sol 00730, à une altitudede 104,90 m, a pu être fouillé. Les travaux de cetteannée se sont arrêtés sur ce niveau au Nord de00632. Au Sud du mur 00632, le sol 00713-00712(104,87 m-104,99 m) prolonge le niveau 00570fouillé en 2008. Il s’agit ici aussi du dernier niveaud’habitation fouillé pour l’année 2009 en J41. Lacampagne s’est en fait arrêtée à une altitude moyennede 104,70 m (00727).
6e phase en K41 (Fig. 9d)
Les fouilles de 2008, dans la partie sud-est deK41, avaient permis de dégager six niveaux d’occu-pation. La continuation des opérations dans la partiecentrale a montré que la situation était plus complexeà cet endroit et qu’il fallait certainement considérerneuf phases d’occupation. Les plans présentés dansces pages permettent de réajuster les relations entreles niveaux de la partie centrale de K41 et la zonesituée au Sud-est. Cette aire était fermée par desmurs au Nord (00448, 00549, 00660) et à l’Ouest(00442, 00550, 00646), ne permettant pas d’établirclairement les relations stratigraphiques entre lesdeux zones.
Ce cinquième niveau d’habitation (phase 6) aété fouillé en 2009. Il est composé des sols 00588(104,60 m-104,63 m) et 00520 (104,56 m-104,60 m).Deux pithoi sont présents dans ce niveau. Le premier(00596) est localisé au Nord-ouest de K41. Il vientse caler contre des pierres éboulées du mur 00416.Le second pithos est au Sud-est. Il s’adosse au mur00471. Le col de ce pithos est protégé par despierres qui en font le tour. L’ouverture a été obturéepar une dalle. Un foyer est installé à l’Ouest, dansl’angle formé par les murs 00416 et 00569. Lecendrier était un peu plus loin à l’Est. Cet espaceparaît se prolonger vers le Nord en J41 et vers leSud.
6) Pour le niveau le plus tardif, cet espace paraît avoir été fermé par quatre murs (01034, 01021, 01111, 01137-01049). Ce niveausemble contemporain de la nécropole. Lors de la phase d’habitation la plus tardive (phase 2), cet espace est ouvert vers le Nord.L’installation du mur 01111, au Nord, est postérieure à cette phase. Deux pithoi sont en relation avec cet état : 00610 au centre de lapièce et 00633 dans la coupe nord de la zone fouillée cette année. Le sol correspondant à ce niveau est situé à une altitude de 105,62 m-105,68 m dans la paroi de la coupe nord.
7) Le rapport précédent (Id., loc. cit. : 331 et 333) mettait en relation le sol 00513 dans la partie centrale de K41 avec le sol 00493dans la partie sud-est de K41. Or, 00513 semble davantage correspondre au sol 00499 (105,20 m-105,22 m) dans la partie sud-est deK41.
222 DOMINIQUE BEYER et alii
CAMPAGNE 2009 DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 223
Fig. 9 : Chantier IV. Carrés J41 et K41. Plans des phases 3 (a), 4 (b), 5 (c) et 6 (d).
Fig. 10 : Chantier IV. Vue du four 00681. Fig. 11 : Chantier IV. J41 : osselet percé de la phase 3.
7e phase en K41 (Fig. 12a)
Le sixième niveau d’habitation (phase 7) estcomposé du sol 00622-00628 (104,50 m-104,58 m)et dans la partie sud du sol 00520 (104,56 m-104,58 m). Deux fours ont été dégagés au Nord, à lalimite de K41 et de J41 : 00627 et 00639. Ceux-cidevaient fonctionner en relation avec une structureen forme de fer à cheval (00628) dont la fonctionn’a pas pu être précisée.
En fait, il a dû se passer peu de temps entre lesixième et le cinquième niveau d’habitation (phase7 et 6). Alors que dans le sixième niveau d’habitation,cet espace était ouvert vers l’Ouest et vers le Sud,lors du cinquième niveau d’habitation la communi-cation orientale a été fermée par l’installation dumur 00471. C’est au même moment ou peu aprèsque le pithos 00522 a été installé. Au Nord-est,l’éboulement des assises supérieures du mur 00416a écrasé le four 00627. Certaines de ces pierres ontété retrouvées à l’intérieur du four en relation avecdes parties effondrées de la paroi supérieure du four.Ce secteur a été rapidement nettoyé. Quelques pierresparaissent avoir été enlevées. Un pithos (00596) aété posé au-dessus du four 00627, profitant certai-nement de l’emplacement disponible.
8e phase en K41 (Fig. 12b)
Ce septième niveau d’habitation (phase 8) connaîtune modification conséquente de l’organisation del’espace. Ce secteur est divisé en trois grandes zonesdélimitées par les murs 00646, 00555, 00569 et00660. Les murs 00646 et 00569 s’appuient sur lemur 00416 qui paraît très important dans l’agencementde cette aire. 00416 ferme en effet cet espace àl’Ouest. Au Nord-est, les murs 00416, 00646 et00555 définissent une aire confinée, composée dusol 00658-00675 (104,20 m). Cet espace ne peuts’étendre que vers le Nord, en J41. Les murs 00569-00660 dessinent un deuxième secteur au Sud quiparaît se prolonger vers l’Ouest et peut-être vers leSud. Le sol 00654 est ici à une altitude de 104,29 m-104,30 m. Enfin, une troisième aire est composéed’une sorte de réduit fermé à l’Ouest par le mur00416 qui s’ouvre vers l’Est de la zone. Le sol00642-00672 est à 104,27 m-104,28 m d’altitude.
9e phase en K41 (Fig. 12c)
Ce dernier niveau d’habitat est peu structuré. Ils’agit davantage d’une aire de travail structurée par
la présence d’un four (00705). La structure circulaire,présente en coupe dans la partie sud de l’aire fouilléeen 2008 (00525), pourrait être mise en relation avecce niveau8. Plus aucun mur n’apparaît à cette phaseet antérieurement.
De façon générale, les fouilles de cette annéeont permis de confirmer les résultats de 2008. Cesecteur a été occupé par une succession de différentsniveaux d’habitation, sans discontinuité, de l’époquehellénistique au début du IIIe s. ap. J.-C. Aucunerupture, aucune couche d’incendie ou de destructionn’est repérable à cet endroit. Une même communautéparaît avoir occupé les lieux sur plusieurs générationspendant cinq à six siècles. De fait, le même typed’organisation de l’habitat revient régulièrement.Les pièces paraissent être structurées par l’installationd’un ou plusieurs pithoi et d’un four alimentaire detype tannur. Le type de céramiques, et plus généra-lement le matériel, varient peu d’un niveau à unautre. L’ensemble témoigne d’une occupation do-mestique, dont les formes semblent perdurer dans letemps. De la même façon, nous sommes arrivés auxmêmes constatations qu’en 2008 dans ce secteur deK41 : les véritables changements, observables ar-chéologiquement, se situent entre l’Age du Fer etl’époque hellénistique. Les premières phases d’ha-bitation, les plus anciennes, dans ce secteur sont à104,08 m environ. Par la suite, c’est-à-dire à unniveau inférieur, les sols deviennent rares et diffici-lement identifiables. Surtout, plus aucun mur nepeut être rattaché à ces niveaux. Ainsi, les structuresd’occupation sont plus ténues et l’activité paraîtavoir été moins importante. Il est possible que lorsde la première phase d’habitation pour la périodehellénistique (c’est-à-dire le niveau le plus ancien :phase 9), des travaux de terrassement aient étéentrepris bouleversant les couches inférieures. Maiscette hypothèse reste à vérifier.
Les travaux se sont arrêtés à une altitude de103,60 m en moyenne en K41.
Par ailleurs, la campagne de 2009 nous a donnél’occasion d’avancer sur un certain nombre de points.L’étude des lampes à huiles et des monnaies, décou-vertes lors des années précédentes pour la dernièrephase d’habitation avant l’installation de la nécropole,a permis d’affiner la datation de ce niveau (phase2). Nous avons en effet un matériel qui peut êtredaté de la fin du IIe s. au début du IIIe s. ap. J.-C.Cette proposition coïncide avec la datation avancée
8) Id, loc. cit. : 335.
224 DOMINIQUE BEYER et alii
CAMPAGNE 2009 DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 225
Fig. 12 : Chantier IV. Carrés K41 et K42. Plans des phases 7 (a), 8 (b) et 9 (c).
par C. Abadie-Reynal à partir de l’étude de la céra-mique9. Cette fourchette chronologique paraît doncassez fiable.
Parallèlement les fouilles de cette année ontrévélé l’importance du mur 00416, d’orientationnord-sud, situé à la limite occidentale de K41. Cemur, à la fois épais (80 cm en moyenne) et haut (unpeu plus de 1,80 m), pourrait avoir eu une place si-gnificative dans l’organisation de cet espace pourles niveaux hellénistiques. Il sera intéressant devérifier son rôle lors des prochaines campagnes. Onpeut se demander s’il n’a pas séparé deux espacesaux fonctions distinctes.
La campagne 2009 a aussi montré de façon plusnette la complexité de l’agencement des niveaux.Nous avions retenu l’existence de six niveaux d’oc-cupation en K41 à partir des résultats obtenus en2008. Les fouilles de 2009 ont permis de complétercette donnée. Neuf niveaux d’occupation peuventêtre proposés à présent. De la même façon, à partirdes relevés établis sur trois campagnes (2005, 2008et 2009) en J et K41, nous commençons à avoir deséléments d’information permettant peu à peu deproposer des hypothèses sur l’organisation des bâti-ments par phase d’habitation.
A cette fin, l’étude du matériel reste une priorité.Ainsi, un nouveau fer de lance a été trouvé en K41dans les niveaux hellénistiques les plus anciens(00708, 104,04, phase 9). Une lame de fer a été dé-couverte également en K41 dans les mêmes niveaux(00689, 103,98 m). Ces deux objets sont à ajouteraux deux autres armes découvertes en 2008 dans lemême secteur, mais à des niveaux supérieurs10. Lesarmes, mises au jour en 2008 (talon de lance etpointe de flèche à douille), ne sont pas suffisammentcaractéristiques. Elles peuvent avoir été aussi bienutilisées pour la guerre que pour la chasse. Espéronsque le fer de lance et la lame de fer trouvés cetteannée puissent nous apporter davantage d’informationsdans ce domaine. Dans les mêmes niveaux, égalementen K41, nous pouvons signaler la découverte d’unpetit autel domestique en terre crue (00721, 103,95 m).Enfin, en J41, la statuette d’un petit taureau présentantune bosse dans le dos (Fig. 13) a été trouvée en00698 (105,05 m-105,10 m), c’est-à-dire, entre laphase 4 et 511.
Malheureusement, le matériel jusqu’à présentdécouvert dans ce secteur n’est pas assez bien connupour être utilisable comme marqueur chronologique.Or, si nous arrivons à délimiter stratigraphiquementces grandes phases d’habitation, il est pour l’instantdifficile d’en affiner la datation. Il importe aussi demieux comprendre les structures d’habitation et demieux approcher l’identité de leurs occupants. Ilserait en particulier intéressant d’avoir plus d’infor-mations sur l’installation du premier niveau d’habi-tation hellénistique.
Seule l’extension de la fouille nous permettrad’en savoir davantage.
3. Le sondage profond en K41 SE (Fig. 14-16)(Dominique Beyer)
Préparé l’an dernier, le terrain dans ce secteurrelativement étroit a été fouillé jusqu’à la base descouches archéologiques. Il a donc été possible d’ex-plorer ainsi le niveau hittite du Bronze Récent(Porsuk V) pour compléter les informations recueilliesces dernières années plus à l’Est, au contact avec lescaissons du système de fortifications.
Auparavant, ce sont les couches de l’Age du Ferqui ont été examinées. Comme déjà évoqué plus
9) Par exemple, dans C. Abadie-Reynal, “La céramique du Haut-Empire à Porsuk”, in C. Abadie-Reynal (éd.), Les céramiquesanatoliennes aux époques hellénistiques et romaines. Actes de la table ronde d’Istanbul, 23-24 mai 1996, Varia Anatolica XV, Paris,2003 : 102. La datation proposée par C. Abadie-Reynal est plus large : IIe s.-IIIe s. ap. J.-C.
10) Voir D. Beyer et alii, “Zeyve höyük (Porsuk). Rapport sur la campagne de 2008”, Anatolia Antiqua XVII (2009) : 377-378.11) Ce taureau est à mettre en relation avec la figurine d’un autre taureau, découverte en 2008, dans le secteur Nord (H42/43 et
I42/43) pour les niveaux hellénistiques. Voir Id., loc. cit. : 318 et 322.
226 DOMINIQUE BEYER et alii
Fig. 13 : Chantier IV. Figurine de taureau àbosse. Terre cuite.
CAMPAGNE 2009 DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 227
Fig. 14 : Chantier IV. Sondage profond de K41 SE. Vue générale du secteur (a), détail (b).
haut, ces dernières se caractérisent, au moins dansce secteur étroit, par l’absence d’une architectureconservée. Seuls d’importants éboulis de grossespierres, dans les couches supérieures, pouvaient enêtre considérés comme les vestiges. Le secteur a étéen outre perturbé par une fosse du côté sud, quirejoint la grande fosse mise en évidence il y aquelques années à l’Est de la “pièce hittite”, entamantles couches jusqu’au sol hittite du Bronze Récent.Dans notre sondage étroit, la découverte, à l’altitudede 101, 70 m env., d’un sol bien conservé, régulier,à surface orangée légèrement cendreuse (00908), aété plutôt une surprise. Du côté nord, ce sol s’inter-rompait sur les débris cuits par l’incendie du sommetde la couche briqueteuse du Bronze Récent (PorsukV), qui avait visiblement été laissée à l’état de ruinepar les occupants de la phase du Fer (Porsuk IV).Malheureusement, peu de matériel clairement datablea été retrouvé sur ce sol. En dessous, mais du côtésud seulement, des couches de terre grise (00909)
contenaient de la céramique du Fer, mais une foisde plus très mélangée Fer Moyen et phase plus an-cienne du Fer. Du côté ouest dans le sondage, cescouches de terre grise aboutissent très profondément(jusqu’à 100, 77 m), formant fosse circulaire, endessous même du niveau du premier sol du BronzeRécent aménagé sur la surface naturelle du höyük(Fig. 15). Cette observation confirme ce que noussavons par nos travaux ici ou là : les occupants duFer, après un abandon consécutif à la destruction duniveau du Bronze Récent, ont creusé parfois trèsprofondément dans les couches du Bronze, demanière ponctuelle, alors qu’ailleurs ils ont longtempslaissé ces ruines du Bronze en l’état.
Le niveau du Bronze a livré pour sa part, malgréla présence d’une fosse et de creusements du Fer, unsol cendreux noir sur lequel reposait la couche dedestruction 00907 du niveau Porsuk V, par endroitsconservée à plus d’un mètre de hauteur. Au sol, desfragments de jarres bousculées par l’éboulement
228 DOMINIQUE BEYER et alii
Fig. 15 : Chantier IV. Sondage profond de K41 SE. Niveau du Bronze Récent percé par la fosse 00909.Vue vers le Nord-ouest.
des murs environnants, à superstructure de briquessur socle de pierres, qui devaient être calées, ici etlà, par de grosses pierres. Une jarre un peu mieuxconservée, couchée sur le côté, a pu être dessinée(00907.1, Fig. 16). Elle est du type hittite habitueldans ce niveau, de taille moyenne (60 cm env. dehauteur), à quatre tenons sur l’épaule. La jarre abuté dans sa chute sur les restes d’un mur 00910orienté est-ouest, dans le même axe que le mur00026, connu depuis le début des travaux à Porsuk,mur nord de la “pièce hittite”, mais décalé vers leNord. Ce mur 00910, dont il n’a pas encore été pos-sible de repérer l’épaisseur, n’est plus conservé ac-tuellement que par la ligne d’enduit argileux de saface sud, sur 40 cm de hauteur maximale, cuit parl’incendie. L’intérieur du mur semble avoir beaucoupsouffert. D’après les vestiges encore en place, surtout
les restes, au niveau du sol, de pièces de boiscarbonisé, longues et étroites, le mur, simple cloisonou mur véritable (?), était constitué de terre avec ar-mature de bois associée, sans doute, à quelques ga-lets12.
Le niveau atteint par Stéphane Lebreton dans lereste du carré K41, cette année, permet d’espérerqu’en direction du Nord, s’il nous est encore possiblede fouiller en 2010, l’étude des niveaux du Fer et duBronze sera grandement facilitée : on s’éloigne alorsdes zones sud très perturbées, et l’épaisseur de lacouche de destruction du niveau V apparaît garantieà 1 m environ. Le secteur est d’autre part pluséloigné du système des caissons de fortification,que nous connaissons bien maintenant, et nous de-vrions avoir la perspective de pouvoir étudier da-vantage l’intérieur du höyük.
12) Cette technique de construction est bien attestée à Porsuk durant la période hittite, au chantier II comme au chantier IV.
CAMPAGNE 2009 DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 229
Fig. 16 :Chantier IV.Sondage deK41 SE. Profilde la jarre00907.1 duBronze Ré-cent.
230 DOMINIQUE BEYER et alii
Fig. 17 : Chantier II. Plan d’ensemble des secteurs H07 et G06.
II. CHANTIER II
Les travaux ont été poursuivis en 2009 dansdeux secteurs distincts en H07 et G06 (Fig. 17).
1. Carrés G06 - G07 (Fabrice De Backer)
Un nouveau sondage de 12,60 m de long sur5,60 m de large a été ouvert cette année sur leChantier II, à la jonction des carrés G06 et G07.
L’objectif de cette opération visait à dégager le pa-rement nord et à étudier le tracé oriental du “massif16”, un mur de plus de 4 m d’épaisseur dont l’extré-mité occidentale avait été dégagée en 197013. A cetendroit, la surface du site (niveau altimétrique :114,26 m) avait été arasée par un bulldozer en 1961.La base du mur a été atteinte à une profondeur de2,50 mètres (111,70 m).
13) O. Pelon, “Rapport préliminaire sur la deuxième et la troisième campagne de fouilles à Porsuk-Ulukışla (Turquie) en 1970 et1971”, Syria 49 (1972) : 304-306, fig. 4.
A la fin des travaux de cette campagne sur cesecteur, la fouille a révélé quatre phases d’occupationséparées par deux phases d’abandon.
a) Phase d’occupation n° 1 (Fig. 18)
Sous la couche de surface (03300), constituéedes déblais de fouilles plus anciennes, se trouve lacouche archéologique (03301) que la prise de terrepar le bulldozer avait fortement perturbée. Celle-cicomporte deux fonds de grosses jarres (Fig. 19,03302 et 03303), arasées par les travaux modernes(114,25 m-113,73 m), ainsi que de nombreux tessonsde céramique commune utilitaire très abîmés, etquelques-uns de céramique sigillée. Parmi des frag-ments d’ossements issus de restes alimentaires, lesespèces ovines et bovines sont les plus représentées.Un élément de sculpture architectonique de gypseorné d’une moulure (03301.1) y fut mis au jour éga-lement.
b) Phase d’abandonEn dessous de cette première phase d’occupation,
nous avons observé une couche d’abandon (03308),ne comportant aucune trace de destruction et dont le
matériel est constitué encore de tessons de céramiquecommune hellénistique et sigillée, ainsi que de frag-ments d’os issus de bovins et d’ovins consommés.Un tesson de céramique dite “West Slope” hellénis-tique, de très petites dimensions, figure égalementau registre des découvertes de cette couche14.
c) Phase d’occupation n° 2Dans cette couche, nous avons découvert une
deuxième série de grosses jarres d’entreposage, oupithoï (03312 et 03314) situés entre 113,90 m et112,76 m. Trois petits murets réalisés en blocs degypse de petite taille (03316, 03317 et 03318) per-mettaient de stabiliser la base de la jarre 03312. Lacéramique associée à ces récipients comporte es-sentiellement de nombreux tessons très communs,représentant les périodes hellénistique et romaine.Dans la jarre 03314, nous avons découvert les frag-ments nombreux d’une autre jarre d’entreposageplus petite. La décoration de celle-ci comporte unmotif répété de triangles et de lignes15. Les ossementsque nous y avons mis au jour proviennent d’animauxconsommés, tels que des bovins et des ovins.
14) Pâte orange clair, décoré de feuilles de vignes stylisées à l’engobe ocre clair sur fond noir.15) D’après Stéphane Lebreton, cela pourrait correspondre à la période proto-hellénistique.
CAMPAGNE 2009 DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 231
Fig. 18 : Chantier II. G06-G07 : plan des phases 1 et 2.
Au Sud, nous avons observé deux amas plus oumoins circulaires de blocs de gypse (03311 et 03319),situés entre 113,76 m et 113,28 m. Au Sud-est deG07, une autre jarre (03325), très fragmentaire, re-posait au sein d’un éboulis de morceaux de céra-miques, de tuiles (03326) et de pierraille (03320) àune altitude similaire (113,67 m-113,35 m).
A l’Ouest, le sommet arasé du “massif 16”(03304), constitué de blocs de gypse de petit calibreet comportant encore quelques petits chaînages debois non carbonisé, formait une saillie à la hauteurdu fond des deux premières jarres.
d) Phase d’abandonSous cette seconde phase d’occupation, nous
avons dégagé une autre couche d’abandon (03309),comportant un matériel presque similaire à celuides précédentes : restes alimentaires d’ovins et debovins ainsi que des tessons de céramique hellénistiqueet sigillée communs très abîmés.
Deux petits ciseaux de bronze à tête pointue,03309.1 et 03309.3, ainsi qu’une très petite monnaiehellénistique du même métal, 03309.5, y furent dé-couverts. Un fragment de petite lampe à huile(03309.7)16, sans doute d’époque hellénistique,constitue le dernier élément remarquable de cettecouche.
Sur l’angle nord-est de la section effondrée dumur antérieur 03322, nous avons dégagé les fragments
d’une jarre (03327, Fig. 21) qui témoigne sans douted’une brève période d’occupation sur ce point (entre112,46 m et 112,19 m) après l’abandon du secteur.
e) Phase d’occupation n° 3 (Fig. 20)
Sous ce niveau, entre 113,06 m et 111,70 m,nous avons découvert une autre phase d’occupationqui comprenait deux murs de blocs de gypse, formantun angle droit. Le mur 03310, de 2 m sur 1,40 m, estorienté ouest-est suivant une pente descendante danscette direction. L’assise supérieure prend appui àl’Est sur le mur 03324. L’extrémité occidentale dumur 03310 comporte un parement bien aligné, plaquécontre le parement du mur 03304. A l’Est, le parementdu mur 03324 n’est pas conservé. Il recouvre unmur 03322, d’orientation nord-sud également. L’ex-trémité septentrionale de celui-ci se perd dans lapente du site, sans doute suite à l’érosion naturelle(Fig. 22).
f) Phase d’occupation n° 4 (Fig. 20)
La dernière couche que nous avons fouilléeconfirme que le mur 03304 reposait sur un chaînagede rondins de bois non carbonisés17, très longs (3 m),parallèles (03328) au parement du mur ou perpendi-culaires (03329), déjà observés précédemment plusà l’Ouest (Fig. 23). Ils sont disposés sur un mêmeplan qui n’est pas horizontal, mais descend del’Ouest vers l’Est (113,33 m à l’Ouest ; 112,14 m àl’Est). Sous cette nappe de rondins, nous avonsdégagé le mur 03321, constitué essentiellement deplaques de grès, et qui suit la même pente que lesmurs 03304-03310, avant de disparaître sous le mur03324.
D’après des échantillons prélevés sur le rondinsitué à l’Ouest de 03328, dans son prolongement,par O. Pelon en 1970, le C14 donne une datation ca-librée de 1080-740 B.C. Ce résultat concerne l’étatde la fortification qui comprenait les rondins. Maisnous n’avons pas encore pu déterminer s’il s’agit dela partie sous les rondins (mur 03321) seule, ou as-sociée à la partie supérieure (mur 03304), ouseulement ce dernier mur. Seule une étude plus ap-profondie permettrait de le comprendre et de savoirsi cet ensemble pourrait correspondre à une courtinede rempart ainsi qu’à un départ de tour.
16) Fragment de lampe 03309.7 à panse carénée et à fond plat : longueur : 5,36 cm, hauteur : 2,37 cm, profondeur du réservoir :1,74 cm.
17) Nous avons prélevé quelques échantillons afin d’en affiner la datation par les méthodes du C14 et de la dendrochronologie. Lesprélèvements 03310.1 et 03310.2 furent envoyés au laboratoire de la Cornell University (New York).
232 DOMINIQUE BEYER et alii
Fig. 19 : Chantier II. G06-G07 : fonds de jarresde la phase 1. Vue vers l’Ouest.
CAMPAGNE 2009 DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 233
Fig
. 20
: C
han
tier
II.
G06
-G07
: p
lan
des
mu
rs d
es p
has
es 3
et
4.
234 DOMINIQUE BEYER et alii
Fig
. 21
: C
han
tier
II.
G06
-G07
:fr
agm
ents
d’u
ne
jarr
e 03
327.
Fig
. 22
: C
han
tier
II.
G06
-G07
: m
ur
0332
2,sa
ns
dou
te d
épar
t d
e to
ur.
Vu
e ve
rs le
Nor
d.
Fig
. 23
: C
han
tier
II.
G06
-G07
: r
este
s d
es r
ond
ins
de
boi
s(0
3328
) d
ans
le m
ur.
Conclusions
On aura remarqué la division de la fonction del’espace qui s’étend sur les carrés G06-G07 en deuxgrandes périodes.
La première correspond à un ensemble fortifiéqui a connu plusieurs phases de construction, dontune qui se situe aux alentours du début du premiermillénaire.
La seconde période d’occupation de ce secteurse distingue par la multiplication des niveaux com-prenant des infrastructures de stockage similaires :les pithoi. En effet, les espaces aménagés pour lestockage de denrées montrent des traces d’abandon,puis sont recouverts de couches de déchets d’ordrealimentaire, qui furent elles-mêmes recreusées pourassurer la base des jarres installées aux niveaux sui-vants (03302-03303, 03325, 03312-03314 et 03327).La céramique de ces niveaux montre clairement unedatation remontant à des périodes plus tardives, hel-lénistique ou romaine.
La suite de la fouille de ce secteur devrait per-mettre de répondre aux interrogations que posentles éléments découverts durant cette campagne.
Il faudrait d’abord élargir les recherches sur le“massif 16”, afin de pouvoir en observer le tracéoriental et le parement sud, et de pouvoir en étudierla relation avec les infrastructures voisines, commela “Maison aux pithoi”.
Dans un deuxième temps, on pourrait approfondirla connaissance des niveaux anciens situés sous lesphases gréco-romaines, afin de pouvoir préciserl’identification de la courtine et sa relation avecl’ensemble des fortifications découvert sur le site.
2. Travaux en H07 (Aksel Tibet)
Un nouveau sondage de 4 m x 8 m avait étéouvert en 2008 dans la moitié nord du carré H07(Fig. 24a) pour, d’une part dégager l’extension versle Nord de la “Maison aux Pithoi” fouillée dans lesannées 1970, et d’autre part, pour avoir la séquencechrono-stratigraphique complète à cet endroit situéjuste à l’Est du secteur où s’étaient concentrés depuisde longues années les travaux dans le chantier II.
Les fouilles de l’an dernier avaient permis demettre au jour deux niveaux architecturaux. Situésous un remblai perturbé par les travaux du bulldozeren 1962, le niveau le plus récent était représenté parune cuve en mortier de gypse (03504) en relationavec une surface d’utilisation (03505) qui avait puêtre suivie par endroits dans la moitié est du sondage,et peut-être aussi associée à deux murs de pierres
(03512 et 03513) perpendiculaires visibles seulementen parement dans l’angle nord-est du sondage. Nousavions pu dater par le matériel céramique associécet ensemble de la phase Porsuk I (période romaine).Le second niveau repéré en 2008 était représentépar un certain nombre de murs de pierres (03502,03507, 03508 et 03511) qui appartiennent probable-ment à la “Maison aux pithoi” qui se trouve juste auSud (Fig. 24a). Le matériel céramique associé avaitmontré que ces vestiges appartiennent à la phasePorsuk II (période hellénistique).
En 2009, les travaux ont été concentrés dans lamoitié est du sondage, sur une superficie de 4 m x4 m environ. La fouille a débuté à partir de lasurface d’utilisation 03505 de la phase Porsuk Irepérée l’an dernier à 113,15 m, avec l’objectif devoir si les tronçons de mur 03502 à l’Est et 03508 àl’Ouest, dégagés en 2008, appartiennent bien à unmême mur comme il avait été supposé alors. Laprogression des travaux a montré que ces deux tron-çons formaient bien un mur unique orienté est/ouest,longeant le côté sud du sondage sur toute sa longueur.Ce mur qui constitue très probablement la limitenord de la “Maison aux pithoi” est formé de bas enhaut dans sa partie orientale (Fig. 25), la mieuxconservée, par 2 assises de gros galets suivies de 3 à4 assises de gypse et d’une assise de plaques ausommet. Son assise de fondation présente un pendageascendant d’Est en Ouest (base du mur à l’Est :112,32 m ; à l’Ouest : 112,92 m). Deux pithoi(03515 à l’Ouest et 03516 à l’Est) qui avaient étédéjà repérés en 2008 engagés dans la paroi nord dusondage, ont pu être un peu mieux dégagés cetteannée (Fig. 26). Dans leur partie visible, ces jarressont en assez bonne condition de conservation, maisleur tiers supérieur manque, probablement coupépar le bulldozer en 1962. Le mur 03502/03508 ainsique les pithoi 03515 et 03516 font partie très proba-blement de la “Maison aux pithoi” et appartiennentau niveau architectural le plus récent de l’époquehellénistique observé dans le sondage en H07 (PorsukIIa).
Le parement sud du mur 03502 comporte un en-duit de mortier de gypse visible sur une longueur de1,45 m depuis la limite est du sondage ; au-delà,l’enduit, d’une épaisseur de 4 à 5 cm, tourne à angledroit vers le Sud. On le suit environ sur 0,40 m dansl’espace exigu qui se trouve entre le parement dumur et la limite sud du sondage. Il s’agit là très pro-bablement d’une installation (03517) tardive (phasePorsuk I) de type bassin, qui a été aménagée dans laterre en utilisant partiellement le mur 03502 alorsque celui-ci était déjà enfoui. Le fond du bassin
CAMPAGNE 2009 DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 235
CAMPAGNE 2009 DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 237
Fig. 26 : Chantier II. H07 Nord. Jarre 03516. Vue depuis le nord.
Fig. 25 : Chantier II. H07 Nord. Partie orientale du mur 03502/03508. Parement nord.
03517 a été repéré à 112,64 m tandis que le pointculminant conservé de l’enduit sur le parement dumur se trouve à 113,09 m, ce qui donne uneprofondeur de 0,45 m pour cette installation. Lebassin 03517 doit être probablement mis en relationavec la cuve 03504, la surface d’utilisation 03505 etles murs 03512-03513 dégagés en 2008 et appartenantà la phase Porsuk I (période romaine).
Les travaux de 2009 en H07 ont permis demettre au jour un niveau architectural plus ancien–IIb– de l’époque hellénistique, représenté par unpodium (03520), un foyer ou un four (03521), unsol en terre battue (03522), un mur (03523) et undallage (03525) (Fig. 24b et 27).
Le podium 03520, de plan rectangulaire auxangles arrondis (dimensions de la partie dégagée :1,30 m x 0,62 m ; hauteur 0,39 m), est en terre com-pactée (Fig. 24b et 28). Il présente trois parois verti-cales enduites. Sa surface supérieure, horizontale,comporte des traces d’un enduit de même natureque sur les parois qui semble remonter au moins àun endroit contre le parement nord du mur 03502.Or le podium est certainement antérieur au mur caril a été coupé au moment de la construction de cedernier. De plus, le podium descend nettement plusbas (112,06 m) que la base du mur à cet endroit(112,32 m). Une explication possible de la présencede l’enduit sur le parement du mur est qu’au momentde l’utilisation de celui-ci le sommet du podium,alors totalement enfoui, ait pu correspondre à un solqui a disparu partout ailleurs. D’ailleurs, au momentde la fouille, à l’altitude qui correspond au sommetdu podium (ca. 112,50 m), des zones de terre pluscompacte ont été observées surtout le long du mur03502, sans que l’on ait pu y identifier la présenced’un sol.
Le foyer ou four 03521 (Fig. 24b et 29) de plancirculaire est adossé au podium du côté est et passesous l’assise de fondation du mur 03502. Façonnéen argile, il a pu être dégagé sur un peu plus que samoitié. Mais sa fouille restant incomplète, il a étéimpossible de décider s’il s’agit d’un four ou d’unfoyer. Son diamètre extérieur est de ca. 0,60 m etl’épaisseur moyenne de ses parois est de ca. 8 cm.Située à 112,03 m sa sole présente des traces de feu.
Un sol en terre battue (03522) caractérisé par laprésence d’une multitude de particules blanchescollées à la surface, a pu être observé autour dupodium 03520 et devant le foyer 03521 auxquels ilest associé (altitude au nord 112,06 m ; au sud
111,91 m). Il a été dégagé sur une aire de1,68 m x 2,54 m, mais son état de conservation estmédiocre dans sa partie nord. Il semble continuer àl’Ouest dans la partie non fouillée du sondage tandisqu’à l’Est, il s’arrête contre le mur 03523.
Le mur 03523 orienté nord-sud a été dégagé sur2,20 m de longueur à partir de la berme nord dusondage (Fig. 24b, 27 et 30). Dans son état actuel deconservation, il est constitué par une seule assise depierres (grès et gypse) disposées en 2 rangées en pa-rement avec un remplissage intérieur de pierres pluspetites. Son extrémité sud est constituée par deuxblocs de forme assez plate qui sont dans l’alignementdes blocs formant la limite sud du dallage 03525(cf. infra). Son épaisseur moyenne est de 0,50 m.
Le dallage 03525 constitué de plaques de grèsde grandes dimensions, de forme rectangulaire outrapézoïdale irrégulière, débute à une trentaine decentimètres du parement est du mur 03523 et seprolonge vers l’Est et le Nord, au-delà des limitesdu sondage. Sa limite sud est constituée par quelquesblocs grossièrement parallélépipédiques qui formentune sorte de muret bas orienté est-ouest. Le vide quiexiste entre le mur 03523 et le dallage n’a pas puêtre encore expliqué.
La fouille du sondage en H07 va être poursuivieen 2010, d’abord dans sa moitié ouest, ensuite surtoute sa superficie afin d’atteindre les niveaux plusanciens. Nous pouvons dire d’ores et déjà que lescouches dans ce secteur sont relativement moinsperturbées que dans la zone des fortifications, cequi a permis d’établir une séquence chrono-strati-graphique plus sûre comme il avait été préconisé.
3. Travaux en G06 (Aksel Tibet)
Les travaux dans le sondage profond 03095 auNord de la tour de fortification du Bronze Récentavaient été arrêtés à l’altitude de 108,25 m à la finde la campagne 2007, sans pouvoir atteindre le basde la tour. La fouille a repris cette année au fond dusondage, sur une surface plus réduite de0,90 m x 1,20 m, située dans l’angle nord-ouest,avec le but d’atteindre la base du mur 03093, murnord de la tour. A la fin des travaux de 2007 était ap-parue une poutre carbonisée horizontale placée dansle parement du mur comme chaînage (108,25 m).Le sondage réduit de 2009 a permis de dégager sousle niveau de la poutre quatre assises de grès qui pré-sentent une maçonnerie beaucoup plus régulière quela partie au-dessus de la poutre de chaînage
238 DOMINIQUE BEYER et alii
CAMPAGNE 2009 DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 239
Fig
. 27
: C
han
tier
II.
H07
Nor
d. V
ue
gén
éral
e d
epu
is le
nor
d d
ela
zon
e fo
uil
lée
en 2
009.
Fig
. 28
: C
han
tier
II.
H07
Nor
d. P
odiu
m 0
3520
.V
ue
dep
uis
le n
ord
.
Fig
. 29
: C
han
tier
II.
H07
Nor
d. F
oyer
ou
fou
r 03
521.
Vu
e d
epu
is le
nor
d.
Fig
. 30
: C
han
tier
II.
H07
Nor
d. M
ur
0352
3 et
dal
lage
035
25.
Vu
e d
epu
is le
su
d.
CAMPAGNE 2009 DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 241
Fig. 33 : Chantier II. Couverture provisoire de la tour du Bronze Récent. Vue depuis le Nord-ouest.
Fig. 32 : Chantier II. G06. Partie inférieure de la face nord de la tour du Bronze Récent.
(Fig. 31-32). La base du mur a été atteinte à 107,20 m.L’assise de fondation fait une avancée de 0,20 à0,30 m par rapport au parement. La hauteur totalede la partie dégagée en 2009 est de 1,03 m, sur unelongueur de 0,86 m.
Des travaux de protection, encore provisoires,ont été également entrepris pour préserver la super-structure de briques de la tour du Bronze Récent :une couverture de plaques ondulées a ainsi été dis-posée, en tenant compte de l’importance des ventsdominants en provenance du Nord-ouest, c’est-à-dire du plateau anatolien (Fig. 33).
L’ampleur de la campagne de 2009 a été réduiteen raison des efforts consacrés aux travaux prépara-
toires à une publication. Elle a néanmoins permisdes avancées appréciables dans notre connaissancedes différentes phases d’occupation du site. Il resteà opérer certaines jonctions entre secteurs, au ChantierIV en particulier, pour affiner la stratigraphie desniveaux les plus récents et leur interprétation. Leterrain a également été préparé, au chantier II commeau chantier IV, pour une exploration en profondeurdans les niveaux du Fer et du Bronze qui présententencore bien des incertitudes, mais un intérêt certain,dans la mesure où on y pénètre davantage à l’intérieurdu höyük. La question de la nature et de la configu-ration des fortifications à travers le temps, dans lapartie est du chantier II, reste entre autres à définir.
D.B. et al.
242 DOMINIQUE BEYER et alii




























![[081] Mauné et al. 2014: Stéphane Mauné, Enrique García Vargas, Oriane Bourgeon, Séverine Corbeel, Charlotte Carrato, Sergio García-Dils de la Vega, Fabrice Bigot y Jacobo Vázquez](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6344899a03a48733920aeeef/081-maune-et-al-2014-stephane-maune-enrique-garcia-vargas-oriane-bourgeon.jpg)