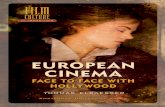Epstein-Barr virus expression within keratinizing nasopharyngeal carcinoma
Gide face � Barr�s
Transcript of Gide face � Barr�s
Orhis Litterarum 1985. 40. 3 3 4 3
Gide face a Barres Peter Schnyder, Oltm, Suisse
Au Professeur Pierre-Olivier Walzer, a I’occasion de son 70’ anni- versaire.
Sa premiere gloire, Gide la dut au fait d’avoir ose s’attaquer a deux de ses pairs plus celebres que h i : Maurras et Barres. Ainsi, la polemique qui I’opposa au second, des 1898, eut bien plus decho que la publication de chacun de ses livres, de Paludes a Llmmoraliste. De Iri ri le reduire a un ccanti-Barres)), et a ne lui reconnaitre d’autre merite que celui de I’inversion ou de la negation des theses de I’ccenracinementn, i l n’y avait qu’un pas: des esprits sectaires ou dogmatiques le franchirent sans tergiverser.
Nous voyons mieux aujourd’hui la clairvoyance de Gide vis-a- vis de Barres. Elle s’articule autour de deux axes: litteraire - i l condamne le roman a these et ses impasses; humain ~ il perqoit le caractere dangereux, ccincestueuxn, de la these mtme, son nkgativis- me, et mtme la pulsion de mort qui I’habite.
la double leqon, litteraire et humaniste, ethique et esthetique, de Gide critique de Barres, les vicissitudes d’une certaine politique, en France et ail- leurs, nous le rappellent chaque jour avec insistance.
Que nous aurions tort de rester indifferents
L‘opposition d’Andre Gide a Maurice Barks constitue un episode bien connu de notre histoire litteraire. Si l’on prend la peine d’y revenir ici, c’est que, face a Barrts, Gide eleve justement des critiques dont l’esprit reste, A nos yeux, moderne; les reconsiderer, des reserves littkraires formulees a 1’Cgard du roman a these aux analyses lucides d’une certaine ideologie, c’est montrer, en dehors de leur intertt historique, ce qui nous rattache a lui.
*
Tres tbt, les deux figures de Gide et de Barres se dessinent comme opposkes. Tres tbt, Barrls s’evertue a rechercher des certitudes, dans un monde qui en est depourvu et ne lui offre qu’une diversite seduisante mais sans signification. Ce desenchantement explique pourquoi il ne tardera pas a eriger au rang de principes, des convictions intimes et mtme des fantasmes. D’une maniere
34 Peter Schnyder
opposee, Gide aspire trks t6t A se liberer du carcan puritain, pour s’ouvrir a la richesse du monde, de la vie, des idCes et des &tres. Mais a la difftrence de BarrQ, il est dkja armt: il a pour guide l’ideal artistique 16gui par Mallarmk et les symbolistes.
De cette divergence profonde cependant rien ne perce encore dans les premiers contacts entre les deux hommes que leurs affinites litteraires rappro- chent. C’est Barres, de sept ans l’aine de Gide, qui fait le premier pas: soucieux de connaitre l’inconnu qui se cachait derriere Les Cuhiers d’AndrP Walter (dont il se disait ravi), il introduit le jeune homme timide - et c’est la son merite, partage par Pierre Louys - dans le monde des lettres. En fevrier 1891, il invite Gide qui n’a gukre plus de vingt et un ans, a prendre part au grand banquet offert en l’honneur du poete Jean Moreas, et le presente a un convive illustre: Stephane Mallarmt.
Fervent defenseur de l’bgotisme, Barres n’etait encore, a cette epoque, que l’auteur d’Un Homme libre, tres en faveur chez les jeunes gens. Gide n’a pas lchappi au charme de ce livre. Dans son cccahier de lectures)) (qu’il appelle suggestivement ((Subjectif))) il note, en mars 1890:
Lu depuis La Roque et meditt tous ces derniers mois. Je reste convaincu malgre les revokes de Pierre [Louys] que c’est I$ une oeuvre maitresse, une oeuvre type de la generation intermediaire qui s’en va - un jalon de I’histoire litteraire.
11 y aurait trop long a dire - en le relisant, peut-&tre ecrirai-je un article. A relire.
Cet article, Gide ne l’icrira pas. Cependant, il consacrera, quelques annees plus tard, a cet auteur de la ccgtntration intermediaire)), certaines de ses meilleures pages critiques. Entre-temps, les deux hommes auront avanct sur des chemins de plus en plus opposts: Barris s’est rapidement dCtournC de son dilettantisme egoiste. I1 place son salut dans la politique, a laquelle il subordonne son art. Doctrinaire et syncrttiste, il tente peu a peu de rationali- ser une conception dkterministe de l’homme, rigide et regressive. Gide, au contraire, est parvenu a stculariser progressivement la ferveur religieuse qui l’habitait pendant sa jeunesse. Celle-ci trouvera un premier aboutissement dans un ideal de pureti esthetique. Dans Le TruitP du Nurcisse (1891), nous pouvons alors lire cette maxime significative:
La question morale pour I’artiste, n’est pas que I’Idee qu’il manifeste soit plus ou moins morale et utile au grand nombre; la question est qu’il la manifeste bien. (Pleiade, 1958, p. 8-9, en note).
Gide,fure a BurrPs 35
Un tel ideal ne pouvait aller sans sacrifices. I1 exigeait le silence, le recueille- ment, le travail dans la solitude. Au lieu de frequenter les milieux littkraires parisiens, ou Barres avait sa place, Gide se retirera bientet, apres un voyage liberateur en Afrique du Nord, dans un des lieux les plus deserts du Jura ...
Les deux artistes ne se voient donc plus guere. Mais Gide suit de tres pres la production de son aine, qu’il continue a considirer comme un maitre. Plein d’admiration, il peut ecrire a sa mkre, en juin 1894, aprQ la lecture d’un recit qui vient de paraitre, Les Deux Femmes du bourgeois de Bruges:
C’est une petite merveille, tres revoltante et surtout lorsque I’on sait que c’est 12 I’histoire de Barres, de Madame Barres et de je ne sais quelle dame r u s e avec laquelle il voyagedit en Espagne peu de temps a p r b son mariage. Mais ceci est une grdnde force chez Barres: sa vie et ses ecrits ne font qu’un.2
S’ttonnerait-on, alors, que, trois annees plus tard, Gide lise assiddment tous les numkros de La Revue de Paris, qui publie en feuilleton, du 15 mai au 15 aodt, le premier volet du (<Roman de 1’Energie nationale)), Les Dkracinks? Paru quelques mois plus tard en volume, ce roman connait un succes imme- diat. I1 marque un moment dans la carriere de Barres - et dans l’evolution de Gide, qui comprend aussit8t tout ce qui le separe de cet ecrivain trop ((engage)) a son godt. Peu soucieux des reactions de la grande presse, i l prend la plume et envoie sa critique a la petite revue que dirige Edouard Ducotk, L’Ermitage, qui la publie dans son numero de fevrier 1898. Ces pages, cepen- dant, ne relevent pas d’une polemique sur le vif. Leur tenue, leur densite, font que Gide, dans ses jugements ulterieurs sur Barres, s’en inspirera volontiers. I1 semble bien qu’elles constituaient pour lui-m&me une reference. De fait, elles contiennent une conception du roman originale, dkfendue avec fermete. Mais surtout, elles affirment une attitude vigoureusement offensive, et m&me pres- que provocatrice a I’egard de la these de I’enracinement. C’est la fameuse apostrophe:
Ne i Paris, d’un pere uzetien et d’une mere normande, ou voulez-vous, Monsieur Barres, que je m’enracine? J’ai donc pris le parti de ~ o y a g e r . ~
Ce ton est be1 et bien nouveau. Nouvelle aussi la facon de proceder: il ne s’agit plus d’une critique fragmentaire et contingente, comme celles auxquelles Gide s’ltait livre jusqu’ici: pour defendre son ami Jammes, par exemple, ou pour rectifier une erreur de jugement, comme dans le cas de Mallarmk4 Cette fois, Gide ecrit de sa propre initiative, et ce qu’il a a dire lui semble assez important pour meriter un article a part entiere. Et, effectivement, en se
36 Peter Schnydcr
mesurant a la thiorie barrksienne de l’enracinement, c’est une definition de sa propre vision artistique qu’il donne.
Enfin, Gide, qui avoue lui-rn2me s’2tre donne du ma1 pour cet article, rivalise avec un critique perspicace et charmant: Leon Blum. Plus jeune que l’auteur des Nourritures terrestres, Blum, ne a Paris en 1872, poursuit ses etudes de droit, mais se pique de littirature puisqu’il compose des vers pour La Conque, et tcrit des articles critiques pour L a Revue Blanche. A partir de 1900, il se consacre plus exclusivement a la politique, et cede sa ccchronique des livres en prose)) a Gide. Critique sagace et original, mais quelque peu affirmatif, Blum avait deja donne, entre autres, une etude sur ccLes Revues)) et inaugure, sous le voile de l’anonymat, des reflexions libres qu’il publiera en 1901, les ctNouvelles Conversations de Goethe avec Eckermann)). Le 15 novembre 1897, il fait paraitre, dans sa ccchronique du roman)), un article sur Les Deracinks, fort elogieux en dkpit de quelques reserves, en particulier vis-a-vis de l’exaltation de la famille et de la commune qui, a ses yeux, ccfaussent et diminuent l’energie~.~ I1 en preparait meme un deuxieme, que devait publier La Revue Blanche, et dont il montra le manuscrit a Gide. Or celui-ci en fut si impressionne qu’il jugea fort mediocre ce qu’il allait ecrire -- et comme il devait l’tcrire au cours d’un sejour en Suisse, il affirma que ces pages se ressentaient de ctleur lieu d’originen, qu’elles manquaient ccde nuance et de contour)), que ccson vrai lyrisme)) ne commeqait qu’ctl partir de 20” au-dessus de zero)) - se disant cependant ccsans vertu pour les ameliorer)).6
Et pourtant cet article est loin d’i3re mediocre, m2me si I’on ne tient pas compte de son aspect de manifeste. Construit en deux parties, la premiere salue en Barres le romancier exquis qui a surpris non seulement ses ccplus chauds admirateursi), mais egalement force l’admiration de ses ennemis les plus ccent&tes)). La seconde aborde le problime a la fois ethique et esthetique de ce ccpesant livre d’une exckdente mais admirable tension>): apres avoir quasiment reduit a neant la these de I’enracinement, Gide en denonce I’in- fluence nefaste, comme de toute these, sur le romanesque hi-mcme. La doctrine tout d’abord; elle est bonne certes pour les faibles, mais mauvaise pour les forts qu’elle tente d’accoutumer a un bonheur deplorablement etriquk:
Quant aux faibles: enracinez! enracinez! [...I Mais i ceux qui, non plus faibles, ne cherchent pas avant tout leur confort, a ceux-ci, le deracinement, propor- tionne autant qu’il se peut a leur force, a leur vertu - la recherche du dkpayse- ment qui exigera d’eux le plus de vertu possible.’
Le deracinement est aussi, ou avant tout, symbolique: corrilat, ou implication nkcessaire, ou encore condition essentielle, de toute volonte de connaissance: toute instruction est d’abord ccun deracinement par la tCte)).* Ensuite il est, sur un plan plus particulierement Cthique, une veritable kcole de l’effort, d’energie stendhalienne. Obligeant l’homme aller au-deli de lui-mtme, il lui permet de se decouvrir hi-mCme. A la these de l’enracinement, donc, Gide oppose son propre eloge du deracinement - kloge paradoxal mais qui touche juste.
Las! Roman Li these, Les DPracinPs manquent deux fois leur but: dans ce qui ne peut ttre qu’un compromis, la these et la litterature se nuisent mutuellement:
[...I ou, pour favoriser votre these et montrer le danger du deracinement, peindre des Ctres si faibles et mediocres. qu’on eiit crik: tant pis pour eux; - ou, pour favoriser votre roman, peindre des Ctres assez forts pour qu’ils ne souffrent plus du depaysement, assez importants pour invalider votre
Ce que Gide deplore par-dessus tout, c’est que l’ideologue Barres l’emporte sur I’artiste, jadis si raffine, si dklicieux. Certes le merveilleux rkcit d’Astine Aravian ~ par exemple ~ rappelle les pages exquises que Barres a jadis ecrites sur I’Espagne et sur 1’Italie; il faut reconnaitre egalement la ctremarquable tenue)) de nombreux episodes, mais l’auteur y a greffk un element exterieur qui met en danger l’equilibre du livre:
Pourquoi, ce dessin si bon, avoir cru devoir le boursoufler inartistiquement d’une these electorale, interessante certes en elle-meme (sans souci m&me qu’elle soit juste ou non), mais dont presque toutes les pages s’engoncent et qui [en] epaissit les moindres mouvements? - Si vous venez, a chacun de ceux-ci, ergoter et. i la force de vos raisonnements, le rattacher a votre these generale, c’est donc que ces evenements n’etaient pas assez eloquents par eux-memes? [...I Et le resultat de votre habilete oratoire c’est que les evenements que vous dites, apres que vous en avez parle, semblent, pris hors du livre, moins eloquents que vous-mime, et ne prouver pas toujours ce que vous voudriez qu’ils nous prouvent.’”
Barres parle trop; au lieu de laisser parler ses personnages, ses paysages, I’histoire elle-mime. Ce qui ccengonce)) son texte, ce qui l’ccempoisse)) dirait Barthes. c’est la glose, c’est l’ideologie. Mais voila justement une idee moder- ne, chere Li Barthes, nostalgique impenitent de Gide, et pour qui la litterature est le seul discours qui dejoue toute idkologie, et n’asservisse pas.
Barrks, donc, a trahi - la litterature. Mais cela ne devrait pas suffire a faire de lui l’ennemi principal de Gide. C’est toutefois en ces termes que celui-ci le designe: ctBarres est prkcieux: en lui se resume d’une facon heureusement
38 Peter Schnyder
assez magistrale tout l’ennemi - (ou a peu pres).))” Ce qui est condamne, alors, c’est non pas tant le manquement a la litttrature que la teneur mCme de l’ideologie. Fixiste, statique, passiiste, celle-ci priviligie les tendances rtgressives de 1’Ctre humain, alors que la dominante, en Gide, est a l’ouvertu- re, au dynamisme, a la mobilitt, aussi bien intellectuelle que giographique, seule gineratrice a ses yeux de tout progres, de tout accomplissement original.
I1 ne faudrait pas pour autant faire de Gide un anti-Barres, tel que le definit Massis. S’il a tres vite compris le nihilisme inherent a la doctrine de Barres, ou les fantasmes obscurs qui nourrissaient son principe de ((La Terre et les Marts)) - principe auquel il a beau jeu d’opposer le fameux ((Meurs et renais)) de Goethe - il ne s’est pas mut en adversaire acharnk, ni attitre, des thkories barrbiennes: comme il le dira dans sa rkponse a Maurras a propos de ((La Querelle du peuplier)) (1903), il n’en blime que ctl’outrance)). En fait, Gide depasse largement l’alternative qui consisterait a adopter ou a refuser ces theories. Sa position est de comprehension et de tolerance. Elle consiste it reconnaitre, lorsqu’il s’agit d’une province-frontiere a l’identite fragile et instable, la ntcessite et la legitimitk d’un sentiment regionaliste fort. Mais ce qui vaut pour la Lorraine ne saurait pretendre A la geniraliti, ne saurait devenir principe de pensee: c’est ce que Gide enonce fermement dans un article de juillet 1905, consacre au livre de Bar& intitulk Au service de I’Allemagne: ((Plus, a nos yeux, la pensee de Maurice Barres et s’iclaire et se justifie, mieux je comprends l’erreur ou nous serions de chercher a penser et sentir en Lorrainsd2 Cette hauteur de vue (mais peut-Ctre sierait-il de parler de condescendance?) s’accompagne d’un eloge littiraire auquel Gide semble prendre plaisir: sensible a une moindre agressiviti de l’auteur dans ce livre, ii un moindre dCsir de sa part d’embrigader le lecteur, il veut peut-Ctre effacer aussi le souvenir de ((l’absurde querelle de mots)) qui l’avait naguere oppose A Barres et a Maurras.I3 I1 se montre donc comprihensif et gCnCreux, citant un passage sur le charme retenu de la vallte de la Moselle, soulignant les qualitis de langue, des premieres pages notamment, ou la tonalite un peu melancolique qui les rend si seduisantes:
[...I la langue en est melodieuse, naturelle, t r b expressive et pourtant sobre; le sentiment quasi religieux qui les gonfle entre en nous de plain-pied. Et j’admire comme le ICger rkcit s’insinue a travers les reflexions de I’auteur: I’histoire a commence presque avant que I’on s’en doute; lui, ne raconte que juste autant qu’il faut; aucun fard, aucune coquetterie littkraire, et, mime aprks que B a r k feint de laisser la parole au heros, le recit reste grave, presque silencieux comme le paysage qu’il habite, d 6 ~ e n t . I ~
Gide juce a Burris 39
Plut6t que de durcir la querelle, et de cristalliser les passions, Gide denoue, dedramatise; il godte le texte, tout simplement, en tout abandon, et le donne a lire avec une reelle generosite. De Barks il retient le meilleur: l’tcrivain, et non ce ((premier organisateur des doctrines nationalistes)) etiquete par M a u r r a ~ . ’ ~
*
Les textes ulttrieurs de Gide sur Barres nous le montrent cedant tour a tour a des mouvements d’admiration ou d’irritation, avec une constante cependant, celle de l’analyse qu’il fait a la fois de l’homme et de l’ecrivain: Gide voit ce que Barres a sacrifie a sa doctrine et essaie de s’expliquer pourquoi il I’a fait. La severite d’abord: elle s’exerce a l’tgard de l’opportunis- te qui, pour un fauteuil d’academicien, compromet sa pensee:
Quel plat discours il nous a fait! Que j’ai souffert des Ilchetes, des flatteries, des hommages i l’opinion de I’assemblee [...I. [...I
Personne ne fera-t-il donc ressortir par quelle etrange et retorse habilete, ce maitre sophiste put, afin de les louer, faire rentrer dans son sac ces deux maitres derdcines: Leconte de Lisle et Heredia? (Et Chenier! et Moreas!)16
Mais surtout, I’homme - celui des Cahiers, celui, donc, qui se livre - est devine, devoile, traque mime, avec une lucidite sans pitit. C’est a une veritable mise a nu ~ avec des intuitions quasi freudiennes ~ que Gide procede: ainsi, les theories de Bar& trahissent pour lui un ((caractere incestueux)); son ccobstination dans I’absurden, son besoin de ((composer artificiellement son personnage)), decoulent - helas - du ((sentiment profond de sa pknurie)): d h e z lui pas de probleme reel, essentiel; pas de ((figure in the carpet)). I1 lui faut I’inventer; il n’aurait, sinon, rien a dire. D’ou ce sens aigu du neant, du vide, de la mort; ce besoin de ccse replier sur ses minima)))).” Voila les theories de Barres reduites a un cache-misere. Et tous les artefacts, qui ont peut-ttre la mime fonction, denoncis: l’asiatisme, le toc, les erreurs de godt (((Faux godt, fausse dignite, fausse potsie, et veritable amour d’une fausse grandeur ... ) ) l a ) , I’incapacite a observer la nature, la mitvrerie, le convenu:
Mais je n’aime pas beaucoup, en general, et particulierement chez Barres, le recours ii de certains tons poetiques et a des mots predestines. ((Lac de beaut6 ... H, ccciel de beaute)), ccmklancolie et amour)), ctastres les plus merveilleuxn. Un vraiment grand artiste ne change pas les couleurs de sa palette, pour faire pottique. Ceci est d’un art de confiseur. Ce qu’il appellera hi-m&me un peu plus loin (parlant de Part de Praxitele) ccsi pornmaden.
40 Peter Schnyder
C’est decidement le Barres de Leurs Figures que je prefere, incisif et montrant les dents. Je ne I’aime pas quand il se parfume, asiatique et dthanchC.19
En revanche, il suffit qu’il decouvre une page riussie sur le plan litteraire pour que Gide accepte aussit6t de redevenir un lecteur fin et genereux, heureux de pouvoir admirer, pr2t a la comparer, par exemple, ccaux meilleures des Choses vues de Hugo))20: c’est lorsqu’il est au plus prks du texte que Gide comprend le mieux l’homme. En ce dernier il a perqu celui qui avait peur de soi-m2me. Quel artiste il aurait ete - quel artiste il est chaque fois qu’il dabandonne, se laisse aller lui-m&me sans souci de ses inconsequences, oublie d’2tre ce qu’il veut 2tre, consent a se montrer naturel: homme et non plus seulement Lorrain)).21 I1 ne fait pas de doute que la personnalite mime de Barres ait fascine Gide: I’humilite des Cuhiers - document alors priviltgie pour une lecture qu’on pourrait appeler ((psycho-critique)) - lui apparait cl’abord comme une marque de la plus grande humanite; et puis il se saisit de cette ((probite si constante)>, et des aveux auxquels elle donne lieu, pour se donner raison a hi-mEme, pour reprendre le dernier mot - sur Barks:
tcQu’est-ce donc que j’aime dans le passe? Sa tristesse, son silence et surtout sa fixitk. Ce qui bouge me gene.)) Peut-on imaginer aveu plus grave? Et comme si tout le futur ne devait pas devenir, ri son tour, du passe! L‘idee d’un progres possible de I’humanitk n’effleure mtme pas sa pensee. Au contact de ces pages, je comprends mieux combien cette idee de progres s’est emparee de moi, me possede.
* I1 semble, pour conclure, que l’on puisse digager, de l’attitude de Gide face d Barrcs, l’evolution suivante. Tout d’abord, Les DtrucinPs permettent i Gide de se definir. Aux theses de Barres, qui sont comme le nigatif de ses aspira- tions, il rkagit passionnement, affectivement, sentant tout ce qu’elles represen- teraient comme entraves pour h i . I1 sait d b lors qu’il a quelque chose a dire et va pouvoir le dire. C’est a partir de ces theses en effet qu’il developpe ses themes, qui deviendront non pas des constantes, mais des lignes de force chez lui: preeminence de l’art contre toute devise du ccpolitique d’abordn; gofit d’un cosmopolitisme proche de celui du XVIII‘ siecle, rompant avec le nationalisme issu de l’tpoque romantique; ideal enfin d’un esprit ((renaissanb face au traditionalisme borne. Pour Gide, le genie, le genie franqais notam- nient, est multiple et synthetique; il dkpasse les particularismes. Et c’est la que les theories de Barres le meconnaissent et m2me le menacent:
La doctrine de I’enracinement, trop rigoureusement appliquke, risquerait, en
Gide ,face a Barris 41
protegeant et en accentuant I’heterogeneite des divers elements franqais, de les faire a jamais se mesentendre, de former des bretons, des normands, des lorrains, des basques, plus bretons, normands, lorrains et basques ... que franqais. Rien de plus particulier que I’esprit de province; de moins particulier que le genie franqais. I1 est bon qu’il naisse des Franqais comme Hugo N... d’un sang breton et lorrain i la foisn, qui, portant en eux tout li la fois les richesses les plus e x t r h e s de la France, les organisent et les contraignent a l ’ ~ n i t k . * ~
En un mot, le genie - qu’il s’agisse de I’esprit d’un pays ou de l’originalite d’un createur - est classique. I1 rtalise I’unite, mais une unite riche, vivante, et diversifiee. La ccclassique terre grecque)), synthese d’C1Cments si divers - ioniens, biotiens, doriens, attiques ~ et la France, ((la plus classique des t e r r e ~ ) ) , ~ ~ en fournissent deux modeles non encore CpuisCs.
L‘autre moment de l’tvolution est celui ou Barres, pour Gide, semble devenir un cas. Le Gide de la maturitk cherche plutbt a comprendre Barres, l’homme et l’krivain. Cette attitude explique sa curiosite, et une certaine chasse aux aveux comparable a celle qui est mise en oeuvre dans son etude sur Dostoievski. L‘homme, il le voit double, se defendant d’une part de lui-mzme, rejetant I’autre en h i au nom d’une identiti imaginaire. I1 faut reconnaitre 1 i une perspicacite intuitive de Gide, qui cherche, au-dela du domaine esthetique, une cle a la constitution d’ideologies totalitaires et ex- cluantes, telles qu’elles s’amorcent chez I’auteur des S e i n e s et Doctrines du Nationalisme.
NOTES
Une etude exhaustive sur Gide et Barres fait encore defaut. Mais on lira avec profit les chapitres qu’ont consacres recemment, aux deux Ccrivains, Emilien Carassus (dans: BarrPs et sa .fortune litthraire, Bordeaux, Ducros, ccTels qu’en eux-rnhes)), 1970, pcusim) et Claude Martin (dans: La MaturitP d’AndrP Cide ( 1 895-1902), Paris, Klinck- sieck, ccBibl. du XXc siecle)), 1977, passim). - Une foule d’articles et d’etudes - telles les pages dues a Henri Massis (v. p. ex., ccL‘Anti-Barrts)), 1932, dans: D’Andrh Cide u Marcel Proust, Lyon, Lardanchet, 1948, pp. 201-10) - defendent Barres contre Gide: ils ont vieilli, mais offrent quelques echantillons interessants d’une critique dogmatique. - Sur I’ideologie barresienne, le livre d’Ernst Robert Curtius, Maurice Barres und die geistigen Grundlagen des jranzosischen Nationalismus. (Bonn, F. Cohen, 1921, 2” ed. 1962), 118 pp., reste la meilleure synthese. V. egalement I’etude tres fouillee de Zeev Sternhell, Maurice BarrPs et le nationalisme FranFais, Paris, A. Colin, 1972, 396 pp.
L‘auteur remercie Mademoiselle Brigitte Lalvte, Paris, des nombreuses suggestions qu’elle a bien voulu lui apporter. Ses remerciements vont egalement li Monsieur Franqois Chapon, Conservateur en chef de la Bibliotheque litttraire Jacques-Doucet,
42 Peter Schnyder
Paris.
1. Dans: Cahiers Andrk Gide, vol. 1, (Paris, Gallimard, 1969), pp. 57-8. 2. Lettre publiee par Jean Delay, dans: La Jeunesse d’AndrP Gide, t. 11, (Paris,
Gallimard, 1957), p. 329. 3. ccA propos des Deracinew, dans: L‘Ermitage, fevrier 1898, pp. 81-7, et recueilli
(avec quelques variantes qui semblent montrer que Gide attachait une certaine importance a son article, malgrt ses affirmations) dans: Prktextes (p. 29-33 dans l’ed. combinbe de PrPtextes - Nouveaux Prktextes de 1963 [Paris, Mercure de France]). Nous reproduisons le texte de la revue; quelques erreurs d‘orthographe ont tte corrigees.
4. V. la lettre polemique que Gide adressa, en novembre 1897, B un journal d’inspira- tion protestante, Le Signal (reproduite dans: Correspondance Jammes - Gide, Paris, Gallimard, 1948, pp. 3024); ensuite la lettre de protestation adressee par I’Ccrivain a Alfred Vallette (publiee dans le Mercure de France du lcr fbvrier 1897, pp. 428-9, et reproduite par C. Martin, op. cit.. p. 178). - Lorsque, onze ans plus tard, Gide vit le nom de Mallarme une nouvelle fois compromis, il rkagit de mCme: on se souvient que sa protestation provoqua le fameux faux depart de La Nouvelle Revue FranGaise (numtro du 15 novembre 1908). V. Auguste Angles, Andre Gide et lepremier groupe de ((La Nouvelle Revue Franpisei> (189&1910), (Paris, Gallimard,
5. Selon Leon Blum, Barres a crCe et mis dans le monde une ccforme de sensibilitk nouvelle)). De la sa grande sympathie pour cet initiateur: ccSi M. Bar& n’eiit pas vecu, s’il n’eiit pas ecrit, son temps serait autre et nous serions autres.)) (La Revue Blanche, 15 novembre 1897).
6. Lettre d’Andrt Gide B Henri GhCon, Nice, 7 janvier [18]98, Correspondance. (Paris, Gallimard, 1976), t. I, p. 148.
7 . V. supra note 3. 8. Ibid. - Gide developpera plus amplement cette fonnule dans sa conference sur
ccl’Influence en LittCrature)) (prononcee le 29 mars 1900, B Bruxelles, et recueillie dans Prktextes).
1978), pp. 101-123.
9. Ibid. 10. Ibid. 1 I . V. supra note 6. 12. Ce compte rendu figure dans LErmitage de juillet 1905. I1 sera repris dans les
Oeuvres compl?tes, t. IV, pp. 433-40. 13. Rappelons I’objet ou plut6t le prktexte de cette querelle, qui est le sens du mot
ctdkracinb. Pour Maurras, cet adjectif signifie ccdont les racines ont Cte trancheew. Gide retorque que, en arboriculture, ccdtracinb n’a jamais voulu signifier autre chose que ccdont les racines ont ttC arrachkes de terre)). La mktaphore est donc abusive, puisque, en passant de I’arboriculture a I’idbologie, on a gauchi le sens du mot. Et Gide d’ccen remettreu: c’est Maurras qui par sa definition arbitraire a rendu sensible ccune faute qu’on n’avait pas bien remarquke)). De cette seule faute stmantique toute la theorie de Barres s’kcroule, la-mCme ou elle devait s’appuyer: (([...I derriere la faute de mot, accourt et s’abrite la faute de pensee. Et si M. Maurras ne la sentait ici tres grave, il n’emploierait pas tant d’ipres soins, ni ne trouverait tant de difficultes, a la defendre.)) (L‘Ermitage, novembre 1903; art. rec. dans: Pritextes, pp. 3 4 8 [ed. de 19631).
Gide juce a Barres 43
14. V. supra note 12. 15. II met mkme une certaine malice a louer Barres, lorsque I'inspiration littkraire de
celui-ci dement si bien ses theories: ces ccqualites en apparence si espagnoleso, a savoir wes parfums, cette morbidesse, cet amour de la mort avoisinant I'amour, ce rythme si rompu, cette allure un peu capitane, cette belle cambrure d'abord puis brusquement ces abandons, ce sourire seulement des Ievres, ces ombres a la Zurbaran, ces langueurs d la Murillo ... H. C'est a chanter Tolede, Venise ou Vladikavkas. que I'ecrivain a trouve ctses plus melodieux accents)) (Chronique generalen de L'Ermitage, fevner 1905, recueillie dans Nouveaux PrPtextes (p. 17 1, ed. citee).
16. Journal 1889-1939 Cjanvier 1907), (Paris, Pleiade, 1951), p. 234. 17. fbid. (22 juin 1930), pp. 988--9. 18. fbid. (5 juillet 1931), p. 1060. 19. fbid. (12juillet 1931), p. 1063. 20. fbid. (5 juillet 1931), p. 1061. 21. ((Souvenirs litteraires et problemes actuels)), conference prononcee en 1946, a
Beyrouth et a Bruxelles; reproduite dam: Feuillets dhutomne, (Paris, Mercure de France, 1949), p. 196.
22. Journal (13 juillet 1931), pp. 1064-5. 23. ((La Normandie et le Bas-Languedoo), dans: LOccident de novembre 1902; re-
cueilli dans: PrPtextes (pp. 41-2). 24. fhid.
Peter Schnyder. Born 1946. Ph.D. (Berne). Has published articles on comparative and contemporary French literature, and on Andre Gide. Publication to appear: G i d e critique (1 889-1 906))).