Genealogie du Genre pptx
Transcript of Genealogie du Genre pptx
Généalogie de l’approche genre L’accent sera mis sur la généalogie de l’approche genre et
ce, en évoquant dans un premier temps une définition du
concept genre, ensuite, on tentera de dresser un aperçu
historique de la genèse de l’approche genre avant
d’entamer l’intégration de cette approche au programme
de développement au Maroc.
Définition du concept genre.
Avant d’entamer la définition du concept genre, il est
judicieux d’évoquer une définition du concept sexe,
lequel constitue une assise à l’autre. En effet, la notion
de sexe, tout en se référant à la structure biologique de
reproduction chez l’être humain, renvoie à la biologie
humaine et signifie des différences corporelles visibles
entre les hommes et les femmes.
Par conséquent, c’est sur cette différence
biologique que se fondent de nombreuses
attitudes relatives aux devoirs et aux droits de
l’homme et de la femme dans une société
donnée.
Le concept de genre « gender » a été essentiellement créé dans la langue anglaise et
ce, du fait que le mot « sex » en anglais possède un
champ sémantique beaucoup plus réduit que le mot
« sexe » en français, chose qui rend difficile la
présentation de la place des hommes et des femmes
dans la société.
Ainsi, et sous l'influence des féministes, qui
différencièrent le sexe anatomique du genre afin de
remettre en cause les contraintes imposées par ce dernier,
le sexe est utilisé pour faire référence aux différences
physiques distinguant les hommes et les femmes, et le
genre est consacré aux différences non anatomiques telles
les différences psychologiques, mentales, sociales,
économiques, démographiques, et politiques entre autres.
Selon le psychanalyste et chercheur Robert Stoller « Le
genre est un terme qui a des connotations psychologiques
et culturelles plus que biologiques. Le genre est la quantité de masculinité ou de féminité que l'on
trouve chez une personne et, bien qu'il y ait un mélange des
deux chez de nombreux êtres humains, le mâle normal a
une prépondérance de masculinité et la femelle normale
une prépondérance de féminité »STOLLER, Robert. Recherches sur l'identité sexuelle à partir du transsexualisme. Paris : Éditions Gallimard, 1989, p.
28.
En effet, le « genre » est l'identité construite par
l'environnement social dans lequel existent les individus.
De ce fait, la masculinité ou la féminité, ne peuvent pas
être considérés comme des données « naturelles », mais
plutôt comme le résultat de mécanismes extrêmement
forts de construction et de reproduction sociale et ce, au
travers de l'éducation. Bref, le genre désigne les
comportements, les pratiques, et les rôles attribués aux
personnes selon leur sexe, durant une époque et dans une
culture donnée.
Selon Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient » et
ce, sous l'influence de l'éducation patriarcale et de la socialisation.
Certains théoriciens, tel Pierre Bourdieu, estiment que cette citation est
également valable pour les hommes : « On ne naît pas homme, on le
devient », et c'est à travers toute une éducation, composée de rituels
d'intégration de la norme masculine, que se façonne l'identité
masculine, et que l'homme assure dans la société une fonction de
reproduction de la domination.
DE BEAUVOIR, Simone, Le Deuxième Sexe II : L’expérience vécue,-. Paris :
Gallimard, Folio, 1949 (renouvelé en 1976), p. 13.
Par ailleurs, du moment où le concept sexe est
biologique, lié à des conditions qui relèvent de
l’ordre de la physionomie, des chromosomes et
des organes génitaux, le concept genre est
sociologique englobant l’identité, la société et la
culture.
De même, si le sexe est une différence biologique
innée, universelle, et inchangeable en fonction des
actions de développement, le genre s’identifie à des
différences sociales acquises, fixées par la société et
variables selon, parmi d’autres, l’âge, la classe
sociale, la religion et l’ethnie.
En d’autres termes, le genre est institutionnalisé
par la famille, la communauté, les organisations
et l’état. Il est maintenu à travers la religion, la
culture et la tradition et enraciné dans le
patriarcat.
Le sexe biologique désigne l’ensemble des
caractéristiques biologiques des hommes et des
femmes ayant pour fonction la reproduction de l’espèce.
Le genre, ou sexe social, est le produit du processus de
socialisation qui assigne des rôles, des responsabilités, des
comportements et des droits différents aux hommes et aux
femmes dans une société, un contexte culturel et
historique donné.
Le concept genre fait référence à l’identité
sexuelle et se définit par l’ensemble des
caractéristiques, valeurs, idées, comportements
ou normes qu’une société ou culture associe à
l’homme ou à la femme, ces caractéristiques
étant considérées féminines ou masculines.
Les différences et inégalités entre les hommes et les
femmes ont des origines liées à la fois à la culture et
à l’éducation. En effet, la culture, désignant la tradition et
la religion, est composée, entre autres, des idées,
idéologies, religions, valeurs et pratiques créées par des
individus d’une même communauté et ayant des
influences sur les relations sociales, la politique et
l’économie. De même, l’éducation et la socialisation sont
deux facteurs décisifs quant à l’apprentissage des normes
de vie et l’acquisition des rôles sociaux.
A les voir sous un angle anthropologique, le sexe
désignant le fait biologique et le genre renvoyant au
fait social semblent être plus claires. En effet, la
différence de sexe en tant que donnée naturelle est un
principe universel d’organisation sociale car les rapports
entre hommes et femmes sont au cœur des trois « piliers »
universels de la société à savoir la prohibition de l’inceste,
l’existence d’une forme reconnue d’union et la répartition
sexuelle des tâches, tel le trouve Claude Lévi Strauss.
De même, le dualisme sexué est à l’origine de ce que les
anthropologues appellent une idéologie généralisant
l’attribution d’un tel rôle, attitude, pratique ou propriété
en fonction d’une dimension sexuée distinguant le
féminin et le masculin. Par conséquent, le sexe n’est plus une variable biologique,
c’est plutôt une propriété symbolique ; ce n’est plus un
principe de différenciation physiologique, mais un
principe d’organisation sociale.
Selon le point de vue des sciences sociales, le genre
emprunte au sexe le caractère d’une variable
démographique, et présente comme catégorie
institutionnelle et psychologique, le caractère
collectif d’une variable sociologique.
Ainsi, contrairement à une catégorie sociologique
comme la classe sociale, le genre n’est pas une
catégorie homogène de sorte qu’il est traversé par
toutes les autres catégories sociales.
Pourtant, la diversité des conditions féminines et
masculines n’est pas incompatible avec l’existence
d’une perception commune du féminin et du
masculin. Surtout, les relations entre hommes et
femmes et leur position sociale font l’objet d’un
ensemble de règles et de pratiques qui instituent de
manière plus ou moins rigide le genre et les
relations de genre.
Le concept genre fait référence aux rôles et
responsabilités des femmes et des hommes
déterminés par la société. Il est lié à la façon
dont les gens sont perçus et censés penser et agir
en tant qu’hommes et femmes en fonction de
l’organisation de la société et non du fait des
différences biologiques.
Ces rôles et responsabilités, quant à eux, renvoient
aux différents travaux, aux besoins pratiques et
stratégiques, aux niveaux d’accès aux ressources et
aux différentes sphères dans lesquelles les hommes
ou les femmes peuvent prendre des décisions et
exercer un contrôle sur les ressources et les
avantages effectués par les hommes et les femmes.
AFARD. Recherche féministe francophone : « Ruptures, Résistances et Utopies », Echo N°12, 2003.
En d’autres termes, le travail quotidien des
hommes et des femmes, leur accès aux
ressources, leur participation à la vie politique,
leur capacité d’exercer leurs droits, diffèrent
selon qu’ils appartiennent à l’un ou l’autre sexe :
« le genre est la construction socioculturelle des rôles féminins et
masculins et des relations entre les femmes et les hommes. Les rôles
féminins et masculins se rapportent aux activités attribuées aux
femmes et hommes dans la société et à la position que femmes et
hommes y occupent respectivement. Ces rôles découlent des forces
telles que la culture, la tradition, la politique et les besoins,
permettent de déterminer l’accès aux opportunités et aux ressources
et imposent des attentes et des limites aussi bien aux femmes qu’aux
hommes ».
Cf. Manuel ISAP, PNUD.
Par conséquent, le genre prend racine dans les
valeurs traditionnelles et a des répercussions sur
la loi et les politiques de développement d’une
société donnée. C’est une notion dynamique qui
subit l’influence des mutations sociales ; de l’âge
des acteurs, de leur niveau d’instruction, de leur
origine sociale et milieu de provenance, et de
leur religion.
En effet bien que le genre englobe des
significations variables en fonction de maints
facteurs, il renferme un dénominateur
commun lequel est l’oppression universelle des
femmes.
En définitive, le genre est un construit social
mais aussi un outil sociologique d’analyse, de
planification et de suivi susceptible de révéler les
différences sociales et les inégalités dans les
relations entre les hommes et les femmes.
De même, c’est une forme de socialisation plus
équilibrée dans la mesure où l’approche genre
s’appuie sur l’ensemble de l’organisation sociale de
la vie économique et politique, afin de comprendre
la formation des aspects particuliers de la société
tout en prônant la construction sociale du genre et
l’attribution des rôles, des responsabilités et des
comportements spécifiques que la société attend des
hommes et des femmes.
Genèse du concept genre Connu sous le vocable de « Gender », le
concept genre est d’origine anglo-saxonne. C’est un concept qui est né
grâce à un long processus de l’engagement féministe à lutter contre les
situations d’oppression que vivent les femmes. L’intégration du
concept genre dans la pensée et les stratégies de développement a été réalisée
selon des étapes bien définies. L’on est parti de l’approche
Intégration de la Femme au Développement (IFD) à l’approche Femme et
Développement (FED) avant d’en arriver à l’approche Genre et
Développement (GED).
http://www.sowamed.ird.fr/resource/RES308_WP6_InitConceptGenre_NDJEBET.pdf
Les débuts de l’approche genre remontent aux
années 1940 et notamment aux lendemains de la
deuxième guerre mondiale. Lors de cette époque, on
assiste à la création de la commission de la
condition de la femme en 1946. La fin des années
1960, marquant le début des revendications pour les
droits juridiques des femmes, a connu la naissance
de l’approche de l’intégration des femmes au
développement IFD.
Dans ce cadre, les stratégies de l’IFD ont été
toutes focalisées sur des projets concernant les
femmes afin de parvenir à un développement
plus efficace et plus performant en prônant des
projets féminins, des composantes femmes dans
les projets, des projets intégrés et des activités
génératrices de revenus.
Parmi ces projets, on note essentiellement
l’accroissement des revenus et de la productivité des
femmes et l’amélioration des moyens dont elles
disposaient pour s’occuper du ménage. Toutefois, ce
concept n’a pas comblé les attentes, dans la mesure
où il ne s’attaquait pas aux causes fondamentales
qui empêchaient les femmes de participer au
développement de leurs sociétés. Par conséquent,
d’autres progrès ont été réalisés et élaborés.
En 1970, l’anthropologue économiste danoise Esther
Boserup avance que le progrès ou le déclin économique
est en relation étroite avec la participation des femmes à la
société. De même, démontre-t-elle, que si les femmes ne
sont pas pleinement intégrées au processus de
développement, le progrès économique tend à se faire au
prix de la marginalisation des femmes d’où la nécessité de
leur participation au processus du développement.
Ainsi, les années 1970 ont apporté la première
conférence mondiale des femmes à Mexico en
1975, l’année décrétée « Année internationale de
la femme ». Vis-à-vis des omissions de l’IFD, la
fin des années 1970 a connu l’émergence d’une
autre approche, il s’agit de l’approche femmes et
développement FED. BOSERUP, Esther. La femme face au développement économique.
Paris : PUF, 1983.
Cette dernière, postulant que les femmes ont
toujours fait partie des processus de
développement, ne met pas l’accent seulement
sur les stratégies d’intégration des femmes au
développement mais elle s’intéresse plutôt à la
relation entre les femmes et le processus de
développement
De même, la valorisation de la contribution des
femmes est désormais perçue comme un indice de la
modernisation économique et sociale. Chose qui
met en exergue les rendements élevés en matière de
bien être, de l’investissement dans l’éducation et de
la participation accrue des femmes.
LE NOUVEL, Emmanuelle. Comprendre le Concept de Genre in Classeur d’outils
pédagogiques réalisé sous coordination de l’Ifaid, 2001.
Les années 1980, elles, ont connu la conférence mondiale
des femmes à Copenhague en 1980 et à Nairobi en 1985
et la mise en place de la charte africaine des droits de
l’homme et des peuples ratifiés en 1981 avec la
reconnaissance des droits des femmes. Dès lors, le
concept IFD est introduit dans la plupart des projets du
développement et les organisations non gouvernementales
(ONG) commencent à œuvrer pour la prise en
considération des femmes dans le développement.
En effet, l’approche FED reconnaît certes aux
femmes leurs droits de participation aux
mécanismes du développement mais sur une base
inégale avec les hommes de sorte qu’elle a
tendance, tout comme l’IFD à regrouper les femmes
sans analyser suffisamment les différences sexuelles
et sans faire appel aux divisions de classe, de race
ou d’ethnies lesquelles ont aussi un impact
important sur le statut social des femmes.
En outre, Les femmes, tout comme les hommes,
ne forment pas un groupe homogène et
monolithique ; l’expérience de travail des hommes
et des femmes, leur participation à la vie politique et
économique et leur capacité d’exercer leurs droits
varient en fonction de leur race, de leur classe, de
leur appartenance ethnique, de leur religion, de leur
statut économique, et de leur orientation sexuelle.
Néanmoins, le concept a été utilisé jusqu’à la fin des
années 1980, l’évaluation de la décennie de
l’Organisation des Nations unies (ONU) ayant dégagé
les insuffisances liées à l’utilisation de l’approche IFD.
Par ailleurs, plusieurs recherches menées par des femmes
tant du nord que du sud ont montré que les insuffisances
notées quant à l’IFD et l’FED résident dans le fait que ces
dernières avaient ignoré l’apport des femmes en matière
de la production des biens et des services au sein de leurs
communautés. Chose qui signifie que les femmes étaient
figées dans un rôle traditionnel et familial.
Et finalement, afin de combler toutes les insuffisances déjà
mentionnées, la théorie genre a donné naissance à l’approche genre et
développement GED vers la fin des années 1980. Dans cette nouvelle
optique, on considère que les hommes et les femmes créent, perpétuent
et déterminent la répartition des tâches mais les bénéfices et les
souffrances, sont mal partagés en fonction du sexe.
De surcroît, les hommes et les femmes ont des rapports différents les
uns et les autres au sein de la société et évoluent dans des secteurs
différents de la communauté et ce, malgré une certaine
interdépendance. Ainsi, le développement se répercute-t-il de façon
différente sur les hommes et sur les femmes car chaque catégorie
exerce, selon son rôle social, une influence différente sur les projets et
les ressources d’une société.
Partant du principe que les hommes et les femmes doivent tous
participer à l’identification des problèmes et des solutions afin
d’avancer les intérêts de la communauté, l’approche GED s’appuie
d’avantages sur l’ensemble de l’organisation sociale, de la vie
économique et politique, afin de comprendre la formation des aspects
particuliers de la société. Elle s’intéresse, non pas à la femme en soi,
mais, à la construction sociale de genre et à l’attribution des rôles et des
responsabilités spécifiques que la société attend des hommes et des
femmes. Le genre n’est donc rien d’autre qu’un construit social.
OTIMI, Claudine Aperçu Général sur le Concept Genre : Notion et Outils d’Analyse
in « Genre - Gouvernance – Accès des Femmes au Pouvoir », AFARD Togo, 2004.
L’approche GED privilégie un développement durable et équitable dans
la mesure où elle cherche non seulement à intégrer les femmes au
développement, mais elle s’aspire à exploiter le potentiel des initiatives de
développement, à transformer les relations sociales et notamment celles de
genre et ce, dans la finalité de réduire les inégalités de genre et de donner plus
de pouvoir aux femmes.
En somme, l’approche GED, à l’opposé des approches précédentes, considère
les femmes comme agentes de changement plutôt que comme bénéficiaires
passives de l’aide au développement.
Par conséquent, l’application de l’approche GED doit permettre aux projets de
développement de répondre aux besoins pratiques des femmes et aux intérêts
stratégiques de celles-ci.
De ce fait, l’approche GED se définit en tant que
stratégie qui vise à permettre l’intégration des
préoccupations de genre dans l’analyse, la planification et
l’organisation de politiques, programmes et projets de
développement. Elle s’identifie à une approche qui prône
des valeurs d’égalité dans tous les domaines où les écarts
entre les hommes et les femmes sont grands, notamment
dans la division du travail ; l’accès aux services et aux
ressources ; le contrôle des ressources et des bénéfices ; et
le pouvoir décisionnel.
En effet, c’est une approche qui ne se concentre pas
uniquement sur les femmes ou sur les hommes, mais
plutôt sur la transformation des rapports entre les genres
dans un sens plus égalitaire tout en évitant de marginaliser
les hommes et en tentant d’élargir la participation des
femmes à tous les niveaux. Bref, c’est une approche qui
ne vise pas à transformer les femmes en hommes, mais
bien à s’assurer que l’accès aux ressources ne relève pas
de l’appartenance à un sexe.
Quant aux apports des années 1990, on note essentiellement la
conférence sur la famille et le développement à Dakar en 1992, la 5ème
conférence mondiale sur la population au Caire en 1994, la conférence
des femmes africaines à Dakar en 1994, et la 4ème conférence
internationale sur les femmes à Beijing en 1995. Pendant la même
époque, les femmes luttent de plus en plus pour l’équité et la
dénonciation des violences faites à leur égard. Pendant les années 2000,
le concept IFD est de plus en plus critiqué tandis que le concept GED
qui lui a succédé est de plus en plus répandu. Par conséquent, les
violences faites aux femmes sont dénoncées et la lutte des femmes pour
plus d’équité s’intensifie.
L’intégration de l’approche genre au programme de
développement au Maroc
Parmi les finalités de l’intégration de l’approche genre, on note
essentiellement la construction d’un partenariat basé sur
l’équité et l’égalité entre les hommes et les femmes et ce, en
respectant la différence et en assurant la participation
équitable, pleine et entière dans tous les domaines. De même,
intégrer l’approche genre dans les politiques de
développement s’avère nécessaire à la promotion d’un
développement durable et équitable.
En effet, l’intégration de cette approche consiste à favoriser
une prise de conscience, à instaurer des stratégies et des outils
pour l’égalité à travers l’intégration du genre à plusieurs
niveaux et notamment dans les modes de fonctionnement des
institutions et dans les projets et les programmes de
développement et à introduire la dimension sociale et
culturelle de la différence entre les femmes et les hommes,
dans les processus de prise de décision et dans l'élaboration
des politiques et des mesures économiques et sociales.
Etant conscient que l’adoption de l’approche genre est
incontournable à la réalisation d’un développement durable,
équitable et humain et à la réussite effective d’une transition
politique, sociale et économique, le Maroc a actuellement
entamé plusieurs initiatives et ouvert plusieurs chantiers
rentrant dans le cadre du « pacte du millénaire pour le
développement » et prônant la valorisation du potentiel
humain et ce, par le biais de l'intégration des femmes dans tous
les processus d'élaboration des politiques de développement.
Chose qui témoigne des réformes et mesures introduites au
niveau national en la matière.
Lors d’un discours qui a eu lieu 20 août 1999, S.M le Roi Mohammed
VI a affirmé : « Comment espérer atteindre le progrès et la prospérité alors
que les femmes, qui constituent la moitié de la société, voient leurs
intérêts bafoués, sans tenir compte des droits par lesquels notre sainte
religion les a mises sur un pied d'égalité avec les hommes, des droits
qui correspondent à leur noble mission, leur rendant justice contre
toute iniquité ou violence dont elles pourraient être victimes, alors
même qu'elles ont atteint un niveau qui leur permet de rivaliser avec
les hommes, que ce soit dans le domaine de la science ou de
l'emploi ?»
http://www.map.ma/mapfr/discours/dis-parlement-Oct-2003.htm
Ainsi, une réelle volonté politique existe-t-elle au Maroc
pour la prise en considération du genre dans le budget de
l’Etat. En effet, différentes politiques publiques sont
entreprises pour tenter d’atténuer les inégalités basées sur
le genre au Maroc. Dans cette optique, la BSG
Budgétisation Sensible au Genre est devenue un objectif
essentiel. Dans les années 90, une quarantaine de pays ont
mis en œuvre des initiatives de budgétisation sensible au
genre qui varient selon le contexte national de chacun
d'eux.
Au Maroc, le processus de budgétisation favorisant
l’égalité des sexes entre dans le cadre du processus de
démocratisation entamé depuis les années 1990. Si, sur le
plan politique et juridique, les avancées vers la démocratie
et le respect des droits humains ont connu une
accélération plus ou moins rapide, sur le plan économique
et social, les avancées demeurent lentes et insuffisantes.
Les différenciations de genre sont encore importantes à
tous les niveaux et les femmes sont plus touchées par
l’impact négatif des différentes politiques.
Le Maroc a élaboré des politiques qui s’inscrivent dans le
cadre des dispositions de la Convention relative à
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDAW, ratifiée par le Maroc en
1993 et parue au Bulletin officiel en 2001) et des
engagements pris lors des conférences mondiales,
notamment celles tenues à Pékin en 1995 et à New York
en 2000 (Déclaration du Millénaire).
C’est ainsi que le Maroc a consolidé un certain
nombre de réformes et ouvert de nouveaux
chantiers en matière de promotion des droits
humains d’une façon générale et, plus
particulièrement, des droits humains fondamentaux
des femmes et fillettes. Cette évolution positive est
marquée par plusieurs réformes dont la plus
importante a été celle du code de la famille.
Dans cette optique, la réforme du code de la famille qui a
vu le jour en janvier 2004, marque une étape décisive du
chemin du développement du Maroc et traduit une volonté
politique affichée de l’Etat quant à une relation de genre
équilibrée où les femmes peuvent espérer ne plus être
marginalisées dans le cadre familial.
De même, depuis septembre 2005, « l’Agence
de développement social (ADS) a institué le pôle genre en
tant que structure ayant pour mission de mettre en place
une stratégie pratique d’intégration des principes de l’approche genre pour accroitre la participation des femmes dans ses projets et programmes de développement ».Mohamed Najib Guedira, directeur de l’ADS (l’Agence de
développement social).
En 2006, on assiste à la mise en place du budget sensible au genre et
l’adoption de la stratégie nationale d’équité et d’égalité entre les deux
sexes, qui prend en considération les besoins des femmes lors du
processus de l’élaboration des politiques et des programmes de
développement. De même, on assiste à l’intégration de l’approche
genre à l’université marocaine et ce, par la prolifération des groupes de
recherches sur la question du genre, chose qui a donné naissance à des
formations du master et du doctorat en la matière.
Mohammed Mezouar s’exprimant dans le cadre du congrès international des femmes
investisseur arabes du 28 au 30 octobre 2009.
La Budgétisation sensible au genre mesure l'impact des allocations des
dépenses publiques sur la répartition des ressources, l'accès aux services et les
opportunités offertes aux populations et ce, par le biais d'une coordination
entre politiques, programmes et budget, dans la finalité d'équité et d'égalité.
L'adoption de plus en plus d'une telle approche à travers le monde trouve son
origine, notamment, dans l'engagement de la communauté internationale à la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement d'ici 2015 et
dans la ratification de la CEDAW, convention qui vise à lutter contre toutes les
sortes de discrimination à l'égard des femmes.
Cette orientation de la dynamique de développement vers
les populations les plus vulnérables implique l'adoption de
politiques publiques et de pratiques budgétaires visant à
réduire la pauvreté et les inégalités touchant de façon
différenciée les populations d'hommes, de femmes, de
filles et de garçons.
CEDAW : Convention sur 1’é1imination de toutes les formes de discrimination à
1’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des
Nations Unies.
Le contexte actuel du pays est parfaitement favorable à l'adoption de
cette approche dans la mesure où il est marqué par la mise en place de
l'INDH, la poursuite de la stratégie de développement social intégré, le
renforcement du processus démocratique, notamment à travers le code
de la famille, de la nationalité, celui des libertés publiques, la
modernisation des secteurs publics, le renforcement de la gouvernance,
de la décentralisation et le processus de réformes budgétaires. Par
ailleurs, l'admission du Maroc pour la première fois à l'aide du
Millenium Challenge Account, visant la réduction de la pauvreté et la
promotion de la croissance économique, est un levier supplémentaire
en faveur de l'adoption d'une approche de proximité envers les
populations démunies.
Il faut noter que des efforts ont été réalisés ces dernières années au
Maroc. Il s'agit notamment de l'enquête Budget-temps et des cartes de
la pauvreté. Toutefois, il y a une insuffisance en information liée à la
difficulté d'estimer le travail non rémunéré des femmes qui n'apparaît
pas dans les statistiques officielles. S'y ajoute le manque d'information
sur la participation des femmes à l'économie notamment dans le milieu
rural et le secteur informel. Actuellement dans le projet Budgétisation
sensible au genre, l'affinement de l'information est un axe prioritaire.
Par ailleurs, des outils de formation visant les formateurs, les
parlementaires et la société civile sont élaborés. Il s'agit du guide de la
réforme budgétaire Dalil et d'un manuel de formation en cours de
finalisation au ministère des Finances.
Le processus de réforme budgétaire représente le point d'ancrage de
cette approche. Elle a pour principaux objectifs de tenir compte des
préoccupations et des intérêts différenciés des femmes, des hommes,
des filles et des garçons lors de la formulation, l'exécution et
l'évaluation des politiques publiques. Elle assure l'équité à travers une
meilleure allocation des ressources budgétaires. Ceci dit, l'analyse
genre des dépenses publiques est, primo, basée sur l'établissement d'un
diagnostic des différents groupes sociaux et l'identification des
principales contraintes. Secundo, la déclinaison des priorités publiques
en objectifs de réalisation, de projets et de programmes. Et enfin
l'évaluation des programmes à travers l'analyse des moyens mis en
œuvre et les crédits alloués.
Pour la première fois au Maroc, un rapport genre a été annexé au rapport
économique et financier 2006. Il est la résultante d'un processus lancé depuis
2002 dans le cadre des réformes budgétaires visant la gestion axée sur les
résultats et la Budgétisation sensible au genre. Le rapport en question présente
l'état des lieux, réalisé en partenariat avec quelques départements engagés dans
le processus de gendérisation du budget. L'objectif étant de prendre la mesure
de ce qui doit être accompli pour une meilleure efficacité des dépenses
publiques. Le rapport présente le concept genre et le contexte de son
introduction, la méthodologie adoptée ainsi que les avancées de certains
départements pilotes engagés dans le processus. La réalisation de ce premier
rapport a eu des échos favorables notamment chez le Fonds de développement
des Nations unies pour la femme (Unifem) qui a qualifié l'expérience
marocaine "de réussite sans précédent".
En définitive, le Maroc, dans sa finalité d’un
développement durable, équitable et égalitaire
entre les deux sexes, n’a cessé d’intégrer
l’approche genre dans tous ses projets et
programmes de développement et ce, en
touchant à tous les domaines, y compris le social,
le politique, l’économique et l’intellectuel.




































































![Word Nerds 12.3.1_HG[2].pptx (Read-Only) - Amazon S3](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6327ab015c2c3bbfa8044a3a/word-nerds-1231hg2pptx-read-only-amazon-s3.jpg)


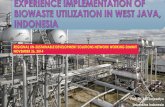







![[pptx] Identification_and_Control_of_Potato_green_BugCitrus_Catterpillar,Sugercane_Termites](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631c6b1aa906b217b906f1da/pptx-identificationandcontrolofpotatogreenbugcitruscatterpillarsugercanetermites.jpg)

![Diapositivas relaciones interpersonales pptx [Reparado]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6331cf4ff008040551042ac9/diapositivas-relaciones-interpersonales-pptx-reparado.jpg)




