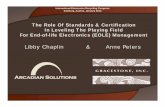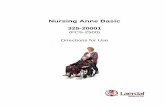Fiche Le Nil Anne Fillon
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Fiche Le Nil Anne Fillon
Langues et cultures de l’Antiquité
LCA – Géographie
ProblématiqueL’enseignement des langues et cultures de l’antiquité au lycée
s’inscrit dans la continuité et dans la logique de l’acquisitionprogressive par l’élève des compétences du socle commun, de l’écolematernelle à la fin de la scolarité obligatoire. Cet enseignement, dontles finalités (définies dans le préambule des programmes de lycée,arrêté du 24 juillet 2007) sont nombreuses et ouvrent sur un champ decompétences très large, doit, peut-être plus que d’autres, du fait mêmede cette ouverture, qui est une richesse, relever le défi de laformation de la personnalité du lycéen comme individu et comme citoyen conscient,autonome et responsable.
Ainsi, l’étude d’œuvres sculpturales et littéraires (d’époquesdifférentes) faisant intervenir des éléments géographiques etethnographiques entraîne l’élève dans un va-et-vient de la géographie àl’art, nouveau pour lui, et propre à éveiller son esprit critique. Ilapprend la continuité de la culture humaniste, à travers les temps,mais aussi dans ses apprentissages qui se trouvent ainsi décloisonnés.Sciences humaines et art sont réunis dans une démarche de compréhensiondu monde.
DémarcheLa démarche proposée permettra de renforcer les compétences 1, 5
et 7 du socle commun : maîtrise de la langue française —réflexion sur sa languepar le travail sur la traduction d’une langue étrangère—, acquisition d’uneculture humaniste —formation du jugement appuyé sur des repèreshistoriques et géographiques— et acquisition de l’autonomie —l’élève estamené à exercer sa curiosité. Il s’agit de revenir à la questionlancinante de l’enfant qui découvre le monde, pourquoi ?, question qui aMinistère de l’éducation nationale (DGESCO) juillet 2012Langues et cultures de l’Antiquitéhttp://eduscol.education.fr/prog
tendance à se raréfier avec l’âge et de chercher constamment les moyensd’y répondre, en ayant recours d’abord aux ressources propres del’élève, puis à celles que lui propose l’enseignant qui le guide dansune démarche organisée et méthodique que l’élève fait sienneprogressivement et peut ensuite transposer à d’autres situations.
Elle vise à rendre l’élève acteur de son apprentissage enl’invitant à construire lui-même la signification : sens littéral d’untexte en langue étrangère, description objective d’une œuvre d’art,réflexion sur le projet de son auteur appuyée sur une recherchedocumentaire, puis analyse des moyens mis en œuvre. Il est aussi invitéau cours de ces étapes à exercer son esprit critique (le commentaire detraduction(s) qui induit une réflexion sur sa propre langue est à cetégard très formateur, a fortiori s’il est accompagné d’une propositionpersonnelle de traduction).
Résonance pédagogique
Le Nil dans le roman grec, realia ou topos ?
Objectifs :
— Montrer les relations entre l’art et la géographie (mélange subtil dedétails réels et d’approximations) et donner à l’élève les moyens de sedocumenter par lui-même et avec méthode.
— Permettre à l’élève d’aborder la sculpture comme il apprend à aborderune œuvre littéraire, ou un extrait d’une œuvre littéraire, par uneproblématique qui interroge sa fonction et réfléchit sur les moyens.
— Montrer l’apport constant des voyages et de la connaissance du mondedans le roman des origines au XIXe siècle : apport de connaissances surdes realia, appuyées sur des sources documentaires, mais aussi recherche del’exotisme pour séduire.
Entrées du programme :
— Seconde : le monde grec, regard et discours ethnographiques— Seconde, Enseignement d’Exploration : formes romanesques grecques— Première : récits et témoignages
2
— Terminale : interrogations scientifiques (géographie, zoologie,techniques)
Présentation de l’action
Préliminaires : Présentation du corpus aux élèves et justification des choix :documents de nature et d’époques différentes : sculptures du XVIIe siècle,extraits d’un roman grec du IIe siècle, extraits de l’œuvre d’un naturalisteromain du Ier siècle et de l’œuvre d’un historien grec du Ve siècle avant J.C.Première étape : Observation des sculptures. Description méthodique.Hypothèses sur les choix de l’artiste. Recherches des sources et des élémentsjustifiant les hypothèses (par exemple, dans la statue du Bernin, le Nil sevoile la face car ses sources sont mystérieuses ; le bas relief de la statuedu jardin des Tuileries présente crocodile et hippopotame comme éléments de lafaune « exotique » du Nil). Recherche sur les auteurs et le contexte de laproduction. Rédaction d’une notice sur chacun d’eux.Deuxième étape : Lecture des extraits d’Achille Tatius (on peut selon le tempset les objectifs lire un seul, deux ou trois des extraits proposés).Commentaire de la traduction dans les passages proposés avec traduction (latraduction des premières lignes du texte 1, très « géographiques » estparticulièrement intéressante à commenter car l’approximation de la traductiona tendance à retirer le caractère « scientifique »). Repérage des éléments« documentaires » et des éléments « littéraires » grâce à une rechercheprécise et réflexion sur leur interaction. Troisième étape : Lecture d’un autre extrait d’un roman grec plus tardif etconstat de la permanence du thème (Héliodore). Comparaison des moyens. Lectured’extraits de romans de Jules Verne montrant la permanence du recours à lagéographie et à l’ethnographie dans le roman.
Corpus :
1. Deux sculptures :
Fontaine des quatre fleuves, Le Bernin, 1648 – 1651, Rome, Place Navone,
3
détail : le NilPhoto Anne Fillon
Le Nil, Lorenzo Otton, 1688 – 1692, Paris, Jardin des Tuileries Photos Anne Fillon
Détail de la frise (hippopotame et crocodile)
Images en format supérieur et mises en page pour impression : http://anne.fillon.free.fr/Grec/Geographie/LeNil/LeNilPlaceNavone.htmlhttp://anne.fillon.free.fr/Grec/Geographie/LeNil/LeNilTuileries.html
2. Extraits du roman d’Achille Tatius, Leucippée et Clitophon
4
— Texte 1 : Achille Tatius, Leucippée et Clitophon, IV, 11 – 12, « Le Nil, θέαμα καινόν », Entre excursus paradoxographique et morceau de bravoure.
— Texte 2 : Achille Tatius, Leucippée et Clitophon, IV, 14 : « Le Nil, une armeredoutable », Le Nil, un élément de la narration à part entière.
— Texte 3. Achille Tatius, Leucippée et Clitophon, IV, 19 : « Le crocodile, unanimal exotique », Où la réalité scientifique semble céder à l’inventionlittéraire.
Textes auxquels on peut ajouter — Héliodore, Les Ethiophiques ou Théagène et Chariclée, IX, 22 : « Un satrape
blasé », où l’Egypte est expliquée aux Grecs par le biais d’un exposé àun Ethiopien peu impressionné car déjà très averti (intérêt du point devue).
Extraits complets : http://anne.fillon.free.fr/Grec/Geographie/accueilgeographie.html
3. Extraits d’Hérodote et de Pline
Le court extrait de Pline et le passage en gras de l’extrait d’Hérodotetrouvent un écho très précis dans le premier passage d’Achille Tatius, serévélant être des sources possibles.
Pline, Histoire naturelle, V, 10Certis tamen diebus auctu magno per totam spatiatus Aegyptum fecundus
innatat terrae.A des jours fixes, il inonde de ses eaux débordées tout le pays, et,
couvrant la terre, il la féconde.
Hérodote, II 9, 10, 14, 17ταύτης ὦν τῆς χώρης τῆς εἰρημένης ἡ πολλή, κατά περ οἱ ἱρέες ἔλεγον,
ἐδόκεε καὶ αὐτῷ μοι εἶναι ἐπίκτητος Αἰγυπτίοισι. τῶν γὰρ ὀρέων τῶν εἰρημένωντῶν ὑπὲρ Μέμφιν πόλιν κειμένων τὸ μεταξὺ ἐφαίνετό μοι εἶναι κοτὲ κόλποςθαλάσσης, ὥσπερ γε τὰ περὶ Ἴλιον καὶ Τευθρανίην καὶ Ἔφεσόν τε καὶ Μαιάνδρουπεδίον, ὥς γε εἶναι σμικρὰ ταῦτα μεγάλοισι συμβαλεῖν. τῶν γὰρ ταῦτα τὰ χωρίαπροσχωσάντων ποταμῶν ἑνὶ τῶν στομάτων τοῦ Νείλου, ἐόντος πενταστόμου, οὐδεὶςαὐτῶν πλήθεος πέρι ἄξιος συμβληθῆναι ἐστί.
La plus grande partie du pays dont je viens de parler est un présent duNil, comme le dirent les prêtres, et c'est le jugement que j'en portai moi-même. Il me paraissait en effet que toute cette étendue de pays que l'on voitentre ces montagnes, au-dessus de Memphis, était autrefois un bras de mer,
5
comme l'avaient été les environs de Troie, de Teuthranie, d'Éphèse, et laplaine de Méandre, s'il est permis de comparer les petites choses auxgrandes ; car, de tous les fleuves qui ont formé ces pays par leurs alluvions,il n'y en a pas un qui, par l'abondance de ses eaux, mérite d'être comparé àune seule des cinq bouches du Nil.
Un extrait d’Hérodote (à titre indicatif) ayant pu servir de sources auxsculptures et aux romans :Recherche à l’aide de la page :http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Herodote_HistoiresII/sequentiel.cfm(on choisit, par exemple κροκόδειλος dans la recherche par ordre alphabétique,les occurrences apparaissent chez de nombreux auteurs).
Hérodote, Histoire, II, 68-70
τῶν δὲ κροκοδείλων φύσις ἐστὶ τοιήδε. τοὺς χειμεριωτάτους μῆνας τέσσεραςἐσθίει οὐδέν, ἐὸν δὲ τετράπουν χερσαῖον καὶ λιμναῖον ἐστί. τίκτει μὲν γὰρ ᾠὰἐν γῇ καὶ ἐκλέπει, καὶ τὸ πολλὸν τῆς ἡμέρης διατρίβει ἐν τῷ ξηρῷ, τὴν δὲ νύκταπᾶσαν ἐν τῷ ποταμῷ. θερμότερον γὰρ δή ἐστι τὸ ὕδωρ τῆς τε αἰθρίης καὶ τῆςδρόσου. (2) πάντων δὲ τῶν ἡμεῖς ἴδμεν θνητῶν τοῦτο ἐξ ἐλαχίστου μέγιστονγίνεται ? […]
Passons au crocodile et à ses qualités naturelles. Il ne mange point pendantles quatre mois les plus rudes de l'hiver. Quoiqu'il ait quatre pieds, il estnéanmoins amphibie. Il pond ses oeufs sur terre, et les y fait éclore. Ilpasse dans des lieux secs la plus grande partie du jour, et la nuit entièredans le fleuve ; car l'eau en est plus chaude que l'air et la rosée. De tousles animaux que nous connaissons, il n'y en a point qui devienne si grandaprès avoir été si petit. […]
Extrait complet :http://anne.fillon.free.fr/Grec/Geographie/LeNil/Herodotecrocodiles.html
4. Extraits de Jules Verne :
Jules Verne, Le Tour du Monde en Quatre-vingts Jours, Chapitre XL’auteur profite du passage de Phileas Fogg en Inde pour donner une description du pays dont les
détails ne paraissent guère indispensables à la narration. La dernière phrase et bien d’autres dansl’œuvre, révèlent qu’à l’objectif encyclopédique s’ajoute une visée patriotique…
Personne n'ignore que l'Inde ce grand triangle renversé dont la base estau nord et la pointe au sud comprend une superficie de quatorze cent mille
6
milles carrés, sur laquelle est inégalement répandue une population de centquatre-vingts millions d'habitants. Le gouvernement britannique exerce unedomination réelle sur une certaine partie de cet immense pays.
Jules Verne, Le Tour du Monde en Quatre-vingts Jours, Chapitre XIUn peu plus loin, quand il s’intéresse au dressage des éléphants, introduisant un terme indou
dans sa description, il semble plutôt être guidé par un souci d’exotisme.Là, ils se trouvèrent en présence d'un animal, à demi domestiqué, que
son propriétaire élevait, non pour en faire une bête de somme, mais une bêtede combat. Dans ce but, il avait commencé à modifier le caractèrenaturellement doux de l'animal, de façon à le conduire graduellement à ceparoxysme de rage appelé «mutsh» dans la langue indoue, et cela, en lenourrissant pendant trois mois de sucre et de beurre. Ce traitement peutparaître impropre à donner un tel résultat, mais il n'en est pas moins employéavec succès par les éleveurs.
Bibliographie (pour le professeur)— Valérie Faranton, La Nature et ses Images dans le roman grec, 2012, éd.
L’Harmattan— L. Plazenet, « Le Nil et son delta dans les romans grecs », Phoenix,
vol. 49, N°1, 1995 (essai que l’on peut lire sur le site de la Classical Association of Canada, http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=cac)
Pour élargir la réflexion et le travail sur l’image : — Ismérie Boissel, L’Egypte dans les mosaïques de l’Occident romain : Images et
Représentations (de la fin du IIème siècle avant J.-C. au IVème siècle après J.-C.), 1975
— Théophile Obenga, Aristote et l’Egypte ancienne, ANKH, n°2, 1993 Les textes d’I. Boissel et de Th. Obenga sont disponibles sur internet.
Sitographie (pour le professeur et les élèves)Le site de J.-F. Bradu : http://jfbradu.free.fr/egypte/LE%20NIL/LE%20NIL.php3?r1=3&r2=0&r3=0Des ressources iconographiques :http://terra.antiqua.free.fr/mosaiques.html#a%20mosa%EFque%20nilotique%20de%20Palestrina
Focus sur les points intéressants
7
— L’élève est invité, tout au long de la séquence, à exercer son espritcritique, en s’appuyant sur des recherches linguistiques (pour latraduction) et documentaires (pour le commentaire).
— Le travail se fait sur des supports variés (on peut les multiplier) etmontre à l’élève comment transposer des démarches (à d’autres situations, àd’autres disciplines).
— La séquence pourrait être prolongée par une production —littéraire ouplastique (dans ce cas, avec la collaboration du professeur d’artsplastiques)— de chaque élève, dans un esprit d’imitation, suivie d’unedémarche semblable à celle de la séquence, mais à partir de laproduction des élèves.
— Il pourrait être intéressant aussi de travailler ensuite autour duvoyage antique et contemporain et de la réflexion sur le monde qu’ilinduit (la notion de frontière, problématique toujours actuelle —cf. Lemagazine bimensuel du Monde diplomatique « Manière de voir », n° 128,d’avril-mai 2013, qui titre « Faut-il abolir les frontières ?»).
— Mais aussi une deuxième séquence pourrait s’intéresser au domaine de lazoologie en pointant plus particulièrement un animal du Nil dont onpourrait confronter la représentation à celle de l’article d’uneencyclopédie actuelle.
Fiche réalisée par Anne Fillon, professeur agrégée de grammaire, Lycée Le Corbusier, Poissy, 78Académie de Versailles
8