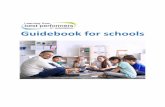Des performers amateurs qui sevaluent Ecologie scenique et categorisation autour du match...
Transcript of Des performers amateurs qui sevaluent Ecologie scenique et categorisation autour du match...
1
Des performers amateurs qui s’évaluent : écologie scénique et catégorisation autour du
match d’improvisation théâtrale.
Communication prononcée dans le cadre de la journée d’étude Apprentissage et Sensorialité,
MSH Paris Nord, juin 2011.
L’ethnologie et la sociologie du jazz ont mis en évidence la part socialisée de cette pratique
musicale, ainsi que les déterminants structurants les échanges entre participants à une
performance, avant, pendant et après le passage en scène. En nous inscrivant dans cette
démarche, depuis les travaux de Howard Becker et Robert Faulkner (2010, 2011), mais aussi
ceux de Jocelyn Bonnerave (2007), Marie Buscatto (2007) ou encore Denis Laborde (2005),
nous voudrions étendre l’analyse écologique de l’improvisation musicale à l’improvisation
théâtrale, à partir d’une ethnographie de troupes françaises qui pratiquent le match
d’improvisation. Le but du présent article est de documenter l’existence et la circulation de
catégories structurant leur répertoire.
L’esthétique de l’improvisation met l’accent sur l’irréductibilité de la situation de
performance, de l’éphémère et de l’instant. De son côté, une sociologie de l’improvisation
donne à voir, depuis la scène jusqu’à la politique associative des troupes, l’articulation entre
un « ici et maintenant » irréductible sur scène, et des dispositifs sociaux créant de la régularité
dans les pratiques et structurants les relations entre les improvisateurs. Dans le cadre de cet
article, nous traiterons d’un cas particulier d’improvisation théâtrale : les matches, pour
proposer une analyse des conditions de production de la cohérence de ces performances. À
partir des outils de la sociologie et de l’ethnologie, nous interrogerons le statut ontologique de
la performance improvisée entre la singularité et la régularité de ce qui est joué sur scène1
1 Arnaud Trenvouez arrive à des résultats similaires en suivant une toute autre voie, celle de l’ergonomie et de
l’analyse des cours d’action. Voir sa thèse de doctorat récemment soutenue (Trenvouez, 2013). Nous invitons le lecteur à se reporter à notre travail de master (Thura, 2012) et à l'article de Trenvouez et Thura (2013)
.
Cette question permet de travailler au cœur des débats fondateurs de la sociologie. En
considérant les troupes d’improvisation comme des groupes sociaux qui apprennent à leur
joueur à respecter une certaine « manière de faire », nous retrouvons la dimension normative
imbriquée dans l’acte créateur et la performance. Cette conception désubjectivise la création
artistique et permet de sociologiser l’objet performance comme fruit d’un processus social de
production (Becker, 1988 ; Bourdieu, 1992 ; Buscatto, 2008). Les joueurs d’improvisation
sont socialisés aux « bonnes formes du jeu », qu’ils intériorisent au fur et à mesure de leur
2
carrière2
Notre matériel a été constitué entre 2008 et 2010 autour d’une enquête participante dans le
cadre d’une recherche de master, au sein une troupe d’improvisation parisienne, mais aussi de
la mise en perspective de notre expérience préalable de joueur depuis 2005. Si le passage de
praticien à analyste n’est pas sans poser de problèmes de réflexivité, il est aussi producteur
d’effets heuristiques non négligeables par l’expérimentation concrète de l’enquêteur
au sein d’une ou de plusieurs troupes. Ces règles, qui prennent la forme de maximes
de jeu, sont mises à l’épreuve sur scène, amenant les comédiens à se repositionner vis-à-vis de
ces dernières et à poursuivre l’élaboration de répertoires de compétences nécessaires à un
joueur et de qualification de ce que devrait être selon eux une « bonne » improvisation.
La mise au jour des répertoires et de la manière dont la performance sur scène est informée
par ces derniers, avant même le début du spectacle a pour conséquences empiriques de porter
une attention toute particulière aux dispositifs sociaux qui encadrent la performance et
participent à sa mise en forme. Nous nous concentrerons ici sur ce qui se passe hors scène,
avant ou après une représentation, et qui participe indirectement à ce qui peut se produire sur
scène. Bien qu’il s’agisse d’une activité improvisée, donc a priori imprévue dans son contenu,
la performance est toujours configurée à l’avance par l’activité hors scène, à l’instar de ce qui
s’observe dans le jazz (Hagberg, 2006) et sur d’autres scènes (Laborde, 1999 ; Jouvenet, 2001
; Vettorato, 2008). Ces travaux traitent de l’organisation qui situe l’improvisation dans des
contextes d’actions obéissant à des normes spécifiques. Pour reprendre un adage propre aux
praticiens des matchs d’improvisation théâtrale : « tout est possible, mais pas n’importe
quoi. »
3. Le
matériel s’articule entre différentes troupes, à Rennes à la LRI4
, et à Paris au sein de la TIPN
(Troupe d’Improvisation Paris-Nord), ainsi qu’au sein de la troupe des Pataugeoires, créée par
quelques membres de la TIPN. Nous avons eu l’occasion de collecter des récits de joueurs,
des discussions dans diverses situations, des captations vidéo de représentations de différentes
troupes, des captations audio d’entraînements d’un groupe débutant de la TIPN et rassemblé
plusieurs carnets de notes de terrain.
2 Sur la notion de carrière en sociologie, se reporter à Becker (1985) et Darmon (2008). 3 Sur la réflexivité et l’engagement du chercheur dans la pratique artistique qu’il étudie, se reporter à Faulkner et
Becker, (2008) et Sizorn, (2008). Pour une réflexion plus générale en sur la relation ethnographique, nous invitons le lecteur à se reporter à Bensa (1995).
4 Les noms des troupes et des personnes ont été transformés par respect de l’anonymat. Les villes d’implantations des troupes ont aussi été modifiées dans certains cas. Pour des raisons de vraisemblance, nous avons transformé les noms d’agglomérations en respectant leur type, leur taille, ainsi que les types et tailles des troupes qu’on peut y trouver.
3
Nous procéderons notre analyse en trois temps. Dans une première partie nous présenterons
les caractéristiques propres à la pratique des matches d’improvisation théâtrale, à savoir une
activité qui se déploie dans un cadre parfaitement défini – le décorum, prescrivant les règles
du jeu à respecter et permettant à des joueurs ne se connaissant pas de jouer ensemble – et
l’absence d’un académisme qui permettrait de déterminer l’état des règles de l’art et ce que
nous appellerons par approximation « les bonnes manières de jouer ». Dans un deuxième
temps, nous aborderons l’écologie des performances (Bonnerave, 2007), à savoir les lieux et
temps qui les précèdent et leurs succèdent et à travers lesquels elles sont discutées, évaluées et
« préparées ». À partir de cette écologie élargie, nous ferons émerger les points de repère
permettant l’élaboration de jugements par les improvisateurs sur leurs performances et sur les
autres joueurs. Enfin, en reprenant la notion de mémoire collective, nous montrerons que sa
diffusion dans les réseaux d’équipes et de joueurs produit des effets sur les occasions de
performances et sur leurs contenus. Les rencontres ne se font pas au hasard, les équipes se
choisissent et cette sélection porte à conséquence sur les contenus possibles des performances.
Cette perspective permet donc, en fin de compte, d’historiciser les performances improvisées,
en allant au-delà du caractère toujours singulier de la performance.
Pratique amatrice, du Québec jusqu’en France
Le match d’improvisation théâtrale est un format créé au Québec à la fin des années soixante-
dix par Robert Gravel et Yvon Leduc. Selon la petite histoire, c’est en désespérant de voir les
salles de théâtre vides et les arènes de hockey pleines que ces deux acteurs eurent l’idée de
mixer les deux univers dans un seul et même spectacle. Ce qui explique l’importation de
nombreux termes sportifs dans le décorum des matches d’improvisation. Le format est déposé
au Québec et cédé à la LNI (Ligue Nationale d’Improvisation) de Montréal bien qu’à notre
connaissance aucune troupe ne reverse de droits au créateur. La LNI est la « gardienne » du
concept dans les formes telles qu’écrites par les créateurs de l’époque.
Le match s’exporte assez rapidement en France dès le début des années quatre-vingts grâce à
quelques troupes professionnelles, avec à leur tête la LIF (Ligue d’Improvisation Française),
avant de se démocratiser une dizaine d’années plus tard via la création de plusieurs troupes
d’amateurs5. On en recense environ deux cents début 20116
5 Une sociohistoire de l’importation des matches d’improvisation théâtrale en France est à constituer, qui
. Ces troupes se déclarent
4
majoritairement en amatrices, bien qu’il ne soit pas aisé de déterminer la véritable part de
professionnels dans le domaine. Certaines troupes se déclarent professionnelle parce qu’elles
versent des cachets à certains de leurs joueurs, intermittents du spectacle par ailleurs, alors
que la majorité des membres pratiquent l’improvisation comme loisir. Pour la suite de notre
propos, il ne sera plus que question de la part amatrice des praticiens, c’est-à-dire des
individus qui pratiquent le match dans le cadre d’un loisir artistique. Les troupes ne sont pas
organisées en fédération officielle, comme c’est le cas en Suisse et en Belgique, la seule
tentative française pour mettre en place un tel réseau s’est soldée par un échec. Elles sont
indépendantes les unes des autres et libres d’organiser leurs matches comme elle le désire.
Rien n’impose à une troupe de reprendre le spectacle tel que défini dans le règlement de la
LNI. C’est donc une pratique marquée par l’autonomie revendiquée des troupes les unes
envers les autres
L’improvisation en France ne jouit pas du prestige rattaché au théâtre, puisque le format
« match » se place aux marges des pratiques artistiques : amatrice et trop « sportive » pour
être associée à l’idée d’une pratique culturelle légitime (Ertel, 1985). D’un point de vue
strictement bibliographique, les seules références universitaires faites à l’improvisation
théâtrale sont des mémoires d’étudiants, qui bien souvent pratiquent eux-mêmes cette forme
d’improvisation et s’en servent dans le cadre de leurs études (Cambillard, 1992 ; Jourdan,
1993 ; Baudrand, 2008 ; Thura, 2009 ; Eber, 2010).
La performance improvisée : une activité cadrée
« Dans un match, on improvise que durant les improvisations. Le reste du temps, on
n’improvise pas. » (Arbitre du tournoi de Saint Louis 2009 lors de son briefing aux deux
équipes)
Un match d’improvisation est donc un ensemble de courtes performances improvisées cadrées
dans un « décorum » réglementé. Une partie de la représentation est déterminée à l’avance,
comme toute pièce, avec un enchaînement de phases préétablies durant lesquelles les rôles de
chacun des protagonistes du cérémonial sont clairement définis. C’est toujours le MC qui
permettrait de mettre en évidence les réseaux ayant gouverné la création des troupes sur le territoire français et rendre compte des liens privilégier entre certaines troupes, en l’instance par les « formateurs » au sein des troupes qui sont souvent parmi les premiers comédiens formé à ce type de représentation.
6 À partir de la base de données du site www.improticket.com qui recense les troupes sur le territoire français, et d'une enquête qualitative que nous avons mise en place, permettant de compléter leur base de données.
5
entre en premier à la suite des musiciens et qui met en branle la représentation en appelant les
différentes phases. Il est le gardien du temps global de la représentation. Une fois les équipes
sur leurs bancs et l’annonce du premier thème, c’est l’arbitre qui prend la main sur la gestion
temporelle de la rencontre au sein des tiers temps de trente minutes. Dans ce découpage
temporel, l’usage de l’espace est lui aussi réglementé : joueurs, MC, assistants et arbitre
n’usent pas librement de l’espace scénique. Il en va de même pour la parole. Elle est
distribuée strictement, les joueurs ne pouvant s’exprimer qu’au travers de leurs personnages
durant les improvisations.
Au sein de cette structure se dessinent un temps et un espace laissant place à la performance
improvisée : les saynètes. Un temps attribué par l’arbitre et un espace délimité par la patinoire
de laquelle les joueurs n’ont pas le droit de sortir pour jouer. Le terme de cadre correspond
bien à cette situation de performance dont les bords sont donnés par le décorum, mais laissent
place à l’indétermination en son milieu : la performance, où tout doit se résoudre sur le
moment, dans l’instant. Cette résolution suit cependant une certaine syntaxe, celle du
règlement, nous l’avons vu au travers des fautes de jeu que l’arbitre peu siffler à un joueur, et
une syntaxe propre aux techniques d’improvisation apprises durant les « entraînements » ou
« ateliers », où les joueurs acquièrent des techniques reconnues comme efficaces par et pour
eux-mêmes. À aucun moment l’improvisation n’est totalement libre, elle s’appuie sur un fond
de connaissances7
Il n’existe pas d’instrument d’objectivation de la qualité d’une performance et d’un spectacle,
à la manière d’un jury attribuant une note. Aucune institution ni groupe composé
d’improvisateurs n’est le garant d’une forme d’académisme sur le jeu, pas même la LNI. La
pratique se développe sans canons partagés sur la manière de faire pour remplir cet espace des
possibles qu’est la patinoire. Toutes les équipes n’ont pas ce que les praticiens appellent « la
même couleur de jeu » et nous serons amenés à voir que cette différence de couleur de jeu a
un impact sur les possibilités de rencontre. Il existe bien deux ouvrages de Robert Gravel dans
lesquels sont dressés quelques préceptes de jeu
déterminant les « bonnes manières de faire » de l’improvisation, sans que
ce fond ne soit nécessairement partagé par les troupes. Les joueurs sont dans une situation où
ils partagent des règles communes, ils jouent au même jeu, mais sans jamais être assurés d’y
jouer de la même manière.
8
7 Nous retrouvons ici la perspective de l’ethnométhodologie telle que développée par Harold Garfinkel dans les
Études en ethnométhodologie (2007). 8 Voir les deux tomes de Robert Gravel et Jan-Marc Lavergne (1987, 1989).
, mais ces deux tomes relativement succincts
6
ne sont pas édités en France et, de ce fait, peu d’improvisateurs ont eu l’occasion de les lire. Il
existe une littérature grise spécifique écrite à destination des formateurs prenant la forme de
recueils d’exercices. Enfin, quelques essais présentent ce que leurs auteurs considèrent faire le
propre de l’improvisation. Mais aucun titre de cette littérature ne propose une synthèse
partagée par tous les joueurs.
La production des catégories de la pratique : esquisse de répertoires situés
Ces derniers développent eux-mêmes des principes de jugement sur leurs performances, que
nous appelons ici évaluation. Bien qu’il existe un fond de techniques qui jouent le rôle de
maximes minimales pour permettre au jeu d’avoir lieu, elles ne suffisent pas à elles seules
pour réponse aux problèmes pratiques des joueurs : comment réussir la mise en forme d’une
saynète cohérente et recevable pour le public, dans un temps imparti et avec des joueurs avec
lesquels je ne partage pas encore la moindre bribe de texte. Nous avons observé que les
troupes se dotent de leurs propres catégories d’objectivation de leur pratique pour pouvoir
qualifier les performances et les classer les unes par rapport aux autres. Ce travail
d’élaboration se passe dans ce que nous concevons à la suite de Jocelyn Bonnerave comme
une « écologie » de la performance (Bonnerave, 2007) : les lieux et les moments qui la
précèdent et la suivent et durant lesquels nous retrouvons les praticiens en interaction entre
eux. Cette écologie et ces catégories reconstruites, nous pourrons considérer les interactions
entre les différentes troupes pour voir comment l’évaluation des matches et des autres équipes
à travers ces catégories structurent les occasions de rencontre et les performances à-venir.
Les occasions de se jauger
Pour les joueurs de match, les opportunités de discuter de leur pratique sont multiples : des
discussions au quotidien, durant les entraînements ou encore avant et après les matches. Au
quotidien, lorsque les joueurs finissent par tisser des liens d’amitié, autour d’un café ou d’un
verre, les joueurs échangent fréquemment avec beaucoup de sérieux sur ce loisir. Ces
discussions sont un moteur de socialisation pour les nouveaux joueurs et leur permettent d’en
apprendre plus sur les références que chacun d’entre eux peut éventuellement mobiliser sur
scène. Ce sont des occasions de discuter de l’histoire de la troupe et des joueurs, des derniers
7
spectacles, des entraînements précédents, des autres troupes, des sensations vécues sur scène,
etc. Ils sont une source pour l’ethnographe qui découvre alors les liens entre équipes et les
trajectoires des joueurs, mais aussi de se faire raconter des improvisations passées et des
matchs marquants.
Occasions plus formelles, les entraînements participent de ce type d’apprentissage. Le
formateur joue un rôle prépondérant puisqu’en dirigeant les séances il y imprime sa marque.
Son rôle est primordial dans l’élaboration du discours sur les bonnes manières de faire. Dans
une certaine mesure, la manière de jouer d’une troupe se rapporte à la vision de
l’improvisation de son ou ses formateurs. En conseillant les joueurs sur les manières de faire,
en essayant d’expliquer aux joueurs pourquoi de leur point de vue une improvisation a ou n’a
pas fonctionné, ils participent à l’élaboration des catégories quant à ce qui fonctionne ou ne
fonctionne pas en improvisation. On peut alors entendre : « ça, c’était une improvisation à la
Jacques Ermont », en référence au formateur de leur troupe. Au moment de mes observations,
ce dernier est formateur à la TIPN et son enseignement est centré l’élaboration de scénarios et
les techniques scénaristiques. À l’inverse, le second formateur de la troupe, Christophe
Bordure, préfère focaliser l’apprentissage sur le jeu d’acteur et l’incarnation du personnage et
leurs interactions pour moteur de l’histoire. Durant les entraînements, il est fréquent que les
joueurs plus expérimentés discutent les commentaires du formateur en faisant référence à des
improvisations passées pour nuancer ou compléter les remarques du formateur. Dans le cadre
des entraînements, les échanges ne sont plus orientés vers le monde de l’improvisation, mais
vers les performances elles-mêmes et les techniques qu’elles nécessitent de mettre en œuvre.
Le troisième cadre d’interaction est les heures qui précèdent et suivent les représentations. Les
joueurs, qui appartiennent à des troupes différentes, y échangent et mettent en perspective
leurs points de vue. La confrontation entre étalons de mesure de la performance marque ces
moments d’interactions. Les fêtes qui suivent une rencontre sont l’occasion de conversations
sur les équipes rencontrées en commun, les matchs à venir, les problèmes des troupes, voire
parfois sur des improvisations très précisément ciblées. Dans ce cadre, ce sont les
performances qui viennent d’être jouées qui servent de point de confrontation à des
expériences passées provenant de plusieurs groupes d’improvisateurs.
Deux moments précédents les matchs participent plus directement au cadrage des
performances de la soirée : le briefe des équipes par l’arbitre et l’échauffement des deux
équipes. En amont de la rencontre, l’arbitre rassemble les deux équipes pour leur
communiquer ce qu’il attend d’elles en termes du jeu. C’est l’occasion d’un cadrage explicite
8
par la figure d’autorité de la représentation : J’attends de vous de belles impros, ça suffit de faire des animaux morts ou des mouettes qui passent en
font de patinoire. Je n’ai pas nécessairement l’envie de siffler des fautes, mais si vous commencez à
déconner, je n’hésiterai pas. (Christian, arbitre et joueur à Nantes)
« Si je me mets à siffler des fautes, prenez ça pour un signal, c’est que je trouve que le spectacle à
besoin d’être dynamisé, alors réagissez en conséquence ». (Jacques Ermont, arbitre et formateur à la
TIPN)
En annonçant le type de faute qu’il ne laissera pas passer et celles avec lesquelles il sera
indulgent, l’équipe invitée se fait une idée de la manière de jouer de l’équipe qui la reçoit,
puisque l’arbitre est généralement issu des rangs de la troupe qui organise la rencontre.
À cette occasion il présente aussi aux joueurs les « catégories » qu’il a prévu pour
accompagner certains thèmes : chantée, à la manière d’un western, sans parole, fusillade, etc.
Il peut aussi s’enquérir auprès de joueurs de leurs envies, s’ils désirent particulièrement jouer
certaines catégories pendant la soirée, auquel cas il s’arroge le droit de modifier certains
thèmes dans ce sens. La présentation des attentes de l’arbitre est généralement suivie de
commentaires entres joueurs : « Ouais, j’aime bien les catégories qu’il nous a mis, on va se
marrer ! » ou « Bon, vu les catégories que l’arbitre a mis ce soir dans son barillet de thèmes ça
risque d’être très « pouet-pouet », donc on fait attention, on ne fait pas n’importe quoi non
plus sinon ça va être le souk », un match « pouet-pouet » servant à désigner une
représentation basée sur des gags à répétition aux dépens de la construction des histoires.
Derrière ces commentaires se profilent déjà des catégories de jugement sur les performances.
Avant que le public n’entre dans la salle, les équipes se livrent à un échauffement collectif sur
scène. Cet échauffement crée l’opportunité pour les joueurs des deux équipes de se jauger
respectivement dans une ambiance.
La manière dont l’échauffement est encadré est aussi révélatrice des habitudes d’une équipe
ou de son niveau potentiel. Lors d’une rencontre entre les Pataugeoires et une équipe rattachée
à une grande école parisienne, dont les joueurs des Pataugeoires n’ont entendu parler qu’une
seule fois, via un membre de la TIPN, ces derniers me font part de leur inquiétude parce que
l’échauffement est « trop encadré », ce qui ne serait pas bon signe selon eux et corrobore les
informations qu’ils avaient reçues sur la troupe. Le coach des Improviseurs assène à de
nombreuses reprises les préceptes de l’improvisation : la nécessité de l’écoute, de la
construction, etc. Les Pataugeoires, eux, sont venus sans coach et sont tous des joueurs
expérimentés de plusieurs années d’improvisation. Les joueurs des Pataugeoires nous
9
confient, une fois l’échauffement achevé, que le coach des Improviseurs les a mis de plus en
plus mal à l’aise à force de les reprendre et de leur expliquer ce qu’ils doivent faire. Un des
joueurs des Pataugeoires y voit un mauvais signe : « s’il les cadre autant, c’est qu’ils ont
besoin d’être cadré… et ce n’est pas bon ça, parce que visiblement ils ne sont pas très à l’aise
et tendus ». Les joueurs quittent la loge en se disant « [de] faire attention et de jouer de
manière adaptée, sans les écraser ». La représentation sera vécue comme très mauvaise par les
joueurs des Pataugeoires, qui pensent qu’il s’agit là du pire match de leur saison sur le plan de
la qualité du spectacle. Ils en reparleront ensuite avec amusement. Pour eux, la rencontre ratée
se profilait dès l’échauffement. Ces expériences, où les équipes se quittent sans le sentiment
d’avoir fait une « belle rencontre » sont appelées des « rencontres ratées ». Elles sont
rattrapables si les joueurs des deux équipes se découvrent des affinités entre eux durant les
soirées qui les suivent.
Des trajectoires des joueurs aux typologies de styles de jeu
Les trajectoires des joueurs9
Les praticiens se réfèrent à des typologies constituées pour qualifier leurs compétences
dans les différentes troupes qu’ils ont fréquentées participent à
l’estimation des compétences qu’ils peuvent mettre en œuvre. Le nombre d’années de
pratique permet aux joueurs de discriminer en première approximation entre « débutants » et
« expérimentés ». Les équipes se précisent généralement si un de leurs membres joue son
premier match. Il s’agit d’une invite adressée à tous les autres pour prêter attention à lui et ne
pas le mettre en difficulté dans les improvisations.
Le passage par des troupes réputées laisse présager chez les praticiens que leurs joueurs font
preuve de qualités. Ainsi, Anaïs, emménageant à Paris après une mutation professionnelle,
postule aux Pataugeoires en leur envoyant un courriel en cours d’année. À cette époque, les
Pataugeoires ne recrutent que par cooptation. Lorsqu’ils apprennent qu’elle est passée par une
troupe semi-professionnelle de la métropole lilloise qu’ils considèrent comme une excellente
troupe, ils décident de la prendre à l’essai. Les improvisateurs se situent en référence à leurs
trajectoires dans différentes troupes : « Ah bon ? Il a joué à Lille trois ans et il est maintenant
à Nantes. Il doit en avoir sous le pied. » (Lilian, joueur à la TIPN).
9 A propos des problèmes conceptuels posés par la notion de trajectoire sociale, Claude Dubar (1998). Nous l'entendons ici comme la somme de l'expérience biographique des comédiens dans le milieu des troupes d'improvisation, quelque soit les spectacles joués par celles-ci.
10
spécifiques. Certains sont considérés comme « puncheurs », terme qui signifie que le joueur
en question arrive à faire des réparties humoristiques au tac au tac, qui se nourrissent du
comique de la situation jouée. À l’inverse, être « constructeur » caractérise un joueur qui au
travers de ses interventions sur scène participe à la mise en place de la trame narrative. Il y a
aussi des joueurs qualifiés de « sauteurs » — qui entrent facilement dans la patinoire
lorsqu’ils ont une idée —, alors que d’autres peuvent hésiter à intervenir dans une
improvisation qu’ils n’ont pas commencée. Enfin, il y a des joueurs « au service », qui
incarnent des personnages de second ou troisième rôle, mais qui vont permettre de débloquer
les situations narratives, apporter une précision nécessaire ou simplement déclencher
l’histoire. Les « bons » joueurs sont souvent décrits comme pouvant ajuster leur jeu entre ces
différentes catégories selon le déroulement de la partie. Ils seraient capables de se faire
puncheurs durant une saynète et constructeurs sur l’improvisation suivante, leader ou au
service, sauteurs s’ils estiment nécessaire de rentrer, ou à l’inverse de rester sur le banc
lorsqu’une improvisation fonctionne bien et que toute entrée supplémentaire n’est pas
considérée nécessaire. Ceci renvoie à une conception processuelle de la virtuosité, soit la
capacité d’un individu à adopter un comportement approprié à la situation en cours.
Autrement dit, un joueur qui manifeste un comportement que ses camarades de jeu
caractérisent comme pertinent face à la situation.
Une partie des catégories formant ces typologies est de l’ordre de l’indicible et de l’implicite.
La « couleur de jeu », terme indigène qui s’applique autant à un joueur qu’à une troupe et qui
renvoie à des multiples dimensions descriptives. Durant le premier tiers-temps d’un match, un
Jacques Ermont conseille une joueuse appartenant à l’équipe qu’il coach ce soir-là : « Soit
attentive à garder ta couleur de jeu, entre pas dans la précipitation de celui d’en face. C'est pas
comme ça que tu joues ». La couleur de jeu, en plus de désigner ce qu’on pourrait nommer un
style de jeu, intègre les univers de référence, les types d’improvisation et de personnage dans
lesquels un joueur ou une joueuse donne l’impression de se sentir à l’aise. Dire d’une joueuse
ou d’une équipe qu’il a la même couleur de jeu que soi signifie qu’elle joue dans un registre
similaire, avec des références communes, des affinités dans la mise en récit et en scène des
saynètes. L’existence d’une homologie dans les manières de jouer et affirmée par te tels
propos, et recherchée par les joueurs.
Les attentes du public, ou l’imaginaire des joueurs quant à ces dernières
11
Les attentes du public participent des polémiques entre joueurs quant à ce qu’il faudrait faire
sur scène. En se positionnant face aux attentes du public, les joueurs et les joueuses tracent les
limites de leurs propres attentes : « Non, mais faut pas se mentir, les gens ils viennent nous voir pour se détendre, pour passer un bon
moment, pas pour qu’on leur joue des impros dramatiques. Faut les faire rire ! » (Arnaud, joueur TIPN
depuis trois ans au moment de l’enquête)
« De toute manière le public, il n’est pas là que pour rire, faut aussi lui proposer des choses nouvelles,
quitte à le secouer un peu » (Léo, joueur TIPN et Pataugeoires depuis trois ans au moment de l’enquête
et ayant appartenu à deux autres troupes auparavant).
Derrière les attentes du public, ce sont avant tout les joueurs qui expriment ce qu’ils estiment
que le public désire voir. Les attentes du public, parce qu’elles sont postulées, servent aux
joueurs pour exprimer ce qu’eux pensent qu’il faille faire pour que le spectacle soit réussi.
Mobiliser l’argument du public dresse un horizon ultime d’évaluation, mais comme ces
attentes restent objectivement inconnues, les joueurs les évoquent à partir de leur propre
ressenti. L’argument du respect des attentes du public est d’ailleurs parfois retourné par
certains joueurs, inscrivant leur propos dans une tout autre conception. Certes il faudrait jouer
pour lui, mais aussi pour soi. « De toute manière, si les improvisations sont belles, le public il ressortira content, il ne se sera pas
ennuyé. C’est lorsque les joueurs s’ennuient sur scène, ne prennent pas de plaisir, que le public est déçu.
Un match pas terrible, si les joueurs sur scène ont eu de la complicité et du plaisir à jouer ensemble, le
public il va le sentir et ça sera un bon match pour lui » (Laëtitia, joueuse TIPN).
Par ailleurs, il est fréquent d’entendre « un public, ça s’éduque ! » et qu’il faut l’habituer à
certains standards de jeux imposés par la troupe. En ligne de fond dans ces débats, l’argument
repose sur « pour quoi le public paie-t-il sa place ? » : pour venir voir un spectacle
humoristique, auquel cas il faut le faire rire puisqu’il vient pour ça, ou, en payant, s’en remet-
il aussi à la troupe pour que cette dernière le surprenne ? Trancher la question est
objectivement impossible en l’état. Les joueurs doivent donc se convaincre entre eux et à
partir des représentations qu’ils projettent sur son public.
L’entité « public » n’intervient pas pour déterminer si un spectacle est réussi ou pas pour les
improvisateurs, mais il intervient dans les débats sur la finalité de la pratique de
l’improvisation : répondre aux attentes théoriques d’un public postulé, ou laisser une place à
l’expérimentation. En bout de course, c’est avant tout ce que les joueurs pensent que le public
attend d’eux qui sert d’étalon de mesure, ce qui nous ramène à des jugements propres aux
joueurs. Le public n’a d’ailleurs pas l’œil de l’improvisateur, ou, pour reprendre Becker, le
12
public est un cave10
Souvenirs et mémoires collectives des improvisateurs : comparer des performances passées
(Becker, 1985, p.109), quelqu’un qui ne sait pas : ce qui retient l’attention
d’un joueur durant une improvisation n’est pas de même nature que ce que le public peut être
amené à apprécier. Avec l’expérience, les joueurs connaissent les ficelles de jeu de leurs
partenaires, et émettent parfois des jugements négatifs sur une improvisation parce que
l’acteur a rejoué une situation ou un personnage qu’il maîtrise alors que le public peut l’avoir
particulièrement appréciée. Les joueurs appellent « une béquille » ou « tomate », un
personnage ou une compétence sur lesquels un improvisateur a tendance à s’appuyer par
facilité. Les critères du public ne recoupent donc que partiellement ceux des joueurs.
Nous avons esquissé comment, sein d’une troupe, émerge une forme de répertoire de
catégories de jugement portant sur la pratique de l’improvisation. Ces catégories ne sont pas
uniformément partagées et il est possible d’identifier des troupes dont les styles de jeu
s’opposent. En l’absence de support durable de diffusion – les rencontres ne font que très
rarement l’objet d’enregistrement – certaines rencontres font pourtant date et sont l’objet de
récits entre les joueurs dans les moments d’échange que nous avons évoqué plus haut. Ces
improvisations mémorables servent autant à évoquer de « bons » comme de « mauvais »
souvenirs d’expériences sur scène, comme je l’ai déjà évoqué pour les Pataugeoires et les
Improviseurs ci-dessus.
À force de temps passé entre joueurs, des mémoires collectives se forment au sein des
troupes. Nous reprenons ici le concept halbwachsien de mémoire collective, autrement dit la
mémoire d’un groupe social particulier. En suivant les remarques faites par Halbwachs à ce
propos, il est plus pertinent de parler de mémoire collective des improvisateurs d’une ligue
particulière (Brian, 2008). Ce concept s’est forgé à partir d’une réflexion sur les musiciens et
des traces que la composition musicale laisse sur les partitions (Halbwachs, 1997). Ces
dernières permettent une transmission dans le temps de cette mémoire. Selon ce qu’un groupe 10 Notons ici l’opération de subsomption des individualités dans l’entité « public » opérée par les joueurs
d’improvisation. On rencontre parfois des « experts » de l’improvisation dans le public, soit des joueurs d’autres troupes, soit d’anciens joueurs, soit encore des personnes férues d’improvisation qui développe une certaine lecture du jeu à force de voir des représentations. Les conjoints ou conjointes des joueuses et joueurs en font souvent partie. Dans la bouche des improvisateurs lors des discussions que nous évoquons ici, il faut entendre « public » dans une conception « masse de spectateurs ».
13
retient du patrimoine musical général, nous pouvons différencier plusieurs mémoires
collectives de groupes de musiciens. Aborder la mémoire des improvisateurs sous cet angle
demeure délicat dans la mesure où l’absence de traces laissées à la suite des performances
rend toute fixation de cette mémoire relativement éphémère. Il est cependant possible de
thématiser les souvenirs des improvisateurs dans ce sens, puisque Halbwachs traite de
l’appariement entre la mémoire individuelle et la mémoire collective : une mémoire collective
peut concerner deux individus qui formaient un groupe et qui, se retrouvant après plusieurs
années d’absences, évoquent ensemble le même souvenir, bien que chacun puisse en avoir
une version individuelle différente (Halbwachs, 1997, p.51 et suiv.). La mémoire collective
peut donc perdurer même sans support matériel dans la mesure où c’est la mobilisation de
souvenirs à travers la reformation du groupe qui compte.
Une des voies d’accès aux mémoires des improvisateurs consiste à observer les effets de la
remémoration des rencontres passées par un groupe d’improvisateurs. Les souvenirs
d’improvisation ou de matches ne font pas que participer à l’élaboration des catégorisations,
ils participent aussi de l’organisation du milieu de l’improvisation et des performances, et ce
de deux manières : par le choix des équipes pour les rencontres à-venir et par la formulation
d’attentes pour les performances futures. Les références aux performances passées sont au
cœur de ces deux processus.
Les occasions de se confronter à d’autres troupes ne sont pas nombreuses durant une saison.
Les équipes doivent choisir celles qu’elles inviteront et celles dont elles accepteront les
invitations. Lors de l’invitation de nouvelles équipes, les effets de la mémoire collective
jouent via la réputation et le partage d’une affinité dans la couleur de jeu. La programmation
de la saison est un moment clé pour l’année de la troupe, puisqu’elle lui permet d’évaluer sa
réputation : être invité ou réussir à inviter une troupe possédant une réputation d’excellence
est interprété comme la reconnaissance de sa propre réputation.
En 2005, une rencontre entre la TIPN la troupe de Nantes ne se déroule pas correctement, et
l’équipe nantaise décline dès lors toute invitation de la part de la troupe parisienne . Après
cinq années de sollicitations infructueuses, la TIPN reçoit enfin un retour positif de Nantes.
Le président et le formateur de la troupe parisienne firent alors le maximum pour envoyer la
meilleure équipe possible : « Faut leur montrer qu’on a repris le niveau, qu’on est sérieux et
qu’on a du répondant ! » Pour des raisons de calendrier, la rencontre à lieu à Nantes, avant
qu’un second match soit organisé en retour par Paris. Ces deux rencontres s’avèrent cette fois
concluantes pour les deux équipes, qui décident alors de s’inviter mutuellement l’année
14
suivante. Le président m’expliqua qu’il était alors très satisfait et qu’il y voyait le signe que la
TIPN, après plusieurs années de recomposition de la troupe, était de nouveau considérée
comme ayant le niveau de ce qu’il estimait être les grandes troupes françaises, telles celles de
Lille, Lyon et Rennes.
Le souvenir d’un mauvais match participe à la politique des troupes, rendant possibles les
occasions de performance. Mais plus que cela, sans avoir rencontré Nantes depuis plusieurs
années, la troupe parisienne conservait une image de la troupe nantaise au sommet de
l’improvisation en France. Dans les faits, l’équipe nantaise traversait une phase de
renouvellement de ses joueurs, les piliers de l’époque ayant pris leurs distances avec
l’improvisation. L’image qui était véhiculée au sein de la TIPN à propos de la troupe n’était
plus exactement le reflet de la situation objective de la troupe en question.
Les joueurs expérimentés arrivent à composer une topographie11 des troupes françaises
s’appuyant sur la fixation de la mémoire collective. Il y a potentiellement autant de
topographies différentes que de troupes d’improvisation, ce qui ne signifie pas que certains
points de ces topographies ne se recoupent pas. Elles révèlent des logiques de cloisonnement
entre différentes troupes, qu’il serait certainement possible de modéliser sous la forme de
réseaux. Une troupe inconnue de la TIPN la sollicite pour une rencontre. Un des membres
regarde sur leur site constate que c’est une troupe très jeune et qu’elle rencontre
principalement des troupes ayant la réputation d’un jeu « pouet-pouet », type de jeu
relativement mal vu par les joueurs de la TIPN. Il en fait part au président12
La mémoire collective des improvisateurs a donc un premier effet mesurable par cette
topographie que tracent les troupes. Elle discrimine à l’avance les partenaires potentiels dans
la mesure où une troupe noue des liens avec des équipes qui présenteront une homologie dans
, qui, sur ces deux
motifs décline l’invitation : une troupe jeune donc devant encore faire ses preuves, mais qui
semble en plus apprécier rencontrer des troupes dont la manière de jouer n’est pas appréciée
par la TIPN. Connaître qui joue avec qui participe donc à l’avance à la formation d’un
jugement de valeur sur le jeu probable des équipes.
11 Le terme de topographie est plus adapté à celui de cartographie, dans la mesure où les improvisateurs n’ont
pas affaire à une carte géographique qui représenterait un espace réel. Ici, topographie renvoi à une représentation de l’espace qui ne se veut pas reproduction de la réalité physique, qui est la représentation de l’espace des géographes et dont nous faisons l’usage, mais plutôt à une représentation de l’espace qui obéie à une syntaxe autre, celle des improvisateurs et qui ne se veux pas une représentation fidèle à la réalité. Cette topographie ne peut avoir d’usage en dehors du cénacle de l’improvisation, contrairement à la carte, qui se veut utilisable en tout temps. Se reporter à la réédition de l'ouvrage d'Halbwachs (2008).
12 Les troupes reposent en général sur une structure légale de type association de loi 1901. Elles ont donc à leur tête un bureau avec un président, un conseil d’administration, etc.
15
le jeu, la même « couleur de jeu ». Cette homologie est un critère qui configure les
performances à l’avance. Des manières de jouer trop différentes excluent a priori la possibilité
de rencontre. L’interconnaissance participe au relevé topographique et à l’actualisation des
réputations par des discussions entre joueurs faisant circuler et se réagencer les mémoires
collectives des troupes. Le choix des équipes à démarcher et des réponses positives à apporter
aux invitations présélectionne les possibilités de rencontre, donc les performances possibles.
Ici, les performances passées informent les possibilités de performances futures en amont des
matches.
La mémoire collective des improvisateurs ne participe pas seulement à la structuration des
opportunités de performances par la sélection des équipes. La remémoration d’improvisations
déjà vues fournit aux joueurs une base de formulation d’attentes pour les performances
futures. Si les improvisations sont uniques et ne se reproduisent jamais deux fois à l’identique,
il n’est cependant pas rare que les joueurs importent des idées d’une improvisation passée
dont ils ont conservé le souvenir.
Un joueur peut évoquer une improvisation pour transmettre des indications de mise en scène,
une distribution de l’espace ou une forme de construction narrative. À ce titre, l’évocation
peut autant servir de guide vers un but à atteindre et ainsi écarter des erreurs faites par le
passé. Certaines improvisations deviennent des cas d’école, utilisés pour illustrer ce qu’il faut
faire ou ne surtout pas faire. Mais ces cas sont finalement très variables d’un groupe
d’improvisateurs à un autre et sont surtout constitués de ce que chacun des groupes a vécu sur
une période de temps où ils jouaient régulièrement.
L’improvisation remémorée peut être une scène jouée durant un atelier d’entraînement, pour
reproduire un schéma de travail durant un match. Dans ce cas, l’évocation se fait durant les
vingts secondes de concertation avant le début de la saynète, et ce sont les joueurs qui ont eu
l’occasion d’assister à l’atelier en question qui peuvent suivre le propos : « Vous vous
souvenez, la semaine dernière à l’entraînement, l’impro avec les quatre chaises, on refait un
truc pareil ? ». L’évocation d’improvisations passées pour orienter l’action entraîne la
mobilisation de tout un ensemble de codes implicites simultanément évoqués par le biais de
ce souvenir : une situation jouée, un positionnement dans l’espace, un schéma narratif, une
distribution des rôles.
La mémoire collective d’un groupe d’improvisateur participe donc à la mise en forme des
performances par deux moyens. D’abord par la structuration par affinité de jeu des logiques
16
de sélection des équipes pour jouer, puis par la formulation d’attentes de jeu. Cette mémoire
ne dure que dans la persistance des groupes d’improvisateurs et leur mise en contact. Elle peut
circuler d’un groupe à un autre par l’intermédiaire des joueurs multisitués qui mettent
plusieurs mémoires en contact. Le support physique de cette mémoire étendue est identifiable
dans le dispositif scénique des matchs d’improvisation, dont l’agencement des éléments dans
le temps et l’espace de la représentation se reproduisent d’une fois sur l’autre. Si l’activité est
mise en série dans les souvenirs des joueurs, c’est parce que les matches d’improvisations se
déroulent tous selon le même canevas et les mêmes règles. Cette mise en série dans un
dispositif se reproduisant peu ou prou d’une occasion à l’autre permet aux joueurs d’avoir un
cadre mémoriel commun. Ce cadre leur donne la possibilité de comparer leurs performances,
que ce soit une saynète isolée ou tout un match. Le partage d’un dispositif scénique semble
être une des conditions de possibilité d’une mise en série sur laquelle reposent les différents
processus de catégorisation du jeu que nous venons de présenter. Cette mémoire collective de
l’improvisation ne repose donc pas seulement dans les « têtes » des joueurs, elle a un substrat
physique, comme les partitions pour les musiciens.
Conclusion
Nous avons cherché à montrer en quoi les performances improvisées dans les matches font
l’objet d’un processus de qualification de type évaluatif par les praticiens, qui formulent ainsi
des repères pour parler de leur pratique et comparer les performances entre elles. Ces
catégories sont portées par les individus qui les ont intériorisées et s’en servent comme
schèmes organisateurs de leur monde via la topographie des troupes ou l’ensemble de
maximes portant sur les manières recevables de jouer. Elles exercent une normativité et
contraignent les possibles sur scène. Elles s’activent dans des circonstances sociales
particulières, que nous avons qualifiées ici d’écologie, pour désigner l’ensemble des activités
qui encadrent la performance. Ces catégories de jugement sont travaillées par l’activité,
reconsidérées en regard des circonstances de la scène. Certains « coups » dans le jeu sont
considérés comme inconcevables et les joueurs s’opposent fermement à leur survenue.
D’autres sont actés comme valides sans discussion. D’autres encore sont considérés comme
acceptables par certains, mais regrettables par d’autres. Nous retrouvons la caractéristique
normative du fait social pour penser la performance. Mais cette fois, cette normativité est
17
confrontée aux impondérables de la scène, et bien que la performance soit socialement
contrainte, l’incertitude laisse le système ouvert pour des solutions in situ qui seront
régularisées par la suite dans les discussions entre joueurs ; incorporées ou non à la mémoire
collective, aux catégories de l’entendement des improvisateurs, à leurs répertoires de jeu.
Autrement dit, cette normativité peut être conçue comme située. L’ordre interactionnel sur
scène ne semble pas indépendant de l’ordre social des improvisateurs.
Les performances improvisées dans les matchs d’improvisation ne sont donc pas des
évènements à la singularité irréductible, elles s’imbriquent dans une mémoire, elles sont
reliées les unes aux autres par les joueurs. Ces mémoires ne sont pas uniquement des
souvenirs revisités, mais bien des moyens d’action orientés vers le futur. Elles participent de
l’organisation du milieu des improvisateurs comme une contrainte et une ressource, et
déterminent au moins en partie les possibilités de rencontre. D’autre part, la mémoire
collective des troupes participe aussi au contenu des performances par des effets de
reproduction de configurations scéniques déjà jouées.
Certes, les joueurs ne savent pas ce qui va effectivement se produire sur scène, l’incertitude
demeure irréductible, mais cette dernière est cadrée dans des dispositifs techniques et sociaux
qui réduisent le champ des possibles : le théâtre, le décorum, l’apprentissage et le partage de
représentations communes. L’incertitude laissée sur scène, durant les saynètes, est donc
structurée par avance, elle est strictement cadrée et possède sa propre structure.
L’improvisation n’est donc pas naturellement synonyme d’aléatoire.
Thura Mathias
Doctorant de l’EHESS
Rattaché au Centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS)
Bibliographie
BAUDRAND Oriane, Match d’improvisation théâtrale. Etat des lieux : une évolution est-elle
possible, mémoire de master 2, Paris 3, 2008.
BECKER Howard, Outsiders : étude de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985
[1963].
BECKER Howard, Les mondes de l’art, Paris : Flammarion, 1988 [1982].
18
BECKER Howard, « Du jazz aux mouvements sociaux : le répertoire en action », Tracés,
Lyon : Editions de l’ENS, n° 18, 2010, pp. 223-236.
BECKER Howard et FAULKNER Robert, qu’est-ce qu’on joue maintenant... ? Le répertoire
du jazz en action, Paris : La Découverte, coll. Sciences Humaines, 2011.
BENSA Alban, « De la relation ethnographique. A la recherche de la juste distance »,
Enquête. Anthropologie. Histoire. Sociologie, Marseille : Éditions Parenthèses, n° 1 (1995),
pp. 131-140.
BONNERAVE Jocelyn, « Pour une écologie musicale. Les performances de jazz », L’Homme,
Paris : Éditions de l’EHESS, n° 181, vol. 1, 2007, pp. 103-129.
BOURDIEU Pierre, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris : Le
Seuil, 1992.
BRIAN Éric, « Porté du lexique halbwachsien de la mémoire », dans HALBWACHS
Maurice, La topographie légendaire des évangiles en Terre sainte, Paris, PUF, coll. Quadrige,
2008 [1941], pp. 113*-146*.
BUSCATTO Marie, Femmes du jazz. Musicalités, féminités, marginalisations, Paris : CNRS
Éditions, 2007.
BUSCATTO Marie, « L’art et la manière : ethnographies du travail artistique », Ethnologie
française, Paris : PUF, vol. 38, n° 1, 2008, pp. 5-13.
CAMBILLARD Benoît, Sociologie d’un jeu. Les matches d’improvisation théâtrale, mémoire
de maîtrise de Sciences Politiques, Université Paris X Nanterre, 1992.
DARMON Muriel, « La notion de carrière : un instrument interactionniste d’objectivation »,
Politix. Revue des Sciences Sociales du Politique, Paris : De Boeck supérieur, vol. 21, n° 82,
2008, p. 149-167.
DUBAR Claude, « Trajectoires sociales et formes identitaires : Clarifications conceptuelles et
méthodologiques », Sociétés contemporaines, Paris : Presses de Science Po, n° 29, 1998,
pp. 73-85.
EBER Alexandre, Les vertus de l’improvisation théâtrale sur les compétences
professionnelles, mémoire diplôme, ICN Strasbourg, 2010.
ERTEL Évelyne, « Le théâtre pris au piège du sport », Théâtre/Public, Montreuil : Éditions
Théâtrales, n° 63, mai-juin, 1985, pp. 74-78.
FAULKNER Robert et BECKER Howard, « Studying Something You Are Part Of: The View
From the Bandstand », Ethnologie Française, Paris : PUF, vol. 38, n° 1, 2008, pp. 15-21.
GARFINKEL Harold, Études en ethnométhodologie, Paris, PUF, coll. Quadriges, 2007
[1967].
19
GRAVEL Robert et LAVERGNE Jan-Marc, Impro I. Réflexions et analyses, Ottawa, Éditions
Léméan, 1987.
GRAVEL Robert et LAVERGNE Jan-Marc, Impro II. Exercices et analyses, Ottawa, Éditions
Léméan, 1989.
HAGBERG Garry, « Jazz Improvisation : A Mimetic Art ? », Revue internationale de
philosophie, Fontenay sous bois : Assoc RIP, n° 238, vol. 4, 2006, pp. 469-485.
HALBWACHS Maurice, La mémoire collective, Paris, PUF, 1997 [1950].
HALBWACHS Maurice, La topographie légendaire des évangiles en Terre sainte, Paris, PUF,
coll. Quadriges, 2008 [1941].
JOURDAN Jean, Hybridation des pratiques sportives et artistiques : Les Matchs
d’Improvisation Théâtrale, DEA de STAPS, Université Paris Sud, 1993.
JOUVENET Morgan, « Emporté par le mix. Les DJ et le travail de l’émotion », Terrain,
Paris : Ministère de la culture, n° 37 (2001), pp. 45-60.
LABORDE Denis, « Enquête sur l’improvisation », dans QUERE Louis et FORNEL Michel
(de) (dirs.), La Logique des situations, Paris : EHESS, collection Raisons Pratiques, 1999,
pp. 261-299.
LABORDE Denis, La Mémoire et l’Instant. Les improvisations chantées du bertsulari
basque, Bayonne : Elkar, 2005.
SIZORN Magali, « Une ethnologue en “Trapézie” : sport, art ou spectacle ? », Ethnologie
Française, Paris : PUF, vol. 38, n° 1, 2008, pp. 79-88.
THURA Mathias, Agir dans l’incertain : les dispositifs sociaux et techniques pour
appréhender une situation d’incertitude. L’exemple des matchs d’improvisation théâtrale,
mémoire de master 2, EHESS/ENS, 2009.
TRENVOUEZ Arnaud, « Pour la conception de dispositifs de formation au travail
collaboratif. Analyse en ergonomie cognitive de l’activité collective en match d’improvisation
théâtrale », thèse de doctorat, Université de Nantes, 2013.
TRENVOUER Arnaud et THURA Mathias, « L’improvisation théâtrale en formation pour
adulte. », Education permanente, Paris : CNAM, vol. 194, pp. 79-90.
VETTORATO Cyril, Un monde où l’on clashe – La joute d’insulte verbale dans la culture de
la rue, Paris : Éditions des archives contemporaines, 2008.