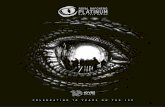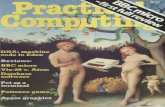patience and fortitude conquer all things - Royal Bafokeng ...
Daniel Cordier, Patience du mémorialiste ("Critique", n° 754, mars 2010)
-
Upload
sorbonne-fr -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Daniel Cordier, Patience du mémorialiste ("Critique", n° 754, mars 2010)
Patience du mémorialiste :Daniel Cordier
et le « temps des Mémoires »
Daniel CordierAlias Caracalla } Paris,
Gallimard, coll. « Témoins »,2009, 931 p.
Quelque chose de nouveau survient actuellement dansle rapport fait de collaboration et de rivalité qui unit l’histoireaux Mémoires, en France, depuis plus de cinq siècles. Jus-qu’alors, il était entendu qu’entre le déroulement des événe-ments et leur reconstitution à froid par les historiens sesituait un temps intermédiaire, qu’Albert Thibaudet nommaen 1920 « le temps des Mémoires ». Durant cette période dedécantation, les acteurs et témoins privilégiés de l’advenuracontent leur existence parce que celle-ci se confond en par-tie avec les faits d’intérêt collectif. Un tel processus d’incor-poration joue un rôle essentiel dans la mémoire nationalepuisqu’il contribue à l’émergence et à la stabilisation de l’his-toire récente : le passé de ceux qui racontent leur existence(hommes politiques, chefs militaires, personnalités publi-ques, écrivains célèbres...) se double, en effet, du passé queleurs lecteurs apportent en tant que compatriotes, specta-teurs de leurs actions passées ou familiers de leurs œuvres.Rattachées par mille liens à nos propres souvenirs, ces viespubliques servent de repères à notre élaboration partagée durévolu, en sorte que « nous attendons les mémoires d’un Tal-leyrand ou d’un Clemenceau avec la même impatience et lesmêmes espoirs que ceux d’un Sainte-Beuve ou d’un Renan 1 ».
1. A. Thibaudet, « Mémoires » [1920], dans Réflexions sur la litté-rature, éd. A. Compagnon et C. Pradeau, Paris, Gallimard, 2007,p. 461.
Ainsi convient-il d’entendre la formule d’Albert Thibaudet quipar « temps des Mémoires » désigne ce phénomène d’incorpo-ration par lequel la vie de certains contribue à fixer, demanière plus ou moins efficiente, plus ou moins polémique,les grands repères du passé « immédiat » – c’est-à-dire assezproche de notre présent pour que les enjeux nous en soientencore familiers.
Il se trouve que le développement fulgurant de l’« histoiredu temps présent » à partir des années 1980 a radicalementbouleversé la donne en dépossédant les mémorialistes desprérogatives « naturelles » dont ils jouissaient jusqu’alors– cela néanmoins tout en stimulant leur productivité, puisqueceux-ci se sont vus sollicités par les professionnels du passéau titre de témoins parmi d’autres : à la fois concurrencés etexhortés, les auteurs de « Vies majuscules » ont été conduitsà offrir des bilans de vie (l’achèvement du siècle favorisant laprolifération de ces récits où l’existence d’un individu seconfond avec la période écoulée) dont l’intérêt restait trèsstrictement limité car il était soumis aux cadres fixés par leshistoriens. Là où le rapport de concurrence favorisait autre-fois une saine émulation entre acteurs et chercheurs, lesmémorialistes se sont vus placés sous la « surveillance » deshistoriens du temps présent. L’indéniable productivité édito-riale dont fait preuve aujourd’hui le genre ne garantit parconséquent en rien la valeur des textes publiés : anesthésiéspar les spécialistes qui en contrôlent étroitement la produc-tion, les Mémoires sont omniprésents mais pour beaucoupd’entre eux indigents.
La publication d’Alias Caracalla de Daniel Cordier remeten cause cette progressive domestication des Mémoires. Celacontre toute attente... Car l’ancien secrétaire de Jean Moulin– à ce titre témoin central de la Résistance entre juillet 1942et juin 1943 – n’avait longtemps pas jugé bon d’en livrer unrécit et avait, à l’inverse, préféré devenir historien, certes demanière tardive mais radicale, en optant pour la recherchela plus rigoureuse, la plus minutieuse : une biographie del’ancien chef du Conseil de la Résistance en trois volumes,Jean Moulin : l’inconnu du Panthéon, suivis d’une vaste syn-thèse, Jean Moulin : la République des catacombes. Cordieravait beau avoir annoncé la publication de ses Mémoiresdepuis plus d’une dizaine d’années, on était donc en droit de
231P A T I E N C E D U M É M O R I A L I S T E
se demander ce qu’un récit à la première personne pouvaitapporter de plus à ces 4 139 pages où la biographie de Moulinservait de fil directeur à une immense histoire de la Résis-tance, composées d’innombrables documents, de fascinantsportraits, ainsi que d’une analyse exhaustive de l’affaireHardy et des polémiques nées autour de la figure de JeanMoulin.
C’est dire l’enjeu que soulève aujourd’hui Alias Caracalla.Daniel Cordier y redresse une dialectique quelque peu grippéeet réaffirme l’éminence de ce que j’appelle ici les « Vies majus-cules ». S’y joue la permanence d’un « temps des Mémoires »,même si l’ordre (et la préséance) réglant l’écriture du passén’est nécessairement plus le même depuis que les historiensse sont emparés du « temps présent ». La valeur que nousaccordons à ces Vies majuscules en dépend étroitement.
De l’historien au mémorialiste : où se situe aujourd’hui le« temps des Mémoires » ?
Le parcours littéraire de Daniel Cordier est le résultatd’un double renversement, tout à fait inattendu dans un cascomme dans l’autre. Ce résistant, témoin central du fait deson extrême proximité avec Jean Moulin et des contacts quo-tidiens qu’il avait avec les dirigeants des différents mouve-ments, refusa après la guerre le rôle de gardien du temple etse consacra à sa carrière de marchand d’art trente annéesdurant. Silence qu’il rompit en octobre 1977, lorsqu’il décou-vrit L’Énigme Jean Moulin, où Henry Frenay accusait le hérosmort sous la torture des Allemands d’avoir été « crypto-communiste » : incapable de contrer efficacement l’ancienchef de Combat lors d’une émission des « Dossiers de l’écran »consacrée à Moulin, Cordier se convertit (le mot a ici tout sonsens) à l’histoire, là où son parcours aurait dû, à l’inverse,tout naturellement le conduire aux Mémoires.
La singularité (et partant la valeur) d’Alias Caracalla tientà ce fait extrêmement rare que le récit personnel y résulte dela rigoureuse ascèse historiographique à laquelle le témoins’est volontairement soumis – au point d’avouer dans la pré-face de Jean Moulin : l’inconnu du Panthéon que « les cinqannées passées à faire la guerre furent pour [lui] moinséprouvantes que les douze années durant lesquelles [il a]
232 C R I T I Q U E
essayé de les raconter 2 ». Daniel Cordier dut, en effet, décou-vrir pour son propre usage les lois de la recherche historique.Après un premier brouillon de deux cents pages où il visait àpersuader de l’innocence de Jean Moulin plutôt que d’établirles faits (cédant ainsi au défaut qu’il condamnait chez Frenay,à savoir privilégier les arguments au détriment des faits), ils’employa à reconstituer le déroulement des événements avecminutie, comprenant à l’usage que les erreurs de jugementne peuvent être évitées qu’en resserrant toujours plus le mail-lage de la chronologie, en situant chaque fait dans soncontexte et en le fondant sur des preuves. Mais là encore,Daniel Cordier prit conscience qu’il « en va des documentscomme des ossements anciens, il faut leur rendre leur fonc-tion et leur vie : c’est-à-dire les rendre intelligibles 3 ». Un teltravail, qui compta entre 1977 et 1989 (date de la publicationdes deux premiers volumes de Jean Moulin : l’inconnu duPanthéon chez Lattès) plusieurs versions, reposait en partiesur une critique du genre mémorial : la lecture attentive desrécits des principaux chefs de la Résistance lui avait en effetrévélé « l’ampleur des erreurs qu’ils avaient commiseslorsqu’ils avaient tenté d’évoquer le passé 4 » – facteur qui nefut pas sans conséquence sur son propre travail, puisqueCordier dut renoncer à raconter les événements à la premièrepersonne, ainsi qu’il avait tenté de le faire à partir du 1er août1942, date de sa rencontre avec Moulin (alias « Rex »). Entreles souvenirs du témoin et les documents de l’historien, il luifallait trancher.
2. D. Cordier, Jean Moulin : l’inconnu du Panthéon, I, Une ambi-tion pour la République, Paris, J.-C. Lattès, 1989, p. 303. Voir de mêmel’intervention de Cordier dans Mémoire et histoire. La Résistance, sousla dir. de J.-M. Guillon et P. Laborie, préface de P. Joutard, Toulouse,Privat, 1995, p. 299-311. Une partie des informations qui suivent pro-viennent d’un entretien avec l’auteur le jeudi 2 juillet 2009.
3. D. Cordier, Jean Moulin : l’inconnu du Panthéon, I, op. cit.,p. 291.
4. Ibid., p. 292. « La plupart du temps, les auteurs se contententde commentaires ou d’interprétations accrochés à quelques faits, dontla datation – quand elle existe – est souvent douteuse. Ce procédéfacilite évidemment les manipulations rétrospectives, mais prépare degrandes surprises et de rudes déceptions aux historiens, quand vien-nent au jour les documents d’époque » (ibid., p. 295).
233P A T I E N C E D U M É M O R I A L I S T E
Symbolique à cet égard est l’amitié qui le lia à Jean-Pierre Azéma, auteur d’une thèse consacrée à Daladier, quidésirait à cette même époque travailler sur Jean Moulin :dirigé par le directeur des archives sur Daniel Cordier qu’ilaborda comme un témoin, l’historien rencontra en réalité uncollègue à qui sa double position de chercheur et d’anciensecrétaire du chef du CNR (Conseil national de la Résistance)– en possession, à ce titre, de nombreux documents – avaitouvert l’accès aux archives du BCRA (Bureau central de ren-seignements et d’action) aux Archives nationales, alors inac-cessibles à l’époque. D’une certaine manière mentor deDaniel Cordier auquel il transmit son savoir historiographi-que et qu’il encouragea dès le début des années 1980 à écrireses souvenirs, Jean-Pierre Azéma fut aussi son disciple,puisque son Jean Moulin : le politique, le rebelle, le résistant,ne parut qu’en 2003. Entre-temps les travaux de Daniel Cor-dier étaient devenus une référence incontournable sur lesujet.
Une première contribution à un colloque de l’Institutd’histoire du temps présent (Jean Moulin et le Conseil de laRésistance, 1983) fut suivie en 1989 et 1993 des trois tomesmentionnés chez Lattès (un quatrième restait à écrire puis-que la biographie s’interrompait, alors, au départ de Moulinà Londres). En 1994, Pierre Nora proposa à Daniel Cordierde publier ses Mémoires chez Gallimard et s’engagea à repu-blier ses travaux précédents : l’intéressé entreprit donc à cettedate la rédaction d’Alias Caracalla, dont le brouillon atteintrapidement 500 pages. En 1997, à l’approche du centenairede la naissance de Jean Moulin, Pierre Nora sollicita à nou-veau notre témoin : on prévoyait de republier la préface de300 pages parue dans le premier tome de Jean Moulin :l’inconnu du Panthéon, qu’il s’agissait d’actualiser, maisl’auteur proposa en lieu et place Jean Moulin : la Républiquedes catacombes, 999 pages de synthèse et de recherches iné-dites, pour lesquelles il interrompit la rédaction de sesMémoires. La parution de cette nouvelle somme chez Galli-mard en 1999 le laissa quelque peu désemparé : il lui fallutplus d’un an pour reprendre un projet mémorial qui l’obligeaità revenir sur son engagement de jeunesse à l’Action français,son antisémitisme mais aussi sa vie sexuelle – autant de véri-tés personnelles qui soulevaient des difficultés d’un ordre
234 C R I T I Q U E
bien différent de la recherche de la vérité historique. De fil enaiguille, Daniel consacra plus de 2 500 pages à sa jeunesse,suivie de sa mission aux côtés de Jean Moulin, de la mort deson « patron », puis de sa propre conversion à l’histoire afinde défendre la mémoire de ce héros. Alors qu’il poursuivaitcette interminable entreprise mémoriale, Jean-Marie Lacla-vetine, membre du comité de lecture de Gallimard, vint auprintemps 2007 consulter les différents manuscrits disponi-bles et opta pour un découpage resserré : du départ du jeunehomme pour l’Angleterre en juin 1940 jusqu’à la mort deMoulin. La jeunesse de Cordier se réduisit dès lors à unpréambule de dix pages et l’affaire de Caluire servit de termi-nus ad quem d’un texte qui offrait ainsi la même homogénéitéchronologique que les Mémoires de guerre du général deGaulle 5.
Là où les mémorialistes sont aujourd’hui contraintsd’écrire sur une période entièrement quadrillée par les histo-riens, Daniel Cordier s’est approprié la maîtrise des profes-sionnels du révolu avant de livrer ses propres souvenirs.Peut-être jugera-t-on alarmiste de parler d’une « domestica-tion » des Mémoires. Il me semble néanmoins que confonduesavec tous les témoins que l’historien interroge comme autantde « bouches de vérité », placées au service d’une enquête dontle cadre épistémologique reste, en partie, étranger à la dimen-sion mémorielle, la portée polémique et la visée esthétiquequi font leur valeur, les Vies majuscules perdent leur auto-nomie et risquent d’être réduites au rang de simples sources,souvent suspectes de partialité. L’histoire du genre mémorialest ponctuée par ces renouveaux soudains qu’apporte, à desmoments stratégiques, la publication de grands textes, pro-pres à relancer la dialectique unissant les spécialistes durévolu à leurs auxiliaires privilégiés, les mémorialistes. AliasCaracalla, qui se présente comme l’aboutissement d’un longtravail historiographique auquel il n’a pas servi, en tant quetel, de « source » mais qu’il vient en quelque sorte couronner,est bien l’un de ces grands textes.
5. Alias Caracalla est, on le voit, la pièce centrale d’un bien pluslong récit couvrant l’enfance de Cordier, sa vie affective et sexuelle,son métier de marchand d’art, ses souvenirs d’écrivains ou d’artistesentre autres, et dont la rédaction se poursuit actuellement.
235P A T I E N C E D U M É M O R I A L I S T E
Incertitudes présentes et certitudes rétrospectives : à queltemps raconter ses souvenirs ?
Car les Vies majuscules disposent d’atouts non négligea-bles. L’un des principaux buts de l’immense biographie deDaniel Cordier était de lutter contre l’anachronisme dont lesmémorialistes comme les historiens de la Résistance ontsouvent été victimes :
Inversant la marche du temps, ils ont eu tendance à en remonterle cours en partant de la situation éminente acquise, à la Libé-ration, par certains acteurs ou certains mouvements. Ce pointde vue déformant a amplifié leur rôle ou leur importance, et cerétrospectivement, dès l’origine de leur action balbutiante de1940-1941, quitte à laisser dans l’ombre les pionniers trop tôtdisparus 6.
Si l’établissement d’une chronologie rigoureuse, la quêtede documents incontestables ou le croisement des témoigna-ges disponibles ont protégé l’auteur de Jean Moulin : la Répu-blique des catacombes d’une telle erreur, celui d’Alias Cara-calla dispose d’autres moyens pour faire comprendre auxlecteurs contemporains ce que représenta réellement l’enga-gement dans la Résistance. Non parce que le savoir dont ildispose serait plus assuré, plus objectif, mais parce que luiaussi est en mesure de raconter les événements sans leursubstituer ce qu’il sait de leur action ultérieure.
Ladifficulté tientàceque le futurcontingentapparaît,unefois survenu, comme réel et même comme nécessaire, phéno-mène que Jean Paulhan nommait « prévision du passé » danssaLettreauxdirecteursdelaRésistance : « Ilnoussemblevolon-tiers après coup, quand un événement s’est passé, que nousl’attendions et nous préparions à lui confusément. À plus forteraisonnouslesemble-t-ilpourautrui. [...].Lemot finnesignifiepas moins dénouement qu’intention, et il n’est guère douteuxque nous avons tendance à confondre l’un et l’autre sens 7. »
6. D. Cordier, Jean Moulin : la République des catacombes, Paris,Gallimard, 1999, p. 24.
7. J. Paulhan, Lettre aux directeurs de la Résistance, Paris, Ram-say, 1987, p. 27-28. Sur les questions de poétique du genre mémorial,je me permets de renvoyer à mon ouvrage Écrire ses Mémoires auXXe siècle. Déclin et renouveau, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèquedes idées », 2008.
236 C R I T I Q U E
Ni l’historien ni le mémorialiste ne peuvent prétendre éra-diquer entièrement une illusion à ce point constitutive denotre rapport au passé. Plus qu’à son tour, le second estmême tenté d’y céder afin d’orienter un récit qui lui permetde plaider sa cause devant le tribunal de la postérité. Quelgarde-fou le mémorialiste peut-il dès lors se fixer ? DanielCordier choisit pour sa part de recourir à une forme, à pre-mière vue, totalement artificielle : le journal intime. AliasCaracalla se présente, les dix premières pages autobiographi-ques une fois passées, comme un faux journal, ou plus pré-cisément un journal factice (entrées datées, conversationsreconstituées, informations ultérieures en notes de bas depage...), dont l’unique et fragile garantie sont les quelquesextraits du journal qu’il tient de fait lors de sa fuite de Franceet au début de son séjour en Angleterre, citées ponctuelle-ment en italique à partir de la page 68 :
Vendredi 21 juin, sur le Léopold II, 9 heures.La mer s’est assagie. Le vent fouette mon visage. Soir de marined’une poésie sobre, presque sombre. Les Allemands sont àBayonne. [...] Nous sommes dix-sept jeunes qui partent pleins del’espoir de vaincre. Quand reviendrons-nous ?
Pour le reste, Cordier ne peut compter que sur la puis-sance de sa mémoire, les recherches accomplies sur cettepériode de sa vie et les quelques documents retrouvés : unelettre de son camarade Briant – « instantané irremplaçable denos sentiments, jugements et préoccupations pour un lecteurd’aujourd’hui » (p. 515) – ou trois feuillets contenant lesrecommandations de Rex avant son départ à Londres – « Lesrécits que j’ai reconstitués sont, en dépit de tout, plus oumoins ornementés par l’imagination et l’oubli. Ces billets sontla voix authentique de Moulin, sans la déformation dutemps » (p. 652). La discontinuité propre au journal lecontraint ainsi à reconstituer un point de vue naïf, (théori-quement) vierge du savoir qu’apporte l’ultérieur. Elle marquede plus la sortie du temps de l’enfance, uniforme et par consé-quent insignifiant, puisque le journal débute le lundi 17 juin1940, lorsque le jeune homme prend conscience que le Maré-chal, en appelant à cesser le combat, trahit la France. Cordierdécide de poursuivre la lutte en fuyant le pays livré àl’ennemi. Elle confère aussi à l’expérience du jeune exilé,
237P A T I E N C E D U M É M O R I A L I S T E
devenu une recrue de la France libre à ses débuts, puis unagent du BRCA et le secrétaire de Jean Moulin, une épaisseurqu’un tel parcours a rarement : c’est tout le palimpseste dutemps historique qui nous est livré grâce aux effets decontraste entre l’action du récit raconté au présent et le pointde vue rétrospectif situé dans les notes de bas de page.
Le procédé impose, bien entendu, de répartir la matièrebiographique de façon quelque peu forcée. Le lundi 5 mai 1941a ainsi pour sous-titre « Sergent armurier » : à cette date, lejeune Cordier reçoit une nouvelle tâche, dont l’auteur livrealors une description succincte mais couvrant toute la périodedurant laquelle il l’exerça ; l’entrée de journal se mue en rubri-que thématique pour les besoins du récit. Reste qu’un tel arti-fice confère à l’ensemble du texte un sentiment de coïncidenceavec le déroulement des événements : les choix sont pris dansl’incertitude, les figures des camarades rencontrés (RaymondAron, Georges Bidault, Jean Moulin...) prennent forme trèsprogressivement, le poids du quotidien (les risques encourus,la répétition de tâches ingrates, l’absence de ce romanesquequi s’attache d’ordinaire au récit d’existences clandestines)confère à l’ensemble un réalisme inestimable. Un tel choixn’était possible que sur une période donnée : de la vie dumémorialiste nous est livrée une coupe, une vue synchroni-que ; le temps est envisagé dans sa profondeur, sa complexitégéologiqueetnondanssonextension, sa résistanceà l’épreuvede la durée. Pour cela, il fallait que se produise la coïncidenceentre une guerre mondiale et la venue à maturité d’un indi-vidu, avide de vivre conformément à ses idéaux.
Antisémitisme, pétainisme et résistances : zones grises de laconscience nationale
Alias Caracalla se double, en effet, d’un véritable romande formation, où le héros, voyant s’effondrer chacune desconvictions dont il avait héritées, ne cesse de se demander :« Aurai-je le courage, un jour, d’être moi-même ? » (p. 452). Aucombatcontre l’ennemisesubstitueuncombatplus intérieur :si Daniel Cordier ne rencontre au cours de la guerre que trèspeu d’Allemands – et n’en tue aucun, ce qui explique, entreautres, qu’il ait si longtemps résisté à l’injonction des histo-riens qui sollicitaient ses Mémoires : il n’avait « pas fait la vraie
238 C R I T I Q U E
guerre » ! (p. 251) –, il rejette en revanche le fardeau de sonéducation politique maurassienne qui nous paraît, avec lerecul, incroyablement anachronique. Cela à l’issue d’innom-brables contradictions. Engagé depuis peu dans les rangs dela France libre, le jeune homme se promet de réaliser dans savie « un christianisme intégral et de rétablir l’ordre chrétien enFrance » (p. 154). Bien qu’il soit électrisé par les discours duGénéral qui promet de rester fidèle aux principes démocrati-ques « quenosancêtresont tirésdugéniemêmedenotre race »,il lui paraît indispensable de faire fusiller les hommes du Frontpopulaire, « les vrais coupables » (p. 262), à la Libération. Anti-sémite déclaré, il se lie immédiatement d’amitié avec RaymondAron dont il admire l’intelligence et qu’il croit lui aussi mau-rassien : quelle surprise lorsqu’un ami lui apprend qu’Aron estjuif – « Ne voulant pas me reconnaître battu, je répliquaifurieux : “De toute manière, c’est mon ami” » (p. 241).
Sources d’une violente guerre idéologique franco-fran-çaise, ces décalages entre les grilles d’appréhension du mondeet l’action menée dans les rangs de la Résistance sont partagéspar beaucoup des compatriotes de Cordier. Mme Moret, femmecourageuse sur qui le jeune homme sait pouvoir toujourscompter, avoue avoir cru lors de leur première rencontre qu’ilétait juif, et ajoute, pour le rassurer, avoir reconnu son erreuraprès quelques jours : « Vous ne vous conduisez pas du toutcomme un Juif » (p. 401) ! Elle qui risque sa vie tous les jourspour aider un résistant gaulliste admire le sacrifice de Pétain,véritable protecteur des Français : fille d’un officier supérieurami du Maréchal, Mme Moret est à la fois pétainiste, vichysteet gaulliste, mariant tant bien que mal ces différentes fidélités.Vécues ici dans l’intimité, ces contradictions sont celles danslesquelles se débattirent aussi certains dirigeants commeHenri Frenay, qui rencontra à plusieurs reprises des membresdu régime de Vichy avant de reconnaître que ces tractationsconduisaient à une impasse.
C’est à cette aune que se juge la valeur des Vies majus-cules qui, pour rendre compte de la complexité d’une situationhistorique, font apparaître dans la vie d’un individu (ou celled’une nation à un moment donné de son histoire) le divorceentre les intentions préalables, les actions menées et lesconséquences qui en découlent, plaçant ainsi l’auteur du réciten situation de juger ce qu’il fut et ce qu’il fit. Inutile, sur ce
239P A T I E N C E D U M É M O R I A L I S T E
point, de multiplier les repentirs : l’existence racontée suffit àmettre en évidence la métamorphose à l’œuvre. Confronté auxévénements, l’individu ne cesse, en effet, de réélaborer l’imagequ’il se fait de lui-même, d’ajuster, plus ou moins rapidement,plus ou moins efficacement, les composantes de son identité(travail de reconfiguration qu’il poursuivra dans l’immédiataprès-coup, puis rétrospectivement). Daniel Cordier intègreainsi peu à peu un vocabulaire politique nouveau, adhère auxprincipes républicains et surtout cache chez lui une nuit unJuif traqué (auquel il fixe pour signe de reconnaissanceL’Action française lors de leur rendez-vous : « Il ne ressemblenullement aux caricatures de Gringoire ou de Je suis partout.Où sont sa bedaine, son opulence, sa morgue ? », p. 441), souf-fre de voir ses anciens amis refuser de rejoindre la Résistanceparce que leur haine des « ennemis intérieurs » l’emporte surcelle des nazis, enfin prend pleinement conscience de sa pro-pre responsabilité lorsqu’il croise pour la première fois à Parisun vieillard accompagnée d’un enfant avec l’étoile jaune :« Subitement, mon fanatisme aveugle m’accable : c’est doncça l’antisémitisme ! » (p. 735).
Gide, Maurras et Valéry : la littérature comme option de vie
À cette vaste entreprise de liquidation, la littérature nereste pas étrangère. On aurait tort de juger anecdotiques lesgoûts esthétiques du jeune Cordier. C’est au contraire dansle détail de ses lectures que se joue la métamorphose la plusfascinante d’Alias Caracalla. Car son auteur évoque un tempsoù des jeunes gens éprouvaient une passion exclusive, vio-lente pour la politique et la littérature, quasi indissociablesà leurs yeux. Deux repères intellectuels tracent d’emblée lesbornes du parcours que suit le destin de Cordier : la doctrinede Maurras et la prose de Gide – « passion de l’autorité etivresse de la volupté » (p. 17). Absurde à nos yeux, ce doubleattachement relève d’une logique propre à la littérature. Cor-dier se récite Verlaine lorsqu’il saute pour la première fois enparachute, invoque Corneille lorsqu’il adresse une lettre derupture à Maurras, réprouve les goûts littéraires de Rex quicode ses messages à l’aide des Amours jaunes de Corbière(Moulin était, en réalité, idolâtre de Valéry, auquel il songeapour la fonction de Président de la République après la
240 C R I T I Q U E
guerre), admire Brossolette parce que celui-ci est normaliencomme Thierry Maulnier, et dévore, lorsque son activité derésistant lui en laisse le temps, aussi bien Les Décombres deRebatet que Les Thibault, Paludes, La Nausée, À la recherchedu temps perdu ou Le Blé en herbe.
Espace intellectuel et esthétique pleinement vivant qu’ilpartage avec beaucoup de ses camarades, la littérature repré-sente pour le jeune Cordier un réservoir infini de références :séparé de sa famille et impatient de partir enfin au combat,il s’explique son propre engagement dans la France libre à lalumière du destin de Jacques Thibault, avec lequel il s’iden-tifie : ce personnage de pacifiste a beau être un militantcommuniste, alors que le jeune maurrassien n’a pour seuldésir que de combattre, Cordier ne s’arrête pas à ces contra-dictions – « les idées sont de peu d’importance puisqu’unmême fanatisme nous habite, un même besoin d’absolu »(p. 216). Perdu dans Paris où il lui faut transférer le secréta-riat de Jean Moulin, il s’en dessine une première topographielivresque : « La rue d’Amsterdam de Sapho d’Alexandre Dau-det, le jardin des Champs-Élysées de Proust, [...] les voluptésde Baudelaire, l’amour maudit de Verlaine et Rimbaud... »(p. 732). Son adhésion au gaullisme, elle-même, tient à unequestion de style : dans les discours du chef de la Francelibre, il admire « une grandeur digne du langage de la France »(p. 116), un lexique, un ton, un rythme qui l’exaltent, au pointque la présence diffuse mais évidente des Mémoires de guerredans Alias Caracalla tient à cette imprégnation durant laguerre par le style oratoire du Général plus qu’à un jeu inter-textuel. Dans la lecture, Daniel Cordier trouve ces options devie, ces possibles que l’existence sociale ou la sphère politiquene lui offrent pas ou ne lui présentent que de manière défor-mée, anachronique. Les tensions s’y résolvent : « Rex » necontredit pas son secrétaire lorsque celui-ci lui déclare queRebatet « possède le talent dramatique pour faire revivre leplus grand désastre de notre histoire » (p. 582) ; à l’inversedes hommes politiques, les écrivains coexistent dans cet uni-vers où Gide occupe encore l’une des premières places parcequ’il « assume les risques de sa liberté » (p. 839), libertésexuelle, esthétique ou d’opinion, fixant ainsi un idéal grâceauquel Cordier trouve le moyen de se libérer peu à peu d’unerhétorique politique haineuse qu’il avait faite sienne.
241P A T I E N C E D U M É M O R I A L I S T E
*
Un mois avant sa mort, alors qu’il bavarde avec « Rex »,celui-ci répond à son secrétaire qui juge que la Résistance estl’honneur de la France :
La Résistance ? Je vais vous dire comment elle finira. Après laLibération, le gouvernement lui rendra hommage en organisantune exposition géante au Grand Palais. On y verra des graphiquesrévélant le nombre de militants, les tirages de la presse, les atten-tats et les morts ; des collections de journaux clandestins forme-ront des panneaux impressionnants ; enfin, des documents et derares photos retraceront son histoire. [...] Le jour de l’inaugura-tion, l’exposition sera envahie par une foule mondaine, qui décou-vrira avec frivolité ce passé inconnu, quand ce ne sera pas, pourquelques-uns d’entre eux, honni. Pendant ce temps, des socié-taires de la Comédie-Française réciteront du Péguy, après quoiseront psalmodiés les noms des martyrs. À l’entrée de l’exposi-tion, on verra la statue monumentale de Charvet 8, en plâtre.Représenté debout, la main droite tendue vers les visiteurs et lagauche levée, pointant un doigt en direction de l’Élysée ! (p. 830)
Les commémorations comme hommages à visée prophy-lactique, destinés à se protéger du passé sous couvert d’enprolonger l’expérience dans le temps présent... Étonnantelucidité de Moulin qui dénonce les effets anesthésiants de laculture commémorative à laquelle nous sommes condamnés,aujourd’hui plus encore que dans l’immédiat après-guerre.Telle est l’ultime leçon d’Alias Caracalla : prouver que lesMémoires sont, à leur meilleur, un correctif à la patrimonia-lisation du passé, sous laquelle la mémoire nationale étouffe.Cela parce qu’ils offrent un point de vue incarné, responsableet vivant sur le passé.
Jean-Louis JEANNELLE
8. Ce pseudonyme désignait Henri Frenay.
242 C R I T I Q U E