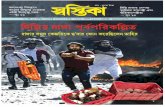Commune de SPAY (72) - Index of
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Commune de SPAY (72) - Index of
DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
au titre de code de l’environnement
au titre du code forestier
au titre de la dérogation sur les espèces protégées
Commune de SPAY (72)
TOME 3 : ETUDE D’IMPACT
Dossier n°E 02 72 5327 – janvier 2018
39 bis rue Fernand Tavano Tel : 02 43 88 66 06 72 000 LE MANS Fax : 02 43 21 82 85
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY
3
SOMMAIRE GENERAL DE L'ETUDE D'IMPACT
Référence II article R122-
5 du CE1 Chapitres Intitulés Pages
2° 1 Description du projet 7
3° 2
Description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet et aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet
37
4° 3 Description des facteurs mentionnés au III de l'article L 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet 51
5° 4 Description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 135
6° 5
Description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet
211
7° 6
Description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine
225
8° 7
Mesures prévues par le maître d’ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités - compenser lorsque cela est possible les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits
243
9° Modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées
- 8 Conditions de remise en état des lieux 291
10° 9 Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement
307
11° 10 Noms, qualités et qualifications des experts ayant préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation 317
12° 11 Eléments figurant dans l’étude de dangers 325
- 12 Eléments d’appréciation de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols (document d’urbanisme) et articulation avec les plans, schémas et programmes opposables aux tiers
333
1 Code de l’environnement
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY
4
Annexes - Fascicules reliés à part Auteurs
Etude d’impact écologique ENCEM
Dérogation au titre des espèces protégées ENCEM
Etudes hydrogéologiques (3) TERRAQUA
NOTA : Le résumé non technique de l’étude d’impact, exigé au 1° du II de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, est fourni dans un fascicule spécifique, correspondant au tome 3 du dossier.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY
5
PRESENTATION
L’étude d’impact est établie dans les formes prévues à l’article R.122-5 du titre II du livre Ier du Code de l'environnement. Conformément au III de l’article R.122-2, elle traite de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions, et notamment des incidences du défrichement nécessaire à sa mise en œuvre. Cette étude a pour objet d'étudier de manière systématique et formalisée les conséquences du projet sur l’environnement, notamment sur la population, la santé humaine, les espaces agricoles et forestiers, la biodiversité, les sols, les eaux, l’air, le climat et le paysage. Elle expose également les conditions d'exploitation et de remise en état du site ainsi que les mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables, réduire ceux n’ayant pas pu être évités, et compenser ceux qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (séquence ERC : Eviter, Réduire, Compenser).
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
9
SOMMAIRE
Page
1 : LE PROJET 11
1.1 : PRESENTATION DU PROJET..................................................................................................................... 11
1.2 : SITUATION GEOGRAPHIQUE ..................................................................................................................... 13
1.3 : OCCUPATION DES LIEUX ......................................................................................................................... 15
1.4 : ACCES .................................................................................................................................................. 17
2 : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ENSEMBLE DU PROJET ET EXIGENCES EN
MATIERES D’UTILISATION DES TERRES LORS DES PHASES DE CONSTRUCTION ET DE
FONCTIONNEMENT 17
2.1 : DESCRIPTION GENERALE DU PROJET ....................................................................................................... 17
2.2 : PRINCIPALES DONNEES CHIFFREES ......................................................................................................... 19
2.3 : PERSONNEL EMPLOYE SUR LE SITE ET HORAIRES DE TRAVAIL ................................................................... 20
2.4 : AMENAGEMENTS PREPARATOIRES .......................................................................................................... 20
4.2.1 : Aménagements préliminaires ..................................................................................................... 20
4.2.2 : défrichement ............................................................................................................................... 21
2.5 : UTILISATION DES TERRES LORS DES PHASES DE CONSTRUCTION ET DE FONCTIONNEMENT ......................... 22
5.2.1 : Decouverture .............................................................................................................................. 22
5.2.2 : stériles d’exploitation .................................................................................................................. 22
5.2.3 : recapitulatif des mouvements de découverte et stériles ............................................................ 23
5.2.4 : Remise en état ............................................................................................................................ 23
3 : CARACTERISTIQUES DE LA PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET 26
3.1 : RESSOURCES NATURELLES UTILISEES..................................................................................................... 26
1.3.1 : Nature ......................................................................................................................................... 26
3.2 : VOLUME ................................................................................................................................................ 26
3.3 : DESCRIPTION DE LA PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET ........................................................................ 28
3.3.1 : Travaux d'extraction .................................................................................................................... 28
3.3.2 : Concassage et criblage .............................................................................................................. 32
3.3.3 : Destination des matériaux élaborés sur la carrière en projet ..................................................... 33
3.4 : DEMANDE ET UTILISATION DE L’ENERGIE ................................................................................................. 34
4.3.1 : Electricité .................................................................................................................................... 34
4.3.2 : Gasoil .......................................................................................................................................... 34
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
10
4 : RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS 35
4.1 : RESIDUS ................................................................................................................................................ 35
1.4.1 : Déchets d’exploitation ................................................................................................................. 35
1.4.2 : Déchets d’entretien du matériel .................................................................................................. 35
1.4.3 : Déchets domestiques ................................................................................................................. 36
4.2 : EMISSIONS ............................................................................................................................................ 36
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
11
Le projet porté par la SAS Carrières TAVANO est détaillé dans le tome 2 du dossier de demande d’autorisation environnementale.
1.1 : PRESENTATION DU PROJET
La SAS Carrières TAVANO, implantée à SPAY, dans le département de la Sarthe (72), en région Pays de la Loire, est spécialisée dans la fourniture et la livraison de matériaux de carrières. L'exploitation de carrière permet d'assurer la livraison de matériaux de carrière et de négoce comme du sable, des cailloux, des granulats, des gravillons, principalement dans le département de la Sarthe (72) et de l’Orne (61) dans une moindre mesure. . La SAS Carrières TAVANO exploite un gisement de sables et graviers sur la commune de SPAY aux lieux-dits « l’Enfournoire » et « la Coyère ». Actuellement l’exploitation de ce site est régie par l’arrêté Préfectoral n°07-721 du 23/02/2007 délivré pour une durée de 13 ans. Un arrêté complémentaire a été pris le 09/04/2013 (arrêté préfectoral n°2013099-0006) pour limiter la production maximale à 207 000 tonnes/an en application du SDAGE Loire-Bretagne. La difficulté d’obtenir une autorisation d’exploitation pour des nouveaux gisements de sables et graviers ainsi que la nécessité d’optimiser l’exploitation des différents gisements autorisés a motivé la SAS Carrières TAVANO à solliciter une demande de renouvellement et d’extension, avec approfondissement de
l’exploitation sur les terrains de la commune de SPAY aux lieux dits l’Enfournoire et la Coyère. Notons qu’une partie des terrains de l’extension sollicitée est boisée. La présence d’argiles intermédiaires au sein des niveaux sableux combinée au mode d’exploitation, à la pelle et à la drague suceuse, sans rabattement de nappe, a jusqu’à présent empêché l’exploitation des niveaux sableux sous-jacents. Cette perte de gisement pouvant être palliée par une mise hors eau des argiles (rabattement de la nappe) et un enlèvement sélectif de ces dernières à la pelle mécanique, la société TAVANO a sollicité une demande de modification des conditions d’exploitation en vue de réaliser un essai de rabattement de nappe pendant 4 mois afin d’extraire les argiles et de mesurer les impacts liés à cette exploitation dans le cadre d’une étude hydrogéologique. Cette modification temporaire à titre d’essai a été accordée, au vu des premières conclusions de l’étude hydrogéologique, par courrier et sans examen de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en formation « carrière » en date du 10 aout 2015. Ce rabattement de nappe temporaire pour extraire les lentilles d’argiles et exploiter les sables sous-jacents est repris dans cette demande.
1 : LE PROJET
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
13
Au droit des terrains du site et des terrains sollicités en extension, des espèces protégées ont été reconnues. Malgré toutes les précautions et mesures mises en place par la société pour les protéger, une destruction de quelques individus ne peut être évitée, une demande de dérogation au titre des espèces protégées est intégrée à cette demande, elle fait l’objet d’un document séparé, annexé au dossier. L’exploitation de la carrière est régie par deux arrêtés :
Arrêté Préfectoral n°07-721 du
23/02/2007 délivré pour une durée de 13 ans soit une échéance d'autorisation en février 2020.
Arrêté préfectoral complémentaire
n°2013099-0006 du 09/04/2013 pris pour limiter la production maximale à 207 000 tonnes/an en application des dernières modalités de limitation des quotas de production en lit majeur de matériaux alluvionnaires du SDAGE Loire-Bretagne.
La production maximale sollicitée sera adaptée à la disposition du SDAGE (disposition 1F) instaurant une réduction des extraction de granulats alluvionnaires de 4% par an. Cette disposition est reprise dans le Schéma départementale de la Sarthe, par la disposition B1. La demande d’autorisation sollicitée, est de 30 années.
1.2 : SITUATION GEOGRAPHIQUE
DÉPARTEMENT : SARTHE COMMUNE : SPAY SECTIONS : AI , AK LIEUX-DITS : "L’Enfournoire et la Coyère" COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES (Lambert II étendu) : X = 438 625 m Y = 2 327 629 m
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
14
Les terrains sollicités dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploitation de carrière (cf. chapitre 6 pour la justification du choix) sont localisés dans le département de la Sarthe, au sud du Mans et en rive gauche de la rivière SARTHE. Le secteur de la carrière, situé entre la rivière et deux axes est / ouest et nord / sud à forte circulation, a été l’objet de nombreuses exploitations.
Récapitulatif des surfaces du projet
Superficie sollicitée en renouvellement 39 ha 49 a 05 ca
Superficie sollicitée en extension 14 ha 80 a 52 ca Superficie de la demande 54 ha 29 a 57 ca Superficie exploitable Environ 36 ha
Sur les 54 ha sollicités, environ 18 ha ne seront pas touchés par l’exploitation, de manière à tenir compte:
- des secteurs déjà exploités - de l’emprise des installations - des contraintes d’exploitation - des délaissés de protection écologique - d'une bande réglementaire non exploitée de 10 m de largeur au minimum en limite de site,
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
15
1.3 : OCCUPATION DES LIEUX
La sablière est implantée intégralement sur la commune de SPAY en rive droite de la Sarthe à l’Est et en rive gauche du ruisseau « le Buard » au Nord-Ouest. Elle est séparée de la ville de Spay à l’Ouest par la route départementale n°323. La base de loisirs « Le Houssais » est située au Sud-Ouest de la carrière. Vers le Sud en direction de la Sarthe, l'emprise est délimitée par un massif boisé constitué essentiellement de résineux. Vers le Nord, se trouve une petite zone d'activité au lieu-dit la Perrée. L'accès à la sablière se fait via la voie communale n° 9 qui dessert également le hameau de "l'Enfournoire" situé à 180 m de l'entrée de la carrière. La sablière actuelle couvre une surface d'environ 40 ha. Elle se compose de 2 secteurs distincts séparés par la VC n°9 : Au Nord se trouve un premier secteur autorisé qui n'est pas encore exploité. La centrale à béton de l'entreprise BETON TAVANO se trouve sur ce secteur. Au Sud de cette voie se trouvent différents pôles d'activités liées à la carrière. Nous pouvons noter :
les installations de traitement et les différents stocks de matériaux, le centre administratif, l'atelier de maintenance, les différents bassins de décantation, les zones d'extraction présentant différents plans d'eau ; le plan d'eau principal se situant dans la
partie médiane de l'emprise. A noter que les installations de traitement et stockage des matériaux finis se situent sur une surface de l’ordre de 3 ha, à l’ouest de la voie communale n°9 qui dessert le site. Les terrains sollicités en extension comportent quant à eux trois secteurs distincts, ils couvrent une surface d’environ 15 ha :
Au nord, entre le ruisseau du Buard qui constitue la limite nord et la zone de décantation et de stockage des stériles actuelle, les terrains d’extension sont occupés par des fourrés, friches et des bois (taillis de chênes, peupleraie).
Au sud du plan d’eau principal, les terrains sont occupés par des friches et des pelouses naturelles. On peut noter la présence d’une parcelle enclavée, non intégrée dans la demande et supportant un poteau électrique.
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
17
A l’ouest, les terrains sollicités comprennent une partie du plan d’eau des Pelouses, qui ne sera pas
ré-exploitée, avec au sud une zone boisée (pinède) pour laquelle une demande de défrichement est intégrée au dossier.
1.4 : ACCES
L’accès au site se fait à partir de la RD 326, axe routier majeur menant au Mans, Arnage et Spay, en prenant la RD 51 vers SPAY et la première à gauche vers Les Aulnays et la VC9 menant à l’Enfournoire. Cet accès emprunté par les camions de livraison permet d’éviter les zones d’habitations et de rejoindre facilement des axes à grande circulation comme la RD 326 et la RD 323 (voir carte de localisation au 1/25000 p.12).
2.1 : DESCRIPTION GENERALE DU PROJET
Après réalisation des aménagements préparatoires, l'exploitation de la sablière sera réalisée à ciel ouvert, selon deux méthodes d’extraction :
Une exploitation en eau, à la pelle hydraulique, sur les 5 premiers mètres : les matériaux extraits sont déposés pour égouttage en bordure du plan d’eau, repris au chargeur et amenés vers les installations de traitement.
Une exploitation en eau, à la drague aspiratrice, qui permet d’exploiter le gisement plus en profondeur. La pulpe extraite (mélange d’eau et de sables) est refoulée dans un bassin situé à proximité des installations. Les matériaux sont ensuite repris à la pelle et traités dans les installations.
Ces méthodes d’exploitation ne peuvent cependant plus être utilisées à partir du moment où des niveaux argileux intermédiaires sont rencontrés. Il est en effet impossible d’extraire sélectivement de l’argile sous l’eau. Cette difficulté a pour conséquence une perte directe de gisement, au niveau des différents plans d’eau peu profonds présents sur le site.
2 : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ENSEMBLE DU PROJET ET EXIGENCES EN MATIERES D’UTILISATION DES TERRES LORS DES PHASES DE CONSTRUCTION ET DE FONCTIONNEMENT
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
18
Pour optimiser l’exploitation du gisement, l’entreprise TAVANO propose une méthode d’exploitation qui permettrait d’atteindre les niveaux argileux intermédiaires en les extrayant sélectivement à sec à la pelle hydraulique de manière à pouvoir par la suite poursuivre l’exploitation des sables Cénomanien sous eau. La méthode proposée repose sur un rabattement partiel de la nappe contenu dans les graves (sur 2 m environ) à partir d’un pompage de forte capacité (300 m3/h) en continu sur 4 mois environ. Cette méthode ne serait pas systématiquement mise en œuvre sur l’ensemble de l’emprise mais uniquement sur les secteurs où la présence d’argiles intermédiaires est clairement identifiée. Les travaux d’exploitation seront coordonnés et comporteront les opérations suivantes :
le défrichement éventuel puis la découverte des terrains, l'extraction des sables selon l’une ou l’autre méthode précédemment décrite, le traitement par lavage- criblage, le réaménagement coordonné du site, Le chargement et le transport des produits finis.
Dès l’obtention de l’autorisation, les travaux préliminaires fixés par l’arrêté préfectoral seront réalisés. Ces aménagements sont déjà pour partie mis en place, ils seront donc complétés. Ces travaux consisteront essentiellement à :
modifier le panneau d’accès indiquant l'identité de l'exploitant, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté,
compléter le bornage du périmètre autorisé, compléter les clôtures au droit des parcelles en exploitation, compléter les panneaux indiquant la présence d'une gravière et les risques encourus en bordure des
terrains du projet. Le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble de ces aménagements préliminaires est estimé à 3 mois. Dans le texte qui suit, l’échéancier des différentes phases de travaux est exprimé à compter de l’obtention de l’autorisation préfectorale.
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
19
2.2 : PRINCIPALES DONNEES CHIFFREES
Caractéristiques du gisement
Emprises (en ha)
totale du projet 39ha 49a environ à exploiter 35 ha environ restant à décaper 7,4 ha environ
Epaisseurs (en m)
Découverte moyenne Terre végétale
0,5 m de stériles 0,3 m de terre végétale
Gisement(1) mini 5 m
maxi 17 m
Cotes (en NGF)
terrain naturel mini 40 m NGF environ maxi 44 m NGF environ
cote minimale d'extraction 24 m NGF
Cote de la nappe en basses eaux
41,2 m NGF aux Aulnays à 37,9 m NGF aux abords de la Sarthe
Volumes totaux (en m3)
découverte 45 000 m3 gisement 2 124 700 m3
densité du matériau commercialisé 1,8 tonnage 3 922 000 t La teneur en stériles du gisement est comprise entre 1 et 5%, soit une moyenne de 2,5%
(1) : d'après les données de la société TAVANO.
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
20
2.3 : PERSONNEL EMPLOYE SUR LE SITE ET HORAIRES DE TRAVAIL
En dehors des chauffeurs routiers venant charger les matériaux, sept personnes travaillent sur le site. L’activité d’extraction et le fonctionnement de l’installation de traitement (lavage, concassage et criblage) ne seront réalisés que du lundi au vendredi (hors jours fériés), dans la tranche horaire 7h30 – 17h30, du lundi au vendredi, jours fériés exclus. Une coupure entre 12 h et 13h30 a lieu pour le chargement clientèle. Les opérations de maintenance pourront avoir lieu éventuellement le samedi, comme prévu dans l’arrêté de décembre 2013 (article 2.2 : les créneaux horaires pour l’ensemble des activités de la carrière sont : période diurne : 7h – 17h30 exceptionnellement jusqu’à 19 h. Hormis les éventuelles opérations de maintenance effectuées le samedi, aucune activité les samedi, dimanche et jours fériés). Il est à noter que la société prévoit de sous-traiter à une entreprise spécialisée la partie de l’extraction des matériaux se faisant par drague aspiratrice.
2.4 : AMENAGEMENTS PREPARATOIRES
2.4.1: AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES
Les aménagements préliminaires, au sens des articles 4 et 5 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, réalisés avant le début de l’exploitation seront les suivants :
modifier le panneau d’accès indiquant l'identité de l'exploitant, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté,
compléter le bornage du périmètre autorisé, compléter les clôtures au droit des parcelles en exploitation, compléter des panneaux indiquant la présence d'une gravière et les risques encourus en bordure
des terrains du projet, Un diagnostic archéologique pourra également être réalisé si la Préfecture de Région estime que cela est nécessaire. A la suite à la réalisation de ces travaux et aménagements, la société des Carrières TAVANO transmettra au Préfet la déclaration de début d'exploitation, à laquelle sera également joint l'acte de cautionnement relatif aux garanties financières.
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
21
2.4.2: DEFRICHEMENT
Un défrichement a été autorisé par arrêté préfectoral en date du 20 avril 2017, pour la parcelle AK 13. Dans le cadre du présent dossier, une nouvelle autorisation de défrichement est nécessaire, concernant pour partie la parcelle AK 11 de la zone d’extension. Cette parcelle est située au sud du secteur ouest sollicité en extension. La superficie de cette parcelle AK 11 est de 4 ha 69 a 47 ca. Cette parcelle appartient dans son intégralité à Mm TAVANO. La partie à défricher présente une superficie de 2 ha 88 a 50 ca. La surface boisée fera l’objet d’une coupe rase, à l’aide de tronçonneuses. Le dessouchage sera fait au moyen d’un engin approprié (type bouteur sur chenilles). Un broyeur forestier sera employé pour déchiqueter les résidus de coupe non valorisables en bois d’œuvre ou de chauffage. Une partie des rémanents coupés seront soit utilisés pour valoriser le sol soit évacués par l’entreprise. Echéancier de défrichement
Le défrichement sera réalisé de façon coordonnée à l’exploitation de la carrière et corrélé avec le plan de phasage. Selon ce dernier, l’exploitation de la parcelle AK11 est prévue en début de phase 4, soit à T+16 ans. Le défrichement se fera donc de façon préalable, au cours de la phase 3, selon l’avancée des travaux d’exploitation et fonction de la période optimum pour le défrichement, entre la fin de l’été et le milieu de l’automne soit entre août et novembre inclus, pour tenir compte des périodes de reproduction et d’hibernation de la faune (cf. étude écologique). Compte tenu de la surface à défricher, les travaux seront réalisés en une seule passe. La durée globale des travaux de défrichement sera de 1 mois environ.
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
22
2.5 : UTILISATION DES TERRES LORS DES PHASES DE CONSTRUCTION ET DE
FONCTIONNEMENT
2.5.1: DECOUVERTURE
Cette opération vise à mettre à nu le gisement en retirant les matériaux de recouvrement, composés ici de terre végétale en surface, sur une épaisseur de 0,3 m environ, et de matériaux sablo-argileux, sur une épaisseur de 0,5 m en moyenne. La découverte sera effectuée au fur et à mesure de l'avancée de l'exploitation, par campagne annuelle, par passes successives de façon à séparer les différents types de matériaux. Seule une superficie de 7,4 hectares reste à décaper, sur une surface sollicitée en exploitation de 35 ha environ. Le volume de découverte, terre végétale comprise est estimé à 60 000 m3. Ces matériaux seront mis en place dans le cadre de la remise en état du site aux endroits définis par le projet. Toutes les indications sont reprises dans le tableau ci-après. Cette opération de découverte sera réalisée au moyen d’une pelle mécanique. Le transport vers les zones de stockage ou à remettre en état sera fait par dumpers. La mise en forme des matériaux sera réalisée au moyen de bull ou de pelle hydraulique. En fonction de l’avancement du projet, la terre végétale sera soit remise en place sur les zones de remblais, de façon coordonnée au décapage, en respectant l’ordonnancement des deux horizons, soit stockée provisoirement.
2.5.2: STERILES D’EXPLOITATION
Les stériles d’exploitation sont de trois types :
Des argiles extraites lors du rabattement de nappe pour pouvoir extraire les sables sous-jacents, le volume est estimé à 25 000 m3,
Les produits de décantation en place qu’il faudra déstocker pour extraire. Le volume est estimé à 20 000 m3,
Des argiles décantées, issues du lavage des matériaux (2,5% du gisement), soit environ 55 000 m3. Ces matériaux serviront à la remise en état du site, avec l’aménagement de hauts-fonds à vocation écologique et le remblayage partiel de la partie nord, le long du ruisseau du Buard.
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
23
2.5.3: RECAPITULATIF DES MOUVEMENTS DE DECOUVERTE ET STERILES
Le tableau ci-après indique les volumes décapés par phase.
Mouvements de la découverte et des stériles d’exploitation
Phase
Volume de
découverte et
terre végétale en
m3
Volumes des
stériles (%
d’argiles du
gisement)
Volume des
argiles extraites
et des matériaux
de décantation
Volume
total Destination)
1
1a 1b 1c
16 000
7 000
6 500 500
3 000
22 500 500
10 000
R1
R1
R2
2
2a 2b 2c
16 500
5 000 1 000 4 500
15 000
5 000 1 000 36 000
R2
R3
R1
3 3a 3b
2 000 8 500
2 000 8 500
R3
R2
4
4a 4b 4c
20 500 8 000 500
2 000
8 000 500
2 000
R4
R3
R3
5
5a
5b
4 500
6 000
20 000
10 000
24 500
16 000
6 500 sur R3
18 000 sur
R1
R1
6 6 3 000 3 000 R1
Total 60 000 55 000 45 000 160 000
2.5.4: REMISE EN ETAT
Comme indiqué précédemment, la remise en état du site dépend de la configuration actuelle avec les différents plans d’eau exploités et des aménagements écologiques envisagés. Rappelons que l’essentiel de l’exploitation concernera l’approfondissement des plans d’eau existants. Au terme de l’autorisation sollicitée, le site présentera 4 grands plans d’eau, séparés par des pistes, d’un secteur nord, remblayé pour partie et d’une plateforme au niveau des installations de traitement et des zones de stockage des matériaux.
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
25
La surface en eau, hauts fonds compris, représentera environ 36 ha :
Plan d’eau nord est, de l’autre côté de la voie communale : 7,5 ha environ Plan d’eau nord : 10,6 ha environ Plan d’eau sud : 11 ha environ Plan d’eau ouest : 6,7 ha environ
A la fin de l’exploitation, l’ensemble des équipements nécessaires à la sablière (équipements de la base-vie, atelier, installations, transformateurs…) sera démonté et évacué. La surface de la plateforme sera décompactée et régalée de terre végétale issue de l’arasement des merlons périphériques.
◄ Plan d’état final de la sablière
Les modalités de remise en état et des aménagements écologiques font l’objet d’un développement spécifique dans l’étude d’impact (chapitre 8).
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
26
3.1 : RESSOURCES NATURELLES UTILISEES
3.1.1: NATURE
Le gisement exploité sur la sablière se compose de deux formations distinctes :
En tête, les sables de la basse terrasse alluviale de la vallée de la Sarthe, attribués à l’étage géologique Würmien. Leur puissance varie de 6 à 8 m.
A la base, les sables du cénomanien inférieur et moyen reposant sur des argiles et dont l’épaisseur peut atteindre 40 m.
Entre les deux formations, des couches argileuses d’environ 2 m d’épaisseur peuvent être intercalées. Leur répartition et leur épaisseur sont assez aléatoires sur le site. Des sondages de reconnaissance ont permis d’estimer leur présence et leur volume.
3.2 : VOLUME
La surface exploitable sur le site est de l’ordre de 36 ha. Le plus sous souvent, l’exploitation se fera par approfondissement d’un secteur déjà extrait. En effet, au droit des plans d’eau existants, la partie de la base terrasse alluviale a déjà été exploitée. Le changement de méthode d’exploitation, drague aspiratrice notamment, après avoir extrait si nécessaire, les argiles intercalées, permet d’extraire les sables cénomanien sur une épaisseur dépendant du bras de la drague, soit environ 15 m. Les estimations de gisement, réalisées par la société, à partir de reconnaissances de terrain, ont permis d’évaluer les réserves de tout venant brut à environ 3 922 000 tonnes. Le SDAGE Loire Bretagne dans son orientation B1 a entériné une réduction des extractions de matériaux alluvionnaires en lit majeur. Cette décroissance fixée à 4% par an par rapport aux productions autorisées en cours sur la région est reprise dans le schéma départemental des carrières de la Sarthe. Afin de respecter cette orientation, une projection de la production annuelle a été réalisée. Les calculs inhérents à cette projection sont détaillés dans la partie demande. Nous ne reprendrons ici que le tableau récapitulatif des productions annuelles sollicitées.
3 : CARACTERISTIQUES DE LA PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
27
Récapitulatif des productions sollicitées
Période Production annuelle
en tonnes maximale moyenne
2018 à 2029 207 000 150 000 2030 202 000 150 000 2031 173 000 150 000 2032 145 000 130 000 2033 119 000 110 000
2034 à 2048 207 000 150 000
Période Production quinquennale
en tonnes
maximale moyenne T0 à T+ 5 ans : 2018-2022 1035 000 750 000
T+6 à T+ 10 ans : 2023-2027 1035 000 750 000 T+11 à T+ 15 ans : 2028-2032 934 000 730 000 T+16 à T+ 20 ans : 2033-2037 947 000 710 000
T+21 à T+ 25 ans : 2038-2042 1035 000 750 000
T+26 à T+ 30 ans : 2043-2047 1035 000 232 000 TONNAGE TOTAL 3 922 000
Compte tenu du gisement disponible, la durée d’extraction est de l’ordre de 27 ans avec une durée d’autorisation sollicitée de 30 ans compte tenu de la finalisation de la remise en état.
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
28
3.3 : DESCRIPTION DE LA PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET
3.3.1: TRAVAUX D'EXTRACTION
METHODE D’EXPLOITATION
L'exploitation de la gravière sera réalisée à ciel ouvert, en fouille partiellement noyée. Deux méthodes d’exploitation sont actuellement en cours sur le site :
Une exploitation sur les 5 premiers mètres environ à la pelle hydraulique ; Une exploitation à la drague aspiratrice pour les niveaux plus profonds du cénomanien, à titre
d’essai. Ces méthodes d’exploitation ne peuvent cependant plus être utilisées à partir du moment où des niveaux argileux intermédiaires sont rencontrés. Il est en effet impossible d’extraire sélectivement de l’argile sous l’eau. Cette difficulté a pour conséquence une perte directe de gisement, au niveau des différents plans d’eau peu profonds présents sur le site. Pour optimiser l’exploitation du gisement, l’entreprise TAVANO propose une méthode d’exploitation qui permettrait d’atteindre les niveaux argileux intermédiaires en les extrayant sélectivement à sec à la pelle hydraulique de manière à pouvoir par la suite poursuivre l’exploitation des sables Cénomanien sous eau. La méthode proposée repose sur un rabattement partiel de la nappe contenue dans les graves (sur 2 m environ) à partir d’un pompage de forte capacité (300 m3/h) en continu sur 4 mois environ, le temps nécessaire à l’extraction des argiles. A l’arrêt du pompage le niveau d’eau se rééquilibrera, les sables cénomaniens pourront alors être extraits à la drague aspiratrice. Cette méthode ne serait pas systématiquement mise en œuvre sur l’ensemble de l’emprise mais uniquement sur les secteurs où la présence d’argiles intermédiaires serait clairement identifiée. L’extraction du gisement repose sur plusieurs opérations :
dans un premier temps, les terrains exploitables ont été découverts par retrait de la terre végétale qui a été provisoirement stockée pour être reprise dans le cadre des opérations de remise en état notamment pour la végétalisation des berges en position ultime. Un stock est actuellement disponible sur le site. A noter qu'à l'heure actuelle toutes les opérations de découverte ont été effectuées sur le secteur autorisé. Les secteurs non découverts concernent les terrains sollicités en extension.
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
29
dans un second temps, le gisement de sables et graviers est exploité directement par une pelle
hydraulique pour les niveaux supérieurs sur environ 4 à 5 m selon l'épaisseur en place des sédiments. Ce niveau correspond aux graves de la formation alluviale de basse terrasse de la vallée de la Sarthe. Les matériaux sont stockés au sol pour égouttage avant d’être repris pour alimenter l’installation de traitement.
En fonction de l'absence des niveaux argileux évoqués précédemment à leur base, l'exploitation des niveaux inférieurs (sables du Cénomanien) se poursuit par une drague aspiratrice. Cette dernière peut aller jusqu’à environ 15 m de profondeur par rapport au niveau d’eau. Jusqu'à ce jour, toutes les opérations d’extraction par drague aspiratrice ont été réalisées à titre d’essai sur le même plan d'eau (plan d'eau A). La profondeur atteinte est de l'ordre de 7 à 8 m sous le niveau d'eau. L'extension sur les autres plans d'eau de la sablière est néanmoins totalement envisageable à partir du moment où les argiles ont été retirées. La pulpe aspirée est refoulée dans un bassin de réception situé à côté des installations. Les eaux dites de « transfert » regagnent le plan d’eau de la zone d’extraction (réserve d’eaux claires) par un réseau interne de fossés dans lequel elles décantent. Les matériaux égouttés, sont directement repris dans le bassin de réception par une pelle qui alimente l’installation de traitement. En présence de niveaux argileux entre la base des graves et les sables du Cénomanien, l'entreprise TAVANO retirera les argiles dénoyées à la pelle. Ces argiles seront alors déposées le long des berges (plan d'eau A) pour le talutage des berges. Après cette opération, les sables seront exploités par la drague aspiratrice selon le protocole décrit précédemment.
N
Périmètre du projet
Zone remblayée
Numéro de phase
Sens de progression
Limite communale
Echelle : 1/5 000Source : cadastre.gouv
0 100 200 m
AK 11
AK 13
AI 47
AI 48
AI 49
AI 89 AI 90
AK 91
AK 48
AI 15
AI 16
AI 46
AK 10
AK 12
AK 11
AK 13
AI 47
AI 48
AI 49
AI 89 AI 90
AK 91
AK 48
AI 15
AI 16
AI 46
AK 10
AK 12
Commune deARNAGE
RD 14
7
VC n°9
RD 32
3
3a1a
2c
5a
4c
5b
3b
2a
2a
R2
R4
R3
R3
R1
1c
4a
6
4b
2b1b
148800 0
CENTRALEÀ BÉTON
ZONE DESTOCKAGE
HangarBureauBasculePOMPAGE
IT
Commune deSPAY
PLAN DE PHASAGE
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
31
PHASAGE
Le phasage est déterminé pour permettre une exploitation rationnelle du gisement, prenant en compte la qualité du gisement ainsi que la répartition des différentes méthodes d’exploitation. L’exploitation sera réalisée en 6 phases quinquennale, la dernière phase ne comportant que 1,5 à 2 ans d’extraction et 3 à 3,5 ans pour la finalisation de la remise en état. Les données relatives à chacune des phases d’exploitation sont regroupées dans le tableau suivant : Pour rappel, l’épaisseur de découverte est estimée à 0,5 m, et l’épaisseur de terre végétale est de 0,3 m. Le pourcentage estimé de stériles dans le gisement est de l’ordre de 2,5%.
Données d’exploitation
Phase
Volume de
terre végétale
en m3
Volume de
découverte en
m3
Tonnage
exploité
(tonnes)
Tonnage des
stériles
(tonnes)
Durée
(années)
1
1a
1b
1c
total
6000
3000
10000
4 000
448000
44100
194900
687 000
11200
1102
4872
5
2
2a
2b
2c
total
6000
10 500
367100
63000
319900
750 000
9177
1575
7997
5
3
3a
3b
total
126500
603500
730 000
3162
15087 5
4
4a
4b
4c
total
8000 12 500
548500
31500
130000
710 000
13712
787
3250
5
5
5a
5b
total
319000
431000
750 000
7975
10775 5
6 6 232000 5800 1,6 +3,4
Total 23000 37 000 m3 3 922 000 t 96 471 t 30 ans
Plan de phasage
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
32
3.3.2: CONCASSAGE ET CRIBLAGE
Les matériaux extraits sont traités dans une installation fixe de concassage-criblage-lavage (installation Bonnet). Cette installation permet de traiter par lavage–criblage le tout-venant (0/100) en fabriquant essentiellement un sable 0/4 (120 t/h). La teneur en argiles des niveaux exploitables de ce gisement est très faible avec uniquement 2%. Les refus 4/100 (10 % des matériaux traités) sont alors recyclés dans l’ancienne installation de concassage-criblage-lavage (installation Chauvin). Précisons que cette installation va être entièrement remplacée dans un délai de 3 ans. Le présent dossier intègre cette demande. A ce niveau plusieurs granulométries complémentaires (graviers) sont produites, à savoir :
0/4 dit « sable drainant » 4/10 (30 %) 10/20 (30 %) 20/100 (20 %). Ces matériaux sont soit dirigés vers un broyeur pour être recyclés dans la chaîne de
traitement soit commercialisés en l’état. Les différents produits sont stockés au sol avant d'être commercialisés. Le fonctionnement des installations actuelles est visé dans l'arrêté d'autorisation sous la rubrique 2515-1 pour une puissance installée de 220 kW (régime de l'autorisation). L’ensemble de traitement avec le remplacement de l’installation ‘Chauvin’ présentera une puissance installée comprise entre 200 et 550 KVA, le plaçant sous le régime de l’enregistrement. A droite, l’installation ‘BONNET’ existante, à gauche, l’installation ‘Chauvin’ qui va être remplacée.
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
33
Gestion des eaux de procédé
L'eau qui est et sera utilisée pour le lavage des matériaux provient d'un pompage (300 m3/h) dans le bassin d'eau claire (ancien bassin d’extraction). Ce pompage est équipé d’un volucompteur. Les eaux de lavage issues des installations sont rejetées dans un réseau de drains servant de zone de décantation. En fin de circuit, les eaux décantées rejoignent le plan d’eau claire à l’opposé de la zone de pompage Dans ces conditions, il n’y a aucun rejet d’eaux de procédés vers le milieu extérieur.
Le lavage des matériaux se fait et se fera avec un circuit des eaux strictement fermé.
Les boues issues des drains de décantation sont mises à sécher en bordure des drains avant d’être reprises et réutilisées pour la remise en état du site.
3.3.3: DESTINATION DES MATERIAUX ELABORES SUR LA CARRIERE EN PROJET
Les produits finis, issus du traitement, sont stockés au sol, à proximité de l’installation et seront évacués par camions. Ces derniers transiteront obligatoirement par le pont bascule, situé à côté du bureau. Ces matériaux sont destinés à :
alimenter la centrale à béton situé de l’autre côté de la VC 9, être mis en œuvre dans un rayon de 40 à 50 km environ.
Les camions rejoignent les axes à grande circulation à partir de la VC 9, sans traverser de hameau.
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
34
3.4 : DEMANDE ET UTILISATION DE L’ENERGIE
Classiquement, l’exploitation d’une carrière requiert des consommations énergétiques liées à l’emploi de l’électricité et de carburant. L’électricité est utilisée pour les installations de concassage-criblage et les convoyeurs, l’éclairage et l’alimentation des locaux sociaux. Les carburants (qui sont des dérivés du pétrole) sont utilisés pour faire fonctionner les engins de chantier (Gasoil non routier : GNR).
3.4.1: ELECTRICITE
L’alimentation électrique des locaux, des installations de concassage-criblage et des convoyeurs se fait à partir du transformateur à huile. Ce dernier possède une puissance de 250 KW. Cette puissance est insuffisante pour un fonctionnement concomitant des installations, ces dernières fonctionneront donc comme actuellement, en alternance. La quantité d’électricité annuelle utilisée est de l’ordre de 100 à 150 000 kWh (12 436 kWh pour l’année 2014).
3.4.2: GASOIL
Les engins de chantier fonctionneront au Gasoil Non Routier (GNR). Le ravitaillement sera réalisé sur une aire étanche à partir de 2 cuves aériennes double peau de 1 500 litres chacune positionnées dans l’atelier. Le poste de distribution sera muni d’un pistolet à coupure automatique de l’alimentation en cas de trop plein. Le volume annuel utilisé est de l’ordre de 50 m3 environ.
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
35
Conformément à la réglementation en vigueur, l’estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du projet est présentée dans ce premier chapitre, dédié à la présentation du projet, dans un paragraphe de synthèse ci-après. Ces aspects sont traités en détail dans le chapitre 4 de l’étude d’impact, dans des paragraphes spécifiques.
4.1 : RESIDUS
4.1.1: DECHETS D’EXPLOITATION
Sont considérés comme déchets d’exploitation :
les matériaux de découverte. Le volume est estimé à 60 000 m3, terre végétale comprise le pourcentage d’argiles du gisement compris entre 1 et 5%. Ces argiles sont éliminées lors du
lavage des matériaux. Elles constituent les fines de décantation. Le volume est estimé à 55 000 m3 Les argiles intercalaires discontinues au sein du gisement, entre les alluvions de la basse terrasse et
les sables cénomaniens. Le volume est estimé à 45 000 m3. Le plan de gestion des déchets d’extraction est présenté dans le tome 2 du dossier du dossier de demande d’autorisation environnementale.
4.1.2: DECHETS D’ENTRETIEN DU MATERIEL
Les types de déchets générés par l’exploitation resteront identiques à ceux produits actuellement sur le site. Ils résultent de l’entretien des engins et des installations et sont constitués par :
des Déchets Non Dangereux (DND) : la ferraille résultant de l’entretien des installations industrielles et des engins, le papier et le carton, le bois (palettes de réception de pièces, défrichement). Hors bois de défrichement, ces déchets sont stockés dans deux bennes, de 5 m3 pour la ferraille et de 5 à 7 m3 pour les autres déchets, évacuées à peu près 2 fois par an par des entreprises spécialisées (Ent Pasenaud et SITA Ouest)
des Déchets Dangereux (DD) : huiles usagées (1000 litres), filtres à huile (1 fut de 200 l), aérosols (1 fut de 200 l), déchets souillés (1 bas de 600 litres). Ces déchets sont évacués par une entreprise agréée (Chimirec) 1 à 2 fois par an.
4 : RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS
Carrières TAVANO Etude d’impact SPAY Chapitre 1
36
Précisons que les entreprises extérieures intervenant pour un chantier spécifique auront en charge la gestion et l’élimination des déchets liés à leur intervention. L’organisation en la matière est définie lors de la rédaction des plans de prévention. Rappelons aussi que les pneus sont repris un pour un par le fournisseur.
4.1.3: DECHETS DOMESTIQUES
Le personnel de la société TAVANO dispose sur le site de locaux, avec vestiaires, sanitaires et réfectoire. Les déchets générés seront :
des eaux usées domestiques, qui sont traitées suivant les modalités règlementaires prévues pour l’assainissement non collectif,
des déchets ménagers en faible quantité (100 kg/mois). Le site n’étant pas relié au réseau d’eaux usées public, une fosse septique vidangée régulièrement est en place au niveau des bungalows. Les déchets ménagers sont pris en charge directement par le service intercommunal de collecte.
4.2 : EMISSIONS
Les émissions susceptibles de résulter du projet concernent :
les émissions sonores liées à l’emploi de matériels, en phase préparatoire (ou phase de chantier) et en phase d’exploitation de la carrière. Elles dépendent du nombre, de la nature et de la position du matériel mis en œuvre. Cet aspect fait l’objet d’un développement, au chapitre 4 de la présente étude d’impact (paragraphe 2.1) ;
les poussières et les gaz, résultant des opérations préparatoires (phase chantier) et d’exploitation (déplacement des engins, fonctionnement des installations de traitement). De même que pour les émissions sonores et les vibrations, ces aspects ont fait l’objet d’un développement spécifique intégré à l’évaluation des risques sanitaires des émissions atmosphériques (chapitre 4 paragraphe 2.7) ;
les émissions lumineuses, résultant de l’éclairage des postes de travail, le matin, voire le soir. L’analyse des effets est traitée au chapitre 4 (paragraphe 2.4).
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 2
37
CHAPITRE 2 :
DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE
L'ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
LEUR EVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU
PROJET ET APERÇU DE L'EVOLUTION PROBABLE
DE L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE
EN ŒUVRE DU PROJET
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 2
39
SOMMAIRE
Page
1 : DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT :
SCENARIO DE REFERENCE .................................................................................................................... 41
2 : EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT EN
CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ................................................................................................... 42
3 : EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT EN
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET...................................................................................... 47
4 : SYNTHESE DES SCENARIIS ........................................................................................................... 49
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 2
41
Les aspects pertinents de l’état actuel sont déterminés en fonction des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 du Code de l’Environnement et hiérarchisés en fonction des enjeux présentés dans le chapitre 3 de l’étude d’impact. Les thématiques retenues sont celles qui présentent un enjeu particulier, évalué de moyen à fort. Il s’agit :
De la population qui occupe les habitations ou les locaux d’entreprises dont les plus proches sont situés :
- à L’Enfournoire, situé à 20 m de la limite d’emprise du projet, coté nord-est de la voie communale n°9.
- à La Perrée, petite zone industrielle présentant quelques habitations, à une centaine de mètres de la limite nord du projet.
- Aux Pelouses, habitations appartenant à Mme TAVANO, situées en presqu’ile au niveau du plan d’eau des Pelouses, à environ une centaine de mètres de la limite d’emprise ouest du projet.
De l’agriculture, du fait de la présence d’une petite exploitation de safran (0,46 ha) au lieu-dit La Perrée. Notons que le projet ne prévoit pas de destruction d’espace agricole.
De l’activité carrière (en relation avec la géologie du secteur) aux niveaux local et régional : la carrière constitue un acteur important de l’activité économique locale avec les emplois directs et indirects (7 emplois indirects générés pour un emploi direct). Par ailleurs, cette activité permet aux entreprises et municipalités de s’approvisionner localement en matériaux de qualité, réduisant les couts de transport notamment. Régionalement, la carrière participe à l’approvisionnement en sables alluvionnaires, matériau présentant une restriction d’exploitation et dont la pénurie sur la région mancelle est annoncée.
Des espaces de loisirs, en raison de l’impact hydraulique potentiel de l’exploitation sur le niveau d’eau des différents plans d’eau de la base de loisirs du Houssay.
De la biodiversité, du fait de la présence de zones humides dans la partie sud de l’extension, de la présence d’habitats et d’espèces variés liés entre-autre à la présence de la carrière et du fait des nombreux aménagements prévus.
Des eaux, et plus particulièrement des eaux souterraines, en raison des variations piézométriques liées aux différents modes d’exploitation, des relations « nappe/rivière » et des usages de l’eau de la nappe (cénomanien et alluviale) (enjeux quantitatif et qualitatif),
Des voies de communication, du fait de la présence d’une voie communale (VC n°9) qui dessert la carrière mais aussi le lieu-dit l’Enfournoire.
Du réseau de distribution d’électricité (poteaux et lignes) présent dans la zone d’exploitation de la carrière en projet : maintien des poteaux en place et maintien de l’accès aux poteaux.
1 : DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT : SCENARIO DE REFERENCE
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 2
42
2.1 : LE PROJET
Le projet consiste en la poursuite de l’exploitation de la sablière existante, avec approfondissement et agrandissement des plans d’eau déjà créés, dans l’emprise actuelle et extension sur 3 secteurs limitrophes. Le secteur sud-ouest nécessitera un défrichement d’une partie de la pinède, sur 2,5 ha environ, soit 7,8% de la superficie de la pinède. Afin d’optimiser le gisement et limiter l’extension en surface, deux modes d’exploitation seront employés : Comme actuellement, une extraction à la pelle hydraulique hors eau ou en eau sur 5 mètres environ. Par drague aspirante flottante, ensuite, pour exploiter plus profondément. La capacité d’exploitation de la drague étant de 14 m par rapport au niveau d’eau. Le gisement est constitué par les alluvions de la Sarthe, avec en dessous les sables cénomaniens. De façon très discontinue, des passées d’argiles sont présentes entre les alluvions et les sables cénomaniens. Pour atteindre les sables, il est donc nécessaire d’extraire spécifiquement ces argiles, ce qui ne peut se faire qu’hors d’eau, suite à un rabattement temporaire de nappe sur deux à trois mètres. Les infrastructures existantes ne seront guère modifiées, une installation ancienne sera remplacée dans les 3 ans par un ensemble de criblage plus performant et plus récent.
2.2 : EVOLUTION DE L’ETAT ACTUEL AVEC MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Cette évolution peut être appréhender à partir de trois grands aspects :
Les paramètres physiques du site Les paramètres humains Les enjeux économiques et biens matériels
2.2.1 : LES PARAMETRES PHYSIQUES
Vis-à-vis des paramètres physiques, les aspects pertinents concernent essentiellement la thématique des eaux, la biodiversité et dans une moindre mesure les surfaces exploitées.
2 : EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 2
43
Les surfaces exploitées :
La carrière actuelle présente une superficie en activité d’environ 39,5 ha, avec environ 13,6 ha en eau répartit en 4 plans d’eau :
Plan d’eau l’Enfournoire : 2,1 ha ; La coyère : 7,3 ha ; Plan d’eau sud-ouest : 2,2 ha ; Plan d’eau nord-ouest séparé du plan d’eau des pelouses par un haut fond aménagé : 2 ha.
La zone d’extension sollicitée représente une superficie d’environ 15 ha dont 5 ha au niveau du plan d’eau des Pelouses ne seront pas exploités. La mise en œuvre du projet engendrera une augmentation progressive des surfaces en eau, l’approfondissement des plans d’eau et le défrichement de la petite zone boisée sud-ouest. A noter que la zone boisée entre le plan d’eau de la Coyère et le plan d’eau sud-ouest est déjà défrichée. La partie à défricher représente 7,8% de la zone de pinède. Conjointement, les surfaces décapées, favorisant l’aspect industriel du secteur, diminueront au profit de la surface en eau.
L’enfournoire
La Coyère
Sud ouest
Nord est
défrichement
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 2
44
Commune de Spay (72) - Projet SAS CARRIÈRES TAVANO Carte 4 : ZONAGE DE LA SENSIBILITÉ PATRIMONIALE
Les autres terrains de l’emprise objet de la demande sont estimés de niveau « moyen à faible ».
Périmètre des terrains objet de la demande Périmètre des terrains à exploiter ou à remanier
Fond de carte : photographie aérienne IGN 2013 du site Géoportail.
Niveau « fort »
Niveau « moyen à fort »
Niveau « moyen »
Plan d’eau 3
Plan d’eau 4
Bassin 7
Plan d’eau 6
Plan d’eau 2
Mares 12
Bassin 9
Bassin 8
Mares 13
Bassin 11
Bassin 10 Plan d’eau 1
Mare 14
Fourrés 1
Haie 6
Haie 1
Haie 2
Haie 3
Haie 4
Bois 1
Bois 2
Bois 3
Fourrés 2
Haie 5
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 2
45
La biodiversité
Actuellement le degré de biodiversité est important sur le site. Comme on peut le voir sur la carte de zonage de la sensibilité patrimoniale, cette sensibilité liée à la présence d’espèces floristiques et faunistiques patrimoniales est surtout présente sur les secteurs en exploitation ou ayant fait l’objet d’une exploitation passée. Au cours de l’exploitation, des aménagements seront créés pour développer et compenser des secteurs qui seront remaniés par l’exploitation. Ces aménagements seront développés dans le chapitre 7 du présent dossier. Les eaux
On considère comme eaux superficielles la Sarthe et le ruisseau du Buard. Les plans d’eau correspondant à une mise à nu de la nappe, ils sont traités dans les eaux souterraines. Vis-à-vis des eaux superficielles, le projet ne génèrera aucun changement, la méthode d’exploitation ne modifiera pas les échanges nappe/rivière existant (cf notice hydrogéologique). Les zones de stockage des boues de décantation et des stériles de gisement pouvant générer des colmatages de berges ne se situent pas dans l’axe des échanges nappe/rivière. Vis-à-vis des eaux souterraines, l’étude hydrogéologique réalisée montre :
que l’utilisation de la drague aspirante ne modifie pas la piézométrie locale, que le rabattement de nappe (nécessaire pour enlever les argiles) a une influence sur la
piézométrie essentiellement à l’aval et que le point de rejet des eaux permet de compenser les baisses locales. Un suivi piézométrique rapproché sera mis en place au cours des périodes de pompage, avec mise en place de cote d’alerte pour ne pas perturber les usages autres comme les activités de loisirs sur la base du Houssay ou le forage servant à l’arrosage de l’exploitation de safran au lieu-dit La Perrée.
2.2.2 : LES PARAMETRES HUMAINS
Vis-à-vis de la population, la mise en œuvre du projet va :
rapprocher l’exploitation du lieu-dit La Perrée au nord. L’habitation notamment sera à une centaine de mètres
rapprocher la limite d’exploitation ouest à environ 180 m des habitations des Pelouses. Pour le lieu-dit l’Enfournoire, le projet prévoit l’agrandissement du plan d’eau, mais ce secteur est déjà autorisé à l’extraction. Le rapprochement de l’exploitation engendrera potentiellement une augmentation du niveau sonore induit par les engins d’extraction (pelle hydraulique ou drague). Des aménagements seront mise en place pour
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 2
46
limiter la gène au droit des habitations. Cette évolution du niveau sonore sera cependant faible dans la mesure où :
il sera temporaire, les autres sources sonores n’évolueront pas, pas de changement de piste, de zone de stockage
des matériaux ou d’emplacement des installations. Vis-à-vis des émissions de poussières, l’exploitation en eau, quel que soit son emplacement, n’est pas génératrice de poussières. D’un point de vue visuel, seules les habitations des Pelouses auront un point de vue sur l’exploitation comme actuellement. La perception visuelle évoluera avec l’exploitation.
2.2.3 : LES ENJEUX ECONOMIQUES ET BIENS MATERIELS
Les biens matériels :
Pour les biens matériels, on prend en compte le bâti, les voies publiques et les réseaux, ici les lignes électriques. Vis-à-vis de la voie publique, il n’y aura aucune modification, la voie communale n°9 reste la voie d’accès avec un trafic induit identique, le projet ne prévoyant pas d’augmentation de production par rapport à la situation actuelle. Au contraire, pour répondre à la contrainte de diminution d’extraction de sables alluvionnaires au niveau régional prévue par le schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux et par le schéma des carrières, certaines années auront une production plus faible (cf partie demande). La mise en œuvre du projet n’aura pas d’impact sur le bâti. La piézométrie sur le site sera suivie très régulièrement notamment en période de rabattement de nappe avec des niveaux d’alerte mis en place. Ces niveaux d’alerte seront inférieurs au battement interannuel de la nappe (cf notice hydrogéologique). Vis-à-vis du réseau électrique, la contrainte sera de maintenir d’une part la stabilité et d’autre part l’accès aux poteaux comme c’est le cas avec l’exploitation actuelle. Un rayon de 20 m sera conservé autour du poteau placé sur la parcelle non intégrée au projet. Rappelons de plus que l’exploitation restera à 10 m de l’emprise parcellaire et que la portion de piste permettant d’accéder à la parcelle sera conservée. Les enjeux économiques :
Deux types d’enjeux sont à considérer :
L’enjeu lié à une baisse du niveau d’eau du fait du rabattement de nappe, pouvant interférer avec l’activité de la base de loisirs du Houssay et avec le forage de l’exploitation de safran.
L’enjeu lié à la ressource elle-même, qui alimente les entreprises locales de travaux publics ou les municipalités locales.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 2
47
Comme vu précédemment, la variation piézométrique liée au rabattement de nappe sera très surveillée. Vis-à-vis de la ressource, la mise en œuvre du projet a un enjeu économique fort, dans la mesure où cette carrière de proximité alimente les entreprises locales en matériaux de qualité, notamment pour les bétons. Si on prend en compte l’orientation B1 du SDAGE qui prévoit une décroissance de 4% par des extractions en lit majeur, le maintien de l’activité de la carrière Tavano permet de limiter la pénurie qui s’annonce, ce d’autant, qu’en 2033, les deux autres sites autorisés dans le département seront en fin d’autorisation. Soit de nouvelles autorisations seront accordées soit les matériaux seront importés d’autres régions, avec des coûts plus importants et des impacts liés au transport (bilan carbone, gaz à effet de serre…..).
Le scénario décrit ci-après correspond au scénario le plus probable d’évolution de l'état actuel de l'environnement en l’absence de mise en œuvre du projet et ce jusqu’à une échéance correspondant à la durée d’autorisation du projet sollicitée (30 ans) pour que la comparaison avec l’évolution décrite au paragraphe précédent ait un sens. Le scénario tient compte de l’ensemble des informations disponibles sur le secteur d’étude, comme :
les orientations d’aménagement définies à l’échelle locale (Plans Locaux d’Urbanisme, documents d’objectifs en application des Directives Habitats et Oiseaux, et autres documents de programmation) ;
les tendances d’évolution pressenties sur le territoire, compte-tenu de l’orientation socio-économique (documents d’orientation, PLU …)
des éventuels projets connus sur la zone ;
des connaissances scientifiques, notamment en matière d’évolution des milieux et du climat le cas échéant.
Dans le cas présent, et compte tenu des informations et des connaissances disponibles à la date de dépôt du dossier, le scénario d’évolution le plus probable est que les terrains concernés par la demande d’autorisation d’exploitation de carrière conserveront la morphologie fixée par le projet de remise en état du site, à savoir des plans d’eau ceinturés par une piste. L’ensemble de traitement, les stocks et les locaux auront disparus. En effet, aucun autre projet n’est à notre connaissance envisagé sur le secteur, et aucune évolution naturelle notable, lié au changement climatique notamment, susceptible de modifier le mode d’occupation actuel des sols n’est prévisible à échéance de 30 ans. Il est donc probable que les plans d’eau restent en l’état et que les zones des bassins de décantation soient stabilisées, nivelées et régalées avec la terre
3 : EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 2
48
végétale présente sur le site. Cet état entrainerait une certaine perte de biodiversité, une partie des espèces patrimoniales étant très liées aux bassins (cf carte ci-avant p.44). En l’état actuel des documents d’urbanisme de la commune de SPAY, l’urbanisation est restreinte à l’enveloppe urbaine du centre-bourg. La zone d’extension d’habitat (zone à urbaniser à vocation d’habitat à ouverture immédiate : 1 AU) est prévue au sud-ouest du bourg. Au nord du bourg sont prévus :
une zone à urbaniser à vocation d’activités économiques, à ouverture immédiate : 1 AUz une zone à urbaniser à vocation mixte, à ouverture ultérieure : 2AU
L’absence de mise en œuvre du projet laisserait un terrain privé (appartenant à Mme TAVANO) présentant plusieurs plans d’eau sans vocation particulière, ou tout au moins autre que celle que la propriétaire voudra bien leur donner. A noter que le défrichement n’aura plus lieu d’être, la compensation par reboisement sur des terrains de la mairie non plus.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 2
49
Aspects pertinents de l’état actuel
Enjeux (cf. chapitre 3) Scénarios d’évolution de l’état actuel Scénario 1 : avec mise en œuvre du projet Scénario 2 : sans mise en œuvre du projet
Population
L’Enfournoire: habitation située à 20 m de la limite d’emprise
Les Pelouses : Habitations sur la presqu’ile au milieu du plan d’eau des
Pelouses : à 180 m de la future zone d’exploitation
La Perrée: un centaine de mètres au nord de l’emprise
Modification du contexte sonore actuel, limitée à la seule évolution des engins d’extraction (pelle ou drague)
Identique à l’état actuel
Activité carrière
Carrière de proximité : approvisionnement entreprises locales et municipalités Préservation d’emplois directs et indirects Ralentissement et diminution de la pénurie annoncée en sables alluvionnaires pour le BTP.
Pérennité des approvisionnement locaux et régionaux Pérennité des emplois directs et indirects (1 emploi direct pour 7 indirects transport compris)
Importation de matériaux avec tous les impacts économiques et environnementaux que cela implique. Diminution de l’activité industrielle sur la commune.
Espaces de loisirs Maintien de la piézométrie pour les plans d’eau de la base de loisirs du Houssay Légère modification locale de la piézométrie du fait du rabattement de nappe, suivie très régulièrement avec mise en place de cote d’alerte.
Identique à l’état actuel (pas de rabattement de nappe)
Biodiversité Nombreuses espèces patrimoniales et habitats variés par la présence de l’exploitation Petite zone humide (mares) dans la partie sud de l’extension
Réalisation de nombreux aménagements à but écologique Compensation des mares par recréation d’habitats semblables
Disparition d’habitats intéressants lors de la remise en état du site (2020) Pas de modification pour la biodiversité présente sur les zones d’extension
Eaux Usages de l’eau souterraine : base de loisirs le Houssay et forage à vocation agricole (très faible débit) pour exploitation de safran. Maintien de la relation nappe/rivière.
Suivis de la piézométrie permettant de maintenir les usages autres de l’eau souterraine. Exploitation gérée de façon à maintenir la relation nappe /rivière
Pas d’évolution par rapport à l’état actuel , pas de modification de la piézométrie pendant l’exploitation (2020) ou après exploitation
Voies de communication Entretien de la voie communale n°9 qui dessert le site Pas de modification, pas d’augmentation de trafic Quasiment plus de trafic sur cette voie à partir de 2020 (desserte de l’Enfournoire uniquement)
Réseau d’électricité Présence de poteaux sur le site actuel et sur une parcelle hors emprise mai incluse dans la zone d’extension sud
Maintien de l’accès à la parcelle : création d’une presqu’ile au niveau du plan d’eau.
Identique à l’état actuel.
4 : SYNTHESE DES SCENARIIS
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
51
CHAPITRE 3 :
DESCRIPTION DES FACTEURS MENTIONNES AU
III DE L’ARTICLE L122-1 SUSCEPTIBLES D’ETRE
AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE
PROJET
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
53
SOMMAIRE
Page
1 : POPULATION ET SANTÉ HUMAINE................................................................................................ 57
1.1: DEMOGRAPHIE .................................................................................................................................. 57
1.2: HABITAT ........................................................................................................................................... 58
1.3: ENVIRONNEMENT SONORE ................................................................................................................ 60
1.3.1: Mode opératoire des mesures de bruit dans l’environnement ................................................... 60
1.3.2: Grandeurs mesurées et niveaux retenus ................................................................................... 61
1.3.3: Conditions de mesures et résultats ............................................................................................ 61
1.4: SANTÉ HUMAINE ............................................................................................................................... 62
1.4.1: Voies de transfert ....................................................................................................................... 63
1.4.2: Population cible .......................................................................................................................... 63
2 : ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET SERVICES – ESPACES DE LOISIRS ......................................... 64
2.1: DONNÉES GÉNÉRALES ...................................................................................................................... 64
2.2: AGRICULTURE .................................................................................................................................. 65
2.2.1: Données générales .................................................................................................................... 65
2.2.2: Structures d’exploitation agricole dans le périmètre du projet de carrière ................................. 67
2.3: SYLVICULTURE ................................................................................................................................. 67
2.4: ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ CARRIÈRES TAVANO ............................................................................... 68
2.5: AUTRES ACTIVITÉS ET SERVICES ....................................................................................................... 68
2.6: ESPACES DE LOISIRS ........................................................................................................................ 69
3 : BIODIVERSITÉ ................................................................................................................................... 71
3.1: ESPACES NATURELS ET FORESTIERS - CONTEXTE ECOLOGIQUE ......................................................... 71
3.1.1: Zonages biologiques .................................................................................................................. 71
3.1.2: Corridors écologiques ................................................................................................................ 73
3.2: FLORE ET VÉGÉTATION ..................................................................................................................... 74
3.3: FAUNE ............................................................................................................................................. 76
3.4: EVALUATION ÉCOLOGIQUE ................................................................................................................ 76
3.4.1: Sensibilité réglementaire ............................................................................................................ 76
3.4.2: Sensibilité patrimoniale .............................................................................................................. 77
3.4.3: Zonage de la sensibilité patrimoniale ......................................................................................... 79
4 : TERRES ET SOLS ............................................................................................................................. 81
4.1: TOPOGRAPHIE .................................................................................................................................. 81
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
54
4.1.1: Topographie générale ................................................................................................................ 81
4.1.2: La carrière actuelle ..................................................................................................................... 81
4.1.3: Le projet ..................................................................................................................................... 83
5 : SOLS ET SOUS SOLS ...................................................................................................................... 83
5.1: CONTEXTE GÉNÉRAL ........................................................................................................................ 83
5.2: GÉOLOGIE LOCALE ........................................................................................................................... 84
5.3: PÉDOLOGIE ...................................................................................................................................... 85
5.3.1: Etat de pollution des sols ........................................................................................................... 85
6 : EAUX .................................................................................................................................................. 87
6.1: CONTEXTE DE LA NOTICE HYDROGEOLOGIQUE ................................................................................... 87
6.2: CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE ........................................................................................................... 88
6.2.1: Réseau hydrographique ............................................................................................................. 88
6.2.2: Synthèse du contexte hydrographique ...................................................................................... 91
6.3: CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ........................................................................................................ 92
6.3.1: Description des aquifères ........................................................................................................... 92
6.3.2: Piézométrie locale ...................................................................................................................... 92
6.3.3: Evolution piézométrique au cours des essais ............................................................................ 96
6.3.4: Remontées de nappe ............................................................................................................... 102
6.3.5: Aspects quantitatifs .................................................................................................................. 103
6.3.6: Aspects qualitatifs .................................................................................................................... 105
6.3.7: Synthèse du contexte hydrogéologique ................................................................................... 108
7 : AIR ET CLIMAT ................................................................................................................................ 109
7.1: QUALITÉ DE L'AIR ........................................................................................................................... 109
7.1.1: Présentation régionale ............................................................................................................. 111
7.1.2: Données locales ....................................................................................................................... 114
7.2: CLIMATOLOGIE ............................................................................................................................... 115
7.3: CHANGEMENT CLIMATIQUE .............................................................................................................. 117
8 : BIENS MATÉRIELS ......................................................................................................................... 120
8.1: AXES DE COMMUNICATION .............................................................................................................. 120
8.1.1: Réseaux principaux routiers et ferroviaires .............................................................................. 120
8.1.2: Réseau fluvial ........................................................................................................................... 120
8.1.3: Réseau aérien .......................................................................................................................... 120
8.1.4: Trafics sur les routes départementales .................................................................................... 121
8.2: RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ............................................................................................................. 122
8.2.1: Eau potable .............................................................................................................................. 122
8.2.2: Eau pluviale .............................................................................................................................. 123
8.2.3: Electricité .................................................................................................................................. 123
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
55
8.2.4: Téléphone ................................................................................................................................ 124
8.2.5: Transport de produits dangereux ............................................................................................. 124
8.3: BÂTI, ÉQUIPEMENTS ET TERRAINS ................................................................................................... 124
9 : PATRIMOINE CULTUREL ............................................................................................................... 125
9.1: PATRIMOINE HISTORIQUE ................................................................................................................. 125
9.2: PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ........................................................................................................ 125
10 : PAYSAGE ........................................................................................................................................ 127
10.1: DESCRIPTION DE L’ENTITÉ PAYSAGÈRE ............................................................................................ 128
10.2: ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX ........................................................................................... 130
10.2.1: Monuments historiques ............................................................................................................ 130
10.2.2: Visibilité .................................................................................................................................... 130
10.2.3: Enjeux ...................................................................................................................................... 130
11 : INTERRELATIONS ENTRE LES ÉLÉMENTS DU CHAPITRE ...................................................... 131
12 : BILAN DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ............................................................................... 132
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
57
Sources : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) Rapport du Plan Local d’Urbanisme de Spay
1.1: DEMOGRAPHIE
La commune de SPAY, appartient, depuis 2011, à la Communauté de communes du Val de Sarthe, créée en 1994. Les objectifs définis par la communauté de communes sont :
Objectif 1 : assurer le développement économique du territoire en veillant à un aménagement équilibré.
Objectif 2 : Mettre en place une politique de l’habitat qui réponde aux besoins des habitatnts et des entreprises.
Objectif 3: Proposer des services de proximité adaptés aux besoins sociaux.
Objectif 4 : Valoriser le cadre de vie et les espaces de loisirs.
Objectif 5 : Renforcer la communication et le sentiment d’appartenance à un territoire.
1 : POPULATION ET SANTE HUMAINE
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
58
Certainses actions à mettre en oeuvre concernent directement la commune de SPAY: Créer et aménager une zone d’activité à SPAY: zone d’accueil d’activités tertiaires
Engager une réflexion sur la mise en place d’une usine de méthanisation
La communauté de commune du Val de Sarthe adhère au Pays Vallée de la Sarthe. Ce dernier à la compétence pour l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale.
Le Pays Vallée de la Sarthe est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant 3 communautés de communes et 62 communes
L’élaboration du SCOT Pays Vallée de la Sarthe est en cours d’élaboration.
Les chiffres clés de la sonnune de SPAY sont les suivants (données 2014) : La population est en augmentation, sur la période 2009-2014, de 5,3%. L’indice de jeunesse de la commune (rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 65 ans) est de 2,9 en 2008 contre 1,56 à l’échelle de l’ensemble de la zone urbaine du Mans. On observe cependant un vieillissement de la population, observé aussi à l’échelle départementale et nationale.
1.2: HABITAT
Le bourg de SPAY s’est développé autour d’un bati ancien centré sur l’église, qui s’est ensuite étendu le long des axes de communication, avec un aggrandissement progressif par des operations de lottissements successifs. Le parc de logements est essentiellement constitué de logements individuels récents, construits dans ces lotissements successifs. Le rythme de construction moyen a été de 23 logements /an sur la période de 1968 à 1990. Après une nette regression dans les années 90; le rythme de construction reprend de 1999 à 2008 avec une moyenne annuelle de 26 logements neufs, avec 1099 résidences principales en 2012.
Commune SPAY
Population totale 2 968 habitants
Superficie 1 422 hectares (14,22 km²)
Densité (habitants par km²) 209
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
60
Les habitations les plus proches de la sablière sont situées :
Au nord, au lieu-dit “La Perrée” à environ 100 m de la limite d’emprise ce secteur abrite une petite activité de type industrielle et une activité agricole de production de safran.
Les Aulnays, au nord ouest, à environ 180 à 400 m de l’emprise,
Les Pelouses, à environ 130 m à l’ouest, Le hameau de l’Enfournoire, à l’est, à environ 200 m de l’entrée du site, et 20 m de la limite
Le bourg d’Arnage au sud est de l’autre coté de la Sarthe,
Le bourg de Spay, à environ 1,2 km à l’ouest.
◄ Carte des zones d’habitat et d’activités
1.3: ENVIRONNEMENT SONORE
Sources : Mesures des niveaux sonores dans l’environnement : 2016 : bureau Technilab Présisons que dans l’arrété préfectoral en vigueur, un contrôle sonore est à effectuer tous les 3 ans.
1.3.1: MODE OPERATOIRE DES MESURES DE BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT
Afin de caractériser le niveau sonore du secteur, des mesures de bruit ont été réalisées durant la plage de fonctionnement de la sablière (dans la plage horaire 8h00 à 18h00). Les relevés ont été effectués conformément à la méthode de controle explicitée dans la norme NF S 31-010, relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, sans déroger à aucune de ses dispositions. Dans ce cadre, chacune des mesures a été effectuée sur une durée de 30 minutes. La campagne a été réalisée le 28 septembre 2016,
au droit des habitations les plus proches situées à l’Enfournoire en zone à émergence réglementée1, en période2 diurne (après 7h), avec et sans activité.
En limite d’emprise du site, à proximité de l’accès
1 Habitations ou zones constructibles les plus proches et susceptibles d'être gênées par l'activité répertoriées dans les
documents d'urbanisme 2 L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 définit la période nocturne dans la plage horaire 22h-7h et la période diurne entre
7h et 22h.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
61
1.3.2: GRANDEURS MESUREES ET NIVEAUX RETENUS
Chaque mesure de base est caractérisée par :
une valeur du niveau de pression acoustique continu équivalent (Leq), en décibels pondérés A ; une valeur du niveau de pression acoustique indice statistique 50 (Leq50 ), en décibels pondérés
A ; Le rapport de mesurage est fourni en annexe. Les mesures réalisées en continu intègrent des sources sonores artificielles ou naturelles dont certaines peuvent être jugées comme non représentatives de la situation sonore du lieu. De plus, dans certaines situations particulières, le niveau de pression sonore continu équivalent pondéré A, LAeq, n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent par l’apparition de bruits particuliers intermittents ou bien porteurs d’une énergie importante sur une courte durée. De telles situations de niveaux de bruit fluctuants se rencontrent fréquemment aux abords des axes routiers et des zones d’activités agricoles par exemple. Dans ce cas, les textes réglementaires indiquent que l’indicateur d’émergence est déterminé par la différence entre les indices statistiques L50 ambiant et résiduel, dans le cas où : LAeq – L50 ≥ 5 dB(A). Sinon, un traitement des sources particulières jugées non représentatives des lieux est réalisé.
1.3.3: CONDITIONS DE MESURES ET RESULTATS
Lors de la campagne, l’activité sur sur le site était habituelle, avec des opérations d’extraction à la drague aspiratrice, de la reprise de matériaux et du traitement de matériaux. Le ciel était couvert avec un vent léger à moyen. Les tableaux suivants récapitulent les valeurs des niveaux de pression sonore continus équivalents pondérés A (en dB(A)), relevés lors des campagnes de mesurage. Les valeurs sont arrondies au demi-décibel près (conformément à la norme NF S 31-010) et comparées à la réglementation en vigueur (arrêté du 23 janvier 1997) :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones
à émergence réglementée
Emergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h (Période
diurne)sauf dimanches et jours
fériés
Emergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h (Période
nocturne), les dimanches et jours
fériés
Supérieur à 35 dB(A)
et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Remarque : Les émergences ne sont définies que pour des valeurs de bruit ambiant supérieures à 35 dB(A).
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
62
En limite de propriété, le bruit ne devra pas dépasser 70 dB(A) en période jour et 60 dB(A) en période nuit. Selon l’arrêté du 23 janvier 1997, on appelle :
Niveau de bruit résiduel BR le niveau mesuré sans activité sur la carrière actuelle ; Niveau de bruit ambiant BA le niveau mesuré lorsque la carrière actuelle est en activité ; Emergence E la différence arithmétique entre BA et BR.
Résultats des mesures de bruit
Points Période
Date
Heure début
Heure fin
Bruit ambiant
Ambiant
Niveau sonore en
dB(A)
Date
Heure début
Heure fin
Bruit résiduel
Résiduel
Niveau sonore en
dB(A) Emergence
LAeq L50 LAeq L50
A
Limite
d’emprise
diurne
28/09/2016
10h25
11h01
51,5 48
28/09/2016
12h39
13h18
51,5 40,5
B
Enfournoire diurne
28/09/2016
11h04
12h00
44 41
28/09/2016
12h10
12h37
40 38 4
L’émergence est conforme à la réglementation en vigueur. Le niveau sonore en limite d’emprise est conforme à la réglementation.
1.4: SANTE HUMAINE
Certaines composantes de l’environnement sont déterminantes pour mener à bien l'évaluation des risques pour la santé humaine, compte tenu des risques potentiels identifies (bruit, émissions atmosphériques, vibrations et rejets d’effluents - cf. chapitre 4). Les voies de transfert, la population-cible et les émissions engendrées par le projet sont présentés dans ce paragraphe. Le détail est reporté au chapitre 4.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
63
1.4.1: VOIES DE TRANSFERT
La voie de transfert des émissions sonores est l’air. Pour ce qui concerne les émissions de poussières et de gaz (comme les gaz issus de la combustion dans les moteurs à explosion), la voie de transfert est également l’atmosphère. Outre l’exposition par inhalation, une exposition est également possible par ingestion, soit directe, soit indirecte (consommation de fruits et légumes issus de potagers, de produits animaux) pour certains polluants considérés comme persistants et/ou bioaccumulables. Pour les effluents, la voie de transfert est l’eau, que ce soit les eaux superficielles ou les eaux souterraines ici mises à nu par l’exploitation. Ces eaux sont susceptibles d'être captées pour l'alimentation en eau potable ou utilisées à d’autres usages comme l’arrosage des jardins ou la pêche de loisirs. Les informations concernant les eaux font l’objet du paragraphe 6.
1.4.2: POPULATION CIBLE
La population potentiellement concernée correspond à celle présente aux abords du projet, et plus particulièrement celle située sous les vents dominants (cf. paragraphe 7.2 sur la climatologie). Aucun établissement de santé (hôpitaux ou cliniques) n’a été recensé dans un rayon proche de la sablière. Par contre, des établissement susceptibles d’accueillir des populations sensibles sont présentes sur la commune de SPAY ou sur les communes voisines (notamment des écoles). Pour les émissions acoustiques, les points de mesures retenus correspondent aux habitations les plus proches de la sablière. En effet, la propagation des ondes sonores s’atténue avec la distance. Les habitations les plus proches sont celles du hameau de l’Enfouroire, au nord est du site, à 200 m de l’entrée, les habitations des Pelouses, à 180 m de l’emprise à l’ouest, les habitations de La Perrée à 150 m au nord de l’emprise sollicitée. Les populations sensibles les plus proches sont localisées sur la carte des zones Habitats et Activités :
E / C / L pour Ecole, college et lycée Les centres de soins, hopitaux, cliniques et maisons de retraites les plus proches sont sur l’agglomération mancelle.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
64
Sources : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) AGRESTE (données en ligne du Ministère de lAgriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt) Documents du PLU de la commune de SPAY Site de la commune de SPAY
Etude écologique ENCEM - 2016 Données fournies par Carrières TAVANO
2.1: DONNEES GENERALES
Les principales activités économiques du secteur sont localisées autour du Mans, zone industrielle Sud à proximité de la voie férrée et de l’aérodrome et au niveau de la zone industrielle Nord. Sur la commune de SPAY, les principales données sont les suivantes (année 2013) :
Commune SPAY
Population active 1 891 soit 76,3% de la population
Actifs ayant un emploi 70,8 %
Taux de chômage 5,4 %
13,7% des actifs travaillent sur leur commune de résidence (SPAY). La répartition des établissements par secteurs économiques est la suivante (au 31 décembre 2014):
Secteurs
Nombre
d’établissements
actifs
(janvier 2015)
Répartition en %
Agriculture,
sylviculture,
pêche
Industrie Construction
Commerce,
transport, services
divers
Services
publics
SPAY 163 5,5 10,4 12,3 63,2 8,6
2 : ACTIVITES ECONOMIQUES ET SERVICES – ESPACES DE LOISIRS
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
65
La répartition des postes salariés par secteur d’activité est la suivante:
Secteurs Total
(déc 2014)
Répartition en %
Agriculture,
sylviculture,
pêche
Industrie Construction
Commerce,
transport, services
divers
Services
publics
SPAY 1 271 6 (0,5%) 479 (37,7%) 324 (25,5%) 409 (32,2%) 53 (4,2%)
On peut remarquer que la part de l’agriculture dans l’activité de la commune est relativement faible.
Le moyen de transport utilisé pour se rendre au travail est très majoritairement la voiture
2.2: AGRICULTURE
2.2.1: DONNEES GENERALES
Dans le cadre du diagnostic du SCOT, la commune de SPAY a été rattachée à l’entité « Vallées de la Sathe et de l’Huisne ». Cette entité se caractérise par des sols plutôt favorables aux cultures. On y observe une forte proportion d’agriculteurs professionnels et une dynamique d’installation favorable. Le territoire est cependant soumis à une forte pression foncière qui peut fragiliser les structures agricoles. Entre 1979 et 2000 (6 exploitations), la commune a perdu 9 exploitations.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
66
Les données concernant la commune de SPAY sont fournies dans le tableau ci-dessous. Elles sont issues du recensement agricole de 2010 du site AGRESTE.
Données agricoles
Commune SPAY
Nombre d’exploitations ayant leur siège sur la commune 5
Emploi (unite de travail) 12
Surface Agricole utilisée 568 ha
(39,9 % de la surface communale)
Superficie en terres labourables 352 ha
Superficie en cultures permanentes 0 ha
Superficie toujours en herbe 216 ha
Cheptel (unité gros bétail1) 847
On décompte en 2010 plus que 5 sièges d’exploitations agricoles sur le territoire de SPAY L’orientation agricole technico-économique en 2010, comme en 2000, est axée sur la polyculture et le polyélevage. On compte cependant, une exploitation spécialisée dans la culture du safran et un agriculteur en bio qui réalise de la vente directe s’inscrivant ainsi dans un circuit court entre producteur et consommateur.
Exploitations agricoles
Exploitation Nom Type d’activités Superficies exploitées
Les Grands Bizerays M Rousseau Lait et cultures spécialisées 114 ha
Belleborde M Lemonnier Volailles de Loué 80 ha
La Vaudelle M Legay Viande , céréales nc
La Perrée M Pohu Safran nc
La Fontaine M Briffaut Agriculture bio, lait, poules
pondeuses, vente directe
230 ha
La commune de SPAY est concernée par 7 IGP (Indication Géographique Protégée qui identifie un produit agricole) :
Bœuf du Maine
Cidre de Bretagne ou Cidre breton Porc de la Sarthe
Val de Loire 1 Unite de comptabilisation de référence permettant d’agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges (bovins,
ovins, porcins, lapins et volailles)
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
67
Volailles de Loué
Volailles du Maine Œufs de Loué
2.2.2: STRUCTURES D’EXPLOITATION AGRICOLE DANS LE PERIMETRE DU PROJET DE CARRIERE
Aucun siège d’exploitation agricole n’est présent dans le périmètre du projet de carrière.
Le siège d’exploitation le plus proche se trouve au lieu-dit La Perrée, au nord du site. Cette exploitation a été créée en mai 2010.
2.3: SYLVICULTURE
Un des secteurs sollicités en extension est occupé par une pinède, landes et lisières herbacées. Ce secteur fait l’objet d’une demande de défrichement intégrée dans le présent dossier. Le secteur sollicité, parcelle AK 11 pour partie, couvre une surface de l’ordre de 2,9 ha et s’intègre dans un massif forestier de 31 ha situé entre la Sarthe et la RD 323, voie à forte circulation.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
68
L’expertise écologique distingue 3 strates distinctes: Strate arborée : une futaie assez lache de pins, issue de semis, dont les troncs sont compris entre 30
et 50 cm de diameter. Cette strate arborée est monospécifique à Pinus pinaster. La pointe sud ouest du secteur à défricher est occupée sur environ 1 000 m² par une jeune plantation de pins présentant des troncs de diamètre compris entre 5 et 10 cm.
Strate arbustive : Taillis de feuillus peu à assez dense, avec des troncs de diamètre compris entre 10 et 20 cm. Cette strate arbustive présente deux espèces : Quercus robur et Castanea sativa
Strate herbacée : très pauvre et peu diversifiée sous la futaie, beaucoup plus riche sur les lisières non remaniées et les chemins foretiers.
Précisons que Madame TAVANO est propriétaire de l’usufruit ou plein propriétaire de tout le massif forestier secteur concerné et secteur attenant. Rappelons que le 20 avril 2017, l’entreprise Tavano a déjà obtenu un arrêté préfectoral de défrichement portant sur une partie de la parcelle ZN n°17 pour une surface de 2,7 ha. Cet arrêté prévoit 3,2 ha de surface à reboiser. A ce jour, l’entreprise Tavano a déjà reboisé 0,8 ha.
2.4: ACTIVITES DE LA SOCIETE CARRIERES TAVANO
La Société Carrières TAVANO est en activité depuis 23 ans et exploite le gisement de SPAY depuis 1974. Elle emploie sur le site d’exploitation 8 personnes. On peut aussi noter la présence de la société Béton Tavano à proximité immédiate. L’ancrage local de la société n’est plus à démontrer et si l’on considère les effectifs de l’entreprise, l’ensemble de dépenses réalisées pour son fonctionnement (salaires, achats de prestations et de matériels, de consommables et d’énergie), les taxes et impositions versées, le lieu de résidence des intervenants et la localisation des fournisseurs, l’empreinte socio économique apparait non négligeable avec un impact économique direct de l’activité de l’usine, un impact indirect lié à l’activité de la chaîne de sous-traitants et les impacts induits représentés par le soutien à la consommation des ménages et aux dépenses de fonctionnement des administrations publiques. On estime qu’un emploi direct induit environ 3 emplois indirects locaux
2.5: AUTRES ACTIVITES ET SERVICES
L’offre de commerces est concentrée sur les bourgs des communes (SPAY, ARNAGE) et bien évidemment sur Le MANS. Hors exploitations agricoles (cf. paragraphe 2.2.2), les entreprises présentes aux abords du projet sont :
Béton TAVANO: centrale à béton sur la sablière, alimentée par les matériaux de la sablière.
Le Batimans : Le Perrée : Entreprise de construction Ltr Industries SA: Manufacture de tabac
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
69
SWM (LTR Industries): Création et fabrication de matériaux à partir de fibres, résines et polymers.
Soremaine VL: casse automobile Parmi les autres entreprises, on citera :
Une entreprise de nettoyage industriel: CNEG
Entreprise de mesnuiseries métalliques: Gaignard Fournisseur de systèms de climatisation: Cesbron
Entreprises axées sur l’automobile: Garage, controle technique, location de véhicules
Entreprise de transport routier : Transaline Services logistiques : Geodis
Pour ce qui concerne les services, en dehors de la Mairie, SPAY dispose d’une agence postale, d’écoles, de salles des fêtes (6 salles municipales), d’une bibliothèque et d’une zone de loisirs avec camping (Le Houssay). Ces services sont centrés sur le bourg de SPAY et sur le domaine du Houssay (base de loisirs). De nombreuses associations tant culturelles que sportives participent à la vie locale.
2.6: ESPACES DE LOISIRS
Dans le secteur, les loisirs organisés sont en relation avec les parcs de loisirs du Houssay, le Spaycific’zoo mais aussi le wake paradise, première base de téléski nautique de la Sarthe, installée sur une ancienne gravière.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
70
Il n’y a pas à proximité du site de sentiers de randonnées balisés et inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). On peut cependant noter la volonté de la commune de préserver un itinéraire de randonnée en bordure de la Sarthe.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
71
Source : Etude écologique– ENCEM –juin 2016. Ce rapport est fourni en annexe hors texte, nous ne reprendrons ici que les grandes lignes.
3.1: ESPACES NATURELS ET FORESTIERS - CONTEXTE ECOLOGIQUE
3.1.1: ZONAGES BIOLOGIQUES
Les terrains objet de la demande ne sont concernés directement par aucun zonage biologique (ZNIEFF1, ZICO2), par aucun site Natura 20003 et par aucun milieu bénéficiant d’une protection réglementaire (arrêté préfectoral de protection de biotope, réserve naturelle…). Ils se situent entre deux ZNIEFF de type 2 : la ZNIEFF « Bois et landes entre Arnage et Changé » localisée à environ 2 km au nord-est du projet et la ZNIEFF « Bois de Moncé et de Saint-Hubert » distante d’environ 3 km au sud (carte 1). Le site Natura 2000 le plus proche est le SIC FR5200647 « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan », localisé à environ 14 km à l’est.
1 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. 2 ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. 3 Le réseau « NATURA 2000 » regroupe les Zones Spéciales de Conservation (ZSC, définies dans le cadre de la directive
Habitats) et les Zones de Protection Spéciales (ZPS, définies dans le cadre de la directive Oiseaux). Un SIC est un site en attente de désignation en ZSC par l’état membre concerné.
3 : BIODIVERSITE
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
72
ZNIEFF de type II
Commune de Spay (72) - Projet SAS CARRIÈRES TAVANO
Carte 1 : ZONAGES BIOLOGIQUES
Bois et landes entre
Arnage et Changé
Bois de Moncé et de Saint-Hubert
Emprise des terrains
objet de la demande
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
73
3.1.2: CORRIDORS ECOLOGIQUES
Commune de Spay (72) - Projet SAS CARRIÈRES TAVANO
Carte 5 : CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Localisation du projet
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
74
Continuités écologiques : le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région des Pays de la
Loire a été adopté par arrêté préfectoral du 30 octobre 2015. Il est consultable sur le site internet de la DREAL.
La carte du SRCE au 1/100 000 (cf. carte des continuités écologiques) représente le cours de la Sarthe en tant que réservoir de biodiversité (sous-trame des milieux aquatiques) et fait apparaître la présence d’un corridor potentiel au niveau de la Sarthe et de ses abords (corridors vallées).
3.2: FLORE ET VEGETATION
La description de la flore et de la végétation est développée à partir des 25 habitats naturels identifiés
◄ Carte des habitats naturels
224 taxons y ont été inventoriés (cf. relevé floristique en annexe 1), ce qui correspond à une diversité floristique de niveau « moyen » sur une surface d’environ 60 ha1. Les relevés floristiques et les tableaux descriptifs des habitats sont dans l’étude écologique. Zones humides La composition floristique des différents habitats montre que les habitats 3g, 4, 10, 11, 12, 15, 17, 18 et 19 sont dominés par des espèces qui ne sont pas référencées en tant que caractéristiques des zones humides dans les listes de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Il ne s’agit donc pas de zones humides vis-à-vis de leur composition floristique. Les habitats 3b, 3c, 3d, 7, 8 et 14 correspondent à des zones humides. Il s’agit pour l’essentiel de zones humides liées à l’activité de la carrière. Seuls les habitats 8 et 14 correspondent à des milieux non remaniés par la carrière (terrains demandés en extension). L’habitat 14 est localisé sur la bande inexploitée de 10 m. L’habitat 8 s’étend au maximum sur environ 300 m2.
1 L’échelle utilisée pour évaluer le niveau de diversité floristique sur une surface de l’ordre de 10 à 20 ha est la suivante : 1 à 50
espèces : diversité très faible, 51 à 100 espèces : diversité faible, 101 à 150 espèces : diversité faible à moyenne, 151 à 200 espèces : diversité moyenne, 201 à 250 espèces : diversité moyenne à forte, 250 à 300 espèces : diversité forte, plus de 300 espèces : diversité très forte.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
76
3.3: FAUNE
Les listes complètes d’espèces animales observées sur l’aire d’étude figurent en annexe 2 de l’étude écologiqueavec les cartes de localisation des transects et habitats d’observation de la faune.
Au total, 146 espèces animales et 2 groupes d’espèces ont été identifiés sur l’aire d’étude.
Insectes: 58 espèces o Lépidoptères rhopalocères: 14 espèces o Odonates : 15 espèces o Orthoptères: 28 espèces o Coléoptères patrimoniaux: 1 espèce
Amphibiens : 4 espèces et 1 groupe Reptiles : 3 espèces Oiseaux: 67 espèces Mammifères: 14 espèces et 1 groupe d’espèces
o Chauves-souris : 5 espèces et 1 groupe d’espèces o Mammifères terrestres : 9 espèces
3.4: EVALUATION ECOLOGIQUE
L’évaluation écologique porte sur les habitats, les espèces végétales et animales et enfin sur les fonctionnalités écosystémiques.
3.4.1: SENSIBILITE REGLEMENTAIRE
Aucune des espèces végétales observées n’est protégée en région Pays de la Loire.
Sur les 47 taxons protégés se reproduisant ou s’abritant sur l’aire d’étude, 45 sont directement concernés par le projet, selon la répartition suivante par groupe biologique :
- 4 espèces et 1 groupe d’espèces d’amphibiens ; - 3 espèces de reptiles ; - 36 espèces d’oiseaux ; - 1 espèce de mammifère.
Les chauves-souris observées sur l’aire d’étude sont toutes protégées. Elles ne sont pas prises en compte dans ce bilan dans la mesure où les inventaires portant sur l’activité de chasse ne donnent pas d’informations
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
77
sur l’occupation éventuelle de gîtes en période de reproduction ou d’hibernation. Sur les cinq espèces inventoriées, une seule est arboricole : la Noctule commune. Deux habitats de gîtes potentiels « très favorables » ont été définis : le double alignement de chênes de la haie 5 et les arbres isolés localisés au nord-ouest du plan d’eau 1.
3.4.2: SENSIBILITE PATRIMONIALE
Flore
Neuf espèces végétales d’intérêt patrimonial ont été recensées. Six espèces « communes » à « assez rares » sont estimées « assez sensibles » Trois espèces « rares » à « très rares » sont estimées « sensibles » :
Six espèces végétales patrimoniales sont concernées par le projet, dont trois « sensibles ». Faune 18 espèces animales sont estimées d’intérêt patrimonial.
Onze espèces « communes » ou « assez communes » au niveau régional sont estimées « assez sensibles »
Sept espèces « assez rares » sont estimées « sensibles ». Il s’agit de trois insectes, de deux amphibiens et de deux oiseaux,.
14 espèces animales patrimoniales sont concernées par le projet, dont deux « sensibles ». Comme pour l’évaluation de la sensibilité réglementaire, les chauves-souris n’ont pu être prises en compte dans ce bilan Habitats naturels
Quatre habitats naturels correspondent ou sont apparentés pour partie à des habitats d’intérêt communautaire. L’habitat 10 n’est que partiellement apparenté à des habitats d’intérêt communautaire du fait de sa pauvreté en espèces caractéristiques et ne peut donc être estimé d’intérêt patrimonial. Les habitats 3a, 3c et 8 correspondent à des habitats d’intérêt communautaire, même si les cortèges floristiques sont assez pauvres. Du fait de cette pauvreté spécifique et du caractère artificiel des habitats de la carrière, nous leur attribuons un niveau « assez sensible ». Nous ajoutons à ces trois habitats un habitat potentiel d’espèces d’intérêt communautaire : les habitats de gîtes potentiels « très favorables » pour les chauves-souris : le double alignement de chênes de la haie 5 et les arbres isolés localisés au nord-ouest du plan d’eau 1.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
79
3.4.3: ZONAGE DE LA SENSIBILITE PATRIMONIALE
26 espèces et 4 habitats d’intérêt patrimonial ont été recensés à l’intérieur de l’aire d’étude en 2014,
2015 et 2016. 10 espèces « sensibles », 16 espèces « assez sensibles » et 4 habitats « assez sensibles » ont été
définis.. A partir de ces données, une hiérarchisation de la sensibilité patrimoniale des terrains étudiés peut être établie. Zone de niveau « fort » : le secteur des mares 12 (environ 1 ha) avec 5 espèces « sensibles » et un habitat « assez sensible » (pelouse des grèves humides). Zones de niveau « moyen à fort » : deux secteurs sur une surface totale d’environ 2 ha :
- la pelouse silicicole sèche au nord des mares 12. Trois espèces « sensibles » et une espèce « assez sensible »;
- le bassin 8 : quatre espèces « sensibles » et deux habitats « assez sensibles »
-
Zones de niveau « moyen » : sept secteurs répartis sur une surface totale d’environ 6 ha : Bilan global : les terrains objet de la demande présentent une sensibilité patrimoniale relativement élevée, avec en particulier un total de dix espèces estimées « sensibles » au niveau supra-régional. Ces dix espèces « sensibles » sont étroitement liées à l’activité de la carrière qui a généré un ensemble d’habitats diversifiés, en particulier vis-à-vis du gradient hydrique (des habitats aquatiques aux habitats secs et chauds). Deux autres paramètres caractérisent une grande partie des habitats qui abritent ces espèces « spécialisées » : une faible couverture végétale et un substrat à caractère oligotrophe (pauvre en éléments nutritifs).
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
80
Commune de Spay (72) - Projet SAS CARRIÈRES TAVANO
Carte 4 : ZONAGE DE LA SENSIBILITÉ PATRIMONIALE
Les autres terrains de l’emprise objet de la demande sont estimés de niveau « moyen à faible ».
Périmètre des terrains objet de la demande Périmètre des terrains à exploiter ou à remanier
Fond de carte : photographie aérienne IGN 2013 du site Géoportail.
Niveau « fort »
Niveau « moyen à fort »
Niveau « moyen »
Plan d’eau 3
Plan d’eau 4
Bassin 7
Plan d’eau 6
Plan d’eau 2
Mares 12
Bassin 9
Bassin 8
Mares 13
Bassin 11
Bassin 10
Plan d’eau 1
Mare 14
Fourrés 1
Haie 6
Haie 1
Haie 2
Haie 3
Haie 4
Bois 1
Bois 2
Bois 3
Fourrés 2
Haie 5
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
81
4.1: TOPOGRAPHIE
Sources : Carte topographique 1719 E de l’IGN à 1/25000,
Plan topographique établi en novembre 2013, Rapport de présentation du PLU.
4.1.1: TOPOGRAPHIE GENERALE
Le territoire de la commune de Spay s’inscrit dans la vallée alluviale de la Sarthe, la pente est orientée vers la Sarthe. Le relief de la commune est relativement plat, avec des altitudes moyennes comprises entre 40 et 45 m. Du fait, d’un relief plat, les ruisseaux et les infrastructures routières font office de ligne de partage des eaux. Les ruisseaux restent assez discrets dans le paysage, marquant légèrement des inflexions dans les courbes de niveau. Localement on peut citer le ruisseau du Buard qui forme la limite nord du projet.
4.1.2: LA CARRIERE ACTUELLE
D’un point de vue topographique, la carrière actuelle se situe sur des terrains plats, présentant une faible pente vers la Sarthe, soit 0,1 à 0,2% vers le sud est. Les cotes se situent entre 43 et 40 m NGF en bordure de Sarthe. La plateforme de l’installation et les pistes se situent globalement à 43 m NGF, légèrement au dessus de la voie communale n°9 à 42,5 m NGF. Les berges des différents plans d’eau suivent la topographie, seuls les stocks présentent une surélévation de 2 m pour les merlons de découverte et jusqu’à 10 m pour les matériaux traités ou à traiter. Les différents plans d’eau présentent une profondeur variable, avec un niveau d’eau fluctuant entre les niveaux de hautes et de basses eaux (37,5 m NGF), laissant donc apparaitre une hauteur de berge variable. La hauteur de battement des niveaux d’eau est de l’ordre de 1 m à 1,5 m et selon la présence d’argiles intermédiaires ou pas, la profondeur des plans d’eau varie entre 2 et 13 m. Notons que pour la réalisation de l’étude hydrogéologique, l’utilisation d’une drague aspirante a été autorisée. Cette dernière a été utilisée sur le plan d’eau de la Coyère. La cote minimale atteinte par cette technique d’exploitation est de 24,3 m NGF (La bathymétrie de 2017 est fournie en annexe de la partie demande).
4 : TERRES ET SOLS
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
83
4.1.3: LE PROJET
Les zones d’extension sollicitées présentent des cotes homogènes avec :
La partie nord le long du ruisseau du Buard, à 41 m NGF;
La partie sud du plan central, entre 41,5 et 40 m NGF;
La partie ouest, entre 41 et 43 m NGF.
La profondeur d’exploitation sera variable, en fonction du gisement, la cote minimale d’extraction sera
de 24 m NGF.
Sources : Carte géologique de la France - Feuille n°358 - Edition BRGM, Etude hydrogéologique - TERRAQUA - juillet 2017
5.1: CONTEXTE GENERAL
Le département de la Sarthe appartient à la marge occidentale du Bassin Parisien bordant le Massif Armoricain. La plaine du Sud du Mans est constituée par les formations cénomaniennes, largement incisées par la Sarthe qui en fonction de son régime a déposé des alluvions s’étageant autour de son lit actuel.
◄ Carte géologique n°358 1/50 000
Les terrains qui affleurent dans le secteur d’études sont décrits ci-dessous des plus anciens au plus récents.
JURASSIQUE :
j4 : Oxfordien inférieur (puissance de 50 mètres) : Succession de niveaux argileux et sableux fins s’alternant avec des bancs calcaires fossilifères. Ce niveau affleure à l’Est d’une faille, au niveau de la ville d’Arnage.
5 : SOLS ET SOUS SOLS
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
84
CRÉTACÉ :
C1 : Cénomanien inférieur (puissance de 43 mètres dans la cuvette du Mans) : Argile glauconieuse à minerai de fer.
C2a : Cénomanien inférieur et moyen (puissance de 40 mètres) : Les « sables et Grès du Maine » forment un ensemble détritique grossier reposant sur des argiles glauconieuses à minerai de fer. Cette formation se compose de sables jaunes ferrugineux grossiers.
QUATERNAIRE :
Quatre formations alluviales étagées en terrasses bordent la Sarthe. La puissance des dépôts de remblaiement varie de 4 à 8 mètres. Elles sont disposées de la façon suivante :
- Fw : formation alluviale de haute terrasse (+ 27 à +30 mètres) ; - Fx : Formation alluviale de moyenne terrasse (+12 à +15 mètres) ; - Fy : formation alluviale de basse terrasse : (+6 à +8 mètres). Le gisement exploité par la
carrière de SPAY provient des basses terrasses alluviales Fy d’âge Wurmien. Il se compose de sédiments siliceux et sablo-graveleux ;
- Fz : alluvions actuelles du lit majeur de la Sarthe.
OEc2 : Grès « roussards » éolisés au Quaternaire (pavage éolien) : fragments de grès tertiaires éolisés.
FORMATION ANTHROPIQUE :
X Remblais : remblais d’anciennes ballastières.
A l’Est de la carrière, un accident tectonique de direction subméridienne est reconnu. Il s’agit de la faille d’Arnage, dont le rejet d’une cinquantaine de mètres met en contact les terrains jurassiques et les sables cénomaniens. Cette faille suit le cours de la Sarthe depuis Allones au Nord puis s’en détache au niveau d’Arnage. Elle est identifiée jusqu’à Saint-Gervais-en-Belin, plus au Sud.
5.2: GEOLOGIE LOCALE
Dossier technique de réalisation des piézomètres – source : Cissé forage
Dans le cadre de l’étude hydrogéologique, quatre piézomètres ont été réalisés aux abords de la carrière, par l’entreprise Cissé Forage du 5 au 11 septembre 2014. Ils sont localisés sur la carte géologique ci-avant.
Le dossier technique comprenant les méthodes de foration, les coupes techniques et les coupes géologiques des piézomètres est disponible en annexe.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
85
Les reconnaissances de terrain ont été menées au rotary jusqu’à 21 mètres de profondeur en Pz3. Elles ont permis l’identification de deux formations :
Les premiers horizons superficiels sont composés de sables appartenant à la formation alluviale de basse terrasse Fy. Sa puissance varie entre 6 et 10 mètres ;
Les horizons sous-jacents sont formés de sables jaunes grossiers reposant sur des argiles vertes. Ces deux faciès datent du Cénomanien inférieur et moyen.
5.3: PEDOLOGIE
Au niveau du périmètre autorisé, tous les terrains ont été décapés, les sols (terre végétale et partie superficielle) ont été soit réutilisés pour la remise en état du site, talutage des berges et revégétalisation, soit stockés en vue de leur réutilisation. Tout le secteur de la carrière autorisé a été remanié. Au niveau des zones d’extension les sols des futaies de résineux sont des sols sableux faiblement organiques.
5.3.1: ETAT DE POLLUTION DES SOLS
Au droit de la carrière, il n’y a jamais eu d’incident tel qu’une fuite de produits dangereux importante (rupture de durit d’un engin ou perte de confinement de cuve d’hydrocarbures) susceptible d’engendrer une pollution. Le site n’est pas recensé dans la base de données des sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL). Les produits potentiellement nocifs pour l’environnement (hydrocarbures) sont stockés dans des cuves doubles peau conformément à la règlementation en vigueur. Le ravitaillement et le lavage des engins se font sur une aire étanche, reliée à un décanteur-déshuileur. Les terrains du périmètre d’extension sont occupés soit par une futaie résineuse soit par une peupleraie, un taillis de chènes et des fourrés et friches et ne présentent pas d’indice de pollution. Le risque de pollution sur ces secteurs est inexistant, du fait de l’absence d’activités industrielles. .
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
86
CARTE DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE LOCAL
Plan d’eau “L’enfournoire”
Plan d’eau “La Coyère”
Plan d’eau “Les Pelouses
Plan deau de pêche de la base de loisirs
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
87
Source : Rapports TERRAQUA: TA 14 046a, TA 14 046 b, TA 14 046 c: note finale Ne sont repris ici que les résiltats des études, pour une information complète, se reporter aux études jointes en annexes
hors texte.
6.1: CONTEXTE DE LA NOTICE HYDROGEOLOGIQUE
Dans le cadre de la préparation du dossier de demande de renouvellement d’autorisation et d’extension, le bureau d’études TERRAQUA a été mandaté par la société Carrières TAVANO pour la réalisation d’une étude hydrogéologique afin de :
Connaître le contexte hydrogéologique local et les principaux enjeux environnementaux ;
Evaluer l’incidence de l’activité souhaitée de la carrière et de sa remise en état sur les écoulements souterrains et superficiels dans l’environnement immédiat du site ;
Proposer des mesures de protection notamment vis-à-vis des modalités d’exploitation et de remise en état.
Les investigations, menées par le bureau d’études TERRAQUA pour répondre à ces différents points, se sont déroulées selon les étapes suivantes :
Une première phase d’études s’est déroulée de septembre à décembre 2014. Elle a consisté à étudier la piézométrie locale de la nappe et les incidences potentielles du fonctionnement de la carrière avec la prise en compte de l’extraction par la drague aspiratrice. Le rapport de cette étude a été remis en février 2015 (référence TERRAQUA : TA 14 046a).
Une seconde phase d’études a été menée d’août 2015 à décembre 2015. Elle a nécessité la réalisation d’un essai de rabattement de nappe après l’accord de la préfecture et sous couvert de mesures de suivis. L’objectif était d’évaluer l’impact et la compatibilité de ce mode d’exploitation, non prévu dans l’arrêté préfectoral en vigueur, avec les ressources en eau locales et de définir les modes d’exploitation futurs de la carrière dans le cadre de la prochaine demande d’autorisation. Les suivis piézométriques et limnimétriques avaient été analysés jusqu’à la fin mars 2016 et interprétés dans un rapport édité en avril 2016 (TA 14 046b).
La troisième phase d’études prend en compte l’effet des écourues de la Sarthe, observées entre septembre et décembre 2016. Les suivis piézométriques et limnimétriques de la carrière sur cette période sont exposés dans cette note hydrogéologique finale.
La notice hydrogéologique finale expose les résultats des trois phases d’études menées depuis
septembre 2014.
6 : EAUX
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
88
6.2: CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
6.2.1: RESEAU HYDROGRAPHIQUE
La carrière TAVANO est localisée dans la partie aval du bassin Loire-Bretagne, plus particulièrement dans le bassin versant de la Sarthe aval où la zone hydrographique est désignée « la Sarthe de l’Huisne (nc) au Rhonne (nc) ».
La carrière TAVANO est positionnée en rive droite de la Sarthe, dans un des méandres aujourd’hui inactifs. Dans un contexte plus local, la carrière de l’entreprise TAVANO est située entre la Sarthe à l’Est/Sud-Est et le ruisseau du Buard au Nord-Ouest Le Buard est un ancien chenal de la Sarthe dont la source est située au Nord de la carrière, à hauteur de la voie communale n°9. Son écoulement intermittent, lié aux contextes hydrogéologique et climatique, est orienté Nord-Est/Sud-Ouest. Il rejoint la Sarthe, par sa rive droite, à l’amont proche du seuil du Moulin sur le territoire de Spay. En aval de la carrière, l’écoulement de la Sarthe est conditionné par deux barrages sur son tronçon
principal (le barrage de Spay et le seuil du Moulin) et par une écluse sur un canal parallèle, faisant l’objet de diagnostics à l’occasion d’écourues. La mise en écourues de la Sarthe tous les 3 ans, qui consiste à un abaissement des biefs, permet d’effectuer des travaux de nettoyage dans le lit et des travaux d’entretien sur ces ouvrages. Le régime hydraulique de la Sarthe est suivi par une station hydrométrique positionnée à l’embouchure du canal. Dans son ensemble, le territoire est parsemé de plans d’eau, témoins d’anciennes gravières dont certaines ont été réaménagées en base de loisirs comme c’est le cas du domaine du Houssay au Sud-Ouest de la carrière TAVANO. Le réseau hydrographique se révèle bien développé dans l’environnement de la carrière TAVANO avec
la présence de milieux aquatiques multiples et diversifiés.
Aspects quantitatifs
Les données hydrologiques de la Sarthe (source Banque hydro) présentées dans la notice hydogéologique ne sont pas reprises ici. Il faut cependant noter qu’une partie de l’emprise du projet d’extension de la carrière TAVANO interfère avec le zonage réglementaire moyen des secteurs naturels et le zonage réglementaire fort dans une moindre mesure délimités par le PPRNI de la Sarthe aval à Spay. Les zones de remblaiement prévues ne sont pas
concernées par le risque de submersion en zone réglementaire forte.
Extrait du PPRNi de SPAY p.90
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
89
Aspects qualitatifs
La masse d’eau superficielle identifiée à hauteur du projet est « la Sarthe depuis le Mans jusqu’à la confluence avec la Mayenne » (code : FRGR0456).
Le domaine piscicole de la Sarthe est de type cyprinicole. L’état piscicole de la Sarthe en aval du Mans était dégradé, selon un diagnostic réalisé dans le cadre du PDPG1 de la Sarthe en 1998. Les principales perturbations à l’origine de cet état relevaient de travaux hydrauliques (chenalisation), de barrages créant des plans d’eau au fil de l’eau et d’annexes hydrauliques et zones humides peu nombreuses, peu fonctionnelles et peu entretenues.
Plus récemment, le contrat de restauration et d’entretien (CRE) de la Sarthe aval 2012-2016 a permis d’évaluer les pressions sur ce tronçon à partir de son état biologique2 et physique (débit, ligne d’eau, lit mineur, berges et ripisylve, continuité des écoulements, lit majeur et annexes hydrauliques). Le diagnostic a fait ressortir les points suivants :
Peu d’altération du compartiment berges-ripisylve ; Possibilité d’amélioration des compartiments berges/ripisylve et continuité ; Comportements lit mineur, lit majeur, débit, continuité et ligne d’eau fortement altérés ; Possibilité d’amélioration de l’enjeu lit majeur mais difficulté pour atteindre le bon état ; Aucune amélioration envisageable des compartiments débit et lit mineur.
Etat de la masse d’eau superficielle
D’après le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, les objectifs d’états de la masse d’eau de la Sarthe aval sont les suivants :
Un bon potentiel d’atteindre l’objectif d’état écologique en 2021 ; L’objectif d’atteinte du bon état chimique n’a pas été défini ; Un bon potentiel d’atteindre l’objectif d’état global en 2021.
Site de baignade du Houssay (base de loisirs) Le domaine du Houssay est localisé au Sud-Ouest de la carrière TAVANO, en aval hydraulique dans le sens d’écoulement de la Sarthe. Il comprend trois plans d’eau dédiés à la pêche dont le plus grand est également voué aux activités nautiques avec une zone de baignade. Selon le classement en vigueur à partir de la saison 2013 (directive 2006/7/CE), l’eau de baignade du plan d’eau « Le Houssay » est d’excellente qualité sur les 4 dernières années (2013-2016) et les résultats d’analyses de la saison 2017, ne faisant pas l’objet de classement pour le moment, sont bons.
1 Plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles. 2 Indice poisson en rivière (IPR) et indice poisson diatomées (IBD).
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
90
Ex
trait
du
PP
RN
i d
e la
Sa
rth
e a
u d
roit
de S
PA
Y s
ur
fon
d IG
N e
t p
ho
tog
rap
hie
aé
rie
nn
e
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
91
6.2.2: SYNTHESE DU CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
La carrière TAVANO est située dans le bassin versant de la Sarthe aval, dans un ancien méandre de sa rive droite.
Sur le secteur du site, le réseau hydrographique est bien développé avec la présence de la Sarthe à l’Est, un ancien chenal à l’Ouest nommé le Buard et des plans d’eau témoignant d’anciennes gravières. Les milieux aquatiques sont ainsi multiples et diversifiés.
L’écoulement superficiel majeur est la Sarthe dont le régime hydraulique est de type pluvial avec un module interannuel de 35,3 m3/h et un débit mensuel d’étiage quinquennal de 7,1 m3/s. Son cours fait état de deux barrages et d’une écluse en aval de la carrière qui conditionnent son débit et sa hauteur. Le département organise tous les 3 ans des écourues, permettant d’entretenir son lit et ses ouvrages hydrauliques. Cette intervention se manifeste par un abaissement du niveau d’eau entre les biefs.
Les limites du projet de carrière interfèrent avec les limites d’expansion de la crue centennale modélisée de la Sarthe, notamment avec le zonage réglementaire moyen des secteurs naturels du PPRNI de la Sarthe aval et le zonage réglementaire fort dans une moindre mesure. Néanmoins, les secteurs voués au remblaiement par des stériles du site sont positionnés en dehors de la zone réglementaire forte du PPRNI.
La masse d’eau superficielle de la Sarthe, définie à hauteur du projet, est fortement altérée en raison des nombreux obstacles à l’écoulement et de travaux hydrauliques ayant modifié son état physique. Dans les conditions hydrauliques actuelles, l’objectif d’atteinte du bon état global de ce milieu a été reporté à 2021.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
92
6.3: CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
Source : Notice hydrogéologiqueTerraqua
6.3.1: DESCRIPTION DES AQUIFERES
Alluvions de la Sarthe
Les formations alluviales constituant une partie du gisement de la carrière drainent les terrains encaissants. L’aquifère est très perméable et productif.
La nappe alluviale est en relation hydraulique avec la nappe des sables cénomaniens sous-jacents. Les plans
d’eau du site et de sa périphérie sont l’expression directe de la mise à jour de cette nappe libre dont
l’écoulement se traduit par un drainage général en direction de la Sarthe.
Cette nappe présente une certaine vulnérabilité vis-à-vis des activités anthropiques. Elle n’est pas exploitée pour l’eau potable en raison de sa qualité d’eau chargée en manganèse et fer. Quelques puits sont utilisés pour l’arrosage de jardin.
Sables du Cénomanien
Cet aquifère possède une bonne perméabilité et productivité dans les horizons sableux. Le niveau argileux du Cénomanien inférieur constitue son mur.
La nappe des sables cénomaniens est en continuité hydraulique avec la nappe alluviale. Le pouvoir
filtrant des alluvions lui assure une protection relative.
Sur le secteur, quelques ouvrages de faible profondeur exploitent la nappe du Cénomanien pour des besoins domestiques.
6.3.2: PIEZOMETRIE LOCALE
Trois campagnes de mesures piézométriques se sont déroulées dans la carrière et les hameaux périphériques:
en période de basses eaux 2014 (29 octobre 2014), en période de hautes eaux 2015 (25 mars 2015) en période de basses eaux 2015 (15 septembre 2015).
Les esquisses piézométriques de basses eaux 2014 et de hautes eaux 2015, illustrées sur les cartes suivantes sont représentatives du comportement piézométrique naturel de la nappe alluviale en continuité hydraulique avec la nappe des sables cénomaniens sous-jacente, en phase d’exploitation de la carrière.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
93
Les observations qui découlent du tracé des isopièzes de basses eaux 2014 et de hautes eaux 2015 sont les suivantes :
Sur le secteur de la carrière les écoulements souterrains sont drainés par la Sarthe selon une direction générale Nord-Ouest/Sud-Est et une direction locale Nord-Sud constatée du côté du lieu-dit Les Plouses en période de hautes eaux grâce à la mesure effectuée au Port au Liard. Les plans d’eau actuels de la carrière n’interfèrent pas sur le profil général des isohypses.
En période de hautes eaux 2015, les niveaux d’eau des puits étaient à une profondeur inférieure à 2 à 3 mètres par rapport au terrain naturel, attestant du caractère subaffleurant de la nappe.
Le gradient hydraulique en période de basses eaux 2014 était de l’ordre de 0,3% contre 0,5% en période de hautes eaux 2015.
La différence piézométrique constatée aux points d’eau mesurés, entre la période des basses eaux 2014 et des hautes eaux 2015, est de l’ordre de 20 centimètres. Pz3 (point n°9) révèle une hausse plus élevée de 67 centimètres, entre ces deux périodes, qui peut s’expliquer par une réalimentation préférentielle de la nappe en raison du rejet des eaux de l’installation de traitement dans le circuit des eaux de décantation. Le plan d’eau central (point n°12) est également affecté d’une élévation un peu plus prononcée de 38 centimètres. Son niveau d’eau est directement influencé par son utilisation dans le circuit des eaux de la carrière (point de prélèvement pour l’installation de traitement et point de rejet final à l’issue des bassins de décantation).
Le dôme piézométrique observé localement sur l’esquisse des hautes eaux 2015, entre les plans d’eau de la carrière et la Sarthe, provient de la présence d’une nappe perchée sur ce secteur qui emmagasine les eaux pluviales avant de les restituer progressivement à la nappe sous-jacente.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
96
6.3.3: EVOLUTION PIEZOMETRIQUE AU COURS DES ESSAIS
La chronique de référence :
Sur le secteur d’études, la ressource en eau souterraine se rencontre dans les terrasses alluviales de la Sarthe en continuité hydraulique avec les sables cénomaniens sous-jacents. La nappe des sables cénomaniens fait l’objet d’une surveillance piézométrique sur la commune d’Allonnes, à environ 6 km au Nord de la carrière. Le piézomètre n°BSS 03586X0145, positionné à une altitude de +54 m EPD, appartient au réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines de la Sarthe. Sa chronique piézométrique est présentée ci-dessous.
Cette chronique piézométrique permet d’apporter des précisions sur les variations annuelles et pluriannuelles de la nappe des sables cénomaniens :
La tendance d’évolution des niveaux piézométriques est plutôt stable à l’échelle globale de la chronique.
L’amplitude maximale des fluctuations piézométriques est de 2,4 mètres. Les plus hautes eaux connues depuis 1993 ont été enregistrées le 21 mars 2001 à +53,62 m NGF et la cote la plus basse le 13 septembre 2006 à +51,22 m NGF.
Les variations piézométriques saisonnières sur le piézomètre d’Alloonnes sont de l’ordre de 70 centimètres à un peu plus d’un mètre. Le phénomène de drainage par la Sarthe, qui s’écoule à environ 2,5 kilomètres à l’Est du piézomètre, tamponne les fluctuations de la nappe des sables cénomaniens.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
97
Entre octobre 2014 et mars 2015, une différence piézométrique de 16 centimètres a été enregistrée sur le piézomètre d’Allonnes. Ce relevé est cohérent avec les données issues des deux campagnes de mesures piézométriques réalisées à hauteur de la carrière.
La mesure de basses eaux 2014 (+52,31 m NGF), à la date de la campagne piézométrique à Spay, est supérieure de 1,09 mètres à la cote minimale connue en ce point de référence (+51,22 m NGF). A l’inverse, la mesure de hautes eaux 2015 (+52,47 m NGF), à la date de la campagne piézométrique à Spay, est inférieure de 1,15 mètres à la cote la plus haute connue (+53,62 m NGF).
→ L’état piézométrique général de la nappe des sables cénomaniens sur la période d’études, entre
septembre 2014 et janvier 2017, est dans la moyenne interannuelle vis-à-vis de l’historique connu.
Suivis sur la carrière :
Plusieurs dispositifs de suivi de la ressource en eau (4 piézomètres et 3 stations limnimétriques) ont servi à affiner les connaissances sur le contexte hydrogéologique local. Leur implantation est illustrée ci-dessous.
Localisation des points de suivi des niveaux d’eau
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
98
L’analyse des suivis, présentés ci-après, a été réalisée à partir de deux phases d’études principales permettant d’évaluer :
l’incidence de l’activité de la carrière sur les niveaux d’eau piézométriques et limnimétriques des plans d’eau, avec la prise en compte de l’action de la drague aspirante. Le rapport TA 14 046a relatif à cette phase d’études a été édité en février 2015 ;
l’incidence d’un essai de rabattement de nappe mené en vue de la demande de modification des conditions d’extraction du gisement. Cet essai a consisté en un pompage de 300 m3/h dans une fouille entre le plan d’eau des Plouses et Pz2. L’emplacement du point de pompage et des points de rejet est précisé sur la carte ci-dessus. Le rapport TA 14 046b relatif à cette phase d’études a été remis en avril 2016.
L’analyse des suivis a par ailleurs été couplée aux conditions pluviométriques et aux conditions hydrauliques de la Sarthe avec une attention particulière sur la période des écourues. Analyse générale des suivis Comportement général de la nappe Les suivis piézométriques rendent compte de la position des ouvrages vis-à-vis des écoulements, à savoir pour la partie amont Pz3 et Pz4 à des cotes similaires les plus élevées, Pz2 à des cotes intermédiaires et Pz1 dans la zone aval avec les cotes les plus basses. Cette configuration piézométrique confirme le sens d’écoulement général de la nappe c’est-à-dire Nord-Ouest/Sud-Est en direction de la Sarthe. Le comportement piézométrique et limnimétrique des plans d’eau est homogène, ce qui atteste de la
continuité « nappe/plan d’eau ».
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
100
Les observations essentielles sur l’évolution piézométrique naturelle de la nappe d’eau souterraine sur la carrière sont les suivantes :
Le niveau piézométrique en Pz1 varie en fonction du niveau de la Sarthe ;
Le niveau piézométrique en Pz2 évolue de manière similaire à celui du plan d’eau central (E2 : La Coyère) ;
Le niveau piézométrique en Pz3 est représentatif de l’évolution naturelle de la nappe sur le secteur amont ;
Le niveau piézométrique en Pz4 est lissé par le plan d’eau amont (E1 : l’Enfournoire).
Analyse couplée aux épisodes pluviométriques : La pluviométrie a une influence modérée voire difficilement perceptible sur les niveaux d’eau piézométriques et limnimétriques alors que le niveau de la Sarthe réagit d’une manière plus significative. Analyse couplée à la chronique piézométrique de référence : L’évolution piézométrique en Pz3, positionné à l’amont, est cohérente avec la chronique piézométrique de référence d’Allonnes. Par extrapolation, les cotes minimales et maximales piézométriques théoriques de la carrière peuvent être évaluées à partir des données caractéristiques de plus basses eaux et de plus hautes eaux connues au piézomètre de référence. Il en ressort les cotes piézométriques théoriques suivantes : : évaluation des cotes piézométriques théoriques de plus basses eaux et de plus hautes eaux de la carrière à
partir des données caractéristiques du piézomètre de référence d’Allonnes
Secteur / Période Basses eaux Hautes eaux
Amont (Pz4/Pz3) +38,8 / +39 m NGF +42,8 / +42,5 m NGF
Aval (Pz1) +37,4 m NGF +41 m NGF
Analyse des différents essais Phase 1 (rapport TERRAQUA : TA 14 046a) : La première phase d’étude a consisté à suivre l’évolution de la nappe et les incidences potentielles du fonctionnement de la carrière de septembre à décembre 2014 avec en particulier le fonctionnement de la drague-aspiratrice sur les quinze premiers jours du suivi.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
101
Cette phase d’étude a révélé qu’aucune influence en lien avec l’intensité des pompages dans l’étang
central et le fonctionnement de la drague aspirante n’a été perçue sur les suivis piézométriques et
limnimétriques mis en place et notamment en Pz2 et E3 qui sont les deux points de suivi les plus
proches de la base de loisirs « Le Houssay ».
Le rejet des eaux issues de l’installation de traitement et du fonctionnement de la drague-aspiratrice dans le circuit de décantation en position amont a compensé le prélèvement global du plan d’eau central. Cette gestion a permis d’assurer un équilibre entre prélèvements et rejets. Phase 2 (rapport TERRAQUA TA 14 046b) : Une seconde phase d’étude a été menée d’août 2015 à décembre 2015 pour étudier la possibilité de mettre en place une nouvelle méthode d’exploitation pour pouvoir atteindre et extraire les niveaux argileux et poursuivre ainsi l’extraction en eau des sables cénomaniens. Pour ce faire, un essai de rabattement de nappe de 300 m3/h sur une durée de 4 mois a été réalisé dans une fosse annexe au plan d’eau des Plouses, après autorisation de la Préfecture. Cet essai de rabattement de nappe a démontré l’absence d’incidence sur le secteur amont de la
carrière, du côté du hameau de La Perrée et du ruisseau du Buard (Pz3) et à l’Est, vers l’Enfournoire
(E1 et Pz4). Par ailleurs, il a mis en évidence une incidence piézométrique locale en aval de la carrière
(Pz2 et Puits du Port au Liard), qui a été en partie compensée par une gestion du rejet des eaux
pompées. L’exploitation avec rabattement de nappe est envisageable moyennant des mesures d’exploitation, de suivi et de gestion :
1. Le rejet est à étudier coté aval ;
2. Le rabattement de nappe devra être temporaire pour permettre une remontée sur les secteurs éventuellement influencés ;
3. Les suivis piézométriques devront être poursuivis sur les phases de pompage ;
4. Des cotes piézométriques de gestion seront définies.
Les points 3 et 4 ont été détaillés au chapitre « Mesures de protection proposée ». Phase 3 : analyse des écourues de la Sarthe : Les écourues de la Sarthe à hauteur de la carrière ont entrainé une baisse de 40 cm sur le niveau piézométrique Pz1, distant d’environ 100 mètres. L’effet accentué du drainage de la nappe, lié à l’abaissement de la Sarthe, a été moindre en Pz2. Globalement, le niveau d’eau de Pz1 évolue en fonction du comportement hydraulique de la Sarthe, signifiant que les berges ne sont pas colmatées et que les échanges nappe/rivière ne sont pas perturbés.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
102
6.3.4: REMONTEES DE NAPPE
Le risque de remontées de nappe, évalué à partir des données du BRGM, révèle une sensibilité très faible à faible sur l’essentiel de l’emprise du projet. En se rapprochant de la Sarthe, la sensibilité devient plus élevée.
Carte des risques de remontée de nappe: source BRGM
La comparaison entre les cotes piézométriques théoriques de plus hautes eaux sur la carrière et les cotes topographiques du terrain met en évidence le potentiel subaffleurant à affleurant de la nappe. Néanmoins, le drainage de la nappe par la Sarthe tamponne ses variations piézométriques saisonnières qui sont généralement de l’ordre d’un mètre.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
103
6.3.5: ASPECTS QUANTITATIFS
Masses d’eau souterraines identifiées au droit du site :
GG113 : Alluvions de la Sarthe : bon état quantitatif atteint en 2015 GG081 : Sables et grès du cénomanien sarthois libres et captifs : : bon état quantitatif atteint en 2015
Zonages réglementaires
La nappe des sables du Cénomanien couvre une surface d’environ 25 000 km². Ce réservoir constitue un
aquifère stratégique pour le bassin Loire-Bretagne.
Nappe à réserver à l’eau potable (NAEP) Selon la disposition 6E du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 intitulée « Réserver certaines ressources à l’eau potable », la masse d’eau souterraine FRGG081 pour partie est à réserver dans le futur à l’eau potable. Seul
le Cénomanien captif est concerné par cette disposition. A hauteur du projet la nappe du Cénomanien
n’est pas classée en NAEP. En relation hydraulique avec les alluvions de la Sarthe, elle est libre.
Zone de répartition des eaux (ZRE1) Le projet se situe en dehors de la ZRE délimitée pour la nappe du Cénomanien. Gestion sectorisée La gestion de la nappe du Cénomanien s’appuie sur une sectorisation basée sur la pression des prélèvements, la baisse piézométrique et des simulations prospectives d’un modèle réalisé en 2008 permettant de définir des orientations en termes de gestion. Le projet est situé en dehors des zones définies.
Usage des eaux souterraines
Les points d’eau répertoriés dans le proche environnement de la carrière à l’occasion des campagnes de mesures piézométriques sont localisés à la carte ci-après. Leur usage est précisé dans le tableau suivant.
1 Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau dans les zones présentant une insuffisance,
autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté
du préfet coordonnateur de bassin.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
105
Nature Lieu-dit X93 Y93 Z
(m EPD)
Profondeur
(m/margelle) Usage
Puits Enfournoire 489507 6762438 41 4,15 Jardin
Puits Enfournoire 489463 6762443 41 3,95 Aucun
Forage La Perrée 488648 6762519 45 20,0 Jardin/Agricole
Puits La Roche 488491 6762436 44 5,40 Jardin
Puits 11 route des Aulnays 487898 6762268 44 4,16 Jardin
Douves 34 rue d'Allones 487668 6762117 43 2,00 Jardin
Puits le Port au Liard 488338 6761358 40 3,78 Aucun
Puits Le Plouses 488233 6761982 41 7,23 Aucun
Puits 62 rue des Aulnays 488323 6762351 43 4,35 Aucun
Cinq points d’eau font l’objet de petits prélèvements ponctuels pour l’arrosage de jardin : 4 à l’amont de la carrière et 1 en aval. Le forage à la Perrée (en amont de la carriière) est utilisé également à des fins agricoles dans le cadre d’une exploitation de safran de 0,46 ha.
Le point nommé « St. Pomp. » sur la carte IGN à l’Ouest de la carrière TAVANO est une station de relevage pour l’assainissement de la base de loisirs du Houssay.
De plus, il est précisé qu’aucun prélèvement d’eau souterraine pour l’irrigation ou pour un usage industriel n’a été référencé dans le secteur de recherche. Captages d’eau potable Selon la cartographie du SAGE du bassin versant de la Sarthe aval aucun captage d’eau potable du type forage ou prise d’eau en rivière n’est répertorié dans le proche environnement de la carrière TAVANO à Spay. La Délégation départementale de la Sarthe, de l’Agence Régionale de Santé Pays-de-la-Loire, confirme l’absence de captage d’eau potable sur la commune de Spay et confirme qu’il n’y a pas de périmètre de protection sur la commune de Spay en provenance de captage présent sur des territoires voisins.
6.3.6: ASPECTS QUALITATIFS
Masses d’eau souterraines
GG113 : Alluvions de la Sarthe : bon état qualitatif atteint en 2015 GG081 : Sables et grès du cénomanien sarthois libres et captifs : : bon état qualitatif, objectif 2021.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
106
Référence qualitative
La qualité de la ressource en eau souterraine (BDLISA 123AB05 et Masse d’eau GG081) a été appréciée à partir d’un qualitomètre implanté à environ 11 kilomètres au Sud-Ouest de la carrière sur la commune de Cerans-Foulletourte. Le point de suivi est un forage de 35 mètres de profondeur (n°BSS 03931X0006) appartenant au réseau national de suivi au titre du contrôle sanitaire sur les eaux brutes pour la production d’eau potable. Il capte la nappe libre du Cénomanien. Les résultats d’analyses des principaux paramètres suivis en ce point sont affichés dans le tableau ci-dessous.
: Principaux résultats des analyses d’eau du qualitomètre n°BSS03931X0006 – source : ADES
Paramètres Nb de mesures Minimum Maximum Moyenne
Conductivité à 25°C (µS/cm) 4 444 509 466 Température (°C) 7 11,7 13 12,7
Oxygène dissous (mgO2/L) 3 5,2 6 5,7 Potentiel pH (pH) 9 6,25 6,6 6,5
Turbidité (NFU) 4 4,3 32 19,1 Fer (mg/L) 57 1,8 27,6 18,1
Arsenic (µg/L) 4 <5 10 9 * Zinc (µg/L) 5 <10 130 65,8 *
Nitrates (µg/L) 10 0,5 0,5 0,5 Atrazine (µg/L) 9 <0,01 <0,02 /
Atrazine Déséthyl (µg/L) 5 <0,01 <0,05 / Atrazine Déisopropyl (µg/L) 4 <0,01 <0,02 / Escherichia Coli (n/100 mL) 4 <1 <1 /
Entérocoques (n/100 mL) 7 0 <1 / *Moyenne sur valeur positive
Les données de ce qualitomètre montrent une nappe d’eau souterraine :
moyennement minéralisée ; qui possède une température cohérente avec les caractéristiques de l’aquifère ; bien oxygénée, en lien avec son caractère libre et sa faible profondeur ; légèrement acide ; sensible à la turbidité ; ferrugineuse au regard de la teneur moyenne ; qui peut contenir de l’arsenic et du zinc ; qui ne semble pas vulnérable aux pollutions diffuses par les nitrates, ni par les pesticides ; qui est préservée des contaminations bactériennes du type Escherichia Coli et Entérocoques.
La qualité d’eau de la nappe du Cénomanien est satisfaisante d’après les paramètres étudiés au
qualitomètre de Cerans-Foulletourte. Sur le secteur de la carrière, les échanges hydrauliques avec la nappe des alluvions de la Sarthe couplée aux relations nappe/rivière rendent la qualité des eaux souterraines plus vulnérable.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
107
Données de la carrière
Un prélèvement a été réalisé le 24 mai 2011 dans le plan d’eau central. Les résultats, sont présentés dans le tableau ci-dessous en comparaison avec des limites de qualité.
: Résultats des analyses d’eau de la carrière TAVANO
Paramètres Unité Résultats Seuil de qualité
Arrêté1 du 22/09/94
Potentiel pH pH 8,43 5,5<pH<8,5
Température °C 19,3 <30
Matière en suspension mg/L 19 <35
Demande chimique en
oxygène
mgO2/L 18 <125
Paramètres Unité Résultats Seuil de qualité
Arrêté2 du 11/01/07
Indice phénol mg/L <0,05 0,10 (1)
Chrome total mg/L <0,01 0,05 (1)
Chrome VI µg/L <30 ×
Cuivre mg/L <0,01 2 (2)
Nickel mg/L <0,02 0,02 (2)
Plomb mg/L <0,01 0,05 (1)
Zinc mg/L 0,059 5 (1)
Mercure µg/L <1 1 (1)
Arsenic µg/L <5 100 (1)
Cyanures µg/L <10 50 (1)
Tableau 1 : résultats des analyses d’eau de la carrière TAVANO
L’ensemble des résultats d’analyses est conforme au seuil de qualité pris en référence. Le dosage du zinc à 59 µg/L est comparable à la moyenne du suivi analytique du qualitomètre.
1 Arrêté du 22/09/94 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de
carrière.
2 Arrêté du 11/01/07 : (1) Limites de qualité des eaux brutes de toute origine, utilisées pour la production d’eau destinée à
la consommation humaine – (2) Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
108
6.3.7: SYNTHESE DU CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
Le contexte hydrogéologique local se caractérise par la présence de la nappe alluviale de la Sarthe en relation hydraulique avec la nappe des sables cénomaniens sous-jacents. Ce système-aquifère sablo-graveleux est drainé par la Sarthe selon un faible gradient hydraulique. Avec un niveau d’eau subaffleurant et un réservoir perméable, il est vulnérable aux activités anthropiques. Les variations piézométriques saisonnières, peu sensibles aux aléas climatiques, sont modestes en raison de l’effet de drainage de la Sarthe. Le suivi piézométrique amont s’apparente à la chronique piézométrique de référence d’Allonnes dont les données caractéristiques ont permis d’évaluer les cotes piézométriques théoriques de plus hautes eaux et de plus basses eaux au droit de la carrière. Les gravières créées par les activités d’extraction sont l’expression de la mise à jour des eaux souterraines comme le montre la cohérence entre les suivis limnimétriques et piézométriques. Les chroniques de suivi mettent également en évidence les relations « nappe/rivière », notamment à hauteur du secteur aval, mais aussi la continuité « nappe/plans d’eau » démontrant le libre écoulement des eaux au travers des berges non colmatées. D’un point de vue quantitatif, les deux masses d’eau souterraines alluviale et cénomanienne ont atteint le bon état en 2015. Le projet est situé dans un secteur où la nappe libre du Cénomanien n’entre dans aucun zonage réglementaire. Dans le proche environnement de la carrière, les usages des eaux souterraines sont voués à l’arrosage de jardins et à l’arrosage d’une exploitation de safran de 0,46 ha. Aucun usage industriel n’a été identifié et aucun périmètre de captage d’eau potable ne s’étend sur l’emprise du projet. La qualité de la ressource en eau souterraine est satisfaisante, le bon état ayant été atteint en 2015 pour la nappe alluviale mais reporté à 2021 pour la nappe du Cénomanien. Au qualitomètre, la nappe du Cénomanien se révèle préservée des pollutions diffuses par les nitrates et pesticides et des pollutions bactériennes. La qualité des eaux de la carrière, analysée en 2011, était par ailleurs conforme aux seuils de qualité pris en référence.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
109
7.1: QUALITE DE L'AIR
Source : Air Pays de la Loire (association de surveillance de la qualité de l’air en Pays de la Loire) La station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche se situe au Mans. Les éléments mesurés sont :
Le monoxyde d’azote (NO) Le dioxide d’azote (NO2) L’Ozone (O3) Les oxydes d’azote (NOx) Les particules fines PM 10 et PM 2,5.
On peut noter qu’une station à SPAY mesure uniquement la quantité d’Ozone.
7 : AIR ET CLIMAT
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
111
7.1.1: PRESENTATION REGIONALE
En Pays de la Loire, l’évolution des émissions de polluants atmosphériques présente une baisse générale, plus marquée cependant sur les polluants issus de la combustion, ce qui témoigne d’une amélioration des technologies
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
112
Consommation d’énergie
Les consommations d’énergie s’élèvent à environ 7 730 ktep en 2014, elles ont diminué de 4% entre 2008 et 2014 (9% en valeur par habitant)
Les transports routiers, le résidentiel et l’industrie sont les plus gros consommateurs, ils représentent respectivement 32%, 27% et 21% des consommations d’énergie finale. Les produits pétroliers représentent le principal combustible utilisé, ils comptent pour 46% dans les consommations d’énergie finale. Le poids du pétrole est principalement dû au secteur des transports routiers dans lequel il est largement majoritaire.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
113
Emissions des gaz à effet de serre
Les émissions de gaz à effet de serre de la région représentent 33 Mteq CO2 en 2014. L’agriculture est le premier secteur émetteur (34%) en raison des importantes émissions de methane de l’élevage et de protoxyde d’azote des cultures. La combustion des transports arrive ensuite avec 23%. Inventaire des émissions de polluants
Emissions par secteur en 2014
Les particules fines peuvent être de source naturelle (embruns , éruptions volcaniques, érosion eolienne…) ou anthropiques. Parmi les sources anthropiques, le secteur agricole et particulièrement les pratiques culturales, est le premier émetteur avec environ 40% des émissions.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
114
7.1.2: DONNEES LOCALES
Il n’existe pas aujourd’hui de sources importantes d’émission de gaz à effet de serre sur le site. Ces sources se limitent à l’utilisation d’engins motorisés agricoles ou d’extraction. Par ailleurs, l’occupation du sol au droit du site (sapinière - carrière) n’est pas facteur de consommation et de fixation de gaz à effet de serre, CO2 en particulier. La route départementale accueille un trafic trop faible pour qu’elle puisse avoir par elle même une influence sur l’émission de ces gaz. Au niveau de la carrière, les émissions de gaz à effet de serre peuvent être estimées à partir des émissions émises par les engins circulant sur le site. Seuls les engins présents sur le site émettent du CO2. En effet, la combustion du gasoil dans les moteurs produit 0,8591 tonne d’eqC par tonne de carburant consommée. Une pelle, une chargeuse et un tombereau évoluent sur le site, ainsi que 2 camions 8x4 et un semi remorque pour les évacuations de matériaux. La consommation moyenne annuelle de GNR est d’environ 50 000 litres par an. Avec une quantité de 42 tonnes de carburant consommé par an (masse volumique moyenne de 840
kg/m3), la production de gaz à effet de serre est de l’ordre de 36 tonnes d’équivalent carbone par an.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’activité n’est et ne sera pas susceptible d’avoir une influence
significative sur le climat ni sur le réchauffement climatique.
Les poussières
L’émission de poussières est étroitement liée aux saisons et aux conditions atmosphériques (sécheresse, vents). Sur l’exploitation, les matériaux sableux, compte tenu de leur nature et de leur mode d'extraction en eau, présentent un taux d'humidité naturel qui leur assure une cohésion suffisante pour limiter l'envol de poussières lors des opérations d'extraction et de chargement. Toutefois, par temps sec, de la poussière est générée par la circulation des engins sur les lieux d’extraction. Mais celle-ci reste confinée sur place au sein même de l’excavation et ne s’étend pas au-delà de l’emprise de l’exploitation Cette nuisance n’atteint pas le milieu humain alentour et ne gêne pas la fonction chlorophyllienne des végétaux situés sur le périmètre de l’exploitation. Au voisinage immédiat des terrains à exploiter, est présente une exploitation de safran, au lieu dit La Perrée, à environ une centaine de mètres de la limite Nord du site, en dehors des axes dominants du vent qui sont de secteurs sud-ouest et nord-est.
1 Source : Guide des Facteurs d’Emission, ADEME 2007
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
115
Le trafic routier peut quant à lui générer des envols de poussières par temps sec, notamment en cas de depots sur la voie publique. Des mesures sont en place pour maitriser ces aspects, elles seront détaillées dans le chapitre 7 relatif aux mesures de protection. En dehors du trafic routier normal qui est la source d’émissions de gaz d’échappement par les véhicules, il n’existe pas d’autre nuisance sur la qualité de l’air qui pourrait entraîner un risque pour la santé des personnes du secteur.
Le secteur bénéficie de fait d’une bonne qualité d’air. L’activité extractive existante ne dégrade pas cette qualité et le projet d’extension maintiendra cet état de fait, moyennant des précautions concernant la circulation des engins afin de lutter contre le risque d’envol des poussières.
7.2: CLIMATOLOGIE
Le climat a son importance vis-à-vis des phénomènes de dispersions de poussières, de la propagation des bruits et du régime des eaux. Les données climatologiques de la région ont été recueillies auprès de la station météorologique du MANS-ARNAGE.
Moyennes climatiques(période 1971 à 2000) :
JANVIER JUILLET moyenne mensuelle sur
l’année mini maxi mini maxi mini maxi
Températures moyennes mensuelles 1,8° C 7,6° C 13,7° C 24,9° C 7 16 DECEMBRE AOUT Total annuel moyen Précipitations moyennes mensuelles 70.9 mm 40.6 mm 686.8 mm DÉCEMBRE AOÛT Total annuel moyen Durées moyennes de l'insolation 53.4 heures 239.9 heures 1 728.4 heures
La pluviosité est conforme aux « règles » générales avec des mois d’été peu arrosés tandis qu’en hiver la pluviosité est importante : 71 mm en décembre. Le cumul sur l’année est en moyenne de 686,8 mm. Localement les températures sont dépendantes du relief, de la nature des sols, de la répartition des cours d’eau et des types de végétation. Ici, les éléments prépondérants dans le contrôle du climat est l’occupation du sol avec la succession de terre labourées et de boisement.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
117
Les vents dominants en fréquence, en force et en vitesse se situent de secteur SUD-OUEST et de secteur NORD-EST, comme le montre la rose des vents. Ils traduisent également une influence océanique surtout les vents les plus forts, liés aux perturbations océaniques. Fréquence des vents en fonction des groupes de vitesses :
Au-delà de 8m/s : 0.9 % de 5 à 8 m/s : 20.3 % de 2 à 4 m/s : 57.6 %
Les facteurs pouvant conduire à une modification locale du climat sont ici liés à l’occupation du sol ; en l’occurrence la juxtaposition d’un massif boisé et de parcelles cultivées, avec un sol régulièrement mis à nu. Cette opposition d’occupation des sols peut engendrer localement des différences de températures à l’origine éventuellement de mouvements d’air. Les superficies mises en jeux ne peuvent cependant pas provoquer des phénomènes perceptibles à l’échelle du climat local. Au droit du site, il n’existe pas d’éléments morphologiques qui pourraient avoir une influence sur le climat.
7.3: CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), dans son rapport publié en 2014, indique que réchauffement du système climatique est sans équivoque. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des mers s’est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté. Les projections pour les prochaines décennies (2016-2035), il est probable que l’élévation de la température moyenne à la surface du globe soit supérieure à 1°C. Les experts retiennent une évolution de la température pouvant entraîner des bouleversements de la circulation des masses d’air sans retenir pour autant un accroissement ou une diminution des précipitations annuelles mais plutôt un accroissement de l’intensité et de la fréquence des phénomènes extrêmes.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
118
A l’échelle européenne, les principaux changements prévus sont une intensification des précipitations extrêmes lors des tempêtes et une diminution de la fréquence des précipitations. Selon l’Agence Européenne de l’Environnement (EEA), les épisodes pluvieux intenses devraient aussi être plus fréquents et plus violents, et les vagues de chaleur plus régulières, pour atteindre une fréquence de deux ans en moyenne pendant la deuxième moitié du XXIe siècle. Selon le Guide pratique du changement climatique de l’Ademe (mai 2015), à l’échelle de la France, les effets se traduisent selon les scenarios d’émissions de gaz à effet de serre (scenarios optimiste et pessimiste selon le niveau de maîtise des émissions) comme suit :
L’augmentation des températures moyennes d’ici 2100 se situerait entre 2°C et 3,5°C.
La baisse des précipitations moyennes de printemps et d’été paraît certaine (10% au maximum vers 2050), particulièrement dans le Sud-Ouest. Les résultats pour les pluies d’hiver et d’automne sont plus fluctuants.
Les extrêmes plus marqués : les jours très chauds (dépassant de 5°C la moyenne) vont être plus nombreux : de 36 aujourd’hui, ils passeraient vers 2030 à plus de 40 (scénario optimiste) ou à plus de 70 (scénario pessimiste). Dans le Sud-Est, cette hausse devrait être plus importante : vers 2090, il est prévu 80 jours très chauds supplémentaires par rapport à la moyenne actuelle. Toutes les régions subiront des sécheresses estivales plus longues. Les résultats restent incertains concernant les pluies très intenses et les vents violents.
Les effets se traduisent sur la répartition des espèces animales, sur le niveau de la mer (d’ici 2100, l’augmentation moyenne pourrait être de 20 à 43 cm dans le scenario optimiste) et les cours d’eau, avec des debits d’étiage plus précoces et plus prononcés et un réchauffement de l’eau (qui influent sur les systemes aquatiques, la resource en eau, les capacités d’irrigation de l’agriculture) et une augmentation des débits en hiver, Les impacts sont synthétisés sur la carte ci-après.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
119
Source : Réseau Climat 2015
Aucun impact n’est mis en évidence dans le département de la Sarthe, la zone n’est pas située en risque majeur de sécheresses plus intenses. Elle ne présente donc pas de vulnérabilité notable au changement climatique. Les conséquences pour le projet, qui peuvent résulter d’épisodes pluvieux intenses plus fréquents et de périodes séches prolongées sont pris en compte dans les chapitres relatifs aux incidences du projet et aux mesures (chapitre 4 et 7).
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
120
8.1: AXES DE COMMUNICATION
Sources : Données du Conseil Général et de la commune (PLU)
8.1.1: RESEAUX PRINCIPAUX ROUTIERS ET FERROVIAIRES
Les principales voies de communication de proximité desservent l’agglomération du Mans :
l’A111, à l’ouest de SPAY, à environ 8 km, qui se poursuit par la RD 326 (contournement sud du Mans)
la RD 326, située à environ 1 km au nord de la carrière,
la RD 323, orientée nord sud, qui part de la RD 326 et qui rejoint La Flèche. Cet axe situé entre la carrière et le bourg de SPAY, passe à 200 m de la limite ouest de la zone d’extension du site,
La RD 147 de l’autre coté de la Sarthe par rapport à la carrière, rejoint, à partir de la RD 323, l’agglomération mancelle par Arnage,
la ligne SNCF Le Mans Tours, en rive gauche, qui passe par Arnage.
8.1.2: RESEAU FLUVIAL
La Sarthe constitue un axe fluvial majeur de la région. La Sarthe a été navigable du Mans jusqu’à sa confluence avec la Mayenne mais pour des gabatits de faible tonnage, jusqu’au début des années 1970. Aujourd’hui la Sarthe est réservée au tourisme fluvial et connait une navigation de plaisance et le trafic commercial à complètement disparu.
8.1.3: RESEAU AERIEN
L’aérodrome le plus proche est celui du Mans qui accueille les vols commerciaux ainsi qu’un aéro club « Les ailes du Maine Avion ». il est distant de 2,5 km environ des terrains étudiés (au nord-est).
1 A : Autoroute
8 : BIENS MATERIELS
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
121
8.1.4: TRAFICS SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES
Spay est traversé par deux axes majeurs, la RD 323 et la RD 326 qui se rejoignent au niveau de l’échangeur de Monné au nord de la commune. Cet échangeur permet la desserte du territoire de Spay, son bourg, les zones d‘activités du Monné et de la Rouvelière au nord. La RD 51, d’axe nord/sud, Allones-Spay et la RD 212, axe est/ouest, Voivres-les-le-Mans-Spay, viennent compléter le maillage.
La carrière prend directement accès sur la RD 323 par une bretelle routière.
Précisons que la RD 323 et la RD 326 sont classées à grande circulation (décret du 31 mai 2010).
Extrait de carte du trafic moyen journalier (tous véhicules) 2015
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
122
Extrait de carte du trafic poids lourds moyen journalier 2015
8.2: RESEAUX DE DISTRIBUTION
8.2.1: EAU POTABLE
Aucune canalisation d’eau potable ne passe sur les terrains du projet.
: Réseau d’alimentation en eau potable
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
123
8.2.2: EAU PLUVIALE
Au nord du site, l’axe d’écoulement des ruissellements est le ruisseau du Bruard. Au droit du site, il n’existe pas de réseau d’eau pluviale ou de drainage sur les terrains étudiés. Les eaux de ruissellement convergent gravitairement de façon diffuse vers les bassins ou s’infiltrent dans le sol.
8.2.3: ELECTRICITE
Plusieurs lignes électriques passent au droit ou à proximité des terrains actuels et de l’extension. Des poteaux EDF sont présents sur le site. La petite parcelle enclavée dans l’extension du plan d’eau principal supporte aussi un poteau EDF, l’accès à ce poteau comme à tous les autres sera maintenu. Source Géoportail Source PLU
Précisons qu’une ligne alimente le transformateur présent sur le site. Cette ligne passse le long de la voie communale desservant le lieu dit l’Enfournoire.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
124
8.2.4: TELEPHONE
Une ligne aérienne longe la VC n°9 jusqu’à l’enfournoire. Cette ligne dessert aussi la carrière.
8.2.5: TRANSPORT DE PRODUITS DANGEREUX
Les terrains du projet ne sont pas concernés par le transport de gaz ou de produits pétroliers.
8.3: BATI, EQUIPEMENTS ET TERRAINS
Ces aspects ont été developpés aux paragraphes précédents, pour ce qui concerne le bâti (paragraphe 1.2), les équipements artisanaux et industriels (paragraphes 2.4 et 2.5), les capatges d’eau potable (paragraphe 6.3.5) et les terrains agricoles et forestiers (paragraphes 2.2 et 2.3). On rappellera ici qu’ils sont constitués par :
les habitations, dont les plus proches (à L’Enfournoire) sont à 20 m de l’emprise (et à 200 m de l’accès) ;
le lieu-dit “La Perrée”, à 100 m au nord: petite zone d’activité industrielle Les éléments du patrimoine culturel, historique et archéologique, font l’objet du paragraphe 9. Les plus proches sont :
L’église Sainte Anne de Spay: le choeur et la nef abritent du mobilier classé.
Le presbytère. Les grands Bizerays:
chateau de l’époque féodale démoli à la fin du XVI ème siècle.
Les vestiges archéologiques recensés ou pressentis.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
125
9.1: PATRIMOINE HISTORIQUE
Sources : Atlas du patrimoine en ligne Base Mérimée Rapport du Plan Local d’Urbanisme Il n’y a pas d’édifices au titre des Monuments Historiques sur la commune de SPAY ou aux alentours proche du site. Il existe cependant sur la commune de SPAY d’autres éléments bâtis anciens remarquables qui ne sont pas protégés au titre de la législation sur les Monuments Historiques, comme par exemple :
l’église Sainte Anne de SPAY, dont une partie de la Nef remonterait au IXème siècle, l’autre daterait de la fin du XIème début XIIème siècle,
le Presbytère, copnstruit au XVIIème siècle est l’un des bâtiments les plus importants du bourg,
Les Grands Bizerays, chateau à l’époque féodale. Seule subsiste à ce jour la ferme attenante à la large façade sud, ses grandes ouvertures et sa tour carrée,
Le four à chanvre à “la Vaudelle”,
Le moulin datant de 1595.
9.2: PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Des entités archéologiques sont actuellement recensées sur le territoire de SPAY par la DRAC. Il s’agit :
d’un habitat fortifié et une enceinte d’époque indéterminée au lieu-dit Les Grands Bizerays ; de l’église de SPAY présentant des vestiges du XIième siècle ; d’un habitat fortifié d’époque médiévale au lieu-dit les Grands Martrais.
Différents indices tendent à préssentir la présence d’autres sites archéologiques :
des traces de construction en terre cuite d’époque gallo romaine au lieu dit La Lande ; d’un habitat fortifié d’époque médiévale au lieu-dit les Brosses.
9 : PATRIMOINE CULTUREL
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
127
Le paysage est marqué par la vallée de la Sarthe qui forme une unite paysagère à part entière.
La dimension horizontale est prépondérante, avec un relief particulièrement plan ce qui limite les larges panaoramas.
10 : PAYSAGE
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
128
10.1: DESCRIPTION DE L’ENTITE PAYSAGERE
L’entité paysagère de la Vallée de la Sarthe présente une dimension horizontale prépondérante du fait de son relief particulièrement plan. Cette impression est sensible particulièrement depuis les routes en lignes droites. Bien que peu directement perçue, la présence de l’eau est sensible indirectement car soulignée par des prairies verdoyantes et des espèces arborées spécifiques. Le contraste est particulièrement saisissant en fin d’été entre les paysages verdoyants des vallées et les camaïeux de jaunes-bruns des cultures. Les limites de cette unité paysagère sont très progressives avec les autres unités. L’eau le dénominateur commun :
La vallée de la Sarthe, creusée dans les sables cénomaiens, est très largement évasée avec un fond rendu particulièrement plan par les abondants dépots fluviaux. Cette vallée forme une grande dépression centrale qui est une caractéristique morphologique structurante du département. Les crues de la Sarthe, avec ses inondations récurentes génèrent des paysages inondés remarquables. Bien que la présence de l’eau soit partout sensible, le cours d’eau se fait discret, souligné par les peupleraies qui jalonnent le cours d’eau mais aussi par le caractère verdoyant des prairies. La dimension anthropique est aussi largement présente, cette dépression centrale ayant aussi été un espace privilégié pour les implantations humaines, et les axes de transport. Aujourd’hui les infrastructures ont un impact visuel majeur, souligné par les importants remblais portant les différentes voies, voie SNCF notamment sans oublier poteaux et lignes électriques. Cette dimension anthropique est essentiellement développée sur la région du Mans, correspondant à un espace urbanisé en évolution.
Extrait de la carte de synthèse des paysages de la vallée de la Sarthe
Site
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
129
Au niveau du site, enclavé entre deux secteurs très urbanisés que sont les bourgs de SPAY à l’ouest et d’Arnage à l’est, on retrouve les grandes lignes du paysage, avec un relief plan, et la Sarthe que l’on perçoit plus qu’on ne voit. La dimension anthropique est très présente par les poteaux et les lignes électriques aériennes qui zèbrent le paysage mais aussi par les différents plans d’eau, témoins d’une exploitation du sous sol depuis de nombreuses années et qui perdure actuellement.
Sarthe 1eres maisons Arnage
Piste Zone d’extension sud
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
130
10.2: ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX
10.2.1: MONUMENTS HISTORIQUES
La carrière actuelle et son extension ne seront visibles d’aucun des batis anciens présents et listés ci-avant. Rappelons qu’il n’y a pas de site inscrit à proximité de la carrière.
10.2.2: VISIBILITE
De part le relief très plat, la visibilité sur la carrière est quasi nulle. Seules quelques habitations de proximité auront un visuel sur le site en exploitation comme les lieux-dits l’enfournoire et les Pelouses. La végétation présente en bord de Sarthe, au niveau des quelques haies présentes et la pinède forment autant d’écrans visuels. Rappelons de plus que le secteur de la carrière, entre la RD 323, à forte circulation et la Sarthe ne comporte que très peu d’habitations, une partie des terrains en bord de la Sarthe étant d’ailleurs en zone inondable.
10.2.3: ENJEUX
D’un point de vue paysager les enjeux du site restent faibles, l’activité actuelle étant déja présente et très peu visible. Seuls les stocks de matériaux ressortent dans le paysage par leur couleur et leur hauteur. Les principaux enjeux paysagers qui ressortent de l’étude de l’état initial sont les suivants :
le maintien des écrans boisés existants en périphérie du site; la bonne intégration des différents plans d’eau, qui à terme seront regroupés pour ne former que
trois grands plans d’eau diminuant l’impression de morcellement.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
131
L’évaluation des interrelations entre les facteurs mentionnés à l’article L122-1 prévue à l’article R122-5 a été supprimée par le décret 2016-1110 du 11 août 2016. Cependant, nous donnons les grandes lignes ci-après. L’implantation de la carrière et son extension est directement liée à la géologie locale, alluvions de la Sarthe et formation des sables cénomaniens présentant des caractéristiques favorables à la fabrication des bétons notamment. L’exploitation bénéficie de la proximité immédiate des voies de communication majeures de l’agglomération mancelle avec un accès aménagé quasi direct sur ces voies. L’habitat est essentiellement regroupé autours des bourgs. Enfin, la diversité écologique est à mettre en relation avec la diversité des habitats présents dans la zone d’étude, notamment dans la sablière actuelle. Les enjeux fonctionnels pour la faune sont quant à eux en lien avec l’occupation du sol (plans d’eau de profondeurs variables, zones de haut fond, …)
11 : INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS DU CHAPITRE
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
Chapitre 2
132
Enjeux Commentaires
Population et santé humaine
L’enfournoire, les Pelouses, La Perrée Enjeu fort du fait de la proximité du projet : Enfournoire : habitation située à 20 m de la limite d’emprise
Les Pelouses : Habitations sur la presqu’ile au milieu du plan d’eau des Pelouses : à 180 m de la future zone d’exploitation
La Perrée : un centaine de mètres au nord de l’emprise
Autres habitations et bâtiments occupés par des tiers Enjeu faible : habitations éloignées des zones en exploitation sans visuel sur le site, sans trafic routier induit
Activités économiques et espaces de loisirs
Agriculture Enjeu faible enjeu faible : pas de surface agricole touchée par l’exploitation
Sylviculture Enjeu faible : valeur économique faible de la pinède en raison de la faible représentation de bois d’œuvre et la faible proportion de sol de qualité et pinède appartenant à Mme TAVANO
Activités des Carrières Tavano Enjeu moyen à fort en termes d’emplois directs et indirects, d’approvionnement du marché régional de la construction, et de la
maîtrise des coûts du béton (centrale à proximité immédiate, diminution des émissions de CO2 et des gaz à effet de serre)
Autres activités Enjeu moyen vis à vis de l’exploitation de safran au Pérrée. Enjeu faible vis-à-vis des activités industrielles proches (zone du Pérrée au nord de l’emprise) Cf. alinéa suivant pour l’enjeu lié à l’activité de pêche de loisir sur l’étang voisin
Espaces de loisirs Enjeu fort vis à vis de l’hydraulique, lié à la présence de la base du Houssay, au sud ouest du site, principalement de l’autre côté de
la RD 323 et plan d’eau de pêche à proximité du Port au liard
Enjeu faible vis à vis du plan d’eau de pêche voisin du comité d’entreprise de l’établissement Garczynski
Biodiversité
Secteur de la carrière actuelle Enjeu globalement fort, Nombreuses espèces et habitats interessants liés à la présence de la carrière générant des habitats
différenciés, nombreux aménagements prévus
Secteur de l’extension Enjeu globalement moyen: zone humide sur la partie sud de l’extension
Terres et sols
Topographie Enjeu faible : peu de variation topographique, paysage très plan
Géologie Enjeu fort pour l’approvisionnement en matériaux des entreprises locales
Pédologie Enjeu faible en raison de la qualité des sols de la pinède et la faible surface représentée
Etat des sols Pas d’enjeu de pollution de sols au droit de la carrière
12 : BILAN DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 3
Chapitre 2
133
Enjeux Commentaires
Eaux Eaux superficielles Enjeu faible : pas d’interférence directe avec la masse d’eau de la Sarthe ou avec le ruisseau du Buard
Eaux souterraines Enjeu fort lié au projet temporaire de rabattement de nappe et au maintien de la relation “nappe/rivière”
Air et climat Qualité de l’air Enjeu faible: pas de secteur sensible affiché en terme de qualité de l’air
Climat Enjeu faible à l’échelle du projet
Biens matériels
Bâti Enjeu moyen du fait de la présence de constructions à proximité du projet
Voies de communication Enjeu moyen lié à la présence de la voie communale desservant la carrière
Réseaux de distribution Enjeu fort lié à présence de poteaux et lignes électriques
Patrimoine culturel Monuments historiques Enjeu nul : pas de monument historique ou monument interressant à proximité de la carrière ou ayant un visuel avec cette dernière
Archéologie Enjeu nul : pas de site archéologique recensé, faible superficie à décaper (zone d’extension)
Paysage
Boisements Enjeu faible lié aux boisements en bordure de la Sarthe : le défrichement n’engendre pas de modification de perception au niveau de la vallée.
Topographie Enjeu faible: Secteur très plan, la création et l’agrandissement de plans d’eau ne génèrent pas de modification visuelle importante du relief
Visibilité Enjeu faible : site quasiment pas perceptible en dehors des habitations de proximité (Les Pelouses notamment et l’Enfournoire pour partie).
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
135
CHAPITRE 4 :
DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
137
SOMMAIRE
Page
1: PREAMBULE : PRINCIPE D’EVALUATION DES INCIDENCES ................................... 141
1.1: DEFINITIONS ................................................................................................................................... 141
1.1.1: - Les effets directs : .................................................................................................................. 141
1.1.2: - Les effets indirects secondaires : .......................................................................................... 141
1.1.3: - Les effets temporaires : ......................................................................................................... 142
1.1.4: - Les effets permanents : ......................................................................................................... 142
1.1.5: - Les effets cumulatifs : ............................................................................................................ 142
1.2: FACTEURS PRIS EN COMPTE ............................................................................................................. 143
1.3: EFFETS CUMULES ........................................................................................................................... 143
2: EFFETS SUR LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE .......................................... 144
2.1: INCIDENCE ACOUSTIQUE .................................................................................................................. 144
2.1.1: Sources de bruit ....................................................................................................................... 144
2.1.2: Reglementation ........................................................................................................................ 144
2.1.3: 1.1.3.1 Niveaux acoustiques du matériel employé .................................................................. 146
2.1.4: Influence e l’exploitation sur le niveau sonore résiduel ........................................................... 146
2.2: VIBRATIONS - PROJECTIONS ............................................................................................................ 148
2.3: EMISSIONS LUMINEUSES.................................................................................................................. 148
2.4: CHALEUR ET RADIATION .................................................................................................................. 149
2.5: EFFETS SUR LA SECURITE PUBLIQUE ................................................................................................ 149
2.6: AMIANTE ........................................................................................................................................ 150
2.6.1: Rappel concernant l’amiante naturel ....................................................................................... 150
2.6.2: Situation sur la carrière ............................................................................................................ 151
2.7: EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE ...................................................................................................... 152
2.7.1: Identification des substances ou émissions à effet potentiel sur la santé des populations ..... 153
2.7.2: Potentiel d’exposition des populations aux substances ........................................................... 154
2.7.3: Effets néfastes potentiels de chaque substance sur la santé .................................................. 157
2.7.4: Niveau d’exposition des populations et caractérisation des risques sanitaires ....................... 160
3: EFFETS SUR LES ACTIVITES ET LES ESPACES DE LOISIRS .................................. 167
3.1: AGRICULTURE................................................................................................................................. 167
3.1.1: Effet sur la surface agricole communale .................................................................................. 167
3.1.2: Effets sur les exploitations agricoles ........................................................................................ 167
3.2: SYLVICULTURE ............................................................................................................................... 168
3.3: AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES .................................................................................... 168
3.4: LOISIRS .......................................................................................................................................... 169
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
138
4: EFFETS SUR LES BIOCENOSES, LES HABITATS NATURELS ET LES EQUILIBRES
BIOLOGIQUES ...................................................................................................................... 169
4.1: EFFETS DIRECTS ............................................................................................................................. 169
4.2: EFFETS INDIRECTS .......................................................................................................................... 171
4.2.1: Effets indirects négatifs abiotiques .......................................................................................... 171
4.2.2: Effets indirects négatifs biotiques ............................................................................................ 172
4.3: EFFETS SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES............................................................................... 175
4.4: INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 ........................................................................... 178
5: EFFETS SUR LES TERRES ET LES SOLS .................................................................. 180
5.1: TOPOGRAPHIE ................................................................................................................................ 180
5.2: SOLS .............................................................................................................................................. 180
6: EFFETS SUR LES EAUX ............................................................................................... 181
6.1: MODES ET CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT EN EAU .................................................................... 181
6.2: INCIDENCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES .......................................................... 182
6.2.1: incidence volumétrique ............................................................................................................ 182
6.2.2: Incidence piézométrique .......................................................................................................... 183
6.3: EFFETS SUR LA QUALITE DES EAUX .................................................................................................. 184
6.4: INCIDENCE SUR LES USAGES DES EAUX SOUTERRAINES .................................................................... 185
6.4.1: Captages d’alimentation en eau potable .................................................................................. 185
6.4.2: Etangs de pêche de loisir ......................................................................................................... 185
6.4.3: Autres usages .......................................................................................................................... 186
7: EFFETS SUR L’AIR ET LE CLIMAT .............................................................................. 186
7.1: EFFET SUR L’AIR ............................................................................................................................. 186
7.1.1: Poussières................................................................................................................................ 186
7.2: REJETS ATMOSPHERIQUES, FUMEES ET ODEURS ............................................................................. 188
7.2.1: Les rejets atmosphériques ....................................................................................................... 188
7.2.2: Odeurs et fumées ..................................................................................................................... 188
7.3: EFFET SUR LE CLIMAT ..................................................................................................................... 189
7.3.1: Equilibre thermique des masses d’air ...................................................................................... 189
7.3.2: Consommation énergétique ..................................................................................................... 190
7.3.3: Effet sur le climat local ............................................................................................................. 191
7.3.4: Vulnérabilité du projet au changement climatique ................................................................... 192
8: EFFETS SUR LES BIENS MATERIELS ........................................................................ 192
8.1: EFFETS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION ..................................................................................... 192
8.1.1: Effets sur l’organisation spatiale des itinéraires ....................................................................... 192
8.1.2: Fréquentation des voies publiques .......................................................................................... 193
8.2: RESEAUX DE DISTRIBUTION ............................................................................................................. 194
8.3: STABILITE DES TERRAINS ................................................................................................................. 194
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
139
8.4: BATI ............................................................................................................................................... 195
9: EFFETS SUR LE PATRIMOINE..................................................................................... 195
9.1: MONUMENTS HISTORIQUES - SITES INSCRITS OU CLASSES................................................................. 195
9.2: ARCHEOLOGIE ................................................................................................................................ 195
10: EFFETS SUR LES SITES ET LE PAYSAGE ET LES PERCEPTIONS VISUELLES ..... 196
10.1: EFFETS SUR LE PAYSAGE ................................................................................................................ 196
10.2: EFFETS SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES ....................................................................................... 197
10.2.1: Possibilités de vue statique: ................................................................................................ 197
10.2.2: Possibilités de vue dynamique: ........................................................................................... 198
10.3: EFFETS SUR LES MONUMENTS ET LES SITES DU BASSIN VISUEL .......................................................... 198
11: IMPACT DE LA PHASE DE TRAVAUX PRELIMINAIRES A L’EXPLOITATION ........... 200
12: EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS ........................................ 201
13: BILAN DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS OU INDIRECTS SECONDAIRES,
TEMPORAIRES OU PERMANENTS ..................................................................................... 203
14: EFFETS CUMULATIFS .................................................................................................. 208
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
141
1: PREAMBULE : PRINCIPE D’EVALUATION DES INCIDENCES
Ce chapitre traite des incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 étudiés au chapitre 3 qui résulteraient du projet en l’absence de mesures adaptées. L’exposé de ces mesures fait l’objet du chapitre 7. Conformément à la réglementation en vigueur, ce chapitre porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers (sans objet ici compte tenu de la localisation du projet), à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.
1.1: DEFINITIONS
Les définitions ci-après sont celles du glossaire du développement durable (Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement - Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les Constructions).
1.1.1: - LES EFFETS DIRECTS :
Ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps. Ils affectent l’environnement proche du projet. Ils peuvent être structurels : effets directs liés à la construction même du projet : la consommation d’espace due à l’emprise du projet, la disparition d’espèces végétales ou animales, la perte d’éléments du patrimoine culturel, la modification du régime hydraulique, les atteintes au paysage, les nuisances au cadre de vie des riverains. Ils peuvent être fonctionnels : les effets fonctionnels sont des effets directs liés à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement : pollution de l’eau, de l’air et du sol, production de déchets divers, modification des flux de circulation, risques technologiques…
1.1.2: - LES EFFETS INDIRECTS SECONDAIRES :
Ils résultent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Ils peuvent être en chaîne : effets indirects qui se propagent à travers plusieurs compartiments de l’environnement (eau, sol, air, espèces vivantes) ou induits : effets indirects générés par le projet, notamment sur le plan socio-économique.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
142
1.1.3: - LES EFFETS TEMPORAIRES :
Ces effets ne se font ressentir qu’à court terme ; ils sont limités dans le temps, soit parce qu’ils disparaissent immédiatement après cessation de la cause, soit parce que leur intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître.
1.1.4: - LES EFFETS PERMANENTS :
Ces effets persistent dans le temps à moyen ou long terme et peuvent demeurer immuables, en perdurant au-delà de la phase d’exploitation du projet.
1.1.5: - LES EFFETS CUMULATIFS :
Ils sont le résultat du cumul et de l'interaction de plusieurs effets directs et/ou indirects générés par le projet sur les facteurs de l’environnement. Un effet est considéré comme positif s’il est bénéfique pour l’environnement physique, naturel ou humain. Il est négatif s’il conduit à un changement dommageable. L’effet décrit une conséquence, indépendamment du territoire concerné. L’incidence (ou impact) est la transposition de l’effet sur une échelle de valeur ; elle traduit le résultat du croisement entre l’effet et la sensibilité des composantes environnementales. Aussi, un effet peut avoir ou non une incidence, selon l’enjeu. Dans le cadre du présent projet, les seuls effets susceptibles de perdurer au-delà de la phase d’exploitation du projet (après la phase de remise en état finale des terrains) concernent essentiellement les thématiques suivantes : l’eau, les sols, les milieux naturels, l’agriculture, les biens matériels (chemins), la topographie et le paysage. Les autres effets, tels que le bruit, les vibrations, les émissions atmosphériques (poussières et gaz) et les émissions lumineuses sont des effets temporaires, qui cesseront après arrêt de l’activité.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
143
1.2: FACTEURS PRIS EN COMPTE
Conformément à la réglementation en vigueur, l’évaluation des incidences tient compte :
des technologies et substances utilisées, dont découlent des effets directs et indirects éventuels tels que l’émission de bruit, de lumière, la chaleur et la radiation, la production de déchets, pouvant être à l’origine de nuisances,
des différentes phases du projet : aménagements préparatoires, phase opérationnelle et la remise en état,
de l’utilisation et de la disponibilité durable des ressources naturelles, en particulier des terres, du sol, de l’eau et de la biodiversité,
de la vulnérabilité du projet au changement climatique. Cet aspect est pris en compte dans l’étude sur les eaux et dans l’analyse des risques d’envols de poussières.
1.3: EFFETS CUMULES
Ce chapitre traite également des éventuels effets en lien avec le projet conformément à l’article L.181-1 du Code de l’environnement, rédigé comme suit : « L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. » Par contre, et pour rappel, les activités industrielles proches existantes, et autorisées au titre de la réglementation sur les installations classées à la date de dépôt du dossier sont intégrées à l’état initial. Sont également traités dans ce chapitre les effets cumulés du projet objet du dossier avec d’autres éventuels projets connus à la date de dépôt du présent dossier et ayant fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.181-141 et d’une enquête publique ou d’un avis de l’autorité environnementale rendu public.
1 Projet soumis à étude d’incidence et non à étude d’impact
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
144
2: EFFETS SUR LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE
Ce paragraphe s’attache à exposer les effets sur la population résultant du fonctionnement de l’activité. L’impact visuel est étudié au paragraphe 10.
2.1: INCIDENCE ACOUSTIQUE
2.1.1: SOURCES DE BRUIT
Les sources de bruit liées au projet seront imputables :
aux travaux ponctuels de défrichement qui seront réduits à un mois environ au cours de la troisième phase quinquennale d’exploitation,
aux travaux périodiques de décapage de la découverture au moyen d’une pelle mécanique, et de dumpers pour le transport vers les zones de stockage ou à remettre en état,
à l’extraction du gisement par pelle hydraulique ou drague aspiratrice, au fonctionnement de l’installation de criblage-lavage des matériaux, au trajet du dumpers sur le site pour alimenter l’installation de traitement.
L’effet sur le niveau sonore sera effectif durant la période d’activité de la carrière, à savoir du lundi au vendredi (hors jours fériés), dans la période comprise au maximum entre 7h et 17h30. Des opérations de maintenance pourront avoir lieu éventuellement le samedi.
Il n’y aura aucune modification des sources sonores par rapport à l’activité actuelle. Le seul changement prévu concerne le remplacement de l’ancienne installation par une plus récente, mais de capacité équivalente, le niveau sonore sera donc semblable.
2.1.2: REGLEMENTATION
Les activités d’extraction sont soumises à la réglementation visant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), qui sont régies en matière de bruit par :
l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié par l’Arrêté Ministériel du 24 janvier 2001, l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement
par les ICPE, l’Arrêté Préfectoral d’autorisation du site.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
145
Les émissions sonores de l'exploitation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées par ces arrêtés, dans les zones où l'émergence est réglementée. Notion d’émergence L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés (niveaux de pression continus équivalents pondérés A) lorsque l'ensemble de l'installation est en fonctionnement et lorsqu'il est à l'arrêt. Les Zones à Emergences Réglementées (ZER) représentent :
l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),
les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation,
l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'Arrêté d'autorisation, dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse…).
L'Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié La carrière est soumise aux prescriptions de l'Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994, modifié par l'Arrêté Ministériel du 24 janvier 2001 qui stipule dans son article 3 que "les dispositions relatives aux émissions sonores des carrières sont fixées par l'Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations Classées pour la Protection de l'Environnement." L'Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 Il fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation et définit la méthode de mesure applicable.
Tableau 1: Valeurs admissibles fixées par l'Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 (art. 3)
Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'établissement)
Émergence admissible
pour la période diurne
allant de 7h à 22h, sauf dimanches et
jours fériés.
Émergence admissible
pour la période nocturne
allant de 22h à 7h ainsi que pour les
dimanches et jours fériés.
Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur ou égal à 45 dB(A) 6,0 dB(A) 4,0 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5,0 dB(A) 3,0 dB(A)
L'Arrêté Préfectoral d'autorisation fixera les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
146
L’Arrêté Préfectoral d’autorisation en vigueur (23/02/2007), articles 8.1
- Les émergences fixées par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 seront respectées, - Le bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser 70 dB(A) en période jour et
60 dB(A) pour la période nuit, - Un contrôle sonore est réalisé tous les 3 ans, au niveau de l’Enfournoir et des Pelouses.
2.1.3: 1.1.3.1 NIVEAUX ACOUSTIQUES DU MATERIEL EMPLOYE
Les niveaux sonores issus des travaux de V. ZOUBOFF (CETE d'ANGERS) et établis à partir de cas réels, donnent, pour des mesures effectuées à 30 m des engins de chantier et matériels, les ordres de grandeurs suivants :
- pelle mécanique : 46 à 54 dB(A), - drague aspiratrice : 45 à 50 dB(A), - tombereau en charge ou camion : 50 à 55 dB(A), - installation de traitement : 70 dB(A), - chargeur : 50 à 55 dB(A).
2.1.4: INFLUENCE E L’EXPLOITATION SUR LE NIVEAU SONORE RESIDUEL
L'analyse prévisionnelle pendant le fonctionnement de l'activité relève de l'application de formules mathématiques. Ces formules, issues de la bibliographie dans le domaine de l'acoustique, sont notamment décrites par les travaux de V. ZOUBOFF (C.E.T.E. d'ANGERS) et M. ULLRICH (formule d'atténuation par les écrans issue de la loi de MAEKAWA). Elles prennent notamment en compte la hauteur du ou des obstacles éventuels, la hauteur de la source et celle du récepteur et la topographie. Le calcul du niveau sonore engendré par l'exploitation a été effectué dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire :
- lorsque la pelle hydraulique ou la drague aspiratrice se trouvera en limite de site, au plus près de l’endroit considéré (source mobile),
- que les tombereaux et les camions de livraison circuleront (source linéique), - avec l'installation de traitement en activité (source fixe).
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
147
Les distances prises en compte pour la simulation en fonction des différentes sources sont les suivantes :
Tableau 2: Distances des sources de bruit aux habitations
Lieu-dit Distance (m)
Travaux
d'extraction
Installation
de traitement Piste interne
1 : L’enfournoire
40 330 300
2 : Les Pelouses 170 1000 200
3 : Le Perrée
150 600 360
La campagne sonore réalisée le 28 septembre 2016 servira de référence aux simulations. Les résultats de cette campagne sont fournis dans le tableau ci-après :
Ambiant Résiduel Emergence
Point Leq L50 Leq L50
Limite de
carrière 51.5 48 51.5 40.5 0
L’enfournoire 44 41 40 38 4
Les estimations de niveaux sonores ambiants (activité carrière, installations de traitement et circulation des camions de livraison sur les pistes internes) sont présentés dans le tableau ci-dessous.
1 Niveau résiduel : niveau sonore sans aucune activité d’exploitation sur le site. 2 Niveau engendré : niveau sonore induit par l'activité (travaux de décapage, d'extraction et de traitement et
commercialisation des produits finis) à hauteur de l'habitation, mais ne tenant pas compte du niveau sonore présent
initialement à cet endroit. 3 Niveau ambiant : niveau sonore qui sera généré par l’activité et intégrant le niveau résiduel.
Lieu-dit
Niveau
résiduel1
en dB(A)
Niveaux sonores engendrés2 en dB(A)
Niveau sonore
ambiant3 attendu en dB(A)
Emergence
en dB(A) Travaux d'extraction
Installation de
traitement
Circulation interne
Equivalents
1 : L’enfournoire
40 47 46 29 49.6 50,1 10
2 : Les Pelouses 40
32.5 35 33 38.4 42,3 2,3
3 : Le Perrée 40
34 40 27 41.1 43,6 3,6
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
148
Seule l’extraction qui se rapprochera des habitations engendrera une augmentation du niveau sonore induit. Pour les habitations des Pelouses ou de La Perrée, les émergences théoriques sans mesures spécifiques sont conformes aux seuils fixés par la réglementation (arrêté ministériel du 23/01/1997). Le point le plus délicat restera pour l’Enfournoire du fait de la proximité des habitations. Pour une exploitation au plus près des habitations, des mesures de protection devront être prises, elles seront détaillées dans le chapitre relatif à cet effet. Rappelons que des mesures de prévention courantes et quotidiennes seront aussi prises pour maitriser cet impact.
Le niveau sonore induit par l’activité constitue un effet direct et temporaire de l'exploitation.
2.2: VIBRATIONS - PROJECTIONS
La nature du matériau extrait (sables et graviers) et la méthode d'exploitation (pelle hydraulique, et ou drague aspiratrice) ne sont pas susceptibles de générer des vibrations, des projections ou même des explosions. De légères vibrations pourront être ressenties aux abords des appareils, mais elles seront rapidement atténuées et ne seront plus perceptibles au-delà d'une dizaine de mètres. Elles ne pourront donc en aucun cas gêner le voisinage. La circulation des tombereaux lors des travaux de décapage et celui des camions de livraison pourront engendrer des vibrations, limitées aux abords immédiats de la piste. Elles ne seront en aucun cas perceptibles sur les terrains voisins. Il en sera de même pour les vibrations générées par les éléments constituant l'installation de traitement, qui ne se propageront pas au-delà de quelques mètres. Les risques de projection seront limités aux environs immédiats des éléments de l'installation de traitement (broyeur, sortie de bande transporteuse …). Ils seront sans danger pour le voisinage du fait de leur éloignement.
2.3: EMISSIONS LUMINEUSES
Compte tenu de la plage horaire de travail, 7h-17h30, l'éclairage des postes de travail sera limité aux périodes de début de matinée et de fin de journée en période hivernale. Dans ces périodes, le travail sera réalisé aux phares des engins et avec des projecteurs orientés au niveau de l’installation. Ces émissions seront perceptibles depuis la portion de VC n°9, essentiellement entre les deux virages qui encadrent l’accès poids lourds du site.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
149
Au droit des habitations, L’enfounoire et la Perrée seront protégées par les merlons périphériques et la végétation. Les émissions lumineuses seront par contre plus directement perçues par les habitations des Pelouses, qui font face à l’exploitation, sans écran. Il subsistera cependant un halo de lumière au-dessus du site. Des mesures seront prises, notamment au niveau de l’orientation des projecteurs pour éviter tout éclairage superflu. L'exploitation est et sera donc à l'origine d'émissions lumineuses, dont la durée varie entre 1 à 3 heures par jour selon la saison et les conditions météorologiques.
Il s’agit là également d’un impact potentiel direct, temporaire, à prendre en compte uniquement pendant la durée de l’exploitation.
Par rapport à l’exploitation existante, le projet ne modifie pas cet impact
2.4: CHALEUR ET RADIATION
Le projet ne générera aucune source de chaleur ou émettrice de radiation susceptible d’avoir un effet sur la population.
2.5: EFFETS SUR LA SECURITE PUBLIQUE
Toute activité à caractère industriel, comme l'extraction des matériaux du sous-sol et leur transformation en granulats, entraîne des risques pour les tiers. Dans le cas présent, il pourrait s’agir :
- de chutes du haut des berges ou en cas d'affaissement de terrain, - de noyade dans les plans d'eau ou dans les bassins d'eau claire ou de décantation de l'installation
de traitement, - d’accidents corporels liés au fonctionnement et/ou à la circulation des engins et des camions de
livraison, - d’accident lié à la présence d’appareils en mouvement ou en hauteur au niveau de l’installation de
traitement. Il convient cependant de noter que ces risques pour la sécurité publique ne peuvent concerner qu'une personne entrée illicitement ou fortuitement sur le site, dans la mesure où il s'agit d'une propriété pour laquelle l'accès sera strictement réglementé.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
150
Le projet, intégrant un accès à la parcelle isolée supportant le poteau EDF, des mesures de protection
seront mises en place. Rappelons que du personnel mandaté peut intervenir sur le site pour l’entretien
des poteaux et lignes présents.
Les dangers présentés par l'exploitation font l'objet d'une étude de dangers spécifique, présentée après l’étude d’impact.
Les effets sur la sécurité publique à l’intérieur du site sont soit directs et permanents (risques de chute et de noyade) soit directs et temporaires (circulation de véhicules, fonctionnement des engins et de l'installation).
Les mesures propres à assurer la sécurité publique sont exposées dans la partie relative à cet effet. Précisons qu’actuellement tous les secteurs décapés ou en exploitation sont cloturés et merlonnés.
2.6: AMIANTE
2.6.1: RAPPEL CONCERNANT L’AMIANTE NATUREL
L’amiante est une substance minérale naturelle correspondant à des variétés fibreuses de silicates appartenant à deux groupes d’espèces minérales, les serpentines et les amphiboles. Les principaux minéraux sont :
- Famille des serpentines : o La chrysotyle
- Famille des Amphiboles :
o La crocidolite, o L’amosite, o L’anthophyllite, o La trémolite, o L’actinolite.
L’amiante peut donc se trouver dans des roches naturelles dont la composition chimique est favorable au développement de celle-ci sous certaines conditions. Certaines roches à composition basique ou ultra basique comme les amphibolites, les méta gabbros, les méta basaltes, les serpentines contiennent ou peuvent contenir de l’amiante.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
151
Sablière TAVANO
2.6.2: SITUATION SUR LA CARRIERE
Premièrement, une roche sédimentaire est une roche exogène, c’est-à-dire formée à la surface de la
Terre. Aucune des roches citées au précédent chapitre n’est sédimentaire or les deux formations
exploitées sur la sablière correspondent exclusivement à des roches sédimentaires.
Deuxièmement, d’après l’annexe 2 de l’instruction de la Direction Générale de la Prévention des Risques [DGPR] (Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie) du 30 juillet 2014 relative à l’amiante naturel en carrières, « les exploitations concernant des formations sédimentaires non métamorphiques dans lesquelles la probabilité de trouver des fibres d’amiante est a priori nulle ou négligeable ne sont pas concernées par la question de l’amiante, à l’exception des exploitations concernant des formations superficielles non consolidées et allochtones (alluvions, moraines, colluvions, éboulis, nappe de charriage, cône de déjection, etc.) ». L’interprétation de cette phrase est délicate mais elle trouve sa résonance pratique dans le cas des Mézières. En effet, deux formations sédimentaires y sont exploitées :
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
152
- les alluvions de la Sarthe, moyenne terrasse - les sables du Cénomanien Supérieur
Les sables du cénomanien ont été formés en milieu marin par apports terrigènes issus du Massif Armoricain. Ces apports ont une provenance géographique très étendue. En sachant que les gisements d’amiante sont rares et limités à certaines roches basiques, il est évident que si l’amiante est présente dans certains apports terrigènes, elle l’est en qualité extrêmement réduite car diluée dans l’ensemble des apports. Les alluvions de la Sarthe correspondent à une formation récente. Les minéraux les composant proviennent de l’ensemble du bassin versant drainé par la Sarthe. Même si celui-ci a évolué au Quaternaire, le bassin versant est resté entièrement compris dans le Bassin Parisien qui est un grand ensemble sédimentaire. Les éventuelles alluvions à risques pourraient correspondre à des alluvions drainant des gisements amiantifères ; ce n’est pas du tout le cas pour la Sarthe. Troisièmement, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières [BRGM] a publié en janvier 2013 (BRGM/RP-62079-FR) un rapport intitulé « Cartographie de l’aléa amiante environnemental dans les départements du Massif Armoricain » dont, géologiquement, une portion Ouest de la Sarthe fait partie. Ce rapport cartographie et identifie les formations géologiques du Massif Armoricain susceptibles de contenir de l’amiante. Elles sont 143 au total. Des cartes synthétiques par département indiquent les zones d’aléa amiante environnemental. Cette carte est jointe en fin de ce rapport avec la localisation de la sablière. On constate que la carrière appartient à une zone de susceptibilité nulle à très faible. Pour toutes les raisons précédemment évoquées, dans l’état actuel de nos connaissances, on peut
conclure à ce jour à l’absence d’amiante dans les granulats de la sablière.
2.7: EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE
Le volet relatif aux effets sur la santé a pour objectif d’étudier les différents risques sanitaires présentés par le projet en fonctionnement normal vis-à-vis de la santé publique (l’accident de fonctionnement est traité dans l’étude de dangers). La gravité de ces risques doit être caractérisée et les mesures prises pour agir sur les risques doivent être présentées. L'étude des effets sur la santé s’appuie sur :
- les éléments de l’étude d’impact elle-même, - les éléments de l’étude de dangers, - les éléments concernant l’hygiène et la sécurité, - les éléments propres aux effets sur la santé si ces effets n’ont pas été inventoriés et étudiés
parmi les éléments cités précédemment.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
153
Il convient de noter que le présent volet des effets sur la santé concerne les populations riveraines au site et non le personnel de l'exploitation dont l'exposition aux substances ou émissions à effet potentiel est réglementé par le Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) et par le code du travail. La circulaire DGS n°2001-185 du 11/04/2001 précise que l’étude des risques sanitaires doit être proportionnée à la dangerosité des substances émises et à l’importance et/ou la fragilité de la population exposée à proximité des travaux et aménagements figurant dans la demande d’autorisation. La circulaire du 09/08/2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation ajoute d’autre part que, pour les carrières notamment, l’analyse des effets sur la santé requise dans l’étude d’impact sera réalisée sous forme qualitative. L’étude des effets sur la santé est mise à jour dans le cadre du présent projet, notamment dans le cadre de cette nouvelle circulaire.
2.7.1: IDENTIFICATION DES SUBSTANCES OU EMISSIONS A EFFET POTENTIEL SUR LA SANTE
DES POPULATIONS
Une substance dangereuse est une molécule capable de provoquer un effet toxique chez l'homme et faisant l'objet d'une classification internationale au titre de la directive européenne 67/548/CEE. Substances potentiellement dangereuses stockées sur le site
Substance potentiellement
dangereuse
Produit contenant la
substance
Lieu de stockage
Hydrocarbures Gazole non routier (GNR) - 2 Cuves double peau de stockage de
1500 l
- Réservoirs des engins
Hydrocarbures Gazole - Réservoir des véhicules légers
Hydrocarbures Lubrifiants - Atelier, sur cuvette de rétention
Hydrocarbures Lubrifiants usagés - Atelier, sur cuvette de rétention
Hydrocarbures Déchets souillés par des
hydrocarbures
- Conteneur dédié sur aire bétonnée à
côté de l’atelier et atelier
Diverses substances chimiques
(en quantité domestique)
Aérosols dégrippants,
détergents
- Conteneur dédié dans l’atelier
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
154
Substances et phénomènes potentiellement dangereux produits lors de l’exploitation de l’installation
- hydrocarbures (lors des ravitaillements sur le site), - poussières totales sans effet spécifique, issues des opérations de gerbage, scalpage, roulage,
dépotage, aménagement… - poussières alvéolaires siliceuses, issues des opérations de gerbage, scalpage, roulage,
dépotage, aménagement… - monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NO et NO2), particules, hydrocarbures imbrûlés,
dioxyde de soufre (SO2) … dans les gaz d’échappement des moteurs thermiques (sur le site et depuis les véhicules de transport clients et fournisseurs),
- bruit, - chaleur, - lumière.
Justification de l’exclusion de certains phénomènes et substances
Aucun micro-organisme n’est utilisé dans les procédés de fabrication. Leur développement n’est favorisé par aucune matière première, sous-produits ou déchets ni par aucun circuit ou équipement de l’installation. Le site n’étant pas relié au réseau d’eaux usées public, une fosse septique vidangée régulièrement est en place au niveau des bungalows. Les polluants liés aux incendies (gaz de combustion, eaux d’extinction d’incendie…) ne sont pas pris en compte car ils ne représentent pas un fonctionnement normal des installations.
2.7.2: POTENTIEL D’EXPOSITION DES POPULATIONS AUX SUBSTANCES
Définition de l’aire d’étude
L'aire d'étude prend en compte l'ensemble des activités humaines (activités industrielles voisines, habitations riveraines, voies de circulation…) qui peuvent être affectées. Au sein de l’aire d’étude, les phénomènes et substances potentiellement dangereux transmis par l’air et par rayonnement ont tendance à voir leur potentiel de danger diminuer avec la distance. Ce n’est pas nécessairement le cas de l’eau qui emprunte des circuits préférentiels en termes de transport et de concentration. L’aire d’étude s’étend donc à plusieurs kilomètres et elle ne peut être définie exactement. Les populations sensibles les plus proches sont situées au niveau des bourgs de Spay et d’Arnage pour ce qui concerne les écoles, collèges et lycée:
Ecoles de Spay : 1000 m de la limite d’emprise ouest du site, Ecoles d’Arnage : 500 m de la limite d’emprise sud-est, de l’autre côté de la Sarthe et de la RD 147. Collège et Lycée d’Arnage : 550 et 650 m de la limite d’emprise nord est, de l’autre côté de la Sarthe.
Les centres de soins, hôpitaux, cliniques et maisons de retraites les plus proches sont situées sur l’agglomération mancelle.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
155
Définition du terme « population exposée »
Par population exposée, nous entendons toute personne soumise pendant une durée « non ponctuelle » à une substance ou un phénomène. En effet, parmi l’ensemble des substances et phénomènes identifiés, nous considérons qu’aucun ne présente une dangerosité suffisante pour avoir des effets sur la santé en cas d’exposition pendant une durée ponctuelle. Nous considérons qu’une heure par semaine pendant la période d’existence de l’installation correspond à une durée ponctuelle. Par conséquent, nous n’inclurons pas les clients et fournisseurs dans la population d’étude. Population cible
Le site est implanté dans une zone périurbaine, enclavé entre deux axes de circulation passants la RD 323 et la RD 147 (de l’autre côté de la Sarthe). Les foyers répertoriés à moins de 300 m sont les suivants :
Lieu-dit Distance minimale par rapport à la
limite d’emprise la plus proche
L’enfournoire 20 m
La Perrée 100 m
Les Aulnays (habitations les plus au
sud) 180 à 400 m
Les Pelouses 130 m
Le port au liard 250 m Habitation du bourg d’Arnage
En face de la pointe sud est de l’autre côté de la Sarthe
150 m
L’activité humaine la plus proche du site est une activité agricole sur les champs qui entourent l’exploitation. De nombreuses activités sont présentes dans le rayon d’affichage de 3 km. Les plus proches se situent au niveau de la petite zone artisanale de la Perrée. Identification de transferts possibles : substances – vecteurs – population
Pour chaque substance, le tableau suivant récapitule : - les compartiments environnementaux concernés (= vecteurs par lesquels peuvent se propager
les substances et les phénomènes), - si ces compartiments environnementaux peuvent devenir des vecteurs d’exposition pour les
populations.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
156
Substance ou phénomène potentiellement dangereux
Vecteur de transmission
Vecteur d’exposition
Hydrocarbures air non eau oui
Diverses substances chimiques
air non eau non
Poussières alvéolaires siliceuses
air oui eau non
Poussières totales air oui eau non
Gaz d’échappement air oui Bruit rayonnement oui
Chaleur rayonnement non Lumière rayonnement non
Justification de la non-exposition de la population à certains phénomènes et substances
Transfert des hydrocarbures par l’air Lors d’un fonctionnement habituel des installations, les égouttures d’hydrocarbures qui peuvent se produire sur le site comportent une fraction volatile. Cependant, cette fraction volatile aura tendance à se diluer dans l’air ambiant. Etant donné le volume représenté par les égouttures et cette dilution, il semble justifié de considérer que cette voie de transfert ne constituera pas un risque pour la santé. D’autre part, les cuves de GNR reste toujours fermées en dehors des opérations de dépotage. Transfert de diverses substances chimiques Aucune substance très volatile ne sera stockée sur le site. L’ensemble des récipients contenant les quelques substances chimiques énumérées précédemment sera d’ailleurs fermé et sous abri à l’atelier. Dans un fonctionnement normal de l’installation, compte tenu des quantités stockées faibles de ces diverses substances chimiques, l’effet sur la santé, que le vecteur de transmission soit l’air ou l’eau, peut être considéré d’emblée comme négligeable. Transfert de poussières totales et alvéolaires siliceuses par l’eau Il n’existe pas aujourd’hui suffisamment d’études pour savoir si les poussières présentent un risque par contact cutané ou par ingestion. Quoi qu’il en soit, d’une manière générale, on peut considérer ce risque comme négligeable par rapport à celui d’une exposition à la poussière par le vecteur aérien. Transfert de chaleur par rayonnement Etant donné la faible conductivité thermique de l’air, et même si l’on estime une utilisation permanente sur le site de la puissance maximale autorisée, les pertes d’énergie sous forme de chaleur ne peuvent avoir d’influence sur l’habitation ou l’activité la plus proche.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
157
Transfert de lumière par rayonnement Il n’existe pas aujourd’hui suffisamment d’études pour connaître les effets néfastes de la lumière sur la santé. L’effet le plus significatif est le trouble du sommeil. L’activité n’ayant pas lieu pendant les horaires habituels de sommeil, on peut conclure que le risque sanitaire lié à l’éclairage artificiel sur le site sera négligeable. Conditions climatiques
Les conditions climatiques sont présentées dans l'étude d'impact au chapitre 3, paragraphe 7.2. Le facteur météorologique habituel le plus influent est le vent pour les substances transmissibles par l’air (poussière, gaz, diverses substances chimiques…). Ces substances sont dispersées (ou diffusées) par les vents. Leurs retombées dépendent de la direction et de la vitesse de ces vents. Le vent dominant sur le secteur vient du sud-ouest. Un vent d’importance secondaire vient du nord-est. Le site n’est pas particulièrement protégé par rapport à ces deux directions de vents. Dans la région, les précipitations sont assez fréquentes. Ces précipitations entraînent une agrégation et une humidification des poussières qui les rendent plus lourdes à déplacer par le vent. En revanche, elles participent grandement au transfert des substances chimiques transmissibles par l’eau (hydrocarbures,…) dans les eaux superficielles et souterraines. Le relief et la végétation jouent aussi des rôles non négligeables dans la propagation des substances : la présence de végétation notamment ralentit les flux d’eau, filtre certaines substances et limite l’extension des retombées de poussières. Les haies, fourrés et bois périphériques restent globalement assez développés sur le secteur et réduisent faiblement les effets potentiels sur la santé humaine.
2.7.3: EFFETS NEFASTES POTENTIELS DE CHAQUE SUBSTANCE SUR LA SANTE
Seules les substances et phénomènes pour lesquels la population sera exposée (ou susceptible de l’être) sont traités. Hydrocarbures
Le contact prolongé avec des hydrocarbures provoque des irritations et des dermatoses. Emissions sonores
Les risques potentiels concernant une exposition forte au bruit sont :
- L’augmentation de la fatigue, - Les troubles de la vigilance, - La surdité irréversible.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
158
Les seuils1 critiques sont les suivants :
- 80 dB(A) : Seuil de nocivité (pour 8 heures d’exposition), - 120 dB(A) : Seuil de douleur.
Des valeurs néanmoins moins élevées peuvent être à l’origine de troubles du sommeil, fatigue et stress. Rejets atmosphériques liés aux émissions de gaz d’échappement
Les gaz d’échappement dans l’atmosphère sont composés essentiellement de :
- CO2 [dioxyde de carbone] (95 %), - CO [monoxyde de carbone] (4 %), - COV [Composés Organiques Volatils] non méthaniques (moins de 1 %), - NOx [oxydes d’azote] (moins de 1 %), - SO2 [dioxyde de soufre] (moins de 1 %), - HAP [Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques] (moins de 1 %).
Le Conseil supérieur d'hygiène publique, instance scientifique du Ministère de la Santé, a mené de 1991 à 1996 une étude évaluant le risque de pollution de l'air sur la santé. Cette étude a conclu à une augmentation du nombre des personnes allergiques et asthmatiques suite à la pollution liée à l’apport de particules fines en suspensions apportées par les gaz d’échappement. Les personnes âgées et les personnes présentant des affections des voies respiratoires sont particulièrement sensibles à ces aéro-contaminants. Poussières totales sans effet spécifique
Il s’agit de poussières totales réputées sans effet spécifique et qui ne sont donc pas en mesure de provoquer seules, sur les poumons ou sur tout autre organe ou système du corps humain, d’autre effet que celui de surcharge. Poussières alvéolaires siliceuses
Les poussières siliceuses sont des poussières qui contiennent de la silice cristalline libre, c’est-à-dire dont le groupement chimique SiO2 n’est lié à aucun autre groupement chimique. A l’état naturel, le quartz est la source quasi-unique de silice libre, la tridymite et la cristobalite étant beaucoup plus rares.
1 Données INRS (2009)
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
159
La différence entre la fraction inhalable et la fraction alvéolaire des poussières est liée au diamètre aérodynamique de chaque poussière en suspension dans l’atmosphère.
- la fraction inhalable comprend les poussières susceptibles de pénétrer dans les voies aériennes respiratoires par le nez ou la bouche. Le diamètre aérodynamique de ces poussières est compris entre 0 et 100 micromètres,
- la fraction alvéolaire est la partie de la fraction inhalable susceptible de se déposer dans les alvéoles pulmonaires. Le diamètre aérodynamique de ces poussières est inférieur à 10 micromètres. Selon les organismes spécialisés et selon les pays, l’interprétation fine du sens du terme « alvéolaire » est différente. Ainsi, parmi les particules susceptibles de se déposer, certaines sont en réalité bloquées dans les voies aériennes entre la gorge et les poumons. Ainsi les particules atteignant réellement les alvéoles pulmonaires pourraient être limitées aux particules ayant un diamètre aérodynamique inférieur à 4 micromètres. Dans le présent dossier, nous en restons à la première définition.
Le fractionnement d’un échantillon de poussières en inhalables et alvéolaires peut être réalisé par certains appareils de prélèvement (exemple : appareil CIP 10) L'inhalation chronique de poussières alvéolaires siliceuses est principalement à l'origine d'affections pulmonaires appelées pneumoconioses fibrogènes nodulaires ou plus couramment « silicose ». Cette pathologie, dont les manifestations cliniques sont tardives et diverses (phase de latence avant apparition progressive des symptômes), dépend de plusieurs facteurs :
- taille des particules, - concentration en silice libre dans l'air, - durée d'exposition.
Les lésions silicotiques se développent en réponse à l'inhalation chronique de particules de silice cristalline libre qui atteignent les alvéoles pulmonaires (selon la durée d'exposition). En effet les particules de silice pénètrent plus ou moins profondément les voies respiratoires selon leur taille et conditionnent ainsi la quantité de particules déposée dans les alvéoles pulmonaires. Les manifestations cliniques comprennent des broncho-pneumopathies chroniques, dyspnée (respiration difficile) et plus gravement des phases d'hypertension artérielle. Les affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline sont détaillées dans le régime général des maladies professionnelles sous le tableau 25 (dernière mise à jour par le décret du 28/03/2003). Des pistes sont en cours d’étude sur le lien entre cancer de l’œsophage et la silice. L’article R. 4412-149 du Code du Travail indique que la valeur limite d'exposition professionnelle sur 8 heures au quartz est de 0,1 mg/m3 et de 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
160
2.7.4: NIVEAU D’EXPOSITION DES POPULATIONS ET CARACTERISATION DES RISQUES
SANITAIRES
Choix des valeurs toxicologiques de référence
En référence à la note ministérielle d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués, la recherche bibliographique des valeurs toxicologiques de référence se fait auprès de plusieurs organismes officiels par l’intermédiaire de leur site internet :
ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – http://www.anses.fr
US-EPA : Agence de Protection de l’Environnement des Etats-Unis (United States – Environmental Protection Agency) – http://www.epa.gov/iris
ATSDR : Agence du Registre des Maladies et des Substances Toxiques des Etats-Unis (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) – http://www.atsdr.cdc.gov
OMS/IPCS : Organisation Mondiale de la Santé – Programme International sur la sécurité chimique (International Program on Chemical Safety) – http://www.inchem.org
Health Canada : Département Fédéral du Canada en charge de la promotion des mesures contribuant à la bonne santé du peuple canadien – Programme d’Evaluation des Substances Prioritaires (Priority Substances Assessment Program) – http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/index-fra.php
RIVM : Institut National de la Santé Publique et de l’Environnement des Pays-Bas (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) – http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf et http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701092.pdf
EFSA : European Food Safety Authority – http://www.efsa.europa.eu/fr OEHHA : antenne californienne de l’US-EPA (Office of Environmental Health Hazard Assessment) –
http://www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp Le choix des VTR à utiliser est basé aussi sur cette note ministérielle : « Par mesure de simplification, dans la mesure où il n’existe pas de méthode de choix faisant consensus, il est recommandé au pétitionnaire de sélectionner en premier lieu les VTR construites par l’ANSES même si des VTR plus récentes sont proposées par les autres bases de données. Dans ce dernier cas, la DGS jugera de l’opportunité de saisir l’ANSES pour réviser sa VTR, mais elle ne sera pas attendue pour l’évaluation. A défaut, si pour une substance une expertise nationale a été menée et a abouti à une sélection approfondie parmi les VTR disponibles, alors le prestataire devra retenir les VTR correspondantes, sous réserve que cette expertise ait été réalisée postérieurement à la date de parution de la VTR la plus récente. Sinon, le pétitionnaire sélectionnera la VTR la plus récente parmi les trois bases de données : US-EPA, ATSDR ou OMS sauf s’il est fait mention par l’organisme de référence que la VTR n’est pas basée sur l’effet survenant à la plus faible dose et jugé pertinent pour la population visée. Si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données précédemment citées (Anses, US-EPA, ATSDR et OMS), le pétitionnaire utilisera la dernière VTR proposée par Santé Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA ».
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
161
Les substances peuvent se classer suivant le type d’effet sur la santé. A ce type d’effet correspond un type de valeur retenu en tant que valeur toxicologique de référence (à seuil ou sans seuil) résumé dans le tableau ci-dessous :
Type d’effet Type de valeur Abréviation Toxique non cancérogène Valeur toxicologique de référence à seuil VTRs Cancérogène mutagène ou génotoxique Valeur toxicologique de référence sans seuil VTRs Cancérogène non génotoxique Valeur toxicologique de référence à seuil VTRs
AIR
Substance / phénomène
potentiellement dangereux
Voie de transmission
ANSES US-EPA
ATSDR OMS / IPCS
Health Canada
RIVM OEHHA EFSA
Gaz d’échappement
(mélange)
Inhalation ND ND ND ND ND ND Ingestion ND ND ND ND ND ND ND ND Contact cutané ND ND ND ND ND ND ND ND
Poussières totales
Inhalation ND ND ND ND ND ND ND ND Ingestion ND ND ND ND ND ND ND ND Contact cutané ND ND ND ND ND ND ND ND
Poussières alvéolaires et poussières alvéolaires siliceuses
Inhalation ND ND ND ND ND ND Ingestion ND ND ND ND ND ND ND ND
Contact cutané ND ND ND ND ND ND ND ND
EAU
Substance / phénomène
potentiellement dangereux
Voie de transmission
ANSES US-EPA
ATSDR OMS / IPCS
Health Canada
RIVM OEHHA EFSA
Hydrocarbures Ingestion ND ND ND ND ND ND ND Contact cutané ND ND ND ND ND ND ND ND
RAYONNEMENT
Substance / phénomène
potentiellement dangereux
Voie de transmission
ANSES US-EPA
ATSDR OMS / IPCS
Health Canada
RIVM OEHHA EFSA
Bruit Rayonnement ND ND ND ND ND ND ND - ND : No Data : aucune donnée trouvée - : VTRs : Diesel particulate matter = 5.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (24h) (02-2003) - : VTRs : Diesel exhaust particulate = 5.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (année)
VTRs : pour une exposition quotidienne à 1 μg/(m3 d'air inhalé), le risque de surplus de cancer est
estimé à 3 pour 10 000
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
162
ATTENTION : CES 3 PRECEDENTES VTR NE CONCERNENT QUE LES PARTICULES EMISES PAR LES MOTEURS DIESEL ET
NON PAS LES GAZ D’ECHAPPEMENT EN MELANGE DANS LEUR ENSEMBLE. - : VTRs : PM2,5
1 = 35.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (24h) (09-2006) VTRs : PM2,5 = 15.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (année) (09-2006) VTRs : PM10
2 = 150.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (24h) (09-2006) - : VTRs : 3.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (année). ATTENTION : CETTE VALEUR CONCERNE DES POUSSIERES ALVEOLAIRES CONSTITUEES UNIQUEMENT DE SILICE - : VTRs : 3,1 mg/kg de la personne exposée (24h) (1999-2000) (taux n'entraînant pas d'effet négatif
sur la santé sur une vie d'exposition) - : VTRs : LEq = 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit (1980) (limite considérée comme n’entraînant pas
de gêne, gêne pouvant être à l’origine d’effets sur la santé globalement bénins) Pour les gaz d’échappement, l’US-EPA détaille des VTRs pour les principaux constituants :
- CO (monoxyde de carbone) : 10 mg/(m3 d'air inhalé) (24h), - Pb (plomb) : 0,15 μg/(m3 d'air inhalé) (trimestre) (10-2008), - NO2 (dioxyde d’azote) : 53 ppb (année), - PM10 (Particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 μm) : 150.10-3 mg/(m3
d'air inhalé) (24h), - PM2.5 (Particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 μm) : 15.10-3 mg/(m3
d'air inhalé) (année), - O3 (ozone) : 0,075 ppm (8h) (05-2008), - SO2 (dioxyde de soufre) : 0,03 ppm (année).
L’article R. 221-1 du code de l’environnement précise, depuis le 21 octobre 2010, de nombreuses valeurs concernant la surveillance de la qualité de l’air ambiant. Même si aucun texte ne recommande d’utiliser ces valeurs dans le cadre d’une étude d’effets sur la santé (il n’a pas encore été précisé quelle valeur parmi celles citées devait être utilisée comme VTR), elles représentent néanmoins une information de première importance dans le droit français.
Objectif de qualité Seuil d’information et de recommandation Seuils d’alerte
Valeur limite pour la protection de la santé
humaine
NO2 40 μg/m3 (année) 200 μg/m3 (heure) 400 μg/m3 (3h) 200 μg/m3 (heure) 40 μg/m3 (année)
PM2.5 10 μg/m3 (année) 28 μg/m3 (année)
PM10 30 μg/m3 (année) 50 μg/m3 (24h) 80 μg/m3 (24h) 50 μg/m3 (24h) 40 μg/m3 (année)
Plomb 0,25 μg/m3 (année) 0,5 μg/m3 (année)
SO2 50 μg/m3 (année) 300 μg/m3 (heure) 500 μg/m3 (3h) 350 μg/m3 (heure) 125 μg/m3 (24h)
O3 120 μg/m3 (année) 180 μg/m3 (heure) 240 μg/m3 (heure) CO 10 mg/m3 (24h)
C6H6 (benzène) 2 μg/m3 (année) 5 μg/m3 (année)
1 PM2,5 : Particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 μm 2 PM10 : Particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 μm
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
163
Caractérisation des risques sanitaires déjà présents
Seuls les risques semblables à ceux induits par le projet sont énumérés afin de savoir s’il existera un effet cumulatif susceptible de créer un risque sanitaire :
- Emissions gazeuses : véhicules sur la voirie proche. En ce qui concerne les gaz d’échappement, le risque est proportionnel au trafic. La RD 323 et la RD 147 sont des axes à forte circulation
On peut considérer que le risque sanitaire existant aux abords de la carrière est supérieur à
celui de la carrière du fait de ces axes notamment. Les établissements industriels proches sont eux aussi à l’origine d’un trafic dont les effets sont cumulatifs mais difficilement estimables et surtout disséminés dans l’espace. D’après le peu de renseignements relatifs à leurs activités, ils ne sont par contre pas à l’origine d’importantes émissions gazeuses dans leur procédé de fabrication,
- Poussières totales et alvéolaires siliceuses :
o l’activité agricole, notamment le labour, est une source d’émission de poussières mais ces poussières sont terreuses et contiennent peu d’éléments siliceux,
o Le trafic routier est aussi une source de particules, d’origine moins minérale que pour une carrière,
- Hydrocarbures : véhicules sur la voirie proche. La quantification du risque est inenvisageable,
- Bruit : selon les endroits, des sources de bruit artificielles existent dans le niveau de fond sonore. Elles sont principalement liées au trafic (RD 323 et Rd 147). L’effet cumulatif de toutes les sources est certain à proximité immédiate du site.
Détermination des niveaux d’exposition et quantification du risque sanitaire
Le niveau d’exposition des personnes doit, en général, être déterminé en prenant en considération :
- le type d’occupation du sol, la sensibilité du milieu naturel, les activités humaines et les ressources avec notamment la présence de captage d'alimentation en eau potable (examiné lors de l'état initial de l’étude d'impact),
- les conditions climatiques et topographiques, - les caractéristiques physiques des substances et phénomènes susceptibles d’être à l’origine
des nuisances, identifiées dans la présente étude, - les problèmes liés à la propagation des différentes substances et émissions identifiées.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
164
Hydrocarbures Au chapitre 7 sont récapitulées les mesures envisagées pour éviter toute fuite d’hydrocarbures. Ne sachant quelle quantité d’hydrocarbures peut être rejetée dans l’eau dans le cadre d’un fonctionnement normal des installations même si des mesures de concentrations ont été faites sur le plan d’eau en exploitation, il semble encore moins envisageable de donner un niveau d’exposition fiable de la population. Il est cependant à signaler que l’eau de la nappe alluviale et nappe cénomanienne libre n’est pas utilisée pour l’alimentation en eau potable, ce qui limite le risque sanitaire. La quantification du risque sanitaire lié aux hydrocarbures n’est donc pas envisageable même si une VTR existe dans la bibliographie (RIVM). Aucune pollution n’a été imputable à la carrière L’étude de l’état de pollution des sols au chapitre 3 paragraphe 5.3.1 n’a montré aucun indice de pollution. Cela incite à penser que l’effet sur la santé vis-à-vis de cette substance sera négligeable. Emissions sonores De jour, l’OMS considère qu’un niveau sonore équivalent LEq supérieur à 55 dB(A) constitue une gêne. Ce niveau sonore n’a pas été atteint los des mesures réalisées en 2016. Le risque de trouble du sommeil sera écarté du fait des horaires diurnes de fonctionnement des installations de traitement et des engins d’exploitation de la carrière. D’après tous ces éléments, on peut estimer que le risque sanitaire lié au bruit sera faible. Une circulation sur
la VC 9 peut engendrer des niveaux sonores qui s’approchent de la VTRs au droit des habitations de
proximité. Il est à signaler que la mesure est réalisée à l’extérieur et qu’un niveau sonore dans l’habitation serait en-dessous de la VTRs. Les camions constituant une part non négligeable de la circulation devant l’habitation, il apparaît important de sensibiliser les chauffeurs routiers à limiter leur vitesse. Quoi qu’il en soit, la perception subjective des bruits, même si elle n’a pas de conséquences avérées sur la santé, peut cependant affecter le voisinage et nous verrons au chapitre 7 les mesures prises sur le site. Rejets atmosphériques liés aux émissions de gaz d’échappement Les gaz d’échappement émis se dispersent dans l’air suivant des conditions qui ne sont pas modélisables pour l’ensemble de la carrière (sources diffuses du fait de la mobilité des engins). Il est ainsi impossible d’établir un lien quantifié entre les émissions massiques de gaz d’échappement de la carrière et la concentration en mg/m3 des substances dangereuses dans l’air inhalé par les populations exposées.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
165
On peut juste rappeler que, théoriquement, plus les émissions d’un gaz sont importantes et plus sa concentration dans l’air est élevée, à quelque échelle que ce soit. La quantification du risque sanitaire lié aux gaz d’échappement n’est donc pas envisageable même si une VTR existe dans la bibliographie (US-EPA et OEHHA). Sur le site, la quantité de gaz émise par l’ensemble de l’activité de la carrière est majoritairement représentée par la chargeuse, la pelle hydraulique et le dumper le reste des émissions gazeuses étant dispersé sur l’ensemble du trajet des camions. On peut donc estimer que l’impact sanitaire lié aux émissions gazeuses de l’activité de la carrière n’est pas significatif. Il est globalement faible et il est encore plus faible si on s’en tient à une population exposée locale. En matière d’effets cumulés, il est difficile de conclure car, comme pour la carrière, l’impact principal relatif aux gaz d’échappement pour une grande partie des activités économiques du secteur est lié aux transports de fournitures ou de produits finis. Les hypothèses de quantification sont donc très complexes. La présence des axes de circulation et des activités autour, fait que le secteur est affecté par les impacts cumulés d’émissions gazeuses. Poussières totales sans effet spécifiques Le site est actuellement générateur de faibles envols de poussières, principalement du fait de l’extraction sous eau et du lavage systématique des matériaux dans les installations de traitement. A cela s’ajoute le fait que, comme nous l’avons vu, ces poussières ne sont pas en mesure de provoquer seules, sur les poumons ou sur tout autre organe ou système du corps humain, d’autre effet que celui de surcharge. Seule la fraction alvéolaire siliceuse de ces poussières peut présenter un risque (voir chapitre suivant). Les panaches de poussières existant ou pas sur les carrières peuvent déjà donner une indication sur l’impact car une carrière produisant des quantités visiblement importantes de poussières a de fortes probabilités d’engendrer des émissions importantes de particules fines, ce qui n’est pas le cas sur la carrière TAVANO. Cependant, le comportement des particules les plus fines est particulier : il est d’autant plus erratique que les particules sont fines. Compte tenu de ces remarques, le risque sanitaire lié aux poussières totales peut être considéré comme non significatif, même en tenant compte des effets cumulés. Poussières alvéolaires siliceuses La Valeur Toxicologique de Référence (VTR) pour des poussières alvéolaires de silice pure est de 3.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) sur une année (OEHHA). Une autre VTR intéressante concerne la fraction alvéolaire (PM10) de l’ensemble des poussières. Elle est de 150.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) sur 24 h (US-EPA).
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
166
Le comportement des poussières alvéolaires siliceuses dans l’air au niveau des habitations est difficilement modélisable correctement car :
- le diamètre aérodynamique des particules en fait des éléments dont le mouvement, erratique, est soumis à de nombreux paramètres qui peuvent multiplier les erreurs dans les hypothèses d’entrée d’une modélisation,
- les sources sur la carrière sont en partie diffuses et mobiles. En outre, actuellement, aucune mesure n’est normalisée pour estimer l’impact sanitaire des poussières alvéolaires siliceuses sur la santé entre une source et des riverains. Cependant, il est possible de qualifier voire de proposer une première approche quantitative de l’impact. En effet, premièrement, comme pour les poussières totales, signalons à nouveau que les matériaux sont extraits pour partie sous eau et ils sont ensuite lavés dans les installations de traitement. Les mesures d’empoussiérage réalisées pour le personnel au niveau des postes de travail du chef de carrière et de la pelle au front donne :
des concentrations en poussières alvéolaires toujours inférieures au dixième du seuil de la valeur limite d’exposition du personnel (VLEP) : indicateur de risque faible,
des concentrations en quartz présentant une certaine variabilité, avec quelques valeurs supérieures au dixième du seuil de VLEP (> 0,03 pour un seuil de 0,1 mg/m3). Du fait de ces quelques valeurs, il existe une incertitude et on ne peut qualifier le risque de faible pour le personnel.
Rappelons que cette approche qualitative se fait sur le personnel travaillant sur le site 8h par jour. Pour les riverains beaucoup moins exposés du fait de leur position géographique, de la météo et du temps d’exposition, on peut estimer le risque comme faible. Les dispositions prises afin de limiter au maximum l’émission de poussières depuis la carrière (voir chapitre 7) auront tendance à réduire tout effet sanitaire potentiel des poussières alvéolaires siliceuses. Conclusion sur la quantification du risque sanitaire
Cette étude montre la difficulté de quantifier le risque sanitaire lié aux différents phénomènes et substances potentiellement dangereux. Même si le risque sanitaire peut être globalement qualifié de très faible,
- sa non-quantification implique de tenir compte du principe de précaution - localement, le lieu-dit l’Enfournoire, du fait de sa proximité avec le site apparaît comme un point
sensible. Dans ce cadre, la bonne application des mesures envisagées et rappelées au chapitre 7 permettra de s’assurer que le risque sanitaire reste bien très faible.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
167
3: EFFETS SUR LES ACTIVITES ET LES ESPACES DE LOISIRS
3.1: AGRICULTURE
3.1.1: EFFET SUR LA SURFACE AGRICOLE COMMUNALE
Les terrains de la carrière, exploitation actuelle et zones d’extension, n’ont pas de vocation agricole, il n’y aura
donc aucune modification de la surface agricole communale.
Les terrains envisagés pour la compensation du défrichement ne sont pas non plus en zone agricole
(Zone NP au PLU).
L’effet sur la surface agricole sera nul.
3.1.2: EFFETS SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Aucune exploitation agricole n’est directement concernée par le projet, en terme de consommation
d’espace.
Il pourrait y avoir un effet indirect sur l'agriculture, lié à un éventuel dépôt de poussière sur les cultures environnantes. Cet éventuel effet serait peu important et temporaire, dans la mesure où les dépôts éventuels pourraient être évacués par les pluies. Les zones agricoles de la commune sont localisées à l’ouest du bourg de Spay et au sud de l’autre coté de la Sarthe. La seule exploitation agricole qui pourrait être concernée, située au lieu dit la Perrée, est une exploitation de safran, sur 0,46 ha. La carrière n’a aujourd’hui aucun impact sur cette exploitation, selon le propriétaire. Les envols de poussières et l’alimentation en eau du forage de l’exploitation feront l’objet d’une attention particulière (cf chapitre 7).
Compte tenu de ce constat, l’effet potentiel sur cette exploitation agricole pourra être indirect, et très temporaire. Il sera nul sur les autres exploitations agricoles.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
168
3.2: SYLVICULTURE
Une demande de défrichement sur 2,9 ha est intégrée à la demande, ce défrichement correspond à une partie du Bois de la sapinière, appartenant à Mme TAVANO, totalisant une surface de l’ordre de 38 ha. Ce bois a fait l’objet d’un plan de gestion simple sur la période 2008-2027. La parcelle AK 11 concernée par le défrichement correspond à la parcelle forestière 1. Elle comprend une jeune plantation de Pin Maritime de moins d’une dizaine d’année. La propriétaire du Bois de la Sapinière souhaite la mise en valeur esthétique et récréative des parcelles, les aspects productifs et cynégétiques sont d’un intérêt très secondaire. La compensation de ce défrichement peut être envisagée sur des terrains appartenant à la mairie de SPAY, actuellement classé en zone naturelle NP. Ces terrains proposés par la mairie sont contigus aux terrains ayant déjà fait l’objet d’une compensation de défrichement par les carrières Tavano (AP de défrichement du 20 avril 2017). Ils interviennent à proximité immédiate d’un aménagement routier et paysager de la RD 51.
L’effet sur la sylviculture sera direct, faible et permanent à court terme. En intégrant la compensation, à long terme l’effet sera nul. L’impact économique de ce défrichement sur 2,9 ha est considéré comme « faible » .
Les effets sur l’écologie de ces boisements sont traités au paragraphe 4.
3.3: AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES
Outre l’activité agricole, différentes activités économiques sont présentes au droit de la zone artisanale de la Perrée. Rappelons que l’activité de la centrale à béton, présente dans l’emprise de la carrière est directement liée à la carrière, elle est directement alimentée avec les matériaux issus du site. En dehors de ces activités, la carrière participe à l’économie locale essentiellement par le biais de la sous traitance et du transport des matériaux.
Les effets de la carrière sur les activités économiques sont qualifiés de forts, positifs, directs et indirects, permanents à court et moyen terme sur la durée de l’exploitation. A long terme les effets seront liés à la vocation ultérieure du site. Aujourd’hui le projet prévoit une remise en état à vocation naturelle.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
169
De plus, le maintien de l’activité de la carrière Tavano permet de limiter la pénurie en sables qui s’annonce au niveau régional, ce d’autant qu’en 2033, les deux autres sites autorisés dans le département seront en fin d’autorisation. Soit de nouvelles autorisations seront accordées soit les matériaux seront importés d’autres régions, avec des couts plus importants et des impacts liés au transport (bilan carbone, gaz à effet de serre…..).
3.4: LOISIRS
Dans le secteur, ces activités sont en relation d’une part avec la base de loisirs du Houssay (base nautique, plan d’eau de pêche, camping et chalets) et avec le patrimoine paysager et naturel local pour les randonnées en bordure de Sarthe. Sur les aspects de fréquentation des abords, bien que proches, l’activité sur le site n’aura qu’un impact réduit, la fréquentation se faisant principalement le week-end et la carrière n’ayant ni impact visuel ni impact sonore vis-à-vis de la base de loisirs. Après exploitation, la remise en état du site à vocation naturelle, pourra renforcer l’attrait local des bords de Sarthe. Sur les aspects hydrauliques, le rabattement de nappe temporaire provoqué sur site pour enlever les zones argileuses et permettre la poursuite de l’exploitation pourra générer un rabattement sur le plan d’eau de pêche. Des mesures de protection et de suivi sont envisagées pour palier cet effet négatif. Ces mesures seront détaillées dans le chapitre 7.
Le projet aura donc, par rapport à l’exploitation actuelle, un impact négatif, direct, temporaire (le temps du pompage de rabattement) sur le plan d’eau de pêche de la base de loisirs. A long terme, après exploitation, l’impact pourra être positif et permanent.
4: EFFETS SUR LES BIOCENOSES, LES HABITATS NATURELS ET LES
EQUILIBRES BIOLOGIQUES
Les éléments de ce paragraphe sont tirés de l’étude écologique réalisée par ENCEM.
4.1: EFFETS DIRECTS
L'impact du projet sur la flore, la faune et les habitats naturels des terrains objet de la demande sera direct et permanent, ceux-ci devant être décapés ou défrichés (terrains demandés en extension) ou remaniés (terrains de la carrière).
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
170
Le niveau d’impact direct et négatif sur un milieu naturel donné est proportionnel au niveau de
sensibilité patrimoniale du milieu et à la surface de milieu concerné par le projet.
Les terrains directement concernés par le projet de renouvellement d’autorisation (carrière) présentent une sensibilité patrimoniale répartie selon quatre niveaux :
- niveau « fort » sur une surface d’environ 1 ha (mares 12) ; - niveau « moyen à fort » sur environ 2 ha (pelouse silicicole et bassin 8) ; - niveau « moyen » sur environ 6 ha (plans d’eau 4 et 6, bassins 7, 9, 10 et 111) ; - niveau « moyen à faible » sur environ 40 ha.
L’impact négatif durant l’exploitation de la carrière va augmenter progressivement, au fur et à mesure du remplacement des milieux terrestres et amphibies actuels par des plans d’eau profonds, d’un faible intérêt biologique. L’impact direct négatif du projet de renouvellement d’autorisation sera globalement de
niveau « moyen ».
Les terrains directement concernés par le projet d’extension (prairie, friches, fourrés haies, taillis, peupleraie, pinède) présentent une sensibilité patrimoniale répartie selon deux niveaux :
- niveau « moyen » sur environ 0,2 ha (mares 13 ; cf. note de bas de page) ; - niveau « moyen à faible » sur environ 13,3 ha.
L’impact direct négatif du projet d’extension sera globalement de niveau « moyen à faible ».
L’impact direct et positif du projet sera proportionnel aux potentialités d’accueil des terrains remaniés pour
la faune, la flore et les habitats naturels, notamment pour des espèces et des habitats d’intérêt patrimonial.
L’impact positif de la carrière est actuellement important. Il va régresser progressivement durant l’exploitation mais se maintiendra à un niveau « moyen » sur différents secteurs de la carrière qui continueront d’abriter un ensemble d’espèces patrimoniales (Polypogon de Montpellier, Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Hirondelle de rivage…). C’est après l’arrêt de l’activité que l’impact positif sera le
plus faible.
Zones humides : d’après les critères floristiques, seul l’habitat 8 (pelouse amphibie des mares temporaires)
correspond à une zone humide sur terrain non remanié d’après les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Il s’étend au maximum sur environ 300 m2. Une mesure permettra de compenser l’impact de l’exploitation de cette zone humide (cf. mesure C1).
1 On pourrait ajouter les mares 13 qui, bien que situées à l’extérieur de la carrière, ont probablement été creusées par un engin
lors d’une manoeuvre (reprise d’un stock de matériaux ou de souches par un chargeur, par exemple).
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
171
4.2: EFFETS INDIRECTS
Ce sont les effets induits par l'exploitation de la carrière sur la faune et la flore des milieux situés en périphérie
et donc sur les équilibres biologiques en place sur ces milieux. Les principaux effets envisageables sont soit d'ordre abiotique (bruit, modification du niveau de la nappe phréatique et des écoulements hydrologiques, modification de la qualité physico-chimique des eaux), soit d'ordre biotique (isolement génétique des populations par fragmentation de l'habitat, modification de la ressource alimentaire...).
4.2.1: EFFETS INDIRECTS NEGATIFS ABIOTIQUES
Bruit : au vu d'études réalisées en périphérie de carrières en activité (ECOSPHÈRE, 2001 ; ENCEM, 2008),
il apparaît que les perturbations liées au bruit sont limitées, la majorité des espèces animales s'habituant rapidement à une activité sonore permanente qui n'est pas source de danger. Par ailleurs, l’exploitation à la pelle mécanique limite le niveau sonore de l’exploitation. La présence d’une héronnière à environ 100 m au sud du plan d’eau 4 confirme ce constat (cf. carte de localisation ci-dessous et vue du 7 avril 2015). Cette héronnière abritait 18 nids de Héron cendré en 2015 (donnée LPO Sarthe).
Cours d’eau : le projet est encadré au sud par la Sarthe et au nord par le ruisseau temporaire du Buard
qui rejoint la Sarthe au niveau du bourg de Spay. L’exploitation restera à une distance minimale de 50 m des berges de la Sarthe. A cette distance, aucun
effet indirect n’est envisageable sur cette rivière.
Plan d’eau 4
Héronnière
Bois 2
Bois 3
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
172
Le ruisseau du Buard borde les terrains objet de la demande sur un linéaire d’environ 500 m. Ce cours
d’eau pourrait être l’objet de pollutions liées à l’activité de la carrière (fines argileuses, hydrocarbures).
Des mesures spécifiques de protection des eaux superficielles et souterraines ont été mises en place par la société TAVANO dans le cadre de l’exploitation actuelle pour limiter les risques de pollution. Elles sont présentées de façon détaillée dans le chapitre relatif aux eaux superficielles et souterraines.
Zones humides : du fait de la présence de la Sarthe et de nombreux plans d’eau d’extraction à proximité du projet, des zones humides sont susceptibles d’être affectées indirectement par l’exploitation.
Les plans d’eau anciens situés à proximité du projet sont tous aménagés avec des berges en pente forte (30 à 40°) très peu favorables à l’installation de ceintures de végétation amphibie. Au niveau des berges de la Sarthe se développent localement des formations hygrophiles de type mégaphorbiaie mais celles-ci sont distantes d’au moins 60 m de la zone exploitable.
Aucun effet indirect sur des zones humides n’est prévisible dans le cadre du projet.
4.2.2: EFFETS INDIRECTS NEGATIFS BIOTIQUES
Fragmentation d’habitats naturels : les amphibiens sont susceptibles d’être perturbés par une
fragmentation de leur habitat, celui-ci étant constitué d’un habitat aquatique de reproduction et d’un (ou deux) habitat(s) terrestre(s) d’estivage et d’hivernage.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
173
Commune de Spay (72) - Projet SAS CARRIÈRES TAVANO
Carte 5 : CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Localisation du projet
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
174
Dans le cas présent, deux espèces d’amphibiens sont assez abondantes sur l’aire d’étude : le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué. Ces deux espèces affectionnent les milieux ouverts ensoleillés et les substrats meubles dans lesquels ils peuvent s’enfouir facilement pour s’abriter et hiverner. Le Pélodyte fréquente également les boisements humides en période d’hibernation Il est donc probable qu’une grande partie de la population d’amphibiens de l’aire d’étude accomplit l’ensemble de son cycle biologique sur la carrière et ses abords immédiats. La création de grands plans d’eau va induire progressivement une fragmentation de l’espace utilisé par ces amphibiens, ainsi qu’une réduction des sites de reproduction. Les populations qui subsisteront sur les marges de la carrière seront donc, à terme, isolées les unes des autres.
Ressource alimentaire : l’aire d’étude abrite un ensemble assez diversifié d’habitats utilisés par diverses
espèces animales localisées en périphérie du site et qui viennent s’y alimenter (Héron cendré par exemple). Ces habitats vont être remplacés progressivement par des plans d’eau, ce qui induira une réduction de la ressource alimentaire. Des aménagements à vocation écologique sur une partie des plans d’eau permettront de limiter cet effet.
Continuités écologiques : le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région des Pays de
la Loire a été adopté par arrêté préfectoral du 30 octobre 2015. Il est consultable sur le site internet de la DREAL.
La carte du SRCE au 1/100 000 (cf. carte des continuités écologiques) représente le cours de la Sarthe en tant que réservoir de biodiversité (sous-trame des milieux aquatiques) et fait apparaître la présence d’un corridor potentiel au niveau de la Sarthe et de ses abords (corridors vallées). Cette situation n’évoluera pas dans le cadre du projet. Le maintien d’une bande de terrain inexploitée d’une largeur minimale de 60 m entre la rive nord de la Sarthe et la zone exploitable permettra de conserver la fonctionnalité du corridor. Les données de terrain ne permettent pas de définir de zone préférentielle de déplacement de la faune et de la flore au sein de l’aire d’étude.
Espèces invasives : la carrière est potentiellement favorable au développement d’espèces végétales invasives susceptibles de coloniser les milieux naturels situés en périphérie.
Les relevés floristiques ont révélé la présence de sept espèces et d’un groupe d’espèces végétales
estimées invasives par le Conservatoire botanique national de Brest pour la région des Pays de la Loire (DORTEL F. et al., 2013). Elles figurent dans le tableau ci-dessous :
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
175
Nom français Nom scientifique Statut en Pays de la Loire Habitat sur l’aire d’étude
Epilobe d’automne Epilobium brachycarpum Inv PDL [AS] 4 (friche maigre)
Jonc grêle Juncus tenuis Inv PDL[AS] 9 (bois 3), 3c (pelouse humide)
Lentille d’eau minuscule Lemna minuta Inv PDL[IA] 3a (plan d’eau 6, mare 14)
Onagre à grandes fleurs Oenothera erythrosepala Inv PDL[AS] 4, 5 (carrière), 11 (friche prairiale)
Raisin d’Amérique Phytolacca americana Inv PDL[IP] 4 (friche maigre)
Séneçon du Cap Senecio inaequidens Inv PDL[IP] 16 (haie 5)
Stramoine Datura stramonium Inv PDL [AS] 4 (friche maigre)
Vergerette Conyza sp. Inv PDL [IP] et [AS] 4 (friche maigre), 5 (pelouse sèche)
Une seule espèce est classée « invasive avérée1 » : la Lentille d’eau minuscule. Elle semble peu abondante sur les deux secteurs où elle a été observée : le plan d’eau 6 et la mare 14. Deux espèces sont classées « invasives potentielles » : le Raisin d’Amérique et le Séneçon du Cap. Elles sont très peu abondantes sur l’aire d’étude. Le taxon Conyza sp. comprend une espèce invasive potentielle : Conyza sumatrensis. Les quatre autres espèces et les autres espèces du taxon Conyza sp. sont classées « invasives à surveiller ». L’impact du projet sur les espèces invasives semble donc réduit. On peut noter l’absence de la Jussie (Ludwigia sp.), taxon invasif avéré. La régression des milieux sableux secs au profit des surfaces en eau réduira les potentialités d’accueil du site pour les plantes invasives.
4.3: EFFETS SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES
Le tableau ci-dessous fait le récapitulatif des espèces animales protégées qui sont directement concernées par le projet (terrains devant être exploités ou remaniés) et qui réalisent une partie ou la totalité de leur cycle biologique sur ces terrains. Les espèces patrimoniales de niveau « assez sensible » sont surlignées en vert et celles de niveau « sensible » en jaune.
1 Les plantes invasives sont classées en trois catégories : les plantes invasives avérées (ayant un caractère envahissant avéré),
les plantes invasives potentielles (ayant une tendance à montrer un caractère envahissant) et les plantes invasives à surveil ler
(n’ayant pas de tendance au développement d’un caractère envahissant dans la région considérée).
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
176
Groupe Nom français Nom scientifique Effectif et localisation
Amphibiens
Crapaud calamite Bufo calamita
1 adulte sur piste au nord du plan d’eau 1 2 à 3 cht au sud-est du bassin 9 2 juv. sous une plaque à l’est de la plaque 8 Bassin 7 nord : 7 pontes + 10 à 15 cht Bassin 8 : 7 pontes Mares 12 : 19 pontes + 10 à 15 cht Mares 13 : 14 pontes + 10 cht dans la mare nord
Crapaud épineux Bufo spinosus ++ juv. bassin 10 1 juv. sur piste au nord du bois 2
Grenouille verte Pelophylax sp.
Plan d’eau 3 : 5 à 10 cht au nord + 5 cht au sud-ouest Plan d’eau 6 : 10 à 20 cht Bassin 7 : 3 à 5 cht Bassin 8 : 5 à 10 cht + 5 juv. Bassin 9 : 5 à 10 cht Bassin 11 : 1 à 5 ind. Mare 14 : 5 à 10 cht
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus
Bassin 7 : 3 à 5 cht Bassin 8 : 4 cht Bassin 9 : 5 à 10 cht Bassin 10 : 3 cht Mares 12 : 15 pontes + 10 à 15 cht Bois 2 : 1 cht sur la bordure nord
Triton palmé Lissotriton helveticus 2 mâles bordure est du plan d’eau 3
Reptiles
Couleuvre à collier Natrix natrix 1 juvénile au nord-ouest du plan d’eau 6 Lézard des murailles Podarcis muralis Bien présent sur l’aire d’étude (15 observations) Orvet fragile Anguis fragilis 1 adulte sous la plaque 4
Oiseaux
Accenteur mouchet Prunella modularis ++ NPo haies 1 et 2, fourrés 1, bois 1 Bergeronnette grise Motacilla alba 1c NC centrale béton, + NPo carrière Bouscarle de Cetti Cettia cetti 1 NPo bois 1 Buse variable Buteo buteo 1 A , 1 NPo bois 3 (1 aire de rapace) Coucou gris Cuculus canorus 1 NP bois 3 Faucon crécerelle Falco tinnunculus + A, 1 NP arbres à l’ouest du plan d’eau 1 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla ++ NP haies 2, 3, 4 et 5, fourrés 1, bois 1 et 3 Fauvette des jardins Sylvia borin + NPo haies 4 et 5, fourrés 1, bois 1 Fauvette grisette Sylvia communis + NP haie 4 Gobemouche gris Muscicapa striata NC bois 2 Grèbe huppé Podiceps cristatus 3c NP plans d’eau 1, 3 et 6 Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla + NP haies 1 et 2, bois 2 Hirondelle de rivage Riparia riparia ++ NC plan d’eau 4, + NC plan d’eau 2 et bassin 7 Huppe fasciée Upupa epops 1 A mares 12 et 13, 1 NC haie 5, 1 NPo haie 2 Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta + NP haies 3 et 4, fourrés 1 et 2 Linotte mélodieuse Linaria cannabina + NP haie 4 Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis 1 NP plan d’eau 6 berge sud-ouest Mésange à longue queue Aegithalos caudatus + NPo haie 4, bois 2 Mésange bleue Parus caeruleus + NP haies 3 et 5, bois 1, 2 et 3 Mésange charbonnière Parus major + NP haies 2, 3 et 5, bois 1, 2 et 3 Mésange huppée Lophophanes cristatus 1 NPo bois 3 Mouette rieuse Larus ridibundus + NC plans d’eau 1 (est), 2 (2016) et 3 (sud) Petit Gravelot Charadrius dubius 1c ou 2c NC carrière Pic épeiche Dendrocopos major + NP bois 2 et 3 Pic vert Picus viridis + NP haie 3, bois 2
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
177
Groupe Nom français Nom scientifique Effectif et localisation
Pinson des arbres Fringilla coelebs ++ NP haies 1, 2, 3, 4, fourrés 1, bois 1, 2 et 3 Pouillot véloce Phylloscopus collybita ++ NP haies 3 et 5, bois 1 et 3 Roitelet huppé Regulus regulus + A haie 1, NPo bois 3 Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos + NP haie 4, bois 1 Rougegorge familier Erithacus rubecula ++ NP haies 1, 2 et 6, bois 1, 2 et 3 Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 1 NP bâtiment accueil, + NPo carrière Serin cini Serinus serinus + NPo haie 2 et 4 Sittelle torchepot Sitta europaea + NP haie 5, bois 2 et 3 Sterne pierregarin Sterna hirundo + NC plan d’eau 3 (pointe sud) et plan d’eau 2 (2016) Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes ++ NP haies 1, 2, 3, 4 et 6, fourrés 2, bois 1, 2 et 3 Verdier d’Europe Chloris chloris + NP haie 4 et 6, fourrés 1
Mammifère Ecureuil roux Sciurus vulgaris + haie 2, bois 2 et 3
Se reporter aux légendes des tableaux de l’annexe 2 pour la signification des symboles et abréviations.
Sur les 47 taxons protégés se reproduisant ou s’abritant sur l’aire d’étude, 45 sont directement concernés par le projet et 3 sont estimées de niveau « sensible » vis-à-vis de leur intérêt patrimonial.
La répartition par groupe biologique est la suivante :
- 4 espèces et 1 groupe d’espèces d’amphibiens (dont deux espèces patrimoniales de niveau « sensible »)
; - 3 espèces de reptiles ; - 36 espèces d’oiseaux (dont une espèce patrimoniale de niveau « sensible »); - 1 espèce de mammifère.
Des individus des populations des cinq taxons d’amphibiens, des trois espèces de reptiles, de Bergeronnette grise et de Rougequeue noir sont susceptibles d’être détruits par les travaux d’exploitation. Il s’agit cependant d’espèces ubiquistes et/ou très bien adaptées aux gravières, qui vont se maintenir durant la période autorisée. Des couvées de Grèbe huppé, Hirondelle de rivage, Martin-pêcheur d’Europe, Mouette rieuse, Petit Gravelot et Sterne pierregarin sont également susceptibles d’être détruites par les travaux d’exploitation. Cet impact peut être facilement évité par des mesures saisonnières de protection des zones de reproduction (mesures R3, R4 et R5) et par un suivi conjoint LPO Sarthe/société TAVANO des populations nicheuses (mesure A4 ; suivi en place depuis 2010). Les 28 espèces d’oiseaux liées aux structures boisées (fourrés, haies buissonnantes et arborées, peupleraie, taillis de chênes, pinède) ne seront concernées que par une destruction d’habitats sur une surface d’environ 6,7 ha. Aucune destruction d’individus n’aura lieu si la mesure de protection des structures boisées durant la phase de reproduction est respectée (mesure R2).
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
178
L’Ecureuil roux occupe la pinède sur une surface d’environ 5 ha. Il ne sera concerné également que par une destruction d’habitat. La Noctule commune est une chauve-souris arboricole qui a été contactée sur l’aire d’étude et qui pourrait donc être impactée par la coupe d’arbres comportant des cavités. Deux mesures seront prises pour éviter cet impact (mesures E2 et R7). Malgré la mise en place des mesures de protection de la faune protégée, un risque de destruction d’individus subsiste. De ce fait et conformément à la législation en vigueur, une demande de dérogation relative aux espèces protégées sera déposée par la société TAVANO.
4.4: INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
Le site Natura 2000 le plus proche des terrains du projet est le SIC FR5200647 « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan », d’une superficie de 3 800 ha et localisé à environ 14 km à l’est. Ce site regroupe les vallées de deux cours d'eau et une partie du massif forestier de Bercé. Il abrite plusieurs étangs et zones humides enserrées dans des massifs forestiers privés et dans le camp militaire d'Auvours. Plusieurs parcelles de la forêt de Bercé, incluses dans le site, contiennent des vieux arbres remarquables, habitats potentiels du cortège des insectes sapro-xylophages. On y observe une intéressante diversité d'habitats et de groupements végétaux : étangs à riche végétation aquatique et amphibie, cours d'eau à courant vif, landes humides à éricacées, landes sèches à bruyères et genêts, prairies tourbeuses à Molinie, tourbières acides à sphaignes et tourbières alcalines1. Ce site abrite 17 espèces d’intérêt communautaire : 7 espèces d’insectes (Gomphe serpentin, Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure, Lucane cerf-volant, Pique-prune, Grand capricorne et Ecaille chinée), 3 espèces de poissons (Lamproie de Planer, Loche d’étang et Chabot), 1 espèces d’amphibien (Triton crêté) et 6 espèces de chauves-souris (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein et Grand Murin). A cette distance de 14 km, aucun effet direct ou indirect lié à l’exploitation de la carrière n’est susceptible d’affecter ce site. Le tableau ci-dessous présente le bilan des effets potentiels et les raisons pour lesquelles le site Natura 2000 n’est pas concerné.
1 Source : site internet de l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN).
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
179
Type
d’effet Nature de l’effet
Raisons pour lesquelles le site Natura 2000 « Vallée du Narais, forêt de
Bercé et ruisseau du Dinan» n’est pas concerné par les effets du projet
Direct Destruction d’habitats naturels Le site Natura 2000 est situé à 14 km du projet.
Indirect
Emissions sonores
A partir du niveau sonore maximal susceptible d’être émis par la carrière et en utilisant la formule d’atténuation du bruit avec la distance, on peut connaître le rayon maximal d’influence sonore de l’exploitation. Dans le cas présent, le rayon d’influence sonore de la carrière ne dépassera pas quelques centaines de mètres.
Rejets d’eau dans le milieu naturel (pollution et/ou modification de l’alimentation en eau)
La carrière n’émet aucun rejet d’eau dans le milieu naturel. Par ailleurs, elle n’appartient pas au même bassin versant que celui du site Natura 2000.
Effet biotique
(modification de la ressource alimentaire, perturbation dans le déplacement des animaux…)
Les effets biotiques du projet porteraient sur des espèces réalisant de grands déplacements quotidiens (alimentation) ou saisonniers (migration). Les espèces concernées par des déplacements quotidiens de plus de 14 km sont limitées à quelques grands oiseaux (notamment des rapaces) et quelques mammifères, dont quelques espèces de chiroptères (les déplacements de la majorité des espèces françaises de chiroptères ne dépassent pas un rayon de 5 à 6 km1). Parmi les six espèces de chiroptères du site Natura 2000, seuls le Murin à oreilles échancrées et le Grand Murin ont des territoires de chasse qui atteignent et dépassent parfois 14 km. Les terrains du projet d’exploitation peuvent donc constituer une zone de chasse pour ces deux espèces à partir du site Natura 2000 ou de ses abords (il s’agit d’espèces cavernicoles en hiver et liées aux bâtiments pour la mise-bas ; la localisation des colonies n’est donc pas connue). Leur surface représente environ 0,1 % d’un territoire de chasse de 14 km de rayon. L’impact éventuel du projet sur l’alimentation de ces deux espèces paraît donc négligeable. Pour ce qui concerne les déplacements de migration, la carrière ne possède aucune infrastructure susceptible de gêner les animaux. Le projet n’induira pas de rupture entre différents milieux utilisés par des espèces au cours des différentes phases de leur cycle biologique (amphibiens notamment).
1 Arthur L. et Lemaire M., 2009.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
180
5: EFFETS SUR LES TERRES ET LES SOLS
5.1: TOPOGRAPHIE
La carrière étant déjà en exploitation depuis de nombreuses années, la phase de chantier correspondant à la mise en place des éléments d’exploitation (installations, atelier, locaux…) est déjà réalisée.
En phase de chantier, l’effet sur la topographie, lié au décaissement, est donc nul.
Durant la phase d’exploitation de la carrière, l’effet sur la topographie sera directement lié à l’activité, dont la finalité est le prélèvement de matériaux. La sablière sera exploitée jusqu’à une cote minimale de 24 m NGF. La partie exploitée hors eau, correspondant à la hauteur des berges de l’ordre de 2 à 4 selon le niveau d’eau. Le changement par rapport à la situation actuelle sera lié à l’approfondissement des plans d’eau et à l’extension de ces derniers. La perception de la modification de topographie sera donc particulièrement réduite. L’effet de l’exploitation se traduit également par la présence de stockages, d’une dizaine de mètres de hauteur Précisons que ces stocks sont déjà existants et ne constituent pas un élément visuel nouveau.
Des mesures, déjà en place, permettent de réduire la perception de ces effets, elles sont décrites au chapitre 7.
L’effet lié à l’agrandissement et approfondissement des plans d’eau sera progressif mais permanent. L’effet lié à la présence de stocks ne sera que temporaire. Après exploitation, la totalité des stocks aura disparu.
Les incidences sur le paysage et les perceptions visuelles qui découlent des effets topographiques sont traités dans les paragraphes relatifs à ces effets.
5.2: SOLS
L’effet sur les sols, au sens pédologique du terme, résultera du décapage et du stockage de la terre végétale liés à l’exploitation (décapage de 0,8 m d’épaisseur moyenne dont 0,3 m de terre végétale). Seules les zones sollicitées en extension seront concernées, l’exploitation actuelle étant déjà décapée en totalité. Rappelons que le décapage concerne une surface de l’ordre de 7,5 ha pour une surface de projet de l’ordre de 54 ha (14%), pour un volume global de découverte (terre végétale inclue) de 60 000 m3. Ces opérations ont généralement pour conséquence de modifier les caractéristiques structurales et les qualités des sols (agronomique ou forestière) :
le décapage pourrait modifier la structure du sol (effet direct),
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
181
le stockage de la terre végétale pourrait entraîner une dégradation de ses qualités par lessivage progressif des minéraux et compactage, entraînant une perte de structure (effet indirect),
la remise en place non maîtrisée de la terre végétale pourrait occasionner un tassement préjudiciable à la reprise de la végétation.
Compte tenu de la vocation des terrains du projet après exploitation (plans d’eaux avec abords enherbés, ces effets sont et resteront faibles, négatifs mais temporaires (stockage de la terre végétale avant réutilisation). Aucune mesure particulière, en dehors des mesures habituelles de préservation et réutilisation de la terre végétale, ne seront mises en place.
L’impact potentiel d’un déversement accidentel d’hydrocarbures concerne les sols et les eaux (cet aspect est traité dans le paragraphe suivant). Un déversement accidentel serait susceptible d’affecter le sol et les eaux superficielles et souterraines, ces dernières étant en relation directe par le biais des plans d’eau. Par ailleurs, le sol constitue un substrat pour les espèces végétales et représente un support d’habitats, dont certains présentent des enjeux écologiques. Les impacts seront toutefois faibles pour les premières et négligeables pour les seconds. Des mesures de protection et prévention sont déjà en place vis-à-vis des risques de pollution des sols et des eaux. Elles seront détaillées dans le chapitre 7.
6: EFFETS SUR LES EAUX
L’analyse des effets sur les eaux est pour partie traitée dans l’étude réalisée par TERRAQUA, jointe en intégralité au dossier (note finale annexe hors texte). Seuls les principaux éléments sont retranscrits dans ce chapitre.
6.1: MODES ET CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
L'exploitation de la carrière (extraction et traitement) nécessitera différents apports en eau décrits ci-après à partir des différents circuits. Besoins du personnel :
eau du réseau public pour les locaux (sanitaires, réfectoire) présents sur site, Alimentation en eau des équipements annexes :
Ces équipements correspondent aux systèmes : d’arrosage des pistes, alimenté à partir du pompage dans le plan d’eau , pompage existant et servant
aussi à l’alimentation des installations de traitement (300 m3/h). de lavage des engins (nettoyeur haute pression), à partir du pompage dans le plan d’eau.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
182
Besoins en eau pour le lavage des matériaux
L’eau nécessaire au traitement des matériaux est et restera prélevée par le biais d’un pompage de 300 m3/h dans le plan d’eau central le plus proche de la zone de traitement. Le système est actuellement équipé d’un compteur volumétrique.
La décantation des eaux de lavage des matériaux se fera en circuit fermé et sera assurée par un réseau de bassins et chenaux curés régulièrement, à l’ouest de l’installation de traitement, avec un retour des eaux décantées dans le plan d’eau central de pompage. Besoins en eau pour l’extraction
Drague aspiratrice : utilisation temporaire Le débit d’extraction de cet engin est de 1 000 m3/h, dont 80 % d’eau et 20% de granulats. La profondeur de dragage vis-à-vis du niveau d’eau est de 14 mètres maximum.
Le rejet de la pulpe s’effectuera par une conduite de refoulement dans un bassin de réception situé à l’ouest des installations de traitement dans lequel les sables ressuient jusqu’à leur reprise par une pelle hydraulique. Les eaux résiduelles s’écouleront ensuite vers le circuit de décantation avec retour dans le plan d’eau central.
Extraction spécifique des argiles discontinues Le rabattement temporaire de nappe, permettant d’extraire les niveaux argileux à sec à l’aide d’une pelle hydraulique, nécessitera un pompage d’une capacité de 300 m3/h. Les eaux issues du pompage seront renvoyées dans le plan d’eau des Pelouses avec une surverse en cas de trop plein vers le plan d’eau central. Ce pompage temporaire ne sera réalisé qu’en présence d’argiles reconnues lors de l’extraction du gisement.
6.2: INCIDENCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
L’exploitation entraine une mise à nu des eaux souterraines et une captation partielle des eaux superficielles. Les effets sont donc très proches et toute disposition pour l’un de ces deux compartiments est bonne pour l’autre, les écoulements souterrains et superficiels sont donc traités ensemble.
6.2.1: INCIDENCE VOLUMETRIQUE
Les prélèvements nécessaires au lavage des matériaux, à l’usage de la drague-aspiratrice ou à la réalisation d’un rabattement de nappe temporaire n’auront pas d’incidence dans la mesure où le rejet sera renvoyé dans le milieu naturel au sein de la carrière.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
183
La quantité d’eau potentiellement non restituée au milieu naturel est liée à la fraction humide restante sur les matériaux vendus. Elle est estimée à environ 3% du tonnage annuel maximal produit soit à environ 6 000 m3/an représentant moins de 1 m3/h.
Lors de la création de plans d’eau, la nappe mise à l’air est assujettie aux précipitations et à l’évaporation. Dans le secteur du projet, les données annuelles statistiques de ces deux paramètres climatiques s’équilibrent1.
L’incidence volumétrique du projet sur l’état quantitatif de la masse d’eau souterraine sera mineure, d’autant qu’elle présente un bon état quantitatif. Pour comparaison, le volume théorique de prélèvement non restitué lié au projet (< 1 m3/h) est infime vis-à-vis du QMNA5 de la Sarthe (7,1 m3/s).
L’effet volumétrique est donc considéré comme négligeable, temporaire, à court et moyen terme. A long terme, après exploitation, l’effet est nul.
6.2.2: INCIDENCE PIEZOMETRIQUE
Le réservoir-aquifère constitué localement par la nappe des alluvions de la Sarthe et par la nappe des sables cénomaniens est perméable et transmissif. Les suivis piézométriques et limnimétriques effectués sur la carrière TAVANO ont montré qu’il existait des échanges « nappe/rivière » indiquant que les berges n’étaient pas colmatées. Les écoulements souterrains sont drainés par la Sarthe selon une direction générale Nord-Ouest/Sud-Est avec une orientation possible Nord-Sud à l’Ouest de la carrière. La piézométrie pourra être localement perturbée au voisinage des zones de remblai et des plans d’eau mais les écoulements conserveront leur direction générale vers la Sarthe dont l’effet de drainage est plus important. Des mesures seront mises en place vis-à-vis des modifications locales de piézométrie. Elles seront détaillées dans le chapitre 7. Le gradient hydraulique de la nappe est naturellement très faible dans le secteur de la carrière, ce qui indique que son abaissement à l’amont des plans d’eau et son élévation à l’aval seront peu modifiés vis-à-vis de la configuration actuelle du site et en évitant le colmatage des berges aval. Cette modification sera d’autant plus faible puisque les gravières sont en partie envisagées de manière perpendiculaire au sens d’écoulement de la nappe.
Les modifications locales de piézométrie sont considérées comme directes, temporaires à court moyen et long terme. Précisons que seul l’effet de rabattement de nappe issu du pompage pour l’extraction sélective des argiles est nouveau vis-à-vis de l’exploitation.
1 Normale pluviométrique annuelle à la station du Mans (1981-2010) : 687,5 mm / Evapotranspiration moyenne annuelle évaluée par le
passé à partir de différentes méthodes de calculs (Penman, Turc et Tornthwaite) : 663 mm.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
184
6.3: EFFETS SUR LA QUALITE DES EAUX
Les risques sur l’aspect qualitatif des eaux souterraines liés à la carrière et à sa remise en état concernent :
une modification de la qualité physico-chimique de la ressource en eau du fait :
o de la mise à l’air atmosphérique de la nappe entrainant notamment un phénomène de photosynthèse mis en œuvre par des organismes végétaux qui se développent dans les plans d’eau. → L’existence de plans d’eau dans l’emprise de la carrière et d’anciennes gravières dans son proche environnement suppose que la nappe a déjà acquis ses caractéristiques physico-chimiques, aujourd’hui en équilibre avec les milieux superficiels ;
o du rejet des eaux de lavage chargées en particules fines pouvant augmenter la turbidité des eaux superficielles mais également colmater les berges « aval » avec un risque de débordement et d’eutrophisation. → Les suivis limnimétriques et piézométriques ont démontré la continuité « plan d’eau/nappe » et attesté qu’il n’y avait pas de colmatage au niveau des berges ;
o de la nature des matériaux servant à la remise en état du site. → Il n’y aura pas d’apport de matériaux extérieurs.
une pollution accidentelle pouvant provenir en phase d’exploitation des engins de chantier (ravitaillement, entretien, problème technique) ou du déversement de produits de maintenance
→ Des mesures de protection existent déjà et de nouvelles sont proposées dans le chapitre 7.
L’impact du projet sur l’aspect qualitatif des eaux sera peu important, si ce n’est de rendre la nappe plus vulnérable aux pollutions accidentelles du fait :
de la nature perméable des terrains ; de son caractère libre et subaffleurant ; et de l’agrandissement des plans d’eau l’exposant davantage.
L’impact lié à la vulnérabilité est et restera direct et permanent, par contre le risque de pollution est et restera direct mais temporaire, lié aux périodes d’exploitation.
Rappelons qu’aucune pollution des eaux n’a été recensée à ce jour sur le site d’exploitation.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
185
6.4: INCIDENCE SUR LES USAGES DES EAUX SOUTERRAINES
6.4.1: CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Aucun captage d’eau potable du type forage ou prise d’eau en rivière n’est répertorié dans le proche environnement de la carrière TAVANO à Spay.
Le projet n’aura donc aucun impact tant quantitatif que qualitatif sur les captages d’eau potable.
6.4.2: ETANGS DE PECHE DE LOISIR
Deux étangs de pêche sont identifiés aux abords :
L’étang de pêche de la base de loisirs du Houssay L’étang de pêche privé de la société Garczinsky Traploir, géré par le comité d’entreprise.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
186
Le seul effet pouvant perturber l’usage de ces plans d’eau de pêche est la baisse du niveau d’eau du au rabattement temporaire pour extraire sélectivement les argiles. Cet effet est déjà développé ci-dessus, pour rappel des mesures seront mise en place, elles seront détaillées dans le chapitre 7.
6.4.3: AUTRES USAGES
L’impact de l’exploitation sur les puits et forage du voisinage est lié aussi à la variation piézométrique potentielle de la nappe sous l’effet du pompage pour exploiter sélectivement les argiles. 7: EFFETS SUR L’AIR ET LE CLIMAT
7.1: EFFET SUR L’AIR
7.1.1: POUSSIERES
Les effets potentiels
Les effets éventuels liés aux envols de poussière sur l'environnement naturel et humain sont de plusieurs ordres : ► Nature des effets potentiels des poussières sur l’environnement
- effets sur l’esthétique des paysages et des bâtiments : coloration après dépôt des poussières, - effets sur les cultures, la végétation et le sol : limitation de la photosynthèse chez les végétaux. Ce
sont des effets à long terme dépendant de la nature des poussières qui ne peuvent s'apprécier qu'après de longues périodes de contrôle,
- effets sur la santé publique (inhalation des poussières : irritation du système respiratoire, irritation des yeux),
- effets sur la sécurité publique : salissures sur les chaussées des routes, risques d’accidents.
► Autres inconvénients pour les riverains pénétration de poussières dans les habitations, dépôts sur le linge… dégradation de la qualité paysagère d’un site.
Ces effets sont liés à des situations particulièrement critiques, ce qui est loin d’être le cas en périphérie du secteur d’extraction compte tenu des modalités d’exploitation et de traitement mises en œuvre.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
187
Vis-à-vis des émissions de poussières, la réglementation ne demande pas d’établir un plan de
surveillance pour les exploitations en eau
Inventaire des points d’émissions et détermination des habitations sensibles.
Vis-à-vis des émissions de poussières, les points les plus sensibles potentiellement (en ne tenant pas compte de la présence d’écrans tels que les haies) sont situés sous les vents dominants par rapport aux sources de poussières. Les habitations le plus sensibles sont aussi les plus proches, à savoir :
L’enfournoire, sous les vents de sud-ouest essentiellement de l’installation La Perrée, sous les vents de sud/sud-est, pour l’exploitation de la partie ouest du site Les pelouses, sous les vents de nord-est, vis-à-vis de l’exploitation de la partie nord du site.
Les points potentiels d’émission de poussières : - L'extraction sera réalisée en majorité en fouille noyée. L'humidité naturelle du matériau extrait limitera
donc tout envol de poussières. - Les opérations de décapage, de remise en état ainsi que la circulation des tombereaux lors des travaux
de décapage pourront engendrer des envols par temps sec et venteux. Ces opérations de décapage seront menées par campagnes d’une durée respective d’un mois environ. Rappelons que très peu de surface reste à décaper.
- Les opérations de traitement pourront être à l'origine d'émissions de poussières, du fait de l'emploi de cribles et de broyeurs. Dans la mesure où le matériau extrait est humide et criblé sous eau, les possibilités d'envols de poussières seront limitées.
- La gêne créée par la circulation des engins (tombereaux et camions) sera limitée puisque la circulation sera effectuée sur une piste privée aménagée à l’écart des habitations.
Des mesures de protection vis-à-vis de ces envols seront toutefois mises en place Les effets potentiels sur les cultures sont traités au paragraphe 3.1, relatif aux effets sur l'agriculture.
Les envols de poussière sont des effets directs et temporaires de l'exploitation.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
188
7.2: REJETS ATMOSPHERIQUES, FUMEES ET ODEURS
7.2.1: LES REJETS ATMOSPHERIQUES
Il n’y a et aura pas d’autres rejets atmosphériques que ceux générés par les engins (pelle et chargeur, tombereau), et les camions en rotation pour l’évacuation des matériaux. Nous avons précisé que l’exploitation de la carrière émettra environ 36 tonnes d’eq carbone par an (133 tonnes eq CO21) soit 0,9 kg eq CO2 par tonne de granulats (base production moyenne de 150 000 t/an)) Ce niveau est très faible par rapport à d’autres activités industrielles : 2
- 0,35 Mt CO2/an pour une cimenterie-type produisant 500 000 t/an (700 kg eq CO2 par tonne de ciment),
- 0,09 Mt CO2/an pour une verrerie-type produisant 150 000 t/an (600 kg eq CO2 par tonne de verre). Source : Cement Sustainability Initiative
Source : Fédération des chambres syndicales de l’industrie du verre
Les rejets atmosphériques sont des effets directs et temporaires de l’exploitation.
7.2.2: ODEURS ET FUMEES
Elles peuvent provenir de deux sources :
- le fonctionnement des moteurs thermiques des engins de chantier et des camions de transfert, - le brûlage accidentel de matériaux divers ou d’hydrocarbures.
1https://www.connaissancedesenergies.org/gaz-effet-de-serre-quest-ce-que-l-equivalent-co2-170807#notes Précisons que certains organismes préfèrent utiliser « l’équivalent carbone » (eq C) à l’équivalent CO2, notamment car ce dernier laisse à penser que seul ce gaz est pris en compte. Sachant qu’un kilogramme de CO2 contient près de 273 grammes de carbone, 1 eq CO2 ≈ 0,273 eq C et 1 eq C ≈ 3,67 eq CO2 2 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2011/Climat_2011/FRI%20REPERES%202010%20FR-INFOS%20PRATIQUES.pdf
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
189
Les seules émanations permanentes produites seront celles dues aux gaz d’échappement provenant des moteurs thermiques. Ces moteurs sont et seront régulièrement entretenus et leurs émissions seront maintenues conformes aux normes en vigueur. Un incendie sur un engin ou sur un réservoir d’hydrocarbures engendrerait des émissions importantes de fumées. La gêne serait cependant brève et d’extension limitée. Conformément à la réglementation, tout brûlage est et sera interdit sur le site. Par conséquent, aucun rejet d’éléments toxiques dans l’air n’est à craindre.
Compte tenu de ces éléments, le fonctionnement « normal » de l’exploitation ne générera pas d’émissions d’odeurs et de fumées susceptibles de gêner le voisinage. Les émissions liées au fonctionnement des moteurs thermiques des engins et camions créent un impact temporaire lié aux seules périodes d’activité, direct sans conséquence particulière sur le voisinage et faible compte tenu du nombre d’engins utilisés.
Les effets sur la qualité de l’air seront strictement identiques à ceux de l’exploitation actuelle : même
production, mêmes engins, mêmes horaires de fonctionnement.
7.3: EFFET SUR LE CLIMAT
D’une manière générale, l’effet sur le climat peut être dû :
à la création de plans d’eau qui peut influencer très localement l’équilibre thermique des masses d’air aux émissions de gaz à effet de serre et principalement aux émissions de dioxyde de carbone (CO2)
résultant de la combustion de matières carbonées fossiles.
7.3.1: EQUILIBRE THERMIQUE DES MASSES D’AIR
D’après une étude financée par l’agence de l’eau Artois Picardie : L'appréciation de l'impact climatique d'une nappe d'eau nécessite l'analyse de longues séries de mesures, qui ne sont que rarement disponibles. On peut toutefois faire état des résultats obtenus lors d’une étude spécifiquement dédiée aux incidences climatologiques résultant de l'existence ou de la création de plans d'eau.
Les travaux d’Antonioletti et Al (« Influence d’une nappe d’eau sur le micro climat » - Journal des Recherches Atmosphériques , 1982) ont porté sur l’étude des variations de température et d’hygrométrie de part et d’autre d’un étang de taille moyenne (100 ha). Ces travaux ont mis en évidence un effet thermique modérateur (élévation de température nocturnes, abaissement des
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
190
températures diurnes), surtout sensible en été lorsque l’écart thermique air-eau est maximal. L’humidité spécifique de l’air apparait légèrement plus élevée à proximité immédiate du plan d’eau, mais cette élévation devient très peu sensible à quelques centaines de mètres.
Les résultats tendent à montrer que l’incidence climatique éventuelle d’un plan d’eau diminue rapidement avec la distance, et reste de toute façon mineure par rapport aux variations climatiques constatées à moyen et long terme. Dans le cadre du projet :
d’une part la taille des plans d’eau est sans commune mesure avec celui de l’étude citée, les effets en seront donc encore amoindris.
D’autre part, les surfaces en eau sont largement représentées aux alentours (Sarthe et les différents plans d’eau) pour que l’agrandissement des plans d’eau de quelques hectares n’ait pas d’influence sur l’hygrométrie et les effets thermiques.
L’influence climatique du projet peut donc être qualifiée de négligeable, à court, moyen et long terme ; Aucune modification ne se fera sentir par rapport à la situation actuelle.
7.3.2: CONSOMMATION ENERGETIQUE
Classiquement, l’exploitation d’une carrière requiert des consommations énergétiques liées à l’emploi de l’électricité et de carburant. L’électricité est utilisée pour l’éclairage, le chauffage et les installations. Les carburants (qui sont des dérivés du pétrole) sont utilisés pour faire fonctionner les engins de chantier (GNR1) et pour les véhicules de service (GR2). La consommation énergétique du projet sera liée :
au fonctionnement des engins et des véhicules du personnel et des entreprises sous-traitantes, et épisodiquement de camions de transport d’engins, utilisant du gasoil (routier ou non routier selon le cas),
aux installations de production et secondairement aux équipements annexes (éclairage et chauffage des locaux, chauffage de l’eau des sanitaires…) qui utiliseront l’électricité, via des transformateurs.
Les quantités annuelles utilisées seront du même ordre de grandeur que celles liées à l’exploitation de la carrière actuelle, puisque la méthode d’exploitation sera inchangée :
50 m3 environ pour le gasoil non routier (engins), 170 000 kWh pour l’électricité.
1 Gazole Non Routier 2 Gazole Routier
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
191
7.3.3: EFFET SUR LE CLIMAT LOCAL
La préoccupation climatique planétaire concerne essentiellement aujourd’hui les gaz à effet de serre (GES), et principalement des émissions de dioxyde de carbone (CO2), résultant de la combustion de matières carbonées fossiles. Rappelons que le projet n’est que la continuité de l’exploitation, et que les conditions d’exploitation
seront identiques.
Les émissions de CO2 seront exclusivement liées aux gaz d’échappement des engins . La quantité générée (133 tonnes éq CO2/an) reste faible et en tout état de cause très réduites par rapport à la problématique planétaire. A titre informatif, une étude réalisée en septembre 2004, sous les partenariats de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), de l’Union Nationale de l’Industrie de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) et de l’Agence Régionale pour l’Environnement Midi-Pyrénées (ARPE) a porté sur l’évaluation de la contribution des carrières aux rejets de gaz à effets de serre (GES), en région Midi-Pyrénées. Dans cette étude, la quantification des GES s’appuie sur la méthode « Bilan CarboneTM d’une activité industrielle ou tertiaire » mise au point par l’ADEME. Elle a consisté à prendre en compte les émissions liées au site d’extraction, au déplacement du personnel, ainsi qu’au transport des marchandises.
L’évaluation des émissions de GES liées à l’exploitation est de 0,604 kg eqC/t1 de roches extraites (2,2 kg eq CO2/t). Le chiffre de la carrière (0,9 eq CO2/t et 133 t eq CO2/an , lié uniquement à la consommation de GNR) est cohérent avec cette étude. A titre de comparaison, cela représente l’équivalent des émissions de 4 personnes2. C’est moins de 0,0001% des émissions de GES à l’échelle de la France (491,1 Mt eqC en 2013 selon CITEPA - Juin 2015) et environ 0,0004% à l’échelle de la région (33 Mt eq CO2 en 2014 selon Air Pays de la Loire) En l'absence d'effet mesurable sur le climat, aucune mesure spécifique ne sera nécessaire.
Néanmoins, les mesures de limitation de la consommation d’énergie sur le site sont de nature à limiter la contribution de l’activité dans les phénomènes globaux de changement climatique.
1 L’eqC est l’abréviation d’équivalent CO2. L'équivalent CO2 est aussi appelé potentiel de réchauffement global (PRG). Il
vaut 1 pour le dioxyde de carbone qui sert de référence. Le potentiel de réchauffement global d'un gaz est la masse de
CO2 qui produirait un impact équivalent sur l'effet de serre. Par exemple, le méthane a un PRG de 25, ce qui signifie qu'il
a un pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur au dioxyde de carbone. 2 En tenant compte d’une émission de 10.1 t d’eq C (37 t eq CO2 par an et par habitant en France (source : Cabinet Carbone 4 - 2013)
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
192
7.3.4: VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
On a vu au chapitre 3 (paragraphe 7.3) que la zone du projet ne présente pas de vulnérabilité notable au changement climatique et que les effets de ce changement se traduisent globalement sur le territoire national par :
une augmentation des températures moyennes et du nombre de jours de forte chaleur, une diminution des précipitations au printemps et en été, des extrêmes plus marqués : sécheresse estivale plus longue, le cas échéant augmentation des pluies
intenses et vents violents. A l’échelle du projet, ces effets se traduiraient par des risques d’envols de poussières accrus, qui seront maîtrisés par une adéquation des mesures (adaptation de la fréquence d’arrosage des pistes notamment). Les terrains du projet étant situés déjà pour partie en zone inondable de la Sarthe, une augmentation de l’intensité des épisodes pluvieux serait sans conséquence sur l’inondabilité de la carrière qui continuera de servir de « bassin écréteur de crue ». Le projet ne présente pas de vulnérabilité significative au changement climatique ; les effets de ce changement sont pris en compte dans les modalités d’exploitation.
8: EFFETS SUR LES BIENS MATERIELS
8.1: EFFETS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION
8.1.1: EFFETS SUR L’ORGANISATION SPATIALE DES ITINERAIRES
Le projet étant la continuité de l’exploitation actuelle, il n’y aura aucun changement dans l’organisation des cheminements locaux actuels. On peut noter que l’accès à la parcelle enclavée, supportant le pylone électrique, sera préservé en permanence, la parcelle se présentera sous forme de presqu’ile avec accès par l’ouest.
Sur cette parcelle, l’effet sera direct, car lié à l’exploitation même de la carrière, et permanent
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
193
8.1.2: FREQUENTATION DES VOIES PUBLIQUES
Quantification du trafic induit par le projet
PHASE DE CHANTIER La phase de chantier nécessaire au démontage de la vieille installation et à la mise en place de la nouvelle durera 6 mois environ. Cette phase de chantier interviendra dans les 3 ans. Cette phase génèrera la circulation de camions supplémentaires pour l’amenée et l’évacuation des matériels au début et à la fin du chantier. Le trafic induit sera négligeable au regard de la durée de cet évènement, tout au plus, une semaine en début et fin de chantier. Les camions emprunteront le trajet habituel, par la déviation de la VC n°9 au droit de la Perrée, pour rejoindre la RD 323. PHASE D’EXPLOITATION Le projet ne prévoit aucune modification de production (150 000 t/an en moyenne et 207 000 t/an au maximum), tout au moins à la hausse. Rappelons que durant quelques années (de 2030 à 2033), la production maximale sera limitée pour répondre aux obligations du SDAGE (orientation B1). Le trafic engendré correspondra, pour des camions de 25 tonnes de charge utile, à
- 27 rotations journalières en production moyenne (150 000 t/an), - 38 rotations journalières en production maximale (207 000 t/an),
Des évolutions de la réglementation permettent d’augmenter, selon conditions, le poids total roulant autorisé des poids lourds à 44 t, soit 15 % de charge utile supplémentaire. Dans ces conditions, le nombre de rotations pourraient être réduit à 16 rotations journalières en cadence moyenne et environ 21 en cadence maximale. Notons aussi que le site approvisionne la centrale à béton située de l’autre côté de la VCn°9 par rapport aux installations de traitement, ce qui représente un tonnage annuel de l’ordre de 16 000 tonnes, et à fortiori une diminution de 3 rotations sur la VC n°9. Il n’y aura donc pas d’augmentation du trafic liée au projet de carrière.
Effets associés
Les effets potentiels liés à la circulation des véhicules sur les voies publiques sont les suivants :
risques d'accidents corporels, notamment avec les véhicules en transit sur la voie communale, risques de salissure de la chaussée (dépôt de boue).
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
194
Les risques d'accident sont limités car : la fréquentation de la voie communale au droit de l’accès carrière est limitée à la carrière elle-même
et aux habitants de L’Enfournoire, le gabarit des voies est suffisant pour supporter le trafic de camions et permettre le croisement en
sécurité de deux véhicules. Dans des conditions normales d'utilisation des véhicules et le respect des règles en vigueur, le trafic généré par le projet ne présentera pas de risque ou de danger particulier. Des aménagements sont prévus pour renforcer la sécurité publique au niveau de l’accès (entretien et nettoyage de la voirie, signalisation adaptée).
Le trafic engendré par les camions de la carrière sur les voies publiques constitue un effet indirect et temporaire de l'exploitation.
Vis-à-vis de l’évacuation des matériaux et de l’impact sur le trafic routier, le projet ne modifie pas la
situation actuelle.
8.2: RESEAUX DE DISTRIBUTION
Aucun réseau de distribution ne sera perturbé par le projet, rappelons que l’accès à la parcelle enclavée supportant le pylône électrique sera préservé. Rappelons que les pylônes présents dans l’emprise actuelle du site sont gérés par ERDF. Les mesures de précaution et de protection sont déjà en vigueur. Vis-à-vis des réseaux de distribution, le projet ne modifie pas la situation actuelle.
8.3: STABILITE DES TERRAINS
Etant donné que :
- les fronts hors eau feront au maximum 3 à 4 m de hauteur compte tenu de du battement de la nappe
- une bande de 10 m réglementaire est conservée non exploitée entre le chantier d’extraction et la limite d’autorisation,
- la pente d'exploitation de fronts sableux reste stable sur le long terme à 2/3, la stabilité des terrains restera assurée sur l’ensemble du site. Rappelons qu’il n’y a pas eu à ce jour de recul de berges significatif et que les berges sont remises en état par talutage de façon coordonnée à l’exploitation.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
195
8.4: BATI
Le projet d’exploitation n’aura aucun effet direct sur le bâti (suppression), puisqu’il n’en existe pas à l’intérieur du périmètre. Des effets indirects potentiels pourraient être liés au phénomène de retrait d’argiles sous l’effet du rabattement de nappe. Géologiquement tout le secteur est en alluvions de basse terrasse, comme sur le site d’exploitation, avec potentiellement quelques lentilles d’argiles à la base des alluvions. Cet effet n’est pas à retenir dans la mesure où :
ces argiles sont sous eau, puisqu’on rabat le niveau piézométrique sur le site pour les extraire des cotes d’alerte de rabattement seront mises en place, cotes restant dans l’amplitude de battement
naturel de la nappe il est peu probable que les assises des voies publiques voire des habitations soient à la profondeur
des argiles (environ 7-8 m de profondeur)
Le projet ne présente aucun effet sur le bâti existant.
9: EFFETS SUR LE PATRIMOINE
9.1: MONUMENTS HISTORIQUES - SITES INSCRITS OU CLASSES
Aucun monument historique et aucun bâtiment susceptible de présenter un intérêt patrimonial n’est présent dans l’emprise du projet et plus généralement, le site d’exploitation n’est situé dans aucun périmètre de protection et il n’y a aucune co-visibilité entre le site et un bâtiment présentant un intérêt patrimonial.
Il n’y aura donc aucun effet direct à ce niveau.
9.2: ARCHEOLOGIE
La réalisation des travaux de découverte de la carrière (7,4 ha environ) pourrait conduire à la découverte fortuite de vestiges archéologiques. L'exploitant se conformera à la réglementation en vigueur en la matière.
Les effets sur le patrimoine seront des effets faibles, directs et temporaires de l'exploitation.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
196
10: EFFETS SUR LES SITES ET LE PAYSAGE ET LES PERCEPTIONS
VISUELLES
Les incidences du projet peuvent être analysées à deux niveaux :
l'impact visuel représente l’emprise visuelle que possèdera le projet dans son environnement. C’est une analyse rationnelle de la proportion du champ visuel occupée par l’activité dans le paysage. Ceci passe également par la recherche et la description des points depuis lesquels ces changements sont visibles.
l'impact paysager concerne, quant à lui, la manière dont le projet modifiera la relation entre le territoire et ses utilisateurs. En effet, le paysage est plus que la simple portion du territoire qui s’offre au regard. Il est la manière dont les individus et/ou les sociétés le perçoivent et le vivent ; c’est l’équilibre entre toutes les contraintes du territoire (anthropique, topographique, floristique, historique…), les liens tissés entre l’homme et son environnement.
L’analyse objective des changements provoqués par la progression des activités dans les paramètres de cet équilibre permettra de comprendre ce qui sera modifié dans le cadre de vie (changements d'ambiance, …). Cette démarche pragmatique permet d’évaluer la façon dont seront ressenties les modifications visuelles.
10.1: EFFETS SUR LE PAYSAGE
L’impact paysager ne consiste pas seulement à relever les modifications paysagères apportées par le projet, mais il s’attache plus à évaluer leur intégration ou leurs potentialités de réintégration dans le paysage. L'impact paysager de l’exploitation sera essentiellement lié à la modification de l’occupation des sols : mise à nu des terrains (suppression de friches, pelouses et pinède), apparition progressive de surfaces minérales sur les emprises (7,4 ha par rapport à la vingtaine d’hectares d’aspect minéral (hors plans d’eau)). Les effets concernant les contrastes de texture et de couleurs, la modification de topographie, la modification de vocation des terrains restent très faibles dans la mesure où l’exploitation existante a déjà engendré toutes ces modifications, le projet n’engendre pas de composante nouvelle dans le paysage.
Pendant l'exploitation, l'impact sur le paysage sera lié à l'aspect artificiel des travaux d’extraction, à la présence d’engins et aux structures de traitement. Cet impact sera directement fonction de l'état de propreté du site et de ses abords et de l’organisation des travaux d’extraction et de remise en état (remise en état coordonnée). La substitution de terrain par des plans d’eau, bien que déjà présents dans le paysage consistera en une modification permanente du paysage local
L’impact sur le paysage sera faible, direct et permanent, à court, moyen et long terme.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
197
Le projet apporte une modification de l’état futur de l’exploitation autorisée en lui apportant une plus
grande homogénéité avec des plans d’eau agrandis reliés entre eux, ce qui évite l’impression
géométrique et de mitage du paysage.
10.2: EFFETS SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES
La notion d'impact visuel recouvre la perception immédiate que l’on a de la carrière. C’est une image instantanée et prise d’un point de vue particulier de la partie de territoire dans lequel s’implante le site. L'importance de l'impact relève d’un certain nombre de facteurs, parfois interdépendants, dont les principaux sont :
le mode de perception : statique et/ou dynamique, l'éloignement par rapport au site : perception rapprochée (moins de 500 m) ou éloignée (plus de
500 m), l'angle de vue de l'observateur : vue rasante et/ou vue plongeante, la présence ou l'absence d'obstacles (haies, merlons, bâtiments, topographie).
Dans la plaine alluviale, l’absence de dénivelé n’autorise que des vues rasantes. Leur portée se limite aux nombreux écrans boisés qui barrent l’horizon. Compte tenu des nombreux écrans, les perceptions se font en position rapprochée.
10.2.1: POSSIBILITES DE VUE STATIQUE:
La modification de perception de la carrière se fera essentiellement vis-à-vis de la zone d’extraction et des surfaces en chantiers qui vont se rapprocher des habitations. L'installation de traitement, les stocks de matériaux, les bâtiments et l’atelier ne génèreront pas d’impact supplémentaire vis-à-vis de la situation actuelle, le projet ne prévoyant pas de déplacement de ces infrastructures. Le changement de l’installation, par une plus récente, ne modifiera en rien la perception. L’exploitation pourra être vue depuis :
Les habitations de l’Enfournoire en position rapprochée. Cependant, la vision ne sera que partielle, au travers des haies présentes aux alentours.
Les habitations des Pelouses. Bien que plus éloignées de la zone industrialisée formée par les installations, les bâtiments et les stocks pour partie, la vue sera cependant directe sans aucun écran car s’ouvrant directement sur les plans d’eau. L’impact visuel sera le plus fort au moment de la période de défrichement de la parcelle AK 11 et de son exploitation, des mesures de protection pourront être mises en place.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
198
Les habitations d’Arnage situées en bord de Sarthe. Situées actuellement à 400 m de la limite d’emprise sud-est, la zone d’extraction se rapprochera à environ 150 m, augmentant la perception visuelle. L’impact sera induit par la perception des engins, essentiellement de la pelle, avec son bras en hauteur, la drague aspiratrice au ras de l’eau sera beaucoup moins perçue. L’impact induit par les installations, les stocks et les bâtiments restera quant à lui identique, quasiment nul du fait de la présence des haies et des quelques zones boisées aux abords des plans d’eau et de la Sarthe.
Les habitations du Port au Liard et des Aulnays n’ont pas de visibilité sur le site du fait de la zone boisée présente autour de l’étang des Pelouses et de la pinède entre la partie sud-ouest du site et la Sarthe.
10.2.2: POSSIBILITES DE VUE DYNAMIQUE:
Les perceptions en vue dynamique sont très limitées :
Les utilisateurs de la VC n°9 auront une perception de l’exploitation au niveau de la portion qui longe le site. Cette perception sera indirecte, elle se fera sur les merlons présents en bordure et sur l’accès avec le trafic des camions. Rappelons que cette portion de voie communale n’est utilisée que pour desservir l’Enfournoire et la carrière.
Une perception partielle de l’exploitation pourra se faire pour les promeneurs depuis le chemin de bord de Sarthe, au travers des quelques portions de ripisylve.
Aucun autre axe routier ou piéton n’aura de vue sur le site d’exploitation. L’impact visuel constitue un effet direct de l’exploitation mais temporaire du fait de la remise en état
coordonnée qui sera achevée au terme de l’autorisation.
10.3: EFFETS SUR LES MONUMENTS ET LES SITES DU BASSIN VISUEL
Il n’y a aucun monument classé ou site dans le bassin visuel de la carrière.
AK 48
NCARTE DES PERCEPTIONSVISUELLES ET DES ÉCRANS
Périmètre du projet
Secteurs sollicités en extension
Limite communale
Points de perception statiques
Zone de perception dynamique
Perception directe
Perception di�use
Ecrans visuels(zone boisée - haies - ripisylve)
Merlons de terre végétale
0 100 200 m
AK 11
AK 13
AI 47
AI 48
AI 49
AI 89 AI 90
AK 91
AK 48
AI 15
AI 16
AI 46
AK 10
AK 12
AK 11
AK 13
AI 47
AI 48
AI 49
AI 89 AI 90
AK 91
AK 48
AI 15
AI 16
AI 46
AK 10
AK 12
Commune deARNAGE
Commune deSPAY
RD 14
7
VC n°9
RD 32
3
Echelle : 1/5 000Source : cadastre.gouv
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
201
11: IMPACT DE LA PHASE DE TRAVAUX PRELIMINAIRES A L’EXPLOITATION
Dans le cas d’une carrière, la phase de travaux préliminaires est relativement limitée et l’impact de ces travaux est en grande partie de même nature que ceux de l’activité de la carrière qui reste une sorte de chantier permanent. L’implantation d’installations peut correspondre à des travaux préliminaires mais dans le cas du présent projet, qui correspond à une demande de prolongation d’exploitation, dans les mêmes conditions qu’actuellement, aucune véritable nouvelle installation ne sera implantée. En effet, le projet prévoit uniquement le remplacement d’une des installations de traitement ancienne par une plus récente aux dimensions et caractéristiques équivalentes. Dans notre cas particulier, le présent chapitre reste donc sans objet dans le cadre de la demande d’autorisation.
12: EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
Les projets connus à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés sont ceux définis à l’alinéa e) du 5° du II de l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. Il s’agit de ceux, qui, au moment du dépôt de l’étude d’impact :
ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 du Code de l’environnement et d’une enquête publique ;
ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
202
En 2017, les projets ayant fait l’objet d’une procédure sont récapitulés dans le tableau ci-après
Commune Projet Consultation publique
Etat du projet Interaction avec le projet de la sablière
Arnage Assujettissement à la règlementation des eaux libres sur la pratique de la pêche de différents plans d’eau
Du 22/06 au 12/07
Néant
Allonnes Extension de dépôt de produits de quincaillerie : enregistrement
16 janvier au 13 février
autorisé Néant
Spay Projet de défrichement de la SAS Carrières TAVANO
2/03 au 16/03 Autorisé Exploitation d’une parcelle présente dans l’autorisation actuelle après défrichement
Le Mans Projet de centrale photovoltaique à la gare de triage avec demande de défrichement
Du 28/08 au 28/09
Néant : projet à 3,7 km au nord du site dans une zone très anthropique cf localisation ci-après.
Guécélard Défrichement pour construction individuelle
18/01 au 1er février
Néant
Mulsanne Défrichement pour construction de logements individuels locatifs
10 janvier au 24 janvier
Néant
Localisation du projet de création d’une centrale photovoltaique Sablière TAVANO Notons que le projet de modification des conditions de remise en état de la carrière sise au lieu-dit La Perrée à SPAY par la SARL ORBELLO GRANULATS MAINE a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation en date du 13 mai 2016. Ce projet prévoit un changement de vocation d’un secteur proposé en zone naturelle boisée en maintien de vocation industrielle pour la mise en place d’une installation de préfabrication. Le projet de préfabrication, connu de la mairie n’est à ce jour pas déposé en préfecture.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
203
13: BILAN DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS OU INDIRECTS SECONDAIRES, TEMPORAIRES OU PERMANENTS
Le bilan des effets est présenté sous la forme de tableaux pages suivantes. Le niveau d’impact brut, en l’absence de mesures, est gradué de la façon suivante : « très fort », « fort »; « moyen », « faible », « négligeable » à « nul ». En ce qui concerne la durée des effets, il faut entendre par « court terme » la phase de chantier, « moyen terme » la phase d’exploitation jusqu’à la fin de l’autorisation et « long terme » au-delà de la remise en état du site. Les effets positifs sont indiqués en italique.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
205
Domaines Effets pris en compte Niveau d’impact brut
Nature des effets en l’absence de mesures et en tenant compte du devenir ultérieur du site (remise en état)
Remarques Direct Indirect
secondaire Temporaire Permanent A court terme A moyen terme A long terme
Population (commodité du voisinage)
Modification des niveaux sonores actuels moyen X X X X
Simulations montrant des niveaux d’émergence conformes aux seuils réglementaires au niveau des habitations en Zones à Emergence Réglementée, sauf à l’Enfournoire où des mesures devront être prises
Vibrations Faible à nul X X X X Vibrations faibles dues aux engins et installations,
distance de propagation très réduite
Emissions lumineuses Faible à nul X X X X
Eclairage des postes de travail, sans risque de nuisance pour le voisinage et les espèces animales. Pas d’activité en période nuit
Amiante Nul X X X Pas de minéraux de type « amiante » dans le gisement
Santé humaine
Emissions atmosphériques Faible X X X X Respect des VLEP pour le personnel. Riverains moins exposés que le personnel. Attention apportée à la réduction des envols de poussières
Emissions de bruit nul X X X X Respect des seuils d’émergences réglementaires pour le bruit lié au fonctionnement du matériel. Pas de risque sanitaire
Modification de la qualité des eaux en cas déversement accidentel d’hydrocarbures ou de disfonctionnement des dispositifs de traitement
nul X X X X Aucun risque vis-à-vis des usages de l’eau
Sécurité publique Accidents corporels fort X X X X Risque en cas d’entrée illicite sur le site, lié à la présence de plans d’eau et bassins de séchage des boues, et à l’emploi de matériel d’exploitation
Activités
Agriculture Nul X X X X X X Aucune réduction de surface agricole
Sylviculture Faible X X X Défrichement d’une faible surface (2,88 ha) Aspects productifs et cynégétiques d’intérêt très secondaire
Economie locale et régionale (hors agriculture et sylviculture) Fort X X X X X X
Pérennisation d’une activité économique locale permettant un approvisionnement des entreprises locales Limitation de la pénurie en sables dans la région du fait de la diminution progressive du quota autorisé
Loisirs Moyen X X X X X X Effet lié à la baisse potentielle du niveau dans le plan d’eau de pêche du fait du pompage très temporaire pour extraire les argiles hors eau
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
206
Biodiversité
Espèces protégées Fort X X X X X Destruction d’habitats d’espèces protégées Destruction potentielle d’espèces Des mesures seront mises en place
Sensibilité patrimoniale Moyen à faible X X X X X Terrains en renouvellement plus riches que terrains
en extension
Potentialités d’accueil Fort à faible X X X X X Impact positif fort à court terme (situation actuelle), moyen à moyen terme et faible à long terme (plans d’eau plus grands et plus profonds)
Incidences sur les sites Natura 2000 Nul Aucun impact du projet sur les zones Natura 2000
Fragmentation d’habitats Moyen X X X X Fragmentation de l’espace utilisé par les amphibiens avec la liaison entre les plans d’eau
Continuités écologiques Nul X X X Maintien d’une bande inexploitée de 60 m (50 +10m) en bordure de la Sarthe permet de conserver la fonctionnalité du corridor.
Sols Décapage de la terre végétale Moyen X X X X X X Modification des caractéristiques structurales et des qualités agronomiques des sols Effets indirects faibles sur les habitats naturels
Eaux
Ecoulements superficiels et souterrains Incidence volumétrique Faible X X X X Pas d’effet sur l’état quantitatif de la masse d’eau
souterraine Ecoulements superficiels et souterrains Incidence piézométrique Forte X X X X X Perturbation locale de la piézométrie sous l’effet du
pompage pour extraire les argiles hors eau
Qualité des eaux Moyenne X X X X X X X Mise à l’air de la nappe (agrandissement) : augmentation de la vulnérabilité aux pollutions, maintien de la continuité plan d’eau/nappe
Usages des eaux souterraines Nul à faible X X X X
Pas d’effet sur les captages AEP Effets potentiels sur le plan d’eau de pêche et sur le forage utilisé pour l’exploitation de safran, liés à la modification potentielle de piézométrie,
Air et climat
Poussières Moyen à faible X X X X
Emissions liées essentiellement à la circulation des engins et camions et aux opérations d’exploitation hors eau
Odeurs et fumées Nul X X X X Emissions liées au gaz d’échappement des engins ou à un incendie accidentel Absence de brûlage sur le site
Emissions de Gaz à Effet de Serre Négligeable X X X X Liés au fonctionnement des engins et camions
(combustion) Vulnérabilité du projet au changement climatique Nul X X X X Carrière située pour partie en zone inondable avec
effet positif écrêteur de crue.
Domaines Effets pris en compte Niveau d’impact brut
Nature des effets en l’absence de mesures et en tenant compte du devenir ultérieur du site (remise en état)
Remarques Direct Indirect
secondaire Temporaire Permanent A court terme A moyen terme A long terme
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
207
Domaines Effets pris en compte Niveau d’impact brut
Nature des effets en l’absence de mesures et en tenant compte du devenir ultérieur du site (remise en état)
Remarques Direct Indirect
secondaires Temporaire Permanent A court terme A moyen terme A long terme
Biens matériels
Modification de l’organisation spatiale des voies de communication Faible X X X X X Création d’une piste d’accès à la parcelle AK 47
Génération de trafic Nul X X X X
Aucune augmentation de trafic sur la VC°9 par rapport à la situation actuelle Il y aura même une diminution temporaire du fait de la baisse programmée des extractions de sables par le SDAGE
Effet sur la stabilité des sols Nul X X X X
Pas de risque d’instabilité des fronts d’exploitation Pente maximale des talus de découverte adaptée à la nature des formations Rabattement de nappe engendré aux points de contrôle (piézomètres) inférieur au battement interannuel de la nappe
Bâti Nul X X X X Rabattement de nappe engendré aux points de contrôle (piézomètres) inférieur au battement interannuel de la nappe
Réseaux de distribution Fort X X X X X Présence de pylônes ERDF sur le site et hors l’emprise mais avec accès par le site
Patrimoine Découverte archéologique Faible X X X X
Pas de site archéologique reconnu sur le site ou aux abords Risque de découverte faible, peu de surface non décapée
Monuments historiques et sites Nul X X X X X Absence de site inscrit et monument historique aux abords du site
Paysage
Modification des vocations faible à moyen X X X X X
Faible surface défrichée Peu de modification de vocations, nombreux plans d’eau déjà présents Substitution progressive des terrains sollicités en extension
Modification topographique Moyen X X X X X Lié à l’extraction même si les surfaces d’eau donnent une impression de planitude
Modification du visuel Faible X X X X X Pas de composante nouvelle dans le paysage
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
208
14: EFFETS CUMULATIFS
Les effets cumulatifs sont les effets qui peuvent agir de concert sur les facteurs de l’environnement. Ils peuvent se développer de plusieurs façons : selon un processus additif (l’effet cumulatif est plus important que les effets pris individuellement), ou au contraire infra additif (l’effet est moindre). L’impact total est alors égal à la somme des effets d’interaction (négatifs ou positifs selon que les effets soient infra ou supra additifs). De manière générale, les différentes thématiques ne sont pas cloisonnées et quand un effet est décrit au sein d’une thématique dans les différents chapitres, il résulte souvent de la conjugaison de plusieurs effets sur plusieurs thématiques. D’autre part, une disposition présentée dans le cadre d’un compartiment (=thématique) environnemental particulier est bien souvent aussi une disposition par rapport à un autre compartiment environnemental (à titre d’exemple, la limitation de la vitesse des engins sur site pour limiter les envols de poussières réduit aussi les effets sur le bruit et les effets sanitaires (émissions gazeuses) pour les habitations de proximité. L’interaction des effets entre eux ont été étudiées dans les différents paragraphes du présent chapitre, par le biais des effets indirects. Les effets cumulatifs potentiels sont présentés, lorsqu’il y avait lieu, dans le tableau ci-après. N’y sont pas repris les éléments pour lesquels il n’y a pas d’effet envisageable.
Carrières TAVANO Commune de SPAY (72) Etude d’impact Chapitre 4
209
Domaines Incidences cumulatives potentielles Niveau d’impact cumulatif
Population
Emissions sonores
Les différents impacts pouvant être moyens à faibles, pris séparément, peuvent être ressentis globalement par les riverains comme un impact global moyen à fort du projet.
Emissions lumineuses
Poussières
Visuel statique
Trafic sur les voies locales
Biodiversité
Suppression d’un milieu par un autre (flore et habitats) : effet biotique
Le niveau d’impact brut sur la faune déterminé dans l’étude tient compte des effets indirects potentiels liés aux émissions sonores, lumineuses et vibratoires. Elle montre que le risque de perturbation est négligeable. Globalement, le niveau d’impact est négligeable. Concernant la flore et les habitats, le niveau d’impact brut reste de niveau moyen.
Piézométrie et zones de hauts fonds actuelles) : effet abiotique Emissions sonores (effet indirect abiotique)
Emissions lumineuses : (effet indirect abiotique)
Voies de communication Poussières En dehors de la phase chantier liée au changement d’une partie de l’installation qui interviendra dans les 3 ans, il n’y aura pas d’impact
supplémentaire vis-à-vis de la situation actuelle. Génération de trafic
Visuel
Modification des vocations La modification du visuel est la conséquence des modifications des vocations et de la topographie (dans une moindre mesure) des terrains engendrés par le projet. Le niveau d’impact sur le visuel, qui traduit les effets cumulatifs sur le paysage, est plus ou moins fort selon les secteurs et le type de point de vue (zones habitées, distance, fréquentation des chemins et route, vision directe ou indirecte). L’effet cumulatif sur le visuel du site reste faible, sauf pour les habitations des Pelouses ou il reste moyen du fait d’une vision directe sur le site, sans écran.
Modification topographique
Modification du visuel
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 5
211
CHAPITRE 5 :
DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES
NOTABLES ATTENDUES DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE LA
VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES
D'ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
EN RAPPORT AVEC LE PROJET CONCERNE
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 5
213
SOMMAIRE
Page
1: PREAMBULE ........................................................................................................................................ 215
1.1: DEFINITIONS ........................................................................................................................................ 215
1.2: ETAT DES LIEUX ................................................................................................................................... 216
2: ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DES RISQUES MAJEURS D’ORIGINE
NATURELLE ET INCIDENCES NEGATIVES EVENTUELLES .................................................................... 217
2.1: RISQUE D’INONDATION ......................................................................................................................... 217
2.2: FEUX DE FORET ................................................................................................................................... 220
2.3: ALEAS CLIMATIQUES ............................................................................................................................ 222
2.3.1: Vents forts .................................................................................................................................................... 222
2.3.2: Foudre .......................................................................................................................................................... 222
2.4: RISQUE SISMIQUE ................................................................................................................................ 223
2.5: AUTRES RISQUES : ............................................................................................................................... 223
3: ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DES RISQUES MAJEURS D’ORIGINE
TECHNOLOGIQUE ET INCIDENCES NEGATIVES EVENTUELLES.......................................................... 224
3.1: RISQUE INDUSTRIEL ............................................................................................................................. 224
3.2: RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES ....................................................................... 224
4: CONCLUSION ....................................................................................................................................... 224
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 5
215
1: PREAMBULE
L’objectif de ce chapitre est d’examiner les incidences négatives notables du projet sur l'environnement qui
pourraient résulter de son éventuelle vulnérabilité à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs. En
d’autres termes, il s'agit de recenser les risques majeurs, dont la matérialisation pourrait constituer un
évènement initiateur d’un danger sur les terrains du projet susceptible d’entraîner une incidence notable sur
l’environnement.
1.1: DEFINITIONS
Le risque majeur est la possibilité qu’un événement d’origine naturelle ou anthropique occasionne des
dommages humains et matériels importants et dépasse les capacités de réaction de la société. Il est
caractérisé par une faible fréquence et une extrême gravité.
Selon l’échelle de gravité produite par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
la catastrophe majeure correspond à des dommages humains correspondants à plus de 1 000 morts et des
dommages matériels de plus de 3 milliards d’euros.
Sur le territoire national, les principaux types de risques majeurs sont :
- 9 types de risques naturels : inondation, séisme, éruption volcanique, mouvement de terrain,
avalanche, feu de forêt, cyclone, tempête et tornade ;
- 4 types de risques technologiques d’origine anthropique : nucléaire, industriel, lié au transport de
matières dangereuses et rupture de barrage.
La prise en compte de ces risques se traduit par une maîtrise de l’aménagement du territoire, qui vise à
éviter l’augmentation des enjeux sur les personnes et les biens et à diminuer la vulnérabilité des zones déjà
urbanisées. Cette politique se traduit par la mise en place de Plans de Prévention des Risques instaurant des
règles d’aménagement, lesquelles sont reprises dans les documents d’urbanisme.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 5
216
1.2: ETAT DES LIEUX
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Sarthe, mis à jour en 2012, identifie 7 types
de risques sur le territoire :
- 5 types de risques naturels : inondation, mouvement de terrain, feux de forêt, aléas climatiques,
et risque sismique;
- 2 types de risques anthropiques : industriel majeure et transport de matières dangereuses
(TMD).
Deux évènements historiques d’inondations sont identifiées dans le département :
Pour la commune de SPAY, 6 risques sont identifiés :
Inondation : une partie des terrains du projet sont concernés par le
PPRinondation
Feux de forêt (feux d’une surface minimale d’1 ha d’un seul
tenant) : SPAY est classée en commune à sensibilité moyenne.
Aléas climatiques
Sismique : La commune de SPAY est classée en zone de sismicité
faible.
Industriel majeur : La commune de SPAY est concernée par le
PPR technologiques de Butagaz, site SEVESO seuil haut situé à
Arnage. Les risques principaux sont l’explosion et l’incendie. Sur le
site sont stockées 470 tonnes de GPL.
Transport de Matières Dangereuses.
:DICRIM communal
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 5
217
Le site GEORISQUES du ministère de la transition écologique et solidaire et les sites InfoTerre du BRGM et
de la DREAL1 recensent, pour la commune de Spay, les arrêtés de catastrophes naturelles suivants :
2: ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DES RISQUES MAJEURS D’ORIGINE NATURELLE ET INCIDENCES NEGATIVES EVENTUELLES
2.1: RISQUE D’INONDATION
INONDATION PAR DEBORDEMENT DE LA SARTHE
La commune n’est pas concernée par un risque important d’inondation mais par une crue à débordement lent
du cours d’eau. Le PPRN 72SST20000072- PPR Sarthe Aval a été prescrit le 27/03/2000, approuvé le
26/02/2007 et révisé le 28/04/2010
1 Direction Régionale de l'Environnement de l’Aménagement et du Logement
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 5
218
Les inondations de la Sarthe aval sont des inondations par débordement de rivière après des épisodes
pluvieux d’automne-hiver. Les débits caractéristiques des crues de la Sarthe à Spay, affichés dans le tableau
ci-dessous, correspondent aux débits journaliers maximums estimés (QJ) pour plusieurs périodes de retour.
Fréquence Biennale Quinquennale Décennale Vicennale Cinquantennale
QJ (m3/s) 210 280 330 380 450
Tableau 1 : débits journaliers maximums estimés de la Sarthe à Spay selon diverses périodes de retour – source : Banque Hydro
Les études menées à partir de l’analyse des débits relevés à la station hydrométrique de la Sarthe aval à
Spay ont permis de retenir les principales caractéristiques de crues suivantes :
le SAGE Sarthe aval indique qu’il a déjà été constaté des débits supérieurs au débit de fréquence
cinquantennale ;
les deux crues historiques de la Sarthe aval sont celles de 1966 et 1995 ;
La crue centennale retenue comme référence pour le PPRNI1 à Spay est une crue modélisée
établissant des hauteurs de submersion supérieures à 1995.
La carte (TERRAQUA) à la page suivante illustre la délimitation des zonages réglementaires du PPRNI de la
Sarthe aval à Spay, qui se déclinent de la manière suivante :
une zone réglementaire forte qui correspond à un aléa fort où la hauteur de submersion2 est
supérieure à 1 m par la crue centennale ;
une zone réglementaire moyenne de secteur naturel qui correspond aux secteurs naturels
soumis à un aléa faible ou moyen où la hauteur de submersion est comprise entre 0 à 0,5 m ou
0,5 à 1 m par la crue centennale ;
une zone réglementaire moyenne de secteur urbain qui correspond aux secteurs urbanisés
soumis à un aléa moyen où la hauteur de submersion est comprise entre 0,5 m et 1 m par la
crue centennale ;
1 Plan de prévention du risque naturel inondation prescrit par arrêté préfectoral le 27 mars 2000 et approuvé après
modification le 28 avril 2010.
2 Hauteur d’eau calculée par rapport au terrain naturel.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 5
219
une zone réglementaire faible qui correspond aux secteurs urbanisés soumis à un aléa faible où
la hauteur de submersion est inférieure à 50 cm par la crue centennale ;
une zone non exposée correspondant au reste du territoire.
A hauteur du projet, le niveau d’eau de la crue modélisée centennale est compris entre +42,2 m NGF environ
à l’amont du côté de l’Enfournoire et +41,7 m NGF environ à l’aval du côté des Plouses.
Une partie de l’emprise du projet d’extension de la carrière TAVANO interfère avec le zonage
réglementaire moyen des secteurs naturels et le zonage réglementaire fort, dans une moindre
mesure, délimités par le PPRNI de la Sarthe aval à Spay.
En terme de vulnérabilité, en cas d’inondation, l’eau va entrer sur le site par les plans d’eau qui serviront de
bassins écrêteurs.
On peut noter que les installations, les locaux et atelier avec les stockages de produits dangereux (huiles,
GNR, déchets dangereux et petits produits (cartouches de graisse, bombes aérosols….) ne se situent pas en
zone réglementaire inondable. En effet la cote des terrains à ce niveau est de l’ordre de 43 m NGF pour un
niveau d’eau de 42,10 m NGF pour une crue centennale.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 5
220
De plus, afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux, les secteurs de remblais avec les produits du
site se feront parallèlement à l’écoulement des eaux.
La vulnérabilité du projet reste donc faible. Il n’y a donc pas d’incidence négative lié au projet à attendre en
cas de risque de ce type.
2.2: FEUX DE FORET
Les feux de forêt peuvent être de 3 natures distinctes :
Les feux de sol qui affectent l’humus notamment en zone tourbeuse,
Les feux de surface qui se propagent en sous-bois,
Les feux de cimes qui brulent la totalité des arbres.
La Sarthe n’est pas un département à risque maximal en matière de feux de forêt, cependant compte tenu de
son fort taux de boisement (118000 ha) le risque est réel et élevé. Les sinistres de ces dernières années
confirment le risque :
Mai 1992 : Pontvallain : 220 ha de résineux
Avril 2014 : Parigné l’Evèque et Marigné Laillé : 10, 50 et 150 ha de résineux
Juillet 2015 : Mulsanne : 105 ha de résineux
Aux abords du site, la partie sud-ouest comporte un boisement, constitué principalement de résineux, d’une
superficie d’une trentaine d’hectares.
Ce boisement au nord est bordé par les plans d’eau du site et par la Sarthe au sud.
Au droit du site, les zones les plus sensibles aux incendies que sont les installations, l’atelier avec les
différents stockages de produits dangereux plus ou moins inflammables (GNR, huiles… ) et les locaux du
personnel, sont situées au nord est dans un environnement très minéral excluant tout risque de propagation
d’incendie.
Au niveau du site, des mesures de maîtrise du risque d’incendie sont et resteront mises en place :
Mesures internes :
- Des extincteurs portatifs seront disposés en nombre suffisant sur le site ainsi que dans chaque
engin; ils seront adaptés à chaque type de feu, et contrôlés annuellement par un organisme
qualifié,
- Un Plan de Sécurité Incendie précisera les consignes de prévention et les mesures de protection,
notamment la localisation du matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve sur le site, ainsi
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 5
221
que les mesures à prendre pour prévenir et combattre le déclenchement et la propagation
d'incendies éventuels,
- Le matériel, les engins, et les transformateurs feront l’objet d’entretien et de contrôles réguliers,
comme c’est déjà le cas,
- Les installations électriques feront l’objet de contrôles périodiques par un organisme agréé,
comme sur le site actuel,
- Un permis de feu sera systématiquement réalisé pour toute intervention par point chaud
susceptible d’occasionner un départ de feu, comme actuellement,
- Les interventions des entreprises extérieures donneront lieu à un plan de prévention dans lequel
l’ensemble des risques liés à l’intervention projetée (et notamment les risques d’incendie) sont
examinés, comme sur la carrière actuelle,
- Le personnel reçoit périodiquement une formation sur la conduite à tenir en cas d’incendie et le
maniement du matériel d’extinction dans le cadre d’une intervention de 1er niveau (effectuée chez
un organisme spécialisé),
- Des téléphones (fixe et portables) permettront d’alerter les services de secours en cas d’urgence,
comme sur la carrière actuelle,
- L’accès du site sera porté à la connaissance du Service Département d’Incendie et de Secours
(SDIS).
En outre, les installations électriques sont conçues et réalisées de façon à résister aux contraintes
mécaniques, à l’action des poussières inertes ou inflammables et à celles d’agents corrosifs, soit par un
degré de résistance suffisant de leur enveloppe soit par un lieu d’implantation les protégeant de ces risques.
Tous les circuits électriques sont et seront protégés par des dispositifs appropriés.
Mesures externes :
- L’accès sera autorisé aux seules personnes habilitées et aux personnes autorisées. L’interdiction
de pénétrer sur le site sera rappelé sur des panneaux régulièrement disposés sur la clôture du
site,
- Le portail ainsi que les locaux, seront fermés en dehors des heures de travail.
Compte tenu de la configuration du site et moyennant ces mesures, le projet ne présente pas de
vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence négative sur les tiers et l’environnement extérieur au projet,
liée au risque d’incendie.
Rappelons que vis-à-vis des pylônes électriques présents sur le site, l’entreprise Carrières TAVANO
nettoie régulièrement les pieds, ce qui limite les risques vis-à-vis de ces structures en cas d’incendie.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 5
222
Le projet ne présente qu’une vulnérabilité très réduite au risque de feux de forêt ; il n’y a donc pas
d’incidence négative liée au projet à attendre dû à ce type de risque. Au contraire, les pistes et la présence
des plans d’eau permettrait aux services spécialisés d’intervenir de façon très efficace.
2.3: ALEAS CLIMATIQUES
Il n’existe pas de PPRN lié au risque météorologique. Seules des consignes individuelles de sécurité sont
édictées en fonction de la vigilance définie par Météo France.
2.3.1: VENTS FORTS
Les vents forts peuvent être à l’origine de chute d’arbres, qui peuvent créer des dommages sur le bâti et les
réseaux aériens.
Une chute d’arbres sur les terrains du projet n’aurait pas de conséquences sur les tiers à l’extérieur du
périmètre.
Dans un cas extrême, les structures de l’installation pourraient également souffrir du vent violent. Compte
tenu de leur conception (absence de bardage) et de la distance importante par rapport aux habitations les
plus proches, il n’y a pas de risque de conséquences sur les tiers.
L’exposition des éléments du projet aux vents forts n’entraînerait pas d’incidence négative sur
l’environnement à l’extérieur du périmètre.
2.3.2: FOUDRE
La foudre est susceptible de présenter un risque, notamment par sa capacité à induire un court-circuit.
Le niveau kéraunique moyen du département de la Sarthe (valeur annuelle moyenne du nombre de jours
d’orages) est de 13. La foudre ne constitue donc pas un risque majeur pour le projet. Dans d’autres
départements, le niveau kéraunique peut être très supérieur (par exemple 44 en Ardèche) et dans d’autres
régions du monde il est d’un ordre de grandeur plus élevé (par exemple, 100 en Floride et 180 en Afrique du
Sud).
La densité de foudroiement, qui correspond au nombre de coups de foudre par an et par km2, est inférieure à
1,5, valeur faible en comparaison avec d’autres départements (4,4 en Ardèche).
Des mesures de protection sont prévues :
Les transformateurs et les installations électriques associées seront installés conformément aux
règles de l’art et à la réglementation en vigueur ;
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 5
223
Les installations électriques et les structures métalliques des locaux seront reliées à la terre.
Compte tenu du faible aléa et moyennant la mise en œuvre de ces mesures, la vulnérabilité du projet au
risque lié à la foudre est extrêmement faible ; il n’y a donc pas d’incidence négative à attendre pour
l’environnement et les tiers liée à ce type de risque.
2.4: RISQUE SISMIQUE
La commune de Spay est classée en zone de sismicité faible ; le secteur est en zone 2 (aléa faible) (décret
2010-1254 du 22 octobre 2010).
Dans ce secteur, les règles de construction parasismiques s’appliquent à la construction de bâtiments
nouveaux de catégorie III (type établissements scolaires). La nouvelle installation de traitement ne rentre pas
dans cette catégorie.
Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque sismique ; Il n’y a donc pas d’incidence négative
à attendre liée à ce type de risque.
2.5: AUTRES RISQUES :
Aléa retrait-gonflement des argiles
Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il
est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité.
Selon leur structure et les minéraux en présence, ces modifications de consistance peuvent s’accompagner
de variations de volume, dont l’amplitude peut être parfois importante et occasionner des désordres dans les
habitations et plus généralement dans les constructions.
Selon la carte établie par le BRGM (site Infoterre), les formations géologiques présentes sur les terrains du
projet correspondent à un aléa faible.
Ce type de risque ne peut donc avoir une incidence négative sur le projet de carrière.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 5
224
3: ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DES RISQUES MAJEURS D’ORIGINE TECHNOLOGIQUE ET INCIDENCES NEGATIVES EVENTUELLES
3.1: RISQUE INDUSTRIEL
Selon les données en ligne de la DREAL, le département de la Sarthe compte 4 sites classés SEVESO seuil
haut. Tous ces sites disposent d’un PPRT. Aucun de ces PPRT ne concernent la commune de Spay
Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque industriel ; Il n’y a donc pas d’incidence négative
à attendre liée à ce type de risque.
3.2: RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), en raison du caractère particulièrement diffus
du risque, il concerne l’ensemble des communes du département.
Le transport de matières dangereuses ne concerne pas que les produits hautement toxiques, explosifs ou
polluants. Il concerne aussi les produits plus communs comme les carburants, gaz ou engrais.
Au niveau du site ce dernier n’est concerné que par un transport de matières dangereuses sur la voie
communale n°9, véhicule livrant la sablière ou l’Enfournoire.
La probabilité d’un accident lié à un transport TMD sur cette voie est très faible, d’autant que le linéaire est
limité.
Le projet ne présente pas de vulnérabilité notable compte tenu du très faible risque d’incident et des mesures
d’isolement (merlon) ; Il n’y a donc pas d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque.
4: CONCLUSION
Au vu de ce qui vient d’être exposé, le projet ne présente pas de vulnérabilité à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs. Il ne présente donc aucune incidence négative liée
spécifiquement à ce type de risques.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
225
CHAPITRE 6:
DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES
PAR LE MAITRE D’OUVRAGE ET RAISONS
POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A
ETE RETENU EU EGARD AUX EFFETS SUR
L'ENVIRONNEMENT OU LA SANTE HUMAINE
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
227
SOMMAIRE
Page
1: RAISONS ET HISTORIQUE DU PROJET 229
2: LE MARCHE DES GRANULATS 231
2.1: CONTEXTE GENERAL 231
2.2: LE CONTEXTE REGIONAL 232
2.3: CONTEXTE DEPARTEMENTAL 233
2.3.1: Demographie et population 233
2.3.2: Les enjeux économiques 234
2.3.3: Les ressources alluvionnaires exploitables 234
2.3.4: Les sites d’exploitation autorisés en 2012 235
2.3.5: Les perspectives à 30 ans 236
3: SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES 239
4: CHOIX DU PROJET D’EXPLOITATION 239
4.1: LE CHOIX DES TERRAINS 240
4.2: CHOIX DE LA METHODE D’EXPLOITATION 240
5: MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 241
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
229
1: RAISONS ET HISTORIQUE DU PROJET
La SAS Carrières TAVANO, implantée à SPAY, dans le département de la Sarthe (72), en région Pays de
la Loire, est spécialisée dans la fourniture et la livraison de matériaux de carrières.
L'exploitation de carrières permet d'assurer la livraison de matériaux et de négoce comme du sable, des
cailloux, des granulats, des gravillons, principalement dans le département de la Sarthe (72) et de l’Orne
(61) dans une moindre mesure.
La SAS Carrières TAVANO exploite un gisement de sables et graviers sur la commune de SPAY aux lieux-
dits « l’Enfournoire » et « la Coyère ».
Actuellement l’exploitation de ce site est régie par l’arrêté Préfectoral n°07-721 du 23/02/2007 délivré pour
une durée de 13 ans. Un arrêté complémentaire a été pris le 09/04/2013 (arrêté préfectoral n°2013099-
0006) pour limiter la production maximale à 207 000 tonnes/an en application du SDAGE Bretagne.
Les modalités d’exploitation définies dans l’arrêté de 2013 sont les suivantes :
Epaisseur moyenne d’extraction : de 7 à 10 m
Superficie autorisée : 394 905 m²
Production autorisée : 150 000 t/an en moyenne et 207 000 t/an maximum
Les moyens techniques mis en œuvre ne sont pas définis dans l’arrêté d’autorisation mais figurent dans le
dossier de demande d’autorisation. Ils reposent sur différents moyens en fonction du gisement. En effet, le
gisement exploité présente plusieurs formations :
En tête les graves de la formation alluviale de basse terrasse de la vallée de la Sarthe attribuée à
l’étage Würmien. Cette formation varie en épaisseur de 6 à 8 m,
A la base, la formation sableuse du Cénomanien inférieur et moyen reposant sur des argiles. Cette
formation est beaucoup plus épaisse en moyenne. Elle peut atteindre 40 m.
Entre ces 2 niveaux, sur l’emprise concernée, existent des intercalations de niveaux argileux
pouvant atteindre 2 m dont la répartition et l’épaisseur sont assez aléatoires.
D’un point de vue hydrogéologique, les aquifères locaux sont les suivants :
Les alluvions anciennes de la Sarthe. Il s’agit d’un aquifère libre, très perméable et très productif.
La piézométrie locale montre que cet aquifère est drainé par la Sarthe. Cette nappe n’est pas
exploitée pour l’eau potable.
Les sables du Cénomanien. Cet aquifère possède une bonne perméabilité et productivité dans les
horizons sableux. Cette nappe est en relation hydraulique avec la nappe décrite précédemment.
Sur le secteur, quelques ouvrages de faible profondeur exploitent les eaux de cette nappe pour
des usages domestiques exclusivement.
Plus en profondeur, les calcaires Bajociens et Bathoniens n’affleurent pas au droit du site.
Les reconnaissances hydrogéologiques effectuées sur le site par le BET TERRAQUA ont montré que le
niveau piézométrique évoluait de +41,2 m NGF au Nord-Ouest du site (secteur des Aulnays) à
+37,9 m NGF aux abords de la Sarthe. La cote moyenne des terrains naturels sur le site est de l’ordre de
+43 m NGF au Nord pour atteindre vers la Sarthe +41 m NGF.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
230
Ces données montrent que la formation supérieure des graves est saturée dans sa partie basale sur 2 à
3 m au maximum.
Jusqu’à maintenant, le niveau supérieur était exploité à la pelle hydraulique sur 5 m environ (graves de
basse terrasse), la partie hors d’eau étant directement acheminée par camion aux installations de
traitement ; la partie en eau extraite également à la pelle subissait un ressuyage puis un transfert vers ces
mêmes installations.
Toutefois, ce mode d’exploitation ne pouvait plus être utilisé à partir du moment où les niveaux argileux
intermédiaires étaient rencontrés. En effet, il devenait alors impossible d’extraire sélectivement ces niveaux
sous eau.
Cette difficulté a pour conséquence une perte directe de gisement dans la mesure où les niveaux sableux
sous ces argiles intermédiaires ne peuvent être atteints. Les différents plans d’eau autour du site sont
relativement peu profonds du fait qu’à l’époque, il était pratiquement impossible d’extraire ce niveau
argileux.
Lorsque ces niveaux ne sont pas présents, l’exploitation du gisement est poursuivie par une drague
aspiratrice qui intervient par campagne sur 2 à 3 mois uniquement par an (de 50 à 70 000 m3/an) afin
d’exploiter les sables du Cénomanien. Précisons que cette méthode d’extraction a été portée à
connaissance de la DREAL 72.
Les matériaux aspirés sont acheminés vers les installations où elles subissent une première décantation.
Ils sont ensuite repris pour être stockés au sol avant traitement, les eaux dites de « transfert » regagnent
le plan d’eau de la zone d’extraction (réserves d’eaux claires par un réseau interne de fossés dans lequel
elles décantent).
En 2015 et 2016 un dossier de demande de modification des conditions d’exploitation, avec notice
hydrogéologique a été déposé. Ce dossier avait pour objectif de proposer une méthode d’exploitation
permettant d’atteindre les niveaux argileux intermédiaires en les extrayant sélectivement à sec à la pelle
hydraulique de manière à pouvoir par la suite poursuivre l’exploitation des sables Cénomanien sous eau.
La méthode proposée repose sur un rabattement partiel de la nappe contenu dans les graves (sur 2 m
environ) à partir d’un pompage de forte capacité (300 m3/h) en continu sur 4 mois environ.
Cette méthode ne serait pas systématiquement mise en œuvre sur l’ensemble de l’emprise mais
uniquement sur les secteurs où la présence d’argiles intermédiaires serait clairement identifiée.
L’étude hydrogéologique ayant montré la faisabilité de cette technique d’exploitation, sous réserve de
quelques mesures de précautions à prendre, l’approfondissement des plans d’eau peut être envisagé.
L’accès à la ressource des sables cénomaniens au niveau des zones en exploitation ou déjà exploitées,
couplé avec une extension géographique réduite permet en termes de gisement disponible de solliciter une
nouvelle demande d’autorisation d’exploitation, ce d’autant que l’autorisation en cours échoit en 2020.
A la demande de la DREAL, cette nouvelle demande intègre donc la demande de rabattement de nappe
nécessaire à l’extraction à sec des argiles.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
231
2: LE MARCHE DES GRANULATS
2.1: CONTEXTE GENERAL
Dans le cadre de ce paragraphe, il apparaît utile de rappeler l’importance des granulats, matière première
indispensable au développement économique.
Ce sont des petits morceaux de roche, d’origine et de nature géologique très variées. La définition du
granulats est donnée par la norme XP-P 18-540 : "l’ensemble de grains de dimensions comprises entre 0
et 125 mm destinés notamment à la confection des bétons, des couches de fondation, de base, de liaison
et de roulement des chaussées, des assises et des ballasts de voies ferrées, des remblais".
Après l’eau, les granulats constituent la matière première la plus utilisée par l’Homme.
En France, on produit et on utilise près de 350 millions de tonnes de matériaux par an (soit près d'1 million
de tonnes par jour) pour l’ensemble des travaux, ce qui représente environ 7 tonnes par habitant et par an,
ou encore 20 kg par habitant et par jour.
Par comparaison, ce ratio est seulement de :
- 1,5 t /hab/an pour le pétrole,
- 0,8 t /hab/an pour le bois,
- 0,7 t /hab/an pour le charbon.
Voici quelques chiffres clés en matière de
consommation de granulats :
- une autoroute : 30 000 t/km,
- une voie ferrée : 10 000 t/km,
- une route nationale : 12 000 t/km,
- un lycée ou un hôpital : de 20 000
à 40 000 t,
- un logement pavillonnaire : de 100
à 300 t.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
232
L’illustration ci-contre résume les quantités
moyennes utilisées dans le BTP (données
2015) (source UNPG).
2.2: LE CONTEXTE REGIONAL
La région Pays de la Loire va connaître dans les prochaines années de grands chantiers qui nécessiteront
d’importants volumes de matériaux.
La cellule Economique Régionale de la construction des Pays de la Loire a dressé une liste des grands
projets envisagés dans la région. Ce recensement (novembre 2014) est issu d’une revue de presse
régionale et nationale, de la consultation de sites internet des principaux maitres d’ouvrages et des budgets
présentés par les conseils généraux et le conseil régional.
129 projets sont recensés, représentant un budget de 17,7 milliards d’euros d’activités pour le BTP.
L’achèvement des projets les plus lointains est prévu pour 2030 comme celui de du déploiement de la fibre
optique en Sarthe.
Pour répondre à ces besoins, la ressource locale existe, mais elle ne peut être mobilisée que
parcimonieusement :
- difficultés d’ouvrir de nouveaux sites d’extraction malgré l’existence de Schémas Départementaux
des Carrières (SDC),
- contraintes règlementaires justifiées par un souci de limiter les impacts sur l’environnement dans
un département où les enjeux en ce domaine sont forts,
- coûts et conséquences sur le développement durable du transport routier, largement prépondérant.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
233
En définitive, la ressource est présente mais l’accès à cette ressource est de plus en plus difficile en raison
de l’urbanisation, de contraintes environnementales et réglementaires ou des difficultés liées à
l’acceptabilité des carrières.
En 2015, la production globale en Pays de la Loire a été de 32,6 millions de tonnes, répartie en :
8 millions de tonnes de roches meubles
23,7 millions de tonnes de roches massives
0,9 millions de tonnes de granulats de recyclage
Ces chiffres représentent une diminution globale de 9,1% par rapport à la production de 2014.
2.3: CONTEXTE DEPARTEMENTAL
Source : SDC Sarthe
2.3.1: DEMOGRAPHIE ET POPULATION
Le département de la Sarthe est vaste et relativement peu peuplé, avec une densité de population de 90
habitants au km²
L’aire urbaine du Mans comprend presque la moitié de la population du département, soit 47% de ma
population sur 13% du territoire.
: Densité de population des communes de la Sarthe
Si les tendances démographiques se poursuivent au cours des trente prochaines années, la tendance sur
le département sera de 80 000 habitants de plus, soit une progression de 14% par rapport à 2007.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
234
2.3.2: LES ENJEUX ECONOMIQUES
Les activités du BTP sont très importantes avec près de 2 500 entreprises répertoriées à la chambre de
commerce et de l’industrie et la chambre des métiers.
Ces entreprises sont essentiellement concentrées autour de l’agglomération mancelle et sont en majeure
partie liées aux secteurs d’activités de l’installation et de la finition ainsi que des ouvrages du bâtiment.
2.3.3: LES RESSOURCES ALLUVIONNAIRES EXPLOITABLES
Les matériaux alluvionnaires : Les formations exploitables sont constituées par les alluvions graveleuses
à silex des vallées de la Sarthe (en aval du Mans), de l’Huisne et du Loir. Ces alluvions se répartissent en
terrasses étagées au flanc des vallées, les terrasses les plus élevées en altitude étant les plus anciennes.
Seules les alluvions récentes et les alluvions anciennes des basses et moyennes terrasses présentent un
usage béton. Les hautes terrasses sont composées des mêmes matériaux que les niveaux inférieurs mais
présentent une teneur en argile plus importante.
Répartition des formations géologiques pouvant fournir des granulats roulés à usage « noble »
Sablière
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
235
Les alluvions récentes et les basses terrasses sont constituées de matériaux de toute première qualité
pour la fourniture de granulat à usage noble et sont nettement utilisées sur le département.
Usage des matériaux alluvionnaires de lit majeur extraits dans le département de la Sarthe (enquête GIPEA)
2.3.4: LES SITES D’EXPLOITATION AUTORISES EN 2012
Au 01/01/2012, le département de la
Sarthe disposait de 45 autorisations de
carrières en vigueur suivant la répartition ci-
dessous par groupe de substances
extraites.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
236
Répartition des carrières par nature de matériaux
Sur ce graphe on peut se rendre compte que la sablière de Spay est le site alluvionnaire le plus
proche de l’agglomération mancelle
2.3.5: LES PERSPECTIVES A 30 ANS
Perspectives par type de granulats
Le tableau ci-dessous caractérise l'évolution, par type de granulats, des taux de production par années
paliers, au regard des capacités moyennes autorisées recensées au 31/12/2009 et sans tenir compte de
leur renouvellement :
: Evolution, par substance et par année pallier, des taux de production au regard des capacités moyennes
autorisées (source : Service économique de l’UNICEM)
Capacités annuelles
d'extraction en milliers tonnes
autorisées en 2009
Pourcentage de la production de 2009
2016 2020 2027
alluvionnaires en terrasse 780 24 2 0
alluvionnaires en lit
majeur
1 210 62 33 33
autres sables 1 520 71 58 39
roches calcaires 60 15 0 0
roches éruptives 2 200 100 100 89
Total 5 770 82 69 41
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
237
La synthèse de l’évolution des capacités annuelles d’extraction montrent, compte tenu de la durée
des autorisations en cours, que les difficultés d’approvisionnement apparaissent pour les
alluvionnaires en lit majeur dès 20129, pour les autres sables à l’horizon 2029 et pour les roches
éruptives après 2033.
Estimations des besoins
Suivant les indications des paragraphes précédents les besoins en matériaux s’établissent comme suit
pour les dix prochaines années pour le département de la Sarthe (en production moyenne autorisée) :
besoins pour la consommation courante : 3,96 millions de tonnes par an (dont 600 000 tonnes
par an de granulats roulés de bonne qualité) soit 39,6 millions de tonnes pour dix ans ;
besoins pour l’entretien des voiries du département : 150 000 tonnes par an soit 1,5 millions de
tonnes pour dix ans ;
besoins spécifiques pour les grands chantiers : 100 000 tonnes par an soit 1 million de tonnes
pour dix ans ;
besoins pour l’industrie et l’agriculture : 550 000 tonnes par an soit 5,5 millions de tonnes ;
besoins en autres matériaux : non significatifs à ce jour.
Les besoins pour les différentes consommations ci-dessus s’établissent ainsi à 4,76 millions de tonnes
par an soit 48 millions de tonnes pour les dix ans à venir.
Comparaison des besoins estimés en granulats pour la consommation courante avec les
autorisations de carrières
L'analyse, via les données de l'UNICEM/CIGO, a porté sur la détermination du solde, par année paliers
et par zone de consommation, entre les capacités moyennes autorisées restantes pour les carrières et les
besoins théoriques estimés pour la consommation.
L'évolution du solde par années palier s'établit ainsi comme suit : (source : étude économique de l’UNICEM)
(en milliers de tonnes) solde 2009 solde 2016 solde 2020 solde 2027
Le Mans -1 110 -1 125 -1 220 -1 390
Perche Sarthois 290 265 -135 -185
Vallée du Loir 1270 460 95 -210
Vallée de la
Sarthe 1 635 1 225 950 880
Haute-Sarthe 870 780 765 435
Alençon 270 270 265 265
Total 2 115 345 -470 -1 235
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
238
Problématiques induites
Les soldes figurant dans le tableau ci-dessus montrent des enjeux importants pour certains territoires.
La zone de consommation du Mans est largement déficitaire en 2009 pour la production de matériaux au
regard de ses besoins en consommation : ce déficit va s'accroitre légèrement entre 2009 et 2027. Les
zones de consommation du Perche Sarthois et de la Vallée du Loir, non déficitaires en 2009, seraient
déficitaires respectivement en 2020 et 2027. Toutefois, compte tenu des exports de matériaux
alluvionnaires à destination de l’Indre et Loire et de la réduction programmée, cette zone est finalement
déficitaire dès 2016.
Le solde global pour le département est négatif à partir 2020 ce qui veut dire qu'il n'y aura pas
assez de carrières autorisées pour satisfaire les besoins de consommation. L'analyse a été réalisée
en tenant compte du non renouvellement des autorisations.
L'évolution des capacités annuelles d'extraction a également été estimée par l'UNICEM/CIGO en tenant
compte du non renouvellement des autorisations et du montant des réserves par site. Cette approche
s'avère plus réductrice : elle conduit à disposer en 2020 d'une capacité d'extraction égale à 48 % de la
production de 2009 contre 60% en tenant compte que de la durée des autorisations. Cette capacité
d’extraction est quasi nulle en 2020 pour les matériaux alluvionnaires. Les réserves de gisements, en 2009,
des carrières autorisées ne permettent pas à priori de couvrir les durées d'autorisation.
Le constat dressé conduit à la nécessité, à court terme, de renouveler certaines autorisations existantes
ou de disposer de nouvelles autorisations d'exploiter notamment pour l'alimentation des zones de
consommation déficitaires. Une réflexion sur l'optimisation d'une utilisation rationnelle des granulats
alluvionnaires en limitant leur emploi pour des filières les nécessitant strictement doit être menée en
parallèle et des solutions d'emploi de matériaux de substitution développées.
Pour les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur les autorisations accordées devront permettre
le respect des objectifs de réduction retenues dans les orientations du présent schéma et reprenant
les dispositions du SDAGE (respect de l'indice IGA défini) et être positionnées en dehors des zones de
vallées fortement extraites définies par le présent schéma.
Le projet d’exploitation présenté par la carrière TAVANO permettra de diminuer un peu le déficit
annoncé en sables alluvionnaires de qualité sur le département. De plus, l’approfondissement avec
exploitation des sables cénomaniens permet d’économiser le gisement alluvionnaire, dans la
mesure où des recompositions peuvent être réalisées en fonction des utilisations souhaitées.
Rappelons de plus que le projet d’exploitation prend en compte les dispositions du SDAGE (indice
IGA) avec une diminution momentanée de la production.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
239
3: SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES
Dans l’hypothèse d’une continuité de fourniture de matériaux destinés à l’industrie du béton (matériaux
roulés à usage noble), deux projets alternatifs sont envisageables :
L’arrêt de la carrière et son remplacement par une nouvelle carrière.
Il paraît assez évident que cela sera générateur de plus d’impacts environnementaux et accompagné de
plus de difficultés liées à l’acceptabilité d’un nouveau site. De plus, l’ouverture d’un nouveau site sera
tributaire de nombreuses contraintes, l’ouverture de site ne pouvant se faire dans des secteurs ayant subi
une très forte extraction (disposition 1F-5) du SDAGE, soit ayant un indice plan d’eau > 4%. Il est très
fortement probable qu’un nouveau site serait, à qualité de matériaux égale, beaucoup plus éloigné de la
zone de consommation mancelle.
L’arrêt de la carrière et l’augmentation de production d’un éventuel concurrent.
Rappelons que la carrière TAVANO est la plus proche du centre de consommation qu’est l’agglomération
mancelle et surtout un des derniers sites encore autorisés à exploiter les sables alluvions en lit majeur de
la Sarthe. Il n’existe donc pas de concurrent proche offrant le même produit.
Une augmentation de production chez d’autres exploitants d’alluvionnaires dans d’autres vallées ou plus
éloignés conduirait très probablement à une augmentation des nuisances et des coûts (liés au transport)
et surtout à une surexploitation du gisement par rapport au rythme prévu. Cela engendrerait un déséquilibre
et la nécessité d’envisager plus rapidement une extension ou l’ouverture d’un nouveau site.
4: CHOIX DU PROJET D’EXPLOITATION
Entre deux solutions pour fournir des matériaux depuis une carrière :
l’ouverture d’un nouveau site,
l’extension d’un site déjà exploité,
il est toujours plus préférable d’étendre un site, sous réserve du respects des contraintes
environnementales, du fait de la maitrise des impacts et des mesures de protection, mais aussi souvent
d’une meilleure acceptabilité du projet par les riverains.
Sans revenir sur la nécessité économique du projet, développée plus haut, différentes possibilités se
présentaient pour poursuivre l’exploitation. Bien que présentés ci-après séparément, tous les choix sont
intimement dépendants les uns des autres.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
240
4.1: LE CHOIX DES TERRAINS
Deux possibilités étaient envisageables (dépendantes de la méthode d’extraction) :
une importante extension surfacique, avec une exploitation essentiellement de sables
alluvionnaires de lit majeur, dans la continuité de l’exploitation actuelle ;
une extension de surface plus réduite et un approfondissement des zones d’extraction.
Dans les deux cas, la maitrise foncière était acquise. La première possibilité a comme contrainte importante
que les terrains d’extension possible sont boisés et classés au PLU en espace boisé classé. Cette option
aurait nécessité un déclassement du bois et une modification du PLU.
La deuxième possibilité a comme contrainte importante qu’elle est tributaire d’une autorisation de
rabattement de nappe pour extraire à sec les passées d’argiles discontinues entre les formations de sables
alluvionnaires et de sables cénomaniens ; autorisation qui ne peut être accordée qu’en fonction des
résultats d’une étude hydrogéologique spécifique.
A champ de contraintes à peu près équivalent, la deuxième solution a pour avantage de répondre plus au
principe de développement durable, sous réserve que les impacts générés soient acceptables.
4.2: CHOIX DE LA METHODE D’EXPLOITATION
En terme d’exploitation, deux méthodes sont envisageables :
à la pelle hydraulique, pour une exploitation sur une dizaine de mètres, à sec et en eau ;
à la drague aspiratrice pour une exploitation plus profonde (14 m par rapport au niveau de la
drague), pouvant atteindre les sables cénomaniens.
Actuellement les deux méthodes sont employées, l’utilisation de la drague aspiratrice ayant fait l’objet d’un
porter à connaissance auprès des services administratifs.
Cependant, la présence de lentilles d’argiles discontinues entre les sables alluvionnaires et les sables
cénomaniens limite l’extraction de ces derniers, donc l’accès à une partie de la ressource.
De la capacité à extraire sélectivement et à sec les argiles (par rabattement temporaire de nappe), dépend
l’assise des terrains sollicités en extension.
L’étude hydrogéologique ayant montré que les effets du rabattement de nappe pouvaient être
évités, réduits et compensés, le projet définitif et présenté dans cette étude a été arrêté.
Ce projet permet de limiter la surface d’extension du site, mais surtout permet d’exploiter des sables
cénomaniens et donc d’économiser la ressource alluvionnaire, en permettant des recompositions de
matériaux en fonction de leurs utilisations. Il répond en tous points aux objectifs définis dans le Schéma
Départemental des Carrières de la Sarthe.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
241
5: MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
La Directive modifiée 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées
de la pollution prévoit que "les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que les autorités
compétentes s'assurent que l'installation sera exploitée de manière à ce que :
toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment
en ayant recours aux meilleures techniques disponibles ;
aucune pollution ne soit causée ;
la production de déchets soit évitée; à défaut, ceux-ci sont valorisés ou, lorsque cela est
impossible techniquement et économiquement, ils sont éliminés en évitant ou en réduisant leur
impact sur l'environnement ;
l'énergie soit utilisée de manière efficace ;
les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs
conséquences ;
les mesures nécessaires soient prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter
tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état satisfaisant.
Elle prévoit les mesures visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions des
activités susvisées dans l'air, l'eau et le sol, y compris les mesures concernant les déchets, afin d'atteindre
un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble."
Bien qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de référentiel dans le secteur d’activité concerné par le dossier
(carrières et installations de traitement) concernant les meilleures techniques disponibles, une analyse des
techniques employées sur le site est présentée ci-après (on se reportera également utilement au chapitre
7, relatif aux mesures de protection).
Les techniques mises en œuvre sur le site sont notamment :
- en matière de préservation de la ressource en eau :
utilisation d'engins entretenus ,
réalisation du plein et du lavage des engins sur une aire étanche reliée à un séparateur à hydrocarbures,
mise en place d'une procédure de gestion des fuites accidentelles d'hydrocarbures, impliquant la mise
à l’arrêt de l’engin concerné, la réalisation des réparations nécessaires dans les meilleurs délais, et la
gestion des matériaux souillés générés,
disposition d’absorbants dans les locaux et de kits anti-pollution dans les engins, pouvant être
rapidement mis en œuvre en cas de fuite accidentelle d'un réservoir ou d’un flexible : fixant la pollution
locale, ils permettent par la suite leur évacuation vers des circuits légaux adéquats,
respect des prescriptions réglementaires concernant les modalités de stockage et de manipulation des
hydrocarbures.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 6
242
- en matière de gestion des déchets :
collecte, tri et évacuation des déchets vers des circuits règlementaires adaptés,
eaux usées des sanitaires des locaux sociaux collectées dans une fosse septique régulièrement
vidangée par un organisme agréé,
fermeture de l’accès au site afin d'éviter tout acte de malveillance (dépôt d'ordures…).
- en matière d'utilisation d'énergie :
consommation énergétique réduite aux stricts besoins de l'exploitation,
- en matière de limitation des émissions de poussières :
exploitation et traitement en grande partie sous eau
limitation des opérations génératrices de poussières en fonction des données météo,
aspersion si nécessaire des pistes de roulement
D'une manière générale, les mesures prises par la société limitent les émissions de toute nature et évitent
les nuisances pour le voisinage.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
243
CHAPITRE 7 :
MESURES PREVUES POUR :
- EVITER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE
HUMAINE ET REDUIRE LES EFFETS N'AYANT PU
ETRE EVITES
- COMPENSER LORSQUE CELA EST POSSIBLE
LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET
SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE HUMAINE
QUI N’ONT PU ETRE NI EVITES NI
SUFFISAMMENT REDUITS
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
245
SOMMAIRE
Page
1: PREAMBULE ................................................................................................................................... 247
2: MESURES RELATIVES A LA POPULATION ET A LA SANTE HUMAINE .................................. 248
2.1: Mesures acoustiques .................................................................................................................... 248
2.1.1: Mesures d’évitement ............................................................................................................ 248
2.1.2: Mesures de réduction d’impact ............................................................................................ 249
2.1.3: Seuils en limite garantissant le respect de l’émergence en ZER ........................................ 250
2.1.4: Mesures de suivi .................................................................................................................. 251
2.1.5: Récapitulatif des mesures de protection acoustique ........................................................... 251
2.2: Vibrations – Projections - Explosions ........................................................................................... 252
2.3: Emissions lumineuses .................................................................................................................. 252
2.4: Mesures relatives à la sécurité publique ...................................................................................... 252
2.4.1: Mesure d’évitement ............................................................................................................. 252
2.4.2: Mesure de réduction des risques......................................................................................... 253
2.4.3: Suivi des mesures relatives à la sécurité publique .............................................................. 254
2.5: Mesures relatives à la santé et la salubrité publique ................................................................... 254
3: MESURES RELATIVES AUX ACTIVITES ET AUX ESPACES DE LOISIRS ................................ 255
3.1: Mesures relatives aux activités humaines .................................................................................... 255
3.1.1: Agriculture ............................................................................................................................ 255
3.1.2: Sylviculture ........................................................................................................................... 256
3.2: Loisirs ........................................................................................................................................... 257
4: MESURES DE GESTION DES SOLS .............................................................................................. 258
4.1: Synthèse des mesures relatives au décapage et a la reconstitution des sols ............................. 258
5: MESURES CONCERNANT LE MILIEU ECOLOGIQUE ................................................................. 259
5.1: Mesures d’évitement .................................................................................................................... 259
5.2: Mesures réductrices d’impact ....................................................................................................... 261
5.3: Mesures compensatoires ............................................................................................................. 264
5.4: Mesures d’accompagnement ....................................................................................................... 266
5.5: Suivi des mesures écologiques .................................................................................................... 268
6: MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DES EAUX ............................................................. 269
6.1: Mesures de réduction ................................................................................................................... 269
6.1.1: Mesures qualitatives ............................................................................................................ 269
6.1.2: Mesures quantitatives .......................................................................................................... 271
6.2: Mesures de surveillance ............................................................................................................... 271
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
246
6.3: Synthèse des mesures relatives aux eaux ................................................................................... 272
7: MESURES CONCERNANT L'AIR ET LE CLIMAT ......................................................................... 273
7.1: Poussières .................................................................................................................................... 273
7.1.1: Mesure d’évitement ............................................................................................................. 273
7.1.2: Mesure de réduction des envols .......................................................................................... 273
7.1.3: Mesure d’accompagnement ................................................................................................ 273
7.1.4: Mesure de suivi des mesures relatives aux émissions de poussières ................................ 274
7.2: Autres émissions dans l’air ........................................................................................................... 274
7.3: Maitrise de la consommation énergétique.................................................................................... 275
8: MESURES RELATIVES AUX BIENS MATERIELS ........................................................................ 276
8.1: Voies de communication .............................................................................................................. 276
8.2: Réseaux de distribution ................................................................................................................ 277
8.3: Stabilité des terrains ..................................................................................................................... 278
9: MESURES RELATIVES AU PATRIMOINE ..................................................................................... 278
10: MESURES DE PROTECTION VISUELLE ET PAYSAGERE ......................................................... 279
10.1: Mesures d’évitement .................................................................................................................... 280
10.2: Mesures de réduction d’impact .................................................................................................... 280
10.3: Mesures compensatoires ............................................................................................................. 280
10.4: Synthèse des mesures paysagères ............................................................................................. 282
11: BILAN DES EFFETS RESIDUELS .................................................................................................. 282
12: EVALUATION DU COUT DES MESURES ...................................................................................... 285
12.1: Coût des mesures acoustiques .................................................................................................... 285
12.2: Mesures relatives à la sécurité publique ...................................................................................... 285
12.3: Mesures relatives à la santé, hygiène et salubrité publique......................................................... 286
12.4: Mesures relatives à l’agriculture ................................................................................................... 286
12.5: Mesures relatives à la Sylviculture ............................................................................................... 286
12.6: Coût des mesures écologiques .................................................................................................... 287
12.7: Coûts relatifs à la protection des sols ........................................................................................... 287
12.8: Coûts relatifs à la protection des eaux ......................................................................................... 288
12.9: Coût des mesures relatives a l’air et au climat ............................................................................. 288
12.9.1: Coût des mesures relatives a la protection vis-à-vis des émissions poussières ................. 288
12.9.2: Coût des mesures vis-à-vis des émissions de gaz, fumées et odeurs................................ 289
12.10: Coût des mesures de maîtrise de l’énergie .................................................................................. 289
12.11: Coût des mesures relatives aux voies de circulation ................................................................... 290
12.12: Mesures relatives à la stabilité des terrains ................................................................................. 290
12.13: Coûts des mesures paysagères ................................................................................................... 290
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
247
1: PRÉAMBULE
Les mesures proposées suivent la séquence dite ERC : Eviter, Réduire, Compenser, telle que prévue au 8°
du II de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, pris en application de l’article 2° du II de l’article L.122-
3, avec :
les mesures d’évitement des effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine ;
les mesures de réduction des effets négatifs notables ne pouvant être évités ;
lorsque cela est possible, les mesures de compensation lorsque les effets ne peuvent être ni évités
ni suffisamment réduits.
Le cas échéant, des mesures d’accompagnement, apportant une plus-value au projet ou un moindre effet au-
delà des obligations réglementaires, sont proposées.
Ces mesures sont identifiées par une lettre : E, R, C ou A correspondant respectivement aux mesures
d’Evitement, de Réduction, de Compensation ou d’Accompagnement. Elles sont suivies par un numéro.
Les modalités de suivi des mesures sont traitées pour chaque élément dans les paragraphes correspondants.
Les coûts sont présentés dans un paragraphe spécifique en fin de chapitre.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
248
2: MESURES RELATIVES À LA POPULATION ET À LA SANTÉ HUMAINE
Compte tenu de l’absence d’effet supplémentaire lié à la faible surface d’extension sollicitée par rapport
à l’autorisation actuelle, les mesures décrites ci-après sont les mêmes que celles déjà en place et/ou
prescrites par l’arrêté préfectoral en vigueur.
2.1: MESURES ACOUSTIQUES
L’analyse faite dans le chapitre 4 a montré que seuls les travaux d'extraction entraineront une élévation du
niveau sonore par rapport à la situation actuelle.
La zone à émergence réglementée la plus sensible est le lieu-dit l’enfournoire.
Le tableau ci-dessous reprend les estimations sonores réalisées au chapitre 4 sur les effets, sans mise en
place de mesure de protection.
2.1.1: MESURES D’EVITEMENT
La seule mesure d’évitement proposée concerne la période d’activité sur le site. Le site fonctionnera
uniquement en période jour (7h-22h) dans la plage horaire de 7 h - 17h 30, du lundi au vendredi, jours fériés
exclus (mesure E1). Une coupure entre 12 h et 13h30 a lieu pour le chargement clientèle. Les opérations de
maintenance pourront avoir lieu éventuellement le samedi.
1 Niveau résiduel : niveau sonore sans aucune activité d’exploitation sur le site. 2 Niveau engendré : niveau sonore induit par l'activité (travaux de décapage, d'extraction et de traitement et commercialisation des produits finis) à hauteur de l'habitation, mais ne tenant pas compte du niveau sonore présent initialement à cet endroit. 3 Niveau ambiant : niveau sonore qui sera généré par l’activité et intégrant le niveau résiduel.
Lieu-dit Niveau
résiduel1 en dB(A)
Niveaux sonores engendrés2 en dB(A) Niveau sonore
ambiant3 attendu en dB(A)
Emergence en dB(A)
Travaux d'extraction
Installation de
traitement
Circulation
interne Equivalents
1 : L’enfournoire
40 47 46 29 49.6 50,1 10
2 : Les Pelouses 40
32.5 35 33 38.4 42,3 2,3
3 : La Perrée 40
34 40 27 41.1 43,6 3,6
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
249
2.1.2: MESURES DE REDUCTION D’IMPACT
Les matériaux de découverte notamment la terre végétale sera mise en place sous forme de merlons
périphériques. Ces merlons seront préférentiellement établis sous forme d’écran sonore (mesure R1), en
particulier en protection des habitations de l’Enfournoire, vis-à-vis de la zone d’extraction.
Notons par ailleurs que les petits merlons en limite d’emprise derrière les installations mais surtout les stocks
de matériaux autour permettent déjà d’amortir l’impact sonore des installations.
Les estimations réalisées ci-après prennent en considérations les écrans sonores :
Pour l’Enfournoire
Stocks et merlons (déjà existants) : le niveau engendré correspond au niveau mesuré lors du contrôle
sonore au droit de l’Enfournoire
Ecran de 3 m par rapport à la zone d’extraction : atténuation de 7,6 dB(A)
Pour Les Pelouses : aucun écran ne peut être mis en place, aucun n’est nécessaire.
Pour La Perrée :
Ecran sonore de 2 m en limite d’emprise, le long du ruisseau du Buard.
Tableau de estimations sonores tenant compte de la mesure R1 (présences d’écrans sonores).
Ne prend en compte que l’écran vis-à-vis de la zone d’extraction.
Les mesures prévues permettent donc de réduire l’émergence théorique au niveau de l’Enfournoire et de la
Perrée
Ces merlons resteront en place aussi longtemps que nécessaire.
En dehors de ces mesures spécifiques, s’ajoutent les mesures habituelles de réduction,
- l’exploitant s’engage à maintenir ses engins dans un bon état de fonctionnement afin de limiter au
maximum les émissions sonores. Les engins utilisés répondent aux normes en vigueur (arrêté du 18
1 Niveau résiduel : niveau sonore sans aucune activité d’exploitation sur le site. 2 Niveau engendré : niveau sonore induit par l'activité (travaux de décapage, d'extraction et de traitement et commercialisation des produits finis) à hauteur de l'habitation, mais ne tenant pas compte du niveau sonore présent initialement à cet endroit. 3 Niveau ambiant : niveau sonore qui sera généré par l’activité et intégrant le niveau résiduel.
lieu-dit niveau résiduel1
en dB(A)
Atténuation
calculée en
dB(A)
niveaux sonores
engendrés2
en dB(A)
niveau sonore
ambiant3
attendu
en dB(A)
Emergence
en dB(A)
L’Enfournoire 40 7.6 42 44,1 + 4,0*
Les Pelouses 40 38,4 42,3 + 2,5
La Perrée 40 1.4 39.7 42,8 + 3,0
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
250
mars 2002) fixant les dispositions communes applicables et la limitation des émissions sonores des
différents engins ou matériels de chantier (mesure R2).
- limitation de l’utilisation des avertisseurs sonores et interdiction de l'usage d'appareils de
communication sonore gênants pour le voisinage, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au
signalement d'incidents graves, à la sécurité des personnes (mesure R3),
- la vitesse des engins sur les pistes de la carrière sera limitée à 30 km/h (mesure R4).
- les pistes seront entretenues régulièrement afin d’éviter la formation de nids de poules ,sources de
nuisances sonores importantes surtout lorsque les engins évoluent à vide (mesure R5).
- usage d’avertisseurs sonores de recul à bruit large bande, plutôt que bande étroite dit « bips de recul »
(mesure R6),
2.1.3: SEUILS EN LIMITE GARANTISSANT LE RESPECT DE L’EMERGENCE EN ZER
Les dispositions relatives aux émissions sonores sont fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation
des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Outre
les seuils d’émergence à hauteur des Zones à Emergence Réglementée, il stipule à l’article 3 que « l'arrêté
préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de
bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect
des valeurs d'émergence admissibles ».
En tout état de cause, les valeurs ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la
période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Niveau sonore à respecter en limite d'emprise en fonction de l'émergence réglementaire
Niveaux engendrés Le maximum au niveau du récepteur
Le = 10 Log (10^(La/10) - 10^(Lr/10))
Point
distance d1(m)
Source - Limite
d'emprise
distance d2(m) Limite
d'emprise - Récepteur
distance d3(m)
Source - Récepteur
BR dB(A)
E max dB(A)
BA max dB(A)
BE max à d3
dB(A)
1 10 10 20 40 6 46 44,7
2 10 100 110 40 6 46 44,7
3 10 120 130 40 6 46 44,7
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
251
Niveaux ambiants La en Limite d'emprise
La = 10 Log (10^(Le/10)+10^(Lr/10))
Point BA à d1 dB(A)
1 : L’enfournoire 51,1
2 : Les Pelouses 65,6
3 : La Perrée 67,0
2.1.4: MESURES DE SUIVI
Conformément à la réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 23 janvier 1997), un constat des niveaux
sonores sera réalisé dans l’année suivant l’obtention de l’autorisation du site et ensuite périodiquement.
Le programme de suivi proposé, en période diurne uniquement, consistera à réaliser un contrôle des
émergences la première année, puis selon une périodicité triennale, sur les trois points étudiés aux alentours
de la carrière. Un contrôle en limite d’emprise sera également réalisé.
2.1.5: RECAPITULATIF DES MESURES DE PROTECTION ACOUSTIQUE
Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi
E1 Activité dans la plage horaire 7h-
17h30, hors week end et jours fériés Périmètre
d’exploitation -
R1 Mise en place d’écrans : merlons
périphériques
Limite d’emprise côté Enfournoire et le long du Buard (La Perrée)
Contrôle en continu par l’exploitant
Contrôle des niveaux sonores
R2 Utilisation d'engins répondant aux
normes en vigueur en matière de bruit
Périmètre d’exploitation
R3
Limitation de l’utilisation de klaxons et interdiction de l'usage d'appareils de
communication sonore gênants pour le voisinage
R4 Limitation de la vitesse sur les pistes
R5 Entretien régulier des voies de
circulation internes
R6 Utilisation d’avertisseurs sonores de
recul à large bande
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
252
2.2: VIBRATIONS – PROJECTIONS - EXPLOSIONS
Aucune mesure ne s’avère nécessaire concernant les vibrations, les projections et explosions puisqu’il n’y aura
pas d’effet notable sur ces points.
2.3: EMISSIONS LUMINEUSES
Les émissions lumineuses induites par l’exploitation seront limitées dans le temps et ne sont pas susceptibles
de perturber la circulation ou de gêner le voisinage, compte tenu de l'orientation des éclairages, en direction
des postes de travail, de l’éloignement des habitations et/ou des écrans formés par la végétation.
Rappelons qu’en dehors des horaires de fonctionnement de la carrière, les éclairages sont et seront
systématiquement éteints.
Précisons qu’aucun éclairage n’est prévu le long de la piste seul l’éclairage des engins est et sera utilisé, en
cas de nécessité.
En outre, aucune perturbation significative n’est à prévoir sur la faune nocturne sensible à la pollution
lumineuse (cf. paragraphe 4).
2.4: MESURES RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE
Les dangers présentés par l'exploitation et les mesures associées font l'objet de l’étude de dangers (Tome 4
du dossier).
2.4.1: MESURE D’EVITEMENT
La seule mesure d’évitement à considérer dans le cadre de la sécurité publique est d’interdire l’accès au site
à toute personne non autorisée.
Pour cela l’ensemble de la carrière est clôturé ou merlonné, des panneaux signalant l’interdiction d’entrée au
public sont mis en place sur la périphérie (mesure E1), et l’accès est fermé par un portail cadenassé en dehors
des heures de travail (mesure E2).
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
253
2.4.2: MESURE DE REDUCTION DES RISQUES
Ces mesures interviennent à l’intérieur du site.
Un plan de circulation avec balisage sur site est déjà mis en place sur le site (mesure R1).
L’accès aux plans d’eau est protégé par des merlons (mesure R2)
Des panneaux rappelant les risques encourus (chute, noyade…) sont apposés au niveau des zones
dangereuses. Ils seront régulièrement entretenus, et si besoin remplacés (mesure R3).
Des bouées munies de toulines sont disponibles en permanence à proximité des plans d'eau (mesure
R4).
Un bateau est disponible en bordure du grand plan d’eau (mesure R5)
Des extincteurs spécifiques sont présents en nombre suffisant sur les engins, au niveau du poste de
commande de l'installation, ainsi que dans le bureau et l'atelier. Ils permettent de lutter contre un
éventuel incendie et la production de fumées qui y serait associée. Ces équipements sont
régulièrement vérifiés par des entreprises spécialisées. Il est à noter qu’un incendie pourrait également
être maîtrisé grâce à la projection de sable sur le foyer (mesure R6).
Pendant les heures d'ouverture, aucun visiteur n’est et ne sera admis sur le site sans l'autorisation du
responsable ou de son représentant, et sans avoir pris connaissance des consignes de sécurité.
La protection des installations et les prescriptions en matière de circulation d’engins notamment relèvent de la
sécurité du personnel, elles ne sont pas reprises dans ce dossier.
Les moyens d’alerte :
les moyens d’alerte : téléphone dans le bureau, téléphones portables du personnel sur site
(mesure R7),
affichage des moyens de secours près des bassins et des numéros de téléphone dans le bureau
et l’atelier (mesure R8).
La remise en état contribuera à réduire fortement les risques liés à la présence des berges, Le risque de chute
et de noyade sera réduit dès lors que les berges seront talutées. Précisons que le talutage des berges est
coordonné à l’exploitation (mesure R9).
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
254
2.4.3: SUIVI DES MESURES RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE
Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi
E1 Clôture du site ou présence de
merlons Périmètre du projet Contrôle par l’exploitant
E2 Portail à l’accès, fermé en dehors
des heures d’ouvertures Accès au site Contrôle par l’exploitant
R1 Plan de circulation et balisage sur
site Emprise du site Contrôle par l’exploitant
R2 Protection des plans d’eau par
merlons Emprise du site Contrôle par l’exploitant
R3 Présence de panneaux
spécifiques au droit des zones dangereuses
Emprise du site Contrôle par l’exploitant
R4 Présence de bouées avec toulines Emprise du site Contrôle par l’exploitant
R5 Bateau disponible Bordure du grand plan d’eau Contrôle par l’exploitant
R6 Equipements de lutte contre
l’incendie régulièrement vérifiés Atelier - bureau
Contrôle par l’exploitant et un organisme de prévention
R7 Présence de moyens d’alerte
(téléphones) Bureau et personnel Contrôle par l’exploitant
R8 Affichage des moyens de secours
et de leur localisation Atelier - bureau Contrôle par l’exploitant
R9 Talutage des berges – remise en
état coordonnée Emprise du site Contrôle par l’exploitant
2.5: MESURES RELATIVES A LA SANTE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE
L’hygiène, la salubrité et la santé publiques seront assurées et préservées par les mesures spécifiques de
protection décrites dans les paragraphes précédents relatifs aux émissions de bruits, de poussières, à la qualité
des eaux rejetées (mesures contre les risques de pollution, suivi qualitatif, ..) et à la gestion des déchets :
- les émissions de poussières seront réduites du fait de l'humidité naturelle du matériau extrait, et de
l'arrosage des pistes en cas de nécessité,
- il n'y aura pas de risque de stress et d'inconfort lié au bruit pour les riverains, des mesures de protection
permettent de respecter la réglementation en vigueur au droit des zones à émergence réglementée,
- il est à rappeler que le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection de captage, et qu'il
n'y a, à notre connaissance, aucun puits dans le secteur qui soit utilisé pour l'alimentation en eau
potable.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
255
- un entretien régulier des engins de chantier, du matériel d’exploitation est réalisé. Le ravitaillement des
engins mobiles est effectué sur une aire étanche,
- aucun brûlage n’est effectué sur le site, il n’y a donc ni odeurs et ni fumées désagréables.
Aucune mesure complémentaire sur la santé publique n’est à retenir.
Il convient de rappeler que l'exploitation est assujettie au Code du Travail, ensemble de mesures strictes et
contraignantes visant à assurer la santé des opérateurs.
A ce titre, le personnel des Carrières TAVANO est sous le contrôle régulier de la Médecine du Travail, seul
organisme habilité à décider l'aptitude des personnes à tel ou tel poste de travail. La Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (unité territoriale de la Sarthe dans le cas présent) assure
par ailleurs le rôle de l'inspection du travail.
3: MESURES RELATIVES AUX ACTIVITÉS ET AUX ESPACES DE LOISIRS
3.1: MESURES RELATIVES AUX ACTIVITES HUMAINES
3.1.1: AGRICULTURE
SURFACES AGRICOLES
Aucune surface agricole n’est concernée par l’exploitation, aucune mesure n’est à mettre en place.
GESTION DES TERRES (PROTECTION DES SOLS)
Précisons que ces mesures sont générales et non spécifiques à l’agriculture, il n’y a pas de remise en état
agricole sur ce site. Elles sont détaillées dans le chapitre suivant.
Les mesures de gestion des terres végétales, destinées à la remise en état du site, consistent à :
décaper sélectivement les terrains restant à décaper, en séparant les horizons organique et minéral,
limiter la hauteur des merlons temporaires de terre végétale, lorsque la remise en place coordonnée
n’est pas possible,
décompacter l’assise avant de régaler les terres lors des opérations de remise en état.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
256
EXPLOITATION DE SAFRAN
La seule activité agricole dans l’environnement immédiat du projet est l’exploitation de safran localisée au
niveau de la zone de La Perrée.
L’activité de la carrière n’a et n’aura aucun impact direct sur l’exploitation agricole, il n’y a donc pas de
mesure particulière à mettre en place.
Le projet de rabattement de nappe pourrait avoir un impact secondaire indirect sur le forage servant à
l’alimentation en eau de l’exploitation agricole (0,46 ha), des mesures de suivi seront mises en place, elles sont
détaillées dans le paragraphe relatif aux eaux souterraines :
déplacement du piézomètre PZ3 en limite nord est de l’emprise du site, en position amont vis à vis de
l’écoulement de la nappe,
suivi piézométrique hebdomadaire en période de rabattement de nappe,
mise en place d’une cote piézométrique d’alerte.
3.1.2: SYLVICULTURE
Vis-à-vis de la sylviculture, la principale mesure consiste à avoir choisi de présenter ce projet d’exploitation,
avec approfondissement des plans d’eau existants et utilisation de la drague aspiratrice, ce qui limite
l’extension du site en surface et le défrichement à effectuer (mesure E1). Rappelons que ce projet est tributaire
de l’acceptation du rabattement de nappe et que l’autre projet aurait nécessité un déclassement d’espace boisé
classé.
La surface à défricher dans ce projet est de 2 ha 88 a. Après exploitation, la vocation des terrains restera un
plan d’eau. Il n’y aura pas de remblayage et reboisement sur ce secteur.
Par ailleurs, l’autorisation de défrichement est subordonnée soit à l’exécution de travaux de boisement
compensatoire, sur une surface équivalente à celle défrichée, assortie le cas échéant d’un coefficient
multiplicateur, ou à d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent, soit à l’acquittement
d’un versement au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois.
Précisons qu’en cas de boisements compensateurs, la surface de boisement doit contribuer à la constitution
d’un massif de 4 ha.
Le pétitionnaire se rapprochera de la mairie pour étudier la possibilité de boisements dans la continuité de celui
déjà réalisé dans le cadre de la compensation d’un défrichement lié à l’exploitation de la carrière. Rappelons
que le boisement compensateur a pris place dans le cadre d’un aménagement paysager de l’entrée de SPAY,
entre la D323 et la D51.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
257
Le coefficient de compensation et le montant de l’obligation financière seront fixés par le service en charge des
forêt-chasse-pêche-nature de la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe. Le choix entre le
boisement ou l’acquittement financier se fera ultérieurement (mesure R1).
BILAN DES MESURES
Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi
E1 Choix du projet -
C1 Reconstitution d’un massif
forestier ou acquittement financier Hors site à définir
Plantations réalisées et suivies par un spécialiste
3.2: LOISIRS
Les effets concernant les espaces de loisirs sont des effets indirects, liés à la variation du niveau piézométrique
de la nappe sous l’effet du rabattement temporaire. Deux espaces sont concernés :
L’étang de pêche de la base de loisirs du Houssay
L’étang de pêche privé du comité d’établissement GARCZYNSKI TRAPLOIR. Précisons que cet étang
n’est quasiment jamais utilisé.
Les mesures de protection qui seront mises en place sont détaillées au paragraphe sur les eaux souterraines.
Par ailleurs, soulignons la volonté de la mairie de Spay, de développer l’axe touristique du Val de Sarthe, par
la création de chemin de randonnée au bord de l’eau. Cette volonté est inscrite au PADD de la commune.
Une attention particulière sera portée à la remise en état du site, afin d’être en cohérence avec le PADD. Cet
aspect est développé au paragraphe sur le paysage et au chapitre relatif à la remise en état du site.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
258
4: MESURES DE GESTION DES SOLS
Aucune disposition spécifique ne s’impose pour la protection des sols dans les secteurs réaménagés en plans
d'eau.
En revanche, des dispositions seront mises en œuvre dans les secteurs qui seront remblayés et les secteurs
d’aménagements écologiques :
- le décapage du sol est et sera effectué de préférence en dehors des épisodes pluvieux ou de beau
temps prolongés (incidences négatives sur la stabilité structurale, augmentation du lessivage des sols),
- des précautions seront observées lors des diverses manipulations des terres, afin de préserver la
qualité du sol et favoriser la reprise de la végétation (mesure R2),
- les terres concernées seront utilisées si possible rapidement et/ou stockées sur de faibles hauteurs,
- la terre végétale et les horizons sous-jacents seront, dans la mesure du possible, décapés
sélectivement (mesure R1),
- le remblayage se fera également en deux temps : découverte et boues de décantation puis, en dernier
lieu, terre végétale précédemment décapée sur cette même parcelle (mesure R3).
Par ailleurs, la remise en état coordonnée à l’avancée de l'exploitation permettra d’éviter le stockage prolongé
de la découverte, préjudiciable à la qualité structurale du sol notamment.
SUIVI DES MESURES
Il ne sera pas nécessaire de mettre en place des mesures de suivi spécifique, le régalage de la terre végétale
se fera dans les règles de l’art avec une progression vers l’arrière pour éviter le roulement des engins sur la
terre végétale et le tassement de cette dernière.
4.1: SYNTHESE DES MESURES RELATIVES AU DECAPAGE ET A LA RECONSTITUTION
DES SOLS
Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi
R1 Décapage sélectif des sols Périmètre de la carrière Contrôle par l’exploitant lors de la
réalisation des travaux
R2 Limitation de la hauteur des stocks
ou remise en place directement. Périmètre de la carrière
Contrôle par l’exploitant lors de la réalisation des travaux
R3 Reconstitution progressive et
sélective des horizons Périmètre de la carrière
Contrôle par l’exploitant lors de la réalisation des travaux
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
259
5: MESURES CONCERNANT LE MILIEU ÉCOLOGIQUE
Source : Etude écologique Encem.
Pour réduire le niveau d’impact d’un projet sur la faune, la flore et les habitats naturels, trois principaux types
de mesures peuvent être définis : les mesures d’évitement (ou de suppression d’impact), les mesures
réductrices d’impact en cours d’exploitation et les mesures compensatoires s’il existe un impact résiduel
significatif. L’exploitant peut enfin proposer des mesures d’accompagnement.
Pour faciliter la lecture du chapitre et la localisation des mesures, chaque mesure est numérotée et localisée
sur la carte 6.
Ces mesures ont été définies en concertation avec la LPO Sarthe.
5.1: MESURES D’EVITEMENT
Deux mesures d’évitement sont proposées :
Mesure E1 : plan d’eau 3, bassin 10 et haie 5.
Le plan d’eau 3 (plan d’eau des Pelouses), le bassin 10 (au nord est du bassin des Pelouses) et ses abords,
dont la haie 5, ne seront pas exploités, soit une surface d’évitement de près de 5 ha.
Ce secteur abrite 4 espèces « sensibles » (Anax napolitain, Oedipode aigue-marine, Pélodyte ponctué et
Sterne pierregarin), 5 espèces « assez sensibles » (Callitriche à crochets, Callitriche à feuilles obstuses,
Rorippe des marais, Conocéphale gracieux et Gomphocère roux) et deux zones de sensibilité patrimoniale de
niveau « moyen » pour une surface globale d’environ 1,1 ha.
Le plan d’eau 3 est un plan d’eau peu profond favorable à des aménagements à vocation écologique au niveau
de ses berges et des ilots à Sterne pierregarin (cf. mesures A1 et A2).
Mesure E2 : Grand Capricorne et chauves-souris.
Les arbres à Grand Capricorne seront conservés en l’état. Il s’agit d’un chêne de la haie 3 et de deux
châtaigniers de la bordure ouest du plan d’eau 1 (plan d’eau de la Coyère). Les arbres associés à ces deux
châtaigniers seront également conservés.
Ces deux mesures permettront de préserver les habitats de gîtes potentiels estimés « très favorables » pour
les chauves-souris : le double alignement de chênes de la haie 5 et les arbres isolés localisés au nord-ouest
du plan d’eau 1 (plan d’eau de la Coyère).
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
261
5.2: MESURES REDUCTRICES D’IMPACT
Sept mesures permettront de réduire l’impact du projet durant l’exploitation.
Mesure R1 : amphibiens.
Les bassins de décantation de la carrière abritent des populations assez conséquentes d’amphibiens, en
particulier de Crapaud calamite et de Pélodyte ponctué.
Pour réduire l’impact de l’exploitation sur les amphibiens en phase de reproduction, les travaux portant sur les
bassins de décantation (remaniement, curage, apports d’argile…) seront réalisés si possible du mois de
septembre au mois de février inclus.
Par ailleurs, pour limiter le risque de destruction d’amphibiens en phase terrestre (de juin à janvier inclus), les
coupes d’arbres et d’arbustes seront réalisées au moins un an avant les travaux de dessouchage et
d’exploitation de manière à permettre aux individus de quitter ces habitats boisés avant leur remaniement.
Enfin, les populations de Crapaud calamite et de Pélodyte ponctué feront l’objet d’un suivi par la LPO Sarthe,
à l’aide d’un protocole standardisé, de manière à évaluer leur évolution durant la période autorisée. En cas de
régression significative des effectifs, la LPO Sarthe proposera à la société TAVANO des mesures destinées à
stopper et si possible inverser cette évolution
Mesure R2 : oiseaux des milieux boisés.
Pour éviter toute destruction éventuelle d’œufs et de poussins d’oiseaux nichant dans des structures ligneuses
(habitats 3d, 3f, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19), tous les travaux d’arrachage des fourrés et de coupes des
arbres seront réalisés en dehors de la période de nidification des oiseaux et d’élevage des jeunes, celle-ci
s’étendant du mois de mars au mois d’août inclus.
Par ailleurs, les habitats boisés du projet ne seront détruits qu’au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation.
Au niveau du plan de phasage, l’exploitation de la zone boisée est prévue en début de phases 4, le
défrichement aura donc lieu en fin de phase 3, sur la période préconisée.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
262
Mesure R3 : Hirondelle de rivage.
La carrière abritera durant son exploitation plusieurs secteurs de berges sableuses verticales favorables à
l’installation de colonies d’Hirondelle de rivage.
Pour éviter l’installation d’hirondelles sur les fronts en cours d’exploitation (à partir de la mi-avril et jusqu’à fin
juillet), ces derniers seront écrêtés dans leur partie supérieure et sur une hauteur minimale d’un mètre de façon
à créer une pente inférieure à 60°. Cette opération ne sera nécessaire que la veille des week-ends et surtout
en avril et mai.
Les fronts colonisés seront conservés en l’état jusqu’à la fin du mois de juillet. Un suivi régulier sera assuré par
la LPO Sarthe, ainsi qu’une assistance dans la gestion et l’entretien des fronts.
Mesure R4 : Martin-pêcheur.
Le Martin-pêcheur d’Europe est nicheur probable dans la berge sud du plan d’eau 6 (plan d’eau de
l’Enfournoire), sous le couvert de la haie 2.
Les travaux de coupe des arbres de la haie 2 et d’exploitation de la berge sud du plan d’eau 6 seront réalisés
en dehors de la période de nidification du Martin-pêcheur, celle-ci s’étendant du mois de mars au mois de
septembre inclus.
Les arbres de la haie 2 seront coupés au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation.
Mesure R5 : Petit Gravelot.
Un à deux couple(s) de Petit Gravelot niche(nt) sur la carrière
depuis 2014 (sur la piste au sud-ouest de l’installation de
traitement en 2014, sur le secteur des mares 12 en 2015 et à
proximité du plan d’eau 2 en 2016).
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
263
Le nid a été repéré chaque année par les employés de la carrière
qui ont mis en place immédiatement un périmètre de protection.
La LPO Sarthe a ensuite assuré le suivi de la nichée. Ce
protocole sera maintenu durant l’exploitation de la carrière.
Mesure R6 : héronnière.
Une héronnière d’une vingtaine de nids de
Héron cendré est localisée à environ 100
m au sud du plan d’eau 4.
L’extension du plan d’eau 4 vers le sud-
ouest et le nord-est ne devrait pas induire
de perturbation plus importante que celle
liée à l’exploitation du plan d’eau 4
puisque les travaux seront réalisés à une
distance plus importante de la héronnière.
La bande périphérique de 10 m sera
intégralement conservée à l’état de
boisement (pinède), comme c’est le cas
actuellement au droit du plan d’eau 4.
Par ailleurs, un suivi de la héronnière sera
assuré par la LPO Sarthe. Des mesures de réduction de l’activité, voire un arrêt des travaux en période de
nidification, pourront être demandés par la LPO Sarthe au droit de la héronnière en cas de régression
significative de la population nicheuse de Héron cendré
Mesure R7 : chauves-souris.
Cinq espèces et un groupe d’espèces de chauves-souris ont été identifiés sur le site en activité de chasse,
dont une espèce forestière, la Noctule commune, qui gîte notamment au sein de cavités arboricoles (cavités,
fissures, écorces décollées).
Pour éviter de détruire des individus de Noctule commune (ou d’autres espèces forestières) qui s’abriteraient
dans des arbres âgés à cavité, une prospection spécifique de ces arbres sera réalisée par la LPO Sarthe. En
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
264
cas de découverte de gîtes d’hibernation ou d’abri estival, les arbres concernés seront répertoriés et seront
coupés en dehors des périodes d’occupation par les chauves-souris.
Rappelons que les deux mesures d’évitement permettront de préserver les habitats de gîtes potentiels estimés
« très favorables » pour les chauves-souris : le double alignement de chênes de la haie 5 et les arbres isolés
localisés au nord-ouest du plan d’eau 1.
5.3: MESURES COMPENSATOIRES
Après mise en place des mesures d’évitement et des mesures réductrices d’impact, il subsistera un impact
résiduel significatif, essentiellement lié à l’exploitation du secteur de la centrale à béton où l’on observe quatre
espèces patrimoniales de niveau « sensible » qui ne bénéficient pas des mesures d’évitement et/ou de
réduction d’impact.
Il s’agit de deux amphibiens protégés, le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué, et de deux espèces non
protégées, la Limoselle aquatique (plante annuelle amphibie des mares 12) et l’Oedipode soufré (criquet des
substrats secs et chauds, présent dans l’habitat 5). Ce secteur abrite également un habitat « assez sensible
» sur une surface de 300 à 400 m2 : la pelouse des grèves humides.
Deux mesures sont proposées pour compenser l’impact du projet sur ces quatre espèces et cet habitat. La
première de ces mesures permettra par ailleurs de compenser la disparition d’environ 300 m2 de zones
humides au niveau des mares 13.
Mesure C1 : création de mares temporaires et d’une pelouse silicicole.
La friche maigre silicicole (habitat 10) localisée
au sud du plan d’eau 1 ne sera exploitée que sur
la moitié de sa surface environ (cf. vue ci-contre
de la partie nord de la friche en mai 2015).
La partie inexploitée, localisée sur la parcelle 48
dont la société TAVANO est propriétaire, fera
l’objet d’aménagements à vocation écologique
destinés à la création de deux habitats : des
mares temporaires et une pelouse silicicole
sèche. Ces aménagements seront réalisés dans
la partie nord du secteur inexploité.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
265
La pelouse silicicole sera aménagée par décapage du sol sableux sur une superficie d’environ un hectare et
une épaisseur d’une dizaine de centimètres (épaisseur exacte à définir sur le terrain), de manière à retrouver
un substrat faiblement organique, voire minéral. Les terrains décapés seront fortement tassés par un passage
répété des engins. L’horizon décapé sera exporté à l’extérieur de la parcelle.
Les mares temporaires seront aménagées au sein de cette zone décapée par creusement à la pelle
mécanique d’un réseau de cinq à six dépressions de superficies et de profondeurs variables, avec un maximum
de 50 cm. Ces dépressions seront pour partie interconnectées et couvriront une surface totale de 2 à 3 000 m2
(surface en eau en période hivernale). Les pentes seront très faibles du fait de la faible profondeur, avec des
valeurs qui varieront cependant en fonction de la superficie et de la profondeur de chaque dépression.
Cet aménagement sera réalisé durant la première phase quinquennale d’exploitation, en période automnale et
avec l’assistance de la LPO Sarthe.
Ces deux habitats feront l’objet d’un suivi par la LPO Sarthe. Une gestion de la végétation sera éventuellement
nécessaire en cas de fermeture des habitats par la végétation herbacée ou les ligneux.
Mesure C2 : déplacement de la population de Limoselle aquatique
La Limoselle aquatique est une plante estimée « rare »
au niveau supra-régional. Elle n’est pas protégée en
région Pays de la Loire.
La population de Limoselle aquatique des mares 12
sera déplacée par la LPO Sarthe au fur et à mesure de
l’avancée de l’exploitation sur ce secteur.
Nous préconisons un décapage manuel (à la pelle)
d’une partie de l’horizon vaseux abritant cette
population sur une épaisseur de quatre à cinq
centimètres, en période estivale, sur un substrat
exondé mais encore frais, de manière à récolter la
banque de graines (la Limoselle aquatique est une
plante annuelle).
L’horizon décapé sera transporté dans des seaux sur deux secteurs favorables au développement de la
Limoselle aquatique, le bassin 10 (zone d’évitement) et les nouvelles mares temporaires (mesure C1), et sera
régalé dans les dépressions de ces deux secteurs sur une épaisseur similaire à celle des mares 12.
Le déplacement pourra être réalisé sur une période de 15 ans, ce qui permettra de tester différents protocoles.
Un suivi sera assuré par la LPO Sarthe.
Pelouse à Limoselle aquatique sur le secteur des mares 12. Juin 2015.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
266
5.4: MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Trois mesures présentées ci-après permettront d’augmenter les potentialités d’accueil du site pour certaines
espèces (Sterne pierregarin, Mouette rieuse, végétation amphibie) ou de recréer des habitats amenés à être
exploités (haies buissonnantes et arborées).
Une quatrième mesure est destinée, par une mission permanente de suivi, d’assistance et de conseil, à assurer
la bonne application de l’ensemble des mesures ERC.
Mesure A1 : Sterne pierregarin et Mouette rieuse
La partie sud du plan d’eau 3 abrite deux
petits ilots correspondant à des déblais de
sondage (cf. vue ci-contre d’avril 2015).
Ces ilots sont colonisés par au moins deux
couples nicheurs de Sterne pierregarin et
deux couples nicheurs de Mouette rieuse. Il
s’agit cependant d’ilots de superficie très
réduite et peu adaptés à la nidification.
Des ilots plus favorables à ces espèces
seront aménagés à l’emplacement des ilots
actuels. Les modalités précises de cet aménagement (nombre d’ilots, superficie, nature du substrat…) et
d’entretien seront définies par la LPO Sarthe.
Cet aménagement sera réalisé durant la première phase quinquennale d’exploitation, en période d’étiage.
Mesure A2 : aménagement de berges favorables à la végétation amphibie.
Deux secteurs de la carrière seront aménagés avec des berges complexes (pentes douces et hauts-fonds)
favorables à l’installation d’une végétation amphibie : le secteur de la centrale à béton et le plan d’eau 3 (qui
bénéficie d’une mesure d’évitement). Le choix de ces deux secteurs repose essentiellement sur leur faible
profondeur, facteur favorable à ce type d’aménagement lorsque le volume de remblais est relativement faible.
Le principe d’aménagement de ce type de berge repose sur la mise en place de remblais meubles (matériaux
de découverte, boues de décantation, argiles bleues) qui viendront affleurer à des profondeurs variables et
avec de faibles pentes au sein de la zone de marnage des plans d’eau. Une coupe de principe est figurée ci-
après.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
267
Cet aménagement sera réalisé sur la berge sud du secteur de la centrale à béton, au fur et à mesure de
l’avancée de l’exploitation. La berge s’étendra sur une soixantaine de mètres en moyenne.
Sur le plan d’eau 3, la berge sera aménagée au niveau des bordures est et sud du plan d’eau, hormis sur le
secteur des îlots à Sterne pierregarin, durant les trois premières phases quinquennales.
La localisation des berges figure sur le plan d’état final.
Mesure A3 : plantation de haies arborées et buissonnantes
Le projet induira le défrichement de 280 m de haies arborées (haie 2 = alignement de chênes âgés sur la
bordure sud du plan d’eau 6) et 200 m de haies buissonnantes à arbustives (haie 4).
En remplacement des haies défrichées, 330 m de haies arborées et buissonnantes seront plantées durant la
première phase quinquennale d’exploitation sur la bordure sud-est du périmètre sollicité, à l’est du plan d’eau
1.
L’objectif de cette plantation est de créer une haie champêtre constituée d’une strate buissonnante favorables
aux oiseaux des fourrés (Linotte mélodieuse, Hypolaïs polyglotte, Fauvette grisette…) et d’une strate arborée
COUPE DE PRINCIPE D’UNE BERGE COMPLEXE
0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
10 20 60
29,3
28
Cote en m
Plan d’eau Roselière haute et basse
Talus ~ 30°
Terrain naturel
Végétation
aquatique
A B
HAUTES EAUX
BASSES EAUX
Distance en m
Remblais
Végétation
aquatique
CV
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
268
riches en arbres d’émonde (têtards). Ces derniers abritent en vieillissant des cavités recherchées par diverses
espèces d’oiseaux (mésanges, Huppe fasciée…) et certaines espèces de chauves-souris (Noctule commune,
Barbastelle…).
Les modalités de plantation figurent en annexe 5. Les travaux de plantation, d’émondage des arbres et
d’entretien de la haie seront assurés par la LPO Sarthe
Mesure A4 : suivi de l’avifaune et suivi des mesures ERC
La LPO Sarthe réalise un suivi standardisé de l’avifaune sur la carrière de la société TAVANO depuis mai
2010. Un rapport annuel est rédigé et adressé à la société.
La société TAVANO souhaite que ce suivi annuel soit poursuivi durant toute la période autorisée et souhaite
également que la LPO Sarthe soit associée à la maîtrise d’œuvre des mesures dans des missions d’inventaires
(mesures R1, R3, R4, R5, R6, R7, C1 et A1), de travaux (mesures C2 et A3) et de conseils (mesures R3, C1,
A1 et A2). Ce partenariat a fait l’objet d’une convention entre la société TAVANO et la LPO Sarthe.
Les modalités d’inventaires (protocoles, fréquences…) et de restitution des données (cartes, listes, analyses…)
seront définies par la LPO Sarthe.
5.5: SUIVI DES MESURES ECOLOGIQUES
Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi de la mesure et
des effets
E1 Évitement du plan d’eau 3, du
bassin 10 et de la haie 5 et des abords
Périmètre carrière Sans objet
E2 Évitement des arbres à Grand
Capricorne Périmètre carrière Sans objet
R1 Protection des amphibiens en
période de reproduction Périmètre carrière Inventaires par la LPO
R2 Protection des oiseaux des milieux
boisés Périmètre carrière
R3 Protection des Hirondelles de
rivage Périmètre carrière Inventaires et conseils par la LPO
R4 Protection du Martin-pêcheur Périmètre carrière Inventaires par la LPO
R5 Protection du Petit Gravelot Périmètre carrière Inventaires par la LPO
R6 Protection de la héronnière Hors carrière Inventaires par la LPO
R7 Protection des chauves-souris
arboricoles Périmètre carrière
Inventaires par la LPO
C1 Création de mares temporaires et
d’une pelouse silicicole Périmètre carrière
Inventaires et conseils par la LPO
C2 Déplacement de la Limoselle
aquatique Périmètre carrière
Suivi des travaux par la LPO Sarthe
A1 Aménagement d’ilots à Sterne
pierregarin Hors périmètre Inventaires et conseils par la LPO
A2 Aménagement de berges complexes Périmètre carrière Selon conseils de la LPO
A3 Plantation d’une haie champêtre Limite d’emprise sud Suivi des travaux par la LPO Sarthe
A4 Suivi standardisé de l’avifaune Suivi des mesures ERC par la LPO
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
269
6: MESURES RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX
6.1: MESURES DE REDUCTION
6.1.1: MESURES QUALITATIVES
EN PHASE D’EXPLOITATION
Aire étanche de ravitaillement et de lavage (mesure R1)
Le ravitaillement en carburant et le lavage des engins sur pneus sont et seront effectués sur une aire étanche
à proximité de l'atelier. Cette aire étanche sera reliée à un décanteur-déshuileur.
Précisons que le ravitaillement des engins sur chenilles se fait et se fera sur place avec une citerne double
paroi, avec toutes les précautions nécessaires (bac amovible et/ou couverture absorbante).
Précisons que les engins seront équipés de kit anti pollution permettant une intervention rapide.
Eaux usées et vannes (mesure R2)
Les eaux vannes et usées du réfectoire et des sanitaires seront envoyées dans une fosse septique
régulièrement vidangée.
Prévention du risque de pollution de la nappe (mesure R3)
Rappelons tout d'abord que l’entretien des engins de chantier ne sera pas effectué sur la carrière mais dans
l'atelier présent sur l'aire de l'installation de traitement, où toutes les dispositions de protection réglementaires
seront mises en œuvre.
Dans cet atelier, les stocks de gazole et les fûts d'huiles neuves et usagées sont entreposés au-dessus de
bacs de rétention étanches correctement dimensionnés.
Les déchets dangereux sont régulièrement évacués (1 à 2 fois par an) par un récupérateur agréé, les bons
d’enlèvement et les bordereaux de suivi sont collectés et archivés dans un classeur au bureau.
Le volume de déchets dangereux pouvant être présents sur site est de :
1000 l d’huiles usagées,
600 l de déchets dangereux divers (cartouches de graisse, absorbants, produits souillés...),
1 fut de 200 l pour les filtres,
1 fut de 200 l pour les aérosols.
L'exploitant veillera au bon état des engins évoluant sur le site, afin d'éviter toute fuite accidentelle
d'hydrocarbures.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
270
Notons que la drague aspiratrice de l’entreprise sous-traitante fonctionne au GNR, que le ravitaillement est
assuré par l’entreprise sous-traitante avec toutes les précautions d’usage. Les produits absorbants
antipollution, notamment des barrages oléophiles sont présents sur la drague.
Si malgré tout une fuite d’huile ou de carburant était constatée, les terres souillées seraient immédiatement
décapées et évacuées.
Une éventuelle pollution d’un des plans d'eau serait circonscrite par l’utilisation d’un barrage oléophile
permettant de circonscrire la pollution, et les eaux polluées seraient pompées et évacuées vers un centre de
traitement approprié.
Des produits absorbants spécifiques (lingettes, poudre et boudins), seront présents en quantité suffisante dans
l’atelier.
Le personnel dispose déjà d’instructions concernant la maîtrise des risques, notamment en ce qui concerne le
déversement accidentel d’hydrocarbures (consignes et protocoles de déchargement). Elles font l’objet de
formation et de rappels dispensés dans des 1/4 h sécurité. (mesure A1).
La remise en état sera réalisée exclusivement à l'aide des matériaux inertes du site (découverte, fines de
décantation, argiles). Aucun matériau extérieur ne sera accepté.
Afin d'éviter les actes de malveillance (dépôt d'ordures), l’accès au site est fermé en dehors des heures de
travail. La remise en état coordonnée permet d’éviter les dépôts sauvages qui pourraient avoir une influence
néfaste sur la qualité des eaux.
Maintien des échanges entre la nappe et les plans d’eau (mesure R4)
Le maintien des échanges hydrauliques entre la nappe et les plans d’eau permet d’éviter les phénomènes
d’eutrophisation et ainsi de maintenir la qualité des eaux. Pour cela :
les berges des plans d’eau sont talutées pour partie dans la masse du gisement, notamment celles
perpendiculaires à l’axe du sens de circulation de la nappe (nord-ouest/sud-est),
les zones de remblai sont mises en place le plus possible parallèlement à l’axe de circulation des eaux.
APRES EXPLOITATION
La remise en état du site est à vocation naturelle et paysagère. Tous les types de déchets seront évacués
selon des filières spécifiques agréées pour les déchets dangereux. Il ne subsistera aucun produit ou matériau
pouvant entrainer une pollution des eaux.
Les terrains étant privés, l’emprise du site restera clôturée afin d’éviter les dépôts de toutes sortes.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
271
6.1.2: MESURES QUANTITATIVES
Les mesures quantitatives à mettre en place sont liées plus spécifiquement au rabattement potentiel de la
nappe lors des opérations d’extraction à sec des argiles présentes entre les alluvions et les sables
cénomamiens. Rappelons que la présence de ces argiles et discontinue et que le pompage pour rabattement
sera temporaire. Le débit de pompage sera de 300 m3/h.
Les mesures de surveillance sont des mesures de suivi au cours de l’exploitation. Elles sont développées dans
le paragraphe suivant.
Mesures quantitatives : (mesure R5)
Avant la réalisation d’un rabattement temporaire de nappe, le circuit des eaux sera prévu de façon à maintenir
un équilibre hydrodynamique entre le prélèvement et le rejet et ainsi compenser les effets d’un éventuel
rabattement sur le secteur amont de la carrière et sur le secteur aval (base de loisirs « Le Houssay » au Sud-
Ouest).
L’encadrement de ces opérations pourra consister en des suivis piézométriques hebdomadaires (mesure
R5). Cette mesure sera complétée par :
pour le secteur amont, la définition d’un seuil de rabattement sur le piézomètre Pz3. Vis-à-vis des
variations piézométriques saisonnières de la nappe (annuelle de 1 mètre environ et interannuelle de
2,4 mètres) et de son usage local (jardin et agricole), un seuil de rabattement d’un mètre en Pz3 est
acceptable pour maintenir l’exploitation du forage utilisé à la Perrée et pallier aux risques de
déstabilisation des structures voisines (voiries, habitations). Rappelons que lors de l’essai de
pompage, le piézomètrre amont n’avait pas été influencé.
pour le secteur aval, une attention particulière sera portée au niveau piézométrique du puits le Port au
Liard qui est le point de suivi le plus proche du plan d’eau de pêche de la base de loisirs « Le
Houssay ». En cas de baisse du niveau d’eau du plan d’eau de pêche de la Houssay, une alimentation
par canalisation à partir du plan des pelouses pourra être mise en place. Une convention est en cours
d’établissement entre la Mairie et les Carrières TAVANO.
6.2: MESURES DE SURVEILLANCE
Un réseau de surveillance des eaux est déjà mis en place sur le site.
Ce réseau est constitué de piézomètres et de points de contrôle des eaux superficielles. Ce réseau permet de
poursuivre le suivi piézométrique en cours et de vérifier l’absence d’impact de l’activité pendant et au terme de
l’exploitation.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
272
Le réseau de surveillance des eaux comprend :
4 piézomètres de surveillance : Pz1 et Pz2 en position aval ; Pz3 et Pz4 en position amont ;
Un puit situé au Port au Liard, à côté du plan d’eau de pêche du Houssay;
1 point de surveillance de la qualité des eaux au niveau du plan d’eau de la Coyère.
Précisons que le piézomètre Pz3 en position amont de la carrière actuelle sera déplacé vers le nord, en limite
d’emprise.
Le niveau de la nappe sera relevé de manière synchrone mensuellement sur les piézomètres et le puit du port
au Liard (mesure S1).
La surveillance de la qualité des eaux (mesure S2) se fera sur le plan d’eau de la Coyère plan d’eau de
pompage qui reçoit les eaux propres issues du circuit de décantation.
Les analyses seront réalisées annuellement par un laboratoire accrédité COFRAC et agréé par le ministère en
charge de l’environnement pour le contrôle de l’eau et des milieux aquatiques, et portera à minima sur les
paramètres suivants :
température, pH, conductivité, matière en suspension, demande chimique en oxygène,
micropolluants organiques : indice hydrocarbures.
Toutes les données acquises dans le cadre de la surveillance sont et seront compilées et archivées. Elles sont
tenues à disposition des services de la DREAL et de la mairie de SPAY.
6.3: SYNTHESE DES MESURES RELATIVES AUX EAUX
Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi / durée
R1 Ravitaillement et lavage sur aire
étanche (engins sur pneus) Devant atelier Durée de l’exploitation
R2 Gestion des eaux usées Devant bureau Contrôles périodiques pendant la durée
de l’exploitation
R3 Prévention des risques de
pollution Périmètre carrière
Contrôles périodiques qualitatif et suivi piézométrique sur les points du réseau
de surveillance sur la durée de l’exploitation (S1 et S2)
R4 Maintien des échanges nappe
plan d’eau Périmètre carrière
Pendant la durée de l’exploitation
R5 Gestion de la piézométrie alentours en période de rabattement de nappe
Périmètre de la carrière et abords
Contrôles hebdomadaires par l’exploitant
A1 Sensibilisation et formation du
personnel aux mesures de maîtrise des risques liés à l’activité
Périmètre de la carrière Exercices périodiques de mise en
situation pendant la durée de l’exploitation
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
273
7: MESURES CONCERNANT L'AIR ET LE CLIMAT
7.1: POUSSIERES
7.1.1: MESURE D’EVITEMENT
Lors du choix du projet, l’option retenue a été de privilégier un approfondissement des plans d’eau existants
(mesure E1) plutôt que d’étendre la surface d’exploitation. En cela cette option limite de fait les envols potentiels
de poussières dus au décapage des terrains et à l’exploitation de la partie hors eau.
Au niveau du traitement des matériaux, rappelons que ce dernier se fait sous eau ce qui évite de générer des
envols de poussières (mesure E2).
7.1.2: MESURE DE REDUCTION DES ENVOLS
Les mesures pour limiter les envols et la dispersion des poussières concernent essentiellement la circulation
des engins sur les pistes, ces mesures sont les suivantes :
- Concernant la circulation :
- Entretien régulier des pistes (mesure R1),
- Arrosage des pistes par temps sec et venteux au moyen d’une citerne à eau tractée si nécessaire
(mesure R2),
- Limitation de la vitesse des engins (mesure R3).
7.1.3: MESURE D’ACCOMPAGNEMENT
L’ensemble du personnel a reçu une sensibilisation sur les impacts environnementaux susceptibles de résulter
de l’activité à son poste de travail et sur les consignes destinées à limiter les envols de poussières (mesure
A1). Des rappels périodiques sont effectués sous forme de sensibilisation directe ou ¼ d’heure sécurité
environnement par le chef de carrière.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
274
7.1.4: MESURE DE SUIVI DES MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS DE POUSSIERES
Précisons que les exploitations de carrière en eau ne sont pas soumises à l’élaboration d’un plan de
surveillance des émissions de poussières.
Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi
E1
Choix de l’approfondissement de
plan d’eau plutôt qu’extension de
surface
Périmètre du projet
-
E2 Traitement des matériaux sous
eau. -
R1 Entretien régulier des pistes
Contrôle par l’exploitant R2 Arrosage des pistes
R3 Limitation de vitesse sur les pistes
A1 Sensibilisation du personnel -
7.2: AUTRES EMISSIONS DANS L’AIR
Ce paragraphe regroupe les mesures communes destinées à limiter les émissions de gaz, dont les gaz à effet
de serre pouvant avoir à grande échelle un effet sur le climat, de fumées et d’odeurs.
Les émissions d'odeurs, de gaz et de fumées anormales sont évitées par les mesures suivantes :
respect de l'interdiction de brûlage (mesure E1),
maintenance régulière des engins et des véhicules (mesure R1),
Les engins en service sont alimentés par du gazole non routier (GNR) en remplacement du fioul domestique,
qui présente notamment :
une très faible teneur en soufre (≤ 10 mg/kg en sortie de raffinerie ou 20 mg/kg au stade de la
distribution), ce qui diminue la production de gaz à effet de serre et de particules,
un indice cétane élevé, permettant une meilleure combustion du carburant et une diminution des
imbrûlés et autres impuretés présentes dans les gaz d’échappement.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
275
Des consignes vis-à-vis d’un incendie sont établies de façon à limiter rapidement l’extension des conséquences
d’un sinistre et les émissions atmosphériques inhérentes (mesure R2). Ces consignes indiquent aussi la
position des éléments de secours et les numéros de téléphones des secours. (cf. Etude de dangers).
La sensibilisation du personnel sur les impacts environnementaux sera poursuivie (mesure A1).
Le bilan est le suivant :
Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi
E1 Respect de l'interdiction de brûlage
Périmètre du site Contrôle par l’exploitant
R1 Maintenance régulière des engins
et des véhicules
R2 Présence de consignes incendie
A1 Sensibilisation et formation du
personnel
7.3: MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE
Les mesures décrites au paragraphe précédent sont autant de mesures qui contribuent à la maîtrise de la
consommation de carburant :
maintenance régulière des engins et des véhicules (mesure R1),
entretien régulier des pistes (mesure R2),
limitation de la vitesse des engins et des véhicules sur le site (mesure R3).
La mise en place du bassin de refoulement de la pulpe (drague aspiratrice) à proximité de l’installation de
traitement sur site, permet de limiter la distance de transport des sables et graviers extraits, participant ainsi à
une utilisation rationnelle de l'énergie (mesure R4).
Un suivi de la consommation (carburant et électricité) est réalisé, de façon à pouvoir détecter tout écart et
mettre en place les actions correctives qui s’imposent.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
276
Le bilan est le suivant :
Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi
R1 Maintenance régulière des engins
et des véhicules
Périmètre du projet Suivi de la consommation
énergétique
R2 Entretien régulier des pistes
R3 Limitation de la vitesse des engins
et des véhicules sur le site
R4 Optimiser les distances de
déplacement des engins
A1 Sensibilisation et formation du
personnel
8: MESURES RELATIVES AUX BIENS MATÉRIELS
8.1: VOIES DE COMMUNICATION
Il n’y aura pas de trafic supplémentaire de camions de matériaux sur les voies publiques, voire ce dernier
pourra diminuer pendant quelques années du fait de la diminution de production programmée (objectif du
SDAGE et du SDC) (mesure E1).
Précisons qu’une partie de la production (16 000 t/an en moyenne) alimente directement la centrale à béton
présente sur le site, ce qui limite d’autant la circulation des camions sur les voies publiques.
Les dispositions déjà en place pour maintenir en état la voie publique à la sortie du site et limiter les risques
d’accident seront maintenues. Ces mesures de réduction des risques et d’accompagnement sont les
suivantes :
Signalisation adaptée en sortie de carrière (mesure R1),
Nettoyage régulier de la voie publique au droit de la traversée entre les deux secteurs de la
carrière, afin d’éviter les risques de salissure (mesure R2),
Sensibilisation du personnel (mesure A1).
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
277
Rappelons que la commune de SPAY a mis en place une voie desservant directement la RD 323 à partir de
la voie communale n°9, permettant au trafic lié aux carrières et à la zone artisanale et industrielle de ne pas
traverser le lieu-dit « Les Aulnays ».
Suivi des mesures
Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi
E1
Pas d’augmentation de trafic voire
diminution temporaire de ce
dernier Périmètre du projet
-
R1 Signalisation en sortie
Contrôle par l’exploitant R2
Entretien de la voie publique au
droit de l’accès carrière
A1 Sensibilisation et formation du
personnel -
8.2: RESEAUX DE DISTRIBUTION
Aucun réseau ne sera affecté par l’exploitation, les pylones EDF présents sur le site, au droit ou en bordure
des zones d’extension resteront en place, l’exploitant maintiendra toutes les mesures en vigueur actuellement.
Précisons qu’à ce jour aucun problème n’a été mis en évidence et que la carrière est ouverte depuis les années
60.
Maintien permanent de l’accès aux poteaux (mesure R1) par une bande de terrain,
Maintien de l’accès aux agents ERDF par l’intérieur du site,
Absence d’exploitation à proximité des pylones,
Nettoyage des pieds des pylones (végétation).
*
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
278
8.3: STABILITE DES TERRAINS
Les mesures mises en œuvre pour éviter les risques d’affaissement de terrains sont les suivantes :
Conservation d’une distance de sécurité entre le périmètre d’exploitation et les terrains voisins de
10 m de large (mesure E1) minimum. Cette distance est portée à 50 m en bordure de la Sarthe.
Talutage des berges en pente douce lors de la remise en état. (mesure R1),
Bilan des mesures
Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi
E1
Conservation d’une distance de
sécurité entre le périmètre
d’exploitation et les terrains
voisins
Périmètre de la carrière
en projet Contrôle par l’exploitant
R1 Talutage des berges en pente
douce lors de la remise en état
9: MESURES RELATIVES AU PATRIMOINE
Aucune mesure particulière n’est à mettre en place vis-à-vis du patrimoine, l’exploitation n’ayant aucune
incidence vis-à-vis de ce thème. On ne peut cependant pas exclure une découverte fortuite lors des opérations
de décapage des terrains sollicités en extension.
Lors de ces travaux, l'exploitant prendra les précautions nécessaires pour éviter toute destruction de ce
patrimoine éventuel en se conformant aux prescriptions de la loi du 27 septembre 1941 relative aux fouilles
archéologiques.
L'exploitant s'engage à signaler toute découverte fortuite à la DRAC, par l'intermédiaire du Maire de la
commune.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
279
10: MESURES DE PROTECTION VISUELLE ET PAYSAGERE
Dans le cas présent, il est important de rappeler que l’activité d’extraction de matériaux sur le site n’est pas
une activité nouvelle. La carrière a été ouverte dans les années 1965.
Photographie aérienne de mai 1957 : Aucune extraction n’a débuté sur le secteur des carrières TAVANO. On a un
début d’exploitation des carrières Baglione au nord de la VC n°9.
Photo aérienne d’Aout 1966 : L’exploitation
a commencé au niveau des bassins de
décantation actuels et stockage de pulpe
(mélange eau/sables de la drague
aspiratrice)
Exploitation
BAGLIONE
Exploitation TAVANO
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
280
Depuis 50 ans, l’activité d’extraction de matériaux sur ce secteur fait partie du paysage local.
D’un point de vu visuel, l’analyse faite des champs de pénétration a mis en avant que l’exploitation n’est
perceptible en mode direct et statique que depuis les habitations des Pelouses. Vis-à-vis de l’Enfournoire, la
vision est indirecte du fait de la végétation et des haies présentes en périphérie.
En d’autres termes, la zone d’extraction n’est et ne sera que très peu visible de l’extérieur, le présent projet,
ne modifiera en rien ce constat.
10.1: MESURES D’EVITEMENT
La seule mesure d’évitement découle du choix du projet d’approfondir les plans d’eau plutôt que d’étendre la
zone d’extraction en surface.
10.2: MESURES DE REDUCTION D’IMPACT
Les mesures proposées concernent davantage des principes de «bon sens» que des mesures étudiées pour
minimiser les impacts potentiels. Elles sont liées à la prise en compte de la perception extérieure du site avec :
- le maintien des abords et du site en bon état de propreté (mesure R1),
- l’entretien des clôtures périphériques (mesure R2),
- l’entretien régulier de l’accès (portail, panneaux indicateurs) et nettoyage de la VC n°9 en cas de
nécessité (mesure R3),
- la mise en place pour mémoire de mesures de réduction des émissions de poussières,
De plus, autant que possible, mis à part la constitution des merlons de protection visuelle et de sécurité
disposés en limite d'emprise, les terres de découverte seront utilisées directement pour le réaménagement,
sans stockage intermédiaire
10.3: MESURES COMPENSATOIRES
Les choix de la remise en état du site s’inscrivent en termes de mesures compensatoires.
Compte tenu de la vocation ultérieure des lieux (remise en état sous la forme de plans d'eau), il ne sera pas
possible de restituer un paysage à l’identique. Cependant le projet d’exploitation n’apporte aucun élément
nouveau dans le paysage.
L’effet à court et moyen terme sera compensé par la remise en état des lieux, effectuée de manière coordonnée
à l'avancée de l'extraction.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
281
Les berges seront talutées et les abords des plans d’eau seront enherbés, de manière à supprimer le caractère
artificiel créé par l’extraction. Les berges ainsi modelées seront favorables à l'installation d'une végétation
subaquatique, qui contribuera à restituer au site un aspect plus naturel et à assurer une intégration satisfaisante
dans le paysage local.
Rappelons que les mesures mises en place en faveur de l’écologie participent à donner un caractère naturel
au site. Ces mesures font l’objet d’un suivi spécifique par la LPO, qui ne sera pas repris ici.
Rappelons que cet axe de remise en état est entièrement compatible avec le caractère des bords de Sarthe
dans lequel le site s’intègre. Il correspond aussi au développement souhaité par la mairie de Spay qui a entériné
dans son PLU (PADD), le développement d’un axe touristique du Val de Sarthe par la création d’itinéraires de
randonnée.
Extrait du PADD de la commune de SPAY
On peut noter que les carrières TAVANO participent à la continuité écologique et sont aussi intégrées dans la
trame bleue.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
282
10.4: SYNTHESE DES MESURES PAYSAGERES
Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi
E1 Choix de l’approfondissement des
plans d’eau
Périmètre de la carrière en
projet Contrôle par l’exploitant
R1 Maintien du site en bon état de
propreté
Périmètre de la carrière en
projet Contrôle par l’exploitant
R2 Entretien des clôtures Périmètre de la carrière en
projet Contrôle par l’exploitant
R3 Entretien de l’accès Périmètre de la carrière en
projet Contrôle par l’exploitant
11: BILAN DES EFFETS RÉSIDUELS
Le bilan des effets est présenté sous la forme de tableaux pages suivantes.
Le niveau d’impact est précisé à titre indicatif par une approche subjective. Il est gradué de la façon suivante :
très fort, fort; moyen, faible, négligeable à nul.
Par « court terme », il faut entendre une durée de quelques années après obtention de l’autorisation, « moyen
terme » la durée jusqu’à la fin de l’autorisation et « long terme » au-delà de la remise en état du site.
Les effets positifs sont indiqués en italique.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
283
Domaines Effets pris en compte Niveau d’impact
brut Remarques Principales mesures
Niveau d’impact
résiduel
Population
(commodité du
voisinage)
Modification des niveaux sonores
actuels moyen
Simulations montrant des niveaux d’émergence conformes au seuil
réglementaire au niveau des habitations en Zones à Emergence
Réglementée, sauf à l’Enfournoire où des mesures devront être prises
- Ecran type merlon de 3 m de hauteur en limite sud de la
plateforme est
Faible à nul
Vibrations/ projections/ explosions Faible à nul Vibrations faibles dues aux engins et installations, distance de
propagation très réduite.
- Pas de rapprochement des installations des zones habitées Nul
Emissions lumineuses Faible à nul
Eclairage des postes de travail, sans risque de nuisance pour le
voisinage et les espèces animales.
Pas d’activité en période nuit.
- Absence d’éclairage en dehors des périodes d’activités Faible à nul
Sécurité publique Accidents corporels fort Risque en cas d’entrée illicite sur le site, lié à la présence de plans d’eau
et bassins de séchage des boues, et à l’emploi de matériel d’exploitation
- Clôture du site, accès fermé hors périodes d’ouverture
- Balisage sur site du plan de circulation
- Protection des zones dangereuses
- Présence de bouées et bateau
- Présence d’extincteurs entretenus
- Talutage des berges, remise en état coordonnée
Activités
Agriculture Nul Aucune réduction de surface agricole / /
Sylviculture Faible Défrichement d’une faible surface (2,88 ha)
Aspects productifs et cynégétiques d’intérêt très secondaire.
- Boisement compensateur ou compensation financière Nul
Economie locale et régionale
(hors agriculture et sylviculture) Fort
Pérennisation d’une activité économique locale permettant un
approvisionnement des entreprises locales.
Limitation de la pénurie en sables dans la région du fait de la diminution
progressive du quota autorisé.
/ /
Loisirs Moyen Effet lié à la baisse potentielle du niveau dans le plan d’eau de pêche du
fait du pompage très temporaire pour extraire les argiles hors eau.
- Suivi du niveau piézométrique lors des périodes de rabattement
- Possibilité de réalimentation du plan d’eau de pêche à partir du
plan d’eau des Pelouses
- Convention signée avec la mairie
Faible à Nul
Biodiversité
Espèces protégées Fort Destruction d’habitats d’espèces protégées. Destruction potentielle
d’espèces. Des mesures seront mises en place
- Préservation des habitats (évitement de terrain et arbres)
- Gestion des travaux dans le temps
- Inventaire des sites par spécialiste avant travaux
- Déplacement d’espèces
- Création de mares et pelouse silicicole
- Aménagement d’îlots
- Suivis des travaux par la LPO
- Suivis biologiques annuels par la LPO
Faible
Sensibilité patrimoniale Moyen à faible Terrains en renouvellement plus riches que terrains en extension
Potentialités d’accueil Fort à faible Impact positif fort à court terme (situation actuelle), moyen à moyen terme
et faible à long terme (plans d’eau plus grands et plus profonds).
Fragmentation d’habitats Moyen Fragmentation de l’espace utilisé par les amphibiens avec la liaison entre
les plans d’eau
Continuités écologiques Nul Maintien d’une bande inexploitée de 60 m (50 +10m) en bordure de
Sarthe permet de conserver la fonctionnalité du corridor.
Incidences sur les sites Natura 2000 Nul Aucun impact du projet sur les zones Natura 2000 / Nul
Sols Décapage de la terre végétale Moyen
Modification des caractéristiques structurales et des qualités
agronomiques des sols
Effets indirects faible sur les habitats naturels
- Décapage sélectif des horizons
- Limitation de la hauteur de stockage de la terre végétale
- Reconstitution progressive et sélective des horizons
Eaux
Ecoulements superficiels et
souterrains
Incidence volumétrique
Nul Pas d’effet sur l’état quantitatif de la masse d’eau souterraine
/ Nul
Ecoulements superficiels et
souterrains
Incidence piézométrique
Forte Perturbation locale de la piézométrie sous l’effet du pompage pour
extraire les argiles hors eau.
- Suivi piézométrique hebdomadaire avec niveau d’alerte Faible
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
284
Qualité des eaux Moyenne Mise à l’air de la nappe (agrandissement) : augmentation de la
vulnérabilité aux pollutions, maintien de la continuité plan d’eau/nappe
- Entretien régulier des engins
- Présence de kit anti pollution et boudins oléophiles
- Ravitaillement sur aire étanche
- Procédure d’intervention en cas de déversement accidentel
Faible
Usages des eaux souterraines Nul à faible
Pas d’effet sur les captages AEP. Effets potentiels sur le plan d’eau de
pêche et sur le forage utilisé pour l’exploitation de safran, liés à la
modification potentielle de piézométrie
- Suivi piézométrique mensuel Faible à nul
Air et climat
Poussières Moyen à faible Emissions liées essentiellement à la circulation des engins et camions et
aux opérations d’exploitation hors eau
- Entretien des pistes
- Arrosage des pistes si nécessaire
- Limitation de la vitesse sur piste
Faible
Odeurs et fumées Nul
Emissions liées au gaz d’échappement des engins ou à un incendie
accidentel
Absence de brûlage sur le site
- Interdiction de brulage sur site
- Entretien des engins
- Présence de consignes en cas d’incendie
- Sensibilisation du personnel
Nul
Emissions de Gaz à Effet de Serre Négligeable Liés au fonctionnement des engins et camions (combustion)
Vulnérabilité du projet au
changement climatique Nul
Carrière en projet située pour partie en zone inondable avec effet positif
écrêteur de crue.
/ /
Biens matériels
Modification de l’organisation
spatiale des voies de communication Faible Création d’une piste d’accès à la parcelle AK 47
/ /
Génération de trafic Nul
Aucune augmentation de trafic sur la VC°9 par rapport à la situation
actuelle. On aura même une diminution temporaire du fait de la baisse
programmée des extractions de sables par le SDAGE
/ /
Effet sur la stabilité des sols Nul
Pas de risque d’instabilité des fronts d’exploitation
Pente maximale des talus de découverte adaptée à la nature des
formations
Rabattement de nappe engendré aux points de contrôle (piézomètres)
inférieur au battement interannuel de la nappe
/ /
Bâti Nul Rabattement de nappe engendré aux points de contrôle (piézomètres)
inférieur au battement interannuel de la nappe
/ /
Réseaux de distribution Fort Présence de pylônes ERDF sur le site et hors l’emprise mais avec accès
par le site.
- Entretien des abords des pylônes
- Pas d’activité autour des pylônes
- Libre accès au personnel ERDF
Faible à nul
Patrimoine
Découverte archéologique Faible Pas de site archéologique reconnu sur le site ou aux abords.
Risque de découverte faible, peu de surface non décapée
/ Faible
Monuments historiques et sites Nul Absence de site inscrit et monument historique aux abords du site / /
Paysage Modification des vocations Faible
Faible surface défrichée
Peu de modification de vocations, nombreux plans d’eau déjà présents
Substitution progressive des terrains sollicités en extension
/ Faible
Modification topographique Faible Lié à l’extraction même si les surfaces d’eau donnent une impression de
planitude
/ Faible
Modification du visuel Faible Pas de composante nouvelle dans le paysage - Entretien et maintien du site en bon état de propreté Faible
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
285
12: EVALUATION DU COUT DES MESURES
Certaines mesures ne sont pas chiffrables, soit parce qu'il s'agit davantage de précautions, soit parce qu'elles
constituent des mesures de réduction des effets dont les coûts entrent dans le coût du projet et dans les coûts
d’exploitation de la carrière en projet.
12.1: COUT DES MESURES ACOUSTIQUES
Mesure Intitulé Coût de mise en
place Coûts de suivi
E1 Activité dans la plage horaire 7h-
17h30, hors week end et jours fériés - -
R1 Mise en place d’écrans : merlons
périphériques Intégré dans le coût
d’exploitation
Contrôle triennal des niveaux
sonores :
1 800 €/3 ans
(18 000 € sur 30 ans)
R2 Utilisation d'engins répondant aux
normes en vigueur en matière de bruit
-
R3
Limitation de l’utilisation de klaxons et interdiction de l'usage d'appareils de
communication sonore gênants pour le voisinage
R4 Limitation de la vitesse sur les pistes
R5 Entretien régulier des voies de
circulation internes
R6 Utilisation d’avertisseurs sonores de
recul à large bande
12.2: MESURES RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE
Mesure Intitulé Coût de mise en place Coût du suivi
E1 Clôture du site ou présence de
merlons Inclus dans le coût
d’exploitation Inclus dans le coût d’exploitation
E2 Portail à l’accès, fermé en dehors
des heures d’ouvertures Déjà en place Inclus dans le coût d’exploitation
R1 Plan de circulation et balisage sur
site Déjà en place Inclus dans le coût d’exploitation
R2 Protection des plans d’eau par
merlons Déjà en place - Inclus dans
le coût d’exploitation Inclus dans le coût d’exploitation
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
286
Mesure Intitulé Coût de mise en place Coût du suivi
R3 Présence de panneaux
spécifiques au droit des zones dangereuses
Emprise du site Inclus dans le coût d’exploitation
R4 Présence de bouées avec toulines Déjà en place Inclus dans le coût d’exploitation
R5 Bateau disponible dans l’atelier Déjà en place -
R6 Equipements de lutte contre
l’incendie régulièrement vérifiés Déjà en place
100 €/an
3 000 € sur 30 ans
R7 Présence de moyens d’alerte
(téléphones) Déjà en place Inclus dans le coût d’exploitation
R8 Affichage des moyens de secours
et de leur localisation Déjà en place Inclus dans le coût d’exploitation
R9 Talutage des berges – remise en
état coordonnée Inclus dans le coût
d’exploitation Inclus dans le coût d’exploitation
12.3: MESURES RELATIVES A LA SANTE, HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
En l'absence de risque sanitaire (cf. § 1.7 du chapitre 4), aucune disposition particulière n'est à prévoir en
matière d'hygiène, de salubrité et de santé publique, en dehors de celles qui concernent la protection des eaux,
le bruit, les émissions atmosphériques et la gestion des déchets qui sont chiffrées aux paragraphes dédiés.
12.4: MESURES RELATIVES A L’AGRICULTURE
Pas d’impact sur l’agriculture
12.5: MESURES RELATIVES A LA SYLVICULTURE
Mesure Intitulé Coût de mise en place Coût du suivi
E1 Choix du projet - -
C1 Reconstitution d’un massif
forestier ou acquittement financier De l’ordre de 4000 €/ha -
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
287
12.6: COUT DES MESURES ECOLOGIQUES
Mesure Intitulé Coût de mise en place Coût du suivi
E1 Évitement du plan d’eau 3, du
bassin 10 et de la haie 5 et des abords
Pas de coût supplémentaire
hormis la perte de gisement /
E2 Évitement des arbres à Grand
Capricorne Pas de coût supplémentaire /
R1 Protection des amphibiens en
période de reproduction Pas de coût supplémentaire
Anticipation de la date des travaux /
R2 Protection des oiseaux des milieux
boisés Pas de coût supplémentaire
Anticipation de la date des travaux /
R3 Protection des Hirondelles de
rivage Pas de coût supplémentaire
Travaux d’écrêtage des fronts /
R4 Protection du Martin-pêcheur Pas de coût supplémentaire
Anticipation de la date des travaux
/
R5 Protection du Petit Gravelot Pas de coût supplémentaire /
R6 Protection de la héronnière Pas de coût supplémentaire /
R7 Protection des chauves-souris
arboricoles Inventaires des cavités : 862 € x 2
= 1724 €*
C1 Création de mares temporaires et
d’une pelouse silicicole Inclus dans les coûts d’exploitation
C2 Déplacement de la Limoselle
aquatique 2 791 €*
A1 Aménagement d’ilots à Sterne
pierregarin Inclus dans les coûts d’exploitation
A2 Aménagement de berges
complexes Inclus dans les coûts d’exploitation
A3 Plantation d’une haie champêtre 10 €/ml x 330 m = 3 300 €
A4 Suivi standardisé de l’avifaune et
suivi des mesures ERC par la LPO de la Sarthe
5 796 €*
86 935 sur 15 ans
* Chiffrage LPO Sarthe
Montant total HT estimé des mesures ERC sur la période autorisée : 94 750 € (coût 2016), hors coûts
d’exploitation.
12.7: COUTS RELATIFS A LA PROTECTION DES SOLS
Mesure Intitulé Coût de mise en place Coût du suivi
R1 Décapage sélectif des sols Inclus dans les coûts
d’exploitation Inclus dans le coût d’exploitation
R2 Limitation de la hauteur des stocks
ou remise en place directement. Inclus dans les coûts
d’exploitation Inclus dans le coût d’exploitation
R3 Reconstitution progressive et
sélective des horizons Inclus dans les coûts
d’exploitation Inclus dans le coût d’exploitation
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
288
12.8: COUTS RELATIFS A LA PROTECTION DES EAUX
Mesure Intitulé Coût de mise en place Coût de suivi
R1 Ravitaillement et lavage sur aire
étanche (engins sur pneus) Inclus dans le coût
d’exploitation
Vidange du déshuileur : 1000 €/an
30 000 €/an
R2 Gestion des eaux usées
Contrôle extérieur triennal: 1 000 €/30ans
10 000 €/ 30 ans
R3 Prévention des risques de
pollution
Inclus dans le coût d’exploitation
Déplacement piézomètre :
10 0000 €
Suivi piézométrique en interne, inclus dans le coût d’exploitation
Suivi qualitatif : analyse annuelle 500 € /an
15 000 € /30 ans
R4 Maintien des échanges nappe
plan d’eau Inclus dans le coût
d’exploitation /
R5 Gestion de la piézométrie alentours en période de rabattement de nappe
Inclus dans le coût d’exploitation
/
A1 Sensibilisation et formation du
personnel aux mesures de maîtrise des risques liés à l’activité
Inclus dans le coût d’exploitation
Inclus dans le coût d’exploitation
12.9: COUT DES MESURES RELATIVES A L’AIR ET AU CLIMAT
12.9.1: COUT DES MESURES RELATIVES A LA PROTECTION VIS-A-VIS DES EMISSIONS
POUSSIERES
Mesure Intitulé Coût de mise en
place Coût du suivi de suivi
E1 Choix de l’approfondissement de plan
d’eau plutôt qu’extension de surface
Inclus dans le coût
d’exploitation
Inclus dans le coût d’exploitation
E2 Traitement des matériaux sous eau.
R1 Entretien régulier des pistes
R2 Arrosage des pistes
R3 Limitation de vitesse sur les pistes
A1 Sensibilisation du personnel
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
289
12.9.2: COUT DES MESURES VIS-A-VIS DES EMISSIONS DE GAZ, FUMEES ET ODEURS
Mesure Intitulé Coût de mise en
place Coût du suivi
E1 Respect de l'interdiction de brûlage
Inclus dans le coût
d’exploitation Inclus dans le coût d’exploitation
R1 Maintenance régulière des engins et
des véhicules
R2 Présence de consignes incendie
A1 Sensibilisation et formation du
personnel
12.10: COUT DES MESURES DE MAITRISE DE L’ENERGIE
Mesure Intitulé Coût de mise en
place Coût du suivi
R1 Maintenance régulière des engins et
des véhicules
Inclus dans le coût
d’exploitation Inclus dans le coût d’exploitation
R2 Entretien régulier des pistes
R3 Limitation de la vitesse des engins et
des véhicules sur le site
R4 Optimiser les distances de
déplacement des engins
A1 Sensibilisation et formation du
personnel
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 7
290
12.11: COUT DES MESURES RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION
Mesure Intitulé Coût de mise en
place Coût du suivi
E1 Pas d’augmentation de trafic voire
diminution temporaire de ce dernier
Inclus dans le coût
d’exploitation
Inclus dans le coût du projet
R1 Signalisation en sortie
R2 Entretien de la voie publique au droit
de l’accès carrière
A1 Sensibilisation et formation du
personnel
12.12: MESURES RELATIVES A LA STABILITE DES TERRAINS
Mesure Intitulé Coût de mise en place Coût du suivi de suivi
E1
Conservation d’une distance de
sécurité entre le périmètre
d’exploitation et les terrains voisins
Inclus dans le coût
d’exploitation
Inclus dans le coût d’exploitation
R1 Talutage des berges en pente
douce lors de la remise en état
12.13: COUTS DES MESURES PAYSAGERES
Mesure Intitulé Coût de mise en place Coût du suivi de suivi
E1 Choix de l’approfondissement des
plans d’eau
R1 Maintien du site en bon état de
propreté
Inclus dans le coût
d’exploitation
Inclus dans le coût d’exploitation
R2 Entretien des clôtures
R3 Entretien de l’accès
R4 Réaménagement coordonné
compatible PADD Mairie Spay
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 8
293
SOMMAIRE
Page
1: CADRE REGLEMENTAIRE 295
1.1: APPROCHE JURIDIQUE 295
1.2: PROCEDURE D’ARRET D’EXPLOITATION 296
1.2.1: Dossier de déclaration de fin de travaux 296
1.2.2: Procès verbal de recolement 296
1.3: RESPONSABILITE CIVILE ET ADMINISTRATIVE 296
1.4: LE SCHEMA DES CARRIERES DE LA SARTHE 297
2: PROBLEMATIQUE DE REMISE EN ETAT 298
3: PROJET DE REMISE EN ETAT RETENU 298
4: DESCRIPTIF DES AMENAGEMENTS 301
4.1: VOLUME DE MATERIAUX DISPONIBLES ET PHASAGE DE REMISE EN ETAT 301
4.2: BERGES COMPLEXES 304
4.3: AUTRES BERGES 305
4.4: PLANTATIONS 306
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 8
295
1: CADRE REGLEMENTAIRE
1.1: APPROCHE JURIDIQUE
Depuis 1970, la législation oblige le titulaire d'une autorisation d'exploitation de carrière et d'affouillement
à procéder à une remise en état des lieux à la fin de l'exploitation ou d'une tranche d'exploitation.
L'article R 512-39-1 (Titre I du livre V partie réglementaire du Code de l’Environnement), abrogeant le
décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié, prévoit que les conditions de remise en état doivent être
présentées dans le dossier de demande d’autorisation.
En outre, l'Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié prévoit en son article 12.2 que :
"L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des
caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise en état du site doit être achevée au
plus tard à l'échéance, sauf dans le cas de renouvellement de l'autorisation d'exploiter.
Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
- le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de toutes
les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site,
- l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu
de la vocation ultérieure du site".
L’exploitant peut compléter ces mesures obligatoires par toute autre mesure qui permet de réaliser une
remise en état de qualité. L’utilisation ultérieure des terrains remis en état n’est, en revanche, pas de son
ressort mais de celui du propriétaire.
D'autre part, en vertu de l'article L.516-1 du Code de l’Environnement, des garanties financières pour la
remise en état du site sont demandées en cas de défaillance de l’entreprise. Les montants garantis
permettent alors de réaliser la remise en état du site.
Les articles R.516-2 à 516-6 du Code de l’Environnement définissent le régime de ces garanties
financières. Les montants jusqu’au terme de l’exploitation sont calculés dans la partie demande
administrative du présent dossier.
L’Arrêté Préfectoral en vigueur du 23/02/2007 précise les modalités de remise en état du site. Le
présent projet ne remet pas en cause les options définies dans cet arrêté sur le secteur autorisé.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 8
296
1.2: PROCEDURE D’ARRET D’EXPLOITATION
1.2.1: DOSSIER DE DECLARATION DE FIN DE TRAVAUX
À l’arrêt définitif de l’activité, l’exploitant adressera au préfet une déclaration de fin de travaux au moins
6 mois avant la date d’expiration de l’autorisation (art. R.512-39-1 du Code de l’Environnement). Cette
déclaration sera accompagnée d’un dossier comprenant un plan de remise en état et un mémoire précisant
les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 compte
tenu du ou des types d’usage prévus pour le site de l’installation.
Les mesures comportent notamment :
1. Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
2. Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement
polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
3. En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
4. Les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploitant pour mettre en œuvre
des servitudes ou des restrictions d’usage.
1.2.2: PROCES VERBAL DE RECOLEMENT
Il est dressé par l'inspection des installations classées pour vérifier le respect de l'application de l'arrêté
préfectoral ou du mémoire de réhabilitation. Il s'appuie sur des justificatifs attestant de la réalisation des
travaux, des constats fait sur place. Il précise les documents sur lesquels il se base.
En vertu de l’article R 512-76 du Code de l'Environnement L'inspecteur des installations classées constate
par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un
exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. »
1.3: RESPONSABILITE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
Après l’obtention du procès-verbal de récolement, l’exploitant demeure responsable administrativement
et civilement notamment en cas d’incident mettant en cause la sécurité publique ou incident de pollution.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 8
297
1.4: LE SCHEMA DES CARRIERES DE LA SARTHE
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de la Sarthe distingue la notion de remise en état
correspondant à l’obligation réglementaire, telle que définie par le Code de l’Environnement, et celle de
réaménagement, qui vise à définir un processus complémentaire à la remise en état, dépassant le cadre
de l’exploitation et relevant de la seule volonté du propriétaire.
Le réaménagement apporte à la zone exploitée une vocation nouvelle créatrice d’avantages d’ordre
économique ou écologique.
L’objectif de la remise en état est multiple :
mettre en sécurité le site (limiter les risques de chutes, de noyades, d’éboulements…) ;
redonner une vocation au site qui doit être réaffecté à d’autres usages (agricole, touristique, loisir,
nautique, pêche, écologique, éducatif, industriel…) ;
assurer un environnement satisfaisant en recréant un cadre de vie adapté au milieu et cohérent
avec l’aménagement du secteur ;
permettre une diversité biologique et une insertion paysagère de qualité ;
faciliter l’acceptation d’une exploitation de carrière.
Les remises en état concernent aussi bien l’excavation laissée par l’exploitation, les terrils et les
installations de surface liées à l’exploitation de la carrière.
Préconisations du SDC Application au site
Nécessité d’une concertation en amont entre les
différentes parties prenantes (orientation E1).
Remise en état en accord avec le projet
communal
Terrains appartenant à Mme TAVANO
Une remise en état coordonnée, chaque fois que
l’exploitation le permet avec si possible une
rétrocession progressive du site (orientation E2)
Remise en état coordonnée sans
rétrocession : plans d’eau réexploités en
approfondissement.
De privilégier un réaménagement à vocation
agricole lorsque le site d’origine était cultivé, afin
de répondre à la loi de modernisation de l’activité
agricole qui prévoit une réduction des rythmes de
consommation des terres agricoles (orientation
E3)
Pas de vocation agricole, le site n’est pas
cultivé depuis plus de 50 ans.
De permettre la conservation de la flore et de la
faune sauvage lorsque les conditions
écologiques sont favorables (orientation E4)
Mesures d’évitement, de réduction et de
compensation des impacts écologiques.
Un aménagement en plan d’eau sous certaines
conditions de densité de plans d’eau, de qualité
des eaux, de préservation des écoulements
souterrains et d’absence d’obstacle à
l’écoulement des crues (orientation E5)
Respect des conditions : préservation des
écoulements souterrains par absence de
remblais et talutage dans la masse des
berges perpendiculaire au sens
d’écoulement, absence d’obstacle à
l’écoulement des crues, pas de merlon ou
digue résiduelle.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 8
298
2: PROBLÉMATIQUE DE REMISE EN ÉTAT
La remise en état est un consensus entre différents paramètres, dont certains deviennent prépondérants
selon les problématiques majeurs mises en évidence.
Dans le cas du site de SPAY, les aspects prépondérants qui ont majoritairement influencé le projet
d’exploitation et le projet de remise en état inhérent sont :
- la nature du matériau exploité (sables alluvionnaires et sables cénomaniens pour partie en
eau),
- l’intégration paysagère à long terme et le milieu environnant (plan d’eau aménagé à vocation
naturelle),
- la cohérence avec le PLU de SPAY et son PADD,
- la volonté du propriétaire et l’accord du maire sur le projet proposé.
3: PROJET DE REMISE EN ÉTAT RETENU
Le projet de remise en état s’appuie sur l’état actuel du site, à savoir la présence de plusieurs plans d’eau
existants. Il vise à renforcer le caractère naturel du secteur, avec :
l’intégration paysagère qui tend à diminuer le mitage : agrandissement des plans d’eau, connexion
entre eux par des seuils naturels, renforcement de la composante ‘eau’ déjà présente avec la
Sarthe et les différents plans d’eau aux alentours,
la compatibilité avec le projet de développement touristique et paysager de la commune (projet
d’itinéraire de randonnée le long de la Sarthe),
le maintien la qualité de la biodiversité présente sur le site, pour beaucoup due à la présence de
l’activité d’extraction, en développant des aménagements écologiques.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 8
299
Précisons qu’une remise en état à vocation agricole n’est pas envisageable dans ce contexte. En effet,
d’une part l’apport de matériaux inertes extérieurs engendrerait un risque supplémentaire de pollution des
eaux souterraines, d’autre part, le secteur n’est pas connecté à des terrains agricoles ce qui en limite
grandement l’intérêt et cela entrainerait de plus une discontinuité paysagère.
Compte-tenu du phasage d'extraction retenu, la remise en état sera effectuée de manière coordonnée à
l'avancement des travaux d'extraction.
Le principe de la remise en état coordonnée à l'avancement des travaux d’extraction permet :
- de sécuriser le site,
- de favoriser une intégration paysagère rapide dans l’environnement après exploitation.
Pour ce faire, il est nécessaire d'organiser le travail de façon à ne pas immobiliser des surfaces importantes
pour stocker la découverte, les stériles d’exploitation ou les boues de décantation asséchées. Les
matériaux, sont et seront directement utilisés pour remettre en état des berges ou remblayer des zones
préalablement définies, ils ne sont et seront manipulés qu'une seule fois et utilisés au plus près de leur lieu
d'origine.
Les travaux sont et seront échelonnés dans le temps et les coûts de fonctionnement de l'extraction en
seront réduits d'autant.
Ce principe permet également une meilleure intégration du site dans son environnement puisque les zones
réaménagées perdent plus rapidement l'aspect artificiel qui caractérise toute exploitation.
Les plantations et la recolonisation spontanée de la végétation contribueront à libérer le site de l'aspect de
chantier, avant même que la remise en état ne soit achevée.
Ces aspects répondent aussi aux orientations préconisées par le SDC en matière de remise en
état.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 8
301
A l’état final, le site présentera quatre plans d’eau avec berges aménagées et modelées pour créer
différents profils, séparés par des pistes en tout venant. Ces plans d’eau auront une superficie de :
plan d’eau de l’Enfournoire : environ 7,5 ha
plan d’eau de la Coyère : environ 11 ha
plan d’eau nord : environ 10,5 ha
plan d’eau sud-ouest : environ 6,5 ha.
Le plan d’eau des pelouses sera en communication avec le plan d’eau nord en période de hautes eaux, au
droit de la partie nord.
Une zone partiellement remblayée au nord le long du ruisseau du Buard, avec les matériaux de découverte,
les stériles d’exploitation et les boues de décantation. Compte tenu de l’incertitude sur les volumes de
stériles de gisement (lentilles d’argiles entre les sables alluvionnaires et les sables cénomaniens), le niveau
de remplissage de ce secteur ne peut être donné avec précision. Le caractère peu perméable des
matériaux de remblai rend ce secteur colonisable par des espèces hygrophiles.
Le secteur correspondant à la zone de traitement et des locaux sera débarrassé de toute structure. Aucun
apport de terre végétale ne sera mis en place, le coté minéral sera privilégié de façon à permettre le
développement d’une végétation pionnière acidiphile. Rappelons que la Limoselle aquatique s’est
développée sur des terrains similaires au droit de petites dépressions topographiques.
4: DESCRIPTIF DES AMÉNAGEMENTS
4.1: VOLUME DE MATERIAUX DISPONIBLES ET PHASAGE DE REMISE EN ETAT
Le volume des argiles extraites lors du rabattement temporaire de la nappe est estimé à environ 25 000 m3.
Le volume des matériaux de décantation (phase 5a) déposés devront être repris pour l’exploitation de ce
secteur. Le volume a été estimé à 20 000 m3.
La remise en état se fera dans la continuité de l’exploitation. Les matériaux serviront à l’aménagement des
secteurs de haut fond à vocation écologique et au remblayage partiel. La remise en état sera tributaire des
volumes de matériaux disponibles et du phasage d’exploitation. La remise en état des berges, en dehors
des zones d’aménagements spécifiques se fera de façon coordonnée à l’exploitation, avec un décalage
d’un à deux ans.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 8
302
Le tableau joint récapitule les estimations de volume des matériaux de découverte et de stériles
d’exploitation
Phase Volume de
terre végétale
en m3
Volume de
découverte en
m3
Tonnage
exploité
(tonnes)
Tonnage des
stériles
(tonnes)
Durée
(années)
1
1a
1b
1c
6000
3000
10000
4 000
4836000
57000
210000
12000
1400
5250
5
2
2a
2b
2c
6000
10 500
367100
63000
319900
9100
1500
8000
5
3 3a
3b
126500
603500
3000
15000
5
4
4a
4b
4c
8000 12 500 548500
31500
130000
13700
500
3000
5
5 5a
5b
319000
431000
8000
10000
5
6 6 232000 5800 1,6 +3,4
Total 23 000 m3 37 000 m3 3 922 000 t 96 250 t
(55 000 m3) 30 ans
La zone de remblayage et les secteurs d’aménagement de hauts fonds devant recevoir les différents
matériaux sont localisés sur le plan de gestion des matériaux stériles. Ces espaces sont numérotés de R1
à R4.
R1 : secteur de remblayage partiel
R2 : Secteur à remblayer et création d’un haut fond dans l’anse de la presqu’ile supportant des
poteaux électriques : volume nécessaire estimé : 20 000 m3.
R3 : Zone de haut fond sur la longueur du plan d’eau situé à l’est de la voie communale n°9 :
Volume nécessaire estimé : 12 000 m3
R4 : Anse du plan d’eau « Les Pelouses » : volume nécessaire estimé : 8 000 m3
Les volumes annoncés correspondent à un minimum nécessaire aux aménagements. Les volumes
pouvant être mis en place peuvent être supérieurs, l’aménagement n’en sera que plus grand.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 8
304
Les volumes de matériaux et leur destination sont récapitulés dans le tableau ci-après :
Mouvements de la découverte et des stériles d’exploitation
Phase Volume de découverte et
terre végétale en m3
Volumes des stériles (%
d’argiles du gisement)
Volume des argiles extraites et des matériaux de
décantation
Volume total
Destination)
1
1a
1b
1c
16 000
7 000
6 500
500
3 000
22 500
500
10 000
R1
R1
R2
2
2a
2b
2c
16 500
5 000
1 000
4 500
15 000
5 000
1 000
36 000
R2
R3
R1
3 3a
3b
2 000
8 500
2 000
8 500
R3
R2
4
4a
4b
4c
20 500 8 000
500
2 000
8 000
500
2 000
R4
R3
R3
5
5a
5b
4 500
6 000
20 000
10 000
24 500
16 000
6 500 sur R3
18 000 sur R1
R1
6 6 3 000 3 000 R1
Total 60 000 m3 55 000 m3 45 000 m3 160 000 m3
4.2: BERGES COMPLEXES
Les berges complexes sont des aménagements à vocation écologique. Elles sont faites de pentes douces
et de hauts fonds favorables à une végétation amphibie, réalisées à partir des matériaux stériles.
Ces berges seront aménagées au niveau d’une anse de plan d’eau des Pelouses (zone R4) ainsi que sur
le linéaire sud-ouest du plan d’eau de l’Enfournoire (zone R3).
Le principe d’aménagement de ces berges est détaillé dans l’étude écologique. Nous ne reprendrons ici
que le schéma.
COUPE DE PRINCIPE D’UNE BERGE
COMPLEXE
0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
10 20 60
29,3
28
Cote en m
Plan d’eau Roselière haute et
basse
Talus ~ 30°
Terrain naturel
Végétation aquatique
A B
HAUTES EAUX
BASSES EAUX
Distance en m
Remblais
Végétation aquatique
CV
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 8
305
4.3: AUTRES BERGES
En dehors des berges complexes, les berges des plans d’eau seront diversifiées avec des pentes
variables :
Berges en pentes douces, de l’ordre de 1 pour
3, talutées et pour partie façonnées avec des
stériles, comme autour du plan d’eau de la
Coyère. On remarquera la présence d’un
géotextile(en pied de berge) comme prévu
dans l’arrété préfectoral
Berge talutée en pente douce : plan
d’eau de la Coyère.
Berges talutées dans la masse.
Afin d’assurer une communication
hydraulique entre les plans d’eau
créés et la nappe, et d’éviter ainsi le
risque d’eutrophisation, des tronçons
de berges seront talutés dans la
masse, non remblayés. Ces tronçons
sont positionnés dans le sens
d’écoulement de la nappe c’est-à-dire
nord-ouest/sud est.
Mars 2015
Février 2017
Février 2017
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 8
306
4.4: PLANTATIONS
Le projet induira le défrichement de 280 m de haies arborées (haie 2 = alignement de chênes âgés sur la
bordure sud du plan d’eau 6) et 200 m de haies buissonnantes à arbustives (haie 4).
En remplacement des haies défrichées, 330 m de haies arborées et buissonnantes seront plantées durant
la première phase quinquennale d’exploitation sur la bordure sud-est du périmètre sollicité, à l’est du plan
d’eau de la Coyère.
L’objectif de cette plantation est de créer une haie champêtre constituée d’une strate buissonnante
favorable aux oiseaux des fourrés (Linotte mélodieuse, Hypolaïs polyglotte, Fauvette grisette…) et d’une
strate arborée riche en arbres d’émonde (têtards). Ces derniers abritent en vieillissant des cavités
recherchées par diverses espèces d’oiseaux (mésanges, Huppe fasciée…) et certaines espèces de
chauves-souris (Noctule commune, Barbastelle…).
Les travaux de plantation, d’émondage des arbres et d’entretien de la haie seront assurés par la LPO
Sarthe.
La plantation aura lieu durant l’automne ou l’hiver, hors période de gel (novembre à février).
La haie sera composée d’essences locales.
La plantation sera réalisée sur le sol en place. Elle nécessitera une préparation du sol, au minimum deux
mois avant la plantation (fin d’été), et notamment un amendement avec un engrais organique.
Un paillage en toile biodégradable (rouleau de 1,50 m de large) garantira une reprise maximale et une
croissance rapide durant les premières années. Sa dégradation naturelle permettra ensuite l’installation
progressive et spontanée d’une strate herbacée capable d’accueillir une flore et une faune diversifiée
(insectes, champignons…). Ainsi, la structure végétale de la haie sera similaire à celle d’une haie naturelle.
Une protection individuelle des plants contre les lapins et les chevreuils sera nécessaire (120 cm de
hauteur).
Pour densifier la haie, une partie des plants sera traitée en taillis (tailles de recépage à 10 cm du sol
l’année suivant la plantation, puis seconde taille des rejets l’année suivante).
La haie comportera deux lignes distantes au minimum de 0,60 m. Les plants seront installés en
quinconce.
D’autres aménagements en faveur de l’écologie comme la création de mares temporaires, d’une pelouse
silicicole ou d’ilots pour Sterne pierregarin plus favorable à la nidification que ceux déjà colonisés, seront
réalisés. Ces aménagements sont détaillés dans la partie relative à l’écologie, ils ne seront pas repris ici.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 9
307
CHAPITRE 9 :
DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION
OU DES ELEMENTS PROBANTS UTILISES
POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES
INCIDENCES NOTABLES SUR
L'ENVIRONNEMENT
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 9
309
SOMMAIRE
Page
1: METHODES DE CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 311
2: METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES DU PROJET 312
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 9
311
1: MÉTHODES DE CARACTÉRISATION DE L’ENVIRONNEMENT
Le préalable à l’évaluation des incidences réside dans la caractérisation de l’état actuel de
l’environnement qui comprend la description des facteurs mentionnés au III de l’article L122-1
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. Cette description fait l’objet du chapitre 3 du
présent dossier.
Les principaux facteurs de l’environnement de la carrière sont analysés de façon thématique, à deux
échelles :
une analyse couvrant de vastes surfaces, qui a pour objet de préciser les grands traits des
principales unités humaines ou physiques. Cette analyse est nécessaire pour appréhender le
degré de spécificité des terrains de la carrière, ou au contraire son caractère banal ou commun.
une étude précise du secteur de la carrière dans un but descriptif et analytique.
La caractérisation des incidences s’appuie aussi en grande partie sur le constat de l’activité
actuelle, puisque cette carrière est en activité depuis environ 50 ans. Cette activité est intégrée
dans le constat de l’état actuel.
C’est au vu de cette analyse de l’état actuel du secteur de la carrière ainsi que de son environnement que
la recherche des impacts est possible. Elle permet de mettre en évidence les enjeux pour l’activité
étudiée. Elle est établie à partir :
de recherches bibliographiques auprès des différents services concernés (échanges
téléphoniques, réunions de travail, collecte d’informations en ligne…),
de la consultation de sources générales : Météo France (climatologie), Institut Géographique
National (topographie, photographies aériennes), Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(banque de donnée du sous-sol, carte géologique de la France à 1/50 000, site Info Terre), bases
de données BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués) et BASIAS (Inventaire
historique des sites industriels et activités en service), cartographies CARMEN (CARtographie du
Ministère de l’Environnement) et INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) et informations
associées (zonages biologiques, sites et paysages...), Air Pays de la Loire (Association
Interdépartementale pour la gestion du Réseau automatique de surveillance de la Pollution
Atmosphérique et d’Alerte en Région Pays de la Loire : données sur la qualité l’air), Agence de
l’eau, etc.
d’observations de terrain, de métrologie (mesures acoustique, mesures piézométriques, analyses
d’eaux, mesures de débit …), de relevés écologiques et photogrammétriques, de sondages
géologiques, de pompages d’essai …
de l’analyse des avis de l’autorité environnementale permettant de définir les projets connus à
prendre en compte dans la réflexion sur les impacts cumulés,
Compte tenu des enjeux, les études préalables ont notamment porté sur les thématiques de l’eau et de
l’écologie,
Les méthodes utilisées pour étudier chaque composante des milieux susceptibles d’être concernés par le
projet sont présentées sous la forme d’un tableau synthétique, aux pages suivantes.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 9
312
2: MÉTHODES UTILISÉES POUR ÉVALUER LES INCIDENCES DU PROJET
L’évaluation des effets repose sur une connaissance détaillée de l’activité en cours, des modifications
prévues et de ses caractéristiques physiques et techniques (emprises, matériels et procédés
d’exploitation, substances ou produits utilisés …).
La carrière et le projet technique sont présentés en détail dans la partie demande du dossier (pièce 1) et
les principaux éléments sont également repris au chapitre 1 de l’étude d’impact.
L’analyse des documents bibliographiques (servitudes, contraintes, documents de planification et
d’orientations, cartographies …), ont conduit à l’identification d’enjeux environnementaux et humains
nécessitant une approche approfondie. Ces enjeux ont été traités dans des études spécifiques réalisées
par des bureaux d’études spécialisés, largement reconnus pour leur compétence.
Les méthodes utilisées pour l’évaluation des effets sont explicitées dans chaque étude thématique, et
résumées dans le tableau suivant.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 9
313
Composantes des milieux Méthodes utilisées
Caractérisation de l’environnement Evaluation des effets
Population
Démographie / Bâti
Données des recensements de l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE), cartographie (base de données IGN, plan cadastral, plan
topographique, photos aériennes…)
Observations de terrain
Données source pour l’évaluation des effets sur la population et le bâti traités aux lignes
suivantes
Bruit
Etablissement de niveaux de bruit de référence à partir de mesures réalisées in-
situ selon la méthode de contrôle (norme NF S 31-010, relative à la
caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement), en différents
points représentatifs et choisis en fonction des exigences réglementaires.
Analyse prévisionnelle, avec fonctionnement de l'activité projetée, réalisée à l’aide d’outils
mathématiques (feuilles de calcul Excel) développés par la cellule acoustique d’ENCEM et
basées sur les différentes formules de propagation des ondes
Cf. Contrôle acoustique Technilab
Emissions lumineuses
Suivant les caractéristiques de l’installation et des engins prévus, les modalités
et horaires de fonctionnement de l’installation et la règlementation applicable en
matière d’hygiène et de sécurité au travail.
Recensement des sources lumineuses potentiellement employées et des populations-cibles
Analyse des effets sur les espèces animales réalisée dans l’étude écologique réalisée par
ENCEM
Sécurité publique Description de la population aux abords du projet faite au paragraphe relatif à
l’environnement humain
Description des dangers découlant de l’activité en fonction de ses caractéristiques et des
risques encourus par la population, en tenant compte de l'efficacité des mesures de
prévention et de protection
Partie traitée spécifiquement dans l’étude de dangers, selon les termes de l’arrêté du 29
septembre 2005, et la circulaire du 10 mai10 récapitulant les règles méthodologiques
applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à
la source et aux Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dans les
installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003
Santé humaine
Rappel des principaux éléments de l’état initial du site : description de la
population aux abords du projet, qui constitue les cibles (cf. population), et des
vecteurs (eaux, air, sols)
Méthodologie des guides « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires »
(INERIS août 2013), « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » (Institut
de Veille Sanitaire février 2000), « Observatoire des pratiques de l’évaluation des risques
sanitaires dans les études d’impact » (Ministère de la Santé) et « Document d’orientation sur
les risques sanitaires liés aux carrières » (BRGM 2004)
Identification des sources, de la nocivité des émissions en fonction des cibles et du niveau
d’exposition (valeurs limites, objectifs de qualité, valeurs toxicologiques de référence, valeurs
d’exposition…)
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 9
314
Activités
économiques et
services / Espaces
de loisirs
Industrie / artisanat /
Services
Données issues du recensement de la population de l’INSEE, d’observations de
terrain, de données en ligne (site de la commune de SPAY…),
Effets étudiés en fonction de l’implantation des activités : effets indirects sur les
populations et le bâti traités aux lignes relatives à l’environnement humain.
Agriculture
Diagnostic établi à partir des données recueillies auprès des agriculteurs, des visites
de terrain et de sources bibliographiques (cadastre, institut géographique national,
PLU de SPAY, recensement agricole)
Evaluation des conséquences sur l’économie des exploitations agricoles.
Sylviculture Recensement des peuplements réalisé lors de relevés de terrain Effets sur la faune et la flore des boisements traités dans l’étude réalisée par ENCEM
Espaces de loisirs Données issues d’observations de terrain, des sites Internet des structures publiques
locales (Conseil départemental, commune de SPAY PLU…), L’activité de pêche est prise en compte dans l’étude hydrogéologique
Biodiversité
Contexte écologique établi à partir des données bibliographiques
Etude écologique ENCEM -)
Description des habitats, de la flore et de la faune établie par des relevés de terrain (7
passages, répartis sur 3 années consécutives)
Evaluation de leur intérêt et de leur sensibilité selon les critères réglementaires et la
bibliographie (réglementation et/ou des outils de bio évaluation pour déterminer la
rareté des espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou
départementales, littérature naturaliste...)
Evaluation du niveau d’impact sur les habitats et les espèces en fonction du niveau
d’enjeu, confronté avec l’intensité de l’impact sur une ou plusieurs composantes de l’état
initial (analyse prédictive de la sensibilité au regard de la biologie et de l’écologie des
espèces et des habitats, de la portée de l’impact dans le temps et dans l’espace)
Pour les fonctionnalités écologiques, prise en compte de la capacité d’accueil général de
l’habitat pour les espèces et de leur rôle en tant que continuité écologique
Cf. Etude écologique réalisée par ENCEM
Composantes
physiques
(hors paysage)
Topographie - Morphologie
Description à partir des bases de données de l’Institut Géographique National
(altimétrique, topographique et photographique), du plan photogrammétrique réalisé
par Axis Conseil (novembre 2014), et d’observations de terrain
Effets décrits à partir des caractéristiques de l’exploitation
Terres et sols
Pédologie et agronomie
Contexte local établi à partir de la carte géologique du Mans, des sondages archivés
à la Banque du Sous-Sol (BSS), des sondages de reconnaissances réalisés
(entreprise CISSE YVES)
Evaluation du volume de terres concernées
Caractérisation des déchets issus de l’exploitation de la carrière en fonction de la note
d’instruction du MEDDTL1 du 22 mars 2011 référencée BSSS/2011-35/TL (partie
traitée dans la partie demande du dossier)
Etablissement d’un plan de gestion des déchets inertes issus de l’exploitation de la
carrière selon la méthodologie décrite dans le guide pour l’élaboration du plan de gestion
des déchets inertes et terres non polluées des industries extractives de l’UNICEM de mai
2011
1 Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 9
315
Hydrologie
Etat des lieux à partir des données qualitatives et quantitatives issues du SDAGE du
bassin Loire- Bretagne, de la banque de données pour l’hydrométrie et l’hydrologie de
la DREAL, …
Analyses d’eaux réalisées par le laboratoire départemental de la Sarthe
Description du contexte hydrographique et analyse des incidences du projet sur ce
contexte.
Cf. Etudes hydrogéologiques réalisées par TERRAQUA
Géologie
Hydrogéologie
Contexte établi à partir de la carte géologique à 1/50 000, des données de la banque
de données du sous-sol des sondages réalisés, et du Système d’Information et de
Gestion des Eaux Souterraines,
Données qualitatives et quantitatives acquises lors des différentes études (2015,
2016 et 2017, essais de pompages, analyses d’eau, mesures de débit de sources…)
Etudes hydrogéologiques (TERRAQUA 2015, 2016 et 2017)
Consultation des banques de données BASIA et BASOL
Conditions actuelles de gestion des déchets d’entretien du matériel décrites à partir
du constat réalisé sur le site et des informations communiquées par l’exploitant (partie
traitée au chapitre 4)
Incidence de l’exploitation et des différents modes d’exploitation sur la piézométrie locale
Essais de rabattement de nappe
Cf. Etudes hydrogéologiques réalisées par TERRAQUA
Air et Climat
Qualité de l’air / Emissions
atmosphériques
Données bibliographiques (Air Pays de la Loire…)
Climatologie Données de Météo France, publications du Groupe Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC) et de l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE)
Paramètres météorologiques pris en compte dans l’évaluation prospective des effets liés
aux émissions atmosphériques émissions sonores
Biens matériels
(hors bâti et terrains)
Voies de communication
Description des réseaux à partir du recensement des voies présentes aux abords de
la carrière (observations visuelles, cartographie du cadastre, IGN…), de la
consultation du service de gestion concerné pour les données de comptages routiers
(Conseil départemental)
Evaluation des conséquences sur la voirie communale.
Réseaux de distribution Recensement des réseaux de distribution (eau, énergie, téléphone, …). Localisation
des pylones sur le plan topographique (relevé par géomètre expert) Application des mêmes précautions que celles prises depuis le début.
Patrimoine culturel et
archéologie
Patrimoine culturel Données fournies par les services de l’état (Direction Régionale des Affaires
Culturelles, la base de données Mérimée, …) Site non concerné
Archéologie Renseignements fournis par le Service Régional de l’Archéologie
Localisation des vestiges archéologique sur le plan des servitudes de la mairie Prise en compte des surfaces impactées par le projet
Paysage
Analyse des enjeux paysagers du secteur (caractéristiques, voisinage, sites
remarquables, perceptions sociales etc.) réalisée à partir de l’atlas des paysages de
la Sarthe d’une part, et de relevés de terrain spécifiques d’autre part.
Recencement des secteurs de visibilité à partir de campagnes de reconnaissance.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 11
325
CHAPITRE 11 :
Eléments figurant dans l’étude de dangers
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 11
327
SOMMAIRE
Page
1: PRINCIPES GENERAUX 329
2: ELEMENTS DE L’ETUDE D’IMPACT FIGURANT DANS L’ETUDE DE DANGERS 329
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 11
329
1: PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les éléments de l’étude d’impact figurant dans l’étude de dangers, sont présentés sous une forme
synthétique dans le présent chapitre.
D’une manière générale, il s’agit d’éléments empruntés aux chapitres suivants :
Chapitre 1 : la présentation du projet,
Chapitre 3 : la description de l’état initial des terrains et des milieux susceptibles d’être affectés par
le projet,
Chapitre 4 : l’analyse et l’évaluation des effets potentiels du projet sur l’environnement,
Chapitre 7 : l’exposé des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues, dans la
mesure où l’estimation des risques doit prendre en compte les mesures mise en œuvre pour
limiter la probabilité des accidents potentiels (les mesures préventives) ou en réduire les
conséquences (les mesures d’intervention).
Seuls sont pertinents les éléments permettant de définir les cibles (populations, milieux) et ceux susceptibles
de jouer un rôle dans la propagation ou l’intensité d’un accident, d’en éviter la matérialisation ou d’en limiter
les conséquences.
Les éléments repris dans ce chapitre sont uniquement ceux qui permettent de définir les cibles des risques
identifiés (population, eaux, sols, milieux naturels, biens matériels) ou qui sont susceptibles de jouer un rôle
dans la propagation ou l’intensité d’un accident, d’en éviter la matérialisation ou d’en limiter les
conséquences.
2: ELÉMENTS DE L’ÉTUDE D’IMPACT FIGURANT DANS L’ÉTUDE DE DANGERS
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 11
331
Thématiques
(Etudes concernées) Description du projet (chapitre 1) Etat initial (chapitre 3)
Analyse des risques potentiels en l’absence de
mesures (chapitre 4) Mesures (chapitre 7)
Population
Etude du risque sanitaire
- Emprise du projet et modalités
d’exploitation : transport des matériaux
- Produits utilisés (hydrocarbures,) et
déchets générés
- Présentation des éléments relatifs à la
population et à l’occupation du territoire
au voisinage du projet
- Risques sur les personnes liées à l’installation
de concassage criblage, aux bassins
- Emissions atmosphériques de fumées en cas
d’incendie du stockage de carburant ou d’un
engin
- Emissions atmosphériques de poussières
liées à la circulation des engins en situation
sèche
- Mesure de fermeture du site (clôtures, merlons,
portails), de protection des bassins dispositifs d’arrêt
d’urgence
- Stockages de GNR à distance des habitations
- Maintien de capacité d’extinction pour faire face à un
incendie dans les meilleures conditions
- Installations conçues pour faciliter l’accès des services
de secours
- Arrosage des pistes, limitation de la vitesse des engins,
entretien des engins et des pistes
- arrosage des pistes aussi souvent que nécessaire
Eaux souterraines et
superficielles
Etudes TERRAQUA)
- Emprise du projet
- Modalités d’exploitation : mode
d’exploitation, surface d’exploitation, cote
d’extraction et de réaménagement, gestion
de la découverte (matériaux stériles et
terre végétale)
- Produits utilisés (hydrocarbures) et
déchets générés
- Description du fonctionnement
hydraulique des terrains du projet
- Piézométrie, caractéristiques
hydrodynamiques, aspects qualitatifs
des nappes susceptibles d’être
concernées par le projet
- Recensement des usages des eaux
souterraines (captages d’adduction en
eau potable, captages industriels et
agricoles, puits domestiques, étang de
pêche)
- Modification locale des écoulements
superficiels sur les terrains
- Impact du mode d’exploitation sur la
piézométrie locale
- Stockage et emploi d’hydrocarbures, pouvant
être à l’origine d’une pollution accidentelle
des eaux suite à une perte de confinement
- Stockage des hydrocarbures et poste de distribution du
carburant conformes à la règlementation en vigueur
(cuves GNR double peau, aire du remplissage du
réservoir des engins sur rétention)
- Formation périodique du personnel à l’intervention en
cas d’épandage d’hydrocarbures consécutivement à un
incident (consigne écrite)
- Stockage et gestion des déchets dans le respect de la
règlementation, sans transfert de pollution (stockage à
l’abri des intempéries)
- Mesures de surveillance des eaux souterraines
(analyses et relevés piézométriques périodiques)
Géologie et sols
Etudes TERRAQUA)
- Emprise du projet
- Modalités d’exploitation : nature des
formations géologiques constituant le
gisement et la découverture, modalités
d’exploitation (drague aspiratrice –
rabattement de nappe) et de
réaménagement
- Nature et structure des formations
géologiques
- Nature et usage des sols agricoles et
forestiers
- Stockage et emploi d’hydrocarbures, pouvant
être à l’origine d’une pollution accidentelle
des sols suite à une perte de confinement
- Respect des pentes de stabilité des fronts
- Mesures relatives aux hydrocarbures détaillées dans la
ligne « Eaux souterraines et superficielles »
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 11
332
Thématiques
(Etudes concernées) Description du projet (chapitre 1) Etat initial (chapitre 3)
Analyse des risques potentiels en l’absence de
mesures (chapitre 4) Mesures (chapitre 7)
Biodiversité
Etude faune&flore (Encem)
- Emprise du projet et modalités
d’exploitation et de remise en état (cf. ci-
avant)
- Produits utilisés (hydrocarbures) et
déchets générés
- Zonages biologiques à proximité et aux
alentours (ZNIEFF, zones Natura 2000)
- Enjeux sur les milieux occupant les
terrains de la carrière ou situés aux
alentours
- Risque de pollution des milieux en cas de
déversement accidentel d’hydrocarbures
- Mesures relatives aux hydrocarbures et à la gestion
des eaux
Biens matériels,
infrastructures et voies
de communication
- Emprise du projet et modalités
d’exploitation : phasage, talutage mis en
œuvre, modalités de transport des
matériaux
- Activités industrielles et agricoles
concernées par le projet, voies de
communication (voie communale n° 9,)
- Réseaux présents sur ou en périphérie
de la carrière (électricité)
- Interaction de l’activité de la carrière sur le
trafic du réseau routier public
- Emissions atmosphériques de fumées en cas
d’incendie du stockage de carburant ou d’un
engin
- Mesures spécifiques relatives au transport,
- Arrosage des pistes, limitation de la vitesse des engins,
entretien des engins et des pistes
- Dispositifs d’abattage de poussières
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
333
CHAPITRE 12 :
ELEMENTS D’APPRECIATION DE LA
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
L’AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION
AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
OPPOSABLES AUX TIERS
Précision aux lecteurs : cette partie n’est plus une composante obligatoire des études d’impact depuis la
réforme issue de l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016.
Néanmoins, pour une bonne information du public, il a été jugé utile de conserver ce chapitre.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
335
SOMMAIRE
Page
1: SCHEMAS ET DOCUMENTS D'URBANISME ..................................................................................... 337
1.1: SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE ............................................................................................ 337
1.2: DOCUMENTS D'URBANISME COMMUNAL : PLU .................................................................................... 340
2: PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES VISES PAR L'ARTICLE R122-17 DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT ..................................................................................................................................... 341
2.1: LISTE DES DOCUMENTS VISES .......................................................................................................... 341
2.2: SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ........................................................ 345
2.3: SAGE SARTHE AVAL ...................................................................................................................... 352
2.3.1: L’avancement du SAGE ............................................................................................................................... 352
2.3.2: Périmètre du SAGE ...................................................................................................................................... 352
2.3.3: Les enjeux .................................................................................................................................................... 353
2.4: SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L‘ENERGIE ................................................................... 354
2.5: ORIENTATIONS NATIONALES POUR LA PRESERVATION ET LA REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
.................................................................................................................................................... 356
2.6: SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE .............................................................................. 356
2.7: SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES ....................................................................................... 357
2.7.1: La notion de compatibilité du schéma .......................................................................................................... 357
2.7.2: Cohérence avec les plans et programmes nationaux et régionaux relatifs à l'environnement .................... 358
2.8: SCHEMA REGIONAL DE GESTION SYLVICOLE ....................................................................................... 365
2.9: LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN ................................................................................................... 365
3: AUTRES SCHEMAS ET PLANS ET CONTRAINTES ......................................................................... 366
3.1: SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES TERRITOIRES ..... 366
3.2: PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR ........................................................................................ 367
3.3: PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX ................................................................. 367
3.4: PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE ......................................................................................... 368
3.5: PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE ........................................ 368
4: AUTRES SERVITUDES ET CONTRAINTES ....................................................................................... 369
4.1: CODE DE LA SANTE ......................................................................................................................... 369
4.2: CODE FORESTIER ........................................................................................................................... 369
4.3: PROTECTION DES SITES, DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ................ 369
4.4: SERVITUDES RESEAUX .................................................................................................................... 370
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
336
4.5: AUTRES SERVITUDES ...................................................................................................................... 370
4.6: PROTECTIONS DES ESPACES NATURELS ............................................................................................ 370
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
337
1: SCHÉMAS ET DOCUMENTS D'URBANISME
1.1: SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Les Schémas de COhérence Territoriale (SCOT) sont des documents de planification qui fixent les grandes
lignes de l’aménagement d’un territoire intercommunal. Ils se substituent aux schémas directeurs depuis la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (loi dite SRU).
Tout comme les schémas directeurs, les schémas de cohérence territoriale (SCOT) sont des documents de
planification spatiale pour le long terme, qui fixent les grandes lignes de l’aménagement d’un territoire
intercommunal.
Ils ont pour vocation de fixer les orientations générales de l’aménagement de l’espace, dans une perspective
de développement durable et de solidarité à une échelle urbaine pertinente.
Les SCOT doivent préciser l’équilibre souhaité entre zones à urbaniser et zones naturelles ou agricoles. Ils
fixent également des objectifs en matière d’équilibre de l’habitat et de mixité sociale, de transports collectifs,
d’équipements commerciaux et économiques. Ils peuvent aussi être plus précis sur des domaines tels que les
grands projets d’équipement et de services, ou les priorités et les conditions d’ouverture de secteurs à
l’urbanisation.
Le SCOT constitue un document d’orientation avec lequel les documents d’urbanisme, les programmes
locaux de l’habitat et les plans de déplacements urbains doivent être compatibles. Le SCOT fixe des règles
générales d’aménagement pour un territoire intercommunal relativement étendu. En revanche, au niveau de
l’urbanisme, c’est le document local, le PLU (plan local d’urbanisme) en général, qui est opposable aux tiers et
détermine l’utilisation du sol au niveau de la parcelle.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
338
Le SCOT du Pays de la Vallée
de la Sarthe est composé des
communautés de communes :
Du val de Sarthe
De Sablé sur Sarthe
De Loué-Brûlon-Noyen
La commune de SPAY
appartient à la communauté de
communes du Val de Sarthe.
Le SCOT du Pays de la vallée
de la Sarthe a fait l’objet d’une
enquête publique du 9 janvier
2017 au 11 février 2017, il est
exécutoire depuis le 11 septembre 2017. Le projet arrêté n’étant pas encore en ligne, nous nous baserons ici
sur le projet de PADD soumis à enquête publique.
Dans un contexte territorial particulièrement concurrentiel, entre l’Ile-de-France et le Grand Ouest, le Pays
Vallée de la Sarthe veut être un pays dynamique et accueillant.
Le projet de développement s’organise autour de 3 grands axes :
Développer l’innovation et les dynamiques entrepreneuriales
o Conforter l’économie agricole, accompagner ses besoins de diversification et ses projets de
développement
o Mettre en place une organisation spatiale des activités économiques qui favorise la gestion
rationnelle de l’espace et la diversification sectorielle
o Renforcer la lisibilité économique du Pays
Favoriser des modes de vie durables
o Renfort du maillage des pôles urbains
o Renouvellement e la qualité urbaine, au service d’une attractivité choisie
o Organisation collective autour des gares avec des mobilité combinées
Valoriser et reconnaitre l’identité du territoire
o Reconnaissance de la valeur patrimoniale du paysage
o Levier touristique révélateur des qualités vivantes du territoire
o Inscription de la trame verte et bleue dans toutes les échelles de vie du territoire.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
339
Ces axes sont développés dans les 12 thèmes du document d’orientation et d’objectifs :
1. Améliorer le fonctionnement et les connexions biologiques des grandes vallées et
du bocage pour une identité locale renforcée
2. Placer l’agriculture au cœur de la stratégie conjuguant industrie agroalimentaire
et ruralité innovante
3. Valoriser le rôle des pôles et optimiser la mutualisation pour un meilleur niveau de
services aux habitants
4. Valoriser les infrastructures physiques et numériques et s’appuyer sur les pôles
pour une meilleure gestion des mobilités
5. Promouvoir les conditions d’accueil à destination d’activités économiques
innovantes, en lien avec la diversité des espaces
6. Améliorer les conditions de développement du commerce de centre-ville et de
l’artisanat
7. Promouvoir un développement résidentiel répondant aux besoins différenciés des
populations
8. Mettre en œuvre un développement résidentiel de qualité
9. Développer une politique touristique cohérente et en appui des richesses
patrimoniales et culturelles locales
10. Optimiser la gestion des ressources naturelles
11. Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances
12. Appuyer l’ambition du Pays en matière de transition énergétique.
Orientation 1 : connexions biologiques : consolidation du réseau de trames verte et bleue
1-1 : Protéger les réservoirs majeurs de biodiversité
1-2 : Protéger les milieux humides et les abords des cours d’eau comme réservoirs complémentaires
1-3 : Protéger et gérer les boisements en tenant compte de la diversité des enjeux
1-4 : Protéger le bocage
1-5 : Assurer les connexions écologiques entre les réservoirs de biodiversité
La carte du SRCE fait apparaitre la présence d’un corridor potentiel au niveau de la Sarthe et de ses abords.
Le maintien d’une bande inexploitée de 60 m (limite d’emprise à 50 m de la Sarthe) entre la rive droite de la
Sarthe et la zone exploitable permettra de conserver la fonctionnalité du corridor.
Orientation 2 : Maintenir et renforcer la position et le rôle du Pays Vallée de la Sarthe en tant que pôle agricole,
pôle d’élevage et pôle agroalimentaire majeur
2.1. : Aménager en minimisant les impacts sur l’agriculture •
2-2 : Protéger les espaces agricoles et donner de la lisibilité aux exploitants •
2-3 : Soutenir l’innovation et la valeur ajoutée
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
340
Le projet n’impacte pas l’espace agricole, il est défini sur un secteur spécifique « carrière » établi dans le PLU.
1.2: DOCUMENTS D'URBANISME COMMUNAL : PLU
La carrière actuelle
et la zone
d’extension sont
classées en zone
spécifique carrière
au PLU de la
commune de
SPAY.
Le règlement de la zone N et plus spécifiquement de la zone NL précise que sont admis :
« dans le secteur indicé « C » et figuré par une trame particulière au règlement graphique :
L’exploitation de carrière et les installations qui y sont liées en vue de regrouper des plans d’eau
existants
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
341
2: PLANS, SCHÉMAS, PROGRAMMES VISÉS PAR L'ARTICLE R122-17 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
2.1: LISTE DES DOCUMENTS VISES
Avant la réforme des études d’impact par le décret 2016-1110 du 11 août 2016 , l’article R. 122-5 du Code de
l’environnement imposait de joindre au dossier les éléments permettant d’apprécier l’articulation du projet avec
les documents pertinents listés à l’article R. 122-17 du même code. Cette exigence ne s’impose plus. Pour une
bonne information du public, il a néanmoins été choisi de maintenir cette présentation dans le dossier.
Plan, schéma, programme, document de planification Remarques
Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n°1083/2006 du
Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et
abrogeant le règlement (CE) n°1260/1999 Sans objet
Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code
de l'énergie
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par
l'article L. 321-7 du code de l'énergie
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.
212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement Cf. § 2.2
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L.
212-6 du code de l'environnement Cf. § 2.2
Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement
et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code Sans objet
Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de
l'environnement Sans objet
Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code
de l'environnement Cf. § 2.3
Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de
l'environnement Sans objet
Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de
l'environnement Sans objet
Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement
Sans objet Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-
2 du code de l'environnement
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement Cf. § 2.5
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
342
Plan, schéma, programme, document de planification Remarques
Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de
l'environnement Cf. § 2.6
Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de
l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du
code
Sans objet
Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement (schéma
départemental des carrières) Cf. § 2.7
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de
l'environnement
Sans objet
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu
par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement
Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux
prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets
non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1
du code de l'environnement
Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-
1-2 du code de l'environnement
Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de
l'environnement
Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de
l'environnement
Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de
l'environnement
Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier
Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier
Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code
forestier Cf. § 2.8
Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du
code forestier Cf. § 2.9
Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code
minier Sans objet
4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1
du code des ports maritimes
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
343
Plan, schéma, programme, document de planification Remarques
Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la
pêche maritime
Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-
1-1 du code rural et de la pêche maritime
Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code
des transports Sans objet
Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code
des transports
Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code
des transports Cf. § 2.10
Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification Sans objet
Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par l'article
34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements et les régions
Sans objet
Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article
57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements et les régions
Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du
décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations
de cultures marines
Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-
1 du code de l'environnement
Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code
de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par
l'article L. 562-1 du même code
Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code
forestier
Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales
Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier
Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier Sans objet
Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code
minier
Sans objet Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1
du code du patrimoine
Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de
l'urbanisme
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
345
2.2: SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui
fixe, pour une période de six ans, “les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux” (article L.212-1 du Code de
l’Environnement) à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne.
Il constitue le plan de gestion demandé par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE).
Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions
techniques, financières, réglementaires, à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés.
Le secteur d’étude est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne. Le comité de bassin Loire-Bretagne a
entrepris la révision du SDAGE de 1996 pour aboutir à un nouveau document en 2015, qui couvre la période
2016-2021. Il a été élaboré à travers une série de concertations techniques et politiques impliquant tous les
acteurs de l’eau (consommateurs, agriculteurs, pêcheurs, industriels, associations de protection de la nature,
élus, Etat).
L'avant-projet a fait l'objet d'une consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Ce document
(SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) a été adopté le 4/11/2015 par le Comité de Bassin et a été arrêté le
18/11/2015.
Il intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de
l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021.
De façon plus précise, au bilan 2015, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi
l’objectif de 61 % des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu.
Le SDAGE répond à quatre questions importantes :
Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des milieux
aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ?
Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des
sources à la mer ?
Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment adapter
les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?
Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques
dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens
de façon cohérente, équitable et efficiente ?
Le SDAGE se compose de 14 chapitres correspondant aux 14 enjeux identifiés Les grandes orientations du
SDAGE du bassin Loire-Bretagne, pour la période 2016 – 2021 sont :
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
346
1 repenser les aménagements de cours d'eau,
2 réduire la pollution par les nitrates,
3 réduire la pollution organique,
4 maîtriser la pollution par les pesticides,
5 maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,
6 protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
7 maîtriser les prélèvements d'eau,
8 préserver les zones humides,
9 préserver la biodiversité aquatique,
10 préserver le littoral,
11 préserver les têtes de bassin versant,
12 faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,
13 mettre en place des outils réglementaires et financiers,
14 informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
347
Orientations du SDAGE
N°
Dispositions
du SDAGE
Dispositions du SDAGE Dispositions du projet
1 : Repenser les
aménagements du cours
d’eau
1 A Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux Sans objet : aucune intervention dans un cours d’eau
1 B Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les
zones d’expansion
Pas d’obstacle à l’écoulement des crues
1 C Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau Sans objet : aucun cours d’eau touché par l’exploitation
1 D Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau Sans objet : aucun cours d’eau touché par l’exploitation
1 E Limiter et encadrer la création de plans d’eau Projet hors secteur de densité importante.
1 F Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires
en lit majeur
Le projet intègre la réduction des extractions en lit majeur et
se porte vers un gisement de substitution (sables
cénomaniens)
1 G Favoriser la prise de conscience Sans objet
1 H Améliorer la connaissance Sans objet
2 : Réduire la pollution par
les nitrates
2 A Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du
bassin versant
Sans objet : le projet ne génère aucun nitrate.
2B Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables
2 C Développer l’incitation sur les territoires prioritaires
2 D Améliorer la connaissance
3 : Réduire la pollution
organique et
bactériologique
3 A Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants
organiques et notamment du phosphore
Sans objet : le projet ne génère pas de phosphore.
3 B Prévenir les apports de phosphore diffus
3 C Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents
3 D Maitriser les eaux pluviales par la mise en place de gestion
intégrée
3 E Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif Assainissement contrôlé régulièrement
4 : Maitriser et réduire la
pollution par les pesticides
4 A Réduire l’utilisation de pesticides Sans objet : le projet n’utilise aucun pesticide
4 B Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de
pollutions diffuses
4 C Promouvoir les méthodes sans pesticides
4 D Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer
l’usage des pesticides
Sans objet
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
348
4 E Développer la formation des professionnels Sans objet
4 F Améliorer la connaissance Sans objet
5 : Maitriser et réduire les
pollutions dues aux
substances dangereuses
5 A Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances - Contrôle périodique de la qualité des eaux
- Les résultats d’analyses sont à la disposition de
l’administration
5 B Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives Dispositifs préventifs des pollutions en place (aire étanche,
décanteur déshuileur, kit anti pollution dans les engins et à
l’atelier, cuvette de rétention pour stockage des produits
dangereux, sensibilisation du personnel…
5 C Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les
grandes agglomérations
Sans objet
6 : Protéger la santé en
protégeant la ressource en
eau
6 A Améliorer l’information sur les ressources et équipements
utilisés pour l’alimentation en eau potable
Aucun impact généré sur la ressource en eau pour
l’alimentation en eau potable (exploitation des sables
cénomaniens dans la partie libre de l’aquifère)
6 B Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de
protection sur les captages
Sans objet
6 C Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et
pesticides* dans les aires d’alimentation des captages
Sans objet
6 D Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages Sans objet
6 E Réserver certaines ressources à l’eau potable Sans objet
6 F Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et
autres usages sensibles* en eaux continentales et littorales
Sans objet
6 G Mieux connaître les rejets, le comportement dans
l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants
Sans objet
7 : Maitriser les
prélèvements d’eau
7 A Anticiper les effets du changement climatique par une gestion
équilibrée et économe de la ressource en eau
Pas de consommation de la ressource en eau : l’eau prélevée
dans le plan d’eau lors de l’extraction revient dans le plan
d’eau après décantation
7 B Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage Suivi piézométrique périodique et fonction du mode
d’exploitation, définition de niveau d’alerte piézométrique,
réalimentation possible de plan d’eau de pêche du domaine
du Houssay.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
349
7 C Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones
de répartition des eaux
Hors zone de répartition des eaux
7 D Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des
prélèvements, par stockage hivernal
Sans objet
7 E Gérer la crise Sans objet
8 : Préserver les zones
humides
8 A Préserver les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités
Evitement d’un secteur, création de mare et de berges
complexes favorisant la végétation amphibie.
8 B Préserver les zones humides dans les projets d’installations,
ouvrages, travaux et activités
8 C Préserver les grands marais littoraux Sans objet
8 D Favoriser la prise de conscience Sans objet
8 E Améliorer la connaissance Suivi écologique depuis de nombreuses années par la LPO
(sous forme de convention), suivi qui sera prolongé la durée
de l’exploitation
9 : Préserver la biodiversité
aquatique
9 A Restaurer le fonctionnement des circuits de migration Le projet ne modifie pas les circuits de migration.
9 B Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales
inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats
Evitement d’une partie des terrains
9 C Mettre en valeur le patrimoine halieutique Sans objet
9 D Contrôler les espèces envahissantes Très faible population
10 : Préserver le littoral 10 A Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et
de transition
Sans objet
10 B Limiter ou supprimer certains rejets en mer Sans objet
10 C Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de
baignade
Sans objet
10 D Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des
zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle
Sans objet
10 E Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des
zones de pêche à pied de loisir
Sans objet
10 F Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement Sans objet
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
350
10 G Améliorer la connaissance des milieux littoraux Sans objet
10 H Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux Sans objet
10 I Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux
marins
Sans objet
11 : Préserver les têtes de
bassin versant
11 A Restaurer et préserver les têtes de bassin versant* Sans objet
11 B Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de
bassin versant*
Sans objet
12 : Faciliter la
gouvernance locale et
renforcer la cohérence des
territoires et des politiques
publiques
12 A Des Sage partout où c’est « nécessaire » Le projet est soumis au SAGE de la Sarthe Aval
12 B Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau Sans objet
12 C Renforcer la cohérence des politiques publiques Sans objet
12 D Renforcer la cohérence des Sage voisins Sans objet
12 E Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le
domaine de l’eau
Sans objet
12 F Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision
pour atteindre le bon état des eaux
Sans objet
13 : Mettre en place des
outils réglementaires et
financiers
13 A Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action
financière de l’agence de l’eau
Sans objet
13 B Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau Sans objet
14 : Informer, sensibiliser,
favoriser les échanges
14 A Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions
partagées
Sans objet
14 B Favoriser la prise de conscience Sensibilisation régulière du personnel en interne et par
différents intervenants (audits, suivi LPO….)
14 C Améliorer l’accès à l’information sur l’eau Sans objet
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
351
Précisons également que le SDAGE indique les problèmes locaux particuliers auxquels les SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) devront apporter les solutions appropriées, ainsi que les enjeux qui
dépassent le cadre local. Le SDAGE constitue un véritable outil juridique, toutes les décisions administratives
prises dans le domaine de l'eau devant lui être compatibles.
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 fixe également les grandes orientations de préservation et de mise en
valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin, et les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2021.
L’évaluation du bon état des eaux superficielles repose sur deux composantes :
o l’état chimique (en regard des normes européennes d’usages : baignade, production d’eau potable,
élevage de coquillages…),
o l’état écologique, apprécié selon des critères biologiques. Si l'état chimique et l’état écologique sont
bons, le “bon état” est reconnu.
Le bon état des eaux souterraines est apprécié en fonction de la qualité chimique et de la quantité d’eau
(équilibre entre prélèvements et alimentation de la nappe).
Les objectifs environnementaux du SDAGE pour 2021, sont les suivants :
o cours d’eau : 60 % en bon état écologique,
o plan d’eau : 66 % en bon état écologique
o eaux côtières : 70 % en bon état écologique,
o eaux souterraines : 75 % en bon état global
o 100 % en bon état quantitatif.
o 76% en bon état chimique
Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures qui propose les actions à engager sur le terrain pour
atteindre les objectifs d’état des milieux.
Les objectifs suivants ont été définis dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sur la Sarthe depuis
le Mans jusqu’à sa confluence avec la Mayenne (masse d’eau FRGR0456):
Pour chaque masse d’eau l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai.
Les niveaux d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des masses d’eau fortement
modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict. En application du principe de non détérioration lorsqu’une
masse d’eau est en très bon état l’objectif est de maintenir ce très bon état.
Les délais sont 2015, 2021 ou 2027.
Les objectifs d’états de la masse d’eau sont :
un bon potentiel d’atteindre l’objectif d’état écologique en 2021,
l’objectif d’atteinte du bon état chimique : n’a pas été défini
un bon potentiel d’atteindre l’objectif d’état global en 2021.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
352
Deux masses d’eau souterraines sont concernées par le projet :
Les alluvions de la Sarthe : GG113
Sables et grés du cénomaniens sarthois libres et captifs : GG081
Ces masses d’eau affichent un bon état quantitatif atteint en 2015 et un bon état qualitatif atteint pour les
alluvions de la Sarthe en 2015 et reporté en 2021 pour les sables cénomaniens.
Dans la mesure où les seuls risques à envisager au cours de l’exploitation résulteraient d’une pollution liée aux
produits hydrocarbonés présents sur le site pour laquelle des mesures de gestion seraient immédiatement
prises, il n’y a aucune raison objective pour que son fonctionnement puisse entraîner une dégradation de la
qualité des eaux pouvant remettre en cause ces objectifs.
2.3: SAGE SARTHE AVAL
2.3.1: L’AVANCEMENT DU SAGE
Le SAGE du bassin de la Sarthe aval est en phase d’élaboration.
2.3.2: PERIMETRE DU SAGE
Fixé par arrêté préfectoral le 16 juillet 2009, le périmètre d’élaboration du SAGE concerne la totalité du territoire
naturel que constitue le bassin versant de la Sarthe aval. Il représente un territoire cohérent du point de vue
des composantes naturelles, des contraintes socio-économiques et des enjeux de la gestion de l’eau identifiés.
Le bassin versant de la Sarthe aval comprend la rivière Sarthe et ses affluents, depuis sa confluence avec
l’Huisne au Mans jusqu’à sa confluence avec la Mayenne en amont d’Angers.
La commune de SPAY est comprise dans ce périmètre.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
353
2.3.3: LES ENJEUX
Le diagnostic a abouti à la mise en évidence des enjeux sur le territoire, ainsi que les objectifs vers lesquels le
SAGE doit tendre.
Limiter le phénomène d’érosion qui représente un enjeu transversal à toutes les thématiques car
dépendant des éléments du milieu naturel, influent sur la qualité de la ressource en eaux et lié au
ruissellement qui influe lui-même sur les inondations et étiages,
Le respect des débits d’étiages permettant un équilibre entre l’ensemble des usages (activités,
prélèvements, rejets…) et le bon fonctionnement du milieu aquatique.
Bien que le SAGE ne soit pas encore applicable, le projet d’exploitation est en conformité avec les objectifs, à
savoir :
toutes les mesures sont et seront mises en place pour ne pas altérer la qualité des eaux souterraines
(précautions vis à vis des produits polluants comme les hydrocarbures),
maintien de la continuité écologique,
maitrise l’impact des plans d’eau, en reliant les plans d’eau entre eux et en maintenant les relations
nappe-rivière,
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
354
2.4: SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L‘ENERGIE
En France, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est l’un des grands schémas
régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II dans le cadre des suites du Grenelle Environnement de
2007.
Il doit permettre à chaque région de définir ses objectifs et orientations propres, afin de contribuer à l’atteinte
des objectifs et engagements nationaux, à l’horizon 2020, de réduction de 20% des émissions des gaz à effet
de serre, de réduction de 20% de la consommation d’énergie, et de satisfaction des besoins à hauteur de 23%
à partir d’énergies renouvelables.
En résumé, le SRCAE est un document d'objectifs et d'orientations en matière :
de réduction des émissions de GES portant sur la maîtrise de l’énergie,
de développement des énergies renouvelables,
d'adaptation aux effets du changement climatique,
de réduction ou prévention de la pollution atmosphérique.
En Pays de la Loire, le SRCAE a été adopté le 18 avril 2014. Il propose des objectifs et orientations visant une
accentuation de l’effort en matière de sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel
régional des énergies renouvelables dans des conditions acceptables sur les plans économique,
environnemental et social. Ce scénario, qui traduit un engagement volontariste de la transition énergétique
dans les Pays de la Loire, prévoit en particulier pour 2020 :
une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la consommation
tendancielle (consommation qui serait atteinte en l’absence de mesures particulières) ;
une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la progression
démographique, représente une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 ;
un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à 21% la part de ces
dernières dans la consommation énergétique régionale.
Ces orientations seront ensuite déclinées en programmes d’actions dans les Plans Climat Energie
Territoriaux (PCET) réalises par les collectivités de plus de 50 000 habitants. Bien que non obligatoire, l’EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunal) Pays de la Vallée de la Sarthe s’est lancé dans la
démarche d’élaboration d’un plan climat énergie territorial. Ce PCET est à l’étape ultime de mise en œuvre.
Les différentes actions mises en place par le Plan d’Actions pour le Climat et la Transition Energétique sont
présentées dans le tableau ci-après.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
356
Les mesures destinées à limiter les effets du projet sur l’air et le climat, présentées au paragraphe 6 du chapitre
7 de l’étude d’impact, permettront de se conformer aux orientations du SRCAE :
utilisation de gazole non routier (GNR) pour les engins mobiles, conformément à la réglementation en vigueur,
maintenance régulière du moteur et de l'échappement des engins d'exploitation, respect de l'interdiction de
brûlage des déchets, mesures de réduction des envols de poussières (arrosage des pistes, limitation de la
vitesse sur les pistes…).
2.5: ORIENTATIONS NATIONALES POUR LA PRESERVATION ET LA REMISE EN ETAT DES
CONTINUITES ECOLOGIQUES
Les orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques s’appuient sur
les enjeux relatifs aux continuités écologiques d’importance nationale.
Aucun corridor écologique d’importance nationale n’est en relation avec le projet.
2.6: SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet
de la région de région, le 30 octobre 2015.
Le projet jouxte le corridor de vallée du bord de Sarthe. Le maintien d’une bande non exploitée de 60 m (50 m
entre la limite d’emprise et la Sarthe et 10 m non exploités réglementaires) permet de maintenir le corridor de
vallée.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
357
2.7: SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) est un document qui définit, en vertu de l’article L. 515-3 du
Code de l’environnement, les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. Il prend
en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des
départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux sensibles, la nécessité d’une gestion
équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe également les
objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Toutes les autorisations de
carrières doivent être compatibles avec ce schéma.
2.7.1: LA NOTION DE COMPATIBILITE DU SCHEMA
Le schéma départemental des carrières constitue un instrument d'aide à la décision du préfet du département,
lorsque celui-ci autorise les exploitations en application de la législation sur les installations classées.
Le schéma départemental des carrières n’est opposable qu’à l’administration. L’article L 515-3 du code de
l’environnement stipule que les autorisations d’exploitation de carrières délivrées en application du Titre 1er du
Livre V de ce code doivent être compatibles avec les orientations et objectifs du schéma départemental des
carrières.
Il doit y avoir un rapport de compatibilité entre l’exploitation de la carrière autorisée et les enjeux
environnementaux identifiés par le schéma départemental des carrières et justifiés au regard de l’article L.515-
3 du code de l’environnement.
La mise en œuvre du schéma suppose qu’il y ait cohérence entre les enjeux environnementaux identifiés et
ceux résultant d’autres plans en vigueur (SDAGE, SAGE, …)
Le nouveau rapport relatif au schéma révisé du SDC de la Sarthe et le rapport de l’évaluation
environnementale associé ont été finalisés pour le premier trimestre 2016 et présentés à la séance de la
CDNPS d’avril 2016.
La CDNPS a, lors de cette séance, arrêté, après vote favorable, le projet de SDC révisé de la Sarthe
afin d’engager la procédure de consultation.
Le projet finalisé du Schéma Départemental des Carrières de la Sarthe doit passer en CDNPS le 6
octobre 2017.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
358
2.7.2: COHERENCE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES NATIONAUX ET REGIONAUX
RELATIFS A L'ENVIRONNEMENT
Documents de stratégie nationale
Les documents suivants, relatifs à l’environnement, à l’écologie et au développement durable, ont été pris en
compte :
la stratégie nationale de développement durable pour la période 2010-2013, qui vise, en développant
une économie sobre en ressources naturelles et décarbonée, à faire de la France un des acteurs
majeurs de l’économie verte ;
la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 qui a pour ambition de modifier en profondeur
notre rapport à la nature en proposant des modèles de développement qui intègrent systématiquement
le volet biodiversité ;
le plan climat de la France, relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement, élaboré
en 2009 qui vise à lutter contre le changement climatique et intègre des orientations relatives au
domaine de l’énergie ;
le plan national d’adaptation au changement climatique adopté en 2011 qui a pour objectif de
présenter des mesures concrètes, opérationnelles pour préparer, pendant les cinq années à venir,
de 2011 à 2015, la France à faire face et à tirer parti de nouvelles conditions climatiques.
le deuxième plan national santé-environnement, adopté en 2009 pour la période 2009-2013 ainsi
que le troisième plan national Santé Environnement pour la période 2015-2019, en cours
d’élaboration, qui visent à protéger la santé publique en améliorant la qualité de l’environnement et en
informant le public ;
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 aout 2015 qui encourage
la consommation sobre et responsable des ressources naturelles (utilisation de matériaux biosourcés
lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments, exigence de priorités aux matériaux issus
du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets pour les chantiers de construction et
d’entretien routiers
le troisième plan d’action en faveur des milieux humides, s’inscrivant dans le prolongement du
précédent plan 2010-2013. Il s’agit de poursuivre une action spécifique sur ces milieux, concernés par
de nombreuses politiques (eau, biodiversité, mais aussi urbanisme, risques naturels et paysagers), de
disposer rapidement d’une vision globale de leur situation et de mettre au point une véritable stratégie
de préservation et de reconquête;
le plan national anguille validé par la Commission Européenne le 15 février 2010 ;
la stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et
substances de carrières du ministère en charge de l’écologie de mars 2012.
Le Grenelle de l’Environnement a permis de faire émerger de nouvelles attentes en termes de gestion et de
préservation de l’environnement, notamment la trame verte et bleue, la réduction des consommations
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
359
d’énergie, l'arrêt de disparition de milieux naturels et ruraux, l’arrêt de la perte de biodiversité, la lutte contre le
changement climatique, etc.
Le Grenelle se retrouve dans 5 grands textes législatifs dont la loi Grenelle I, la loi sur la responsabilité
environnementale, la loi OGM, la loi d’organisation et de régulation des transports ferroviaires et la loi dite
Grenelle II, promulguée le 12 juillet 2010, portant sur 6 domaines majeurs, à savoir (1) bâtiments et
urbanisme, (2) transports, (3) énergie, (4) biodiversité, (5) risques, santé et déchets et enfin (6) gouvernance.
Différents articles de loi Grenelle 1 concernent l’élaboration du schéma des carrières :
Lutter contre le changement climatique : la France doit diviser par quatre ses émissions de gaz
à effet de serre (GES) entre 1990 et 2050. Une réduction des émissions de GES est attendue dans
les secteurs des transports et de l’énergie. Dans le domaine des transports l’objectif est de réduire
les émissions de GES de 20% d’ici 2020.
Stopper la perte de biodiversité : l’Etat se fixe notamment comme objectifs la constitution d’une
trame verte et bleue d’ici 2012, la mise en place d’ici 2013 de plans de conservation ou de restauration
des espèces végétales et animales en danger, compatibles avec le maintien et le développement des
activités exotiques envahissantes.
Retrouver une bonne qualité écologique de l’eau : le premier objectif est d’atteindre, d’ici à
2015, le bon état écologique de l’ensemble des masses d’eau. D’ici à 2012, des plans d’action
seront mis en place pour protéger les cinq cents captages les plus menacés par les pollutions diffuses
(cf. captages prioritaires).
La gestion intégrée de la mer et du littoral : le régime des extractions en mer sera réformé avec
une vision d’ensemble du milieu maritime.
L’environnement et la santé via le Plan Santé Environnement ;
Les déchets : il s’agit d’améliorer, en particulier, la gestion et la valorisation des déchets issus
des chantiers des bâtiments et travaux publics.
Le Comité de Pilotage a intégré ces éléments lors de l’élaboration du schéma, et des arbitrages qu’il a été
amené à effectuer, notamment lors de la comparaison des différents scénarios dans l’Evaluation
environnementale, en prenant en compte ces critères environnementaux.
Documents de stratégie régionale ou départementale
La Sarthe est concernée par un certain nombre de plans et programmes visant à gérer l’environnement ou
l’occupation des sols.
Les principaux documents de référence ayant été pris en considération sont les suivants (liste non exhaustive)
:
Le contrat de Plan d’Etat Région des Pays de la Loire (CPER) 2015-2020 (CPER) signé le 23
février 2015. Ce contrat représente un engagement contractuel de l’Etat et de la Région, permettant,
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
360
avec des cofinancements qui seront apportés principalement par les autres collectivités, de mobiliser
des crédits publics pour investir dans les domaines prioritaires qui ont été définis au plan national :
o mobilité multimodale ;
o enseignement supérieur ;
o recherche et innovation ;
o transitions écologique et énergétique ;
o Numérique ;
o Innovation, filière d’avenir et usine du futur ;
o emploi, orientation et formations professionnelles ;
o Territoire.
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-
2021, adopté en décembre 2015. En application de la directive Cadre sur l'Eau, il fixe les objectifs de
restauration à atteindre sur les eaux superficielles, souterraines, les plans d'eau et les eaux littorales.
Il établit par ailleurs les orientations à mettre en œuvre pour y parvenir.
Le Plan régional santé environnement adopté le 9 mai 2011 pour la période 2010-2013 (PRSE2)
qui identifie dix actions prioritaires pour un environnement favorable à la santé des habitants des Pays
de la Loire. Le plan régional santé environnement (PRSE3) est en cours de construction à partir du
bilan du plan régional santé environnement 2010-2013 (PRSE2), de l’évaluation du PRSE2, du PNSE3
(adopté en novembre 2014) et du baromètre santé environnement 2014, enquête sur la perception
des habitants de la région des enjeux de santé en lien avec l’environnement ;
Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés adopté en 2009 ;
Le Plan départemental de gestion des déchets du BTP en cours de révision en 2011 (le précédent
a été approuvé en 2004). La loi du 7 août 2015, portant Nouvelle organisation territoriale de la
république (loi Notre), a instauré le Plan régional de prévention et de gestion des déchets
(PRPGD) qui devra être approuvé dans un délai de 18 mois et se substituera au PDGDBTP ;
La Charte 2008-2020 du Parc Naturel Régional Normandie-Maine qui matérialise le projet commun
pour la protection, l'aménagement et le développement du territoire du parc pour les prochaines années
à venir ;
Le Plan Régional de la qualité de l’air (PRQA) dont la dernière version a été approuvée par arrêté
préfectoral le 24 décembre 2002. Celui-ci fixe les orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution
atmosphérique due au trafic routier, aux émissions agricoles et aux plantes allergisantes. Par ailleurs,
il incite à la réalisation d’économies d’énergie et à la prévention de la pollution agricole ;
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique : Le SRCE co-élaboré par l’État et la Région
est le volet régional de la trame verte et bleue. Les documents d’urbanisme comme les Schémas de
Cohérence Territorial (SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les cartes communales
doivent prendre en compte le SRCE au cours de leur élaboration ou à l’occasion de leur révision.
Les carrières en activité ou réaménagées font partie des espaces dont la contribution à la TVB doit
être examinée à l’échelon local suivant l’intérêt du site. Dans l’objectif d’assurer une cohérence entre
les différentes politiques de préservation des ressources naturelles que constituent les matériaux
et les milieux naturels, la prise en compte du SRCE se fera directement à l’échelle des projets.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
361
Le Schéma Régional d’Infrastructures et de Transport approuvé (SRIT) qui fait du développement
du ferroviaire une priorité régionale via par exemple une participation à court terme à la mise en place
d’infrastructures (installations terminales embranchées…) et qui soutient les innovations et les
expérimentations relatives aux transports via notamment le lancement d’une réflexion sur l’opportunité
de développer le transport fluvial sur la Loire et ses principaux affluents (Loir, Sarthe, Mayenne). Cela
concerne la « navigation de tourisme et de loisirs, voire commerciale pour le transport de
marchandises » ;
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire pour la
région des Pays de la Loire adopté en 2008 ;
Le Plan régional agriculture durable des Pays de la Loire (PRAD) – version 9 du 26/03/2012.
Dans les réflexions menées pour l’élaboration du SDC, les orientations et les objectifs fixés par ces plans
régionaux et départementaux sont pris en compte.
En étant compatible avec le Schéma des Carrières, le projet est compatible de fait avec ces différents schémas
et plans.
Les différentes orientations et objectifs du schéma sont repris dans le tableau ci-après. Ont été rajouté à ce
tableau les remarques concernant leur prise en compte par le projet.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
362
Objectifs Orientations Prise en compte dans le projet
Zones de protection
du milieu et
consommation
d'espace
A-1 Protéger les secteurs à enjeux
environnementaux
Seul secteur à enjeu concerné : le PPRi secteur naturel aléa moyen : pas de
création d’obstacle à l’écoulement des crues.
A-2 Produire des études d'impact et d'incidences
de qualité renforcée
Etudes hydrogéologiques préalables sur 2 ans
A-3 Encadrer la création de nouveaux plans d'eau
Projet : agrandissement des plans d’eaux existants :
o Pas de perturbation globale de l’écoulement des eaux souterraines
(étude hydrogéologique)
o Mesures préventives vis-à-vis des risques de pollution des eaux
o Maintien des relations nappe / rivière
A-4 Limiter la prolifération d'espèces invasives Une seule espèce invasive avérée : pas de mesure particulière vu les effectifs
réduits de l’espèce
A-5 Réduire la consommation d'espaces agricoles
ou forestiers
Pas d’extension sur des espaces agricoles, les zones d’extensions sont classées
en zone spécifique carrières
Approfondissement des plans d’eau existants plutôt qu’extension de surface de
l’exploitation
A-6 Veillez à la qualité des eaux de rejets Mesures préventives en place
Contrôles périodiques
A-7 Réduire les nuisances lors du fonctionnement
des exploitations
Mesures préventives en place
Contrôles périodiques
A-8 Maitriser les prélèvements d’eau Cf étude hydrogéologique
A-9 Préserver les têtes de bassins versants et les
zones humides
Non concerné
A-10 Préserver les paysages particulièrement
remarquables
Non concerné
A-11 Prendre en compte la biodiversité héritée Etude écologique
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
363
Usages rationnels et
économes de la
ressource
B-1 Réduire l'extraction des matériaux
alluvionnaires en lit majeur
Approfondissement des plans d’eau et exploitations des sables cénomaniens
(gisement de substitution)
Réduction du tonnage exploité conformément au sdage intégré dans le phasage
d’exploitation
B-2 Réserver les matériaux nobles aux usages
nobles
Débouché commercial préférentiel : les centrales à béton
B-3 Passer la part de matériaux recyclés à 10 % de
la production départementale
Non concerné
Garantir l'accès aux
gisements
C-1 Prise en compte, par les collectivités, de leurs
besoins en matériaux de carrière dans les
documents d’urbanisme
Zonage carrière spécifique dans le PLU de la commune de SPAY
C-2 Meilleure prise en compte des données de
l’observatoire des matériaux
Transport des
matériaux
D-1 Privilégier la consommation des granulats
locaux au plus près des lieux de production
Proximité du plus gros centre de consommation : agglomération mancelle
D-2 Favoriser le recours aux infrastructures
routières structurantes
Voie communale permettant l’accès direct aux axes à grande circulation
D-3 Etude pertinente pour les transports et les flux
de matériaux
Centre de consommation très proche ne permettant pas un mode de transport
alternatif aux camions
D-4 Proposition de raccordement à un moyen de
transport en site propre pour carrières importantes
ou transport de grande distance
Non concerné
D-5 Privilégier une meilleure organisation du
double fret et du fret opportun
Non concerné
Remise en état des
carrières
E-1 Anticiper le plus possible la réflexion et la
concertation entre acteurs locaux
Concertation effective avec la commune, convention passée avec la commune
E-2 Remettre le site en état au fur et à mesure Remise en état des berges coordonnée à l’exploitation
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
364
E-3 Privilégier le remblayage des excavations et la
remise en état en terres agricoles ou forestières
A l’encontre du projet de remise en état définit en cohérence avec la vocation
affichée du secteur (secteur naturel)
E-4 Privilégier les réaménagements conduisant à
s'intégrer dans la biodiversité locale
Aménagements écologiques variés
E-5 Orientations à privilégier par type de carrière
Secteur non classé « à forte densité d’extraction », diminution du mitage par
connexion entre les plans d’eau, préservation des écoulements (diminution du
risque d’eutrophisation), prévention des pollutions
Sensibilisation et
formation des
professionnels et
information des
riverains
F-1 Sensibilisation et formation des professionnels
Sensibilisation du personnel
Adhésion à la charte environnementale des producteurs de granulats mettant en
place des audits et différentes formations
F-2 Mettre en place des CSS si nécessaire Non concerné
F-3 Privilégier les comités locaux de suivi (CLS)
pour la concertation locale avec les riverains
Les CLS sont un des axes prioritaires de la charte professionnelle des
producteurs de granulats.
Concertation avec la mairie mais aussi avec les riverains
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
365
2.8: SCHEMA REGIONAL DE GESTION SYLVICOLE
Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) des forêts privées a été approuvé par arrêté du ministre de
l’Agriculture, de la pêche et de la ruralité en date du 26 janvier 2005.
Ce document précise les conditions d’une gestion durable en forêt privée, en apportant au propriétaire les
renseignements indispensables à l’élaboration d’une politique raisonnée de mise en valeur de sa forêt. Tout
document de programmation de gestion doit suivre les recommandations contenues dans le SRGS.
Le projet d’exploitation de la carrière induit le défrichement de bois (1 ha environ) qui s’insèrent dans un massif
du « Bois de la sapinière » géré par un plan simple de gestion (PSG) élaboré en 2008 pour la période 2008-
2027.
Ce type de plan « comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux
de la forêt et, en cas de renouvellement, de l’application du plan précédent, un programme d’exploitation des
coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas
échéant, des travaux d’amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant
l’objet d’un plan de chasse, (…) proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole »
(art. L. 222-1 du Code forestier).
Précisons que ces bois (pinède) appartiennent à Mme TAVANO.
2.9: LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) est un document de planification et de programmation qui définit les
objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour organiser de façon durable les déplacements, avec pour
objectif la diminution du trafic routier.
C’est une obligation légale pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
La commune de SPAY n’est pas concernée.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
366
3: AUTRES SCHÉMAS ET PLANS ET CONTRAINTES
3.1: SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET
D’EGALITE DES TERRITOIRES
La région Pays de la Loire a adopté en 2008 , le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire
La Région devra se doter d’ici 2018, d’un Schéma d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) à valeur prescriptive. Ce document stratégique intégrera de nombreux schémas
sectoriels, comme le numérique ou le climat par exemple. Largement concerté, il méritera d’être très ouvert
sur les régions voisines et en particulier à l’échelle de la façade Atlantique.
Afin d’amorcer la réflexion, le Président du Conseil régional a demandé au CESER de « dégager les défis
majeurs à relever dans les 10 ans qui viennent ». Le CESER en propose douze
1. Une région attractive ;
2. Une région accessible et où l’on doit pouvoir facilement se déplacer ;
3. Une région au dynamisme démographique qu’il faut accompagner et anticiper ;
4. Une région qui mette en œuvre la nécessaire transition énergétique en faisant face aux conséquences
du changement climatique ;
5. Une région qui résorbe sa fracture numérique ;
6. Une région favorable à l’activité économique et l’emploi ;
7. Une région avec un équilibre social à renforcer ;
8. Une région qui permette à tous les ligériens d’avoir accès aux soins ;
9. Une région à construire autour d’un maillage et d’un équilibre territorial ;
10. Une région qui gère les ressources naturelles, respecte la biodiversité et les milieux naturels et gère
ses déchets ;
11. Une région qui conserve et valorise son patrimoine culturel, encourage la pratique et la création
artistique, le sport de haut niveau et la pratique sportive ;
12. Une région dans l’espace européen et ouverte à l’international.
Le CESER propose de s’appuyer sur un certain nombre de principes pour concrétiser ce grand dessein : la
concertation ; la solidarité ; la sobriété ; le développement ; la mutualisation, le partage et la coordination ; les
complémentarités ; l’équilibre territorial et la proximité ; la prévention et la sécurité ; l’anticipation et l’évaluation,
l’innovation ; la coopération.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
367
3.2: PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) consiste notamment à fixer les orientations et
recommandations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre, a minima,
les objectifs de la qualité de l’air prévus par la réglementation en vigueur.
La Région Pays de la Loire élabore le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA), ainsi que son suivi et son
évaluation depuis la loi du 27 février 2002. La dernière version de ce plan a été approuvée par arrêté
préfectoral le 24 décembre 2002. Il est constitué :
d’une évaluation de la qualité de l’air
d’une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé et les conditions de vie
d’un inventaire des substances polluantes.
Le PRQA fixe les orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique dues au trafic routier,
aux émissions agricoles, aux plantes allergisantes. Par ailleurs, il incite à la réalisation d’économies d’énergie
et à la prévention de la pollution agricole.
La Région soutient l’association «Air Pays de la Loire» qui a plusieurs missions :
mettre en place des dispositifs de mesure dans les grands centres urbains, les agglomérations de taille
moyenne, les zones rurales,
modéliser pour comprendre et anticiper les pics de pollution,
informer le public sur la qualité de l’air et prévenir en cas de pics de pollution.
Les mesures en relation avec la qualité de l’air ont été présentées au paragraphe 7 du chapitre 7.
Pour rappel, l’exploitation ne génère que relativement peu de gaz à effet de serre, ces gaz sont imputables au
trafic des engins et camions d’évacuation des matériaux. Le transport, compte tenu de la proximité des centres
de consommation, ne peut se faire par un autre mode. L’implantation d’une centrale à béton sur le site permet
de réduire les distances d’évacuation des matériaux.
3.3: PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX
La Région des Pays de la Loire met en œuvre une politique de protection de l’environnement dont l’efficacité
repose sur des enjeux partagés avec les acteurs locaux.
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
368
Elle concerne entre autre la gestion des déchets dangereux, nouvelle compétence régionale, qui s'est traduite
par l'adoption en janvier 2010 du Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) et d'un plan
d'actions.
Le PREDD comprend, une présentation du cadre général de la procédure suivie de son contexte réglementaire
et administratif, un bilan de l’état des lieux de la gestion actuelle des déchets dangereux en région, une
synthèse de l’analyse prospective réalisée visant à définir les flux à prendre en compte à l’horizon 10 ans et
les besoins d’installations en découlant ainsi que la définition des objectifs et orientations que les différents
acteurs régionaux souhaitent développer.
Ce PREDD qui fait le bilan de la gestion des déchets dangereux sur le territoire régional s’est fixé des objectifs
ambitieux à l’horizon 2019:
- réduire de 4% de la production de déchets dangereux en Région des Pays de la Loire;
- collecter 80% des déchets dangereux produits en région contre 65% en 2006;
- atteindre 40% des tonnages de déchets dangereux produits en région traités dans une filière de
valorisation ;
- atteindre 3 % du transport des déchets dangereux en mode alternative à la route.
Rappelons que les déchets dangereux générés sur le site sont stockés dans des bacs spécifiques étanches et
à l’abri des intempéries. Leur évacuation se fait par des récupérateurs agréés, ayant des filières de
valorisation.
3.4: PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE
Ce plan a été introduit par la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996. Le décret
en Conseil d'Etat du 25 mai 2000 en a précisé le contenu. Il s'applique aux agglomérations de plus de 250.000
habitants et aux zones dans lesquelles les valeurs limites de qualité de l'air ne sont pas respectées. Il vise à
ramener dans la zone les concentrations en polluants à un niveau inférieur aux valeurs limites. Pour ce faire
des prescriptions particulières applicables aux différentes sources d'émission (chaudières, usines, trafic routier,
combustion du bois, ...) sont prises par arrêté préfectoral. Chaque plan doit faire l'objet d'une enquête publique.
Le PPA est arrêté par le préfet de département.
3.5: PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE
Il n’y a pas d’itinéraire de randonnée recensé sur la commune de SPAY.
Les plus proches sont localisés à :
Voivres lès le Mans : Boucle villageoise des vallées
Le Mans : le tour de la base de loisirs de la Gèmerie au départ de Chaoué
Le Mans : le tour du Mans nord
Sargé lès le Mans : Les chemins médiévaux de Sargé lès le Mans
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
369
4: AUTRES SERVITUDES ET CONTRAINTES
4.1: CODE DE LA SANTE
Les terrains objet du projet se trouvent en dehors de tout périmètre de protection de captage public
d'alimentation en eau potable.
4.2: CODE FORESTIER
La parcelle AK11, au sud-ouest du projet est boisée. Son exploitation nécessitera un défrichement sur une
surface de 2 ha 88 a 50 ca.
La demande d’autorisation environnementale intègre la demande d’autorisation de défrichement, pour
2,885 ha. Précisons que cette zone boisée n’est pas classée en espace boisé classé (EBC).
4.3: PROTECTION DES SITES, DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DU PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE
ZPPA 183106 du 15/12/2010
Périmètres MH fusionnés Château des Huneaudières
ZPPA 183637 du 11/07/2016
Carrières TAVANO Etude d’impact
SPAY Chapitre 12
370
Le patrimoine culturel ou naturel peut bénéficier de contraintes réglementaires très strictes : il s'agit notamment
des sites inscrits ou classés (articles L. 341-1 et suivants du Code de l’environnement) et des monuments
historiques et de leurs abords (loi du 31 décembre 1913). Ces derniers bénéficient d'un rayon de protection de
500 mètres.
Le projet n’est concerné par aucun site ou monument historique. Aucune zone de présomption de patrimoine
archéologique n’est définie sur le périmètre du projet.
4.4: SERVITUDES RESEAUX
Les réseaux d’électricité qui passent sur l’emprise du projet ne seront déplacés. Les précautions vis-à-vis des
pylones seront les mêmes que celles actuellement en vigueur.
4.5: AUTRES SERVITUDES
La commune de Spay n’est grevée d’aucune servitude radioélectrique
4.6: PROTECTIONS DES ESPACES NATURELS
Les terrains du projet ne sont inclus dans aucun milieu bénéficiant d’une protection réglementaire (arrêté
préfectoral de protection de biotope, réserve naturelle…).
Le projet n’interfère avec aucune ZNIEFF.
Par ailleurs, la zone d’étude est située en dehors de toute zone Natura 2000.