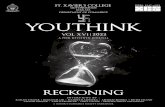COMMERCE ET INTEGRATION
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of COMMERCE ET INTEGRATION
Rechercher sur lesite:
Home | Publier un mémoire | Une page au hasard
Contribution à l'histoire économique duSoudan Français, le commerce colonial de 1870 à 1960 ( Télécharger le fichier original ) par Djibril Issa Niaré Université de Bamako Faculté des Lettres, Langues, Arts etSciences Humaines (FLASH) - Maitr??se 2003
Dans la categorie: Histoire
Disponible enmode multipage
MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE République du Mali
UNIVERSITÉ DE BAMAKO Un Peuple-Un But-Une Foi
Recherche
FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES, ARTS, ET SCIENCES
HUMAINES (FLASH)
DER Histoire-Archéologie
MEMOIRE DE MAITRISE
Thème :
CONTRIBUTION À L'HISTOIRE ÉCONOMIQUE DU SOUDAN FRANÇAIS :
LE COMMERCE COLONIAL :
1870-1960
Présenté et Soutenu par : Djibril Issa Niaré
Directeur de Mémoire : Mr Mamadou Sow Date de Soutenance : /19 / 04/ 2007/
Membres du Jury :
Mr : Dr Idrissa MAIGA
Mr : Dr El Mouloud YATTARA
Promotion 1999 - 2004
INTRODUCTIONCette étude fait une description du commerce colonial : ses causes, ses acteurs (avec leurs rôles), son mode de fonctionnement, les produits commercialisés et son impact(historique, économique, démographique ou social)
Nous devons comprendre que l'histoire est un processus continu. Ainsi le commerce colonial découle d'une évolution, c'est-à-dire que d'autres événements l'ont engendré. Le phénomène qui l'engendra directement est la traite négrière, car de la cessation de celle-ci, il naquit. La traite négrière est la première forme de commerce régulière qui exista entre l'Europe et l'Afrique
après l'invention des outils permettant d'entreprendre des voyages à longue distance.
Après l'interdiction de la traite négrière, ses différents acteurs se convertissent dans une nouvelle forme de commerce, la nature ayant horreur du vide.
La conquête coloniale, la colonisation et la réorganisation des colonies ont été décisives pour le commerce colonial. Cette réorganisation touche beaucoup de domaines, d'abord le contrôle militaire de la zone puis le cadre administratif, le cadre fiscal, le cadre législatif, le cadre organisationnel. Elle devrait faciliter également la réalisation des infrastructures permettant la fluidité du commerce français florissant. Le commerce colonial, après ces différents phénomènes quil'ont introduit, ne pouvait que retrouver un terrain favorable à son plein épanouissement. Ce commerce s'effectuait par un mécanisme bien agencé. Un réseau était ainsi organisé. Il comprenait les maisons de commerce et leurs ramifications et les acteurs animant leréseau. Les maisons de commerce sont des compagnies généralement européennes, qui pratiquent leur activité dans l'espace ainsi organisé à leur gré par la métropole.Il existait des grandes et des petites maisons de commerce, en fonction de leur statut juridique ou fiscal et en fonction de la capacité de brassage d'affaire. Ces maisons disposaient des ramifications. Les ramifications allaient des comptoirs (principales représentations de lamaison de commerce), aux colporteurs (derniers distributeurs du produit), passant par les succursales, les factoreries et les points de vente tertiaires (les étalagistes).
Quant aux acteurs animant les maisons de commerce, ce sont les personnes qui y travaillent. On peut les diviseren trois principaux groupes, à savoir : les Européens, les Syro-Libanais ou Libano-Syriens ou encore les Lévantins, et les indigènes. Les Européens sont ceux qui tiennent les comptoirs de la maison. Ils sont soit issus de la famille d'un actionnaire important du groupe ou issus du cercle restreint des proches de ceux-ci. Ils
entretenaient d'étroites relations avec les gouverneurs qui les soumettaient à une surveillance secrète et une fiche de renseignement qui permettait de donner d'amples informations sur eux. Ils étaient tous fichés. Les Syro-Libanais ou Libano-Syriens ou Lévantins sont des migrantsvenus des territoires français de l'Orient (d'ou leur nomde Lévantins), il s'agit du Liban et de la Syrie. Ils sont majoritairement chrétiens. Ils ont servi au début comme intermédiaires dans les maisons de commerce européennes. Avec la pratique de cette activité, ils parviendront à créer des maisons pour eux-mêmes avec les capitaux ainsi générés. Ces sociétés que les Syro-Libanais ont créées par la suite n'ont pas la même tailleque les européennes. Leur profusion fut surtout favoriséepar le départ de certains Européens pour des raisons de crise (crise économique de 1929, Première et Deuxième Guerre Mondiale). Ils livrèrent une concurrence rude aux Européens. Le groupe des indigènes est constitué par des Soudanais (Soudan Français) et des Wolofs. On les appelleles `'Dyula''. Ceux ci sont des courtiers, les colporteurs, de véritables navettes des maisons de commerce. Quelques rares d'entre eux créeront des maisonsde commerce pour leur propre compte, avec les capitaux qu'ils ont constitués. Cette situation survint à la veille des indépendances et après les indépendances, car des maisons de commerce y rentreront en Europe.
Le commerce colonial consistait en deux principales opérations : l'importation et l'exportation. L'importation consistait à introduire au Soudan Français des produits issus de la France (métropôle coloniale), des colonies voisines (françaises et anglaises) et d'autres pays (pays européens et latino-américains). Ces produits étaient généralement industriels. Parmi ceux-ci,nous citerons les alimentaires, les textiles, les verreries, les matériaux de construction, etc. L'importation introduit des produits jadis méconnus en Afrique. L'exportation concernait des produits dont l'exploitation avait un caractère de traite. Les différents produits indigènes destinés à l'exportation observent un cycle périodique dans l'année. Toute la
machine d'intermédiaires intervenait pendant ces périodes. Ces produits sont essentiellement issus de l'agriculture, de l'élevage, de la cueillette, de la chasse, du ramassage et des mines. Les unités de transformations étaient quasi absentes. Les ramificationsdes maisons de commerce se chargeaient de la vente des produits importés et l'achat des produits destinés à l'exportation. A ces niveaux du réseau commercial, les intermédiaires (`'Dyula'' et Syro-Libanais) étaient très importants et incontournables.
Le commerce colonial se pratiquait sur des voies de communication qui connaissent une grande diversité. Ces voies allaient des chemins de fer aux voies routières passant par les voies fluviales. Le chemin de fer était la première voie de communication du point de vue du volume de marchandises transportées de la côte au Soudan Français. Le principal chemin de fer était le Dakar-Nigerachévé en 1924. Il relie la côte à l'intérieur du Soudan Français. La voie fluviale est la seconde voie de communication après le chemin de fer selon le même critère. Il existe ici deux principaux cours d'eau qui seprêtent à la navigation. Il s'agit du fleuve Sénégal et du fleuve Niger. Le fleuve Sénégal fut la porte d'entrée principale des Français dans le Soudan Français. Il est navigable de Saint-Louis à Kayes. Des bateaux à vapeur sont déjà fréquents sur le Sénégal au début du XXème siècle. Le Niger offre une possibilité de navigabilité endeux directions, à savoir le Nord (Koulikoro- Tombouctou)et le Sud (Bamako-Kouroussa). Il connait la fréquence despirogues aménagées avec les progrès de la mécanique en pinasses. Les voies routières constituent la continuité des voies ayant servi le commerce des grands empires du Soudan Occidental (Wagadu-Ghana, Mali et Songhay). Elles connaissent la fréquence des piétons, des camions et d'autres moyens de locomotion tractés par les animaux.
Les régions s'échangeaient des produits : de Saint Louis et Dakar (les points de départ du commerce colonial), à Tombouctou (son aboutissement). Certaines régions étaientdéfavorisées par rapport à d'autres dans cet échange.
Ainsi le Sud recevait l'essentiel de ses produits des colonies voisines, qu'elles soient françaises ou anglaises. Les produits européens comme les produits africains arrivaient dans toutes les régions qui y participaient. Des centres jadis importants sur le plan commercial perdirent leur éclat avec le basculement des directions du commercial, tel fut le cas de Tombouctou. La monnaie utilisée était celle de la métropôle (la France). Cette monnaie s'impose après l'élimination des autres monnaies et des autres formes d'échange, respectivement, les cauris et les pièces venues des comptoirs autrefois négriers ainsi que le troc.
Le commerce colonial causa des conséquences sur le plan socio-économique, historique, politique et démographique.Ses déplacements de populations au gré des zones de production des cultures destinées à l'exportation, causèrent des problèmes sociaux avec l'intégration de celles-ci en certains endroits. Les infrastructures réalisées furent un acquis, mais leur réalisation fit unehécatombe. Les travaux de réalisation de ces infrastructures revêtaient un aspect de force. L'exportation massive des produits pendant les Guerres Mondiales, provoqua des famines. A la suite des catastrophes engendrées par ces famines des efforts sanitaires sont déployés par des consciences humanistes. La dépendance de l'Afrique vis à vis de l'Occident est accentuée. Les cultures ainsi exportées suscitèrent des intérêts qui ont permit aux pays du Soudan Occidental de les mettre au centre des préoccupations. Elles occupent de nos jours une place de choix dans l'économie de ces pays. L'arriération de l'Afrique est aggravée également.
Sous un angle critique, nous constatons que le commerce colonial a mis en place des mécanismes qui devraient défavoriser l'Afrique dans le concert des nations. Ces mécanismes permirent aujourd'hui de maintenir la dépendance de l'Afrique à l'Occident ou la continuité de la colonisation : c'est le néo-colonialisme.
PREMIERE PARTIE :
ORIGINES ET FACTEURS DECISIFS DU COMMERCE COLONIAL
CHAPITRE I :
LA TRAITE NEGRIERE, ORIGINE DU COMMERCE COLONIAL
L'esclavage est l'une des plus vieilles pratiques de l'humanité. Il a des origines dans l'Antiquité. Il est pratiqué dans toutes les parties de la terre peuplées parl'espèce humaine. Il s'effectue sur plusieurs échelles : au sein d'un royaume, au sein d'un empire, au sein d'une sous-région, au sein d'un continent et au sein d'un espace intercontinental. L'Afrique ne fait pas exception.Elle connut une forme très importante avec une particularité tant historique, économique, sociale que politique sinon géopolitique.
Il est convenu d'appeler cette forme Traite Négrière. La traite négrière était pratiquée en direction de plusieursgrands axes, créant ainsi deux cas : la traite orientale et la traite atlantique.
La traite orientale était pratiquée en grande partie dansl'Océan Indien, la Mer Rouge et la Méditerranée. Elle consistait à amener d'Afrique les esclaves noirs pour le Proche-Orient et les pays occidentaux bordant la
Méditerranée.
Quant à la traite atlantique, qui retient surtout notre attention, elle était pratiquée dans l'Océan Atlantique. Elle débuta à partir du XVème siècle et prit fin dans la seconde moitié du XIXème siècle. La traite atlantique consistait à acheter des esclaves noirs africains en Afrique, pour les vendre sur le continent américain principalement et l'Europe d'une manière relativement faible. L'itinéraire de ces négriers (marchands d'esclaves noirs) avait trois grands pôles : l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. D'Europe, ils s'approvisionnaient essentiellement en produits manufacturés européens (verreries, textiles, alcools, friandises, etc.) qui étaient vendus et échangés contre captifs. Ces derniers (les esclaves) étaient vendus en Amérique et aux Antilles pour répondre à la demande en main-d'oeuvre principalement dans les plantations de canne à sucre, de coton et de café. D'Amérique, les marchands s'approvisionnaient en grande partie en épices et des matières premières pour l'industrie textile. Ces produits étaient vendus en Europe.
La traite négrière plongea l'Afrique dans une situation sans précédent, créant ainsi la méfiance entre les différentes entités politico-ethniques, favorisant un désordre conjugué à une instabilité et une insécurité quis'intensifia progressivement de manière croissante. Elle fut causée principalement par l'esprit d'aventure des Européens, la recherche par ceux-ci des bras valides pouvant satisfaire les besoins en main d'oeuvre du nouveau monde dont la puissance réside dans l'agricultureet la recherche pour l'Europe d'une population active servile assumant les tâches domestiques.
La traite permit au monde occidental de se développer tout en amorçant une croissance économique qui suit le processus irréversible de la mondialisation. L'Europe acquit par la suite une hégémonie économique, politique et culturelle. L'Amérique bénéficia d'une population trèsactive bâtissant de véritables infrastructures économiques permettant de préparer une longue et solide
puissance économique.
Quant à l'Afrique, qui fournit les esclaves, elle fut dépouillée d'une de ses principales richesses que constituent les bras valides et les femmes en âge de procréer. Comme conséquences psychologiques, la traite amorce chez l'Africain un sentiment de surestimation de l'homme blanc. Les différentes entités politico-ethniquesou étatiques se lancent dans une situation de cahot très accentuée. Ces différents facteurs appauvrissent considérablement l'Afrique.
Cette traite balise le terrain pour les relations économiques entre l'Afrique et l'Occident. A partir des voyages de reconnaissance est apparue la traite négrière,à partir de cette traite est apparu le commerce colonial,et ce commerce colonial enclenche les relations économiques modernes entre l'Afrique et le reste du mondeque nous vivons aujourd'hui. Tous ces phénomènes et ces relations sont classés de manière inévitable dans le processus de mondialisation enclenché depuis l'Antiquité.
Ainsi, la traite négrière apparaît comme un facteur prépondérant dans l'avènement du commerce colonial. Le commerce colonial est la suite historique du processus enclenché par la traite négrière. Plusieurs jalons posés rendent aisés la compréhension de ce point de vue. La pratique régulière de la voie maritime Europe-Afrique favorisa une bonne connaissance de l'Afrique. Les infrastructures commerciales (comptoirs commerciaux), la commercialisation à petite échelle de certains produits africains (peaux et produits végétaux) parallèlement au commerce d'esclaves, le contact permanent avec les peuples africains ne pouvaient que préparer un terrain favorable à la pratique du commerce colonial qui était déjà latent. La cessation de la traite négrière est en soi un début logique pour le commerce colonial car l'Europe en quête d'une dynamique de croissance économique concevait l'Afrique comme un déboucher et aussi il fallait trouver un substitut à l'esclave comme marchandise. Notons qu'à cette période les progrès technique et scientifique avaient propulsé en avant
l'industrie européenne qui était jadis « artisanale » en créant une surproduction. Puisque ce surplus devrait êtreécoulé, l'Afrique répondait à ce besoin, d'autant plus qu'une relation de sujétion était établie. L'événement qui consolida cette relation de sujétion est la conquête coloniale et la colonisation.
CHAPITRE II :
FACTEURS POLITIQUES DU COMMERCE COLONIAL : PENETRATION COLONIALE ET COLONISATION
1- Pénétration coloniale :
A partir de 1878 les premiers canons de la conquête coloniale retentissent à Sabuciré du Logo. Et la machineinfernale de la France fait tomber tour à tour les centres importants de la résistance ouest africains, plusparticulièrement du Soudan Occidental : Le Fouta d'El Hadj Omar Tall, Le Cayor de Lat Dior Diop, le Bélédougou de Koumi Diossé le Wasulu de l'Almamy Samory, le Kénédougou des Traoré, etc.
A partir de 1850 les bases de la conquête politique du Soudan Occidental sont jetées. De la côte sénégalaise la France s'apprête a donner le coup d'envoi de sa machine militaire. Elle entre à partir de Saint Louis (créé en 1638) et plus tard Dakar (créé en 1862). Les Français suivent le cours du fleuve Sénégal. Ils se mettent à construire des infrastructures militaires, essentiellement les forts dont les plus importants sont :Ceux de Médine et de Dakar. Celui de Médine fut construit
de 1855 à 1857. L'artisan de cette politique est le Général Louis Léon César Faidherbe (1818-1889), énergiqueconquérant de l'empire colonial Français naissant.
Faidherbe ne manque pas de tact et de moyen pour accomplir sa difficile mission. Il se heurta à la réticence du pays wolof et de leurs voisins. Le cas le plus illustrant est celui des Toucouleurs conduits par ElHadj Omar Tall.
A cette époque la France organise ces territoires. Depuisle XVIIème siècle quelques factoreries et points de venteeuropéenne sont installes dans le Haut-Fleuve ou Haut-Sénégal. Selon Maurice Delafosse depuis 1867, des tentatives de commerce français dans la région sont menées, ce qui justifiait la construction du fort de Médine1(*).
Faidherbe en ces termes disait : « Nous ne pouvions accepter ces conditions, car faire le commerce sans protection avec les barbares est une chose reconnue impossible depuis longtemps. Aussi loin d`abandonner et de démolir nos forts, nous crûmes nécessaire d`en créer un nouveau, plus avancé que tous les autres, à Médine, pour éloigner notre frontière de Bakel et sauver si c`était possible l`important commerce de ce comptoir. »
Cela traduit la tension entre les Français et les résistants africains, ils croyaient tous au début que lesFrançais venaient juste pour commercer sans pourtant perturber leurs droits de douanes ou de coutumes. Les Français eux n`admettaient pas que la pratique du commerce par leurs ressortissants soit empêchée par les droits de douane ou coutumes très pesants. Alors le seul moyen de favoriser la libre circulation des marchands et de leurs marchandises, était de passer a la conquête politico-militaire afin de détenir tous les facteurs de décision. C`est ce que va faire la France. A partir de cette époque la situation politique est très déterminanteet très favorable à la France.
2- La réorganisation dans les colonies ou colonisation :
Apres la conquête, la France réorganise ses colonies. Cette réorganisation touche plusieurs domaines : administratif, fiscal, commercial et militaire. Ce processus débute depuis la France. Les colonies étaient d`abord gérées par le ministère de la Marine. En1889, le Sous-secrétariat d`Etat aux Colonies est crée dont le premier responsable est Eugène Etienne. Ce Sous-secrétariat d`Etat est rattaché au Ministère du Commerce.En 1894, le Ministère des Colonies est créé.
a-Sur le plan administratif :
La France va procéder à une division administrative. D`abord le Sénégal est divisé en quatre communes principales qui sont Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis. Le Soudan sera divisé en cercles qui seront divisés en subdivisions et les subdivisions en canton.
Les Cercles sont au nombre de dix-sept à savoir :Kayes, Bafoulabé, Kita, Bamako, Nioro, Goumbou, Sokolo, Satadougou, Sikasso, Ségou , Koutiala, San , Djenné, Mopti, Issa-Ber ou Niafunké, Bandiagara et Tombouctou plus tard en 1911. Les Cercles sont dirigés par des Commandants civils ou militaires. Ils étaient instruits et rendaient compte au Lieutenant-gouverneur du Soudan Français siégeant à Bamako. Les chefs des subdivisons étaient des administrateurs le plus souvent civils. Quantaux chefs de cantons ils étaient des indigènes et choisisdans le groupe des chefs de village constituant le canton.
Cette administration travaillait étroitement avec des gardes affectés à leur compte. Parmi ceux-ci l'on pouvaitretrouver et des indigènes, et des Français. Ces indigènes étaient recrutés parmi les soldats qui avaient servi dans l`armée française au moment des batailles de pénétration. Ils se sont rendus célèbres tristement a
travers la terreur qu`ils semaient au sein de la population
b. Sur le plan fiscal :
1900, déjà la conquête militaire du Soudan Occidental estpresque achevée, à partir de 1895 la France crée l'A.O.F.(l'Afrique Occidentale Française), un gouvernement général dirigé par un gouverneur regroupant huit territoires a savoir la Côte d'Ivoire, le Dahomey, la Guinée, la Haute Volta, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Soudan. Le siège du gouvernement était à Dakar
La France organise également ses colonies sur le plan fiscal. Le décret du 14 Avril 1905 fixa les tarifs douaniers dans les colonies. Au titre du même décret un bureau des douanes est ouvert à Kayes le 17 octobre 1907.La tarification était beaucoup plus souple dans l`A.O.F. par exemple la gomme était taxée à 30F la tonne, les peaux à 100F la tonne, et le coton exempt de droit de douanes. Pour l`entrée en France, certains produits étaient admis en franchise. Parmi ceux-ci nous avons la gomme, les peaux, le karité, la laine et le caoutchouc. Les territoires qui bénéficiaient de cette déréglementation étaient : La Guinée, la Mauritanie, le Niger et le Soudan. Ils constituaient la `'Zone libre `'
Toutes les marchandises entrant dans l'A.O.F. non originaires de la Métropole étaient surtaxées. Cette mesure traduit les politiques protectionnistes de l'époque devant la surproduction agricole et industrielleeuropéenne et américaine. Le protectionnisme se définit comme les mesures adoptées par un Etat, pour protéger sesfrontières à l'entrée des marchandises étrangères. Ainsi les produits alcooliques sont prohibés à l'entrée, mesurequi n'empêche pas leur entrée.
Les impôts procèdent à la classification des commerçants.Il y avait sept classes de commerçants et les plus importantes étaient les trois premières. La première était constituée par les représentations principales des
grandes maisons de commerce et des grands négociants, lesbanques, les importateurs et les exportateurs en gros. Ils payaient un impôt de 1500f et 12% de leur chiffre d'affaire. La deuxième classe était constituée par les commissaires en marchandises, les agents de douane, les entrepreneurs de travaux publics, les entrepreneurs des transports eau et terre, l'importateur en gros ou l'exportateur en gros, la succursale d'une maison de commerce ou d'un négociant. Cette classe payait un impôt de 1000f et 10% de leur chiffre d'affaire.
La France avait fixé des impôts pour tous ceux qui intervenaient dans le circuit économique. Ainsi les exploitants de carrière devraient payer un impôt de 5F par ouvrier et 10% de leur chiffre d'affaire. Pour les fabricants de briques, de carreaux, de ciment, de poteries, de tuiles, de tuyaux, etc., l'impôt était 10F par ouvrier. Un impôt de 10F par hectolitre de capacité brute des alambics et 3F par hectolitre de capacité brutedes bassines pour les fabricants distillateurs et liquoristes. Un impôt de10F par ouvrier travaillant dans les usines d'égrenage était payé, et 10F par cheval-vapeur de force motrice pour les machines et tout autre engin.
c - Sur le plan commercial :
Sur ce plan la France pose les jalons indispensables pourun commerce consistant. D'abord les premières réalisations furent la création de deux chambres de commerce. La première vit le jour en 1884 sous le nom de `'Chambre de commerce Française de Kayes -Médine `' son siège est à Kayes. La deuxième vit le jour le 04 janvier 1896 sous le nom `'Association des Commerçants etEmployés de Commerce du Soudan Français `'.Son siège est à Bamako.
Beaucoup de difficultés se sont posées pour la fixation des prix. Les difficultés sont dues à la distance et les facteurs liés au transport. Pour cela le colonisateur avait pris des mesures palliatives. L'on tenait désormaiscompte du coût élevé de transport et les voies de
communication. Ainsi l'arachide achetée à Kayes était plus chère pour le traitant que celle achetée à Bougouni ou à Dioïla. Cela se comprend aisément dans la mesure où la différence du prix est compensée dans le transport. Letraitant pouvait imposer son prix en fonction de la zone dans laquelle il opère. L'acheminement des produits vers la côte sénégalaise revenait un peu cher. La France avaituniformisé les prix établissant ce qu'on appelle les Mercuriales une mercuriale est une liste comportant le prix des articles vendus sur le marché. Ainsi en 1910 il y avait deux mercuriales une à Kayes et une à Bamako.
La MERCURIALE de KAYES à la date du 1 er JUILLET 1910
PRODUITS EUROPEENS Produits Unités Prix
GuinéePièce de 15 mètres 7 Francs
Toile blanchePièce de 30 mètres 15 Francs
Guinée ChandoerPièce de 15 mètres 9 Francs
Liménéas Le mètre 1 Franc
Toile de VosgesPièce de 30 mètres 15 Francs
SucretonPièce de 30 mètres 14,50 Francs
Ambre faux La boule 2 à 5 Francs
Perles La filière0,30 à 0,50 Franc
Farine Le kg 1 FrancSucre Le kg 0,80 FrancVin Le litre 1 FrancCognac La bouteille 7 FrancsAbsinte Le litre 4,50 FrancsPétrole Le litre 0,50 Franc
PRODUITS INDIGENES Produits Unités PrixMil Le kg 0,15 FrancMaïs Le kg 0,15 FrancArachides Le kg 0,20 FrancHaricots Le kg 0,20 FrancHuile d'arachides Le litre 1,50 franc
KolasEnsemble de 1000noix 100 Francs
Sel La barre 11 FrancBeurre de Karité Le kg 1 Franc
Pagnes La pièce4 à 10 Francs
Couverture de Ségou La pièce
15 à 20 Francs
Couverture de laine La pièce 5 FrancsBandes de coton Le mètre 0,10 FrancGomme Le kg 0,35 FrancCoton Le kg 0,30 FrancChevaux Tête 200 à 300 Fr
Boeufs Tête25 à 75 Francs
Boeufs porteurs Tête60 à 100 Francs
Moutons Tête3 à 10 Francs
Boeufs pour bouchérie Le kg 4 à 5 FrancsMoutons pour boucherie Le kg 1,25 FrancRiz Le kg 0,30 FrancMiel Le kg 1 FrancTabac Le kg 0,20 KgPeaux de boeufs Le kg 1 Franc
Peaux de moutons Le kg 0,50 FrancPeaux d'agneaux Le kg 0,75 FrancOr Le gramme 3 FrancsSamara La paire 2 à 5 FrancsIndigo Le kg 1Franc
Anes Tête40 à 60 Francs
Poule Tête0,50 à 1 Franc
Canard Tête 2 à 5 FrancsLa MERCURIALE de BAMAKO à la date du 01 er juillet 1910
PRODUITS EUROPEENS Produits Unités PrixFarine Le kg 1,50 FrancSucre Le kg 1,50 FrancCafé Le kg 1,50 Franc
HuileLe litre 4,25 Francs
VinaigreLe litre 2,50 Francs
Poivre Le kg 3,25 FrancsSel Le kg 0,25 Franc
Vin blancLe litre 2,25 Francs
Vin rougeLe litre 1,75 Franc
RoumeLe mètre 0,50 Franc
BazinLe mètre 0,75 Franc
PercaleLe mètre
0,75 à 1 Franc
Andrinople Le 1 Franc
mètrePRODUITS INDIGENES Produits Unités PrixMil Le kg 0,20 FrancRiz Le kg 0,40 Franc
Sel en barreLa barre
15 à 20 Francs
Arachides Le kg 0,12 Franc
HuileLe litre 1 Franc
TabacLa charge 0,30 Franc
Beurre de Karité Le kg 0,30 FrancSel en vrac Le kg 0,25 Franc
Bandes de cotonLe mètre 0,40 Franc
Couvertures de Kassa
La pièce
5 à 7 Francs
ToilesLe mètre 0,3 Franc
GuinéeLe mètre 0,50 Franc
Pagne L'unité6 à 10 Francs
Cire Le kg 1,50 Franc
Vache La tête60 à 70 Francs
Taureau La tête35 à 40 Francs
Ane La tête 35 Francs
Cheval La tête150 à 200 Francs
Mouton La tête5 à 6 Francs
Chèvre La tête 3 à 5
FrancsSource : Mémoire SIDIBE Daouda `'Maisons de Commerce et Commerce Colonial au Soudan Français.1878-1933 `' pp 42-44, Session de juin 1983 ENSUP, Département Histoire-Géographie.
DEUXIEME PARTIE :
ETUDE DETAILLEE DU COMMERCE COLONIAL
CHAPITRE I :
ENCLENCHEMENT DU PROCESSUS
Les références par rapport au temps de l'enclenchement ducommerce colonial, se situent au début de la colonisationplus précisément à la fin de la seconde moitié du XIXème siècle. Le qualificatif colonial détermine les débuts de ce commerce effectivement à la fin du XIX ème siècle. Avec la fin de la conquête coloniale, nous assistons à l'installation des institutions commerciales et l'organisation. Les bases de ce commerce furent jetées avant la fin du XIX ème. Selon Maurice Delafosse in `'Haut-Sénégal-Niger `' Tome 3 P 383, un commis nommé Bazy réussit de fructueuses opérations au Galam et jusqu'au `'Rocher'' du Haut-Sénégal. Ce commis serait le premier Français ayant pénétré librement la colonie future du Haut-Sénégal2(*).
La colonisation est un concept expliquant uniquement l'âge d'or des Européens en Afrique selon Joseph Ki-Zerbo3(*). A partir de ce concept on pourra comprendre aisément que cela ne signifie pas le début du contact desEuropéens avec l'Afrique, mais plutôt le début de
l'hégémonie politique, économique et même culturelle. Ce qui permet de comprendre que certaines des pratiques du temps de la colonisation ont bien débuté avant son avènement. Avec son avènement, elle donne son sceau à celles-ci. Le commerce s'inscrit dans ce cadre parmi plusieurs autres pratiques. Donc le début du commerce colonial rime avec la colonisation. Et cette colonisationne débute pas dans le Soudan Occidental aux mêmes momentset aux mêmes lieux. Cela est dû à beaucoup de facteurs tantôt liés aux questions de priorité pour les Français tantôt liés aux conditions d'accès et tantôt liés à l'importance politico-économique des régions à conquérir.L'expansion et l'essor du commerce colonial suivent Mercurialeégalement la même évolution que la colonisation.
CHAPITRE II :
ROLE ET PARTICULARITES DES DIFFFERENTS ACTEURS
Le commerce colonial était une nouvelle pratique, il serale centre d `intérêt de plusieurs acteurs. Déjà la conquête et la réorganisation de l'ouest-africain sont terminées par la France, le commerce ne peut que trouver un terrain favorable pour son épanouissement. Il sera très organisé. Nous avons plusieurs intervenants dans ce domaine à commencer par les autorités compétentes. L'administration coloniale Française était une administration purement dévouée au service du commerce français : des services du fisc à ceux de l'administration territoriale passant par les organisations commerçantes, tous œuvrent pour la promotion du commerce des Français.
Le commerce était organisé en réseau. Ce réseau était composé de structures et d'agents. Les structures allaient des maisons de commerce à leurs ramifications. Quant aux agents ils sont les principaux animateurs de ces structures.
1- Les structures de commerce :
Elles étaient principalement composées de grandes et de petites maisons de commerce et leurs ramifications.
a. Les grandes maisons de commerce
Elles sont des grandes compagnies issues de la métropole (France). C'est des compagnies qui font l'importation en gros et l'exportation en gros. Leur implantation en Afrique commence à partir de la fin du XIXe siècle et le but du XX ème siècle. Une distinction s'impose: les sociétés commerciales négrières et les compagnies qui font le commerce colonial. L'implantation des compagnies négrières commence à partir de la deuxième moitie duXV ème siècle. L'implantation des maisons de commerce a débuté au Sénégal qui constitua la porte d'entrée du Soudan Occidental. Avant, pendant et après la conquête coloniale, elles s `installèrent à l'intérieur du nouveau territoire. Elless'occupaient du commerce des produits africains constituant les matières premières pour l'industrie européenne et également du ravitaillement de l'Afrique en produits européens. Elles ont développéen Afrique la culture de certains produits, ainsi que le ramassage et la cueillette d'autres.
Elles étaient liées entre elles par un système financier
Anciens, Archives Nationales du Mali à Koulouba.
* 7Joseph Ki-Zerbo, `'L'histoire de l'Afrique Noire, d'hier à demain'' Editions Hâtier, Paris 1878, P433 : « Les routes, les ports, les voies ferrées, à l'absence de matériels (on limitait au maximum l'achat des machines), ont été construits à la main par des hommes et des femmes. Celles-ci passaient des semaines et des mois à damer les routes comme le plancher de leur case. Nul ne peut compter le nombre d'heures de travail ainsi systématiquement extorquées. »
Rechercher sur le site:
© Memoire Online 2000-2013Pour toute question contactez le webmaster
Recherche