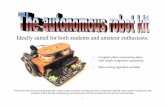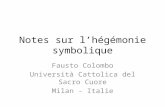CELSA DE L'AUTEUR AMATEUR SUR LE WEB ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of CELSA DE L'AUTEUR AMATEUR SUR LE WEB ...
UNIVERSITE de PARIS IV – SORBONNE CELSA
École des Hautes Études en Sciences de l’Information
et de la Communication
MÉMOIRE DE MASTER RECHERCHE
DE L’AUTEUR AMATEUR SUR LE WEB COLLABORATIF
L’exposition de soi
Sous la direction de M. Francis Yaiche, Maître de Conférences HDR
Gustavo GÓMEZ-MEJÍA Soutenu le15 juin 2007 Note du mémoire : Master 2 Recherche Sciences de l’Information et de la Communication Option « Médias-Signes-Représentations » Année 2006-2007
0
REMERCIEMENTS Je tiens tout d’abord à remercier mon directeur de recherche Monsieur Francis
Yaiche pour son orientation et son soutien dans la réalisation de ce mémoire. De la
même façon, j’adresse mes remerciements à l’ensemble du corps professoral du
Celsa, qui par ses enseignements et échanges tenus au cours de cette année de
séminaires ont stimulé ma réflexion sur différents plans.
Il me faut de même remercier mes camarades de classe pour l’expérience commune
que nous avons partagée, Madame Isabelle de Brosses pour sa bienveillance à
notre égard, Kantuta Quirós et Aliocha Imhoff de l’association Le Peuple qui manque
avec qui j’ai pu collaborer parallèlement à mes recherches, ainsi que Mademoiselle
Eve Dussausaye, ancienne doctorante pour ses discussions sur des questions
sexuelles.
Enfin, j’exprime ma gratitude à Mademoiselle Gaëlle Martine Fillion pour sa solidarité
sur le champ ainsi que ma reconnaissance fantomatique à mon grand-oncle Rafael
Ortiz Gonzalez et à sa veuve Esther qui dans la distance ont su égayer la rédaction
de ce mémoire.
1
SOMMAIRE INTRODUCTION--------------------------------------------------------------------------------------- p.4 I. DE L’AUTEUR-AMATEUR SUR INTERNET--------------------------------------------- p.18 1.1 Autour de l’Auteur : trajectoire d’un écran habité-------------------------------------- p.18 1.1.1. Vues rétrospectives de l’Auteur sur Internet :
De la synthèse homme-machine comme individuation historicisée---------------- p.18
1.1.2. L’Auteur en communauté : le statut de l’Auteur comme expérience sociale----- p.21
1.1.3. L’Auteur et l’Amateur : naissance d’une collaboration--------------------------------- p.25 1.2. L’écran de l’Amateur : éclairages pornographiques du réseau------------------- p.31 1.2.1. De la pornographie comme écologie médiatique---------------------------------------- p.31
1.2.2. Mythologies pornophiles : l’explosion amateur------------------------------------------- p.38
1.2.3. Au rendez-vous des pornographies émergentes ---------------------------------------- p.45 II. L’EXEMPLE PORNOGRAPHIQUE---------------------------------------------------------- p.50 2.1 Xpeeps.com : la fenêtre du voyeur ?-------------------------------------------------------- p.50 2.1.1. Préalables techno-sémiotiques : l’imaginaire du peep show------------------------- p.50
2.1.2. L’Architexte : masque ou corset de l’Auteur-Amateur----------------------------------- p.52
A. Se profiler pour son profil : acheminement de l’Auteur------------------------------- p.54 B. Se mettre en exposition : la galerie de l’Auteur---------------------------------------- p.57
2.1.3 L’Interface et l’Interaction : Du fonctionnement technique aux fonctionnements sociaux--------------------------- p.59
2.2 L’Auteur-Amateur mis à nu : le travail de s’exposer----------------------------------- p.62 2.2.1 Auto-poétique : l’entité identitaire à l’épreuve du regard-------------------------------- p.63
A. L’existence de l’Auteur comme poétique à double détente------------------------- p.64 B. L’Auteur et l’objectif : se donner à voir--------------------------------------------------- p.67
2.2.2 Les blasons anatomiques : rhétoriques du morcellement---------------------------- p.70
A. L’existence de l’Auteur comme rhétorique érotique du morcellement------------p.70 B. Se donner à avoir : du charnel comme pulsion scopique radicale---------------- p.73
2.2.3 Contours culturels : poétique du reflet et du rassemblement ------------------------- p.77
A. L’existence de l’Auteur comme reflet imaginaire-------------------------------------- p.78 B. Se donner à lire : des signes corporels comme filtres du regard------------------ p.80
2
III. PERSPECTIVES CRITIQUES : L’AUTEUR-AMATEUR À L’ÉPREUVE DU QUOTIDIEN--------------------------------- p.84
3.1 L’Auteur et l’Amateur (suite) : le rituel, le régime, le regard------------------------ p.84 3.1.1 De l’Auteur-Amateur comme agent sémio-économique idéal------------------------- p.85
3.1.2 La Propriété et le regard------------------------------------------------------------------------- p.90 3.2 Idéologie de la persona : tensions statutaires------------------------------------------- p.93 3.2.1 L’humain du système, le système de l’humain-------------------------------------------- p.93
3.2.2 Circonstances atténuantes : le corps et l’écran------------------------------------------- p.96 CONCLUSION------------------------------------------------------------------------------------------ p.99 BIBLIOGRAPHIE-------------------------------------------------------------------------------------- p.105 ANNEXES------------------------------------------------------------------------------------------------- p.113 RÉSUMÉ---------------------------------------------------------------------------------------------------p.133 MOTS-CLÉS--------------------------------------------------------------------------------------------- p.134
3
INTRODUCTION
Ce travail, conçu originellement sous un autre titre –Les libertines électroniques : de
la porno-réalité comme mutation de l’érotisme sur Internet– prenait pour point de
départ l’interrogation de certaines pratiques d’exposition de soi liées au
développement de l’Internet collaboratif. Depuis, cette interrogation est demeurée la
pierre angulaire (et inaugurale) de notre réflexion, bien que, au fil de rencontres et
recherches engagées, la nature des réponses qu’elle apporte ait mutatis mutandis
suivi l’évolution du sujet. Ainsi, dans ce mémoire, l’étude de ces pratiques
d’exposition n’obéit plus au but de les analyser en détail à l’aune des différents
genres et langages qui coexistent au sein de l’industrie pornographique. Plutôt que
de vouloir tracer une épopée généalogique du reality porn, ou de prétendre statuer
sur les frontières entre pornographie et érotisme –lieu de toutes les instrumentalités–
, l’objectif principal de cette recherche prend désormais une autre direction : nous
voulons, en effet, à partir d’une étude centrée sur des productions personnelles et
« pornographiques », développer une approche compréhensive du statut de l’Auteur
sur les sites web dits collaboratifs.
Derrière cette reformulation du sujet, qui peut toujours paraître issue d’un parti pris
hygiénique ou pudibond, se joue la pertinence de cette recherche dans le champ
disciplinaire des Sciences de l’Information et de la Communication. Pour cause,
l’explosion des user-created contents1 sur l’Internet contemporain qui confronte notre
regard à une proposition disjonctive : d’une part, elle fait défiler sous nos yeux un
nombre croissant de corpus spécialisés et quasi-prêts à une étude en immanence,
alors que, parallèlement, elle sous-tend des logiques sociales fines –transversales
aux divers supports et domaines– qui absorbent, organisent et encouragent la
production desdits contenus. L’objet de notre recherche est dès lors doublé de cette
tension techno-sémiotique : dans chacune des productions amateur que nous
étudions, les traces de leurs auteurs rencontrent tour à tour les exigences d’une
économie symbolique dans laquelle elles sont insérées. Ainsi, notre volonté
d’aborder cet ensemble de signes numériques et sociabilisés en tenant compte de
1 Aussi appelés User-generated contents (UGC) ce terme décrit les contenus directement générés par les utilisateurs sur Internet.
4
leur spécificité, relativise la place (autrefois primordiale) que nous accordions à
l’hypothèse d’une injonction technologique. De manière générale, nous prenons nos
distances vis-à-vis des déterminismes techniques et des paranoïas panoptistes, pour
voir dans les productions étudiées, des rencontres auteur-dispositif où nous sommes
prêts à repérer ces solidarités entre formes et fins qu’Eco ou encore Petitot ont pu
comparer –toujours avec prudence– aux « nervures du marbre2 ».
Puissent ces remarques préalables, en ce début de questionnement, limiter alors le
spectre du sens dégagé par une problématique qui se bâtit comme suit : en partant
du constat que la place centrale laissée à l’Auteur au sein du web collaboratif
constitue actuellement un appel à la participation sur le mode de l’amateurisme, nous
nous proposons d’interroger ces productions amateur –en l’occurrence
pornographiques– en tant que lieux de tensions où se redéfinit en permanence le
statut de cet auteur. Quel est donc cet auteur donné à voir ? Ses propres productions
(iconiques et textuelles3) sont porteuses d’éléments de réponse, car les marques de
l’Auteur qu’elles véhiculent sont resignifiées par leur insertion dans l’économie du
système : ce quid est qui nous hante se fait dès lors indissociable des usages
sociaux dont font l’objet ces signes. Ainsi problématisée, notre réflexion sur le statut
de cet auteur amateur pornographique –tel qu’il se donne à voir dans ses différentes
productions– est menée dans les pages qui suivent à la lumière de trois hypothèses
principales :
La première d’entre-elles s’intéresse à l’Auteur en tant que subjectivité créatrice,
sous un angle proche de l’auctor qu’envisageaient des approches encore pré-
structuralistes4. Dans cette perspective, notre approche de ses productions,
conçues comme opus singuliers, prend en considération les marqueurs sémiotiques
témoignant de son accès à une position d’auctorialité : pour prendre l’exemple
2 Petitot, Jean, « Les nervures du marbre. Remarques sur le “socle dur de l’être“ chez Umberto Eco » introduction à l’ouvrage Au nom du sens. Autour de l'œuvre d'Umberto Eco, sous la direction de Paolo Fabbri et Jean Petitot, Grasset, 2000 3 Dans un premier temps, une prise en compte des productions audiovisuelles avait été envisagée. Cependant, sur le dispositif étudié l’usage de vidéos demeurant encore rare, nous avons pris le parti de nous concentrer sur les productions iconiques et textuelles du travail auctorial. 4 Nous nous inspirons du cours d’Antoine Compagnon sur la « Généalogie de l’auteur » accessible sur http://www.fabula.org/compagnon/auteur
5
commun d’un autoportrait exhibitionniste, nous nous intéresserons dès lors aux traits
sémantiques qui le revendiquent comme « propre », aux procédures par lesquelles
l’auteur y signe et affirme la particularité de son œuvre. Les discours autoréférentiels
sur la matérialité du processus créatif et les éventuels distancements entre une
« existence d’auteur » et une existence ‘autre’ concernent de même cette première
piste interprétative, dans laquelle l’Auteur –étant initiateur d’une auto-poïèse–
assume son statut en nom propre.
Notre seconde hypothèse accorde une emprise moindre au statut de notre Auteur-
Amateur : là où l’hypothèse antérieure constitue un degré zéro du processus de
production, cette fois-ci nous nous proposons de corréler l’autonomie de notre objet
aux usages sociaux en vigueur et aux potentialités du dispositif. L’auteur, ainsi
conceptualisé, n’est plus auctor par lui-même, mais plutôt internaute livré à l’exercice
d’un authorship encadré par des médiations techno-sémiotiques. Dans cet ordre
d’idées, ses productions nous interpellent par leur teneur indicielle sur la relation que
l’auteur entretient avec le support auquel il les destine : la conception logicielle des
prérogatives de l’auteur, la confection de contenus sur mesure pour certains usages
rituels ou la présence de manifestations méta-discursives sur les médiations en
question, sont autant de points saillants dans cette optique d’étude. Nous sommes
face à une hypothèse qui postule que le statut de l’auteur est davantage subsidiaire
des conditions de participation d’un web collaboratif « commanditaire » que des
initiatives subjectives de notre première piste.
Enfin, notre troisième hypothèse confronte l’Auteur et ses productions, non pas au
quant-à-soi, ni à ce qui est formalisé par le dispositif, mais plus spécifiquement à
l’univers culturel dans lequel ils viennent s’insérer. De ce fait, les contenus qu’il
fabrique ne sont plus ni opus singuliers, ni les denrées nécessaires du « Web 2.0 » :
réinscrits dans une circularité du sens, ils apparaissent à nos yeux comme des
imageries. Cette approche sous-tend le statut d’un auteur avant tout dépositaire de
codes culturels dont la mise à l’œuvre garantit à ses productions une valeur
réflexive : dans cette perspective nous nous intéressons aux phénomènes
d’identification vis-à-vis de certaines composantes sémantiques, aux formes subtiles
de la connotation et à la différenciation endogène entre variétés pornographiques.
6
Derrière l’assemblage de matières signifiantes ayant lieu dans chacun des espaces
personnels étudiés, le statut de l’Auteur est ainsi le lieu d’une tension tripartite : tour
à tour, dans ces productions complexes que l’internaute produit, fournit et/ou colore,
des signes s’intègrent aux corps et des procédures se transforment en usages. A
l’aune des trois hypothèses que nous venons d’énoncer, et des rapports de force
qu’elles induisent sur notre objet d’étude, la volonté de cette recherche est de
théoriser, en tenant compte de la spécificité de notre exemple, la place assumée par
l’individu dans un web sémiotique- et socialement voué à être de plus en plus dense.
1. POSITIONNEMENT DE CETTE RECHERCHE L’ancrage que nous avons donné à notre problématique ainsi que les hypothèses de
recherche qu’en conséquence nous venons de formuler, positionnent d’emblée le
sujet de cette étude dans la tradition interdisciplinaire qui caractérise les Sciences de
l’Information et de la Communication. Les exigences épistémologiques liées à une
telle construction de notre objet, impliquent cependant un travail minutieux de
délimitation théorique par rapport aux acquis dont d’autres disciplines peuvent se
vanter dans leurs approches respectives d’un champ pornographique par nature
pluridimensionnel. Nous tenons en effet à défendre la pertinence d’une approche
SIC, jusqu’ici relativement absente dans les polémiques environnant ce sujet, si l’on
tient compte de la place privilégiée que certaines approches politistes,
philosophiques, sociologiques ou féministes se voient accordée : c’est vis-à-vis de
ces courants de pensée traditionnellement enracinés dans le domaine, que notre
approche retrouve sa spécificité. Pour illustrer cette problématique d’interdiscursivité
scientifique, nous procéderons à une redéfinition des principaux termes de cette
recherche en les situant par rapport à d’autres tissus notionnels susceptibles d’être
convoqués.
a) Auteur5 : Malgré la complexe structure triadique dans laquelle nous déclinons ce terme au fil
de nos hypothèses, « auteur » reste un terme transversal aux différentes approches 5 Dans le texte, nous écrirons « l’Auteur », et « l’Amateur » en donnant à ces lettres majuscules le sens d’une figure idéelle qui est au centre de ce mémoire. A contrario, les mêmes termes en minuscules réfèreront à un auteur ou un amateur en particulier. Cette précision textuelle s’inspire de la distinction analogue que Jorge Luis Borges faisait en parlant des personnages de l’une de ses histoires : « les compères sont des individus et ne parlent pas toujours comme le Compère, qui lui est une figure platonicienne » in Historia Universal de la Infamia, Alianza Editorial, Madrid, 1974, p.10
7
ci-dessus mentionnées. Notre préoccupation sur le statut de l’Auteur actualise donc
les acquis d’une théorie littéraire où la notion peut être tantôt l’objet d’études
transhistoriques que de décompositions post-structuralistes comme celles de
Barthes et Foucault6. Ces dernières nous guident dans l’analyse de nombreuses
productions problématiques où l’auteur tend ouvertement au générique ou à
l’anonymat.
En contrepoint de cet input littéraire, l’acception juridique du terme doit être
considérée : mobilisée par les notices « you must be 18 or over to enter this site7 » et
d’autres rappels aux « conditions d’utilisation » du web collaboratif pour adultes,
cette conception de l’Auteur quant à elle fait abstraction des problèmes de sens
signalés précédemment dans une perspective contractualiste de responsabilisation
du sujet de droit8.
La pensée certalienne peut enfin faire le pont entre ces deux pôles de l’Auteur en
question : gestionnaire de son sens tenu pour responsable dans l’espace de l’autre,
notre auteur assume pleinement cette ambivalence pour jouer (ou déjouer) son
propre rôle dans le cadre d’une historicité quotidienne.
b) Amateur : Amateur est sans doute le terme le plus problématique de notre énoncé. Catégorie
fonctionnelle au sein d’un discours de la compétence technicienne qui oppose
l’Amateur au Professionnel, l’amateurisme est devenu un axe de recherche de plus
en plus investi par les chercheurs venus de la Sociologie dite de l’Innovation. Ainsi,
dans la préface à l’ouvrage d’Antoine Hennion sur l’amateur musical9, l’on peut voir
6 Aujourd'hui, les supports collaboratifs rendent urgente cette question : quelle acception peut-on encore donner à une notion critique comme celle d'auteur quand elle est confrontée à la variété et à la diversité des expériences et pratiques culturelles ? 7 « Vous devez avoir au moins 18 ans pour accéder à ce site » NdT. Cet âge correspond à l’âge de la majorité sexuelle (age of consent) dans la plupart des juridictions américaines. 8 Ceux-ci sont les termes de l’engagement de l’utilisateur dans la cession des droits d’auteur : By publishing, displaying, posting or otherwise disseminating any messages, text, files, images, photos, video, sounds, profiles, works of authorship, or any other materials whatsoever (collectively the “Content”) on or through the Service, you hereby grant to XPeeps a perpetual, non-exclusive, fully-paid and royalty-free, worldwide license 9 Hennion, Antoine et alii, Figures de l’amateur, Formes, Objets et Pratiques de l’amour de la musique aujourd’hui, La Documentation Française, 2000.
8
établie une stratification entre l‘Amateur, le Connaisseur et le Professionnel, qui est à
la base des représentations communes sur le terme. La gêne que nous éprouvons
vis-à-vis de cette approche vient de la distance qu’elle induit entre l’Amateur et l’objet
aimé. Les ‘totemisations’ et dissymétries excluantes qui en résultent rendent
inopérante cette conception dans le cadre d’une étude qui voit sans cesse cohabiter
un auteur et un amateur dans une même personne.
A ce premier distinguo interdiscursif il faut ajouter une deuxième acception du terme,
véhiculée en large mesure par la doxa réseautique et la presse autour de l’explosion
du « web 2.0 » : dans cette perspective, plus que d’amateurisme il sera question
d’amateurisation10. En effet, indépendamment du domaine, le sens de cette
amateurisation recouvre désormais l’accès massif d’une population d’internautes à
des positions énonciatives et productives qui faisaient autrefois l’objet d’un
cloisonnement professionnel. Cette piste terminologique nous intéresse en ce qu’elle
reconnaît à l’amateur un statut actif indissociable des médiations techno-
sémiotiques.
Si notre conception de l’Amateur dans cette étude s’inspire ouvertement de cette
acception anglo-saxonne et ‘cybernautique’ du terme, la définition que nous sommes
en train d’établir serait loin d’être complète faute d’une prise en compte des
connotations qu’en pornographie peut revêtir le mot amateur. Originellement utilisé
comme adjectif pour qualifier des productions caractérisées par l’absence de paie au
titre de performances sexuelles, le terme a connu depuis les années 70 une
évolution intéressante. Il est sorti de la dichotomie amateur/professionnel pour
adopter peu à peu un sens autonomisé : étant donné les limites de la ‘pornographie
salariée’, et la plus-value qu’il traduisait en termes d’une authenticité fantasmée, le
film amateur –contemporain de la caméra de 16 mm– a pu progressivement occuper
une position valorisante au sein du marché des biens symboliques érotiques11. Cette
10 A ce sujet, la discussion entre deux célèbres bloggeurs américains Tom Coates et Clay Shirky portant sur The Mass Amateurisation of (Nearly) Everything accessible sur www.plasticbag.org cristallise des points de vue communément admis dans la doxa réseautique. 11 Cette évolution des productions pornographiques est étudiée en details dans l’article d’Eric Schaefer "Gauging a Revolution: 16mm Film and the Rise of the Pornographic Feature". Cinema Journal - 41, Number 3, University of Texas Press, 2002, pp. 3-26, accessible sur la base de données http://muse.jhu.edu/
9
évolution a participé au glissement sémantique opéré sur l’appellation amateur, qui a
dès lors cessé de se définir en termes de place (comme il est encore défini dans les
acceptions précédentes) pour être avant tout reconnu en termes d’esthétique et de
code. Par la suite, l’amateur des vidéos privées et non commerciales, parodié et
instrumentalisé, a été promu en genre (« Amateur porn ») puis en catégorie
marketing de l’industrie du X.
Dans le cadre spécifique de notre recherche, la question du statut de l’Amateur en
pornographie fera l’objet d’un développement plus ample et critique ; pour ce qui est
de sa définition au sein de notre énoncé, nous retiendrons qu’il fait nécessairement
couple avec auteur que ce soit en tant qu’amator fréquentant des productions ou que
réalisateur d’un langage aficionado.
c) Web collaboratif : Ayant à l’esprit les enjeux sous-jacents à l’émergence de la notion de « web 2.0 »
telle qu’elle a été conçue et popularisée par l’agence de communication américaine
O’Reilly Media12, nous optons volontiers pour l’appellation « web collaboratif » pour
référer aux sites Internet qui nous occupent. Ce choix lexical privilégié dans l’énoncé
de notre recherche témoigne d’une prise de conscience face à l’instrumentalisation
dont le syntagme « web 2.0 » fait l’objet en permanence13. Loin de l’enthousiasme
suscité par cette « nouvelle génération » de sites dans le discours de publicitaires,
marketeurs, et programmateurs en informatique, notre approche du concept l’inscrit
dans une continuité logique des usages et supports techniques sans chercher à
accentuer un prétendu point de rupture.
De façon concrète, nous qualifions de ‘collaboratifs’ les sites couplant contenus
crées par l’utilisateur et pratiques de social networking. Le site Xpeeps.com (que
12 La définition la plus récente que cette agence donne à sa création est la suivante : "Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the internet as platform, and an attempt to understand the rules for success on that new platform. Chief among those rules is this: Build applications that harness network effects to get better the more people use them." Tim O’Reilly sur http://radar.oreilly.com/ le 12/10/06. 13 Dans notre pré-enquête, nous avons assisté au cycle de conférences sur le « Web 2.0 », que l’Association d’Agences Conseils en Communication avait intitulé « Révolution », dans le cadre de la 1Oème édition de la Semaine de la Publicité tenue au Palais de Tokyo, Paris, 27 au 30 novembre 2006.
10
nous présenterons en détail dans les pages suivantes) étant un dispositif clone de
Myspace14 fonde notre analyse sur un exemple archétypique de ce qu’est cette
collaboration en ligne : un objet techno-sémiotique qui derrière un nombre
considérable de « discours d’escorte15 » accueille une polyphonie dense dont il tire
sa valeur, assure l’indépendance des matières signifiantes pour en faire des objets
de libre circulation et double ses « signes passeurs » de liens sociaux.
d) Pornographique : En conclusion de cette tentative de définition des termes figurants dans notre
énoncé, pornographique est l’adjectif venu qualifier notre exemple. La pornographie
telle qu’elle est ordinairement définie en fonction du caractère « excitant et explicite »
de ses images nous pose le problème suivant : dans une recherche portant sur le
statut de l’Auteur, cette conception des productions pornographiques les circonscrit
comme si elles étaient un ensemble monolithique et nous contraindrait in fine à
l’impasse sémiotique de devoir trancher sans finesse les complexes questions de
l’intentionnalité auctoriale. Or, tel que nous le soutenons dès le départ, nous sommes
davantage intéressés par la possibilité de neutraliser la composante porno- pour
mieux étudier sa graphie depuis la Communication.
Ainsi conceptualisée, cette pornographie, par nature polyphonique et susceptible de
stylisations, n’admettrait pas non plus certaines lectures émanant de sa critique
féministe, qui se focalisent sur les rapports de pouvoir qu’elle représente au
détriment de la construction sémiotique de ses différents codes. Dans cet ordre
d’idées, le terme en question recouvre ici des productions de différents genres (à
dominance amateur), jouissant de la liberté d’expression caractéristique du web
collaboratif : à savoir un éventuel contrôle a posteriori sous la forme d’un clic sur le
lien « report inappropriate content 16». Cette conception fluctuante et autorégulée
semble la plus apte pour notre sujet car elle tolère la plus grande diversité du signe
tout en nous rappelant ses limites purement conventionnelles. Tout compte fait,
14 http://www.myspace.com et http://www.xpeeps.com pour les deux sites mentionnés. 15 Nous empruntons ces notions à l’ouvrage collectif Lire, écrire, récrire, Objets, signes et pratiques des médias informatisés, réalisé sous la direction de E. Souchier, Y. Jeanneret, J. Le Marec, Centre Pompidou-BPI, Paris, 2003. 16 « Signaler un contenu inapproprié » NdT
11
pornographique reste ici l’interprétant cognitivement le plus économique pour référer
à un ensemble hétéroclite de nudités signifiantes.
Le travail de définition que nous venons d’effectuer ne prétend aucunement arrêter le
sens des termes analysés, au contraire il a pour but de mettre en évidence la
richesse sémantique liée à leur « limitrophie17 » dans l’élaboration du cadre
théorique de référence de cette recherche. Les phases de problématisation et
conceptualisation de notre travail dont rendent compte les idées jusqu’ici
développées constituent les fondements d’un plan d’expérimentation mis à l’oeuvre
tel que nous le présentons ensuite.
2. PLAN D’EXPÉRIMENTATION a) Pré-enquête A titre récapitulatif nous rappellerons les temps forts de la pré-enquête que nous
avons menée sur le terrain. Cinq rencontres ont pu déplacer ponctuellement notre
regard, chronologiquement elles ont eu lieu dans l’ordre suivant : ( 1 ) La journée
d’études intitulée « Éditer l’intime » organisée par la Bibliothèque Nationale de
France qui, du diariste au blogueur, a pu traiter en diachronie d’un statut particulier
de l’auteur en fonction du couple intime/extime et des supports qu’il investit, nous
fournissant de nombreux éléments de réponse à ces questions depuis
l’interdisciplinarité. ( 2 ) Dans le cadre de la Semaine de la Publicité, que nous avons
déjà évoquée brièvement dans les pages précédentes, les conférences au sujet de
la « mutation créatrice » provoquée par le « web 2.0 » en tant que discours extra-
universitaire et vecteur de l’air de notre temps. ( 3 ) La rencontre du doctorant
Mathieu Trachman qui prépare une thèse à l’EHESS sur le thème « Filmer
l'hétérosexualité : Sociologie du cinéma pornographique » sous la direction de Rose-
Marie Lagrave et Eric Fassin a pu, a son tour, nous éclairer sur une réalité
sociologique du secteur dans une posture critique féministe. ( 4 ) Les conversations
17 Barbarisme d’origine hispanique dans ma bouche, miraculeusement légitimé en tant que néologisme sous la plume de Jacques Derrida : « Contre les évidences doxiques et métaphysiques, quant à la netteté, la linéarité de cette séparation, il propose ce qu’il nomme une limitrophie (de trephein, nourrir, en grec). Il s’agit, dans une topique révolutionnaire, de penser ce qui avoisine les limites, ce qu’elles nourrissent, font croître à leurs bords, et qui les compliquent indéfiniment. Les limites, dira-t-il, sont feuilletées, plurielles, sur-pliées, hétérogènes, ne permettant de déterminer rien qui soit complètement objectivable. » E. de Fontenay in Un jour Derrida, Actes du colloque tenu sur l’auteur au Centre Pompidou le 21 novembre 2005.
12
que j’ai pu avoir avec les organisateurs du Festival de Cinéma Queer de Paris qui
vont dans leurs déconstructions jusqu’à parler de post-pornographie et m’ont fait
découvrir les travaux sur le Netporn des chercheurs de l’Institute of Network Cultures
d’Amsterdam18. ( 5 ) Enfin, le dialogue d’Edgar Morin avec le professeur d’esthétique
François Soulages à la Maison Européenne de la Photographie tenu le 13 février
2007 a donné une épaisseur anthropologique à notre regard dans la lignée du
complexus comme complément de certaines idées rencontrées dans son œuvre
auparavant. Parallèlement à ces rencontres, sur la partie informatisée de notre
terrain, nous avons étudié la faisabilité de cette étude sur une dizaine de sites de
reality-porn dans une phase encore exploratoire, avant de pencher pour le choix
jacobin sur lequel se fonde le plan d’expérimentation en vigueur.
b) Choix des outils méthodologiques
Dès la fin de cette pré-enquête notre étude s’est centrée sur le site Xpeeps.com,
décision que nous justifions par rapport à l’orientation de notre problématique. En
effet, voulant répondre à la question du statut de l’Auteur Xpeeps réunissait un
nombre considérable de conditions favorables à l’étude. Là où d’autres sites
ressemblent encore à des forums ou à des annuaires, Xpeeps présente une
structure caractérisée par une décentralisation généralisée des places d’énonciation
au profit d’espaces personnels indépendants -à la Myspace- dans lesquels l’individu
est ‘souverain’ de publier ses propres contenus et de faire ses propres choix de
personnalisation en étant reconnu comme auteur. Cette nature collaborative ajoutée
à sa gratuité intégrale annonçait une effervescence socio-sémiotique suffisante à
notre cas d’étude. Par ailleurs, ce choix nous assure toujours une compréhension
approfondie, même si relative, préférable aux risques de dispersion ou généralisation
forcée, éventuellement parasitaires dans une approche comparatiste.
Ayant décidé ainsi de notre source documentaire principale, l’étape suivante a été de
déterminer quelle serait l’unité employée dans le recueil de données. Suivant le
découpage proposé par le site, nous avons opté pour un corpus fait de profils
(profiles). Ces espaces personnels crées par les internautes membres de Xpeeps se
déclinent en deux temps (en deux clics) : une page frontispice (le profil lui-même), et
18 http://www.networkcultures.org/netporn/
13
une « photo gallery » susceptible d’accueillir jusqu’à 16 photos19. Le corpus sur
lequel nous travaillons actuellement comporte 45 de ces profils avec leurs galeries
respectives. La modalité de sélection de ces profils a été la suivante : les trois
premières unités ont été prélevées suivant la suggestion « cool new people » qui
présente aléatoirement en page d’accueil les trois derniers membres inscrits sur le
site. Par la suite, à partir de chacun de ces membres, nous avons prélevé le profil
apparaissant en première position parmi ses amis, et avons répété ces procédés 3
fois subséquentes en nous éloignant dans les cercles relationnels. Répétée trois fois
à deux semaines d’intervalle à partir du mois de janvier 2007, cette procédure était la
seule apte à garantir une véritable représentativité de notre corpus car elle combine
une dose d’aléatoire compensée par le suivi de la sociabilité en arborescence
proposée par le site. Le schéma suivant illustre bien la modalité de sélection mise en
œuvre.
> Niveau 1« Cool New People » > Niveau 2 : Ami 1 > Niveau 3 : Ami 1 de l’ami > Niveau 4 : Ami 1 de l’ami de l’ami > Niveau 5 : Ami 1de l’ami de l’ami de l’ami
Début janvier
o – o –o | | | o o o | | | o o o | | | o o o | | | o o o
Mi- janvier
o – o –o | | | o o o | | | o o o | | | o o o | | | o o o
Début février
o – o –o | | | o o o | | | o o o | | | o o o | | | o o o
Il faut rappeler que c’est par l’exploration intuitive des « amis des amis » que sur les
sites de social networking l’internaute parvient à tisser des liens. Les écueils que
nous voulions éviter par ce partage entre le point de départ et son correctif étaient de
ne pas rester dans un cercle restreint de friends, ni non plus dans un cercle qui serait
dominé par les nouveaux utilisateurs. Outre cette justification fondée sur la nature de
notre problématique ainsi que sur les us et coutumes de la socialisation en ligne,
cette constitution du corpus repose sur une application des hypothèses qu’en
psychologie sociale, l’américain Stanley Milgram a développées sous le nom de
19 Le dispositif ayant évolué lors de notre recherche, actuellement, chaque galerie accueille jusqu’à trois pages de photos, chacune hébergeant une vingtaine d’unités.
14
« Small World Phenomenon20 » : son travail empirique sur les chaînes de
connaissances interindividuelles (acquaintances) comme mécanisme de réduction
de complexité du monde a un grande intérêt méthodologique dans des travaux
portant sur des objets réticulaires comme celui-ci.
Les données recueillies font en ce moment l’objet d’un traitement analytique
éclectique entrepris sur plusieurs fronts. En effet, l’assemblage de matières
signifiantes ayant lieu sur chacun des profils étudiés nous a invité à effectuer d’abord
une cartographie de leur présence dans chaque espace avant de décider des outils
susceptibles d’être employés. En fonction de leur aptitude à traiter les diverses
natures des substances expressives investies par nos auteurs amateurs, les choix
méthodologiques retenus ont été les suivants :
1. Le textuel
Les matières textuelles présentes dans chaque espace personnel étudié regroupent
trois types d’éléments : pseudonymes, textes de présentation de soi et
commentaires. Ainsi, tenant compte des valeurs de chacun de ces éléments, nous
confrontons les premiers d’entre eux à une analyse lexicologique parvenant à une
modélisation des nicknames très utile dans la compréhension des mécanismes par
lesquels l’auteur se nomme lui-même. En ce qui concerne les textes de présentation
de soi, ils font l’objet d’une analyse de discours traditionnelle en vue de dégager les
stratégies représentationnelles à l’œuvre dans la mise en scène de soi. Enfin, les
commentaires (comments) en tant qu’échange de parole nous intéressent à l’aune
d’une analyse de l’énonciation capable de révéler la place assumée par les
interlocuteurs et les implicites des réactions autour des productions proposées par
l’auteur.
2. L’iconique
L’iconique est la substance expressive centrale de notre étude. Il concerne
notamment la photo principale de l’auteur (sa display image), et les images qu’il
présente dans sa galerie. Dans cette perspective, ces catégories font l’objet d’une
analyse sémiotique de tradition barthesienne : en fonction de leur construction c’est
20 Milgram, Stanley, The Individual in a Social World, Essays and Experiments, McGraw-Hill, 1992
15
plutôt l’auteur de la Chambre claire, des analyses sadiennes ou de la rhétorique de
l’image que nous convoquons. Sur ces deux niveaux, les analyses d’Eliseo Verón
sur la sémantisation du corps sont aussi une source d’inspiration. Les bannières
publicitaires en tête de page, bien qu’iconiques, ne feront pas l’objet d’une analyse
sémiotique détaillée.
3. Le dispositif
Enfin, une prise en compte du dispositif, fondement commun de nos 45 profils, prend
la forme d’une analyse techno-sémiotique destinée à mettre en lumière les
contraintes imposées à notre auteur, la préfiguration de son statut et l’ergonomie de
ses échanges. Dans sa forme, elle s’inspire des travaux que Valérie Jeanne Perrier
a pu mener sur la dimension normative (« architextuelle ») des Systèmes de
Management de Contenu (CMS)
***
Dans cette étude du statut de l’Auteur-Amateur, le corps de notre réflexion se déploie
sur trois parties : la première est celle de la situation de l’Auteur en question dans
son contexte d’émergence, historiquement lié à l’évolution du monde informatique.
Dans cette première étape, nous étudierons les solidarités existantes entre l’Auteur
et les dispositifs techniques de façon à comprendre la nature changeante du travail
auctorial et les implications du web collaboratif sur ce dernier, notamment à travers
l’apparition d’une figure de l’Amateur consolidée (1.1). En parallèle, nous suivrons
l’évolution du discours social environnant la pornographie sur Internet (1.2). Dans
une deuxième partie, nous interrogerons l’exemple du web collaboratif
pornographique dans la continuité des deux premières thématiques développées. La
structure de cette partie comprend d’abord les résultats de notre analyse du dispositif
sur la place qu’il préfigure pour l’Auteur (2.1), avant de confronter les constructions
auctoriales étudiées à l’aune de chacune de nos hypothèses (2.2). Enfin, nous
effectuerons une ouverture critique à partir des figures de l’Auteur-Amateur observé,
de façon à donner une portée théorique extra-pornographique à son statut réel (3.1
et 3.2). Après nos conclusions, le corps du mémoire présente en annexe les
16
références employées, et nos outils d’analyse Enfin, un CD annexe21 contenant les
captures d’écran correspondant à l’objet étudié propose au lecteur une vue
d’ensemble de l’expérience menée.
21 Cf. Annexe 8 p.132 Post-face, notice explicative sur le CD
17
I. DE L’AUTEUR-AMATEUR SUR INTERNET
1.1. AUTOUR DE L’AUTEUR : TRAJECTOIRE D’UN ÉCRAN HABITÉ
Autour du feu, de la parole, du livre, de la presse ; autour de la radio, de la télévision,
autour du serveur enfin. Il serait contraire à l’objet et à l’esprit de ce mémoire de
mettre en exergue une quelconque tentative de synthèse de l’histoire des médias.
Sous couvert de contextualisation, ce faisant on sous-tend la plupart du temps une
lecture linéaire et technocentriste des objets-médias, au détriment de lectures tout
aussi envisageables sous un angle davantage sémiotique et social. Dans cette
perspective, de ce bref ‘incipit’ en italiques, nous ne garderons volontiers que l’autour
de, évitant d’insister sur des listes subséquentes d’exploits et d’espoirs techniciens
qui nous empêcheraient d’accorder le fil conducteur de notre réflexion au
peuplement par l’Auteur de la « galaxie Internet22 ».
1.1.1. Vues rétrospectives de l’Auteur sur Internet : De la synthèse homme-machine comme individuation historicisée.
En tant que « cause première ou principale d’une chose », « inventeur, initiateur ou
responsable23 » de la même, la figure de l’Auteur dans sa définition courante,
commune à toutes langues qui la reçurent par voie latine, offre en effet un éclairage
différent à l’heure de penser les processus ayant lieu autour des écrans et des
machines interconnectées. Pour inscrire ce questionnement d’emblée dans
l’Informatique, nous citerons un exemple de Douglas Hofstadter, professeur en
sciences cognitives, célèbre pour son livre Gödel, Escher, Bach. Dans son article
« Le médium cerveau est-il remplaçable ? 24 », Hofstadter raconte ses débuts dans
la programmation sur un énorme ordinateur Burroughs 220 : « Je frissonnais à l’idée
de me trouver, peu ou prou, en communication avec un ‘autre mathématicien’ » écrit-
22 Nous référons à l’ouvrage La Galaxie Internet de Manuel Castells (Fayard, 2002) pour une lecture historique recentrée sur les aspects techniques de l’évolution d’Internet entre 1962 et 1995. Par ailleurs, il faut rappeler que ce titre fait lui-même écho à La Galaxie Gutenberg de Malcolm McLuhan, ouvrage qui postulait dans un esprit plus proche du notre les bases d’une lecture « écologique » de l’histoire des médias. 23 D’après le Trésor de la Langue Française Informatisé : http://atilf.atilf.fr/ - entrée Auteur. 24 Paru dans la Revue Médium n°9, décembre 2006
18
il sur son expérience, en allant jusqu’à comparer les productions de la calculatrice
géante des années 1960 à celles d’« un esprit véritable, quoique électronique ».
« Bien sûr que c’était moi qui écrivais tous ces programmes –poursuit-il– (…) mais
cela n’empêchait pas que j’eusse parfois l’impression que le 220 mentalisait
réellement au cours de son travail forcé ». Ce témoignage de Hofstadter, au-delà de
son ton éminemment anecdotique, soulève à nos yeux un problème intéressant,
transversal à toute relation homme-machine : la question de la position. Car bien que
Hofstadter ait parfaitement conscience d’être l’Auteur –la cause, le responsable
programmateur– de ses calculs, l’ordinateur semble de toute évidence transcender la
position de simple mécanisme téléologique qu’en Cybernétique on lui accorderait. A
l’origine de cette impression de « machine spirituelle » se trouve l’existence d’un
langage informatique certes précaire, mais se prêtant déjà une première métaphore :
celle d’une situation d’énonciation où la réactivité de la machine –calquée sur les
attentes de la triade ego-hic-nunc– donne lieu à cette impression profondément
étrange pour l’Homme qui, procédant par couplage de positions, finit par projeter sur
la machine la figure d’un co-énonciateur. Il épouse une machine autrement
célibataire25. C’est le début d’une solidarité discursive entre le mécanisme et
l’Auteur.
Ainsi préfigurée, cette solidarité prendra une forme concrète lorsque les ordinateurs
seront mis en réseau : là où on n’aurait pu voir que des terminaux informatiques en
interconnexion, l’aspect technique sera progressivement atténué par des marqueurs
auctoriaux, à commencer par un nom. Dans cette perspective le choix d’un nom
d’utilisateur (login) équivaudra au baptême d’un auteur désormais solidarisé à une
adresse IP : d’une part une marque de son identité, d’autre part l’identifiant de son
équipe, associés par le caractère @ comme les faces de la feuille de papier
saussurienne26. Inscrire le moi à la machine sous la forme d’un nom. Geste
25 Le thème de la machine célibataire était très populaire au début du XXème siècle : il postule l’idée d’une machine ou d’un appareil qui serait autosuffisant, qui n’aurait plus besoin d’un autre acteur pour se produire. Une part de l’œuvre de Marcel Duchamp (de qui il sera question plus loin) y fait référence. 26 Sur le site de son centre de recherche BBN Technologies, Ray Tomlinson, inventeur de l’e-mail, explique son choix du signe @ pour séparer username et host au sein d’une même entité : « He needed a character that would not appear in any host or individual name. The @ sign didn't appear in names, so there would be no ambiguity about where the separation between login name and host name occurred. The character also had the advantage of meaning "at" ». Il s’agit donc d’un signe interdit à l’Auteur aux yeux du système qui en outre avait l’avantage de
19
personnel de nommer et se nommer, accentué par la complexité sociale croissante
du réseau ainsi que par le développement d’interfaces où l’Auteur n’était plus
programmateur mais la figure centrale d’une métaphore communicationnelle. Qu’il
s’agisse du « courrier » ou de la « salle de conversation », nous sommes dès lors
entrés dans un régime de visibilisation de l’Auteur, de personnification des kilo-octets
de l’autre, de cet autre pour lequel nous ne sommes que pixels.
C’est toute la question des pixels auctorialisés, ceux qui se trouveront investis par
des subjectivités reconnaissables, susceptibles de produire un effet de présence
personnelle en opposition à ce qui paraît strictement logiciel. Dans cet ordre d’idées,
certains énoncés métadiscursifs automatiquement générés tels « Aurore.Dupin a
écrit : » en début de mail, ou « **Julien13 a rejoint la conversation** » dans un
chatroom prennent tout leur sens : ils semblent délimiter l’espace discursif logiciel et
le personnel en donnant un cadre aux énoncés ‘proférés’. La place centrale est celle
de l’Auteur : on peut toujours savoir qui parle (de façon moins essentialiste que
formelle), on peut identifier à l’écran qui est l’entité responsable de tels ou tels pixels.
On retrouve ainsi dans la figure de cet Auteur solidarisé à sa machine, deux traits
caractéristiques de ce que Michel Foucault en 196927 appelait la fonction auteur.
D’abord, une dimension classificatoire, celle qui permet de regrouper un ensemble
de signes sous un même nom, créant un dedans et un dehors (les délimitations
discursives dont nous parlions) et, de façon complémentaire, une dimension
projective qui nous permet de voir derrière ces mêmes ensembles une figure idéale,
celle de l’Auteur comme garant d’une « unité stylistique », d’un « champ de
cohérence ». Hormis ces deux points, nous nous garderons d’exporter dans notre
étude d’autres développements de cette théorie foucaldienne : sa dénonciation de
l’Auteur comme simple fonction attachée à un certain type de textes, définie par des
« pratiques institutionnelles historicisables », paraît difficilement adaptable à un
domaine autre qu’une Littérature conçue comme un système discursif transhistorique
idéologiquement déterminable. Néanmoins, nous garderons cette inquiétude pour fonctionner comme « à », préposition locative le situant. The @ sign – Icon for the digital age : http://bbn.com/Historical_Highlights/@sign.html 27 Foucault, Michel " Qu'est-ce qu'un auteur ? ", 1969, in Brunn, Alain, L’Auteur, texte VI Flammarion, 2001, pp.76-82
20
remettre en perspective cette existence de l’Auteur sur Internet, au-delà de ce qui est
concrètement contextualisable par des critères formels encodés sur une page ou au
cours d’un échange.
Rétrospectivement, l’assimilation des codages sémio-pragmatiques de l’auctorialité
apparaît comme la condition cognitive sine qua non de la représentabilité
informatique, non plus d’une situation élémentaire d’énonciation, mais d’une série de
complexes situations communicationnelles. Ainsi, au fil de deux décennies de
sociabilité en ligne, l’habitus de l’internaute a su intégrer progressivement les
logiques d’individuation qu’Internet met à l’œuvre pour se rendre intelligible en tant
que monde social. Entre 1960 et nos jours, l’acceptation de la machine comme
prothèse –loin de toute science fiction– est devenue un standard préalable au
devenir individu sur Internet ; de la même manière que l’exclusion numérique
fabrique des non-personnes, symétriquement ces individus ne peuvent exister que
dans la mesure où ils se livrent à l’exercice auctorial qui les rend partenaires de ce
monde social. Dans un régime du type « esse est percipi28 » comme celui de
l’Internet contemporain, il faut tour à tour coloniser les serveurs de ses propres kilo-
octets et entacher les écrans de ses propres pixels. Il faut, autrement dit, mener
l’expérience subjective d’être son propre auteur pour n’exister qu’en étant reconnu
en tant que tel.
1.1.2. L’Auteur en communauté : le statut de l’Auteur comme expérience sociale
La question du couplage homme-machine comme genèse d’un auteur individué, telle
que nous l’avons exposée, ne saurait prendre tout son sens à défaut d’une projection
effective dans les différents univers sociaux qu’héberge le réseau. Dans cette
perspective, l’E-mail, l’IRC29 et les messageries instantanées, comme exemples
primaires de l’exercice auctorial, ont joué un rôle primordial dans l’intériorisation chez
l’internaute d’une figure réflexive répandue de l’internaute comme producteur, ne fût-
28 Dans le dire de l’évêque George Berkeley : « Être c’est être perçu ». 29 Internet Relay Chat : protocole de chat en temps réel ayant développé le concept de salles de conversation (chatroom) très populaire dans les années 90.
21
ce qu’au degré zéro de producteur d’une parole informatisée, d’informateur parolier.
Ré-apprendre à écrire et à converser de manière ponctuelle depuis son terminal, a
été en effet une étape nécessaire pour asseoir le rapport utilitariste qu’est celui d’un
auteur à une technologie dans un premier temps. Ce type de rapport, appelé par
d’aucuns « instrumental30 », prédomine encore chez certains internautes pour qui
Internet demeure essentiellement un mode d’accès au journal après révision
routinière d’une boîte mail et réponse éventuelle à quelques courriers, pour n’en
donner qu’un exemple. A cette hauteur du mémoire, nous opterons cependant pour
laisser ces auteurs de côté, pour ne nous intéresser qu’à un autre type d’auteurs
dont l’expérience d’Internet n’est plus celle de l’usage ponctuel d’un outil
communicationnel, mais plutôt celle d’un moyen d’expression parfaitement intégré
dans leur Lebenswelt, basculant ainsi vers un monde vécu à plénitude dans les
complexes contrées de sa continuité sociale.
Du premier type d’auteurs à ce deuxième qui retient toute notre attention, se joue la
capacité à concevoir Internet comme un espace-temps, comme un construit
humain au sein duquel ils occupent naturellement une place. Cette conception du
réseau qui postule l’Auteur comme responsable d’un territoire numérique du moi,
engagé dans un vaste jeu de relations, prend ses bases sur une conjonction
idéologico-technique articulant deux plans distincts : d’une part, l’enracinement du
discours des communautés virtuelles dans l’imaginaire social ; d’autre part,
l’évolution des pratiques de téléchargement dans les deux sens : depuis et vers
(download et upload). Nous nous attarderons sur une mise en perspective de ces
deux points afin de montrer leur incidence sur la question plus actuelle de l’Amateur
comme figure de proue de l’Internet contemporain.
En ce qui concerne la dimension idéologique de ce phénomène de
responsabilisation de l’Auteur, il nous faut remonter à 1993, année où Howard
Rheingold avec la parution de son ouvrage éponyme The Virtual Community
s’attribuait la paternité du terme. D’après son expérience de pionnier dans la
« Communication Médiée par Ordinateur » (CMC), Rheingold -qui participait à des
30 Michel Beaudouin-Lafon, « Ceci n'est pas un ordinateur : Perspectives sur l'Interaction Homme-Machine » in "Informatiques - enjeux, tendances, evolutions", sous la direction de René Jacquart. Technique et Science Informatique, n° I 19, janvier 2000, pp 69-74
22
groupes de discussion par e-mail depuis 1985- donne à son objet une première
définition : « Les communautés virtuelles sont des agrégats sociaux qui émergent du
Net lorsqu’un nombre suffisant de gens poursuit des discussions publiques pendant
assez de temps et avec suffisamment de cœur pour que des réseaux de relations
personnelles se forment au sein du cyberespace31 ». Cette définition, remise en
contexte, demeure le point de départ idéologique de l’ouverture du réseau aux non-
spécialistes, aux non-informaticiens sur deux points : sous le concept de
communauté, elle postulait l’appartenance potentielle de quiconque mettant en
commun son expérience individuelle quelle qu’elle soit ; complémentairement, elle
présupposait l’existence de cet autre comme moi, réduisant à une affaire d’affectio
societatis minimale et de hasard les formes que prendraient ce nombre infini de
cases communautaires vides en quête d’occupants. Le discours d’accompagnement
était lancé, il ne manquait plus que la technique : malgré le faible taux d’équipement,
la circulation du discours de la communauté virtuelle, promu au rang d’idéal
participatif, assurait que l’aventure des modulateurs/démodulateurs ne serait pas par
principe l’objet d’un rapport purement instrumental comme ce fut le cas du fax.
C’est avec l’apparition du navigateur grand public de Netscape en 199432, que l’idée
de communauté devint réelle : en tant qu’unité de référence, la page web était
appelée à devenir l’objet autour duquel il y aurait rassemblement communautaire. La
Communication Médiée par Ordinateur sous ses formes précédentes comportait les
limites de l’attachement physique au disque dur de la machine comme lieu de
résidence des applications ; a contrario, la trajectoire nécessaire à la consolidation
des communautés était celle d’une exportation vers le Web des données des auteurs
mais aussi des applications. Extérieure aux terminaux, et de ce fait commune, la
page était le lieu de contact de productions auctoriales qui changeaient de statut :
elles n’étaient plus énoncés, ni flux, elles étaient traces de l’Auteur publicisées,
pérennisées, réifiées. Dans cette perspective, les forums de discussion ont été
déterminants comme forme prototypique d’un foyer auctorial. Nous rejoignons sur ce
point les observations de Jean-Thierry Julia et Emmanuelle Lambert qui voient dans 31 « Virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace » in Rheingold, Howard, The Virtual Communities : Homesteading on the Electronic Frontier, MIT Press, 1993, disponible sur http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html . C’est nous qui traduisons.
23
les forums une « figure contributive33 » marquant un passage du réactif au créatif
dans l’histoire d’Internet.
En effet, les procédures d’inscription et l’assomption d’une identité auctoriale au sein
d’un forum inaugurent la continuité expressive dont nous parlions précédemment :
l’espace de publication étant à disposition, il sera question pour les auteurs de
rapporter au forum leurs propres expériences, de contribuer aux discussions sur la
base d’une temporalité déterminée par l’activité des autres membres. Cette forme
basique de don de soi –comme implication visibilisée- sera la pierre angulaire d’une
appartenance communautaire vécue comme telle. Par la suite (que nous
connaissons), la nature des expériences personnelles rapportées se fera de plus en
plus hétéroclite : narrativiser et publier l’anecdote sur un forum au tournant du siècle,
encoder un disque en fichiers MP3 et le mettre à disposition sur un réseau peer-to-
peer deux ans plus tard, ouvrir et entretenir un blog, plus récemment mettre en ligne
ses photos et ses vidéos, faire tout ça en même temps. Ces différents procédés par
lesquels l’internaute acquiert et affirme son statut d’Auteur, ont pour commun
dénominateur la numérisation de fragments du quotidien en proportions chaque fois
plus importantes. Numérisation et don, tel est le combustible des réseaux. Deux
gestes profondément anthropologiques, deux opérations fondatrices de mondes
sociaux où le lien entre auteurs a pris les formes du download et de l’upload,
d’opérations minimales de téléchargement et de téléversement,
Au-delà des détails techniques, la trajectoire que nous venons de tracer correspond
à une dynamique de production auctoriale généralisée qui est à l’origine du degré de
complexité sémiotique et sociale qu’atteignent aujourd’hui nos réseaux. Information,
communication et expression, ne font qu’un continuum au sein des communautés en
question. Cette apparente confusion des genres doublée d’une multipolarisation des
possibilités de contribution est caractéristique de l’avènement du « Web 2.0 »,
catégorie que nous questionnerons dans la partie suivante au cours de laquelle il
sera question aussi de l’Amateur : figure siamoise et corollaire d’un Auteur
surreprésenté au centre du Web dont les jeux de relations communautaires et le
rapport aux productions numérisées peinent trop souvent à être intelligibilisés.
33 Julia, Jean-Thierry et Lambert, Emmanuelle, Énonciation et Interactivité : du réactif au créatif, Communication et Langages n° 137, octobre 2003
24
1.1.3. L’Auteur et l’Amateur : naissance d’une collaboration
L’apparition de l’appellation « Web 2.0 » est contemporaine d’une critique trop
souvent adressée à l’Auteur réseautique, communément accusé d’amateurisme. La
nature de ce reproche va dans le sens d’une disqualification des productions mises
en ligne sur des dispositifs communautaires et collaboratifs par rapport aux
productions issues d’acteurs exerçant une plus forte mainmise quant au processus
de contrôle éditorial. Nous sommes dans le cas de figure typique qui oppose
l’Amateur au Professionnel en termes de qualification (comme attribut de l’Auteur) et
de qualité (comme propriété sémiotique de l’objet numérisé). A partir d’une querelle
ainsi formulée, on ne saurait dépasser une conception bipolaire du travail auctorial,
certes utile à la controverse doxique mais inopérante dans la perspective d’atteindre
d’autres niveaux compréhensifs d’analyse. Dès lors, pour sortir de cette impasse
dichotomique, nous proposons de replacer cet Auteur-Amateur dans son contexte
techno-sémiotique d’émergence avant de risquer tout jugement comparatiste.
En tant que concept, le « Web 2.0 » découle des pratiques auctoriales
communautaires dont nous avons signalé les fondements au cours de notre partie
précédente. L’idée d’un versionnage du Web sous-tendant une discontinuité, voire
une réelle nouveauté entre les stades « 1.0 » et « 2.0 » d’Internet relève à nos yeux
d’une volonté de schématisation propre à l’instance de production dudit concept : le
cabinet de conseil américain O’Reilly Media. Nous sommes face à un discours qui
fonctionne de la manière suivante : sur la base d’une composante empirique fondée
sur l’observation de la vie communautaire en ligne, on parvient à la préconisation
d’une série de lignes directrices à l’usage des webmestres dans le but d’accroître les
modalités de participation disponibles sur leurs sites.
En ce qui concerne l’exercice auctorial, la mise en application des principes du
« Web 2.0 » accentue certains traits que les formes les plus sociales d’Internet que
nous avons précédemment évoquées avaient implémentés de manière intuitive.
Ainsi, la trajectoire d’exportation vers la page web comme objet autour duquel se
rassemblent les auteurs a été érigé une fois pour toutes en principe recteur de
l’architecture du réseau : la Web Oriented Architecture (WOA). De même, la
numérisation fragmentaire de la vie de l’Auteur, de plus en plus téléversée et
25
publicisée, a inspiré un second principe, celui d’une compossibilité permettant à
différents objets de nature différente d’exister en même temps au sein d’une même
page web. Ce terme par lequel nous traduisons le vocable anglais
mashability correspond à une propriété des objets numériques postulant une
conception plus libre de la composition des pages. Ainsi, des objets discrets tels
qu’un clip vidéo, un lecteur audio, un texte ou une animation en Flash peuvent être
incrustés par des auteurs différents dans une même page sans qu’il y ait conflit. Ceci
est rendu possible grâce à des applications inter-opérantes basées sur le web et à
des marqueurs sémiotiques permettant l’identification des multiples auteurs et
productions comme entités bien distinctes. Enfin, d’un point de vue logistique, ces
deux principes sont complétés par un principe de catégorisation collaborative des
pages et des objets numériques en question : ce parti-pris éminemment
pragmatique, préconise les tags par rapport aux taxonomies établies a priori. La
définition des catégories sémantiques d’étiquetage d’une production devient ainsi
une prérogative prioritaire des auteurs, responsables non seulement de la
numérisation et du don de ces données, mais aussi des méta-données qui rendent le
vaste inventaire navigable. Ce dernier point constitue peut-être la véritable
nouveauté au sein d’un concept programmatique prêt-à-prescrire comme solution de
participation.
Pour l’historien d’Internet que nous sommes depuis le début de ce mémoire, le
« Web 2.0 » ne mérite guère son rang actuel de révolution. En faisant la part entre
l’empirisme et les promesses qu’il incarne en tant que concept, il est bien plus juste
de le concevoir comme une réforme économique allant dans le sens d’une
industrialisation : dans la continuité des « figures contributives », il généralise (et
radicalise) la standardisation et la mesurabilité des opérations liées au travail
auctorial. Concrètement ceci se traduit par une mise en équivalence quant au
profilage et formatage respectifs des auteurs et des productions, doublée d’une mise
en place de mécanismes de comptage et de gestion industrielle du feedback
(commentaires, clics, visites). De cette manière l’interface préfigure aussi l’interaction
–comme transaction entre auteurs autour des productions– en gardant toutefois un
registre total des activités ayant lieu au sein du dispositif (évaluations, parcours,
retours). Le caractère industriel de ces dernières transformations des interfaces
participatives réside essentiellement dans le développement d’indicateurs
26
fonctionnels mesurant (et évaluant) les qualités performatives des composantes
articulées dans la page. Bien que ces indicateurs de participation soient relativement
anciens dans l’histoire de l’Internet, car consubstantiels à l’exploitation des
potentialités des serveurs en termes de trafic, leur mise en visibilité comme données
pertinentes pour l’Auteur est quant à elle tout à fait récente. C’est dans cette
perspective que le travail auctorial devient concevable comme travail industriel.
Désormais la fourmilière d’auteurs qui peuple le web laisse nolens volens des traces
visibles derrière elle, comme les empreintes qu’on laisserait au simple toucher de
l’objet numérisé. Ces traces visibles, traçables, sont devenues une véritable
contrepartie du travail auctorial, et c’est en cela que le « Web 2.0 » parachève une
véritable réforme économique : il déplace (et replace) le circuit transactionnel de
l’échange dans une sphère traditionnellement liée au don en même temps qu’il
homogénéise les relations entre auteurs et crée pour leurs différentes productions
des barèmes comparables de valeur.
Toujours dans une perspective économique, le cabinet de recherche en technologies
Gartner a effectué une lecture des effets participatifs et sociaux du « Web 2.0 »
traduite sous la forme d’un cycle vertueux34. Le postulat de base de cette
conceptualisation des rapports économiques ayant lieu sur le réseau suppose un
rééquilibrage des relations producteur / consommateur. En effet, ce modèle cyclique
qui reprend la forme de l’arbre celtique de la vie pour illustrer la complexité et la
réversibilité des rapports entre ces acteurs, accorde au consommateur un pouvoir
économique déterminant : au cours de l’échange où l’Auteur confie à la plateforme
distributrice ses productions, son horizon de rétribution est dominé par une promesse
de retour d’«intelligence distillée » (distilled intelligence). Cette intelligence distillée
correspond au feedback provenant des consommateurs, ainsi qu’à des traces
comptabilisées précieuses pour la plateforme à un macroniveau. Dès lors, si l’Auteur
est important, le consommateur le devient tout autant car il est lui aussi Auteur d’un
feedback à la fois générateur de valeur, indicateur de performance et surtout
gratificateur symbolique. Ce sera cette dernière composante du retour du
consommateur qui permettra le redémarrage du cycle ou sa réversibilité : le marché
34 Cf. Annexe 1 p.114 – Schéma du cercle vertueux du « Web 2.0 », source : Gartner.com
27
est conçu comme une conversation, à deux voix et à deux voies35. Nous sommes
donc en face d’un dispositif qui affirme une position auctoriale comme étant partagée
par ces deux acteurs. Autant l’Auteur proprement dit que le consommateur
constituent un même circuit autour d’objets communs, les contenus (user created
contents), sur la base de positions présupposant leur participation active.
Au-delà des vues schématiques que peut inspirer le concept de « Web 2.0 », c’est
cette évolution de la figure du consommateur comme parallèle de l’Auteur qui retient
toute notre attention. En son temps, Michel de Certeau avait beaucoup insisté sur le
fait que la consommation n’était pas une activité passive36. A la lumière de l’écran,
cette thèse se confirme pleinement et paraît des plus lucides. La part auctoriale du
consommateur sur Internet n’a fait que s’accroître ; elle est incitée et visibilisée, elle
est devenue indispensable au fonctionnement du système. Ainsi peut-on se
demander, du fait de la sollicitation et implication sémio-économique de ce
consommateur-auteur, si son vrai statut n’est pas celui d’Amateur. Nous ne parlons
pas (encore) d’amateurisme, question qui relève d’un jugement comparatiste au cas
par cas. Dans notre contexte d’analyse, nous questionnons l’émergence de cette
position bien établie, agglutinante et singularisante à la fois qu’est l’Amatorat. En
effet, dans un système nourri de contenus numérisés où les avis comptent, l’Amateur
autant que l’objet aimé doivent être pensés dans l’abstraction comme deux flux
complémentaires avant de rentrer dans le détail de leur actualisation en tant que
concepts. L’Amateur de quoi, d’un énième content ? C’est en ces termes qu’il faut
réfléchir pour comprendre la portée générique de sa figure, soit comme euphémisme
du consommateur, soit comme co-créateur hyperbolique de la valeur37. Selon la
couleur axiologique des discours d’accompagnement du « Web 2.0 », l’Amatorat
peut ne pas jouer une même fonction ; cependant, sa présence est transversale, 35 « Markets are conversations » était la première des 95 thèses constituant le Cluetrain Manifesto. Les propositions de ce document visionnaire allant à l’encontre de la transposition du marketing traditionnel aux online markets émergents ont été depuis signées et adoptées par de nombreuses entreprises et sont aux sources des modifications économiques que nous décrivons. The Cluetrain Manifesto, par Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls, David Weinberger , Perseus Book , 2000, disponible sur http://www.cluetrain.com 36 Certeau (de), Michel, L’Invention du Quotidien, arts de faire Tome 1, Gallimard, 1980, La production des consommateurs p.XXXVII 37 A ce sujet, le livre d’Alban Martin L’âge de peer, chapitre 2 « Le consommateur s’implique de plus en plus dans la chaîne de création de la valeur traditionnelle. Disponible sur http://alban.martin.googlepages.com
28
consubstantielle à l’idée d’une collaboration (positive ou négativement connotée)
ayant lieu sur ces supports.
Compte tenu de cette réflexion, la figure de l’Amateur se décentre d’un ordre
sociotechnique qui l’a traditionnellement structuré comme sujet d’usages et pratiques
constantes jugées amatoriales autour de l’objet aimé, vers un cadre d’analyse
d’inspiration sémio-pragmatique sans doute plus apte à saisir des nuances
expressives à partir de variables contextuelles. La figure anachronique de l’Amateur
de Beethoven, par exemple, ou celle de n’importe quel autre « Amateur de », nous
oblige à concevoir un sujet d’amour constant et quantifiable, un sujet de goûts
motivés, enfin un sujet d’inventaires (discographiques, littéraires…) autour d’un objet
totémisé dont les pratiques et discours déclaratifs ne seraient pertinents que fonction
d’une confluence vers cet objet. Or, l’Amateur dont nous traitons est beaucoup plus
circonstanciel et éphémère : seuls quelques clics, quelques lignes, quelques
rétroactions éparpillées restent de sa relation à l’objet ; un objet lui-même dissout,
dispersé, volatile dans ce temps accéléré des réseaux. Si à cet égard Internet
continue sa mise à mal des conceptions romantiques de l’Auteur, et célèbre
l’échantillonnage des cendres de Barthes et de Foucault, nous aurions tort de ne pas
déconstruire de façon parallèle la figure de l’Amateur. Quatre points nous paraissent
fondamentaux dans cette reconceptualisation :
( 1 ) Tout Amateur est Auteur, au moins de lui-même par la ouverture d’un compte et
la création d’un profil par lesquels il se donne à l’existence. ( 2 ) Chaque dispositif
instaure un régime auctorial pour l’Amateur, délimitant des espaces de soi et des
répertoires d’opérations différents : ainsi, l’Amateur de Youtube peut s’abonner
(subscribe) aux vidéos d’autrui, celui de Myspace fonctionne essentiellement par
ajouts d’amis (friend requests), sur Orkut on peut devenir Fan au sein de
communautés, etc. ( 3 ) Au sein des dispositifs Auteur et Amateur sont des rôles
réversibles, de ce fait il y a co-labor : les modélisations économiques du « Web 2.0 »
mettent l’accent sur la circularité de cette relation réciproque de consommation
comme production donnant lieu statutairement à un système des paires adjacentes.
( 4 ) Les tenants et aboutissants de la relation auteur-amateur s’inscrivent dans un
paradigme dit d’« innovation de masse » (mass innovation) qui postule qu’un nombre
toujours plus grand d’utilisateurs au sein d’un monde social doit nécessairement
29
avoir un potentiel créatif supérieur : remplaçant la question classique ‘qui connaît qui’
par ‘qui connaît quoi’, il s’agit de maximiser la quantité de données en ligne sans
juger a priori de leur qualité ou de leur pertinence.
Dans cet état de faits, le traitement de la question de l’Amateur sur Internet devient
prioritaire dans la compréhension de nouveaux modèles économiques mais aussi de
phénomènes culturels émergents. Toutefois, sa théorisation ne saurait être réduite à
un schéma économique, à un circuit logistique ou à une description ethnographique.
C’est la raison pour laquelle tout au long de cet exposé, l’Auteur a été notre point de
départ : L’Auteur de quoi ? L’Amateur de quoi ? Deux questions qui ne sont plus
centrales dans la compréhension de ce qui les relie. Les contenus sont passés à un
second plan, c’est la constitution du réseau qui prime. Dans cette perspective nous
insistons sur une conception de l’Amateur en deux temps : d’abord, comme figure
originaire d’un effet de position vis-à-vis de l’Auteur, puis comme actualisateur in situ
d’un certain type d’amateur. Par le biais de cette double détente compréhensive,
nous pouvons articuler à la fois deux niveaux de la relation Auteur-Contenu-
Amateur : la prise en compte de l’effet de position concerne une construction in
abstracto du réseau, préfigurée par la proposition générique qu’est adressée à tout
Internaute d’être Amateur pour devenir partenaire d’un monde numérique,
définissant d’abord un amatorat en creux ; ce n’est qu’après avoir conçu ce premier
niveau définitoire que nous pouvons étudier lucidement (l’actualisation de) l’Amateur
dans son rapport à un auteur précis et juger des propriétés sémiotiques des
contenus qu’ils produisent au cours de ce qui serait une approche casuistique de
l’Amateur.
Faute de ces deux étapes de raisonnement, il est difficile de cerner autre chose
qu’un amateurisme tergiversé entre les intérêts sectoriels et les vues subjectives
d’un sollen éditorial. Quel statut pour l’Internaute contemporain ? Le terme Pro-Am
(pour professionnel-amateur) a été proposé, malgré sa compromission intenable. De
notre côté, nous continuerons à parler d’un Auteur-Amateur, dépositaire historique
d’habitudes transversales au travail accompli par les machines et les hommes. Du
programmateur ermite de monades informatiques logocentrées au membre actif des
réseaux égocentriques de sociabilité, il est toujours question de l’exercice d’une
pratique auctoriale : qu’elle concerne huit bits ou huit millions de pixels, la réflexion
30
menée au fil de ces pages situe cet exercice dans sa spécificité et prépare notre
esprit à affronter les écrans des domaines culturels les plus divers.
1.2. L’ÉCRAN DE L’AMATEUR : ÉCLAIRAGES PORNOGRAPHIQUES DU RÉSEAU
Après avoir traité de la trajectoire de l’Auteur à l’écran, dans cette deuxième partie
nous passerons des effets de position proposés par le réseau, à l’étude détaillée
d’une pornographie en ligne, de façon à souligner sa spécificité sémiotique, mais
aussi le rapport qu’elle entretient avec d’autres discours sociaux, liés à Internet.
Le juge américain Potter Stewart s’était prononcé au sujet de la pornographie de la
manière suivante : « Je ne sais pas définir la pornographie, mais je sais la
reconnaître38.» Au-delà de sa valeur d’antécédent juridique, cette difficulté à définir
la pornographie -dans sa tension avec son aspect facilement reconnaissable- nous
servira de point de départ dans le parcours suivant : de la main de la figure de
l’Amateur nous allons suivre métamorphoses médiatiques et évolutions discursives
de façon à comprendre le passage d’un écran intimiste à un exercice de
publicisation.
1.2.1. De la pornographie comme écologie médiatique
Ne définissons pas la pornographie –sommes-nous tentés d’écrire– ; sa définition
courante soulève à elle seule une série de problèmes suffisante à épuiser l’arsenal
des théories de la réception esthétique : « Pornographie : Représentation de choses
obscènes, sans préoccupation artistique et avec l'intention délibérée de provoquer
l'excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées39 ». Comment comprendre
en effet la triade « chose obscène »- « préoccupation (non)-artistique »-« intention
délibérée » autrement que comme une usurpation a priori du jugement évaluatif d’un
public fantasmé ? Ou bien au-delà du jugement, du côté des effets, serait la 38 Le juge Potter Stewart, cas Jacobellis v. Ohio (1964), cité par Ogien, Ruwen, Penser la pornographie, PUF, Paris, 2003, p.29 39 Trésor de la Langue Française Informatisé : http://atilf.atilf.fr/ - entrée Pornographie
31
pornographie ce corps symbolique responsable a posteriori d’excitations
pavloviennes mesurables sur des critères formels ? Dans le premier cas cette
définition pourrait rejoindre l’herméneutique corporocentrée développée par les
derniers travaux de Georges Molinié qui voit dans l’expérience pornographique un
modèle généralisable à toute expérience esthétique40 ; dans le second cas de figure
nous transiterions davantage vers les expériences menées par une éthologie urbaine
autrichienne consacrée à l’étude sélective de certaines variables
neuroendocrinologiques41. Jusqu’ici deux façons de construire la question
pornographique : celle du public constituant, celle du corps qui est contraint. Elles
nous intéressent en ce qu’elles sont traversées par deux questions centrales à notre
réflexion : quel public ? quel corps ? Toute définition de pornographie prétend
implicitement répondre à ces deux questions : la représentation pornographique
n’étant pas la même pour l’enfant, l’adolescent ou le majeur ; la représentation
pornographique n’étant pas la même pour la femme, le queer ou l’homme. Ainsi,
l’exercice de définition de la pornographie devient l’exercice de définition de ses
frontières, la délimitation de son champ d’action. Cette urgence de circonscrire
publics et corps par définition n’est pas sans rappeler un sens premier
historiquement sédimenté : « πορνογραφία : traité sur la prostitution ».
Les sentiers du définitoire pornographique nous conduisent de force aux nouveaux
périmètres esthétiques et juridiques de la maison close : sa réglementation ou sa
tolérance, la complaisance ou le dégoût. Dès lors que l’on considère qu’au tournant
du XXème siècle la pornographie revêt bien le caractère d’une pratique culturelle
‘légitime’ par son poids économique et influence stylistique, l’entretien d’un débat
fondé sur des freins d’ordre moral autour de la pornê ne peut se faire qu’au détriment
d’un accompagnement éclairé encore déficitaire de ses différentes graphies.
Procédant d’abord par une mise entre parenthèses des questions de l’obscène, de
l’intentionnel et de l’excitant, la pornographie peut redevenir ce qu’elle est, une
représentation ; et comme telle nous pouvons la regarder autrement, plurielle et
40 Molinié, Georges, Hermès mutilé. Vers une herméneutique matérielle, Éditions Honoré Champion, Paris, 2005 41 Les chercheurs du Ludwig-Boltzmann-Institut fur Stadt-Ethologie à Vienne travaillent sur la perception d’images en présence ou absence de phéromones responsables de l’excitation sexuelle. Une lecture évolutionniste verrait « l’intérêt reproductif de l’espèce » comme facteur d’explication des résultats obtenus ; avec moins de déterminisme nous songeons davantage aux connotations prises par la copuline et l’androstenol par rapport à une expérience socio-sensorielle dans le cadre d’une sémiotique de l’olfaction.
32
soumise à des contraintes expressives. Dans cette perspective, la Pornographie,
somme idéale de toutes les représentations pornographiques, retrouve sa place au
sein d’une théorie des discours sociaux : elle devient un flux sociodiscursif situé,
poreux ; elle nourrit un imaginaire commun aussi bien que peut le faire un discours
publicitaire ou un discours des imaginaires nationaux. Quant à la particularité du
discours pornographique, celle-ci tient peut-être à l’écart existant entre les
représentations mentales socialement véhiculées et les représentations proprement
pornographiques faisant l’objet d’actualisations effectives.
De fait, la réputation hégémonique de la pornographie s’est bâtie sur la visibilité
publique de ses lieux, plus que sur la visibilité de ses représentations : la revue n’est
pas ouverte, le cinéma n’est pas fréquenté, la cassette n’est pas louée, le site n’est
pas accédé, pas nécessairement ; cependant sur les présentoirs du tabac-presse,
dans les rayons du vidéoclub, sur les écrans ou dans les rues tout simplement, ces
objets demeurent visibles et nourrissent la connaissance intuitive d’un imaginaire
pornographique. Cette prégnance subliminale de la pornographie relève donc
davantage d’une aura topographique et objectale que d’une exposition des corps et
publics aux représentations en question. Il faut situer la pornographie dans ses lieux
contemporains : bien que toute une génération de poètes syphilitiques (ou non) ait su
capturer l’aura des maisons closes au travers de rames de descriptions à l’encre
noire, celles-ci suivent dans le temps la tendance d’un lenocinium42 en déclin. Le
spectacle du corps, comme tous les autres spectacles de ce siècle (qu’on songe au
music hall ou à la messe dominicale) a lui aussi pris sa fuite en avant de la main de
la technique, sous la forme de médias. Sur les trottoirs, les clients exclusifs de
femmes publiques se font relativement rares ; A l’écran, les objets médiatiques
pornographiques (et leurs stars) sont identifiables très facilement. Dans ce monde
sur-abondant en médiations, les mères maquerelles se seraient transmutées en
fonction éditoriale.
42 Le lenocinium, voix latine elle aussi tombée en désuétude, synthétise le fait de destiner les femmes à la prostitution, à son propre profit. Parallèlement à Internet une logique sociale semble avoir traversé ses maisons, reconverties pour la plupart en clubs échangistes (swinging clubs). A l’âge du Sida, les visites des sciences sociales de l’exotique et les artistes ou médias travaillant l’esthétique du voyeur -à l’instar de nouveaux émissaires sociétaux- dans ces lieux, sont symptomatiques de la désaffiliation dont font objet certaines pratiques sexuelles immédiates basées sur l’engagement présentiel du corps dans une transaction.
33
En tant que lieux visibles et véhiculaires des représentations pornographiques
contemporaines, les médias constituent l’environnement dans lequel celles-ci et
évoluent. Dès lors, une vue d’ensemble du système pornographique comme
« écologie médiatique » peut nous permettre de comprendre l’empreinte actuelle de
ces objets publics comme matériaux signifiants de ce type de discours : à différence
des réflexions économiques que l’on pourrait mener ici en termes de poids intra-
sectoriels et marchés globaux pour l’« industrie du X », le sens d’une réflexion
écologique comme celle que nous proposons consiste à faire émerger les jeux de
relations existants au sein d’un système étudié en accentuant les nécessaires
solidarités symboliques qui s’établissent entre les différentes représentations et
supports. D’un point de vue mcluhanien, nous avons donc affaire à une série de
corps plus ou moins nus, doublés (ou précédés ?) d’un message du médium qui
parle pour lui-même en disant à chaque fois qu’il n’est pas cet autre médium. Ainsi,
la nudité des petits formats et humbles imprimeurs se distance de celle du papier
glacé, et différente à son tour est la nudité des chaînes hertziennes et câblées qui
cryptent leurs signaux tard le soir ; ou encore la nudité des magnétoscopes qui
exprimera sa substance de bobine dans son rapport avec les DVD où les CD-ROM’s.
Dans cet ordre d’idées, les mêmes contenus selon leur véhicule ne donneront pas
lieu aux mêmes représentations de la pornographie. Nous pouvons bel et bien parler
de pornographies, à la forme plurielle qui sous-tendent les tensions sémiotiques
intrinsèques à l’auto-affirmation de chaque médium. Plaçons la pornographie qui
prend sa racine sur l’ordinateur en réseau au centre de l’écosystème pornographique
que nous dressons43 : vis-à-vis de cette pornographie réseautique, nous signalerons
certaines spécificités médiatiques fondamentales émergeant des méta-messages
différentiateurs en termes d’imaginaires convoqués et contraintes discursives
inhérentes aux diverses techniques de représentation.
De manière générale toute écologie médiatique organise ses objets comme un
système de transports et sollicitations socio-sémiotiques. En ce qui concerne nos
pornographies, ces rapports écologiques modifient le statut du signe transporté en
définissant différentes manières de mise en condition pour sa consommation. Ainsi, 43 Ce choix est motivé par la nature informatique de notre objet. Pour une réflexion centrée autour de la pornographie des magazines et vidéos nous référons au chapitre 3 « L’imagerie sexuelle » de l’étude du Sociologie Patrick Baudry – La pornographie et ses images. Paris, Armand Collin, 1997.
34
les produits d’une industrie cinématographique essentiellement scandinave, puis
américaine ou française44, en plein essor pendant les années 70 ont fait leur transit
des salles de projection vers les logis (ou cabines de sex-shop) en modifiant en
cours de route leurs formats et le profil de leurs consommateurs.
Ce déplacement d’un lieu social vers un lieu privé (ou privatisé) confère au signe
pornographique animé une mobilité jusqu’alors réservée aux images statiques
faisant corps avec revues de tailles discrètes et moins discrètes ou bien avec sur la
page ‘trois’ de divers tabloïdes jaunes45. Qu’en est-il donc de ces signes
pornographiques qui font corps avec un matériel informatique ? Dès les années 80
eux aussi circulent : entre escales en serveurs des images fixes primitives
commencent à prendre forme sur les écrans VGA des espaces (professionnels ou)
domestiques. Nous rejoignons le contexte de l’auctorialité primigène que nous
décrivions dans le chapitre précédent : numérisation et don sous une forme très
précaire46. En effet, dans un premier temps cette pornographie en ligne consistera
essentiellement de photos découpées de magazines pour adultes qu’un utilisateur
scanne et partage sur USENET avec les membres de son Newsgroup. Le signe
pornographique gardera les traces de ce transit de support du papier vers le
silicium : il devient un signe rétroéclairé (pixels qui font corps) pour un corps de
membres du réseau. 44A ce sujet, le documentaire L’Age d’Or du X Français (Striana Productions, 2005) retrace bien le parcours d’une pornographie filmique française en expansion après la libération sexuelle de la fin des années 70. Du côté américain, la figure emblématique de cette époque à qui l’on continue de consacrer des hommages documentaires est Linda Lovelace, égérie du célèbre film de Gerard Damiano, Deep Throat. (VF : Gorge profonde) 45 A l’instar de la page three girl de The Sun, depuis 1969 l’existence d’une page équivalente sur ce type de titres nationaux est devenue récurrente outre-manche : les Seite-eins-Mädchen du Bild en Allemagne, l’Ekstra Bladet et ses Side 9 Pigen danoises, sur El Espacio en Colombie, La Cuarta au Chili et d’autres tabloïds en version roumaine, australienne ou finnoise nous pouvons poursuivre une longue liste d’exemples. Dans le contexte français, dès son arrivée à la Direction de France Soir, Dominique Jamet, ancien président de la Bibliothèque Nationale de France a fait une priorité de la suppression de cette page nationale : « L’un des combats que mène Jamet est de l‘ordre du symbolique - reporte-t-on sur le blog de L’Express rubrique Médias sur l’entrée du 5 mars 2007- (…) Au motif qu’à l’heure d’Internet ce type de reproduction, un brin vulgaire, qui pouvait encore, il y a quinze ans, apparaître pourquoi pas kitch (sic), est aujourd’hui bien banale, car à la portée du premier internaute venu. » Renaud Ravel, Rédacteur-en-chef de L’Express : http://blogs.lexpress.fr/media/ 05/03/2007. 46 Les newsgroups ne transmettant que du texte, ces découpes pionnières étaient encodées en format ASCII. Par la suite la reconstitution visuelle en caractères ASCII d’images érotiques est devenue un des genres pornographiques les plus ironiques : l’ASCII porn, lieu d’une iconicité mémorielle détournant la « lettrure » et indifférente à la haute résolution. Le film Deep Throat encodé en ce format rudimentaire a remporté plusieurs prix de festivals internationaux et fait office d’œuvre de Net Art accessible sur le site du Zentrum für Kunst und Medientechnologie de Karlsruhe : http://www1.zkm.de/%7Ewvdc/ascii/java/
35
La pornographie réseautique poursuit son autonomisation sémiotique avec
l’ouverture du World Wide Web en 1995, qui permettra aux signes de se constituer
en page. A l’intérieur de ces pages, des nouveaux environnements discursifs font
oublier l’origine des contenus : bien qu’il soit encore subsidiaire de photographies
destinées au papier, le web pornographique développe progressivement ses propres
mécanismes de représentation. Le maniement éditorial du matériel iconique
privilégiera l’épaisseur hypertextuelle à l’immédiateté : suspense entre clics car le
temps de l’image a changé. Autour de l’image elle-même en 256 couleurs, la plupart
du temps un fond noir de html code 000000 et en bas de l’écran un bouton solitaire
de retour : « Back to the Gallery ». Dans l’histoire d’Internet, ces sites
pornographiques des années 90 peuvent être tenus pour archétypiques d’une
certaine pensée de la galerie : la gestion spatiale de ce qui est donné à voir passera
par l’usage massif des Thumbnails comme dispositif technosémiotique de
prévisualisation. En effet, ces miniatures informatiques indexielles doublées de
signes passeurs orienteront le parcours des internautes vers l’unique image désirée
articulant ainsi une logique de la sélection à une téléologie de l’exclusivité : pour la
main du visiteur qui clique la mécanique du désir équivaut à une sollicitation
sémiotique progressive à partir de valeurs de taille et résolution.
La description de cette pensée de la galerie, véritable jardin aux sentiers qui
bifurquent, ne serait pas complète à défaut de prendre en compte des logiques
organisationnelles taxonomiques qui ont restructuré conceptuellement la
pornographie du réseau. Derrière la part visible des représentations, transparaît le
message du médium : l’arborescence apparaît comme principe nécessaire de
rection. Il faut classifier cette pornographie pour agencer sa navigation : on procède
à une reprise des genres plus ou moins définis par les acteurs du milieu et on
accélère leur stabilisation. Pour reprendre une distinction peircienne, nous dirons
qu’en fonction du motif, de l’esthétique photographique ou du corps en question on
opère un traitement par types de tokens de format JPEG en créant des galeries
homogènes. Des critères physiques (âge, race, proportions), d’orientation sexuelle,
de fétiches ou d’actes sexuels particuliers sont retenus pour trier les contenus. Ainsi
Lolita, Bondage, Asian, Mature apparaissent parmi d’autres comme sous-genres au
36
menu47. La fonction éditoriale des pages, devient ici un projet aux enjeux
curatoriaux : préfiguration cognitive des publics, sélection pour la sélection. Cette
pornographie perméable à l’imaginaire encyclopédique d’Internet assemble dans ces
sites des prétentions totalisantes : parmi le répertoire de genres, les internautes
doivent quotidiennement choisir, apprendre à formaliser leur désir. De fait,
familiarisés aux concepts et aux structures ils sont constitués en Amatorat, ils
deviennent connaisseurs, ils occupent une position proche de celle des habitués qui
à la sortie du ciné-club seraient en mesure de tenir un débat. C’est ce qui arrivera
par la suite avec le développement de forums réinsérant dans la polyphonie ces
représentations.
La position de l’Amateur est créée, c’est celui qui franchit le seuil de cette notice qui
comme la pellicule du magazine est censée restreindre l’accès aux mineurs. C’est
celui qui se fait membre et a droit à un mot de passe à l’instar des abonnements de
vidéo-clubs ou des chaînes câblées pay-per-view. Il découvre les premières vidéos
en ligne, cet audio hautement compressé qui rend les cris crus et robotiques (loin de
la facticité des voix des actrices de doublage), cette image animée dont les
photogrammes par seconde exploitent la persistance rétinienne de façon bien
différente des cassettes et des bobines. Au bout de quelques clics l’Amateur devient
le lieu de cette esthésie intermédiale, en échange de rien au départ -le temps d’une
période d’essai- puis d’une somme modique (par rapport au marché) sur une carte
bancaire à débiter. Le cas échéant, des sites gratuits demeureront accessibles
financés quant à eux par une contagion de virus publicitaires.
Tout compte fait, parmi les objets de cette écologie médiatique, la pornographie
d’Internet représente une offre relativement plus large que celle de son entourage
dans son assemblage de matières signifiantes, laquelle n’étant pas liée au un mode
co-présentiel de consommation est de fait socialement moins contraignante.
Numériquement reproductible, elle circule dans des vastes sphères à un coût réduit.
Cette pornographie qui hisse dès ses débuts le mot « sex » au Top 10 des moteurs
de recherche, n’est donc plus ostracisable ; d’autant plus qu’elle gagne de nouveaux
amateurs et apprend en temps réel quels sont leurs goûts. En ce sens Internet a
47 Pour une description complète des sous-genres pornographique avant Internet, voir Stella, Renato, L' osceno di massa. Sociologia della comunicazione pornografica, Franco Angeli, 1991, pp. 226-230
37
modifié l’écologie des pornographies : au début responsable d’une déstabilisation en
apparence prédatrice, puis assumant naturellement avec le temps le rôle d’une
centralité méta-médiatique. Le Web s’est érige en scène pour des représentations
pornographiques qui côtoyant les sons, les textes et les images d’autres horizons se
voient ratifiées comme univers de consommation culturelle. Dans les travaux de
Linda Williams, celui-ci est le point de passage d’une pornographie obscène vers une
pornographie en scène : sur la base d’une distinction entre ob-scene (au sens de
tenu hors scène) et. on-scene (en scène par publicisation), l’auteure se demande :
« Comment des scénarios sexuels autrefois obscènes ont été amenés sur la scène
d’une sphère publique ? 48 ». Jusqu’ici nous avons déniché la galerie dans le
médium : dans quel sens peut-on faire une scène du réseau ? Certes, l’Amatorat fait
office de public, mais qui sont les auteurs ? Pour finir de répondre à ce
questionnement que nous faisons nôtre, poursuivons cette réflexion sur l’expérience
conjointe du signe et du médium de l’autre côté de l’écran. Interrogeons le parcours
de l’Amatorat réseautique dans sa colonisation d’espaces qui lui ont paru propres,
intéressons nous à l’émergence de ces pornographies de soi-même comme formes
contemporaines d’autoréflexion.
1.2.2. Mythologies pornophiles : l’explosion amateur.
Dans son article “Going Online : Consuming Pornography in the Digital Era ”, la
chercheuse Zabet Patterson nous rappelle une série d’images d’Épinal sur la
pornographie réseautique : nous sommes le 3 juillet 1995 et le magazine américain
Time consacre son numéro à ce qui demeure « un des premiers exposés mass-
médiatiques sur la prévalence et les dangers de la pornographie en ligne49 ». En
couverture, un enfant visiblement stupéfait pris du point de vue de l’écran, les mains
48Restitué au pied de la lettre, le paradoxe de l’On-scenité comme concept pour Williams est le suivant : « On/scene is one way of signaling not just that pornographies are proliferating but that once off (ob) scene sexual scenarios have been brought onto the public sphere. On/scenity marks both the controversy and scandal of the increasingly public representations of diverse forms of sexuality and the fact that they have become increasingly available to the public at large.” Linda Williams (Editor), Porn Studies, Introduction, Duke University Press, Londres, 2004. 49 Patterson, Zabet, “Going Online: Consuming Fantasies in the Digital Era.” in Linda Williams, ed., Porn Studies, Duke University Press, Durham, 2004, p 104.
38
sur le clavier, photographié dans une pénombre à peine rétro-éclairée. D’un bleu
glacial, l’hebdomadaire titre : “CYBERPORN : Exclusive : A new study shows how
pervasive and wild it really is. Can we protect our kids – and free speech?50 ”.
Absente depuis 1986 des couvertures de Time51, la pornographie fait ainsi sa rentrée
décennale sous une forme réseautique promue au rang de préoccupation publique :
dans une seule et même page on la nomme (« cyberporn »), on l’inculpe (au nom
des enfants), on ouvre son procès tout en rappelant les limites de la liberté
d’expression. Cette configuration, rappelant le triptyque naming-blaming-claiming par
lequel William Felstiner52 distingue les étapes canoniques du litige, connote très
négativement dès ses débuts l’affichage public d’éventuelles appartenances à
l’Amatorat de la pornographie des réseaux. Cependant sur Lycos, Altavista, Excite,
et autres moteurs de l’époque, « sex » et « porn » ne cessaient de s’affirmer parmi
les mots les plus recherchés.
Ce contraste fonde un mythe de l’Amateur anonyme de pornographie, qui serait un
consommateur obscur, connu de personne à l’exception de son ordinateur. En effet,
son corollaire est une sorte de ‘machine masturbatoire’ dans laquelle les
représentations de l’obscène sont recluses. Patterson s’arrête sur une photographie
qui peut illustrer assez bien notre mythe : «une image d’un homme nu, enlaçant de
ces jambes et bras le clavier et le moniteur d’un ordinateur, semblant se fondre dans
l’écran53 ». Comme souvent, les manques d’imagination sur la dimension symbolique
50 « CYBERPORN : Exclusive : une nouvelle étude montre à quel point il est omniprésent et sauvage. Pouvons-nous protéger nos enfants – et la liberté d’expression ? » Time Magazine, n° du 3 juin 1995. Ce numéro a déclenché une vague de craintes sur la base de statistiques imprécises. La controverse a conduit au discrédit des auteurs de l’étude à l’université de Carnegie Hall, et demeure un antécédent prégnant des excès auxquels a conduit une lutte contre la pornographie fondée sur des rhétoriques quantitativistes. 51 La dernière couverture remontait au numéro du 21 juillet 1986 : “Sex Busters » titrait Time sur un dessin parodique des Ghostbusters, rendant compte du combat juridique mené par censeurs et lobbys contre la prolifération de contenus sexuels sur l’arène publique. Cf Annexe 2 p. 115 – Trois couvertures du magazine Time 52 William L.F. Felstiner, Richard L. Abel, Austin Sarat, The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming, in Law & Society Review, Vol. 15, No. ¾ 1981 consulté sur http://jstor.org. Dans l’affaire du Cyberporn la principale conséquence fut l’obligation pour les sites de publier un avertissement en page d’accueil dissuadant les mineurs d’accéder. Dans cet esprit, sur de nombreux sites la date de naissance de l’internaute est demandée lors de sa première visite. S’il se déclare majeur une cookie qui permettra de le reconnaître lui est envoyée, lui évitant lors des prochaines visites cette formalité à valeur juridique. 53 In op. cit., p. 104. (C’est nous qui traduisons)
39
et sociale des territoires numériques se traduisent en abus et hypertrophies d’une
corporéité machinale.
Revisités douze ans après leur émergence, ces mythes de l’anonymat et de la
‘machine masturbatoire’ peuvent rétrospectivement sonner faux. Depuis cinq ans, on
assiste à une montée de la visibilité en ligne de la pornographie et de son Amatorat
par laquelle la machine a évacué son image masturbatoire, étant devenue par
excellence l’outil d’expression d’amateurs qui s’organisent en communautés
accessibles et portent bien leur nom. La normativité sociale quant à elle a concentré
ses forces et phobies dans la lutte contre les circuits pédophiles incontestablement.
Dans ce contexte la pornographie connaît une progression de ses chiffres et un
fleurissement de ses formes. Quantitativement et stylistiquement nous pouvons
parler dès lors d’une explosion amateur. Comment l’expliquer ? Quels critères
structurent le baromètre d’image de cet Amatorat ? Des historiens culturels tels
Jean-François Sirinelli insistent sur la complexité de ces phénomènes d’évolution
des normes et des goûts : il est question de « rythmes subtils » sensibles à l’« air du
temps », de périodes de « ralentissement » ou d’« accélération54 » ; les amateurs
participeraient à cette deuxième dynamique dans le domaine de la pornographie.
Dans notre recherche de facteurs explicatifs nous pondérerons l’influence de
discours d’accompagnement sociotechniques, tendances de consommation
culturelle et esthétiques de la pornographie sur un Amatorat revendiquant désormais
la pluralité de ses pratiques sur un espace réseautique de plus en plus investi
comme nouvelle scène publique.
Du discours d’accompagnement au mythe se joue une tergiversation : une quête
d’adhésion idéologique peut ainsi agglutiner velléités de mystification ou
stigmatisation éparses dans un tissu social, jusqu’à en constituer une narrative. La
sacro-sainte protection des enfants, le tabou des sexualités clandestines et une
méconnaissance due à la nouveauté des pratiques du réseau ont comme nous
l’évoquions motivé la dévalorisation d’une première figure de l’Amateur de
pornographie en ligne. Cependant, l’impact de ces reproches adressés à un secteur
54 J-F Sirinelli, La norme et la transgression, Remarques sur la notion de provocation en histoire culturelle in revue Vingtième siècle n°93, janvier-mars 2007.
40
encore jugé marginal n’aura pas marqué durablement l’Amatorat en question. Les
figures noires de l’Amateur seront en effet atténuées par une prolifération de
discours sur des promesses du « virtuel » qui nolens volens irradieront
transversalement de leurs bienfaits tout univers réseautique même le
pornographique.
En pleine bulle Internet naîtra donc un mythe positif qui concerne lui aussi cet
Amatorat et changera son image : l’utopie du « sexe virtuel » (ou « cybersexe »)
comme au-delà des rapports entre internautes. Par le biais de ces nouvelles
narratives de la rencontre, on quitte le domaine inquiétant de l’anonyme, vecteur de
connotations négatives : on fonctionnera davantage sur une modalité de l’incognito,
dans la mesure où un travail auctorial sur soi-même est entrepris par les amateurs
comme réponse au problème de la construction d’identités plus ou moins factices. La
‘machine masturbatoire’ cachait un espace sociodiscursif. Il n’était donc pas question
de prothèses -comme un imaginaire de la réalité virtuelle avec casques et gants
avait pu l’interpréter55-, la route vers le « cybersexe » concernait de manière
prioritaire l’Amateur, dans son développement d’une compétence sémiotique
primaire : celle d’une mise en signes linguistique des pratiques érotiques à l’oeuvre.
Dans les salles de conversation où se mêlent internautes pornophiles et
pornophobes, l’écrit équivaut au faire. En ligne il y a scène dès lors qu’il y a jeux de
rôles, jeux qui stabiliseront progressivement les routines discursives d’une sociabilité
orientée vers la stimulation de la libido par le texte : dans cette pragmatique amateur,
sur la base d’un travail co-auctorial de gestion de paradigmes lexicaux se joue une
prise de conscience massive des effets que sur Internet certains énoncés peuvent
produire sur autrui. Parallèles aux chatrooms, les forums soudent le sentiment
d’appartenance à un Amatorat développant des habitudes contributives sur des
thèmes variés relatifs (ou non) à la pornographie. Participant à l’exercice de la
parole, la figure de l’Amateur prend une allure dépositaire de cette vertu
démocratique.
55 Bien qu’une « Télédildonique » (Teledildonics) qui postule le contrôle de jouets sexuels électroniques par intermédiaire d’ordinateurs en réseau ait été conceptualisée par le père de la notion d’ « hypertexte » Ted Nelson, la recherche et développement des technologies dites « haptiques » suit encore une lente évolution et ce dans les domaines de la Médecine et Robotique essentiellement.
41
Ce premier temps de l’explosion amateur voit miraculeusement multipliée la
fréquentation de ces salles de conversation et forums où des flux d’habitués
s’illustrent dans la volupté électronique (ou sa simulation). Cependant, pour
l’Amatorat adepte de ces pratiques, les limites textuelles de leurs communications
créeront bientôt un espace de doute, un sentiment d’incrédulité, un soupçon :
comment savoir en effet qui se trouve de l’autre côté du réseau ? S’agirait-il du vieux
pervers qui se fait passer pour une jeune fille en fleur ? Tout ceci relève d’une
stéréotypie du « travestisme informatique 56», comparable à celle qui a entouré
d’autres dispositifs (correspondances érotiques, appels téléphoniques anonymes,
minitel rose), et entretenue sporadiquement par les arrestations in flagranti de
quelques cas marginaux. Cette fois ci, la bonne foi de l’Amatorat qui aurait pu
continuer à être trahie, a été préservée par la technique. En effet, l’arrivée imminente
de moyens numériques de capture de l’image sur le marché donnera un nouvel élan
à ces amateurs, rassurés de visu et produisant eux-mêmes leurs propres photos et
vidéos.
Ces internautes « webcamés» comme les appelle Nicolas Thély57 seront
fondamentaux dans le développement chez les amateurs de nouvelles habitudes du
corps sémiotisé. Additions à Eliseo Verón : Il est là, je le vois, il me parle - et vice-
versa. En cette fin de siècle, le visionnage de l’autre se complète de la possibilité
d’être vu. Pas de montage, pas de contrainte de contenus, seuls ces pixels crus qui
décomplexent peu à peu l’Amateur de sa propre image et font de sa vie un flux
cinématique nu. C’est à ce moment que s’amorcent les deux composantes
essentielles du travail de l’Amateur en tant qu’Auteur : sur la promesse du « faites-
le chez vous », devenu réalité depuis les prémices d’Internet, s’articule désormais un
esprit du « Do It Yourself » traversant les domaines les plus divers du réseau.
Sous l’impulsion de ces innovations techniques qui incitent l’Amatorat à la
production, l’iconique fait maison explose et donne lieu à des formes hybrides telles 56 Nous empruntons cette expression à Allucquére Rosanne Stone dans son article « Le corps réel pourrait-il se lever ? » in Cyberspace : First Steps, sous la direction de Michael Benedikt, Cambridge, MIT Press, 1991, consulté sur http://www.rochester.edu/college/fs/publications/stonebody.html 57 Thély, Nicolas, Vu à la webcam – (essai sur la web intimité), Les Presses du Réel, Paris, 2002
42
que les photoblogs. La pornographie a sans doute été l’un des univers culturels où
les effets de cette conjoncture se sont ressentis le plus. Domaine historiquement
sensible aux innovations techniques, la pornographie amateur peut être conçue d’un
point de vue matérialiste comme une conséquence directe de la popularité des
caméras 16 mm58, puis des caméscopes et des formats grand public de la vidéo.
Dans cette perspective nous pouvons dire que la prolifération de moyens
numériques de production iconique est responsable d’une seconde génération
d’amateurs : si autrefois les laboratoires argentiques de confiance, des circuits plus
ou moins clandestins de vidéo-clubs, impliquaient des sommes pécuniaires et étaient
nécessaires pour se produire, l’équipement de l’internaute en webcams, appareils
photos et téléphones, semble avoir banalisé de manière générale le concept de prise
de vue.
Faites-le vous-même, faites le chez-vous, cela n’a aucun coût : sous cette injonction
tacite du réseau, nombreux sont les champs culturels qui explosent et la
pornographie n’est pas l’exception. Dans cette conjoncture se renouvelle un mythe
de l’Amateur qui le voit enfin redevenir personne ordinaire : des messieurs tout-le-
monde, des voisins et voisines d’à côte. A ce sujet, il y a douze mois la rubrique
« Ecrans » de Libération titrait avec véhémence : « Ton ex à poil sur la toile59 ». Tout
sauf de la prostitution, de l’auto-publication massive à tort ou à raison qualifiée de
pornographique. Faites-le vous-même, faites le chez-vous, cela n’a aucun coût, moi
aussi je le fais, voyez-vous : ces mythes de l’Amateur comme un average joe ou
comme une girl next-door participent à nos yeux de deux tendances fondamentales
préalables au « Web 2.0 » : d’une part, ils fonctionnent comme mécanismes d’un
désir mimétique d’exposition sur les supports ; d’autre part, ils assurent la
surabondance et la gratuité des contenus comme spécificité affirmée d’un imaginaire
du réseau.
En échange de sa participation l’Amateur reçoit dans les réseaux de socialisation les
contreparties sémio-économiques dont nous avons précédemment parlé (1.1.2) et 58 C’est le point de vue d’Eric Schaefer dans son article "Gauging a Revolution: 16mm Film and the Rise of the Pornographic Feature" in Williams, Linda (dir), Porn Studies, Duke University Press, 2004, p. 391
59 Seguret, Olivier, « Ton ex à poil sur la Toile» in Libération, 10 juin 2006
43
surmonte l’angoisse existentielle d’être une non-personne électroniquement parlant.
En tant que lieu de gratification symbolique contemporain, Internet articule pour
chaque Amateur « monde propre » et un « monde social » tous deux composites. Il y
a un tournant ici : à la lumière de l’écran et du jour, l’Amateur cesse d’être une figure
monomaniaque pour s’afficher comme un internaute de plus, qui aime certes les
corps, mais aussi la littérature, la technologie, la musique ou le foot. Autant de
facettes d’un Amatorat que de topoï sur lesquels peuvent s’opérer de multiples
identifications. Profilé comme un homme du commun, devenu une figure de
proximité relative, l’Amateur est de moins en moins l’objet de mythologies, il bascule
aisément vers le domaine de la prosopographie. En se produisant, il se laisse décrire
au sein d’un circuit de mutuelles observations, qu’elles soient pornographiques ou
non.
La pornographie réseautique en tant que écologie médiatique a pu intégrer au fil du
temps ces différentes mises en visibilité de son Amatorat, connaître la main qui
clique ainsi que son regard. Le résultat n’est autre qu’une spécialisation graduelle
des goûts parallèle à une diversification des pornographies sur différents supports.
Nombreuses sont les galeries qui depuis une décennie continuent à proposer une
offre encore structurée sur la dichotomie basique softcore / hardcore ayant comme
critère d’organisation l’absence ou présence de formes de génitalité explicite
(pénétration, masturbation, éjaculation) dans la représentation. Ces stades binaires
de la pornographie semblent lointains : par ces seuils du hard et du soft, ils
reproduisent les lignes de la censure ou le statut des acteurs dans leur conception
de la représentation, plus qu’il ne traduisent les préférences d’un Amateur. Il ne
pouvait être autrement pour une figure longtemps restée méconnue. La prise de
parole de l’Amatorat et son intervention en tant qu’Auteur sont des phénomènes
récents auxquels les pornographes sont désormais particulièrement sensibles. Nous
parlerons de quelques exemples de pornographie postérieure à cette explosion
amateur qui en termes d’esthétique de la représentation et de stratégies de
segmentation vont dans le sens d’un renouveau, d’une majeure circulation et a
fortiori d’un moindre rejet (qui vaudrait acceptation) de contenus qui à la croisée
d’imaginaires composites n’apparaissent plus comme étant exclusivement
pornographiques.
44
1.2.3. Au rendez-vous des pornographies émergentes
En faisant abstraction des contraintes juridico-réglementaires qui font sa spécificité,
l’industrie pornographique fonctionne comme les autres industries culturelles :
derrière les productions, se joue toujours une vie de business-model ponctuée par
les enjeux de rites communicationnels. Dans le cas de l’adult industry, selon
l’expression consacrée, c’est depuis 24 ans que chaque mois de janvier Las Vegas
accueille les acteurs du secteur participant à l’AVN Adult Entertainment Exposition,
évènement sous lequel l’écologie médiatique pornographique que nous avons
décrite se recrée sous forme de salon.
Au cours des quinze dernières années, la part des exposants venus d’Internet et des
thématiques liées à l’expansion du X informatisé s’est accrue de façon considérable.
Cependant, à l’intérieur de cette branche réseautique, on observe depuis 2001 un
renouvellement radical de l’offre pornographique. La structuration de celle-ci -tel que
nous l’avons évoqué- se faisait jusqu’alors sur des critères d’orientation sexuelle
(héterosexuel/homosexuel), des critères physiques (âge, race, proportions) ou enfin
sur la nature de certains actes sexuels particuliers ou fétiches. A partir de ces trois
bases classificatoires trois grandes catégories respectives de pornographie peuvent
être distinguées : des pornographies genrées (straight/gay porn), des pornographies
du casting (Lolita, Asian, Latina, Mature, etc) et des pornographies de la
performance (Bondage, SM, Anal, Hardcore, etc.). Cette taxinomie, à l’œuvre dans la
production et tri de contenus, avait longtemps été efficace et semblait être
exhaustive : elle donnait une lisibilité au champ pornographique tout en fournissant
des formules de représentation. Toutefois, sous l’influence des productions amateur
une nouvelle grande catégorie fera irruption, modifiant l’équilibre des genres
existants : il s’agit de ce que nous appellerons des pornographies du réel, dans la
mesure où la réalité de la représentation qu’elles proposent émerge comme critère
primordial dans la (re)structuration d’une offre globale qui semblait avoir atteint un
point stable.
Loin d’une problématique d’ordre strictement ontologique, le « réel » proposé par ces
pornographies émergentes peut s’exprimer comme conflit de langages expressifs :
dans cette perspective elles correspondent à une variante technicisée du réalisme
45
pour la quelle la prétention au réel se traduit en écarts manifestes par rapport au
langage stabilisé des fictions pornographiques. En effet, peu de domaines de la
culture (audio)visuelle occidentale ont connu un processus de stéréotypisation aussi
intense que la fiction pornographique, comparable en ce sens aux sitcoms et aux
telenovelas. En faisant nôtre une expression barthésienne, nous pouvons dire que la
standardisation progressive des constructions fictionnelles en pornographie a abouti
« moins à abolir l’érotisme qu’à le domestiquer60» : cadrée, rationalisée,
industrialisée, ‘aseptisée’, la fiction pornographique aura souvent recours à une série
de formules de réalisation61. Les traits principaux de cette domestication fictionnelle
peuvent être résumés comme suit : ( 1 ) schémas narratifs simplifiés où l’intrigue
concerne le passage de la rencontre à une performance sexuelle téléologique ; ( 2 )
acteurs ressemblants, poids et tailles moyens, protubérances érogènes, corps
athlétiques épilés pour mettre en valeur ces dernières, absence de tatouages,
maquillage de plateau ; ( 3 ) quant à l’acte lui-même : séquences ordonnées de
pratiques (anales, orales, génitales) correspondant chacune à des plans différents,
combinatoire des positions avec préférence pour la levrette et la position connue
comme reverse cowgirl accordant une visibilité maximale au corps de la femme62 ;
( 4 ) luminotechnie de studio et édition du son ajoutant interjections de plaisir et/ou
musiques synthétiques jugées érotiques aux voix (souvent doublées) des acteurs.
A l’égard de ce modèle hégémonique de production fictionnelle, ces pornographies
émergentes dans leur revendication du « réel » se distancieront d’abord en adoptant
des critères formels antagoniques sur ces quatre points, puis en modifiant le rapport
du spectateur à la construction elle-même. Deux contre-exemples emblématiques
peuvent illustrer les tendances transgressives de ces pornographies réseautiques
que journalistes, usagers, académiciens et pornographes ont pu qualifier à quatre
60 Roland Barthes au Moulin Rouge souligne ainsi les tentatives de « donner au strip-tease un statut petit-bourgeois rassurant » dès sa présentation, “Strip-tease”, in Mythologies, Paris, Seuil, 1957. 61 En pornographie, comme en musique pop, la critique Anglophone appose à ces constructions l’adjective formulaic pour souligner leur caractère stéréotypique. 62 Une critique féministe de la pornographie dénonce ce point comme mise en scène de la domination masculine à la suite des travaux d’Andrea Dworkin, notamment son ouvrage Pornography: Men Possessing Women, New York Plume, 1979.
46
mains de reality porn ou altporn. Le premier d’entre eux est celui de Bang Bus63,
archétype du reality porn, qui depuis 2002 présente des femmes qui sont
approchées alors qu’elles marchent dans la rue et auxquelles on propose impromptu
de monter dans un van pour des pratiques sexuelles. De ce fait l’intrigue est le fruit
de constantes négociations : sélection, persuasion et exécution relèvent d’une co-
construction entre les parties prenantes. A l’intérieur du van, chauffeur, caméraman,
acteur et invitée ont tous des rôles, des corps et des statuts bien différents. Cet
ajustement interactionnel permanent structurera l’intrigue de façon différente. Au-
delà de cette tension situationnelle, la composante reality de la représentation sera
accentuée par certains choix esthétiques : notamment le style gonzo de tournage,
c'est-à-dire camera à la main filmant à la première personne et l’absence d’édition, à
l’exception des génériques d’ouverture/clôture. Ainsi sur le plan visuel apparaîtront
réels de façon contrastive les corps sans maquillage, non-épilés, à la lumière du jour,
livrés à l’exercice d’une pornographie improvisée et ambulante. Quant à l’audio, il
sera souvent question d’un tetralogue à bâtons rompus entre tous les passagers,
souvent cacophonique, parasité des bruits de la ville et du moteur, et des coprolalies
proférées par les partenaires de l’acte. Ces caractéristiques inusuelles, en nette
rupture sémiotique avec les fictions pornographiques traditionnelles, vaudront à Bang
Bus une grande notoriété. Chaque épisode destiné en exclusivité au site Internet
Bangbus.com, sera attendu, commenté par un Amatorat participant à des forums
voire des fanclubs. En outre, les épisodes téléchargés seront remis en circulation par
des amateurs sur des réseaux de partage peer-to-peer. A cet égard, la réalité de
Bang Bus ne se borne pas au codage brut d’une rencontre aléatoire, elle concerne
aussi son statut d’objet trivial accomplissant une fonction de ciment social. Pour une
pornographie, habituellement considérée comme pomme de la discorde et forme
paroxystique de l’asocial, cette emprise positive sur le réel constituera un passage
significatif dans l’évolution de son image.
Un second exemple emblématique de ces pornographies du réel est celui de Suicide
Girls, communauté internationale de jeunes filles volontairement reconverties en pin-
ups, à l’origine de l’alt porn. Dans son cas, la transgression des conventions
fictionnelles sera dans un premier temps d’ordre programmatique. En effet, lors de
63 http://www.bangbus.com
47
sa fondation en 2001, la priorité du site était de développer une pornographie
alternative, dans la mesure où celle-ci ne serait pas hétérocentrée et privilégierait de
ce fait des corps non soumis aux canons de la pornographie fictionnelle masculine64.
Ainsi verra-t-on apparaître sur le site des corps tatoués, maigres, androgynes ou
obèses longtemps exclus de l’écran pornographique. Comme pour Bang Bus, ces
filles s’inscriront dans une démarche volontariste mais iront plus loin dans la mesure
où elles accèderont au statut d’Auteur en tant que responsables de leur figuration.
Par conséquent, maîtresses de leur corps, elles décideront de leurs looks, de leurs
partenaires, de leurs actes en situation et choisiront aussi leur bande-son selon leurs
goûts, souvent du punk rock. Cette pornographie ‘incarnée’ intègre dès lors le tissu
culturel complexe dans lequel évolue chaque individu. Cette évolution individuelle se
poursuivant même en dehors de l’espace représentationnel exporte le
pornographique dans l’interpersonnel. Lorsque les Suicide Girls se constitueront en
tant que portail communautaire, pour l’Amatorat la figuration pornographique
comptera autant que la dynamique des groupes sociaux. Des filles amatrices du
monde entier créeront aussi leurs profils de pin-ups et téléverseront les images de
leurs corps nus ou non parmi d’autres fragments de leurs vies pratiquant la sélection
et la publication comme exercices auctoriaux principaux.
Bang Bus et Suicide Girls demeurent les antécédents historiques de la « longue
traîne65 » de sites ayant participé à l’expansion des niches du reality porn et de l’alt
porn au cours des cinq dernières années. Par la suite ils ont capitalisé leur notoriété
en diversifiant leur offre à travers l’édition de DVD et la vente de produits dérivés. Si
au-delà de ces niches, nous estimons leur impact dans la vie globale du réseau,
nous pouvons juger qu’ils ont été des vecteurs d’acceptabilité grand public
(mainstream acceptability) de nouvelles formes de pornographie médiée par
ordinateur. En parfait accord avec l’exercice de conceptualisation sous forme de 64 En contre-pied des postures féministes anti-pornographiques d’Andrea Dworkin, l’enjeu de Suicide Girls était de se revendiquer «women-owned and women-operated » dans une perspective de genres sexuels post binaires. 65 Le concept de long tail, traduction en français « longue traîne », a été proposé par Chris Anderson, éditeur de l’influente revue digitale Wired, pour décrire la structure concurrentielle des marchés mis en évidence par Internet : Anderson observe que bien que les bestsellers soient toujours en position de peloton détaché, le développement du Web collaboratif a contribué à visibiliser des concurrents minuscules, non-négligeables appartenant à des niches irréductibles. Sur une courbe croisant l’offre et la demande, cette image décroissante donne l’impression d’une longue traîne correspondant à une myriade de parts de marché convoitables. Cf. Anderson, Chris, The Long Tail, Hyperion, New York, 2006
48
trajectoire auquel nous nous sommes livrés dans le chapitre précédent (1.1) autour
de l’Auteur et l’Amateur, nous pouvons signaler de façon précise les enjeux de cette
phase cruciale d’émergence du « réel » dans le réseau : il fallait d’une part habituer
l’Amatorat à une offre changeante, à géométrie variable, dont il co-créerait la valeur
en exprimant son opinion ; il fallait d’autre part habituer l’auteur à être pornographe
de soi même, à numériser des fragments de sa vie sans pudeur.
Pour l’édition 2007 du grand salon pornographique d’expositions, la grande
nouveauté était l’arrivée attendue de sites collaboratifs parmi lesquels Xpeeps.com
auquel nous consacrerons la deuxième partie de ce mémoire. En ayant à l’esprit que
la principale caractéristique des sites collaboratifs est la réversibilité existante entre
les statuts d’Auteur et d’Amateur, nous approcherons ce site particulier en tant
qu’exemple pornographique d’un certain devenir du réseau. A l’heure où une
constante alternance production-consommation rythme nos navigations, un écran
transactionnel-libidinal surgit devant nos yeux. Derrière les pixels, dans la continuité
de notre réflexion, questionnons les formes intimes de l’Auteur-Amateur, exposons-
nous à son exposition, soyons tout yeux pour les constructions protéiformes qui
articulent le réseau à son ego.
***
49
II. L’EXEMPLE PORNOGRAPHIQUE
2.1 XPEEPS.COM : LA FENÊTRE DU VOYEUR ?
Le 7 janvier 2007 le site collaboratif Xpeeps.com a été officiellement lancé, après le
succès rencontré pendant les huit mois d’expansion de sa version bêta. Crée par la
compagnie AEBN Network, société de Caroline du Nord originellement spécialisée
dans la vidéo à la demande (VOD), le site a été présenté comme « le MySpace du
porno ». En effet, son communiqué de presse le présentait comme « une
communauté gratuite en ligne permettant à ses membres de créer leurs profils et
réseaux sociaux. La différence vient de l’absence de censure et de sa dominance
porno. » Parallèlement, AEBN présentait aussi PornoTube, clone de YouTube rentré
dans le top 20 des sites les plus visités la semaine même de son lancement.
Cette apparition de supports délibérément cloniques des étoiles du moment peut être
comprise comme une réaction à l’exclusion systématique des contenus explicites sur
les sites collaboratifs dominants comme politique draconienne de gestion d’un risque
d’opinion jugé trop important. Ainsi, la part de contenus créée par les utilisateurs et
rejetée a posteriori par les administrateurs a donné lieu à une offre et une demande
flottantes récupérées par les nouveaux supports en question. A l’heure actuelle,
Xpeeps compte 430000 profils, occupe le rang 4583 des sites les plus visités sur
l’Internet mondial et ses membres visitent en moyenne 23 profils hébergés dans son
enceinte66. Notre corpus prélève le double de cette moyenne (la page d’accueil en
moins) : quarante-cinq espaces. A longueur de 45 clics, quel type d’auteurs pouvons-
nous voir ? Après avoir effectué une analyse du dispositif, chacune de nos
hypothèses sera confrontée aux productions étudiées.
2.1.1. Préalables techno-sémiotiques : l’imaginaire du peep show.
Selon l’expression latine nomen omen, le nom est un présage. Cette locution elle-
même dépositaire du sens de la maxime réaliste de l’Empereur Justinien nomina
66 Sources : Traffic Rank and Page Views per user for Xpeeps.com – Alexa Traffic Search - Alexa.com et Newsletter d’Xpeeps.com du 20/03/2007.
50
sunt consequentia rerum veut donc que les noms soient les conséquences des
choses67. Confrontés à l’analyse d’un site web, notre point de départ, à l’aune de cet
adage, n’est autre que le nom qu’il porte comme premier poste d’interrogation. Le
monde d’Internet en effet est le lieu d’une série de combats onomastiques autour
« des enjeux de pouvoir et d’identification qui se cachent derrière l’attribution des
adresses68 ». En pornographie, cette situation est d’autant plus radicale : l’exemple
le plus célèbre reste incontestablement celui du site pour adultes Whitehouse.com
qui avait en son temps suscité la rage de l’administration Clinton69.
Les prétentions à la fois pornographiques et collaboratives d’Xpeeps.com expliquent
sans doute le choix de son nom. X, en tant de sème renvoie à la nature explicite des
contenus. Comparativement, cette lettre qui à la base n’était qu’une unité américaine
de censure, peut même fournir des informations sur l’intensité de cette
pornographie : étant donné le nombre de sites utilisant le triple X dans son nom, X
par rapport à XXX s’inscrit dans une échelle de gradation70. De son côté, peeps
renvoie à la rencontre visuelle. A l’origine, le peep show, comme exhibition d’un
spectacle vu au travers d’une ouverture n’avait pas de connotation érotique si ce
n’est celle du montrer et du voir. Aujourd’hui, l’acception dominante du terme renvoie
à un spectacle de striptease en cabines. Dans ce transit sémantique historique,
peeps souligne surtout la nature de l’écran comme dispositif du voir. Vu dans son
ensemble, Xpeeps comme nom réfère donc à des représentations visuelles
explicites que Roland Barthes qualifierait d’«hystériques» en ce qu’elles ne se
constituent que si on les regarde71. Ce trait éminemment collaboratif de la relation
voyeur/objet est accentué ici : l’Amateur est co-auteur de l’Auteur qui se produit.
67 Justinien, Institutions, Livre II, 7,3 68 Nous rejoignons sur ce point l’observation d’Yves Jeanneret et alli, Chapitre II, encadré 7 : l’URL comme signe d’identité, à propos de « ogm.org » in Lire, écrire, récrire, objets, signes et pratiques des médias informatisés, Paris, BPI, 2003, p. 139, 140. 69 Les internautes voulant visiter le site de la Maison Blanche ne s’y rendaient par erreur faute de familiarité avec l’extension de domaine gouvernementale du site officiel Whitehouse.gov 70 A ce sujet, William Rotsler, historien du cinéma érotique signale avec humour « the XXX-rating means hardcore, the XX-rating is for simulation, and an X-rating is for comparatively cool films » in Contemporary Erotic Cinema, New York, Penthouse Ballantine Books, 1973, p.251 71 Dans La Chambre Claire, Roland Barthes juge hystérique en ce sens la tension entre l’Histoire et son partage. La Chambre Claire, in Œuvres Complètes, Tome 5, Paris, Seuil, 2002 p. 842
51
L’imaginaire du peep show est donc celui où se rencontrent l’envie et l’interdit. Ceci
nous rappelle l’ultime peinture de Marcel Duchamp, qu’il ne voulut rendre publique
qu’après sa mort. Le tableau intitulé Étant donné : 1. La chute d’eau, 2. Le gaz
d’éclairage72 mettait en effet son spectateur devant une vielle porte de bois percée
de deux trous à hauteur d’homme. Ce qui était donné à voir par ces orifices n’était
autre chose qu’une scène représentant une femme nue, les jambes écartées.
Couchée dans l’herbe et tenant une lampe à gaz dans sa main, elle surprend son
spectateur par son réalisme comme corps émergent en trompe l’œil du paysage.
A l’instar de ce coup de nez posthume duchampien, le dispositif d’Xpeeps.com
modifie le rapport à l’iconique en demandant un engagement spectatorial conscient.
De retour aux matières informatiques après ce bref détour par la technique picturale,
nous interrogerons la mise en scène techno-sémiotique qu’Xpeeps propose des
corps à l’écran, ayant à l’esprit que ceux-ci ne se constitueront qu’en cliquant et en
regardant.
2.1.2. L’Architexte : masque ou corset de l’Auteur-Amateur
D’un point de vue technique, tous les contenus d’Xpeeps constitués en pages web
sont traités de façon logicielle par des Systèmes de management du contenu ou
CMS. Ces outils logiciels qui - comme le rappelle Valérie Jeanne-Perrier dans son
article Des outils d’écriture aux pouvoirs exorbitants ?- permettent à l’Auteur de
mettre en ligne ses productions faute de maîtrise du langage html et du protocole de
transferts FTP, sont disponibles en ligne et façonnent de manière forte tous les sites
autopubliés73. A cet égard, Xpeeps.com dont le dispositif est un clone de Myspace
génère à partir d’un complexe CMS des espaces web personnels appelés Profils que
par la suite les auteurs pourront actualiser et interconnecter.
Dans la pratique, l’ouverture d’un compte comporte les étapes suivantes : ( 1 )
déclaration à valeur juridique de sa majorité d’âge (la date de naissance est
72 Cf. Annexe 3 p. 116 Tableau de Marcel Duchamp : Étant donné : 1. La chute d’eau, 2. Le gaz d’éclairage 73 Jeanne-Perrier, Valérie, Des outils d’écriture aux pouvoirs exorbitants ? in Réseaux, volume 24 n° 137, « Autopublications », UMLV/Lavoisier, mai-juin 2006, p.99
52
sollicitée) après prise de connaissance d’un avertissement destiné aux
personnes facilement choquées ou offensées, ou appartenant à des communautés
dont les normes n’autorisent pas le visionnage de matériaux érotiques adultes74 ( 2 )
choix d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe ( 3 ) présentation d’une adresse
mail valide. La première étape concerne un passage de rigueur pour tous les sites
portant le label restricted to adults (RTA). Quant au choix du nom, celui-ci marque la
genèse baptismale de l’Auteur, il s’agit du pseudonyme par lequel il sera reconnu et
de ce fait fonctionnera comme concept fédérateur de tous les pixels auctoriaux quel
que soit leur format autour d’une seule et même identité énonciative. Enfin, le mot de
passe, relève de la prérogative auctoriale de verrouiller l’accès de tiers aux positions
de contrôle du système de management de contenus. Toute modification du compte
sera communiquée à l’adresse mail fournie, ainsi qu’éventuellement une lettre
d’information sur les nouveautés d’Xpeeps.com
Par la suite, l’Auteur est confronté au noyau de son travail : la gestion sémiotique de
son profil qui sera socialement sa façade personnelle, et de sa galerie photo qui à un
clic de distance du profil constituera une sorte de jardin intérieur. Pour gérer ces
deux espaces à sa charge, l’Auteur est placé dès la page d’accueil à chaque
navigation face à un tableau de bord comportant six fonctions : ( 1 ) Voir profil ( 2 )
Voir votre galerie ( 3 ) Éditer mon profil ( 4 ) Ajouter/éditer des photos ( 5 ) Voir
commentaires ( 6 ) Vidéos préférées. Les deux premières options relèvent de ce
qu’Edgar Morin pourrait appeler une hétéroscopie75 : se regarder soi-même comme
un autre, en absence de l’autre. En effet, dans ce huis clos qu’est le tableau de bord,
la possibilité de voir son propre profil ou sa galerie, postule pour l’Auteur l’opération
de devenir son propre Amateur : cette possibilité de regard amatorial sur la
production auctoriale anticipe une nécessité de décentrage par la prévisualisation
des modifications que l’utilisateur effectue sur son profil ou sa galerie. La troisième
fonction n’est plus hétéroscopique : proposée à la première personne, l’édition de
mon profil présuppose un rapport possessif à l’égard de l’espace web. Ajouter/éditer
des photos concerne à son tour le téléversement, agencement ou suppression des
images de sa propre galerie à la manière d’un album personnel. La fonction Voir 74 cf. Annexe 4-A p.117 – Register : Interface d’inscription à Xpeeps 75 Edgar Morin en dialogue avec François Soulages, « 13° Dialogue, Réflexion, Création & Image » Maison Européenne de la Photographie, 13 février 2007.
53
commentaires rappelle en effet que l’Auteur n’est pas le seul à publier sur son profil :
sur la page, l’espace discursif du moi cohabite avec celui d’autrui76. Enfin, la fonction
Vidéos préférées sert à constituer une collection de favoris et nous rappelle que la
société propriétaire d’Xpeeps est à l’origine spécialisée dans la vidéo à la demande.
Nous nous concentrerons sur le profil et la galerie comme résultats du parcours
auctorial proposé par ce tableau de bord CMS. Dans cette perspective, nous
convoquons le concept d’architexte tel qu’il a été développé par Yves Jeanneret et
Emmanuël Souchier, pour désigner ces « outils d’écriture situés en amont77 » qui
sont à l’origine et commandent des productions à l’écran. La nature hautement
balisée du travail auctorial sur Xpeeps.com relève donc d’une rigide conception
architextuelle du processus d’autopublication qui tend certes à faciliter des tâches
mais aussi à rendre les profils et les galeries uniformes, isotopiques, créant de ce fait
une discipline du regard. Ainsi, confronté à l’édition de son profil, la tâche de l’Auteur
est allégée par un CMS pré-éditeur qui a déjà standardisé et structuré le processus
de création comme un cheminement de demandes de clics, d’information et de
contenus. Choisir et remplir seront donc les gestes attendus par les boîtes de textes
et les menus déroulants générant ces deux espaces principaux.
A. Se profiler pour son profil : acheminement de l’Auteur De haut en bas et de gauche à droite, conformément aux habitudes dominantes de
lecture à l’écran en Occident, les profils se structurent à partir d’informations publiées
et demandées comme suit : en ce qui concerne les « infos personnelles78 », on
demandera ( 1 ) prénom et nom « qui ne seront révélés à personne sur le site ; utilisé
seulement dans les recherches de vos amis par nom. » ( 2 ) Informations générales :
taille en pieds et pouces, groupe ethnique d’appartenance (Asian, Black, East Indian,
Latin/Hispanic, Middle Eastern, Native American, Pacific Islander, White/Caucasian,
Other au choix.), genre (Male, Female, Transgender, Couple), type de corps
(Slim/Slender, Athletic, Average, Some Extra Baggage, More to Love, Body Builder).
Jusqu’ici, ces demandes d’information personnelle placent l’Auteur dans un espace
76 Annexe 4-B p. 118 capture Espace de soi vs espace d’autrui 77 In op.cit, p. 23-24 78Annexe 4-C p.119 Infos personnelles : Interface d’inscription à Xpeeps
54
de vérité : vérité sur son nom s’il veut être trouvé, vérité sur sa taille, genre, type de
corps et ethnicité comme évaluation de son propre corps par rapport aux variables
biométriques maniées par le moteur de recherche d’Xpeeps.com. Nous noterons au
passage le découpage ethnique américano-centré stimulant les fantasmes de sexe
interracial ou plus simplement le grégarisme communautaire au sein d’une société
multiculturelle, ainsi que la discrète axiologie normative à l’œuvre dans la proposition
de types de corps où toute forme de surpoids est présentée avec humour auto-
dérisoire. Lorsque l’Auteur mettra des photos en ligne, celles-ci feront office de
preuve par l’image corroborant ou infirmant la véridicité de ces informations selon la
convergence ou divergence des renvois sémiotiques du textuel à l’iconique.
Le parcours de création du profil se poursuit par la demande d’« informations
basiques79 » parmi lesquelles : ( 1 ) Nickname : plus que d’un simple pseudo, il
s’agit ici du nom d’Auteur comme identité énonciative fédératrice et propriétaire du
profil éponyme. ( 2 ) Headline : ceci est le sous-titre qui figurera en dessous du nom
à la manière d’un slogan, d’une maxime où d’une clé de lecture du profil. ( 3 )
Localisation actuelle : ville, code postal, État et pays. ( 4 ) About me : espace textuel
de présentation de soi répondant à la question implicite qui je suis ( 5 ) Qui j’aimerais
rencontrer ( 6 ) Page personnelle : URL si c’est le cas. ( 7 ) Messageries
instantanées : possibilités de contact par ICQ, MSN Messenger, Yahoo Messenger
ou AIM d’America Online. ( 8 ) Je suis ici pour : Sorties, Relations, Réseautage,
Amitié. ( 9 ) Pour conclure : Tabac / Alcool ? Oui / Non. Cette étape de la publication
est peut-être la plus dense du processus. Elle place l’Auteur dans un espace
d’implication face auquel il est obligé de s’auto-définir. Nous ne sommes plus dans
l’évaluation factuelle de l’étape précédente. Ici disparaissent les menus déroulants
pour laisser l’Auteur et son curseur face à des questions ouvertes suivies boîtes de
texte vides. Nombreux sont ceux qui préféreront ne pas répondre. En effet, c’est le
moment de plus grande liberté discursive du processus d’autopublication et de ce fait
le plus responsabilisant : l’Auteur est responsable en même temps de son baptême,
de son maître-mot, de son ancrage territorial, d’un récit introductoire autoréférentiel,
de la définition de son horizon d’attentes sur Xpeeps.com. Tout tend à donner forme
à une identité qui se déploie dans d’autres lieux du réseau et qui se complète de
79 Annexe 4-D p.120 Informations basiques : Interface d’inscription à Xpeeps
55
pratiques concrètes comme boire et fumer : qui héberge-t-on est la question sous-
jacente à toutes ces informations basiques et discriminantes, étrangement
semblables à celles qu’on demande lors d’une mise en collocation.
Un troisième round de demandes d’information concerne le « Style de vie80 » de
l’utilisateur, les variables demandées sont : ( 1 ) Occupation ( 2 ) Orientation
(sexuelle) : pas de réponse, bi, gay, straight ou pas sûr précisent l’intérêt sexuel
subjectif au-delà du genre qui était lui abordé sur des critères physiques objectaux.
( 3 ) Religion : 15 modalités de réponse par ordre alphabétique ( 4 ) État marital :
swinger, célibataire, dans une relation, divorcé ou marié ( 5 ) Enfants : pas de
réponse, je ne veux pas d’enfants, un jour, indécis, j’aime les enfants mais pas pour
moi ou heureux parent ( 6 ) Éducation : six niveaux de High School à Post-grad, et
enfin, dans une tradition très anglo-saxonne ( 7 ) Revenu : 8 fourchettes allant de
moins de $30,000 à $250,000 et plus. Dans ce temps de l’interrogatoire, l’espace de
définition proposé à l’Auteur suppose de sa part qu’il fournisse son positionnement
social. Cette remise en situation de l’Auteur dans le tissu sociétal rappelle ici la
lecture de la méthode onirocritique d’Artémidore effectuée par Michel Foucault : en
effet, Foucault note que dans ce cadre hellénique d’analyse du songe sexuel, au-
delà des traits physiques le rapport du rêveur à son partenaire sexuel s’exprime
essentiellement en termes de profils sociaux81. Pour l’Amateur, il sera donc question
de décrypter ces différentes variables (statutaires, professionnelles, économiques)
retenues par le dispositif comme vecteurs de désirabilité sociale. Observons enfin
certaines préférences induites par ces menus déroulants : du côté de l’état marital,
swinger que Myspace France traduit par libertin est proposé en tête de liste, et
marié occupe la dernière place. En ces temps où le « cyber-adultère » commence à
être invoqué comme cause de divorce, l’Auteur doit aussi exprimer une conception
du familial. Celle-ci concerne aussi la variable enfants, qui est ici traitée avec
légèreté pour faciliter sa cohabitation avec l’univers de la pornographie sociale.
80 Annexe 4-E p.121 Styles de vie : Interface d’inscription à Xpeeps 81 « C’est également comme « personnages » que les partenaires représentés dans le songe sont envisagés. (…) Ils n’apparaissent que comme des profils sociaux : des jeunes, des vieux (…), des riches ou des pauvres ; ce sont des gens qui apportent des richesses ou demandent des cadeaux ; ce sont des relations flatteuses ou humiliantes. » in Foucault, Michel, Histoire de la Sexualité, Tome 3, Le Souci de Soi, Paris, Gallimard, 1984, p. 42
56
La quatrième et dernière étape de demande d’informations concerne les centres
d’intérêt de l’Auteur proposant cinq boites de texte vides libellées comme suit : ( 1 )
Général, ( 2 ) Musique, ( 3 ) Films, ( 4 ) Télévision, ( 5 ) Héros. Dans ces cinq
domaines, l’Auteur se constitue en Amateur : il y cite des références culturelles aux
valeurs sociales variées qui pouvant être partagées par d’autres amateurs
fonctionnent comme topoï intersubjectifs d’identification. Dans cet espace de
publicisation du goût, nous remarquerons que les intérêts pour la pornographie
seront souvent mentionnés dans la rubrique Général. De même, par rapport à
Myspace, ici la catégorie livres disparaît au profit d’une catégorie télévision. Ceci
préfigure un Amatorat aux pratiques culturelles sous-évaluées, excluant de fait la
possibilité de constituer aussi un Lectorat, comme biais architextuel.
Par ailleurs, l’architexte prend en charge les possibilités de présentation du
document en proposant à l’Auteur des feuilles de style en cascade ou CSS pour une
mise en forme prédéterminée de son profil. Ces configurations donnent une
épaisseur scénique et sémiographique au langage html : en effet, l’Auteur copie/colle
dans une boite de texte des séquences préfabriquées de code source contenant les
informations des couleurs, polices et fonds relatives à la publication de ses données.
L’utilisateur peut aussi, s’il le souhaite, affecter ces critères formels à tous les profils
d’Xpeeps.com dans son expérience de visionnage individuel pour des raisons de
goût ou de confort. De façon sous-jacente, l’Auteur est ici confronté à un espace de
customisation survalorisé qui marque son accomplissement éditorial. Dans les faits,
peu d’auteurs iront aussi loin, découragés par l’aspect cryptique du langage html,
même si son maniement au sein des profile editors auxiliaires est lui très balisé.
B. Se mettre en exposition : la galerie de l’Auteur Ayons à l’esprit que le slogan d’Xpeeps n’est autre que Xpose yourself. Tous les
espaces du dispositif sont couronnés de cette injonction consubstantielle au concept
du site et inscrite sur son logo. Xposez-vous est donc l’injonction adressée aux
auteurs amateurs : comment l’interpréter ? Nous pouvons estimer que toutes les
informations que l’Auteur délivre dans l’acheminement architextuel que nous venons
de décrire relèvent déjà du domaine de l’exposition. Cependant, étant donné les
connotations imagologiques véhiculées par le peep show comme mode d’exposition,
57
le noyau de cette injonction contient une demande claire de matières iconiques en
provenance de l’Auteur.
Le lieu où se concentrent ces contenus iconiques auctoriaux est la galerie
photographique. La téléologie du peep show veut que l’image ne se constitue qu’au
regard du voyeur ; dans cette perspective, le profil malgré sa densité informationnelle
est relégué au rang d’antichambre d’une navigation orientée vers l’établissement de
contacts visuels avec le corps de l’Auteur. Si l’architexte de la création du profil
répond à la question de la construction identitaire, celui de la galerie quant à lui
n’obéit qu’à la question du faire corps. On attend de l’Auteur sa production en peep
show. Pour ce faire, le tableau de bord du CMS inclut la fonction Ajouter/Éditer des
photos. Derrière elle, une interface classique de téléversement avec deux boutons
parcourir et upload : ainsi exporte-t-on ses photos du disque dur vers un serveur. Le
rôle de l’Auteur s’arrête ici, au stade de publicisation, le logiciel prend en charge la
question de la publication. Le processus se déroule sous la consigne enthousiaste :
« partage tes photos et expose-toi ».
Loin des trous duchampiens à hauteur d’homme, la version électronique du peep
show est l’héritière directe des dispositifs développés par la pornographie
réseautique. Ces dispositifs que nous avons commentés dans le chapitre précédent
(1.2.2) ont défini une discipline du regard consubstantielle à une pensée de la
galerie. Les photos de l’Auteur sont ainsi publiées par le CMS sous la forme
d’une mosaïque d’images de taille réduite : un peu plus grandes que les thumbnails
d’antan, mais pas assez pour satisfaire l’esthésie du voyeur. Pour passer des
aperçus brefs et multiples au contact frontal avec le corps de l’Auteur, l’Amateur doit
donc sélectionner et cliquer sur l’icône de sa prédilection. La métaphore du clic
comme moyen d’accès revêt ici quelque chose de charnel : elle incarne la démarche
volontariste de s’exposer au corps en exposition.
Qu’il s’agisse du profil ou de la galerie, l’architexte d’Xpeeps confronte l’Auteur à une
problématique d’assemblage de matières sémiotiques en permanence. Le faire corps
résulte d’un assemblage d’images corporelles fédérées par l’identité polyfacétique
que le CMS préfigure au préalable. La figure archétypique préexiste, l’Auteur-
Amateur n’est que responsable de sa propre figuration. Il sémiotise sa vie au travers
58
de catégories invariables qui la rendent lisible comme texte tissu de fils discursifs
sociaux. Et c’est cette vie en rien biologique qu’il donne à son corps. De la contrainte
architextuelle naît donc la poétique de la personne. Périmétrage et paramétrage sont
les deux opérations auxquelles se livre l’Auteur ; celles-ci pourraient à première vue
supposer un rapport de contenance, tel le masque qui contient le crâne d’un homme.
Or, la question n’est pas matérielle mais symbolique : ce n’est pas le masque lui-
même mais l’obligation de son port qui rend à l’existence chaque auteur. Il s’agit bel
et bien d’un rapport de projection (malgré la contenance) : être Auteur de l’Auteur, tel
est le mystère des architextes qui jouent avec les tautologies de la persona.
2.1.3 L’Interface et l’Interaction : du fonctionnement technique aux fonctionnements sociaux A l’âge du « web 2.0 », l’ingénierie textuelle sous-jacente à tout dispositif se voit
doublée d’une ingénierie sociale inhérente aux prétentions de collaboration. Tel que
nous l’avons décrit, l’ingénierie textuelle définit des cadres de publication.
L’ingénierie sociale quant à elle s’occupe d’anticiper des cadres de participation. Le
sens de cette analogie correspond en effet à deux moments distincts de l’action de
l’Auteur : le premier est celui du processus d’auctorialisation, le second est celui d’un
Auteur-Amateur en communauté sur lequel nous nous concentrerons.
La vie communautaire d’un site de social networking comme Xpeeps.com relève en
large mesure d’un travail d’anticipation des usages et de préfiguration des rôles.
Quant aux rôles, ceux-ci sont statutaires : chaque membre est tour à tour Auteur ou
Amateur, toutefois la nature du rapport amatorial fait l’objet de distinctions. En effet,
sur les profils, on note bien que l’interface ségrégue deux groupes sociaux : les amis
et les peeps. Les peeps sont classés comme tels en raison de leur appartenance à
l’industrie pornographique, ce sont des professionnels étant de ce fait séparés de la
communauté amateur. Les interactions, comprises ici comme échanges de pixels
auctoriaux, prennent entre ces classes deux modes relationnels principaux : de
l’Amatorat vers les pornstars le rapport sera d’admiration ascendante, de fanatisme
si l’on veut ; des professionnels du métier vers les amateurs, a contrario, la liaison
sera publicitaire, l’Amatorat sera en effet constitué en cible de contenus
promotionnels ou commerciaux. Ce cas de figure est semblable à celui de Myspace
59
dans sa mise en relation de fans potentiels avec des groupes musicaux signés sur
des majors. D’un point de vue marketing, la formule est efficace. En ce qui concerne
la seconde classe statutaire ou la première - compte tenu de son importance - à
savoir les amis, nous pouvons dire qu’elle repose sur un présupposé d’égalité qui se
traduit par des rapports symétriques. Néanmoins, deux modes relationnels peuvent
être différenciés au cours des échanges amicaux : d’une part un rapport Auteur-
Amatorat où il s’adresse aux membres de son réseau ; d’autre part les rapports
Amateur-Auteur qui eux prennent la forme de la contemplation ou de l’évaluation.
Qu’il s’agisse des peeps ou des amateurs, ces différents modes relationnels
découlent tous d’une même opération : la demande d’amis ou friend request. Celle-
ci est accomplie par la fonction Add to friends disponible sur les profils de tous les
membres d’Xpeeps.com : un clic -analogue à celui demandé sur les sites marchands
pour ajouter au panier- génère un écran de confirmation pour que la proposition
d’amitié soit adressée. Elle sera acceptée ou rejetée lorsque le récipiendaire prendra
connaissance du profil de son Auteur. Il s’agit ainsi d’un acte conscient et
volontariste demandant la collaboration des deux parties prenantes.
L’accomplissement de l’ajout, d’un point de vue techno-sémiotique, opère une
équivalence entre lien social et lien hypertextuel : en effet, après acceptation, les
deux membres deviennent amis, ce qui se traduit ipso facto par l’interconnection de
leurs profils grâce à des signes passeurs mutuels automatiquement générés.
L’expression social networking prend tout son sens, dans les formes du dispositif se
confond la technique du réseautage avec la rhétorique de la sociabilité.
Le statut d’ami donne accès à un espace d’auctorialité pour l’Amateur sur le profil
d’autrui. Ainsi, l’opération d’ajout est très souvent suivie par l’inauguration de cet
espace mis à disposition dans lequel les deux amateurs s’expriment mutuellement
leurs remerciements pour l’acceptation. Ces échanges prennent la forme d’une
« paire adjacente82 » comparable à celles qu’on observe en analyse
conversationnelle : A : «merci pour la requête ! » ; B : « merci pour l’ajout !». Sur les 82 Une « paire adjacente » telle qu’elle a été définie par Schegloff comporte les traits suivants : deux énoncés adjacents produits par des locuteurs différents, séquentiels et dont le deuxième par rapport au premier doit être pertinent. Notons ici que le cadre spatio-temporel de la relation concerne deux profils différents, de ce fait l’adjacence des énoncés est plus temporelle que spatiale. cf. Schegloff, Emanuel, Notes on a conversational practice : formulating place in Bachmann, Christian et alii, Langage et communications sociales, chapitre 6, Paris, Didier, 1991
60
espaces de commentaires des profils abondent les exemples de ces énoncés de
bienvenue dont l’échange constitue le rituel principal des interactions où s’affichent et
s’affirment les valeurs de sociabilité hypertextuelle qui fonde la communauté
d’auteurs-amateurs. Si par la suite, des ‘amitiés’ se nouent au-delà du statutaire,
celles-ci reposeront sur des échanges fréquents de commentaires utilisant la
fonction « publicisante » post a comment, ou -si les partenaires le veulent- en
s’envoyant des mails privés (send a message) ou enfin en transposant leur relation
sur d’autres dispositifs comme les messageries instantanées ce qui modifie
substantiellement le cadre spatio-temporel de leurs interactions. Dans l’anticipation
de ces usages potentiels, l’interface signale à chaque fois si un utilisateur est en
ligne ou le cas échéant, l’heure et la date de sa dernière connexion sur Xpeeps.com.
Du côté des galeries, l’usage rituel est le commentaire des photos. Ici, les amateurs
expriment leurs réactions sur les représentations du corps de l’Auteur. Sous chaque
photo, par ordre ante-chronologique, les éventuels commentaires s’accumuleront
accompagnés à gauche par les avatars respectifs de leurs auteurs. Étant donné que
les amateurs choisissent comme avatar des photos d’eux-mêmes pour être
représentés en situation, ces espaces web textuellement polyphoniques deviennent
sur un plan iconique un lieu de cohabitation de liens hypertexte solidaires d’images
de corps auctoriaux. Ainsi, venu voir ou commenter un certain type de corps en
exposition, l’Amateur rencontre aussi les traces discursives du passage de ses
prédécesseurs. S’il est attiré par le commentaire de quelqu’un ou par l’avatar de son
corps, il pourra se rendre sur son profil, lui demander d’être son « ami » et
redémarrer ainsi un cercle vertueux de rituels sociaux.
Jusqu’ici, l’ingénierie sociale à l’œuvre sur Xpeeps.com prend pied sur une
conception idéelle des interactions : les intentions sont claires, les projets sont
perçus comme communs. Cependant, toute ingénierie sociale serait incomplète faute
d’une intégration du dysfonctionnement interactionnel comme dérive possible au sein
des différents cadres de participation. Dans cette perspective, l’interface d’Xpeeps
définit aussi des fonctions et des sanctions allant dans le sens des ajustements et
contrôle sociaux. Ainsi, il faut rappeler que bien qu’il y ait collaboration, l’Auteur reste
le maître de son profil et de sa galerie photo. Il peut décider de supprimer les
commentaires qu’on lui laisse, ce qui s’avère utile lorsqu’un amateur détourne ces
61
espaces de socialisation en lieux d’affichage sauvage et spams viraux. Si sur un plan
plus personnel, l’Auteur est harcelé par un amateur, il peut bloquer ces interactions
incommodantes en ajoutant le nom de ce dernier à une liste noire ou ignore list qui
exclura le responsable de sa liste d’amis et neutralisera les échanges source de
tension. Quant aux photos elles-mêmes, des mécanismes de contrôle sont prévus
par l’interface. Si l’image est celle de quelqu’un soupçonné d’être mineur en âge, tout
utilisateur est encouragé à dénoncer son existence en cliquant sur la fonction Report
illegal activity, systématiquement présente en bas de chaque photo. Il en va de
même pour les photos qui relèveraient de pratiques jugées aberrantes comme la
bestialité, des formes extrêmes de « traite de personnes » ou de sado-masochisme
qui elles, au-delà des conventions sociales, relèveraient des codes pénaux. Enfin,
tout utilisateur peut dénoncer l’usage par quelqu’un d’autre de ses propres photos :
dans ce cas, il contacte l’administration du site qui procédera à la suppression du
compte de l’usurpateur. Cette mesure vise à protéger le droit d’auteur en même
temps qu’elle affirme les valeurs d’auto-exposition.
De manière générale, l’articulation de l’architextuel et du social dessert la raison
d’être du site en orientant l’Auteur-Amateur dans sa poétique autant que dans ses
interactions. Dans cette conjoncture, Xpeeps favorise une thématisation de chaque
utilisateur comme assemblage de signes, chacun desquels aura une part statique
d’exposition et une part dynamique de circulation. La fenêtre du navigateur actualise
les contenus du serveur. Le regard que lui porte l’Amateur actualise l’intention de
l’Auteur. Dans ce peep show à distance, il est question d’auras filtrées par le
dispositif. Des corps au réseau, de l’écran aux yeux, la médiation qui lie chaque
Auteur-Amateur à Xpeeps pourrait être l’archétype d’une relation voyeur-pourvoyeur.
2.2 L’AUTEUR-AMATEUR MIS À NU : LE TRAVAIL DE S’EXPOSER L’Auteur est l’acteur central de l’Internet contemporain. C’est lui qui tisse la toile, qui
génère les pixels, qui provoque les écrans. Dans notre cas très particulièrement, sa
place est visible en tant qu’orchestrateur de clics et orientateur de regards. La
demande générique du dispositif est bel et bien l’exposition de soi : le site préfigure
l’espace auctorial comme une case vide entourée d’une fenêtre à l’usage d’un public
62
expectant. Reste à l’Auteur à s’approprier cet espace : comment le conçoit-il,
qu’entend-il par exposition de soi ? Deux questions complexes et profondes qui
déterminent un rapport au monde autant qu’un rapport à soi. Nous nous demandons
à notre tour : quel est donc cet auteur donné à voir ? La réponse nous pose à sa
place et présuppose toute une discipline du regard83.
2.2.1 Auto-poétique : l’entité identitaire à l’épreuve du regard A l’approche des auteurs à l’écran, notre regard est guidé de prime abord, avant de
commencer à voir, par la pensée abstraite que cette construction est la leur, qu’elle
leur appartient. Dans cette perspective, nous passons d’une problématique de
structuration architextuelle à une problématique d’appropriation personnelle de
l’espace. Il s’agit du passage d’une poétique automatique à une auto-poïèse
comprise ici comme exercice poétique de figuration de soi. Pour l’Auteur conçu ici
comme subjectivité créatrice, le sens de l’action n’est autre que de se produire à
l’existence à partir des contraintes données. L’œuvre résultante porte les traces de
cette conception de l’être Auteur, qui privilégie le positionnement vis-à-vis de soi-
même comme impératif dépassant toute matière d’expression.
Le jeune Walter Benjamin articulait ces problèmes du faire et se faire autour du
concept poétique de noyau. Le « noyau poétique » à son sens est ce présupposé de
l’œuvre où l’idée de tâche fait pendant à l’idée de solution. La tâche pour l’Auteur est
de s’exposer, la solution est son exposition. Cependant, « la tâche et la solution ne
sont séparables que par abstraction84 ». Lorsque nous avons affaire à une auto-
poétique qui prend la forme triviale de l’autopublication, cette pensée du noyau
poétique peut nous éclairer puisqu’elle suppose un travail auctorial entrepris dans
une sphère confondant la sphère de l’œuvre avec la sphère de la vie.
83 Cette discipline du regard est celle de nos outils d’analyse, mis au service de nos trois hypothèses sur l’Auteur-Amateur. Chacune de ces hypothèses a inspiré respectivement une des trois parties suivantes. Les données expérimentales de ces analyses avant la constitution de ce triptyque font l’objet de l’annexe 7, Analyses p. 124 84 Benjamin, Walter, Deux poèmes de Friedrich Hölderlin : « Courage de poète » et « Timidité » in Œuvres I, Gallimard, 2000, p. 94
63
De manière concrète, nous parlons de ces auteurs qui mettent en signes leurs vies
suivant l’injonction de l’architexte mais surtout leurs envies. Le noyau poétique que
l’on décèle au fil de leurs constructions textuelles et iconiques prend certes appui sur
un positionnement vis-à-vis de la technique et du social mais obéit de manière
prioritaire à un problème existentiel transposé au réseautique. En d’autres termes, il
s’agit pour ces auteurs de numériser et exporter des fragments de leur vie. Ils se
donnent à voir tels qu’ils sont ou croient être, et de ce fait leurs galeries et profils ne
font que traduire une immédiateté de la vie.
La question ici est donc celle d’une « non-mise à distance » d’Xpeeps, de ne pas le
concevoir comme un site à circonscrire, de ne pas le concevoir comme un site
pornographique. Ceci donne aux auteurs une aisance qui n’est pas due à l’absence
de censure, mais à une conception libre de l’exercice autobiographique. Ainsi, ces
auteurs qui livrent leur intime, se livrent eux-mêmes mais livrent aussi ce qui les
entoure, ce qui les délimite, leurs circonstances pour reprendre le dire du philosophe
espagnol Ortega y Gasset. « Yo soy yo y mis circunstancias85 », tel est donc le
noyau de cette auto-poétique qui donne à voir l’Auteur dans toute son épaisseur
socio-sémiotique. Ce sont des gens, nus ou habillés, dans leur cadre de vie qu’on
peut lire en même temps qu’ils s’écrivent. Leurs constructions sont denses mais
nous guident dans la compréhension de leur processus créatif.
S’agit-il de pornographies ? La question adressée parait abusive. Si c’est le cas, elle
suppose que l’on élargisse le spectre de l’excitant et de l’explicite au-delà du corporel
vers le circonstanciel. Tel est le glissement sémantique que ces auteurs
accomplissent. Ils se donnent à voir dans une proximité frappante que nous
soumettrons à analyse, allant de la poétique de soi aux monologues de la rhétorique
érotique.
A. L’existence de l’Auteur comme poétique à double détente Photographe de soi-même, mannequin de soi même, webmestre et biographe officiel
au jour le jour. Ainsi pourrait-on parler du type d’auteur en question. Il conçoit son 85 « Je suis moi et mes circonstances » NdT. Par cette phrase, le philosophe espagnol José Ortega y Gasset transférait le problème existentiel du biologique vers l’ontologique. L’absence de circonstances équivaut à l’absence de moi selon cette lecture, car ce sont les circonstances qui me rendent unique. Nous essayerons par la suite de développer le concept de circonstance en sémiotique.
64
travail en termes globaux, se laisse mouler par l’architexte et répond à toutes ses
demandes d’information. Entre lui et le support, on serait tenté d’apercevoir un
rapport de soumission ; cependant, sa démarche volontaire témoigne davantage
d’un rapport utilitaro-hédoniste qui transforme l’interface en moyen d’expression.
Du côté du profil, cet auteur fait usage exemplaire de tous les champs disponibles
d’autopublication. Néanmoins, c’est par l’espace Qui je suis qu’il débute son
exposition. En toutes lettres, l’Auteur se présente à la première personne. Elle dit
d’où elle vient, son tempérament, l’opinion qu’elle a d’elle-même en éloges et
reproches, elle dit même où on peut la trouver avec humour. « Actuellement, j’étudie
à l’université de Manchester et y reste la plupart du temps, mais à l’origine, je viens
de Sheffield. Je suis quelqu’un qui aime s’amuser, et un peu folle. A mon avis, je
suis quelqu’un de sympathique avec ceux qui le sont avec moi, mais je peux être une
vraie pute malgré moi. Je ne suis pas très sûre de moi, et autodestructrice, mais j’y
travaille. Je suis timide quand il ne faut pas, et bruyante lorsqu’il ne faut pas ! J’ai du
mal à faire confiance aux gens et je juge leur caractère de manière assez sévère. En
gros, je ne fais pas confiance aux gens à la première rencontre, j’y travaille aussi.
J’ai un sens de l’humour très aléatoire qui est plutôt sarcastique et bête. Quand je
suis chez moi, vous me trouverez au Corp, au Nelson, au Dove et au Rainbow, en
train de faire du shopping, au cinéma ou en train de squatter chez un ami ! A
Manchester, vous me trouverez dans mon adorable résidence étudiante, à Jilley’s,
Roadhouse, 42nd street, et dans des concerts…. 86 »
Lorsque l’Auteur se présente dans un tel niveau de détail, il devient difficile de
négliger son épaisseur psychologique et son ancrage dans le réel à l’approche de
ces photos. Il réussit à créer un système sémiotique autoréférentiel où les renvois
entre ses textes et icônes forment un réseau de sens autant qu’une complexe
mosaïque personnelle. Cette convergence sémiotique synonyme d’une cohérence
individuelle met en scène un auteur qui dépasse largement les limites de son corps.
Nous pouvons dire en détournant un célèbre latinisme d’Eco que l’Auteur dans son
profil est indissociable d’un amator in fabula qui opère l’émergence globale d’une
interprétation. Ainsi, ayant pris connaissance d’autant d’informations personnelles,
86 Cf CD annexe, 28-P, 28-G, NdT
65
lorsque l’on franchit l’antichambre qu’est le profil en direction de la galerie où
s’exposent les corps, on ne fait que réactiver un parcours sémantique pris en charge
par l’Auteur qui fédère comme concept un ensemble de pixels et sa propre narration.
Il met en scène les éléments disjoints d’une entité identitaire qui n’apparaîtra pas
comme telle faute d’une projection de l’Amateur dans l’Auteur.
Prenons l’exemple d’un homme qui, sans s’étendre dans son auto-récit, nous livre
quelques informations. Il écrit : « Je suis assez tranquille, mais aussi très passionné
par les choses que j’aime faire. Si vous voulez en savoir plus sur moi, cherchez-moi
sur Yahoo puisque je suis en ligne la plupart des soirées. Si vous ne me voyez pas, il
y a des chances que je sois juste invisible. 87» Par ailleurs, il nous apprend dans la
rubrique occupation qu’il est militaire au sein de la United States Air Force (USAF).
En effet dans sa galerie, on le voit tranquille sur une chaise en uniforme camouflé à
la lumière du jour, devant son bureau ; mais aussi en soirée, les jambes écartées
sur son lit, souris en main à côté du clavier de son ordinateur. L’Auteur ne fait que
mettre en signes sans malice sa vie quotidienne, mais privilégie les images saillantes
qui donneront une épaisseur supplémentaire au sens de son exposition. Dans son
profil, il crée l’expectative, dans sa galerie, il crée l’impression. Ce premier type
d’auteur distingue bien le temps qui se joue entre deux clics, entre deux espaces
d’auto-poïèse qui lui demandent deux types différents de productions.
Dans son profil, il mettra en scène ses attributs sociaux, il se donnera à lire au
prisme de l’architexte et de ses catégorisations. Il créera son rôle, son histoire en
mettant en avant des archétypes sociétaux : ici le soldat, l’étudiante plus haut, mais
aussi l’immigré latino, l’ancienne gymnaste ou l’apprenti écrivain88. Dans sa galerie, il
mettra en scène ses attributs corporels, comme illustration de ce qu’il est, de
manière toujours aussi désinvolte. Cette double détente signifie une économie
cognitive en termes de présentation : l’Auteur mobilise une représentation commune
à laquelle il appose par la suite une icône-solution. Ce savoir-faire poétique prend
une forme intuitive qui valorise la nudité de l’Auteur car elle n'apparaît qu’à la fin du
parcours sémantique. Le résultat pour l’Amateur-modèle propose quatre séquences :
87 Cf CD annexe, 31-P, 31-G, NdT 88 Cf CD annexe ,10-P, 10-G, 38-P, 38-G
66
( 1 ) procéder à la reconnaissance de grands types sociaux, ( 2 ) faire la
connaissance de l’individu, ( 3 ) s’exposer à l’exposition de cet individu, ( 4 ) effectuer
le retour à son histoire personnelle. Ainsi, les phases préliminaires au peep show
auront un effet direct sur la sémiose en cours. A la fin de ce jeu de socialisation et
déshabillage, le résultat ne peut être autre qu’une étudiante nue, un soldat nu, un
apprenti écrivain nu, tous ces corps dénudés par le regard mais habillés par les
statuts sociaux qu’ils avouent.
Dans cette perspective, l’Auteur-Amateur est gestionnaire d’une proto-pornographie
atténuée par sa proximité qui neutralise l’obscène par l’habillage social d’une
insertion. L’attentat à la pudeur est déjoué en étant constitutif de la vie de l’individu
au même titre que ses goûts ou sa profession. Nous sommes proches de la pensée
de Linda Williams lorsqu’elle considère que ce qui devait être tenu en dehors de la
scène est désormais en scène et indissociable de toute forme contemporaine
d’autoréflexion. C’est une entité identitaire qui se met en exposition, un moi-référent
ipse et idem qui prend en charge sa représentation89. Tout se fait à la première
personne assumant un visage et un nom sans que cela relève d’aucune
revendication, sous un régime simple d’auto-affirmation.
B. L’Auteur et l’objectif : se donner à voir La mise en scène de la mise en-scène est donc un enjeu principal pour ce type
d’auteurs. Comment parvient-il à faire rentrer sa nudité dans le champ du visible ?
En passant de la tâche auto-poétique à sa solution, nous pouvons interroger de
manière moins abstraite le savoir-faire ordinaire à l’œuvre dans les constructions.
Jusqu’ici, nous avons été face à un auteur qui sait se raconter et s’identifier
socialement. Maintenant, en franchissant le seuil de la galerie, nous pouvons étudier
les façons dont il se déshabille et se donne à voir.
En exposition, l’Auteur met en œuvre un savoir photographique qui n’est pas
technicien, qui témoigne du glissement du couple capture d’image / prise de vue vers
le corps de pratiques de cette «culture très ordinaire » dont parlait de Certeau. La 89 Dans son ouvrage Soma & sema (Maisonneuve, 2004), Jacques Fontanille développe à partir de ces catégories ricoeuriennes similaires une théorie sémiotique que nous n’importerons pas ici étant donné l’indifférence que les modèles tensifs formalisés montrent à l’égard des médiations techniques en lien avec les valeurs sociales dont un corps peut être l’objet.
67
mise à nu spontanément publicisée est contemporaine d’une société où caméras et
appareils numériques accèdent au rang d’objets indéracinables d’un quotidien. Il est
donc question de photos où « un essentiel se joue dans cette historicité quotidienne
indissociable de l’existence des sujets qui sont les acteurs et les auteurs d’opérations
conjoncturelles90». En effet, les galeries retracent souvent une histoire individuelle,
celle des occasions que la vie moderne au jour le jour laisse de se prendre en photo.
L’autoportrait dans cet ordre d’idées devient le format canonique de toute poétique
de soi en situation.
Formellement, ces autoportraits ont la particularité de mettre en scène leurs auteurs
comme acteurs mais aussi comme gestionnaires du processus de production. A
l’écran, un portrait en contre-plongée d’un corps torse nu, mais aussi un bras qui se
lève et se tord pour réussir un cadrage acceptable et opérer une prise de vue. A
l’écran, cette photo aux proportions et perspectives anomales, résultat d’un appareil
posé sur un meuble, d’un minuteur en comptage régressif, d’une pose trouvée dans
l’urgence du corps comme dernier recours. A l’écran, cette image du corps de
l’Auteur souvent dans sa salle de bains face à son miroir décidant d’appuyer sur
l’obturateur au moment qu’il choisit pour éblouir notre regard grâce à un flash
délibérément posé sur le mercure. Torsions, retardateurs, réflexions, tels sont les
trois ressorts matériels de cette technique photographique d’autoreprésentation.
Sur un plan sémiotique, ces photos favorisent un corps continuum solidaire de toute
l’entité identitaire. Vue d’ensemble d’un auteur qui a parfaitement conscience d’être
un seul et même corps, jouant au jeu des parties dénudées. C’est le visage qui opère
cette indivisibilité et plus spécialement le regard qui psychologise ce corps et l’anime
dans sa fixité. Il est question de l’opération qu’ Eliseo Verón a conceptualisée sous le
nom de l’«axe Y-Y91» : l’acteur regarde « l’œil vide de la caméra, ce qui fait que moi,
je me sens regardé ». Les «yeux dans les yeux » s’établit donc cet axe de contact
visuel artificiel. Cependant, les motivations auctoriales pour accomplir cette opération
sur un écran cathodique ou un écran rétro-éclairé ne sont pas les mêmes. A la
volonté d’instaurer un « régime de réel » au sein du dispositif énonciatif du plateau 90 Michel de Certeau in op cit, p.39 91 Verón, Éliseo, « Il est là, je le vois, il me parle », in Réseaux n°21, décembre 1986, p. 78-78,
68
du journal télévisé, on substitue ici quelque chose de plus pathétique, de moins
construit, de plus réel : il s’agit d’un regard qui traduit cet « avènement de moi-même
comme autre » que Barthes évoquait en définissant la Photographie comme
« dissociation retorse de la conscience d’identité92». Plus que chez Barthes, l’Auteur
est ici photographié en le sachant car il est des deux côtés de l’appareil ; plus que
jamais il se sent regardé par l’objectif et se constitue en train de « poser ». L’Auteur
se fabrique un autre corps, la capture applique sur lui une transformation active, elle
dissocie sa conscience d’identité, elle le dédouble instantanément en Auteur et
Amateur de soi-même : en se pensant comme un autre, il accomplit l’énonciation
photographique du moi.
Les quelques fois où le regard se détourne, la conscience de la pose est tout aussi
intense. L’Auteur dévie les yeux dans le but de donner une nuance expressive à son
visage : celle-ci peut traduire un caractère pensif voire mélancolique ou a contrario
une coquetterie stratégique qui transforme le vide du regard en forme évasive d’une
invitation à s’impliquer dans une histoire auctoriale. C’est l’histoire d’un homme dans
sa chambre ou celle d’une femme au bain, les poses adoptées ne sont pas
anodines, elles sont en grande mesure apprises, reprises du répertoire de
l’iconographie occidentale plus que de quelconque inventaire kinésique qui prétend
faire du mimo-gestuel une simple combinatoire. C’est tout l’art plagiaire de se
coucher sur un lit en vague pose d’athlète, de sourire comme une starlette, de poser
négligemment un doigt près de sa bouche et provoquer en l’approchant.
Autant de postures mémorielles s’actualisent à l’écran et suscitent un effet escompté
chez l’Amatorat. Ces constructions assumées produisent en commentaire des
énoncés qui prennent toujours la forme d’une assertion constative : vous êtes beau,
vous êtes belle sont à la fois des constats de beauté autant que des constats
d’identité. Il arrive parfois que quelqu’un focalise sur un rideau de douche ou un
vêtement dissimulé. Peu importe. Ce déplacement vers la circonstance ne saurait
nous troubler : dans tous les cas, c’est l’auteur qui hante et produit ces temps et
espaces qui n’appartiennent qu’à lui, cette entité que forment le corps et les objets. 92 Au début du cinquième chapitre de La Chambre Claire, Roland Barthes nous fait part de son expérience d’être photographié. Il décrit ce moment d’émergence de la pose à la première personne, comme moment où une image – son image – va naître. « Je vis l’angoisse d’une filiation incertaine » écrit-il à cet égard. In op cit, p. 796-798.
69
2.2.2. Les blasons anatomiques : rhétoriques du morcellement Le travail auctorial d’exposition de soi est comme nous l’avons dit relatif à ce que l’on
entend par exposition et par soi. Il est ainsi un deuxième type d’auteurs dont le
spectacle témoigne d’un positionnement différent : ni entitaire, ni identitaire ; bien au
contraire ils se donnent à voir de manière fragmentaire et partiale. Loin du thème
narcissique du miroir, il est question ici d’auteurs qui exploitent le site comme vitrine
primordiale. C’est le X d’Xpeeps qu’ils font prévaloir.
Dans cette perspective notre problématique se décentre, l’Auteur à l’écran a allégé la
lourdeur de sa tâche auto-poétique – conçue comme immense spectre de choix – au
profit de solutions adaptées à un horizon d’attentes restreint. Qu’attend-on de moi ?
C’est la question qu’il entend, et bien avant de produire sa vie en spectacle il pense
déjà à l’autre, à cette altérité fantasmatique que sera son Amatorat. Il choisit des
fragments non pas d’une vie, mais d’un corps, présupposant que c’est la seule chose
qui intéresse le regard. Dans cette perspective, il est dépositaire d’une pornographie
qui n’est pas solitaire, qui relève toujours d’une construction sociale.
L’Auteur gère donc le spectacle de son corps morcelé en fonction des usages
sociaux dont il peut faire l’objet et des représentations qu’il se fait sur la nature du
site. Il travaille les pixels comme la chair prisonnière du réseau. Son travail auctorial
ne prend pas le ton d’une confession autobiographique, il se calque plutôt sur une
demande en vigueur. C’est à l’exposition frontale qu’ici nous nous exposons.
A. L’existence de l’Auteur comme rhétorique érotique du morcellement Nous l’avons compris, l’Auteur en question bascule d’un paradigme de l’expression
vers la frénésie de l’exposition. Cette exposition est toujours cadrée par un seul et
même architexte, mais son exécution modifie la nature du rapport qu’entretient
l’Amateur à l’écran avec sa médiation. En accentuant la nudité expositive comme
une fin en soi, c’est tout l’espace du dispositif qu’on resignifie. C’est la discipline du
regard qu’on prend en charge, c’est l’Amatorat qu’on sonde imaginairement pour
mettre en place cette rhétorique d’un corps qui s’adapte au langage html, mais aussi
aux parlers sexuels de paliers en bas de page. L’Auteur présuppose qu’on veut
moins savoir que le voir : l’image de soi comme représentation complète devient un
70
concept secondaire, et contraste la puissance de la diffusion publique impudique
avec les limites plates de l’écran.
De manière concrète, cette conception de l’autopublication étant orientée vers
l’exposition accorde à l’iconique une place prioritaire par rapport au textuel : l’image
devient la substance du parcours. Ainsi, les profils des auteurs présentent une
légèreté informationnelle en ce qui concerne la création d’une proximité sociale.
Nous sommes face à des sujets qui se définissent par leurs comportements sexuels
plus que par une histoire personnelle, de ce fait ils apparaissent deshistoricisés sur
toute autre facette de leurs vices et vertus. La rubrique About me, auparavant clé
autobiographique du contenu présente ici une sexologie de l’Auteur : « Je suis une
étudiante curieuse de la bisexualité qui aime montrer son corps et se masturber dans
sa chambre devant sa webcam. Mes mesures sont 36C-25-35, je fais 5’4’’, 115
livres, avec une chatte poilue et juteuse. Comme je l’ai dit, je suis bi-curieuse et je
fantasme toujours de sucer les seins et lécher la chatte d’une jeune et petite femme
noire. Je fantasme aussi d’être en gangbang et de sucer un groupe d’hommes noirs
d’âge moyen avec de longues queues qui déchargent sur moi. J’aimerais me les
taper tous en même temps, ou même faire une orgie. Je suis tout simplement une
chaudasse de salope93». Tous les auteurs ne prendront pas le temps de préciser
avec tant de détails leurs envies sexuelles. Dans cette tâche d’autodéfinition
érogène, ils seront souvent assistés par un outil spécialement conçu pour être
exhaustif dans la rationalisation du domaine : le questionnaire. En effet, en
répondant à un questionnaire préfabriqué, l’Auteur contourne sa propre mise en
narrativité grâce à un ordre séquentiel imposé où des modalités de réponses
donnent une lisibilité optimale aux comportements sexuels sur un ton générique et
désimpliqué94.
En répondant au questionnaire, l’Auteur se livre à une pratique très usitée sur tous
les sites de social networking. Il s’agit en effet de la manière la plus synthétique de
parler de soi en parlant de ses pratiques. Pour ce qui est de l’exemple
pornographique, le fournisseur est un site appelé NaughtyPoll.com qui propose aux
93 CD annexe 11-P, 11-G. Cette traduction se base sur les équivalents sociolinguistiques français des termes employés, NdT 94 Cf. Annexe 5 p. 122 – Présentation par questionnaire
71
internautes une vingtaine de questions sur une sexualité qui se veut à la fois
objectale et objective. Age, orientation sexuelle, sexe oral, nombre de partenaires,
style du poil pubien, sous-vêtements préférés définissent une première couche
factuelle. A celles-ci s’ajoute un passage visuel : As-tu déjà pris quelqu’un ou été pris
toi-même nu en photo ?, As-tu déjà été sur une plage nudiste ?, Regardes-tu de la
porno ? Voici un point de rupture lorsqu’à cette question on propose comme réponse
« Oui, et j’ai même ma propre production ». L’Auteur se reconnaît comme
pornographe amateur de soi-même et finit de répondre au reste des questions :
Taille des organes, expériences homosexuelles, position préférée, circoncision,
jouissance la plus rapide, fréquence de masturbation, expériences collectives, âge
du premier rapport. L’Auteur copie/colle le résultat de l’enquête dans l’espace
d’édition de son profil et s’épargne ainsi un travail autonome de présentation.
Codification, synchronisation, formalisation, sont des opérations que peut accomplir
un questionnaire tel que l’observait Pierre Bourdieu95. Le questionnaire est le lieu de
la norme explicite non pas par les réponses qu’il suscite, mais par les critères qu’il
retient dans sa structuration. Pourquoi l’Auteur doit-il exprimer le style de ses poils ou
les mesures de son corps ? Comment ces variables sont-elles devenues à tel point
porteuses de signification ? On voit bien la nature éminemment sociale de tout le
travail accompli par ce second type d’auteurs : il a envie de faire classe, il a envie
d’être agi par le réseau. L’autoréflexion se cantonne à l’action et l’action à son tour
ne concerne que le corps. Ce paramétrage porte les traces d’une économie du signe
à laquelle se conforme l’Auteur : la question n’est pas tant de faire corps par rapport
à soi-même que d’inscrire ce corps dans des usages sociaux.
Ainsi, profils et galeries participent d’un même processus de focalisation du visible
autour des zones du corps dont les valeurs d’usage correspondent à une attente
générique de nudité qui neutralise l’ego. Le sens de cette construction sociale du
corps n’est autre que celui du morcellement. L’Auteur fournit le mode d’emploi de
son enveloppe charnelle et effectue le découpage nécessaire pour la rendre
opératoire. Seins, fesses, et régions génitales deviennent les points nodaux du peep
show. Ceci rappelle une pratique poétique du XVIème siècle qui consistait à découper
95 Bourdieu, Pierre, « Habitus, Code et Codification », Actes de la recherche en Sciences Sociales n°64, 1986, p.40-44
72
en parties le corps féminin de façon à mieux le décrire et le chanter au travers
d’images versifiées voluptueuses destinées à recréer un nombre de disciplines
exclusives du regard. Ces poèmes auxquels on donnait le nom de Blasons96 avaient
pour noyau la quête d’une méthode spécifique pour chanter une « Cuisse » ou un
« Beau Tétin ». A leur manière, nos auteurs actualisent la pratique du Blason
Anatomique en se donnant à voir et à avoir comme segments de corps constituant
tout un chacun une variante respective de l’exercice érotique du voir.
B. Se donner à avoir : du charnel comme pulsion scopique radicale Lorsque l’idée de blason rejoint la pensée de la galerie où nous sommes, l’espace de
la page devient celui d’une mise en scène radicale du dépouillement. Non seulement
chaque image exhibe sa chair de manière frontale, mais encore faut-il que ces chairs
cohabitent, juxtaposées, et que l’une d’entre elles attire de l’Amateur le clic et le
regard. Exposer et disposer sont deux gestes que l’Auteur accomplit ici en recréant
un jeu de tensions entre son corps morcelé et l’envie de le voir. Sigmund Freud dans
Trois essais sur la théorie sexuelle97 a donné à cette envie le nom de « pulsion
scopique ». Littéralement Schaulust, à la fois le plaisir, l’envie et la joie qui sont liés à
ce qu’il considérait comme une perversion du voir.
Loin de la normation clinique, ce qui nous intéresse ici est d’analyser le
fonctionnement sémiotique du système conformé par ces blasons. Nous essaierons
de comprendre comment l’Auteur relayé par le dispositif est co-gestionnaire de cette
« pulsion scopique » et acquiert de ce fait une emprise sur son réseau social. Dans
cette perspective, le dispositif par les thumbnails, versions miniatures de ce qui est
donné à voir, instaure cette logique visuelle évoquée précédemment où la résolution
et la taille de l’objet finalisent une sémiose dès lors qu’elles atteignent leurs valeurs
maximales. En cet âge de millions de pixels par image, chaque blason peut ainsi
dépeindre un niveau de détail à l’écran que l’œil nu même à l’aide d’une loupe ne
serait pas en mesure d’apercevoir.
96 Blasons Anatomiques des parties du corps féminin, invention de plusieurs poëtes françois contemporains était le titre complet de ce recueil poétique polémique imprimé à Lyon en 1536 par François Juste qui était aussi l’éditeur de Rabelais. Parmi les vers produits sous forme de Blasons, on comptait celui à « La Cuisse », à «La Chevelure Blonde », ou à « La Larme », mais aussi ceux du « Con », du « Beau » et du « Laid Tétin ». Longtemps considéré comme un livre rare et précieux, le recueil a été réédité par Gallimard en 1982. 97 Freud, Sigmund, Trois essais sur la théorie sexuelle, Folio, Paris, 1989
73
Cette curiosité scopique induite par le dispositif est accentuée par les
caractéristiques formelles des mises en scène choisies pour et par le corps auctorial.
En effet, dans chaque construction l’Auteur manie deux variables qui modifient la
position assumée par l’Amatorat. Celles-ci sont le cadrage et la distance, qui en
instance de production fonctionnent simultanément mais à l’écran demeurent
susceptibles de produire des effets différents. Du côté du cadrage, celui-ci est
directement responsable du morcellement. Étant donné le fait que les compositions
privilégient ouvertement la génitalité comme critère définitoire du point focal, la
rhétorique de l’image à l’œuvre est celle d’un motif érogène résultant de l’exclusion
figurative du corps ‘accessoire’. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’anatomie féminine les
constructions rappellent souvent ce chef-d’œuvre pictural longtemps jugé obscène
sinon indécent qu’est « L’origine du monde » de Gustave Courbet. En son temps le
photographe Maxime du Camp disait du tableau avec humour que « par un
inconcevable oubli, l’artiste avait négligé de représenter les pieds, les jambes, les
cuisses le ventre, les hanches, la poitrine, les mains, les bras, le cou et la tête98 ».
En faisant abstraction de l’ironie propre aux hommes des Beaux-Arts, nous pouvons
faire nôtre cette remarque au sujet du cadrage. En effet, c’est en jouant sur la
tension champ/hors-champ que le peintre réaliste ou nos internautes contemporains
maximisent la force de frappe de leurs images.
Plus que d’un nu, c’est d’un fragment de nu dont il s’agit à chaque fois, de 1866 à
2007, du Musée d’Orsay à notre écran quotidien. Indépendamment des techniques
de représentation c’est cette nature fragmentaire insistant sur le sexe qui continue à
définir le pornographique dans l’imaginaire social. Cependant, nous voudrions
insister sur un aspect poétique sous-jacent : le statut de commande que revêtent ces
images. C’est toujours ‘à la demande de’ qu’une icône se conçoit
pornographiquement. Que ce soit pour le riche collectionneur Turc ou pour
l’internaute lambda, l’Auteur est pornographe en ce qu’il intègre à son œuvre le voir
pulsionnel d’un Amatorat qu’il cherche à satisfaire explicitement. Tel est le noyau
poétique des blasons. Ce sont des images destinées à l’usage social, des images-
98 Maxime du Camp (1822-1894) cité par Makarius, Michel, « Un portrait sans visage » consulté sur le musée critique de la Sorbonne à l’adresse http://mucri.univ-paris1.fr/mucri10/article.php3?id_article=83
74
action qui renient leur valeur autobiographique ou documentaire. Elles n’ont pas été,
elles sont à chaque fois.
A l’écran chaque actualisation confirme que ces blasons anatomiques répondent à
un horizon d’attente. Les logiques du « Web 2.0 » disposent à côté de chaque
image un mécanisme de comptage : chaque clic laisse la trace de son passage.
Ainsi l’Auteur apprend que c’est lorsqu’il blasonne qu’il satisfait la demande. Il intègre
qu’une photo d'entrejambe est souvent plus appréciée que celle d’un visage. Il est
conforté dans ses choix parcellaires de cadrage. Dans le cas de l’anatomie
masculine, ceci est aussi vrai. Le choix du phallique comme motif central est très
récurrent et sa mise en scène rappelle alors un autre dispositif destiné à l’ostension
du membre comme exclusion du reste du corps. Ce dispositif qu’on appelle le Glory
hole a connu son heure de gloire dans la seconde moitié du XXème siècle : un trou
dans un mur à travers lequel on peut observer ou agir les parties qui s’y engagent.
Le cadre serré de l’échange garantit seulement une connaissance génitale des
partenaires de l’acte. Pour ce type d’auteurs, les galeries d’Xpeeps font l’objet d’un
usage semblable, elles n’exposent que leurs sexes à un flux d’amateurs difficilement
reconnaissable.
Au-delà du cadrage, nous distinguons une autre variable isolée dans les
constructions auctoriales : il s’agit de la distance, comprise ici sous une acception
courante, comme distance entre la zone photographiée et l’objectif. Dans les faits, la
distance est consubstantielle au cadrage ; cependant, une distinction peut éclairer
artificiellement cet exercice de sémio-pragmatique pornographique. Ainsi, l’effet
principal relatif au cadrage est de jouer avec la pulsion scopique décisive du clic,
effet que mesurent les mécanismes de comptage. Quant à la distance, celle-ci
représente non pas un cadre de regard, mais un désir de proximité charnelle,
d’extase du réel donné à voir. Il faut cliquer pour expérimenter la distance ou
l’absence de distance : la question cesse d’être qu’est ce que l’Auteur veut montrer ?
(cadrage), et devient comment l’Auteur a voulu le montrer ? (distance). L’Amatorat
est très sensible à cette distance auctoriale qui radicalise l’exercice du voir. En effet,
les distances faibles cumulent une force perlocutoire qui modifie l’esthésie de
l’Amateur et lui fait commenter de manière expressive cette proximité spectatorielle
qui marque son expérience. Les commentaires d’amateurs sous chaque blason
75
témoignent d’un rapport particulier à l’image. Ainsi voit-on naître, lors de la prise de
parole, l’ensemble des champs sémantiques liés à chaque organe dès lors que
l’Auteur opère ce zoom qui annihile la distance. Les adjectifs surgissent alors pour
flatter les tailles, commenter les palettes, qualifier les textures. L’oculaire atteint son
niveau maximum de détail. Nous pouvons alors observer que le corps morcelé se
réifie, que les commentaires ne portent plus sur l’Auteur comme entité, mais plutôt
sur une chose charnelle qui existe à l’écran de manière indépendante : vous êtes
beau, vous êtes belle ne sont plus à l’usage ; ici, on parle d’un vagin ou d’une verge
réifiés, plutôt que de leurs maîtres responsables.
Cependant, toute distance a une limite même lorsque l’objectif et la chair rentrent en
contact. C’est alors qu’Internet réapparaît comme ce qu’il est, une médiation
informatique à distance. Cette limite matérielle de l’exposition à l’exposition fait
émergence dans les énoncés que les amateurs émettent à l’égard des parcelles de
corps qu’ils envisagent. Ainsi, la plupart des commentaires commencent par une
expression qui traduit la frustration sinon l’impossibilité d’un charnel matérialisable : I
would like to…, I would love to… Tant de choses que l’Amateur aimerait et aimerait
faire si l’Auteur était en présence. Le choix du conditionnel n’est pas vraiment un
choix, il est le seul mode verbal probable99, il porte dans sa désinence le dernier
bastion du virtuel comme souhait avoué irréalisable. La créativité sociale, à l’instar de
la métis des Grecs, a trouvé une ruse pour palier à l’absence de charnel dans
l’échange. Ainsi, nombreux sont les hommes qui impriment les photos des galeries,
se masturbent sur elles et publient les images résiduelles comme hommage : ce sont
des galeries d’icônes défigurées par le contact du sperme, du papier et de l’encre.
Ces blasons anatomiques contiennent en eux-mêmes la substance sémiotique d’une
économie active et contraignante. Pour faire communauté, l’Amatorat formule les
termes de sa demande et les auteurs fournissent des réponses sur-mesure en
construisant de la sorte leurs propres images. Le corps morcelé est ici monnaie
courante : c’est le munus dont il faut se prémunir pour devenir partenaire de
99 Si certains linguistes ne reconnaissent pas au conditionnel un statut de mode verbal à part entière et le rattachent toujours au mode indicatif, ici en revanche nous faisons partie de ceux qui lui accordent une indépendance. En effet, ses valeurs modales en contexte à l’indicatif paraissent inexprimables. A ce sujet : Maingueneau, Dominique, Approche de l’énonciation en linguistique française, Hachette, 1981, chapitre 7, pp. 80-85.
76
l’échange. Les usages sociaux contractualisent cette auto-poétique par les marges.
In fine, on ratifie l’Auteur phallocrate et l’Auteure vaginale comme fournisseurs
modèle d’expériences sensorielles : cadrages serrés, distances menaçantes.
Comment penser ici la circonstance ? Comme un ongle mal peint, comme un drap
froissé, comme un paquet de mouchoirs auquel, en taille, un membre se compare ?
Tout semble s’évacuer au profit du corps fragmentaire, c’est une para-pornographie
qui prend place : une commande plus qu’explicite, anatomiquement centrée, un
corps découpable devenu le lieu d’un télescopage pulsionnel actualisable.
Tels sont les ressorts de cette rhétorique qui apparente le charnel à une pulsion
scopique radicale. Sa dérive n’est autre que cette « violence métonymique100 » dont
parlait Roland Barthes en relisant Sade, qui peut être tenue par certains comme
modalité de l’obscène par excellence. Dans tous les cas, nous ne sommes plus dans
l’obscène mis en-scène des auteurs précédents, cet obscène-ci concerne des
auteurs qui pratiquent « le plaisir d’un fugace défoulement101 » visant « l’action
directe sur notre système nerveux » ; comme le conçoit Daniel Bougnoux, ils
produisent leur propre obscénité en provoquant l’effondrement symbolique de la
scène ou le renversement de ses codes.
2.2.3 Contours culturels : poétique du reflet et du rassemblement Il est un troisième type d’auteurs pour qui l’exposition de soi prend un sens
composite différent. Ce n’est pas une production de leurs vies sur Internet, ni une
insertion des morceaux de leurs corps dans le circuit social du regard. Ils viennent se
montrer de manière certes entitaire, mais ce n’est pas sur le mode de la personne
elle-même qu’ils se présentent : ils basculent sur le mode du personnage. Leur
travail auctorial substitue la distance théâtrale à la proximité sociale.
100 Barthes, Roland, Sade, Fourier, Loyola, Seuil, 1971, p.36 101 Bougnoux, Daniel, « L’obscène, la scène et le secret », in Médium n°9, Éd. Babylone, octobre-décembre, 2006 p. 66-75
77
Cette transformation s’effectue essentiellement par une inscription de signes dans le
corps auctorial. Le positionnement de l’Auteur se fait donc moins vis-à-vis de lui-
même ou d’un horizon d’attentes amatoriales que d’un univers culturel de référence.
Autrement dit, il s’agit d’une poétique de l’incorporation au sens étymologique du
terme : utiliser son corps comme surface inscriptible pour devenir dépositaire d’un
sens partagé par des semblables, mais cryptique pour la plupart. Ce travail poétique
en amont sur le corps auctorial a pour corollaire une rhétorique de l’identification dès
lors que deux membres partagent les codes interprétatifs et donnent un sens
particulier à l’exposition.
Le postulat de base est d’aller à l’encontre de l’idée selon laquelle sexuellement tous
les corps se valent sous un même rapport. Il s’agit de connoter le corps pour
resignifier l’exposition de soi : au-delà d’un simple peep-show, Xpeeps devient un
salon d’exposition où l’on fait acte de présence en laissant d’autres consommer sa
propre différence. Pour conceptualiser ce jeu de différenciation et de dénaturation du
corps pornographique, certains théoriciens comme Marie-Hélène Bourcier proposent
le terme de post-pornographie102. Il s’agit de marquer une rupture avec les codes
esthétiques et anatomiques dominants, pour favoriser l’émergence de pornographies
alternatives susceptibles de renouveler les disciplines contemporaines du regard.
A. L’existence de l’Auteur comme reflet imaginaire Nous sommes face à des auteurs qu’il serait facile d’exotiser en considérant qu’ils
appartiennent aux tribus contemporaines du monde occidental. Punk ou gothique
seraient dans cette perspective des raccourcis économiques permettant certes un
étiquetage rapide, mais induisant cependant le biais du surplomb, l’extériorité du
regard. Pour essayer de comprendre ces poétiques alternatives, nous nous mettrons
face à face sans catégories définies a priori : nous étudierons la synthèse du corps et
du dispositif dans l’émergence et fonctionnement du personnage auctorial.
Le degré zéro du corps auctorial équivaut à l’état prétendument naturel de cette
nudité conjoncturelle qu’on peut appeler la tenue d’Adam. A partir de cet état, un 102 Bourcier, Marie-Hélène, « Post-pornographie » in Dictionnaire de la Pornographie, PUF, 2005, p.378. L’auteure a fait sien le combat de l’Américaine Annie Sprinkle, créatrice du terme post-porn en 1989, et poursuit dans la sphère française la critique des stéréotypes réducteurs ou stigmatisants dont fait l’objet la pornographie dans le discours social.
78
processus d’appropriation stylistique commence pour l’Auteur, de « mondanisation »
si l’on préfère : cela commence par une coupe de cheveux, par un lobe percé en bas
âge ; c’est souvent sous tutelle parentale qu’on commence à socialiser et sémiotiser
le corps de l’enfant. Pour les auteurs que nous traitons, cette anthropologie
minuscule a beaucoup de sens : ce sont ces transformations corporelles qui
constituent un point de départ. « We are born naked. All the rest is drag 103» disait le
célèbre acteur travesti RuPaul à cet égard pour justifier que sa pratique aux yeux des
autres pourrait être considérée comme normale.
C’est dans cet état d’esprit ouvert que l’Auteur se conçoit. Il a conscience que le
corps peut être plastiquement libre et le travaille comme support de sens. Dans cette
perspective, son corps véhicule une appartenance culturelle en même temps qu’il
reflète une posture sociale. Ces codages corporels ont suivi au cours du XXème siècle
une tendance globale de diversification stylistique aboutissant à un élargissement
des possibilités anatomiques identificatoires. Le concept clé est celui de techniques
du corps tel qu’il a été proposé par Marcel Mauss. Il s’agit des « façons dont les
hommes, société par société, d’une façon traditionnelle savent se servir de leur
corps104». L’Auteur dispose donc d’un répertoire de techniques du corps, pour
manger et pour marcher, mais aussi pour entreprendre sa propre transformation.
Quittant le terrain des sociétés « traditionnelles », nous dirons que les médias de
masse ont souvent orienté le sens de cette transformation. Ils ont véhiculé une
pluralité d’imaginaires corporels constituant un Amatorat segmenté. L’Amateur, en
tant qu’Auteur de lui-même appliquera sur son corps des techniques qui articulent
son devenir individuel à une reconnaissance stylistique sociale. Transposée sur
Internet, la question de la transformation auctoriale redevient pertinente sur les sites
de social networking : chacun s’approprie son espace selon les codes qui sont les
siens, et c’est à partir de la reconnaissance de ces codes que se crée un réseau
social amatorial. Il est question de créer un profil et une galerie qui soient perçus
comme étant à l’image de soi.
103 « Nous naissons nus. Tout le reste c’est du travestissement » NdT 104 Mauss, Marcel, Les techniques du corps, 1934, consulté sur http://classiques.uqac.ca
79
De la même manière qu’ils se teignent et déteignent les cheveux, nos auteurs ont
tendance à expérimenter la plasticité du langage html pour personnaliser leurs
espaces. Il n’est pas rare de voir leurs profils sur un fond noir ou rose ou avec des
polices différentes qui contrastent avec ce que l’architexte d’Xpeeps propose par
défaut. Par ailleurs, c’est ce type d’auteurs qui exploite le plus les cases destinées
aux centres d’intérêts en fournissant leurs références culturelles comme éléments
participant à une cohérence stylistique et permettant une lisibilité sociale.
Ainsi, pour illustrer cette idée de customisation, prenons l’exemple d’un profil dont le
sous-titre (headline) marque le ton dès le départ : « This vagina has a brain105 ». Par
cette maxime, l’Auteur affiche une distance – peut-être méprisante – à l’égard
d’autres amateurs comme ceux dont nous traitions dans le chapitre précédent.
(2.2.2) Dans la case musique, l’Auteur critique la possibilité qu’il appartienne à un
cliché social, il affirme : « Je ne crois pas que "seuls les gothiques écoutent de
l’indus, seul les racailles écoutent du rap, seuls les rednecks écoutent de la country,
seules les jeunes minettes écoutent de la pop, et que si tu écoutes de tout tu sois un
poseur."» L’auteur poursuit sa longue digression sur ses goûts musicaux citant
Marilyn Manson entre autres, ainsi que ses séries et films préférés. Il signale par
ailleurs : « je préfère voir une photo de ton visage qu’une photo de ton sexe » et fait
figurer le piercing parmi ses aspirations. Le tout sur fond noir, gris et mauve. La
police des liens est une variété de verdana barrée. Autant de signes pour marquer
une position auctoriale sophistiquée afin d’harmoniser le passage vers sa galerie par
la mise en convergence des formes et couleurs. L’Auteur est le reflet de discours
sociaux sur la musique, le cinéma, la télévision et le corps dans lesquels se
reflèteront d’autres amateurs, mais il est aussi le reflet de sa propre imagination : son
image correspond à celle d’un personnage sous les traits duquel il s’imagine lui-
même, auquel il consacre toutes ses photos. Il construit un corps construit pour
continuer sa transformation.
B. Se donner à lire : des signes corporels comme filtres du regard A l’écran, sur son corps, sur son corps à l’écran, c’est une démarche de recherche
esthétique qui guide le travail auctorial. Un tatouage ici, un piercing là, et des photos
105 « Ce vagin a un cerveau… » NdT, CD annexe 34-P, 34-G
80
respectives pour documenter ce ‘parfaire’ corporel et le donner à voir. Le profil
comme antichambre de la galerie fait ici office de métadiscours esthétique, de
consigne du regard. Son contenu semble dire : voici l’œuvre vivante, lisez-la. En
effet, il n’est pas question de la voir, ni de l’avoir comme auparavant (bien que cela
puisse arriver), il est question pour l’Amateur de la lire dans l’image, de reconstituer
mentalement cette intention de l’Auteur de se produire sous un corps différent.
Dans cet ordre d’idées, chaque auteur se met en scène comme espace bio-politique
souverain, mais aussi comme gestionnaire de son image : il s’adonne à une charte
graphique et à une ligne éditoriale. Ils incarnent bien cette posture foucaldienne que
l’artiste féministe Barbara Kruger rendit célèbre sous forme de slogan : « Your body
is a battleground ». Cette conceptualisation du corps comme champ de bataille
suppose non seulement une combativité à l’égard des signes qui le parasitent, mais
aussi une véritable politique représentationnelle comme engagement auctorial.
De manière concrète, les constructions de ces auteurs ne sont pas seulement des
prises de vue, elles font souvent l’objet d’un traitement graphique subséquent. Ainsi,
filtrées par Photoshop et ses équivalents, les images gardent les traces de ce
passage logiciel où l’Auteur a manipulé une série de réglages afin d’obtenir un
résultat final satisfaisant. Ces réglages correspondent la plupart du temps au
contraste, à la luminosité, à la saturation et à l’échelle de couleurs. Autant de
modifications qui connotent le corps auctorial de manière différente : il sera moins
charnel avec un teint qui rend la peau pâle, il échappera au quotidien en se
soumettant au régime du sépia ou du noir et blanc. En matière de composition, sont
privilégiées les vues d’ensemble avec une conscience de la pose maximale. Ce n’est
pas seulement le regard qui traduit l’avènement de l’image, mais tout le corps qui
exécute une figure rhétorique et gymnastique. En outre, ce corps n’est jamais seul :
le vestimentaire joue un rôle primordial, lingeries et accessoires captent le regard,
des couches de maquillage donnent une « beauté efficace » au « visage profane de
la vie quotidienne106 », les objets mis en scène ont une valeur symbolique. Ces
auteurs, outre la conscience de la pose ont une conscience de la circonstance qu’ils
106 Edgar Morin au sujet des visages « maxfactorisés » du monde du cinéma, « Le temps des stars, la liturgie stellaire». in Les stars, Seuil, Paris, 1972, p.43
81
essaient de maîtriser en retravaillant chaque image. Rien ne doit être perçu comme
hasardeux ni résiduel, les prétentions photographiques au réel sont substituées par
une nette préférence pour les constructions artificieuses. Ainsi, il n’est pas inusuel de
voir un corps détouré pour obtenir un fond homogène sur lequel on vient incruster un
élément graphique étranger : c’est le cas d’une tête de mort rose fluo apposée sur un
sein pour parodier une censure, ou des lettrages censés évoquer une carte postale.
Le système sémiotique de la galerie de ce type d’auteurs repose sur une
multiplication du studium par chaque construction. Nous empruntons ce concept à
Barthes pour décrire cet « intérêt humain » qui permet culturellement de participer
« aux figures, aux mines, aux gestes, aux décors, aux actions107 ». L’Auteur essaie
de sensibiliser l’Amateur à une esthétique qu’il revendique propre. Ainsi, pour la
première fois, les commentaires ne s’adressent ni à la personne, ni à l’organe réifié,
mais à l’image elle-même ou au look comme ensemble : Nice picture! , on n’évalue
plus un corps mais sa mise en image. L’Amateur dissocie le scopique du charnel.
Il arrive parfois qu’au-delà du studium, il y ait punctum, c'est-à-dire un élément
ponctuel dans l’image capable de poindre le regard. Ainsi, le regard se recentre sur
un élément qui n’est pas le corps, mais qui s’y incarne : ceci peut être une robe, un
vernis, un piercing Prince Albert qui transperce le gland. Autant d’objets poignants
dont le commentaire témoigne d’un décodage amatorial qui n’est pas
pornographique ou érotomane et reconnaît à ces pratiques une plus-value
auctoriale : celle du corps physiquement engagé dans l’espace de proposition
sociale. A ce sujet, les dispositifs de social networking réalisent le présage
nietzschéen selon lequel qui se ressemble s’assemble. Dans cette perspective, ce
type d’auteurs a tendance à créer des cercles sociaux étroits, ce que l’on exprime en
anglais par un clustering coefficient (cœfficient de connectivité entre voisins) qui
mesure l’affinité entre individus pour tisser des liens. Autrement dit, ces amateurs
font clique étant donné qu’ils meublent leurs corps de signes similaires et maîtrisent
les mêmes filtres du regard.
107 Barthes, Roland, La Chambre Claire in op cit, chapitre 10, p. 809
82
Ces auteurs montrent bien que l’obscénité est neutralisable à partir du moment où
les contours culturels de la scène symbolique paramètrent l’exposition, et de ce fait
le regard. Par les filtres des signes incorporés, la nudité devient impossible. Malgré
le dépouillement total, il reste toujours quelque chose à lire qui occupe le premier
plan du corps auctorial. Plus que d’une post-pornographie, nous dirions qu’il s’agit
d’une proto-pornographie dans la mesure où celle-ci expérimente avec des formes
culturelles hybrides, qui pourraient bien comme expérience sociale déclencher de
nouvelles tendances pornographiques ou simplement mettre à mal certains
standards.
Qu’il s’agisse d’entités identitaires, de blasons anatomiques ou de stylisations de la
tenue d’Adam, les conceptions de l’obscène et du pornographique varient dès lors
qu’elles traduisent différentes conceptions de l’exposition de soi. Il est question de
savoir quelle est la priorité de l’Auteur quand il fait de son corps l’objet d’un travail
auctorial : accorde-t-il la prééminence à sa personne morale, à sa personne sociale,
ou à son personnage ? Se positionne-t-il vis-à-vis du miroir, des attentes
amatoriales, ou d’un idéal codé culturellement ? Nous avons dressé ici trois figures
différentes de l’Auteur-Amateur qui se recouvrent parfois et qui montrent bien que
ces questions complexes se posent pour chaque mise en scène de soi. Un point
commun émerge cependant : de manière transversale, tous les échanges se
déroulent toujours sur une norme tacite de bonne foi, comme si l’Amatorat avait
conscience de la fragilité du corps auctorial, comme si l’exposition était un bien
suprême dans la vie du réseau social. Personne ne porte atteinte à personne sur
cette scène du regard, c’est l’unique garantie pour que le spectacle soit. Nous nous
appuierons sur cette piste lisse et opaque à la fois pour donner suite à notre réflexion
dans le chapitre suivant.
***
83
III. PERSPECTIVES CRITIQUES : L’AUTEUR-AMATEUR À L’EPREUVE DU QUOTIDIEN 3.1 L’AUTEUR ET L’AMATEUR (SUITE) : LE RITUEL, LE RÉGIME, LE REGARD Nous avons vu à travers l’exemple pornographique comment un dispositif permet et
encourage l’accès à une position auctoriale supposant un exercice d’exposition de
soi. Dans une moindre mesure, il a été question jusqu’ici d’Amatorat. Nous avons
parlé de son regard et des traces qu’il laisse, plus que de la véritable nature de son
rôle. Or, si le « Web 2.0 » peut être conçu ouvertement comme une machine
d’auctorialisation, il convient de poursuivre cette réflexion en l’interrogeant également
comme machine d’amateurisation. Nous avons insisté précédemment sur la
réversibilité des positions d’Auteur et d’Amateur comme condition essentielle à
l’émergence du web collaboratif. En partant du réel vers l’abstraction, nous nous
éloignerons quelque peu de la chair de nos corps pour mieux y revenir après avoir
débattu du sens de cette co-labor dans laquelle s’engagent auteurs et amateurs,
fraîchement constitués comme colonies des serveurs.
Pour ce faire, la méthode n’est autre que celle que propose l’histoire d’Internet :
empirisme et promesses, et vice versa. Deux composantes discursives dont nous
entreprendrons la critique : Que promet-on ? Qu’a-t-on appris ? Nombreux sont les
ponts qui relient les laboratoires informatiques aux laboratoires du social. Rares, a
contrario, sont les occasions de concevoir ces liens en neutralisant l’enthousiasme
du progrès technique, ou en cachant son scepticisme sur le progrès social qu’ils
incarnent quotidiennement. Tel est le sens que nous donnons à ces perspectives
critiques : il ne s’agit pas de se plaindre des prétendues dérives du travail auctorial,
ni non plus de légitimer le présent comme lendemain en devenir constant. Dès lors,
nous poursuivons cette trajectoire qui relie Auteurs et Amateurs comme parties
prenantes du monde social que prétend incarner désormais tout écran.
84
3.1.1 De l’Auteur-Amateur comme agent sémio-économique idéal
Dans l’Internet contemporain, les figures actantielles du producteur et du
consommateur comme partenaires d’un échange marchand ont été mises à mal par
un afflux massif d’internautes produisant des contenus spontanés qui a modifié la
nature de cet échange sur trois points : ( 1 ) Basculement du marchand vers le
symbolique : l’échange se présente comme gratuit et ne génère plus une plus-value
immédiate. ( 2 ) Le cadre de l’échange se diffère dans l’espace-temps : entre la mise
en ligne d’une production et sa consommation effective, un laps indéfini de temps
peut s’écouler sans que cela n’affecte son potentiel commercial. ( 3 ) Production et
consommation cessent d’être planifiées et planifiables dans le détail : le système
fonctionne à très grande échelle et la notion de perte n’engage pas les partenaires
de l’échange. Ainsi, la nature symbolique de la plupart des échanges à l’écran rend
les concepts de producteur et consommateur inopérants en ce qu’ils transposent une
réalité de marché trop rigide sur un monde social qui ne se structure pas de la même
façon qu’un centre commercial. Ou alors faudrait-il concevoir le centre commercial à
la manière d’un José Saramago qui y voit un substitut de la messe dominicale, un
nouveau temple du monde contemporain.
C’est tout le concept d’agent qu’il faut repenser à l’écran : agent de quoi ? Question à
laquelle l’on ne peut pas répondre à défaut d’observer les actions accomplies par un
internaute au quotidien. L’activité des modems augmente sous l’ordre de la main.
Nous l’avons vu à travers l’exemple pornographique : le spectre d’action de
l’internaute se situe bien au-delà de la lecture mais souvent en deçà du
transactionnel marchand. Pour qualifier ce statut hybride du navigant réseautique
contemporain, nous avons choisi de le considérer tout au long de ce mémoire
comme un Auteur-Amateur : acteur de la scène des échanges symboliques, libéré
d’obligations contractuelles, responsable de sa propre figuration à l’écran.
Nous venons de regarder dans le détail l’Auteur-Amateur qui autopublie, qui
commente, qui laisse les traces de son passage. Jusqu’ici, il a été question de
signes en situation, d’individualités auctoriales appréhendant différemment
l’exposition de soi. Qu’arrive t-il lorsqu’on conçoit ces signes dans l’abstraction,
lorsqu’on évacue l’individualité de chaque auteur ? La posture est radicale, mais
85
nous permet de voir les logiques sociales sous-jacentes aux échanges entre l’Auteur
et l’Amatorat. En effet, sur les sites de social networking, chaque Auteur-Amateur,
avant d’être conçu sous un angle poétique ou économique, n’est essentiellement
qu’un agent sémio-économique, un participant. En le qualifiant d’agent sémio-
économique, nous voulons insister sur le fait qu’il est l’objet d’une théorie du signe
insensible au contenu qui ne prétend être d’abord qu’objets informatiques génériques
et usages sociaux modélisables. L’Auteur-Amateur, avant d’être lui-même, est déjà
‘cliquable’, ‘téléchargeable’, ‘commentable’. Même sous un angle juridique, les sites
de social networking se déresponsabilisent des contenus : en termes de droit
d’auteur, chaque internaute est responsable. Dès lors, quel est donc le statut de ce
signe tiraillé entre l’abstraction économique et la proximité interpersonnelle ? Partons
de l’hypothèse que ce signe n’est que l’unité d’une économie réseautique, et que
l’Auteur-Amateur est son agent responsable.
Dans cette perspective, nous sommes proches de Jean Baudrillard lorsqu’il propose
une critique de l’économie politique du signe : « Ce n’est pas comme véhicule d’un
contenu, c’est dans leur forme et leur opération même que les médias induisent un
rapport social, et ce rapport n’est pas d’exploitation, il est d’abstraction, de
séparation, d’abolition de l’échange108». Si nous actualisons cette thèse en atténuant
sa controverse avec les théories d’inspiration clairement marxiste d’Enzensberger,
par rapport auxquelles se positionnait Baudrillard, nous pouvons concevoir l’Auteur-
Amateur comme agent d’abstraction, opérateur des médias informatisés qui
organisent l’économie du signe à l’écran. Ainsi, participation et collaboration érigées
en idéaux du monde réseautique ne seraient que la couche discursive superficielle
de rapports éminemment économiques que sous-tendent les signes et leurs usages.
Sans le qualifier d’«exploitation» ni d’«abolition», partons du rapport social
qu’induisent les sites collaboratifs comme MySpace ou Xpeeps : il s’agit ouvertement
de participation médiée par ordinateur ; cependant, le sens de celle-ci a beaucoup
évolué au long de ces dix dernières années. Une sémantique historique des
opérations accomplies par l’internaute le montre bien : ouvrir un compte, s’inscrire,
ont glissé vers créer un profil, rejoignez la communauté. Rétrospectivement, de
108 Baudrillard, Jean, Pour une critique de l’économie politique du signe, Gallimard, 1972, p. 207
86
register à join in se joue le passage d’une rhétorique fonctionnelle de la base de
données à celle de l’expression communautaire et de la rencontre. Il en va de même
pour la notion de stockage : la question de la capacité s’est évaporée, la tendance
est à abolir les limites mêmes du stockage, ce qui l’annihile. Aujourd’hui, nous
pouvons distinguer deux formes de stockage : la première qui se revendique comme
telle héberge en effet de manière industrielle et impersonnelle des fichiers de taille
importante ; la deuxième ne s’assume plus comme telle car elle revêt un caractère
personnel et fonctionne sur une rhétorique du partage. La première forme
correspond à des sites comme RapidShare, YouSendIt ou MegaUpload sur lesquels
un fichier est mis à disposition pour téléchargement. L’interface ne prévoit que cet
usage, c’est une économie du transport, du ponctuel, du service locatif de gigabytes.
La seconde forme est celle qui nous intéresse ici. L’internaute met à disposition ses
fichiers sur son espace, mais ceux-ci ne sont pas destinés exclusivement à être
téléchargés, ils vont être davantage vus, commentés, écoutés, reproduits que
transportés définitivement entre deux locaux de stockage à distance. C’est une
économie de l’exposition, du rituel, de l’actualisation constante des mêmes espaces.
Cette participation suppose que l’accent soit davantage mis sur le téléversement
que sur le téléchargement. L’Auteur est donc responsabilisé de l’actualisation d’un
espace et développe avec celui-ci un rapport d’attachement et d’entretien, un peu
comme un vieux monsieur avec son jardin, sauf que cette fois-ci ce jardin est
publicisé et vaut image de soi pour d’autres jardiniers. Avant d’être responsable de
sa propre figuration (qui suppose une adéquation sémiotique avec un récit de vie),
l’Auteur a déjà un rôle économique figuré comme devoir qu’il acquiert avec le
système de signes. L’Auteur travaille son espace face à un Amatorat qu’il ne connaît
pas : entre les passants et le nombre d’amis surélevé, il ne sait jamais qui le regarde
mais garde conscience d’être regardé. Implicitement, cette situation de regard
amatorial plus fantasmatique que réelle, entraîne de la part de l’Auteur un
engagement hystérique et une promesse constante de nouveauté. C’est donc toute
la tension entre les signes personnels et les expectatives sociales qui structure la vie
de ces sites. Pourtant, les expectatives comme l’Amatorat sont par nature
insondables, on peut prétendre les connaître, mais elles relèvent d’une attention pas
aussi stable que l’Auteur ne le croit. Nous sommes dans un cas de figure proche de
celui du philosophe Miguel de Unamuno tenté de répondre à la question qui es-tu par
87
une phrase d’Obermann : « Pour l’univers, rien ; pour moi-même, tout109 ».
L’économie du signe proposée est a priori pour l’Auteur tout aussi égocentrique :
mon espace, mon profil, ma galerie, mes amis, et la question qui suis-je ? reviennent
en permanence. Or, pour le dispositif, le problème se pose en termes
sociocentriques : en règle générale aucun des auteurs n’est censé être un isolat. Ces
deux niveaux, l’égocentrique et le sociocentrique sont les responsables de l’activité
sémio-économique sociale : pour l’Auteur, une mise en signes définitive ne serait
possible que post mortem, pour l’Amatorat, ces signes ne valent que comme points
nodaux et perdent très rapidement leur effet de surprise, le tour décisif se jouant la
première fois.
Dans cette perspective, nous pouvons dire que le couple Auteur/Amateur constitue
l’agent sémio-économique idéal : du côté de l’Auteur, une figure égocentrée pour qui
les signes doivent changer au fil du temps pour traduire l’évolution de sa vie ; du côté
de l’Amateur, une figure sociocentrée qui n’est plus l’amateur des signes, mais
l’amateur d’une économie du signe. En effet, participation et collaboration sont des
discours qui traduisent non pas un rapport auctorial ou amatorial au signe lui-même,
mais un attachement au medium qui le contient. Ainsi, quitte-t-on à jamais le
paradigme de l’amateur de, car l’objet de l’amour devient indéfinissable : c’est
MySpace ou Xpeeps que les internautes aiment comme abstraction d’une offre qui
rencontre une demande. Le ressort de cette économie du signe est la récurrence :
chaque visite ne compte plus par la rencontre qu’elle implique, mais comme exercice
rythmique du sens. C’est la répétition des formes qui habitue à l’exercice : il n’est
jamais question d’un auteur ou d’un amateur en particulier, ce qui fascine est
l’imposition collective d’une mise en équivalence. Si l’économie instaure ce régime
d’égalité en termes de prérogatives et d’usages, c’est pour mieux accentuer son
caractère de coquille vide et virtualisante de violences symboliques éphémères. En
autonomie, l’internaute choisira son parcours de participant économique, il fera
avancer les mécanismes de comptage, nouera des relations avec d’autres agents
qui in fine prendront son parcours en charge.
109 Le philosophe espagnol Miguel de Unamuno citant le personnage Obermann du roman homonyme d’Etienne Pivert de Senancour, in Del sentimiento trágico de la vida, Folio, Barcelone, 2002, p.7
88
Si dans un premier temps les dispositifs rappellent la fatigue de devoir être soi, cette
charge de travail auctorial sera compensée par la suite par les rituels amatoriaux de
reconnaissance, contre-proposition et distraction. L’excès existentiel de l’effort
poétique initial se dissout dans le hasard social qui le soulage, le récompense et
redémarre les cycles de production auctoriale. Accès et actualisation sont les deux
opérations de cette économie du signe : l’accès est l’annexion au medium comme
espace de visibilité sociale ; l’actualisation est la garantie de survie du système
comme moteur de la récurrence. Ces deux opérations permettent au medium de
reposer sur des réseaux sociaux grandissants qui en termes de production et
consommation sont tout à fait autosuffisants. Les dispositifs profitent du spectacle
autarcique qu’ils organisent en formalisant les échanges Auteur-Amatorat. Le signe
n’est plus l’objet de l’échange, sans que l’échange soit aboli pour autant. L’échange
devient une rencontre topographique dans le lieu consensuel du média : sa répétition
le promeut au rang de rituel d’abondance préférant dans le signe le hasard de sa
rencontre à sa promesse de sens.
Cette économie du signe que nous décrivons comme théorie des usages du signe à
l’écran correspond - par le télescopage qu’elle pratique à l’égard des sémioses
locales - à la conception du réseau que postule la loi de Metcalfe110. Formalisée par
Robert Metcalfe, inventeur de la technologie Ethernet et co-fondateur de la
compagnie 3Com, cette loi stipule que la valeur d’un réseau est proportionnelle au
carré du nombre de ses membres, étant donné que chaque membre est
potentiellement connecté à tous les autres. Ainsi, la valeur du réseau modifie la
valeur du signe de la manière suivante : le système des connexions sociales
détermine l’espace d’usage du signe ainsi qu’un ensemble de signes concurrents. La
valeur sémantique (sens pour quelqu’un) est indissociable de la valeur sociale
(connectivité potentielle), ne plaçant pas l’Auteur-Amateur dans un paradigme
romantique de création et contemplation, mais au contraire dans l’exploration
constante d’affinités. Au temps de la créativité de masse, le sémiotique dessert le
social en étant le moteur de l’affinité : ces affinités momentanées seront pérennisées
en liens donnant au signe un statut de passerelle piétinée. Sur les pas de quelqu’un
d’autre, l’Amateur frayera son chemin hypertextuel et bifurquera à un moment sur un
110 Robert Metcalf, Metcalfe’s Law Recurses Down the Long Tail of Social Networks : http://vcmike.wordpress.com/2006/08/18/metcalfe-social-networks/
89
signe affin sans se rendre compte qu’il porte en son regard la responsabilité d’élargir
un circuit économique. Les traces de ce regard guideront idéalement d’autres
regards dans leur rencontre de signes : pour que le rituel devienne récurrent, il faut
que l’édifice soit mi-temple, mi-labyrinthe, il faut que le cadre de l’échange paraisse
sans limites. L’Auteur-Amateur exprime le vertige de faire partie d’un réseau élargi,
en même temps qu’il ne parle qu’à titre personnel, il est le sujet-objet d’un laboratoire
ironique.
3.1.2 La Propriété et le regard
Nous concevons la navigation dans le web collaboratif comme un rituel d’activation
d’une économie du signe à complexité croissante. En tant que cadre de l’échange,
l’écran modélise les interactions effectuant un lissage des possibilités de subversion
ou de rupture du circuit de navigation sociale. Les points de non retour ont été
supprimés : il est toujours possible de cliquer ailleurs, de passer à l’espace de
quelqu’un d’autre. Outre cette fluidité du regard à l’écran, nous avons signalé cette
norme tacite de bonne foi qui épargne les auteurs des critiques de l’Amatorat.
L’exemple pornographique montre à quel point Internet constitue un milieu sécurisé
pour pratiquer l’exposition de soi. Jamais une insulte, jamais un commentaire
complexant. Sur Myspace, même constat : jamais les injures ne viennent troubler ou
désapprouver la mise en ligne de quoi que ce soit. Les rares exceptions peuvent être
supprimées en usant d’une prérogative auctoriale. Comment expliquer cette
cohabitation d’une polyphonie hyperbolique avec une univocité du regard ? Les
amateurs se multiplient et ne regardent pas les mêmes choses ; cependant,
axiologiquement, leurs regards vont dans le même sens : l’approbation.
Dans son ouvrage Qu’est-ce que le virtuel ?, Pierre Lévy propose une lecture de
cette tendance à la « valorisation réciproque » comme condition d’une intelligence
collective qu’il considère idéale. Loin de l’enthousiasme qui entoure l’idée
d’intelligence collective pour Lévy, nous pouvons l’exprimer en termes simples : il
s’agit d’une mise en ligne massive de contenus numérisés qui constitueraient un
patrimoine collectif pour tous les internautes, une démocratisation par les réseaux de
l’accès au savoir. Dans cette perspective, nous pourrions par exemple parler d’un
90
savoir pornographique dans les mains d’un collectif intelligent : l’Amatorat. La même
situation serait envisageable pour un savoir littéraire ou musical. Ce qui nous
intéresse dans cette numérisation et mise en ligne des savoirs est la structuration
qu’ils adoptent en se constituant à chaque fois comme «mondes de culture».
Idéalement, Lévy décrit quelques unes des règles et valeurs qui régiraient ces
« mondes »-là : « évaluation permanente des oeuvres par les pairs et le public,
réinterprétation constante de l'héritage, irrecevabilité de l'argument d'autorité,
incitation à enrichir le patrimoine commun, coopération compétitive, éducation
continue du goût et du sens critique, valorisation du jugement personnel, souci de la
variété, encouragement à l'imagination, à l'innovation, à la recherche libre111 ». Ces
normes sociales sont en vigueur dans le monde culturel pornographique que nous
avons étudié dans ce mémoire. Deux éléments retiennent cependant notre attention :
l’incitation à enrichir le patrimoine commun et le souci de la variété dont l’Auteur-
Amateur que nous avons étudié est le garant. En effet, l’absence de valorisation
réciproque se traduirait par la désertion des auteurs et l’appauvrissement du
patrimoine en général. Or, l’abondance est la condition pour que le rituel soit
récurrent. Cette logique de la valorisation explique la prolifération de productions
auctoriales, mais n’explique pas l’invisibilité d’un discours négatif à l’écran. A cet
égard, nous estimons nécessaire de souligner la nature éminemment référendaire
des rapports que lient l’Auteur et l’Amatorat : en règle générale, sur les espaces
personnels, les expériences négatives ne laissent pas de traces, si l’approbation
n’est pas momentanée et totale, l’alternative n’est que l’ignorance et le néant.
Ces mondes numérisés de la culture véhiculent ainsi une conception du collaboratif
qui est proche de la complaisance. A la croisée du droit à la participation comme
liberté d’expression et de l’impossibilité de refuser un clic ou un regard, l’exploration
d’affinités sémiotiques finit par produire la structure d’un réseau social. Si les
fragments du privé sont livrés à la sphère publique avec tant d’aisance qu’ils
paraissent parfois des « offrandes prostitutionnelles112 », c’est parce que le régime
participatif a pour fondement un culte de la productivité personnelle qui ne saurait
111 Lévy, Pierre, Qu’est-ce que le virtuel ? Chapitre 8, La virtualisation de l’intelligence ou la constitution de l’objet, disponible sur http://hypermedia.univ-paris8.fr/pierre/virtuel/virt0.htm 112 Molinié, Georges, in op cit p.258
91
être discriminant. A partir du moment où un auteur assume une production comme
sienne, un respect sacro-saint recouvre son œuvre car celle-ci porte son aura, mais
surtout parce qu’elle légitime l’exercice public de la propriété comme droit.
Le mérite de l’Auteur n’est autre que de se laisser aliéner son opus proprium – voire
son opus nigrum dans le cas de la pornographie – pour voir validé son droit de
propriété par la reconnaissance amatoriale. Ceci produit une image positive de soi,
même dans des circonstances que le monde contemporain qualifierait de « trash ».
Quoi qu’il en soit, l’Auteur est toujours propriétaire, et revêt cette aura souveraine de
maître de son corps et de son espace. Il ressort fortifié de son audace : il a
conscience d’avoir été vu en train de faire usage public de sa propriété. Telle est la
plus-value d’un détour par le public pour toute proposition de subjectivité : le sujet
socialisé se forge une image publique et cumule des regards qui ne fonctionnent pas
comme mécanismes de contrôle social, mais comme gratificateurs symboliques de
sa prouesse ostentatoire.
Le couple rituel/tabou des mondes numérisés de la culture organise ainsi un système
de regards : l’Amatorat a le droit de tout explorer, de tout scruter, mais n’a pas le
droit de décevoir l’expectative propriétaire auctoriale. Il s’agit de rendre une image de
retour confortant l’exercice de numériser et donner à voir. Ce ne sont pas les parties
nobles ou honteuses de l’Auteur qui incitent l’Autre à s’exposer, c’est la confiance
qu’il a du système sur l’interdiction de regards malveillants. Internet est tout sauf un
lieu d’autocritique : il stimule un processus auto-poétique à condition que celui-ci ait
une emprise sociale. Les auteurs et les amateurs utilisent l’écran comme une salle
de miroirs qui aliène leur image, mais la leur rend. Le droit civil donne à ce régime le
nom de « nue-propriété113 » : l’Auteur demeure le propriétaire titulaire de son image
mais cède son usufruit à tout amateur qui y aurait vu un brin d’affinité. L’usage et la
fruition reviennent à des amateurs qui eux aussi se sont dépossédés. Tout Auteur-
Amateur est nécessairement un nu-propriétaire.
113 La notion de nuda proprietas découle du droit civil romain, et décrit le droit qui reste au propriétaire pendant la durée de l’usufruit lorsque il est dépossédé de sa jouissance : proprietas nuda est proprieta deducto usufructu. Plus simplement, la nue propriété qualifie la propriété séparée de la jouissance de la chose. Cf.Code civil français, articles 578 et s. 587
92
3.2 IDÉOLOGIE DE LA PERSONA : TENSIONS STATUTAIRES
Dans la continuité de cette réflexion sur l’activité rituelle de réactivation d’un régime
d’exaltation du « propriétariat » à la base de l’économie du signe du web collaboratif,
nous avons voulu interroger les idées qui dominent le quotidien que partagent
l’Auteur et l’Amatorat. Notre lecture a été délibérément abstraite afin de viser cette
partie opaque de la vie des signes lorsqu’elle atteint un niveau transculturel et supra-
auctorial. Maintenant, nous revenons vers le quotidien de cet Auteur-Amateur
lorsqu’il perd conscience de son statut d’agent économique : jour après jour, cette
économie du signe prend la forme conviviale de l’échange interpersonnel, qui efface
le soupçon d’un rapport instrumental à l’écran. La distance artificielle que nous
venons d’induire pour extérioriser notre regard sera ici écourtée pour essayer de
saisir l’essence habituelle de l’exercice auctorial114. La méthode n’est autre que de
nous mettre à la place de l’Auteur pour comprendre la personne qu’on lui demande
non pas d’être mais d’avoir. Pour ce faire, nous alternerons des passages à la
première personne destinés à revivre une dramaturgie auctoriale, avec des
passages d’analyse où le métalangage permettra un distancement.
3.2.1 L’humain du système, le système de l’humain
Le discours est toujours celui du partage des photos, des textes, des musiques avec
des amis qui ne sont pas là. L’Amatorat est virtuel : c’est l’Auteur qui l’attend.
Cependant, cette démarche de rencontre entre une proposition de subjectivité et un
public qui la validera se doit d’être agile à l’image de la culture du court terme qu’est
celle de notre temps. Dans cette perspective, la rationalité à l’œuvre n’est autre
qu’une systématisation de l’humain. Il faut codifier un moi pour l’écran qui reste
assez moi, mais qui, par rapport aux autres, puisse être équivalent. Le sens de cette
construction est donc celui du recensement autoréflexif sur des critères homogènes
pour tout un corps social. C’est un résumé de l’être –comme histoire personnelle et
comme projection dans le présent– qui est demandé à chaque auteur :
114 Nous revisitons la citation de Michel de Certeau, qui est transversale à ce mémoire : «un essentiel se joue dans cette l’historicité quotidienne indissociable de l’existence des sujets qui sont les acteurs et les auteurs d’opération conjoncturelles», in op cit p.39
93
représentation synthétique de soi qui puisse susciter le regard, et provoquer des
affinités traduites en adhésion amatoriale. « Il faut que je me trouve un nom, une
image, que je parle en quelques lignes de moi-même, que je dise ce que j’aime
socialement, musicalement, sexuellement » : nous appelons cet assemblage de
signes issus d’une réflexivité individuelle un modèle de persona. Le medium Internet
sous ses formes collaboratives rend l’application de ce modèle sur chaque individu,
intuitive et spontanée, comme si elle allait de soi ; dans cette perspective, il
est « effecteur d’idéologie 115».
L’idéologie de la persona suppose donc la praxis logicielle d’une « théorie
matérialiste du soi » sous une des formes que Charles T. Wolfe conçoit : il s’agit
d’une « réduction et reconstitution logique de l’identité personnelle ». Cette opération
de réduction et reconstitution repose sur un même modèle de persona, qui n’est
autre que l’objectivation du moi en un soi. « Il faut que je sois moi-même en
adéquation avec le modèle proposé pour être soi » : la mosaïque de données
personnelles (biométriques, autobiographiques, sociologiques, consuméristes,
comportementales) constitue actuellement le modèle du soi sur Internet. L’absence
d’une de ces composantes mutile la persona de son masque plein : cette
combinatoire garantit un ancrage symbolique efficace à l’écran, elle donne à la
médiation informatique l’habillage sémiotique d’une situation interpersonnelle. Peut-
on subvertir ce modèle ? Les contre-exemples abondent mais traduisent une forte
dose d’ironie sociale : nous songeons aux auteurs qui dans le cadre destiné aux
goûts musicaux citent « la pluie », dans la rubrique télévision incrustent une vidéo de
YouTube (ou PornoTube), et dans la rubrique héros mentionnent leurs grands
parents. Ces pratiques sont subversives en ce qu’elles détournent le modèle de la
persona de son rôle pragmatique initial : celui de permettre une mise en équivalence
transversale en segmentant l’individu dans une série de topoï identificatoires. Faute
d’amateurs qui aiment la pluie ou la gériatrie familiale, le modèle est mis à mal. A
l’inverse, il est possible de créer une persona fausse : de remplir toutes les rubriques
en visant une cohérence des données qui rejoigne un archétype individuel, c’est le
soi. Tout le paradoxe est là, au sein du dispositif, il y a des machines qui créent des
façades comme celles utilisées pour distribuer du spam ou communiquer en mode
115 Baudrillard, Jean, in op cit p.207
94
viral ; ces machines parviennent à être plus personnes que celui qui cherche une
prétendue honnêteté du moi.
Dans l’idéologie de la persona, ce qui est en jeu est le distancement entre le soi et le
moi : l’écran en tant que miroir socialisé fournit un prototype identitaire compatible
avec le rituel d’exploration d’affinités et le régime de nue-propriété. Ainsi, chaque
fragment du soi factice est destiné à faire écho aux fragments d’autrui mais aussi à
être source de jouissance par une sorte de fétichisme. Ce qui fascine est cette
systématisation de l’humain, cette rection par catégories distinctes qui prétend
résumer l’essentiel de soi, en tout cas ce qui est considéré comme essentiel
socialement. Très rapidement on comprend que faute de coprésence, c’est au
système des objets qu’on s’en remet pour faire émerger un jugement personnel.
«Ce que j’aime socialement, musicalement, sexuellement se parle en objets, en
objets communs » : or, les seuls objets communs convoqués sont ceux du monde de
la consommation. La stabilisation des valeurs sociales de ces objets est
contemporaine de la modélisation de la persona : les médias de masse ont permis
de parler de soi-même avec des objets. Comme le casque et la lampe auraient pu
symboliser la personne d’un minier, ici, un tas de livres, CDs, et DVDs peuvent de
même recréer l’idée d’une personnalité. Si depuis les années 80 le thème de la
société de consommation semble avoir été remplacé par celui de la société de
communication, c’est pour mieux effectuer la consommation symbolique de l’autre.
C’est une sorte de méta-consommation, celle qui rend possible qu’on lise cet autre,
somme d’objets, comme s’il était un Frankenstein encodé à l’écran.
Le rôle des médias a été de répandre ces modèles de construction identitaire : ils
nous ont habitués à la consommation récurrente de ce que Stuart Hall appelle des
« stratégies représentationnelles116 » : un ensemble de représentations destinées à
construire un sens commun sur l’appartenance et sur l’identité. Les formes sociales
d’Internet incarnent dans cette perspective une posture médiatique qui suppose que
ces stratégies représentationnelles ont déjà été intériorisées et procèdent de ce fait à
accentuer leur systématicité. La persona devient habituelle. Il est intéressant de
noter qu’avec le temps ces objets représentatifs d’une personnalité, seront eux aussi
116 Hall, Stuart, A identidade cultural pós-modernidade , DP&A editora, Rio de Janeiro, 1992, p.51
95
numérisés et disponibles sur Internet. A ce moment-là, Internet pourra se vanter
d’avoir réussi une systématisation de l’humain doublée d’une systématisation des
objets. Telle est l’illusion stratégique d’un circuit représentationnel efficace qui
répond aux questions « qui je suis » et « que aimer » comme un oracle numérique.
3.2.2 Circonstances atténuantes : le corps et l’écran Le contrepoids de la systématicité idéologique de la persona est la circonstance.
Nous entendons par circonstance la part résiduelle du réel à l’écran. Ainsi, la
capacité de l’Auteur à être persona en appliquant un modèle identitaire est toujours
atténuée par une circonstance qui ne se laisse pas systématiser. Le masque est
parfait mais laisse entrevoir l’œil légèrement myope ou le grain de beauté qui, en tant
qu’attributs accidentels, constituent le lieu même de la distinction identitaire et de
l’effet de réel. Tout auteur est confronté au moment de se donner à voir à cette
tentation perfectionniste que Louis Marin met dans la bouche du peintre Poussin qui
disait de sa peinture : « Je n’ai rien négligé117 ». Dans l’art sous-évalué que pratique
l’Auteur-Amateur que nous avons étudié, cette tension se présente, mais
contrairement au peintre, la négligence est revendiquée. La prééminence de l’image
photographique et sa non maîtrise technicienne accentuent sans doute cette
visibilisation de la circonstance. Cependant, loin de la technique de représentation
par laquelle Nicolas Poussin serait fasciné s’il vivait, c’est le lieu même de la
représentation qui entretient avec l‘Auteur un rapport particulier.
L’écran en effet, entretient avec le corps un rapport antagonique historiquement
sédimenté : rares sont les fois où un écran n’ait pas été utilisé pour représenter des
corps. Des silhouettes anthropomorphes qui amusaient l’enfance royale projetées
sur un drap, en passant par les visages-paysages des stars du cinéma que Morin
décrit, jusqu’aux corps sémiotisés des présentateurs télé. L’exception avait été celle
de l’écran informatique qui fut longtemps un lieu exclusivement dominé par des
pixels textuels puis hypertextuels. Comme nous l’expliquions au début de ce
mémoire, il aura fallu attendre que la pulsion scopique fabrique des corps au format
117 Marin, Louis, De la représentation, Seuil, 1993, p. 328
96
ascii pour figurer enfin l’anthropomorphe à l’écran. Daniel Bougnoux dira : « Le réel
se dérobe, la matière se volatilise, moins de corps est sollicité. On peut s’inquiéter de
cette conversion virtualisante, que certains équilibrent par des sursauts physiques
(...) Dans ce contexte, la pornographie peut apparaître comme une de ces conduites
par lesquelles du corps se trouve malgré tout rappelé, qui ailleurs se dérobe.118»
Dans notre lecture de l’Auteur-Amateur, cette « conversion virtualisante » équivaut à
l’idéologie de la persona. L’anthropomorphe a contrario serait ce sursaut physique, la
pornographie son corollaire. Le point de tension s’effectue dès lors qu’à l’écran
informatique cohabitent la modélisation de la persona et sa figuration
anthropomorphique : le corps atténue la systématicité identitaire, mais
paradoxalement reste le moyen le plus efficace de personnifier.
L’antagonisme du rapport corps/écran traduit ce paradoxe de l’organique dans
l’inorganique : selon l’expression du philosophe italien Mario Perniola119, le corps à
l’écran a un « sex-appeal » supplémentaire, celui de mieux incarner la personne que
sa propre chair. La question ne se pose pas en termes de matériel/immatériel, entre
le corps et l’écran tout est matériel. Au début du XXème siècle, il était possible de voir
des cartes postales d’un homme ou d’une femme livre à la main, en train de se
masturber. Le rapport corps/écran est de cet ordre : c’est un artefact qui force le
corps à s’imaginer. Nous pouvons avoir deux conceptions différentes de ce rapport.
Dans une pensée de la prothèse, l’écran est le prolongement de l’imagination
visuelle. Dans une pensée de l’inscription, l’écran est le lieu du corps imaginé. La
radicalité de l’exemple pornographique consiste à concilier ces deux pensées :
l’écran est la prothèse inscriptible qui apprend à l’Auteur que son corps est
inscriptible et que la persona est une prothèse.
Le rôle de la circonstance dans le rapport corps/écran est d’atténuer l’aspect factice
de la mise en scène de soi. Elle détourne le regard « corporo-centriste » vers les
objets exclus du masque pour mieux faire rejaillir la présence de la chair à l’écran. Le
contre-exemple paroxystique de ce qui arrive au corps représenté en l’absence de
circonstance est celui d’un autre peintre qui n’a rien pu négliger car il a supprimé
118 Bougnoux, Daniel, in op cit p. 73 119 Perniola, Mario, Le sex-appeal de l’inorganique, Leo Scheer, 2003
97
l’espace du négligeable. Nous parlons de René Magritte et son tableau sobrement
intitulé La Représentation120. Il s’agit d’un corps de femme peint des côtes aux
cuisses en nudité. Il est strictement question de ce corps puisque l’artiste a découpé
sa toile au plus près de ces formes féminines que de façon millimétrique un cadre
doré vient isoler. L’absence de circonstance équivaut à l’isolement du corps qui dès
lors renonce à toute ambition de personnification représentationnelle. Une fois de
plus Magritte dénonce la représentation : il n’y reste que la prothèse inscrite ou si l’on
préfère, l’inscription sur la prothèse.
Si à l’instar de Magritte nous détourions tous ces corps que nous avons étudiés de
leurs environnements circonstanciels, les auteurs-amateurs qui se donnent à voir
cesseraient d’être eux-mêmes pour devenir un seul et même Auteur-Amateur idéel.
Cette opération, envisageable sur Photoshop, montrerait par la négative l’absorption
réseautique d’une part auctoriale qui ne se laisse pas systématiser. Elle ne
correspond ni au système de l’humain proposé par le réseau, ni à son système
d’objets : la circonstance est le lieu qui rappelle à l’Auteur-Amateur son absence
d’auto-critique et son inconscient refoulé, en même temps qu’elle dénonce les
défaillances symboliques de la culture populaire comme monde commun imaginé.
Ainsi, l’Auteur-Amateur qui se donne à voir ne se donne pas à voir lui-même, il
donne à voir ce qui en ce début de siècle signifie devoir définir un projet identitaire et
une appartenance culturelle en accord avec les exigences sociales de systématicité
véhiculées par Internet. Il n’est pas l’Auteur d’une mise en scène de soi, il est un soi
mis en scène par un air du temps partagé.
***
120 cf Annexe 5 p. 123 La Représentation de René Magritte, 1937
98
CONCLUSION
Au terme de ce mémoire, nous avons exploré plusieurs facettes des formes
contemporaines d’Internet. Nous avons néanmoins ancré cette réflexion sur un
aspect bien particulier : le statut de l’Auteur tel qu’il se donne à voir. Cette
problématique partait de l’observation des pratiques d’exposition de soi telles qu’elles
prolifèrent sous forme de sites web. Il s’agissait de pratiques d’exposition radicale
puisqu’elles montraient leurs auteurs en activité sexuelle ou en état de nudité. De ce
fait, le champ de rattachement de l’Auteur en question était tout aussi réseautique
que pornographique. Puisque nous avons voulu traiter ce sujet depuis les Sciences
de l’Information et de la Communication, l’accent a été mis sur les rapports que
l’Auteur entretient avec un Internet qui dépasse le dispositif informatique pour
s’asseoir comme discours social transversal à tous les domaines culturels, parmi
lesquels le pornographique. Par conséquent, celle-ci n’était pas une étude de cas,
mais une réflexion critique inspirée par la nature de l’exemple choisi.
En accord avec ce positionnement liminaire, notre raisonnement a pris pour point de
départ une étude de l’Auteur en diachronie de façon à contextualiser sa figure et voir
comment celle-ci avait évolué parallèlement au développement d’Internet. Ainsi, la
première scène de ce mémoire était celle d’un rapport homme/machine encore peu
intuitif, mis en lumière par le pionnier Douglas Hofstader. La dernière scène serait
celle d’un internaute lambda naviguant sur son ordinateur personnel. Entre ces deux
scènes, notre analyse historique de l’Auteur a suivi une trajectoire double : celle des
marqueurs auctoriaux à l’écran, celle de la colonisation des serveurs par ses propres
données. Dès lors, nous avons pu voir le point de passage d’un rapport utilitariste à
la machine à un rapport qui conçoit son expérience comme celle d’un monde vécu.
En étudiant la conjonction idéologico-technique conformée par le discours
d’accompagnement des communautés virtuelles et l’évolution des pratiques de
téléchargement, nous sommes arrivés à une définition actuelle de l’auctorialité
réseautique comme opération quotidienne de numérisation et don sous la forme du
téléversement. L’intérêt de cette analyse diachronique était de démontrer que
contrairement au discours entourant l’émergence du « Web 2.0 », il n’y avait pas de
rupture révolutionnaire mais plutôt une réforme économique augmentant la visibilité
99
des pratiques auctoriales pré-existentes extériorisées sur des pages web conçues
non pas comme supports mais comme lieux de rencontre communs. Cette
socialisation des productions auctoriales est à l’origine d’une position
complémentaire de celle de l’Auteur, à savoir celle de l’Amateur. Le web collaboratif
multiplie les possibilités de contribution et lie entre ces deux figures un espace
sémiotique commun au sein duquel elles entretiennent des rapports de production de
contenus, génération de valeur et gratification symbolique. La principale
caractéristique de cette collaboration est donc la réversibilité statutaire entre les
positions d’auteur et d’amateur. Dans cette perspective, nous avons affirmé tout le
long du mémoire un statut double d’Auteur-Amateur.
Les implications de cette conceptualisation nous ont évité de parler de secteurs
économiques et de chaînes productives, mais nous ont permis en revanche de
réfléchir en termes d’écologie médiatique et d’Amatorat. Il s’agissait de souligner la
dimension sémiotique du travail auctorial, de ne pas concevoir l’Auteur comme un
simple fournisseur de contenus, ni l’Amateur comme un consommateur passif
dépendant d’un écran. En pornographie, la portée de cette transformation
conceptuelle nous a permis de dépasser plusieurs dichotomies. La première,
psychologisante, celle du couple voyeur/objet ; la deuxième, stigmatisante, celle du
couple proxénète/client. Comme pour producteur/consommateur, le sens de ces
binômes limitait la réversibilité des deux pôles et empêchait de rendre compte de la
circularité actantielle constitutive du web collaboratif comme discours social.
A travers la figure de l’Auteur-Amateur, nous pouvions désormais avancer dans notre
entreprise d’analyser les pratiques d’exposition de soi à la rencontre d’une initiative
de l’Auteur avec les logiques sociales d’une économie en place. En l’occurrence,
l’exemple pornographique que nous avons traité est celui du site collaboratif
Xpeeps.com. En rappelant l’imaginaire du peep show, nous avons constaté dans
quelle mesure le dispositif des thumbnails (vignettes) suppose une démarche
volontariste d’exposition auctoriale actualisée par le clic et le regard de l’Amateur.
Cependant, le site n’étant pas seulement une galerie, nous avons de même interrogé
l’architecture des profils. Dès lors, la problématique de l’exposition a rejoint celle de
l’autopublication : de façon très concrète, nous avons étudié le rôle de l’architexte
dans un site de social networking : dans cette perspective, sa dimension
100
contraignante s’est avérée indispensable à l’émergence d’une métaphore
communicationnelle interpersonnelle prouvant que l’interface était conçue comme
lieu d’interactions.
Après ces considérations techno-sémiotiques, nous avons procédé à la confrontation
systématique de nos trois hypothèses de départ ayant à l’esprit la figure de l’Auteur-
Amateur à la fois comme construit socio-historique dépositaire des discours du do it
yourself et comme assemblage sémiotique résultant des modélisations à l’écran. Dès
lors, confrontés à la question du statut de l’Auteur donné à voir, il nous a paru
nécessaire d’adopter une discipline du regard en nous projetant à la place de
l’Auteur sans pour autant prétendre à statuer sur son intentionnalité. Ce n’est pas
non plus la place de l’Amateur que nous avons voulu usurper. Ainsi, nos analyses
ont cherché à restituer ce statut comme résultant de tensions existantes entre
l’Auteur, le dispositif et sa conception de la communauté.
Notre première hypothèse postulait un auteur s’exprimant en tant que subjectivité
créatrice proche d’un auctor au sens classique, capable de concevoir ses
productions comme opus singuliers. Il s’agissait de voir cet auteur comme initiateur
d’une auto-poïèse. D’emblée, face à cette première piste, nous avons été amenés à
relativiser la portée de nos propos initiaux ; en adéquation avec les acquis de notre
analyse techno-sémiotique, nous ne saurions pas concevoir l’Auteur comme étant
« initiateur » d’une auto-poïèse. En effet, celle-ci est amplement guidée par
l’architexte qui limite la créativité de la subjectivité. Ainsi, l’Auteur accomplit certes
une poétique, mais son moi est filtré par le formatage web. Dès lors, son portrait
prend la forme d’une entité identitaire : celle-ci résulte de l’auto-affirmation induite par
l’architexte qui réussit à mettre en lumière plusieurs dimensions de l’individu. De ce
fait, cet auteur affiche dans un premier temps une proximité sociale sur les différents
fronts de son profil avant de se dénuder. L’exposition de soi ici est l’aboutissement
d’un parcours d’auctorialisation assistée qui traduit une envie de se donner à voir sur
tous les plans, y compris sur le plan sexuel. Dans cette perspective, Internet offre ici
une possibilité expressive constante à ces existences d’auteur assumées pour qui
chaque occasion d’exposition est exploitée.
101
Notre seconde hypothèse proposait de corréler le statut de l’Auteur aux usages
sociaux en vigueur sur le site et aux potentialités du dispositif d’Xpeeps. De ce fait,
nous postulions que le web était en quelque sorte commanditaire des contenus et
que l’Auteur répondrait davantage à une injonction participative qu’à son propre
vouloir. La question ici était donc rhétorique et non pas poétique : il s’agissait de voir
un auteur positionné par rapport à un horizon d’attente amatorial et laissant de coté
le jeu de miroir. Nos analyses ont montré l’influence du motif pornographique sur les
productions de ce type d’auteurs. En effet, les auteurs pratiquent une rhétorique du
morcellement qui disloque un corps accessoire d’un corps explicite sur lequel se
focalise le regard. Cette procédure nous a rappelé la pratique poétique du blason
anatomique, ici exécutée sur une matière iconique, ainsi qu’une une autre célèbre
commande : celle de L’Origine du Monde. L’équivalence opérée entre nécessité
représentationnelle et nécessité sexuelle traduit une envie auctoriale de canaliser
une pulsion scopique. L’Auteur mène ici une existence fragmentaire orientée vers un
but précis, sexuel en l’occurrence, qui étant partagé par une communauté
d’internautes devient le moteur d’une créativité sociale.
Notre troisième hypothèse postulait le rapport à un univers culturel (voire sous-
culturel) de référence comme critère déterminant du statut de l’Auteur. Dans cette
perspective, l’Auteur serait dépositaire de codes culturels particuliers garantissant à
ses œuvres une valeur réflexive. A l’issue de nos analyses, cette hypothèse se
trouve confirmée. En effet, il est bien des auteurs qui sur l’écran, mais aussi sur leur
corps manient une combinatoire de signes de façon à différencier leur exercice
auctorial : ces signes relèvent du monde de la consommation culturelle et montrent
l’influence d’Internet dans la diffusion d’imageries vers lesquelles l’Amateur tend. De
ce fait, on bascule sur le mode du personnage qui donne à la scène du web une
distance théâtrale. De la même manière que ces auteurs font de la sémiologie sur
eux-mêmes, ils conçoivent leur rapport au web collaboratif comme un exercice de
différenciation sociale et filtrage du regard.
La portée relative de cette observation des pratiques d’exposition de soi montre bien
que le statut de l’Auteur-Amateur sur le web collaboratif se définit toujours comme un
positionnement privilégiant une histoire personnelle, une représentation fragmentaire
ou la construction d’un personnage. Ces trois possibilités auctoriales traduisent
102
l’emprise d’Internet sur trois plans distincts : une tendance au biographisme, à
l’atomisation ou à l’idéalisation dès lors qu’il est question d’une exposition de soi.
Chacune de ces tendances comporte une conception de la scène différente ; par
conséquent, au vu de notre exemple pornographique, il a été intéressant de réfléchir
à la question de l’obscénité qui peut résulter de deux conceptions différentes : soit
l’on considère dans une perspective diachronique qu’Internet a favorisé un
élargissement de la scène comme champ du visible, soit, de façon synchronique on
interroge au cas par cas les conditions nécessaires à l’effondrement symbolique de
cette scène. Au cours de notre étude, nous avons observé ces deux cas de figure qui
nous ont inspiré à notre tour une réflexion sur la circonstance comme élément
sémiotique produisant une série d’effets du réel à l’écran, parmi lesquels cette
obscénité-là. Cette notion telle que nous la concevons relève d’une sémiotique
ouvertement post-structurelle et peut être tenue pour responsable de la mise à mal
de la solidité constitutive des stéréotypes sur Internet. Le web collaboratif, par
l’intensité de ses échanges multiplie les occasions d’apparitions circonstancielles qui
font muter en prototypes ou paratypes certaines constructions par rapport à leurs
langages stabilisés.
Cette réflexion sur la circonstance suivie d’une ouverture critique ont guidé nos
conclusions au fil d’une troisième partie où nous avons cherché à dépasser le cadre
strict de nos hypothèses pour questionner le statut de l’Auteur-Amateur lorsqu’il se
livre à l’exposition de soi. Ainsi, nous avons pu voir que l’exposition de soi amène
toujours une valorisation positive liée au fait que l’économie du signe du web
collaboratif s’est érigée sur un culte de la productivité personnelle, véritable moteur
de sa croissance. Dans ces conditions, la figure de l’Auteur à l’écran est avant tout
celle du propriétaire : son statut se définit toujours en détournant par le public ses
propres productions. L’exposition de soi n’est autre chose que la pratique d’un agent
sémio-économique montrant comme biens communs ses propres biens.
Par ailleurs, nous avons observé que pour accéder à une position d’auctorialité sur le
web collaboratif, indépendamment des formes de l’exercice, il est toujours
nécessaire de se constituer en persona. De ce fait, nous considérons le média étudié
comme effecteur d’une idéologie consistant à systématiser la personnalité de
l’humain de façon à ce que les auteurs se constituent sur des bases semblables.
103
Étant donné le fait que des objets du monde de la consommation culturelle sont
utilisés par l’Auteur dans la définition de sa propre identité, une perspective de
recherche s’ouvre pour prolonger notre réflexion sur les correspondances
symboliques entre les valeurs sociales de ces objets et les projets identitaires
personnels. Nous avons enfin montré comment le corps fait contrepoids à cette
systématicité, car il est toujours accompagné de circonstances inclassables, tout en
restant paradoxalement le moyen le plus efficace de personnifier un auteur.
Au terme de ces pages conclusives, notre réflexion sur le statut de l’Auteur reste
indissociable de l’histoire des technologies de représentation sur lesquelles il prend
forme. Pour le cas d’Internet, à l’écran ses tendances protéiformes sont compensées
par la systématisation des données et la nécessité d’anthropomorphisme. L’Auteur
sans corps reste à penser et pour l’instant son existence paraît aussi improbable que
celle d’une machine célibataire en 1906. Nous sommes en 2007, année où comme
Picabia le disait : « la pudeur se cache derrière votre sexe121».
***
121 Picabia, Francis, Jésus Christ Rastaquouère, Paris, 1920, p. 7, édition fac-similée accessible sur le site de l'Université d'Iowa http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/ Jesus-Christ_rastaquouere/index.htm
104
BIBLIOGRAPHIE THÉMATIQUE
> Sémiologie Amossy, Ruth et Herschenberg Pierrot, Anne, Stéréotypes et clichés, Armand Colin, 2005
Barthes, Roland, Mythologies, Paris, Seuil, 1957
Barthes, Roland, Sade, Fourier, Loyola, Seuil, 1980
Barthes, Roland, La mort de l'auteur in Œuvres complètes : tomes IV, Éditions du Seuil, Paris, 2002
Barthes, Roland, La chambre claire, Œuvres complètes : tomes V, Éditions du Seuil, Paris, 2002
Compagnon, Antoine, Généalogie de l’auteur, cours accédé sur www.fabula.org
Darras Bernard et alii, Icône-Image, Médiation & Information n°6, L’Harmattan, 1997
Durand, Jacques, Rhétorique et image publicitaire in Communications n°15, 1970
Eco, Umberto, Le signe, Le livre de poche essais, 1988
Fontanille, Jacques, Soma & sema, Maisonneuve, 2004
Franceschetti, Massimo, “L’estesia e la comunicazione di Paolo Fabbri”, entretien paru dans le revue Parol n°15, décembre 1999, et consulté sur www.unibo.it
Guiraud, Pierre, Sémiologie de la sexualité, Payot, 1978
Makarius, Michel, « Un portrait sans visage » consulté sur le musée critique de la Sorbonne à l’adresse http://mucri.univ-paris1.fr/mucri10/article.php3?id_article=83
Marin, Louis, De la représentation, Seuil, 1993
Molinié, Georges, Hermès mutilé. Vers une herméneutique matérielle, Éditions Honoré Champion, Paris, 2005
Petitot, Jean, « Les nervures du marbre. Remarques sur le “socle dur de l’être“ chez Umberto Eco » introduction à l’ouvrage Au nom du sens. Autour de l'œuvre d'Umberto Eco, sous la direction de Paolo Fabbri et Jean Petitot, Grasset, 2000
Pezzini, Isabella, « L’imagination sémiotique et l’hypertexte. Du système sémantique global à Internet » in Au nom du sens. Autour de l'œuvre d'Umberto Eco, sous la direction de Paolo Fabbri et Jean Petitot, Grasset, 2000
Thély, Nicolas, Vu à la webcam – (essai sur la web intimité), Les presses du Réel, Paris, 2002
105
Veron, Éliséo, « Il est là, je le vois, il me parle », in Réseaux n°21, p. 73-95, décembre 1986
Veron, Éliséo, « Corps signifiant », in Sexualité et Pouvoir, Paris, Payot, 1978
> Pornographie / Sexualité
Anonyme, Les Blasons Anatomiques du Corps Féminin, Gallimard, 1982
Arcand, B, « L'avatar porno : L'Avatar » Ethnologie française vol. 28, no2, pp. 176-185, 1998
Attwood, Feona « Reading Porn: The Paradigm Shift in Pornography Research » Sexualities, Vol. 5, No. 1, p. 91à 105, 2002
Barcan, Ruth, « In the Raw : “home made“ porn and reality genres » Journal of Mundane Behavior, University of Western Sydney, 2002
Baudry, Patrick, La pornographie et ses images, Pocket, 1999
Borrillo, Daniel et Lochak, Danièle, La liberté sexuelle, PUF, 2005
Bozon, Michel, Sociologie de la sexualité, Nathan, 2002
Bozon, Michel, Dossier « Sexe : sous la révolution, les normes », Revue Mouvements n°2°, mars-avril 2002
Deleu, Xavier, Le consensus pornographique, Mango documents, 2002
Dworkin, Andrea, Pornography, Dutton, New York, 1989
Di Folco, Philippe, Dictionnaire de la pornographie, PUF, 2005
Fabre, Clarisse et Fassin, Eric, Liberté, egalité, sexualités, Actualité politique des questions sexuelles, chapitre 7 : Pornographie, Belfond, 2003
Freud, Sigmund, Trois essais sur la théorie sexuelle, Folio, Paris, 1989
Gould, Stephen, “The production, marketing and consumption of sexually explicit materials”, Journal of public policy & marketing 1992 vol 11 p.135 consulté sur http://ww2.svc.ctc.edu/dept/psychology/psych117/pornogra2.htm
Milon, Alain, et Marzano, Michela, La réalité virtuelle : Avec ou sans le corps ? Autrement, 2005
Molinié, Georges, De la pornographie, éditions Mix, Paris, 2006
Ogien, Ruwen, Penser la pornographie, PUF, 2003
Perniola, Mario, Le sex-appeal de l’inorganique, Leo Scheer, 2003
106
Picabia, Francis, Jésus Christ Rastaquouère, Paris, 1920, p. 7, édition fac-similée accessible sur le site de l'Université d'Iowa http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/ Jesus-Christ_rastaquouere/index.htm
Rotsler, William, Contemporary Erotic Cinema, New York, Penthouse Ballantine Books, 1973,
Stella, Renato, L' osceno di massa. Sociologia della comunicazione pornografica, Franco Angeli, 1991
Striana Productions, Documentaire L’Age d’Or du X Français, 2005
Schaefer, Eric, "Gauging a Revolution: 16mm Film and the Rise of the Pornographic Feature". Cinema Journal - 41, Number 3, University of Texas Press, 2002, pp. 3-26, accessible sur la base de données http://muse.jhu.edu/
Williams, Linda, Porn studies, Duke University Press, 2004
> Internet
Anderson, Chris, The Long Tail, Hyperion, New York, 2006
Beaudouin-Lafon, Michel « Ceci n'est pas un ordinateur : Perspectives sur l'Interaction Homme-Machine » in "Informatiques - enjeux, tendances, evolutions", sous la direction de René Jacquart. Technique et Science Informatique, n°19, janvier 2000
Castells, Manuel, La galaxie Internet, Fayard, éd 2002
Coates, Tom,” (Weblogs and) The Mass Amateurisation of (Nearly) Everything…” in Plasticbag.org, Septembre 2003, consulté sur www.plasticbag.org
Fourmentraux, Jean-Paul, Art et Internet, Les nouvelles figures de la création, CNRS éditions, 2005
Julia, Jean-Thierry et Lambert, Emmanuelle, Énonciation et Interactivité : du réactif au créatif, Communication et Langages n° 137, octobre 2003
Levine, Rick et alii, The Cluetrain Manifesto, Perseus Book , 2000, disponible sur http://www.cluetrain.com
Levy, Pierre, Qu’est ce que le virtuel ?, éditions de la Découverte, 1998
Martin, Alban, L’Age de peer, 2006, disponible sur http://alban.martin.googlepages.com
Rheingold, Howard, The Virtual Communities : Homesteading on the Electronic Frontier, MIT Press, 1993, disponible sur http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html
Semprini, Andrea, La société de flux, Formes du sens et identité dans les sociétés contemporaines, L’Harmattan, 2003
107
Shirky, Clay, “Weblogs and the Mass Amateurization of publishing”, consulté sur www.shirky.com
Stone, Allucqére Rosanne, « Le corps réel pourrait-il se lever ? » in Cyberspace : First Steps, sous la direction de Michael Benedikt, Cambridge, MIT Press, 1991, consulté sur http://www.rochester.edu/college/fs/publications/stonebody.html
Souchier Emmanuel, Jeanneret, Yves et alii, Lire, écrire, récrire, Objets, signes et pratiques des médias informatisés, Centre Pompidou-BPI, Paris, 2003.
> Sciences Humaines
Adorno, T.W.et Horkheimer, Max, La Dialectique de la Raison, Paris, Gallimard, 1974
Baudrillard, Jean, Pour une critique de l'économie du signe, Gallimard, Paris,1972
Baudrillard, Jean De la séduction, Galilée, 1979
Benjamin, Walter, Œuvres I et II, Gallimard, 2000
Boltanski, Luc, Les usages sociaux du corps in Annales. Économies, sociétés, civilisations, 26(1), 1971, p. 205-233
Bourdieu, Pierre, La distinction, critique sociale du jugement, Editions de Minuit, 1979
Bourdieu, Pierre, « Habitus, Code et Codification », Actes de la recherche en Sciences Sociales n°64, 1986, p.40-44
Brunn, Alain, L’Auteur, Flammarion, 2001
Certeau (de), Michel, L'invention du quotidien : Arts de faire, Paris, Gallimard,1990
Deleuze, Gilles, Pourparlers 1972-1990, Minuit, 1990
Duerr, Hans Peter, Nudité et Pudeur, Le mythe du processus de civilisation, Maison des sciences de l’homme, 1998
Felstiner, William et alii, The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming, in Law & Society Review, Vol. 15, No. ¾ 1981 consulté sur http://jstor.org.
Foucault, Michel, « Qu'est-ce qu'un auteur ? » in Dits et Écrits, tome I, Gallimard, 1994
Foucault, Michel, Histoire de la sexualité, Gallimard, 1984
García Canclini, Néstor, Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad, Grijalbo, México, 1989
108
Giddens, Anthony, The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies, Stanford University Press, 1993
Goody, Jack, La peur des représentations, Éditions La Découverte, 2006
Hall, Stuart, A identidade cultural pós-modernidade , DP&A editora, Rio de Janeiro, 1992
Hennion, Antoine et alii, Figures de l’amateur, Formes, objets, pratiques de l’amour de la musique aujourd’hui, La Documentation française, 2000
Maffesoli, Michel, Le Temps des tribus, Editions de la Table Ronde, 2000 (3éd)
Mauss, Marcel, Essai sur le don, 1924, consulté sur Les Classiques - UQAC : http://classiques.uqac.ca/classiques/
Mauss, Marcel, Les techniques du corps, 1934, consulté sur http://classiques.uqac.ca
Milgram, Stanley, The Individual in a Social World, Essays and Experiments, McGraw-Hill, 1992
Morin, Edgar, L'esprit du temps, Grasset, Paris, 1962
Morin, Edgar, Les stars, Seuil, Paris, 1972
Morin, Edgar, L’identité humaine, La méthode Tome V, Seuil, 2001
Morin, Edgar, en dialogue avec François Soulages, « 13° Dialogue, Réflexion, Création & Image » Maison Européenne de la Photographie, 13 février 2007.
Sirinelli, Jean-François, « La norme et la transgression, Remarques sur la notion de provocation en histoire culturelle » in Vingtième Siècle, Revue d’histoire, p.7-14, janvier-mars 2007
> Méthodologie
Bachmann, Christian et alii, Langage et communications sociales, chapitre 6, Paris, Didier
Borges, Jorge Luis, Historia Universal de la Infamia, Alianza Editorial, Madrid, 1974,
Ducrot, Oswald et Schaeffer Jean-Marie, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Éditions du Seuil, 1995
Maingueneau, Dominique, Approche de l’énonciation en linguistique française, Hachette, 1981
Unamuno (de), Miguel, Del sentimiento trágico de la vida, Folio, Barcelone, 2002
109
Vassallo de Lopes, Maria Immacolata, Pesquisa em comunicação, Edições Loyola, São Paulo, 2003
> Articles de presse Notre corpus presse repose sur une sélection d’articles ayant trait à deux sujets
principaux : d’une part le « web 2.0 » dans sa couverture médiatique et d’autre part
les retombées sur la pornographie en tant que mot clé employé dans le moteur de
recherche documentaire de la base de données d’Europresse.
Azoury, Philippe et Richard, Emmanuelle, « Ahhhh…, clic, hmmm ! » in Libération, 8 juillet 2006
Barron Jess, “When Sub-Pop meets Porn”, Wired News, June 26, 2002
Esposito, Roberto, « ‘Communauté’ ne signifie pas identité, mais altérité » in Le Monde, 19 décembre 2000
Hennette-Vauchez, Stéphanie, « Corps inaliénable » in Le Monde, 17 octobre 2006
Iacub, Marcela, « Sexe en location », in Le Monde, 17 octobre 2006
Pierrat, Emmanuel, « La volupté dans les flammes » in Le Figaro Littéraire, 2 septembre 2004
Martin, Marie Hélène, « La charité commence par le porno » in Libération, 26 juillet 2005
Rivoire, Annick, « Le bal des mutants », in Libération, 25 juin 2004
Seguret, Olivier, « Faux cul » in Libération, 9 octobre 2002
Seguret, Olivier, « ‘Le porno est libérateur’ » in Libération, 23 février 2005
Seguret, Olivier, « Sex is politics» in Libération, 29 mars 2006
Seguret, Olivier, « Ton ex à poil sur la Toile» in Libération, 10 juin 2006
Takeuchi Cullen, Lisa, “Sex in the Syllabus” in Time Magazine, 26 mars 2006
Timson Judith, « Pourquoi je veux être une femme objet » in Courrier International, 22 décembre 2005
Wallon, Gilles, « Chambres avec vue sur l’imaginaire » in Libération, 8 septembre 2004
Les Inrockuptibles numéro spécial Sexe, n° 577, août 2006
110
Les Inrockuptibles, Dossier spécial « Numérique : l’ère du partage », n° 599, 22-28 mai 2007
Time magazine, Dossier « Time’s person of the year : You » n° du 25 décembre 2006
> Revues scientifiques
Le choix de ces revues relève de leur publication de certains articles phares qui ont
servi d’inspiration dans le développement de nos analyses. Qu’ils portent sur
l’Internet, les pratiques culturelles ou le corps, leurs approches respectives sont
complémentaires : Médium nous a apporté une conscience médiologique sur le
temps long qui double assez bien les approches synchroniques et techno-
sémiotiques de Communication et Langages.
Revue Médium
Bougnoux, Daniel, « L’obscène, la scène et le secret », in Médium n°9, p. 66-75, Éd. Babylone, octobre-décembre 2006
Fourmentraux Jean-Paul, « Le Net art », in Medium n°6, Éd. Babylone, Paris, janvier-mars 2006
Hofstadter, Douglas, « Le médium cerveau est-il remplaçable ?» in Médium n°9,p. 3-23, Éd. Babylone ,octobre-décembre 2006
Sicard, Monique, « Corps transparent, esprit nouveau », in Médium n°9, p. 37-47, Éd. Babylone, octobre-décembre 2006
Soriano, Paul, « Les nouvelles hybrides », in Médium n°10, p.3-25, Éd. Babylone, janvier-mars 2007
Revue Réseaux
Jeanne-Perrier, Valérie, « Des outils d’écriture aux pouvoirs exorbitants ? » in Réseaux, volume 24 n° 137, « Autopublications », UMLV/Lavoisier, mai-juin 2006, p.99
Licoppe, Christian et Beaudoin, Valérie, « La construction électronique du social : les sites personnels, L’exemple de la musique », in Réseaux n°116, 2002
111
Revue Communication et Langages
Jeanne Perrier, Valérie, « L’écrit sous contrainte : les systèmes de management de contenu CMS » in Communication et Langages n° 146, décembre 2005
Communication et Langages n° 147, Internet, une optique du monde, mars 2006
Deseilligny, Oriane, « Journaux personnels en ligne : les marqueurs communicationnels » in Communication et Langages n° 150, décembre 2006
> Sites Internet
XPeeps : http://www.xpeeps.com
MySpace : http://www.myspace.com
O Reilly Media : http://radar.oreilly.com/
Alexa web search : http://www.alexa.com
Trésor de la Langue Française Informatisé : http://atilf.atilf.fr/
Bang Bus : http://www.bangbus.com
SuicideGirls : http://www.suicidegirls.com
112
SOMMAIRE DES ANNEXES
1. Schéma du cercle vertueux du « Web 2.0 »------------------------------------ p.114 2. Trois couvertures du magazine Time -------------------------------------------- p.115 3. Tableau de Marcel Duchamp --------------------------------------------------------- p.116
Étant donné : 1. La chute d’eau, 2. Le gaz d’éclairage 4. Interface d’inscription à Xpeeps
4A Register -------------------------------------------------------------------------------------- p.117 4B Espace de soi vs Espace d’Autrui ----------------------------------------------------- p.118 4C Informations personnelles --------------------------------------------------------------- p.119 4D Information basiques --------------------------------------------------------------------- p.120 4E Styles de vie -------------------------------------------------------------------------------- p.121
5. Présentation par questionnaire------------------------------------------------------ p.122 Questionnaire masculin / questionnaire féminin
6. Tableau de René Magritte--------------------------------------------------------------- p.123
La Représentation
7. Analyses : discipline du regard employé --------------------------------------- p.124 8. Post-face – notice explicative sur le CD------------------------------------------ p.132
113
ANNEXE 1 : Schéma du cercle vertueux du « Web 2.0 » Source : Tutoriat “Web «2.0 » Basics, Principes, Platforms for the enterprise” Gartner, Symposium IT Xpo Cannes, 2006. Synthèse disponible sur le site du cabinet www.gartner.com Ceci est une diapositive tirée de la présentation du cabinet de recherche en
technologies Gartner. Cette modélisation économique du « Web 2.0 » insiste sur le
fait que les plateformes web doivent incorporer un certain nombre de libertés liées au
« nouveau pouvoir des consommateurs » comme condition de succès. La forme
circulaire de ce schéma est censée représenter la réversibilité entre un
consommateur et un producteur qui profiteraient respectivement des contenus
proposés et d’une « intelligence distillée » due à la traçabilité des usages. Dans cette
perspective, le site web se doit de devenir transparent adoptant la forme minimale de
fournisseur ou distributeur selon qu’il s’agisse du consommateur ou du producteur.
Les lignes éditoriales s’affaiblissent au profit de l’autarcie des usagers qui gèrent une
dynamique de marché. Le site fournit l’infrastructure et garantit les libertés d’usage,
étude, copie et innovation pour augmenter les usages et les profits de façon
proportionnelle. Le succès de MySpace est dans cette perspective un cas
exemplaire.
114
ANNEXE 2 : Trois couvertures du magazine Time Ces trois numéros du magazine américain Time
peuvent illustrer l’évolution de l’imaginaire lié aux amateurs de pornographie. La première couverture nous renvoie à l’été 86 dans le cadre de l’offensive juridique relative à la censure du sexe menée par les lobbies conservateurs de l’ère Reagan. La deuxième Une correspond à un numéro de juin 1995. En pleine explosion Internet, le cyberporn est signalé comme danger public, au nom de la protection des enfants. L’étude sur laquelle se basait le magazine sera contestée mais laissera sur les amateurs une image très négative de la pornographie en ligne. Enfin, le numéro de fin d’année 2006 élit comme personne de l’année un vous adressé aux internautes. L’écran de la couverture est un miroir faisant ainsi un éloge collectif. La pornographie, elle-même étant traversée par les logiques participatives que Time exalte, a sans doute bénéficié de cette évolution positive de l’imaginaire des amateurs sur Internet. Time, du 21 juillet 1986, du 3 juin 1995 et du 22 décembre 2006
115
ANNEXE 3 : Tableau de Marcel Duchamp Étant donné : 1. La chute d’eau, 2. Le gaz d’éclairage, 1946-1966, Philadelphia Muséum of art
Voici les images du complexe dispositif fabriqué par Marcel Duchamp pour son œuvre ultime Étant donné. La réminiscence de l’imaginaire du peep show se traduit ici comme jeu intentionnel de l’artiste avec la curiosité du spectateur. Lorsque celui-ci s’approche et regarde par les trous desquels la porte est percée, il découvre l’image féminine nue ci-dessus représentée. Duchamp lui-même, dans son manuel posthume pour le montage de l’œuvre écrivait : « un spotlight 150 W doit tomber verticalt., exactt., sur le con. » La nature du motif, mais surtout l’implication demandée par le dispositif pour actualiser l’exposition rappellent ici le dispositif d’Xpeeps dans sa conception de la collaboration entre auteurs et amateurs.
116
ANNEXE 4-B : Espace de soi vs Espace d’autrui L’espace en vert correspond à l’espace de l’Auteur, et se constitue des informations recueillies par l’acheminement architextuel lors de la création de son profil. L’espace en rouge correspond quant à lui à l’Amateur qui laisse des commentaires. Les deux auteurs collaborent du fait de l’interopérabilité des applications d’autopublication propre à cette forme du web. Ceci est un profil type montrant la collaboration sur un plan énonciatif et éditorial.
118
ANNEXE 5 : Présentation par questionnaire
Questionnaire masculin Questionnaire féminin Voici deux exemples de productions d’une figure auctoriale par le moyen des questionnaires. Cette méthode est très utilisée par les auteurs dans le but de donner un aperçu rapide de leur identité sexuelle. Elles sont de ce fait le complément des informations recueillies par le CMS au cours des écrans qui ont précédé.
122
ANNEXE 5 : TABLEAU DE RENÉ MAGRITTE La Représentation, 1937, National Gallery of Scotland, Edimbourg
Ce tableau peint par René Magritte en 1937 était à l’origine une toile rectangulaire
jusqu’à ce que le peintre décida de la découper pour lui faire confectionner un cadre
sur mesure. C’est alors que son titre lui vint à l’esprit : La Représentation. Dans cette
opération de découpage et détourage, nous voyons naître l’archétype de la
suppression de la circonstance, neutralisant la part parasite ou résiduelle
responsable d’un effet de réel ou d’obscénité au profit d’une représentation du corps
dénoncée comme telle.
123
124
ANNEXE 7: Analyses : discipline du regard employé
En complément de l’analyse techno-sémiotique menée sur l’ensemble du dispositif,
nous avons systématisé notre regard sur les productions auctoriales en distinguant
deux espaces différents, à savoir le profil et la galerie. En tant qu’assemblages de
matières expressives différentes, nous avons expérimenté pour le texte et pour
l’iconique des méthodes adaptées. Pour la question du pseudonymat, nous avons
fait une étude lexicographique de façon à voir comment chaque nom est composé, et
à quel imaginaire il renvoie. Les textes de présentation à leur tour ont été
décomposés en narratèmes pour voir les thèmes principaux émerger. Les
commentaires des amateurs ont été classés par type d’énonciation en 4 catégories :
personnalisés quand ils s’adressent à l’Auteur comme entité, réifiés quand ils ne
concernent qu’un organe en particulier, désidératifs quand l’Amateur exprime son
désir de partager la scène, et génériques lorsqu’ils ont des formes simples, mono-
adjectivées. Du côté de la galerie, notre analyse de l’iconique a étudié la composition
globale de la galerie, en distinguant les portraits des blasons, et en signalant à
chaque fois le motif représenté. De même, nous avons étudié la question de la
circonstance comme part irréductible de l’environnement auctorial provoquant un
effet de réel. Enfin, nous avons procédé à des remarques particulières sur
l’articulation des différentes colonnes d’analyse pour déboucher sur un rattachement
de chaque Auteur-Amateur à une des trois hypothèses envisagées. Ces analyses
constituent la substance de notre seconde partie et ont inspiré, par leur relief, le
distancement de cette discipline du regard à l’œuvre dans notre troisième partie. Les
auteurs-amateurs sont classés alphabétiquement, et leurs numéros d’enregistrement
correspondent à ceux du fichier du CD annexe.
N° Pseudonymes Construction du pseudonyme
(lexèmes)
Textes de présentation (narratèmes)
Iconique Type d’ énonciation - comments
Circonstance Remarques particulières
Appartenance hypothétique
1 Brat Brat dénote l’idée d’enfant gâté
État civil : célibataire après divorce. Intensité sexuelle. Attend un homme sexy.
Deux blasons vaginaux, un portait buste nu axe YY, photo de fellation.
Invitations des amateurs dans la scène : « I got next », « May I have a taste »
Ongles peints, piercing clitoridien, tatouage discret, draps rouges en satin, narines dilatées, bord noir parasite
La photo de fellation est celle de son avatar.
H2 atténuée par un autoportrait.
2 Britman Brit : origine géographique britannique Man : genre sexué
Age, taille, taille sexuelle, apparence, récemment séparé et ayant déménagé, absence de vie sociale et appel à l’amitié
5 blasons phalliques, un autoportrait décapité, un faux blason avec PC, un magazine recouvert de sperme
Commentaires réifiés impersonnels : « nice cock », « yummy»
Carrelage, veinosité, bureau en désordre, écran d’ordinateur, texture du papier.
Il se propose pour éjaculer sur des photos.
H2
3 Bruce Nom propre Age, tempérament, nom, sexe, état civil,
4 portraits habillés où l’on voit son visage, en situation estivale avec cigarette, copine et bière. 3 blasons phalliques dont un éjaculant. 2 photos de sa copine au bain et la sortie du bain
Onomatopées gustatives pour les blasons, Jugements de type « Nice couple », « Luv the relaxed look » pour les portraits, commentaire sur la bière
Jardin estival, serviette Mickey, produit d’hygiène, poste de radio, bières, plantes vertes, bureau en désordre, planisphère, bonnet de Noël, fautes d’orthographe
Ville : Eindhoven, Incite aux commentaires par des questions posées aux amateurs.
H1 avec variétés de cadre de vie.
4 Bubba 258 Surnom + quantième
Père de 2 enfants, profession : serrurier, ouverture aux autres.
6 blasons phalliques issus d’une même séquence, 3 portaits dont deux avec chapeau.
Invitations volontaristes pour les blasons : « looks like you need ME to help you out » Commentaires réifiés de type « nice cock » Pour les portraits, jugements sexys sur le look de cowboy
Livres empilés, contre-jour, grain de basse résolution,
En écho à son chapeau, le sous-titre de son profil est «la vie est dure, mettez un casque » NdT
H1 avec saillance d’attributs comme moustache et chapeau.
5 Carlito Nom propre avec diminutif hispanique
Disponibilité sur d’autres sites (MSN, MySpace), tempérament, origine géographique (Rochelais exilé à Bordeaux), profession : étudiant en philosophie, métadiscours sur ses pseudonymes
12 portraits habillés dont 4 torse nu. En pose classique d’athlète avec un ballon, 1 blason phallique. Location : appartement, plage, parc.
Commentaires ironiques « you need a penis picture », « oh la la » Commentaires en français fautifs
Photo sur le mur, boite de thé, poupée, mur tagué, voiture immatriculée, yeux rouges
Inspiration d’athlètes helléniques pour les poses, métadiscours sur ses photos (jeunesse, ivresse)
H1 Large dispersion temporelle, renvoi d’images françaises
6 Cassandra Loves XPeeps
Nom + relation au dispositif
Végétarienne, amatrice de l’horreur et du rock n’roll, Étudiante en physique et ingénierie du son
17 portraits en intérieur portant des vêtements stylisés dans des poses de pinup, dont 3 de qualité professionnelle.
Enonciation personnalisée« You are hot », « you look incredible »
Tatouages, Tshirt AC/ DC, chien, mannequin, grain flouté
Certaine des photos sont des autoportraits, les poses reprennent des standards de
H3 tatouages, boucles, maquillage en affinité avec un large inventaire
125
pinups marilyniens. Remarques auto dérisoires : « narcissistic and so shallow »
musical.
7 Coyote Animal (connotation sauvage du désert)
Tempérament. Aimerait rencontrer des femmes
1 seul portrait habillé, éloigné dans la nature
15 visualisations et aucun commentaire
Paysage irrégulier Californie H1
8 Doberman Chien germanique Taille, poids, physique, hobbies
2 photos : un portrait et un blason masturbatoire en plongée.
Phrase desiderative : « I’d love to ride your cock »
Montre, draps, sueur. H1
9 Ebon Terra Pseudonyme composé rappelant un nom de star porno
Référence à son blog pour plus d’information : dans son blog, un questionnaire et un récapitulatif des questions qu’on lui a posées.
2 galeries complexes. la première contient des portraits topless ou sans culotte nus de corps entiers, ainsi que des photos de ces mêmes portraits imprimés en version papier sur lesquels des amateurs ont éjaculé (online facial). Enfin, des mosaïques de photos que l’Auteur aime sur Xpeeps.
Jugements de valeur : « beautiful », « I like », jugements réifiés : « sweet shaved cunt », « sexy legs », « Nice breast » Phrases désidératives « I’d love to fuck you » D’autres amateurs se proposent par la suite pour éjaculer sur ses photos : « Moi aussi si tu me le demandes, j’espère que j’aurai assez d’encre » NdT.
Vêtements sur le sol, matelas sans draps par terre, texture du papier modifiée.
Son avatar inusuel représente une photo d’elle-même avec une bulle de pensée dans laquelle on voit un cunnilingus. L’Auteur commente (innocent thoughts). Les amateurs trouvent créatif.
Entre H2 et H3 : accent anatomique, mais construction d’un personnage sexuel.
10 Figment Dragon , nom d’une mascotte de Disney
Tempérament, background (ancienne gymnaste et nageuse)
8 autoportraits dont trois à l’aide du miroir. Seul un axe YY ( « those big brown eyes, they hypnotize ») habillée, sur le reste des photos : chambre en maillot de bain, salle de bains en nudité.
Personnalisés : « you’re just too cute », « you really look like a godess ». Sur la matérialité “what a fantastic pic…gotta love those self-taken bathroom pics”
Tatouage, pendentif en émeraude, nounours par terre, ongles peints, vêtements entassés, serviettes de bain (une commentaire : « Nice towels »)
Brisbane, Australia. Exclusivement composé d’autoportraits.
H1
11 FoxyBrown Sugga
Foxy : dérivé de renard, maligne. BrownSugga : allusion raciale métaphorique et orthographique (sucre brun)
Orientation, et habitudes sexuelles, mensurations, fantaisies sexuelles, auto-évalution
4 blasons : 2 coupés à hauteur des seins, dont un masturbatoire, 2 coupés à hauteur de bouche, avec titre « I love chocolate » et « open for business »
Commentaires réifiés : adressés à « that pussy », désidératifs « I wish I could », onomatopées gustatives par rapport à l’allusion au sucre et au chocolat
Grain de l’image très pixellisé.
Fantaisie du sexe interracial « want big ethnic orgy »
H2
12 Freeman7 Nom + quantième Aucune information sauf âge (21 ans) et sexe (M).
Une seule photo, la même que l’avatar du profil, portrait de l’auteur, en compagnie de deux demoiselles souriantes et habillées.
Aucun commentaire sur sa photo. Sur son profil, quelqu’un se vante d’avoir été le premier à le commenter.
Tee shirt Abercrombie, au fond, un passant anonyme.
Bien que ne fournissant presque aucune données, l’Auteur mène une vie active sur le site, avec 75 amis.
H1
13 Gas Panic GasPanic est le nom d’un club
Une bannière qui renvoie à son blog, et
4 photos : 2 portraits, dont un portant la mention « à
Jugements impersonnels :
Décoration japonisante,
Sur son profil, quelques
H1
126
tokyoïte une publicité de la société AEBN pour laquelle elle travaille comme sales executive pour le Japon (Il nous fait ici rappeler que AEBN est aussi la maison-mère d’Xpeeps)
peine réveillée » NdT. Une photo de sa moto et un tatouage.
« gorgeous face », « so cool »
aquarium, photos surexposées.
commentaires rappellent l’époque des images érotiques codées en caractères textuels (Ascii)
14 Horny Mama Adjectif d’excitation sexuel + appellation de femme familière.
Expectative de rencontre, exigence d’amitié, recours à un questionnaire pour compléter sa présentation
2 galeries exclusivement consacrées à des blasons anatomiques de toutes les zones érogènes. Sur l’une, on entre aperçoit le début du visage de l’Auteur.
Commentaires réifiés qualifiant la zone représentée et phrases désidératives « I’d eat that like it is my job »
Accessoires sexuels, draps froissés, pigmentation corporelle, luminosité irrégulière
Toutes les photos reçoivent au minimum 10 commentaires prouvant l’efficacité des blasons anatomiques accompagnés d’une phrase d’injonction sexuelle du type « anyone like ».
H2
15 H-Town Hung H-Town : origine géographique (Houston). Hung : accroché
Peu d’informations. Renvois sur des sites pour adultes.
7 blasons phalliques. Trois commentaires d’une même amatrice insinuant des pratiques diverses.
Jus d’orange, bouteille d’eau, braguette du jean, rayon de soleil, fils électriques.
H2
16 HughMan Prénom + genre État civil, centres d’intérêt, Science fiction, l’Auteur se définit comme geek, forme paroxystique de nerd
8 images, dont une seule est susceptible d’être une production sienne. Il s’agit d’un blason phallique blasphématoire accompagné d’une statuette christique. Pour le reste, il s’agit d’imageries utilisées comme humour sur les profils.
Le seul commentaire rendrait à son vrai auteur une des images : « un de mes amis, Bonnie Heath a pris cette photo » NdT
Les imageries brillent par l’absence de circonstance. Par ailleurs, la statuette par laquelle se compare en taille le membre photographié.
Les imageries représentées sont massivement utilisées : il s’agit de détournement sexuels de panneaux signalétiques, ou de personnages fictifs (Kermit, Spiderman)
Le profil serait à priori H1 par le ton de proximité, mais il n’y a presque aucune production auctoriale.
17 Irony Is A Dead Scene
Il s’agit du nom d’un disque d’un groupe de rock américain : littéralement “L’ironie est une scène morte”.
Références musicales in extenso, cinématographiques, marques de voiture et guitare. Dit vouloir une moustache comme celle du personnage TV Earl Hickey.
3 autoportraits de l’Auteur dont 2 devant son ordinateur et 1 blason phallique avec tentative d’éradication de la circonstance (détourage).
Un seul commentaire : « Boys with glasses are so hot »
Bois contreplaqué, moustache en train de pousser, flou délibéré. Pour le blason faisant l’objet de détourage, la circonstance a été presque éradiquée : un ongle sale demeure.
En affinité avec son souhait, l’Auteur affiche une moustache en train de pousser
H3
18 Jazzman Jazz : musique noire + genre
Préférences sexuelles féminines
23 blasons phalliques + une photo de fesses
Commentaires réifiés : « Lovely looking dick »
Chambre, vêtements, tableau de bord d’une
Effet d’obscène par prégnance de
H2
127
voiture, papier essuie-tout
circonstance et distance trop rapprochée.
19 Jennasaurusrex Détournement du dinosaure tyrannosaurus rex avec le prénom Jenny
Aucune présentation textuelle, Age (20)
8 autoportraits légèrement habillés dont 3 images retravaillées par modification du teint et superposition de textes, et d’autres éléments graphiques.
Commentaires personnalisés : « you’re perfect » ou observation des lunettes ou du piercing.
Chambre, bijoux en forme de cœur, sac à dos avec drapeau mexicain et américain.
La typographie choisie pour les textes s’inspire de pochettes de disques mainstream récents.
H3
20 KinkyKing Kinky est un adjectif pour pervers, King pour roi.
Intérêts sexuels, tempérament
7 blasons phalliques sont un au fomat gif animé en train d’éjaculer. 4 photos d’amatrices portant sur leurs seins des feuilles de papier saluant l’Auteur de façon manuscrite.
Commentaires réifiés : « Nice cock », insinuations : « Is that for me ? ». Pour le gif animé, expression de surprise : « fantastic pic », « hottest pic award »
Bas à linge sale, radiateur, chaussettes, câbles, moquette, calligraphies sur le papier.
Le gif animé, par son caractère inusuel cumule presque 4000 visualisations.
H2
21 Kitten Kitten traduit chaton Age (22), préférences sexuelles (travestissement) , espère rencontrer un « sugar daddy » qui le maintiendra.
2 pages de galeries combinant 9 autoportraits, 12 blasons anaux, et 5 photos de portraits décapités.
Pour les blasons, commentaires réifiés, pour les portraits, commentaires personnalisés de type « what a pretty girl you are »
TV, stores, bijoux, affiche de Trainspotting entre autres films, bouteille de Coca-Cola à moitié vide.
Pour signifier son statut de crossdresser, l’Auteur joue avec la combinaison de son sexe masculin avec de la lingerie féminine ou un godemiché.
H3. Malgré la récurrence des blasons, l’accent est mis sur la construction d’un travesti sophistiqué.
22 Kokoro Nom japonais d’un célèbre roman
Nom, présentation de son entreprise, ouverture aux autres
4 pages de galeries dominées par la présence de portraits de nudité, au bain, ou dans un décor préparé. Quelques blasons coexistent sur lesquels l’Auteur superposé des caractères manuscrits en japonais.
Compliments personnalisés : « You are so sexy Kokoro », désidératifs : “I’d love to join you”. Sur les blasons, commentaire sur la prise de vue, et tentative de décrypter le japonais
Mobilier japonais, draps fleuris, serviette de Hello Kitty,
L’Auteur est propriétaire d’une compagnie de Hentai, c'est-à-dire une variété de mangas érotiques.
H3
23 LadyHarley Lady en référence à son sexe, Harley pour la marque de motocyclettes.
Age, Apparence physique, Hobbies (pornographie, motos, musique) ambitions pornographiques, Ouverture aux autres
5 portraits de corps entiers, avec des habits différents, dont deux « buste nu ».
Jugements impersonnels : « very sexy », « looking hot »
Tigre blanc en peluche, sac d’achats, souris et mousepad.
L’Auteur se revendique pornographe amateur.
H1
24 LoverOfCocks69 Littéralement, amatrice de vits + quantième sexuellement connoté.
Prénom, Age, Apparence physique, tempérament, préférence masculine, pratiques préférées.
Trois portraits : un en lingerie, un avec casquette, et un en tenue de sport.
Commentaires sur son corps « beautiful body » ou sur la lingerie « I like your lingerie ». Insinuations orales en réponse à sa question
Ketchup, gant de cuisine, savon.
Les trois poses sont codées : la posture de pinup, puis les lèvres arrondues, ou les doigts près de la
H1
128
« Like my lips ? » bouche. 25 Maggie Diminutif de
Margaret Revendication de son obésité, age, profession (travaille dans la banque), physique, hobbies, tempérament, volonté de se tatouer et de se percer + questionnaire pour compléter sa présentation
10 autoportraits dans sa chambre, salle de bains et voiture dont deux torse nu. Axe YY sur 9 des 10 photos.
Commentaires réifiés sur la taille de ses seins ou personnalisés « Very beautiful Maggie »
Bibelots, serviette de toilette, téléphone portable
H1
26 Marie Prénom virginal Age, hobbies, ouverture aux autres, expectative sociale
15 photos dont 5 blasons. Pour le reste, portraits de nus dans sa chambre. Axe YY soutenu. Sur son profil, en outre, elle publie d’autres photos hébergées sur d’autres sites.
Commentaires projectifs : « let me do that for you » ou personnalisés « you’re absolutely perfect »
Affiches sur le mur de rappers, sac plastique, peluche abandonnée, sac à dos
L’Auteur contractualise son rapport aux amateurs en explicitant une règle : pas de photos = pas d’ajout.
H2 avec tendance H1. Sans pratiquer le morcellement, sa politique contractuelle est davantage orientée vers une exigence sociale.
27 Miss Bunny Miss en référence à son sexe, Bunny pour lapine.
Absence de texte, présentation d’une manière publicitaire.
6 portraits habillés, en studio, posture pinup, avec influence d’alternative porn
Jugements génériques : « very sexy » ou méta esthétiques : « I love the pinup girl look »
Studio Il d’agit d’une pinup professionnelle qui a son propre site, ayant troqué les peeps pour les amis comme espace d’existence
Non pertinent
28 Miss Rabbit Miss en référence à son sexe, Rabbit pour lapin
Origine géographique, tempérament, lieux fréquentés, hobbies.
14 autoportraits dont 11 avec axe YY, 3 en noir et blanc, et un décapité.
Commentaires personnalisés ; « You’re so pretty »
Cheveux mouillés, verre plastique, draps froissés, carrelage de salle de bains.
Titres révélateurs : « Me being a poser», « Moi », « Trying to look seductive …cut my head off »
H1
29 Naughty Auttie Naughty comme espiègle, + diminutif Auttie
État civil, tempérament, hobbies + questionnaire qui complète la présentation
Galerie hybride où cohabitent 4 blasons (deux génitaux, 2 des pieds), plusieurs portraits torse nu, des imageries automatiquement générées, importées d’Internet comportant le nom de l’Auteur.
Formes désidératives : (I’d liketo get on top », formes réifiées : « very sexy feet »
Draps froissés, magazine entassés, ongles peints, moquette, grain pixélisé.
L’Auteur utilise beaucoup de graphiques pour personnaliser son profil
H2
30 Nccraz911 Probablement North Carolina Crazy + numéro violence.
Aucune information 4 autoportraits dont 3 axe YY, et un torse en lingerie.
Réactifs à son geste, « I can show you a surprise », ou réifiant : « hot body »
Salle de bains, téléphone Motorola, cahier, bague, étiquette du soutien
H1
129
gorge 31 Nytehawk Littéralement,
faucon de nuit. Rappelle un nom de code de la force aérienne
Tempérament, contacts sur Yahoo
6 photos, dont 3 blasons phalliques, 2 autoportraits nus, et une photo principale de l’Auteur en uniforme camouflé devant son bureau.
Commentaires sur l’uniforme : « I love man in uniform », formes réifiées : « gorgeous balls »
Bureautique, montre, métallique, vêtements par terre, camouflés
Renvois sémiotiques entre profession USAF, style capillaire et vestimentaire militaire.
H1
32 Picman Probablement pour Pictureman
État civil, profession (photographe pornographe)
11 photos en compagnie de femmes torse nu, sur lesquelles l’Auteur a superposé les prénoms de chacune d’elles, avec un effet d’encadré.
Une forme désidérative : « damm, why wasn’t I invited ? »
Ballon de baudruche, chaînes. Par ailleurs, le travail d’édition de l’Auteur a tenté de supprimer la circonstance.
L’homme, à l’image d’un Don Juan, construit un personnage parodique du milieu du porno
H3
33 Pulbaas Fait peut-être référence à un site porno homonyme
Message cryptique en français : « épicier en cachet », Ville : Lyon encrypté en latin sous la forme Lugdunum.
8 photos et une caricature. Les photos montrent l’Auteur dans des situations sociales avec amis. Il y a même une photo de son père. Pas de nudité.
Pas de commentaires Prise électrique, bouteille d’eau, housse de skis, boite Téfal.
L’Auteur transforme sa galerie en album familier.
H1
34 Rape Victim #13 Victime du viol + quantième obscur
Intérêts sexuels, nom, tempérament, ancrage géographique, zodiaque, politique contractuelle (préfère photo de visage que de membre)
Sur 3 pages de galeries, combinaison d’images intégrant autoportraits, blasons, et images travaillées sur Photoshop. Très souvent, le contraste est altéré pour dénaturer l’image. L’Auteur fait allusion à la pop des années 90 ainsi qu’à ses tentatives ratées d’être une gothique chinoise.
Commentaires sur la photo : « great pic », réifiés pour les blasons avec adjectifs, « nice and smooth »
Bijoux en têtes de morts, pinces à linges, coupures, affiches musicales, tournevis.
Exploite largement la rubrique Intérêts avec des références culturelles précises et personnalise son profil avec des couleurs sombres
H3
35 Sarah86 Prénom + probable date de naissance
Nom, orientation sexuelle (transsexuelle)
6 portraits de corps entiers+ un blason postérieur.
Commentaires désidératifs : « I’d love to join you, tell me how »
Circonstances atténuées par Photoshop, via constraste et recadrage
La transsexualité est représentée par l’ostentation du membre en même temps de celle des seins, et une fois de plus est accentuée par l’usage de lingerie
H2, en tant que minorité sexuelle
36 SexyinTexas Adjectif + ancrage géographique
État civil + position contractuelle : « only girls », et « No pics, no add »
2 pages de photos consacrées essentiellement à des blasons anatomiques.
Commentaires désidératifs : «I wish I was me » et réifiés : « beautiful suckable nipple »
Grains de beauté, ongles, piercing au nombril.
Lorsque le visage de l’Auteur apparaît, il est caché en cadrant la zone en négatif.
H2
37 SissyAmber Sissy est souvent utilisé pour décrier
Age, orientation sexuelle (transsexuelle),
Deux pages de galeries, dont la plupart des photos
Commentaires personnalisés : « You’re
Draps froissés, cheveux mal colorés
Ici, paradoxalement,
H2 en tant que minorité sexuelle
130
131
l’efféminé. Amber, pour l’ambre.
pratiques sexuelles dans le détail + questionnaire pour compléter sa présentation
sont axe YY. 1 blason anal one, hottie »,et désidératifs « I wanna be your other Daddy
l’axe YY produit un effet d’obscénité en assumant la présence du sperme avec le regard fixe
38 Six String Fait peut être référence à l’univers de la guitare.
Tempérament, physique, profession (aspirant écrivain ou photographe),
10 photos : 6 autoportraits et 4 blasons phalliques
Commentaires réifiés : « pretty cock »
feuille de paie, tickets de caisse, bibliothèque, réveil, veinosité.
L’Auteur présente par ailleurs des goûts musicaux élaborés.
H1
39 Squirts Littéralement, décharge, comme dans le cas d’une femme fontaine.
Justification de sa présence sur le site, conception de l’exposition comme art et non pas comme pornographie.
8 autoportraits dans une esthétique pinup. Regard millimétré.
Commentaires génériques « simply amazing », ou décryptant l’intention auctoriale ; « old school pinup »
L’Auteur neutralise la circonstance en posant sur un mur blanc, ou en retravaillant ses images sur Photoshop.
Nous remarquerons l’usage du noir et blanc, la pratique de détourage et la personnalisation du profil avec un fond léopard.
H3
40 Subzero1 Fait allusion au froid : en dessous de 0°
Pas d’informations 9 photos, 4 autoportraits habillés avec axe YY, 4 blasons de pratiques pénétratives.
Commentaires personnalisés : « you look sooo sexy », et propositive « can I be next ? »
Casquette californienne, tatouages, date imprimée sur les photos, faux ongles.
H1 malgré son manque d’informations
41 Sugarpie Littéralement, Tarte au sucre
Pas d’informations 14 blasons dont 13 vaginaux.
Commentaires réifiés et désidératifs « It looks delicious, I’d love to have a taste »
Draps et vêtements froissés
Effondrement de la scène symbolique par matraquage du blason.
H2
42 TattooJonny Tatouage + prénom Se définit comme un singe tatoué
1 seule photo de l’Auteur portant des tatouages.
Nombreux commentaires sur les tatouages « super sexy ink »
Aisselles, fond, très pixélisé.
L’image porte la mention d’une adresse. Peut-être a-t-elle été téléchargée ?
H3
43 Tiffani Allegri Prénom + Nom rappelant un nom de porn star
Comportement sexuel, tempérament, centres d’intér
8 photos : 5 plans larges en solitaire, 3 avec son partenaire.
Onomatopées, et jugement générique : « so hot !»
Valise, collants serrés, marques de bronzage
Sur sa photo principale, l’Auteur inscrit la mention Shemale pour affirmer sa transsexualité.
H2
44 Trixie Diminutif de Beatrix Age, tempérament, ouverture aux autres.
5 autoportraits, et un blason de fellation.
Jugement sur le look : « Very sexy look », Sur le portrait également visible comme avatar « Great pic »
Interrupteur, chevet de lit en bois, mousse de savon, ongles peints
Pose sensuelle codifiée : l’index dans la bouche.
H1
45 Vipre 711 Peut être une variante de Viper, vipère + quantième
Pas d’informations Une seule photo : blason phallique en contreplongée
Commentaire réifié : « Nice cock »
Bordure de la fenêtre, ombre projetée
H2
Annexe 8 : Postface : notice explicative sur le CD
Ci-joint, vous trouverez un seul CD contenant un seul dossier. Son visionnage n’est
pas indispensable à la compréhension du sujet développé. Ce disque contient 99
captures d’écran correspondant aux profils et galeries des auteurs prélevés sur les
pages d’Xpeeps.com de façon à constituer notre corpus. Il s’agit de productions
personnelles qui demandent une sensibilité esthétique et juridique qui est dans
certains cas mise à l’épreuve.
Dès lors, ici nous ne les présentons qu’à titre illustratif. Dans le but de ne pas
orienter l’esthésie d’un lecteur que nous jugeons « averti », nous avons opté pour
une organisation systématique et alphanumérique. Ainsi, les numéros de 1 à 45
correspondent chacun à un auteur différent ; la lettre P ou G indique s’il s’agit de son
profil ou de sa galerie. L’ensemble des fichiers a été encodé au format MHT qui
s’ouvre sur n’importe quel navigateur en conservant les liens de la capture, au cas
où le lecteur voudrait prolonger son parcours hypertextuel. Le dossier Légende
contient un tableau Excel répertoriant les équivalences de notre nomenclature avec
le nom de l’Auteur et l’adresse de son profil Internet. Ainsi, ce CD n’est pas clos,
mais il n’est pas non plus ouvert. Il est destiné à un usage académique ponctuel.
132
RESUMÉ
Ce mémoire interroge le statut de l’Auteur sur le web collaboratif, à partir de
l’exemple du site de social networking Xpeeps.com. Effectuant une contextualisation
historique de l’évolution du travail auctorial sur Internet, ce travail voit émerger la
figure réversible de l’Auteur-Amateur comme modèle de participation proposé par les
dispositifs appliquant les préceptes du « Web 2.0 ». L’exposition de soi au centre des
constructions iconiques et textuelles de ces Auteurs-Amateurs donne pied à une
analyse des différentes manières de se produire à l’écran à titre individuel. La
question de l’obscénité fait partie de la réflexion par la proximité des productions
observées avec celles d’un imaginaire pornographique qui est parallèlement analysé.
Une ouverture critique met en tension la figure de l’Auteur-Amateur avec l’économie
du signe et les procédures de construction identitaire en place sur ces sites web.
133