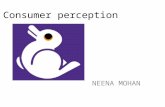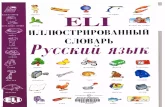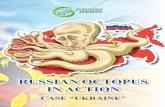Russian-French and French-Russian Christian Church vocabulary of 1600 words
Bosnian War, Russian Perception
Transcript of Bosnian War, Russian Perception
- 1 -
Université Paris-IV Sorbonne
Mémoire de recherche Master 2
UFR d’Histoire
Session de Septembre 2012
Perception Russe de
Figure 1 : photo prise le 15 octobre 1991, à gauche Slobodan Milosevic et à droiteBoris Eltsine
Author : CBS News StaffCredit : AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 2 -
La Guerre De Bosnie
Aspects Militaires, Diplomatiques et leRôle de l’Opinion Publique
Université Paris-IV Sorbonne
Mémoire de master 2
UFR d’Histoire
Session de Septembre 2012
Perception Russe de
la Guerre De Bosnie
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 3 -
Aspects Militaires, Diplomatiques et
le Rôle de l’Opinion Publique
Clément Scherer – Juin 2012Sous la direction de M. Olivier Forcade
Clément Scherer 2 Bis rue Winston Churchill 91300 Massy [email protected]
Remerciements
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 4 -
Je tiens à remercier tout d’abord mon directeur de recherche, Monsieur Olivier Forcade, pour le soutien apporté à ma rechercheEn second lieu, mes pensées vont à mes professeurs derusse de l’INALCO pour leur gentillesse et pour leur aide.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 5 -
Entre déterminisme civilisationnel et anarchiecaractérielle, quelle politique russe enBosnie ?
1. Introduction……………………………………………………………………………5
Première Partie : La recomposition de l’appareil
diplomatique russe, quelle politique et quels
acteurs ?...................................................
............................................................
......10
I. Evolution des intérêts russes dans les Balkans, une
histoire de « civilisation » ?...........10
II. La recomposition de l’appareil diplomatique russe après
la guerre froide……………22
Deuxième Partie : La presse et l’opinion publique, une
perception déformée ?..............37
I. La formation d’une opinion publique russe, entre
désintérêt et crispations…………....37
II. De « l’homme de la rue », à Vladimir Jirinovski
jusqu’aux mercenaires……………..51
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 6 -
Troisième Partie : Les relations russo-américaines pendant
la guerre de Bosnie, l’association sans
l’intégration…………………………………………………………...60
I. La Russie conciliante…………………………………………………………………..60
II. La collaboration militaire américano-
russe…………………………………………...74
1. Conclusion……………………………………………………………………………84
Liste des abréviations
CEE : Communauté économique européenne.
CEI : Communauté des Etats Indépendants.
CFE : Traité sur les forces conventionnelles en Europe.
CSCE : Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.
FORPRONU : Force de Protection des Nations Unies.
IFOR : Implementation Force.
JNA : Armée populaire yougoslave.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 7 -
KPRF : Parti communiste de la Fédération de Russie.
LDPR : Parti libéral démocrate de Russie.
ONU : Organisation des Nations Unies.
OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
PRES : Parti de l’unité et de l’accord russe.
RFY : République fédérale de Yougoslavie.
RSK : Armée de la Krajina.
SFOR : Stabilization Force.
URSS : Union des Républiques soviétiques socialistes.
VSR : Armée de la République Sprska.
Introduction
1.1 Etat du débat historiographique.
L’histoire des relations entre la Russie et les Balkans
est l’histoire asymétrique de la Russie Impériale, dont les
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 8 -
désirs d’expansion vers la mer Egée au XIXe siècle se heurtent
à « l’homme malade de l’Europe », l’Empire Ottoman, ainsi
nommé par le prince Alexandre Gorchakov, chancelier du tsar
Alexandre II et les pays qui composent les Balkans. Si cette
étude n’a pas pour vocation de dresser l’histoire complète des
relations entre la Russie et les Etats balkaniques, certains
événements méritent d’être rappelés, non que leur évocation
soit une explication intangible des relations internationales
à la fin du XXe siècle mais plutôt, à l’inverse, pour se
prémunir d’interprétations abusives de l’Histoire qui
conduisirent certains théoriciens, à défaut d’être historiens,
à exacerber les liens d’amitié entre la Serbie et la Russie, à
exagérer la solidarité orthodoxe, lui faisant porter le lourd
fardeau de « Choc des civilisations ». Le plus célèbre d’entre
eux est Samuel Huntington. La Bosnie en est pour lui le cas
exemplaire. Pour Samuel Huntington, la fin de la guerre froide
n’annonce pas à l’inverse de Fukuyama, « une fin de
l’Histoire1 » mais l’avènement des guerres de civilisations2.
Ainsi il écrit que « la rivalité entre grandes puissances est remplacée par le
choc des civilisations 3» et « les conflits culturels les plus dangereux sont ceux qui
ont lieu aux lignes de partage des civilisations 4». La Bosnie, de fait selon
Huntington, se dresse comme la ligne de partage entre mondes
orthodoxe, chrétien et musulman. Son embrasement, inéluctable,
est bien la preuve qu’il existe des civilisations. Pour que le
paradigme soit entièrement clos et indéfectible, il faut que
1 Francis Fukuyama, La fin de l’Histoire et le dernier Homme, Flammarion, 14 septembre1993, 448p.2 Samuel Huntington, Le choc des civilisations, Odile Jacob, 1996, 545p. 3 Ibid, 23. 4 Ibid, 23.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 9 -
s’exerce une solidarité entre Etats de même religion, de même
culture, bref que les Etats partageant une même civilisation
ne se désolidarisent pas de ce concept premier de civilisation.
L’étude de la perception russe du conflit bosnien devient un
élément clé pour contredire la théorie d’Huntington qui
affirme que « la violence entre les Etats et les groupes appartenant à différentes
civilisations comporte un risque d’escalade si d’autres Etats ou groupes appartenant
à ces civilisations se mettent à soutenir leurs « frères » 1», non pas que cette
affirmation soit fausse en théorie, mais les faits et la
pratique de la diplomatie russe démentent l’idée de « frères
slaves ». En créant une métaphysique des relations
internationales, Huntington souhaite, de la même manière
qu’Aristote, prouver par l’évidence que les civilisations sont
l’horizon indépassable des relations entre Etats, comme l’est
la « nature humaine » pour Aristote. Pourtant, la position
russe sur le conflit bosnien semble obéir à une logique
principale, qui n’est pas celle de la solidarité, mais celle
de la confrontation avec l’OTAN, une organisation qui n’est
donc pas une civilisation. La logique civilisationnelle, en
plus de faire croire à un continuum historique et culturel,
paraît inapplicable en pratique en relations internationales,
trop exigeante, trop contraignante, elle ne répond pas
toujours aux intérêts égoïstes des Etats. Huntington n’hésite
d’ailleurs pas à détourner les raisons de la guerre de Bosnie
pour conférer une teinte civilisationnelle aux actes des
Etats. La Serbie et la Croatie, appartenant selon Huntington à
deux civilisations différentes, se sont cependant rejointes
pour envahir la Bosnie, « la Serbie, voulant s’affirmer comme le défenseur1 Ibid, 23.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 10 -
de la chrétienté contre les Turcs, envahit la Bosnie. La Croatie s’associe à cette
action 1». Les civilisations catholiques et orthodoxes
s’effacent au profit d’une seule et même civilisation
chrétienne transformant le paradigme strict de départ en un
paradigme mou. Huntington invente des intérêts et des raisons
supérieures à cette guerre qui opposa majoritairement des
milices sanguinaires qui obéissaient à des chefs de guerre
dont les motivations supérieures s’arrêtaient parfois au
simple plaisir de tuer son voisin d’antan. Un plaisir de tuer
qui ne se soucie guère d’une quelconque logique de
civilisation.
L’histoire des relations entre les Balkans et la Russie est
chargée de conceptions qui déforment la réalité historique
pour n’utiliser que certains faits élevés au rang d’évidences.
Cette étude aura pour ambition d’analyser la perception russe de
ce conflit, d’étudier les faits et le contexte global qui ont
déterminé le choix de la politique et de la diplomatie russe
dans les Balkans. Il est aussi nécessaire de rappeler qu’il ne
s’agit pas d’une analyse comparative entre la Serbie et la
Russie, mais bien de la perception d’un conflit et des menaces
potentielles qu’il engendre.
1 Ibid, 475.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 11 -
I.2 Problématique et structureMon approche consiste à recentrer la guerre de Bosnie dans
une relation plus globale entre la Russie et les Etats
balkaniques et ne se résume pas à une analyse des relations
entre la Serbie et la Russie, ce qui serait s’inscrire
pleinement dans le paradigme d’Huntington. Il ne s’agit pas
non plus de nier les solidarités et le facteur religieux, qui
dans cette guerre joue un rôle important, ni de passer sous
silence les quelques centaines de mercenaires russes partis en
Bosnie pour des raisons d’ailleurs assez diverses, et qui ont
combattu contre les partisans d’Izetbegovic. La première
partie de mon étude nous étudierons les relations
diplomatiques entre les pays balkaniques et la Russie, celle-
ci faisant face à une recomposition de ses intérêts
stratégiques et militaires. Nous interrogerons notamment la
part de l’héritage soviétique dans la diplomatie russe post-
guerre froide et les positions russes durant le conflit. Dans
un second temps nous analyserons les réactions de l’opinion
publique. Des études très précises ont été conduite pour
évaluer l’état de l’opinion entre 1992 et 1995 sur les
questions de défense, de la politique étrangère, notamment
celle vis-à-vis de l’OTAN et plus particulièrement celle menée
pendant la guerre en Bosnie. Il ressort brièvement de ces
études une indifférence d’une grande partie de la population
sur ces questions extérieures, mais parmi les classes les
mieux informées on observe des convictions contraires, soit
pro-occidentales soit anti-OTAN. Dans un deuxième temps,
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 12 -
l’étude de la presse nous indique une forte présence d’anti-
occidentalisation et un rejet de la politique étrangère russe
conduite par Kozyrev. On pourrait résumer schématiquement par
la formule consacrée « Aujourd’hui la Serbie, demain la Russie 1 ».
Enfin, le troisième moment de ma recherche m’a conduit à
m’interroger sur la participation de la Russie dans
l’application militaire du traité de Dayton, cette
intervention obéissant à un paradigme déjà employée en 1945 à
l’occasion de la partition de Berlin en zones occupées par les
alliés. Cependant du fait de l’infériorité manifeste de la
Russie face aux Etats-Unis on peut se demander si cette
indépendance n’est pas feinte, voire même si elle n’obéit pas
à des préoccupations électoralistes.
I.3 MéthodologieMon approche méthodologique a tout d’abord consisté à
m’intéresser aux principaux acteurs russes du conflit. Les
livres de mémoires de Boris Eltsine et de son homologue
américain, Bill Clinton m’ont ainsi délivré une première
perception du conflit en Bosnie. Je me suis ensuite intéressé
aux déclarations publiques de Kozyrev, à la réaction à ces
déclarations dans l’opinion occidentale et russe. Il
s’agissait pour moi de cerner les moments de rupture dans la1 Pravda, 14 septembre 1995, p.1 et 3.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 13 -
diplomatie russe et d’interroger leur portée. La redéfinition
des concepts stratégiques et de défense méritaient également
d’être traitée, la question était de savoir dans quelle mesure
les déclarations et les actes des principaux acteurs de la
politique étrangère russe s’inscrivaient dans ces concepts de
« sécurité collective », de « monde multipolaire » et
« d’étranger proche ». Enfin, grâce à des ouvrages et à des
sources russes (issues des différents journaux russes et de
sondages) il m’a été permis d’analyser l’opinion publique
russe lors de la crise de Bosnie.
Les sources de première main d’origine russe sont à l’heure
d’aujourd’hui impossible à obtenir, ma bibliographie s’est
donc appuyée sur des sources majoritairement américaines, du
Département d’ Etat américain, de l’ONU mais aussi sur des
rapports de la Douma.
I.4 NotesEn 2011 est publié Limonov d’Eric Carrère, livre remarquable
qui raconte l’histoire de cet aventurier, poète et romancier
dont l’engagement en politique au côté des nationalistes
russes ne lui apporta qu’un court réconfort au désespoir de
voir s’écrouler l’URSS. Comme l’écrit Eric Carrère « il aime mieux
être le chef d’un parti de trois personnes que le féal de quelqu’un qui rassemble des
millions 1». Il partage avec Malaparte ce désir de guerre, assez
irrationnel, difficile à traiter pour l’historien qui préfère
1 Eric Carrère, Limonov, PO.L, 2011, p.367.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 14 -
les raisons politiques aux raisons personnelles, qui amena son
engagement dans la République serbe de Krajina. Aux idées
politiques, il choisit la violence, la guerre, car elle révèle
les hommes loin des milieux intellectuels qui discutent sans
connaître. Plus que l’intention de « choquer le bourgeois »,
comme son ami Jean-Edern Allié, il s’agit bien d’une « co-
naissance » dans la guerre, sa vie d’avant n’étant qu’une mort
lente, sans gloire.
Impossible de faire une sociologie complète de ceux qui ce
sont engagés en Serbie, et plus particulièrement des Russes,
on peut juste supposer que ces hommes ce sont engagés au nom
d’un « pan-slavisme » plus ou moins mythique, d’une amitié
entre les nationalismes portés en Russie par le nationaliste
Jirinovski qui rassembla sous sa bannière, néo-fascistes,
nationalistes et nostalgiques d’une « Grande Russie »
impériale ou communiste.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 15 -
Première Partie : la recomposition de
l’appareil diplomatique russe, quelle
politique et quels acteurs ?
I. Evolution des intérêts russes dans les
Balkans, une histoire de « civilisation » ?
I.1] Les intérêts stratégiques russes dans les
Balkans de l’époque moderne à l’époque
contemporaine.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 16 -
La Russie partagea avec d’autres grandes puissances telles
que la France, l’Angleterre, l’Empire Austro-hongrois des
intérêts dans les Balkans, au détriment de « l’homme malade de
l’Europe », l’Empire Ottoman, qui depuis le siège de Vienne en
1683 ne cessait de perdre du terrain. Ce recul « fut le fait de deux
puissances, l’Autriche et la Russie, la seconde envisageant froidement la disparition
de l’empire du Sultan 1». Que désirait la Russie ? La Russie
désirait « s’ouvrir une porte sur la mer », selon les mots de
Pierre le Grand, car cette grande puissance continentale qu’il
gouvernait était écartée de la Mer Noire et de la Mer
Méditerranée par l’Empire Ottoman. L’Empire russe n’hésita
pas, pour fragiliser l’Empire Ottoman, à envoyer des agents
dans les Balkans, souvent Grecs, dont la mission était
d’exciter les nationalismes, une mission qui eut un certain
écho au Monténégro où le vladika Danilo Ier Petrović proclama le
tsar « champion de la liberté 2». La Russie, à la fois par
intérêt, mais aussi par compassion pour les Slaves entretint
certains liens avec des principautés alliés comme le
Monténégro. Ces liens ne résistèrent cependant pas aux
marchandages qui eurent lieu en 1782 entre Catherine II et
Joseph II, la Russie choisissant le khanat de Crimée plutôt que
les Balkans occidentaux laissés à l’Empire Austro-hongrois. En
1826 et en 1829 la Convention d’Ackermann et la Paix
d’Andrinople permirent de consolider la Serbie comme Etat,
cependant la Serbie pesait peu de chose aux yeux de la Russie,
au contraire de la Grèce et de la Bulgarie. La guerre de
Crimée entre 1853 et 1856 confirme que des intérêts supérieurs
1 Georges Castellan, Histoire des Balkans, Fayard, 1991, p.194. 2 Ibid, 200.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 17 -
dictaient la conduite de la Russie tsariste, il s’agissait
avant tout d’exploiter le mécontentement des sujets chrétiens
pour fragiliser un peu plus l’Empire Ottoman. La Porte, grâce
à son commerce florissant avec l’Angleterre, pu s’assurer le
soutien de cette dernière et ne survit pendant ces décennies
que par le bon vouloir du trône d’Angleterre. La victoire
militaire de la coalition franco-anglo-turque aboutit au
traité de Paris le 30 mars 1856 qui confirma la relégation de
l’Empire Ottoman au rang d’Empire en sursis, « l’intégrité du
territoire ottoman placé sous la garantie des Puissances, neutralisait la Mer Noire,
ouverte à tous les navires marchands, internationalisait le Danube et son delta,
obligeait le sultan à l’application complète des réformes promises depuis 18391 ».
Même si la guerre de Crimée n’est pas un souvenir ou un
héritage que les nationalistes serbes rappellent lors de la
guerre de Bosnie, il est frappant de constater que la
domination ottomane, certains parlent de « joug », et « le
jeu » des grandes puissances au XIXe siècle ont inspiré les
nationalistes serbes en 1990. Ainsi, John Morrison affirma que
Karadzić « définit le conflit comme la guerre anti-impérialiste en Europe. Il
affirme avoir pour mission d’effacer les dernières traces de l’Empire Ottoman2 ».
Une affirmation qui démontre toute l’étendue de l’amalgame
créé par la récupération politique de faits historiques. En
effet, la Russie de la tsarine Catherine II avait également
des visées impérialistes dans les Balkans, à ceci près que la
Russie prit parti contre l’Empire Ottoman pour son propre
compte avec pour ambition une expansion vers la Mer
1 Ibid, 288.2John Morrison, « Pereyaslav and After: The Russian-UkrainianRelationship », International Affairs, 69, octobre 1993, p.677.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 18 -
Méditerranée. Cette volonté de démembrer l’Empire Ottoman
trouva un écho dans la petite principauté serbe alors sous
protectorat russe, dont la survie dépendait essentiellement de
la Russie. Néanmoins, cette petite principauté ne rassemblait
pas tous les Serbes, certains vivaient en Hongrie et leur sort
fut bien différent, notamment lors de la Révolution hongroise
de 1848. La proclamation d’une Voijvodine autonome en mai 1849
ne fut pas acceptée par l’Empire Austro-hongrois soutenu par
la Russie, cette révolte, tuée dans l’œuf, ne démontre pas des
intérêts orthodoxes ou panslaves supérieurs aux intérêts de la
Russie. La guerre serbo-turque de 1877, qui répondait à
l’insurrection bulgare, fut un succès militaire pour Belgrade,
qui par la suite réclama le sandjak de Novi Pazar, le Kosovo,
une partie de la Macédoine et le port de Vidin, sur le Danube1.
En 1878, le conflit entre la Russie et l’Empire ottoman tourna
à l’avantage des Russes qui obtinrent lors du traité de Di
Stephano la création d’un Royaume indépendant de Bulgarie et
la reconnaissance par l’Empire Ottoman de l’indépendance de la
Serbie et de la Roumanie2. La Russie préféra néanmoins
récompenser territorialement la Bulgarie plutôt que la Serbie
lors de la paix de San Stefano. La Russie semblait plus
facilement s’accommoder d’une « Grande Bulgarie » que d’une
« Grande Serbie ».
A la fin du XIXe siècle la Serbie était déjà divisée entre
austrophiles et russophiles avant qu’elle ne bascule
totalement dans le camp des russophiles lorsque Pašić amena le
1 Georges Castellan, Histoire des Balkans, Fayard, 1991, p.327.2 Frederic P.Miller, Relations entre la Russie et la Serbie, IphascriptPublishing, p.18.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 19 -
parti radical à la tête de la Serbie avec 80% des suffrages1,
cette orientation ne changea pas malgré son assassinat en
1903. La Serbie privilégia elle aussi une politique étrangère
nettement prorusse. En 1904, après la défaite de la Russie
face au Japon, les Balkans devirent un intérêt prédominant
dans la diplomatie russe2. En 1912, pendant la guerre
balkanique la Serbie et la Bulgarie scellèrent une alliance
dont les modalités territoriales, en cas de victoire, furent
par la même occasion entérinées. Jusqu’à la première guerre
mondiale les alliances balkaniques dominèrent les relations
internationales dans cette région et le jeu des grandes
puissances ne se réveilla que le 28 juin 1914, date de
l’assassinat de l’archiduc Ferdinand. Le jeu mécanique des
alliances amena la France et la Russie à prendre position pour
la Serbie mais l’objectif n’était pas tant la défense de
Belgrade que la chute de Constantinople et le contrôle du
Détroit des Dardanelles. Pour la Russie, le Détroit des
Dardanelles représentait même un intérêt stratégique de
premier ordre, notamment pour son commerce de céréales et son
développement économique de manière générale3. En 1917, lorsque
les Bolcheviks prirent le pouvoir, l’intérêt pour les
Dardanelles ne fut pas abandonné et les Balkans demeurèrent un
enjeu majeur jusqu’à la Seconde Guerre mondiale comme
l’atteste la demande du ministre des Affaires étrangères
russe, Vyacheslav Molotov à Hitler au sujet des Dardanelles.1 Ibid, 329.2 “Russian involvement with the Balkans has run very deep and developed intoa central theme of Russian foreign relation”, Ivo Lederer, Russian ForeignPolicy, Yale University Press, p.412. 3 Voir également sur cette question, Barbara Jelavich, The Ottoman Empire, theGreat Powers and the Straits Questions 1870-1887.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 20 -
Molotov affirma que les Dardanelles faisaient partie de la
« zone de sécurité 1» de la Russie et demanda à installer des
bases navales dans le Bosphore et les Dardanelles2.
La Seconde guerre mondiale a affermi les relations
soviéto-yougoslaves par la lutte commune contre l’envahisseur
nazi mais pendant toute la Guerre Froide, l’allié privilégié
demeura la Bulgarie, éternelle rivale de la Serbie dans les
Balkans, avec à sa tête le dirigeant communiste Todor Zhivkov
qui fut loyal à l’URSS jusqu’à sa chute en 1989. La relation
entre Staline et Tito fut plus délicate, ce dernier fut exclu
du Kominform en 1948 et la Yougoslavie rejoignit le Mouvement
des Non-alignés en 1964. Cette rupture avec le giron
communiste poussa Moscou à renforcer son influence sur la
Bulgarie devenue dépendante des aides économiques de l’URSS3.
Néanmoins, l’URSS n’abandonna pas l’idée de faire revenir la
Yougoslavie dans la sphère d’influence communiste pour une
raison stratégique, les ports de l’Adriatique offraient la
possibilité à l’URSS d’exercer son influence dans la Mer
Méditerranée, et pour une raison idéologique d’autre part, la
Yougoslavie proposant un modèle alternatif dangereux à l’URSS.
En effet, on constate qu’à l’annonce de l’exclusion de Tito du
Kominform en 1948 des luttes de clans eurent lieu en Bulgarie
déstabilisant un pays pourtant bien ancré à la sphère
communiste4. Le titisme devient un prétexte à l’épuration des
membres du Parti (environ 20% des effectifs). La politique
1 Stephen Larrabee, “Russia and the Balkans: old themes and new challenges”in Russia and Europe the Emerging Security Agenda, p. 390. 2 Lederer, note 2 p.423. 3 J.F Bown, Bulgaria under communist rule, pp.297-300.4 Georges Castellan, Histoire des Balkans, Fayard, 1991, p482.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 21 -
étrangère de Gorbatchev, plus souple, conjuguée à la mort de
Tito, favorisa les mouvements nationalistes constituant la
Yougoslavie, amenant celle-ci à se désintégrer dans les années
1990-1991.
D’un point de vue stratégique contrôler les Balkans
représentait toujours pour la diplomatie russe un moyen de se
protéger contre une agression maritime ou terrestre, certes
très hypothétique du fait de la dissuasion nucléaire. A cet
enjeu stratégique s’ajoute un enjeu économique relativement
faible mais qu’il convient de traiter. La Russie fut en effet
moins affectée par la crise yougoslave que les pays européens,
pour des raisons économiques tout d’abord, la scission entre
Staline et Tito ayant affecté les transactions économiques
entre les deux Fédérations et pour l’accueil des réfugiés, qui
fut plus important en Europe de l’Ouest. La Russie conservait
des intérêts économiques dans certains domaines tels
l’électricité, le gaz, l’industrie lourde et les
communications, des domaines qui jouèrent un rôle dans
certaines négociations, on peut penser notamment à celles
concernant Gazprom pour le rétablissement de l’électricité et
du gaz à Sarajevo. D’un point de vue géostratégique, les
Balkans représentent un enjeu pour la Russie qui doit trouver
des alliés face à la Turquie et à l’Iran qui eux, cherchent à
s’imposer comme des puissances régionales et qui utilisent
leur influence auprès des pays musulmans de l’ex-URSS. La
Russie, elle, se tourne vers la Serbie, la Macédoine, la Grèce
et en Bulgarie dans le but de lutter face à la montée de
nouveaux acteurs dans les Balkans. Cette course d’influence
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 22 -
est disputée également avec les pays européens qui cherchent à
inclure progressivement les pays des Balkans à l’intérieur
d’une CEE en construction. Néanmoins, la Russie et l’Europe ce
sont souvent retrouvées d’accord concernant la volonté de
conserver les frontières de la Yougoslavie au contraire de
l’Allemagne qui reconnut très tôt la Slovénie et la Croatie
car elle pouvait « bénéficier » de l’éclatement de la
Yougoslavie pour développer son influence vers ces nouveaux
pays et ainsi déplacer le centre de l’Europe de la France vers
elle. Enfin, la Yougoslavie est le lieu de confrontations
entre la nouvelle Russie et les Etats-Unis qui cherchent à
ancrer leur influence dans cette région par le biais de
l’OTAN. C’est bien l’OTAN qui cristallisa l’attention des
élites russes, partagée entre soutenir l’allié traditionnel
serbe et la coopération avec l’Occident, pour, d’une certaine
manière, illustrer la bonne volonté de la Russie à rejoindre
les pays dits « libéraux » par des actes.
I.2] Le panslavisme : perception et réalité.Le panslavisme est une idée développée à partir du XVe
siècle sous l’impulsion de Vinkó Pribojević qui trouva un écho
dans la diplomatie étrangère russe dans la deuxième moitié du
XIXe siècle. Le panslavisme propose une sorte de confédération
de tous les peuples slaves dont les modalités demeurent
contradictoires, doit-il s’agir d’une confédération
démocratique et égalitaire ou bien d’une confédération sous
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 23 -
domination russe ? Bakounine fut l’un des seuls représentants
russes de ce mouvement panslave au XIXe siècle, il demandait
la création d’une Union panslave en dehors de la Russie
tsariste, ce régime empêchant le libre déploiement de ce
mouvement1. Cette conception s’oppose frontalement à ceux qui
voient le panslavisme comme un « bloc », une conception
unitaire partagée par tous les Slaves. C’est le cas de Samuel
Huntington dont la vision du panslavisme refuse les
contradictions inhérentes au mouvement. En effet, il est bien
difficile d’imaginer ce type d’union de manière concrète au
sein d’un Etat confédéral. Il reste la théorie de « l’amitié
entre les civilisations » et de la solidarité entre les
peuples. Ce principe, selon Huntington, trouve son plein
déploiement dans la guerre de Bosnie. Pourtant on constate en
analysant l’histoire de la Russie que ce n’est pas tant l’idée
de peuple slave qui domine au sein des élites russes mais bien
l’impérialisme, ce sentiment d’appartenir à une « Grande
Russie » dominée par la religion orthodoxe. Certes, Huntington
ne définit pas de civilisation slave mais ces solidarités
justifient, selon lui, l’idée de « choc des civilisations ».
Le panslavisme, bien que minoritaire, fut repris par des
personnalités comme Ziouganov, alors premier secrétaire du
parti communiste en 1993, comme moyen pour la Russie de
retrouver son influence en Europe et de s’opposer aux Etats-
Unis, en se basant sur la théorie selon laquelle le
panslavisme du XIXe siècle a favorisé une politique étrangère
1 J.B Duroselle, Revue belge de philologie et d'histoire, 1954, Volume 32, Numéro 32-4,pp.1202-1204.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 24 -
russe active sur les frontières occidentales sans esquiver les
tensions inévitables d’une telle politique avec l’Europe1.
Cette démarche civilisationnelle Sergei Stankevich, alors
premier conseiller en politique étrangère du président Boris
Eltsine, l’endosse. Pour lui la politique étrangère russe doit
se focaliser sur les territoires de l’ancienne URSS où les
liens ethniques sont les plus forts, notamment là où résident
des minorités russes. La démarche aboutissant à la création de
la CEI, cette « maison commune », pourrait s’expliquer
également par la volonté de certains dans l’administration de
Eltsine, à créer une communauté d’intérêts slaves qui pourrait
par la même occasion régler le problème des Russes de
l’étranger. Il s’agit en quelque sorte de combattre la
mondialisation et le libéralisme économique par le repli
civilisationnel et émotionnel. A la raison émotionnelle,
s’adosse la raison plus pragmatique de l’existence d’une
diplomatie russe discordante de celle des Etats-Unis, question
incessante à laquelle les diplomates russes vont opposer
plusieurs stratégies dont celle de l’identité commune, slave
et orthodoxe. Ainsi les racines slaves, plus ou moins
mythiques, deviennent un alibi pour poursuivre une stratégie
plus large, contre l’élargissement de l’OTAN, une
préoccupation beaucoup plus prégnante que le sort des Serbes,
et pour justifier l’engagement de la Russie dans les Balkans.
En 1993, une étude révèle d’ailleurs que 52% de l’élite russe
s’identifie comme « Westernizers » et 45% comme « Slavophiles »2,1 Bobo Lo, Russian Foreign Policy, Reality, Illusion and Mythmaking, Palgrave Macmillian, 2002, p.15.2 Suzanne Crow, “Why Has Russian foreign policy changed?” RFE/RL Research Report 3, 6 mai 1994, 6.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 25 -
ces derniers demandant un changement d’orientation de la
politique étrangère conduite par Kozyrev. La question du
panslavisme, loin d’être centrale, est un écran de fumée qui
dissimule une politique étrangère plus réaliste, plus encline
au compromis, mais qui pour des raisons à la fois
traditionnelles et électoralistes se teinte d’un discours
slavisant. Parmi ceux s’identifiant comme « Slavophiles » il
faut comprendre que ceux-ci se définissent surtout par
opposition aux « Westernizers » et qu’ils désirent suivre une
autre route que celle menant à l’économie de marché. Ces
personnes vont se définir par opposition, mais vont également
embrasser des conceptions en politique étrangères assez
différentes, certains néoréalistes pensaient qu’il était
nécessaire de privilégier une alliance slave pour forger et
entretenir des amitiés et des partenariats durables tandis que
d’autres, à l’instar de la théorie civilisationnelle de Samuel
Huntington, souhaitaient privilégier un slavisme
panorthodoxe.
De même, il convient de discuter cette idée transformée en
axiome selon laquelle la Russie serait « l’allié
traditionnel et naturel» de la Serbie alors qu’au contraire de
la Bulgarie la Yougoslavie n’était pas dans l’orbite de l’URSS
et que la Russie a eu une position jusqu’en 1993 très hostile
à la Serbie. Comme le démontrent les tractations entre
Catherine II et Joseph II ou entre Molotov et Hitler, la
Russie n’a pas hésité à marchander, voire à instrumentaliser
son influence dans les Balkans pour gagner des points
stratégiques et ainsi augmenter sa puissance. La solidarité
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 26 -
panslave devenait ainsi un moyen de puissance mais pas une fin
en soi, il s’agissait d’un double langage en fonction des
« échelons » des pays, pour reprendre l’expression
d’Huntington. L’influence devient un mode de marchandage avec
les autres grandes puissances, Autriche-Hongrie, Allemagne et
Etats-Unis, non pas pour protéger les « alliés traditionnels »
mais pour augmenter sa puissance sur le continent européen.
Cette volonté de puissance va de pair avec une peur du déclin,
la Yougoslavie étant perçue par certains analystes comme une
« petite Russie », son éclatement inquiéta beaucoup Moscou.
Mais plus que la peur c’est sans doute l’opportunité de
réaffirmer sa position dans une zone traditionnellement sous
influence russe qui domina pendant la crise bosniaque. La
perception d’une identité panslave a elle bien existé au sein
des comités de rédaction des grands journaux comme la Pravda.
Plusieurs journalistes ont ainsi mis en exergue la nécessaire
solidarité entre la Russie et la Serbie. On peut citer le
numéro de la Pravda du 23 Janvier 1992 où le journaliste Youry
Bychkov exprima son désir de voir la solidarité panslave se
réaliser « les Serbes sont merveilleux et des gens amicaux, qui sont proches de
nous 1». Si ces commentaires demeurent marginaux, il n’empêche
que la presse communiste dans son ensemble, plus par réalisme
politique que par conviction, joue de cet argument pour
déstabiliser le déjà peu populaire Andrei Kozyrev2. On observe
donc un décalage entre la realpolitik du ministre des affaires
étrangères russe, dont l’ambition consiste à apaiser les
1 Youry Bychkov, Pravda, 23 Janvier 1992.2 Eric Shiraev, “Russian Decision-Making Regarding Bosnia” in InternationalPublic Opinion and the Bosnian Crisis, p.158.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 27 -
relations avec l’Ouest, et une certaine frange de l’opinion
publique, très minoritaire, mais qui fait entendre sa voix en
utilisant l’idée du « frère slave » comme argument politicien
plus qu’idéologique.
I.3] La « civilisation orthodoxe », alibi
politique ou réalité manifeste ?Samuel Huntington reprend la théorie d’Edward Mortimer
selon laquelle « la religion est de plus en plus en passe de faire intrusion dans
les affaires internationales 1». La religion orthodoxe, plus qu’une
religion, serait une civilisation, autrement dit elle
regrouperait des Etats et des peuples au sein d’un même
ensemble. Cette création ne serait pas le résultat de la
volonté des peuples, ou la résurgence inconsciente d’une
histoire mais serait bien la volonté de la Russie, « la Russie crée
un bloc formé d’un territoire orthodoxe qu’elle dirige et entouré d’Etats musulmans
relativement faibles qu’elle dominera 2». Il s’agirait d’un système que
la Russie tenterait d’imposer au monde occidental, qui
dépasserait « l’étranger proche » pour créer un horizon
lointain de solidarité. D’ailleurs, les dirigeants américains
comme Strobe Talbott, alors Secrétaire d’Etat adjoint, affirme
que la politique menée par les Etats-Unis à l’égard de la
Serbie rencontra un écho très défavorable en Russie du fait de
leur « très longue sympathie pour les Serbes qui sont, comme la plupart des
1 Samuel Huntington, Le choc des civilisations, p.65.2 Ibid, 238
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 28 -
Russes, des Orthodoxes slaves 1» et d’ajouter que « le panslavisme était en
train de faire son retour en Russie 2».
Pourtant, il est difficile de concevoir que Boris Eltsine
et Andreï Kozyrev aient eu pour volonté de créer un tel réseau
de solidarité, pour une raison évidente et électoraliste : les
personnes se revendiquant du panslavisme étaient dans leur
grande majorité des opposants de longue date à la politique de
Boris Eltsine. Strobe Talbott insiste sur ce point et révèle
que la grande inquiétude de Kozyrev concernait la politique
intérieure de la Russie et que chaque vote des résolutions du
Conseil de Sécurité de l’ONU était conditionné par la crainte
de voir se généraliser le populisme et la xénophobie. La
politique conduite par Eltsine et Kozyrev, voire même leurs
convictions profondes, s’opposent frontalement aux généralités
de Samuel Huntington affirmant que « les guerres d’ex-Yougoslavie ont
également produit le ralliement quasi unanime du monde orthodoxe derrière la
Serbie 3». Il nous faut donc pour contredire Huntington
distinguer les aspects fondamentaux de la pratique de la
politique étrangère russe. Tout d’abord il nous faut rappeler
la déclaration de Gorbatchev lors du Discours d’ouverture du
Forum pour un monde dénucléarisé, « plus que jamais notre politique
étrangère est déterminée par notre politique intérieure 4», une déclaration
qui ne faisait que confirmer la désidéologisation des
relations internationales depuis Brejnev notamment. Cette
désidéologisation se poursuit entre 1992 et 1993 avec comme
1 Strobe Talbott, The Russia Hand, Random House, p.73.2 Ibid, 73. 3 Samuel Huntington, Le choc des civilisations, Odile Jacob, p.427.4 Jean-Christophe Romer, « La politique étrangère sous Boris Eltsine »,Annuaire Français de Relations Internationales, p.49.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 29 -
point d’orgue les « Principes de la politique étrangère »,
adopté le 23 avril 19931 qui met en exergue trois objectifs
principaux, à la fois établir des relations avec les membres
de la CEI qui formeront « l’étranger proche », une sorte de
doctrine Monroe qui aurait pour but de limiter l’influence de
l’Ouest sur les pays sortis de l’URSS, éviter la création
d’une « zone tampon » la privant de relations directes avec
l’Ouest, et enfin développer des relations avec les grands
pays occidentaux et le reste du monde. Favoriser les pays
selon leurs croyances ne fait donc pas partie des priorités
établies par le Ministère des Affaires Etrangères russe, du
moins de manière officielle. En réalité il y a une constance
dans la diplomatie russe, celle exprimée par Gorchakov à
l’Empereur Alexandre II, « nos politiques doivent poursuivre un double
objectif. Premièrement, préserver la Russie d’un engagement dans n’importe quel
type de complications externes qui pourrait dévier nos efforts de notre
développement interne. Deuxièmement nous devons mettre tous nos efforts pour
assurer qu’il n’y aura pas de changements – ni territorial ni un basculement
d’influence ou de puissance – en Europe qui pourrait sérieusement endommager nos
intérêt ou la situation politique 2».
Cette constance ne doit pas pour autant masquer le rôle
réel de l’Eglise orthodoxe dans la politique étrangère russe.
Selon une étude menée en Russie en 1996, 72% des Russes
accordent leur confiance à cette institution3. Le théologien
Dietrich Bonhoeffer insiste d’ailleurs sur la relation unique1 Nezavisimaja Gazeta, 29 avril 1993. 2 Igor S. Ivanov, The New Russian Diplomacy, Brookings/Nixon Center, pp.26-273 “72 per cent of respondents in Russia expressed great confidence in theChurch”, Cem C. Oguz, “Orthodoxy and re-emergence of the Church in Russianpolitics”, Journal of International Affairs, décembre-janvier 1999 Volume 4 Numéro4.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 30 -
entre l’Eglise orthodoxe et l’Etat russe « l’Eglise orthodoxe est
l’organe spirituel de l’Etat et le protecteur spécial de l’ethnos1 ». L’entrée du
Patriarche dans le déroulement de la politique étrangère
exerça une influence certaine sur la politique étrangère russe
sans pour autant mettre au cœur de ce conflit la question de
l’Islam. La question ne doit donc pas porter uniquement sur
l’influence de l’Eglise orthodoxe sur le peuple russe mais
aussi sur son rôle politique original, semi gouvernemental et
transnational comme toute religion. L’Eglise orthodoxe est
d’autant plus transnationale que la chute de l’URSS a fait
émerger des Eglises nationales concurrentes, elle prétend
ainsi, tout comme le gouvernement russe, garder son influence
sur « l’étranger proche ». Plus encore, l’Eglise orthodoxe
entretient un rapport à la nation fort ambigu, elle se veut à
la fois en dehors des réalités de frontières et de la
contingence politique tout en « profitant » des crises, « Il se
nourrit de la crise socioculturelle de la Russie et des bouleversements des années
1990 dans la mesure où il permet de penser la continuité en dehors des accidents du
politique2. L’orthodoxie se veut la religion d’une patrie sans
frontières politiques, le visage d’un peuple dispersé à
travers l’ancien Empire soviétique. Kathy Rousselet pose
d’ailleurs une question déterminante « la perception orthodoxe de
l'homme et la congruence d'un peuple, d'un territoire et d'une Église permettraient-
elles de désigner une civilisation slave-orthodoxe ? ». L’Eglise défend très
clairement une démarche civilisationnelle, perçue par nombre
1 Vigen Guroian, Ethics After Christendom: Toward an Ecclesial Christian Ethic (William B.Eerdmans, Grand Rapids, MI, 1994), p. 5.2 Kathy Rousselet, « L'Église orthodoxe russe et le territoire » in Revued’études comparatives Est-Ouest. Volume 35, 2004, N°4. Religions, identités etterritoires. pp. 149-171.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 31 -
de croyants comme naturelle et légitime, mais l’Eglise
orthodoxe a-t-elle les moyens de créer une « civilisation » ?
Suffit-il de dire pour que la réalité soit ? Dans le cadre de
la guerre de Bosnie ce sont les Etats qui vont agir ou ne pas
agir, ce sont eux qui perçoivent les menaces et qui agissent
en fonction de leurs intérêts, les peuples peuvent suivre ou
s’insurger, ils peuvent influencer mais jamais ils ne
décident.
Il convient de s’interroger sur la place de l’Eglise
orthodoxe en Serbie, sur sa place dans la société serbe et sur
les liens qu’elle entretient avec l’Eglise orthodoxe russe. La
crise économique, la guerre en Bosnie a ramené dans le giron
de l’Eglise orthodoxe serbe des jeunes ne croyant plus dans la
politique, en 1996 « sur un peu plus de 10 millions d'habitants, l'actuelle
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) compte près de 7 millions d'orthodoxes, dont 42
% de pratiquants en 1993, contre seulement 25 % en 1975 1». L’influence de
la religion est indéniable, à l’instar du rôle de l’Eglise
orthodoxe en Russie, celle-ci a une place autonome et une
autorité qui dépasse les contingences politiques. L’Eglise
orthodoxe serbe pris néanmoins position en faveur de Slobodan
Milosevic lorsque celui-ci arriva au pouvoir. L’Eglise
reconnaissait en cet homme le vrai garant des intérêts serbes,
celui qui pourrait unifier une « Grande Serbie ». De l’autre
côté, Slobodan Milosevic savait que l’appui de l’Eglise
demeure le levier fondamental pour espérer convaincre son
peuple à le suivre. Ainsi, disparaît progressivement l’image
d’un Slobodan Milosevic héritier du titisme, peu soucieux de
1 Nicolas Miletitch, « L'Eglise orthodoxe serbe » in Politique étrangère N°1,1996, 61e année, pp. 191-203.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 32 -
l’Eglise orthodoxe, au profit d’images spectaculaires qui
montrent l’exhumation des victimes de la Seconde Guerre
mondiale avec un message clair : « peut-on vivre avec ces Croates et ces
Musulmans qui ont massacré des Serbes il y a 50 ans et qui, aujourd'hui,
revendiquent une indépendance annonciatrice de nouvelles tueries ? 1». La
rupture avec Milosevic se fit lorsque celui-ci, à partir de
1993 fit pression sur les Serbes de Pale pour qu’ils acceptent
le plan Vance-Owen et lorsque la Serbie imposa un embargo sur
les Serbes de Pale en août 1994. Cette rupture amena l’Eglise
orthodoxe serbe à se rapprocher de Karadzic, pourtant isolé
sur la scène internationale. Les liens avec l’Eglise orthodoxe
russe existent mais ils sont minces. Il faut insister sur le
fait que l’Eglise orthodoxe serbe a un fonctionnement séparé
de son équivalente russe, « l'Eglise serbe — autocéphale — ne dépend pas
d'une autorité extérieure et son existence est profondément liée à l'idée de nation
serbe 2». La théorie d’une religion orthodoxe transnationale
pouvant former une civilisation est battue en brèche par les
divisions internes à l’Eglise orthodoxe et par le
fonctionnement autonome d’entités religieuses nationales et
nationalistes. Lors de sa rencontre avec le patriarche russe
Alexis II, le patriarche Pavle critiqua à nouveau le plan du
Groupe de contact et réaffirma son soutien aux Serbes de
Bosnie, soulignant que l'Eglise « ne peut accepter que les Serbes de
Bosnie aient moins de droit que les deux autres peuples 3». Pour autant, le
patriarche russe tint un discours différent à Karadzic,
l’enjoignant à un règlement pacifique du conflit : « ma visite ici
1 Ibid, 193.2 Ibid, 192.3 Politika, 15 octobre 1994.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 33 -
est une modeste contribution en faveur de la paix dans l'espoir que tous les conflits
puissent être résolus à la table de négociation et pas sur le champ de bataille 1».
Certes, le patriarche Alexis II a bien condamné l'offensive
croate contre les Serbes de Krajina comme aucune autre
personnalité religieuse ne l’a fait et a même déclaré en juin
1995 que « la Yougoslavie et la Serbie peuvent toujours compter sur l'aide de la
Russie 2». Est-ce néanmoins suffisant pour annoncer, à la
manière de Samuel Huntington et de François Thual dans la
Géopolitique de l’Orthodoxie, « la formation d'un bloc orthodoxe qui bouscule les
héritages de l'histoire puisqu'on y voit côte à côte la Roumanie, la Serbie et la Grèce
former une espèce de triangle d'acier contre les puissances occidentales, leurs alliés
et bien entendu contre toute forme d'islam 3». Dans les faits la
solidarité russo-serbe ne s’est pas manifestement faite au
travers de la religion, malgré également des discours et des
déclarations qui vont dans le sens de la formation d’un bloc
de valeurs orthodoxes. Une assemblée de l'Eglise orthodoxe
russe regroupant 350 délégués venus de Russie et de l'étranger
s'est d’ailleurs prononcée, en décembre 1995, pour le
rétablissement de « l'unité historique des trois peuples
frères, biélorusse, russe et ukrainien ».
1 Reuters, « Patriarche et pèlerinages… », Lesoir.be, mercredi 18 mai 1994.2 Nicolas Miletitch, « L'Eglise orthodoxe serbe » in Politique étrangère N°1,1996, 61e année, p.198.3 François Thual, Géopolitique de l'orthodoxie, Dunod, Paris, p. 108-109.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 34 -
II. La recomposition de l’appareil diplomatique
russe après la guerre froide.
II.1] La position de Gorbatchev à l’aube de
l’éclatement yougoslave et de la guerre de
Bosnie.
Comme le souligne avec emphase Lenard J. Cohen la
Yougoslavie constitue pour Mikhail Gorbatchev l’une des
priorités et l’un des « challenges » les plus importants dans
les dernières années de l’URSS1. Gorbatchev est favorable à la
préservation de la Yougoslavie telle que l’a conçu Tito, ce
qui impliquait le maintien d’une cohésion entre les peuples,
une solidarité pourtant ébranlée par les discours
nationalistes de Tudjman et de Milosevic. Si cette position
politique concorde avec la position européenne et américaine
du début de l’année 1990, il convient de s’interroger sur la
perception de Gorbatchev de la montée au pouvoir au sein de la
ligue communiste de Serbie de Milosevic. Gorbatchev n’a pas
pesé sur les événements en Yougoslavie autant qu’il a semblé
1 “The violent aftermath of Yugoslavia’s dissolution was one of MikhailGorbatchev’s main foreign policy challenges during the last five years ofthe Soviet regime” Lenard J.Cohen, “Russia and the Balkans: pan-Slavism,partnership and power”, International Journal, Vol. 49, No. 4, Russia's Foreign Policy,Automne 1994, p.814.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 35 -
le vouloir, certes il a condamné la montée des nationalismes,
accentuant les différences et menaçant la totalité de la
Yougoslavie mais il resta néanmoins assez neutre lorsque des
conflits à l’intérieur de la Ligue Communiste éclatèrent1.
Milosevic écarta des cadres du parti, notamment Stambolic,
pourtant très proche de Milosevic en terme d’idées mais jugé
trop lent dans les réformes. Lors de la visite de Gorbatchev
en Yougoslavie en mars 1988, Milosevic salua sa venue par ces
mots « malgré toutes les difficultés que l’on rencontre la base du socialisme
actuellement et historiquement est la société la plus progressive de notre
époque 2». Par ces mots Milosevic tente de teinter sa politique
nationaliste par un discours rassurant et pro soviétique, mais
Gorbatchev n’est pas dupe, pour lui toute remise en cause de
l’ordre communiste tel qu’institué est une menace pour l’URSS
même. Sa visite, la première depuis 1980, avait pour but de
réaffirmer les liens politiques et économiques qui unissent
les deux pays. Il jugea qu’une excessive décentralisation et
une libéralisation trop grande pouvaient avoir des effets
néfastes pour l’intégrité d’un pays, notamment en accroissant
les inégalités. De ce constat découlent des réformes
nécessaires en Yougoslavie pour réduire l’importance des
nations au sein d’un pays multiethnique dont le fonctionnement
même se base sur une représentativité des nations. Pour
Gorbatchev, la nation doit être le communisme et même s’il
reconnaît qu’en ignorant les difficultés ethniques « les
problèmes se sont accumulés », il ajoute « dites-moi l’endroit où il n’y a pas
1 Ibid, 816. 2 Slavoljub Djukic, Izmedju Slave I Anateme: Politicka Biografija SlobonadaMilosevica, Filip Visnjic, 1994, p.103.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 36 -
de problèmes, nommez moi un tel pays 1». Tout le paradoxe de la
position de Gorbatchev à l’égard de la Yougoslavie peut
s’exprimer ainsi, à la fois la prise de conscience que nier
les nations serait fatal pour l’URSS et le refus du
nationalisme et du populisme. Milosevic en jouant de la corde
nationaliste usait d’une tactique dangereuse pour Gorbatchev
mais celui-ci déclara « les meilleurs représentants russes ont toujours vu la
lutte pour la libération des Slaves du Sud avec une profonde sympathie et sont venus
pour les aider lors des moments cruciaux... dans le cœur de chaque Russe et Serbe,
dans leur mémoire génétique pour ainsi dire réside une bienveillance mutuelle et une
propension à l’amitié 2». Pour autant Gorbatchev ne devint pas
l’allié de Milosevic, une idée développée après le soutien de
ce dernier lors du coup d’Etat orchestré contre Boris Eltsine,
mais il ne devint pas pour autant un adversaire. Gorbatchev
soutint les réformes de Markovic, pourtant libérales, car
elles réduisaient la notion d’ethnicité en apportant un niveau
de vie meilleur aux Yougoslaves. On peut discuter cette idée,
la Yougoslavie dans les années 1980 subissait un tel niveau
d’endettement et un tel délitement de son économie que
certaines des Républiques commerçaient plus avec les pays de
l’Ouest qu’entre elles. Doit-on voir la visite de Gorbatchev
comme une énième tentative de l’URSS de ramener la Yougoslavie
dans le giron de Moscou pour des raisons économiques ? Dans
tous les cas la « thérapie de choc » de Markovic, bien aidée
par le sabotage de Milosevic, ne réussit qu’à aggraver une
situation sociale déjà bien préoccupante3. D’autre part, on
1 Foreign Broadcast Information Service/Soviet Union, 16 Mars 1988, p.23.2 Foreign Broadcast Information Service/Soviet Union, 17 Mars 1988, p.21. 3 Jens Stilhoff Sorensen, State Collapse and Reconstruction in the Periphery: Political Economy, Ethnicity and Development in Yugoslavia, Serbia and Kosovo, Berghahn Books,
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 37 -
constate que malgré les discours, Gorbatchev a plus ou moins
accepté l’idée d’une Yougoslavie indépendante, et qu’il
renonça dans les grandes lignes à la doctrine Brejnev qui
prône une souveraineté limitée des Etats périphériques à
l’URSS. Un renoncement progressif mais qui ne s’est pas
démenti, comme lors du 27e Congrès du Parti communiste de 1986
où Gorbatchev insista sur l’idée que plusieurs voies mènent au
socialisme, et plus radicalement encore le 7 décembre 1988 aux
Nations Unies lorsqu’il déclara que « la liberté de choix est un
principe universel. Il ne devrait pas y avoir d'exception 1».
La visite de Gorbatchev en 1988 annonça d’une certaine
manière la libéralisation du marché yougoslave et la
révolution vers le pluralisme en mars et avril 1990 en Croatie
et en Slovénie. Ces deux pays virent la montée du nationalisme
et l’anti-communisme se confirmer par les résultats du vote,
suivi ensuite par la Bosnie et la Macédoine et l’élection de
nationalistes communistes en Serbie et au Monténégro. Un
détachement s’opéra encore plus nettement avec la politique de
l’URSS, les partis nationalistes yougoslaves intensifièrent
leurs liens avec les ultranationalistes russes et avec les
soutiens au panslavisme au détriment de la politique étrangère
officielle de Gorbatchev rejetée en bloc. Si paradoxalement la
libéralisation politique profita aux partis nationalistes,
ceux-ci ne sont pas pour autant devenus des partisans du
pluralisme et de la démocratie, surtout en Serbie, ce qui les
rapprochent d’autant plus d’une certaine frange de politiques
p.139.1 Tony Judt, Après-guerre: une histoire de l'Europe depuis 1945, Éd. Grand Pluriel, 2005, p. 707.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 38 -
russes. Lenard Cohen évoque également l’arrivée de membres de
la JNA en mars 1991 à Moscou pour négocier l’achat d’armes1, et
des informations plus précises nous révèlent que Gorbatchev
perdait petit à petit le contrôle de son gouvernement. Le
ministre de la Défense, Dimitri Yazov, donna son accord, sans
l’autorisation de Gorbatchev, le 10 et 11 août 1991 à une
vente d’armes représentant deux milliards de dollars incluant
des tanks, des hélicoptères de guerre et des lance-roquettes2.
Le commandant de l’armée de l’air yougoslave, le général Anton
Tus négocia également l’achat d’un escadron de MIG-29 avec
Dimitri Yazov ; l’ensemble de la transaction fut la plus
importante pour la Russie depuis 19883.
La politique étrangère de Gorbatchev s’effrite, malgré la
déclaration commune de Bush et Gorbatchev au sommet de Moscou
en juillet 1991 condamnant l’usage de la violence en Krajina
et exigeant le respect des Droits de l’Homme des deux côtés4.
Les efforts de l’Administration russe, fortement divisée,
restèrent vains, le ministre des Affaires étrangères de l’URSS
Alexander Bessmertnykh déclara qu’un Etat unique et
indépendant de Yougoslavie était « un élément important pour la
stabilité des Balkans et de l’Europe comme un tout 5». Il rencontra également
le Secrétaire d’Etat américain James A.Baker à Berlin dans le
but d’éviter une désintégration violente de la Yougoslavie,
pour les diplomates américains comme russes la question du
1 Politika : The International Weekly (Belgrade) 80 (28 Septembre 4 Octobre 1991), p.7.2 Glenny 1996: 61.3 Podgorica weekly "Monitor", March 15, 1996.4 Mike Bowker, Russia, America and the Islamic World, Ashgate, 19 Octobre 2007, p.52. 5 Pravda, 29 Juin 1991 : 1.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 39 -
maintien de la Yougoslavie intégrée n’était déjà plus
d’actualité. Gorbatchev jugea très négativement l'engagement
de l'OTAN dans les Balkans car selon lui il est marqué par un
manque de respect pour la Russie qui ne fut pas consultée
avant les bombardements. « La preuve de ce changement drastique »,
écrit-il, « est notamment le fait que le Conseil de Sécurité des Nations Unies
s'est mis aux ordres de l'OTAN en signant avec l'OTAN un mémorandum secret pour
prolonger le mandat de cette organisation »1. Il considère qu'une telle
approche est extrêmement dangereuse car la Russie ne pourra se
remettre d'une telle humiliation. M. Gorbatchev appelle de ses
vœux que la Russie et l’Europe construisent ensemble un
nouveau système de sécurité sans l’OTAN. Il signale qu’une
nouvelle Guerre Froide n’est pas à exclure si la Russie est
ainsi mise hors-jeu et si l’OTAN poursuit son élargissement à
l’Est.
II.2] Yugoslavia, “an horror mirror”?2
Les comparaisons entre la Russie et la Yougoslavie,
voire avec la Serbie ont été nombreuses ; les amalgames
également. Pour de nombreux analystes russes, l’exemple de la
Yougoslavie peut réveiller les craintes d’une dissolution de
l’URSS dans le sang. C’est cette peur que souligne N. Arbatova
lorsqu’elle écrit que « l’expérience yougoslave a eu de fortes répercussions
sur la politique étrangère russe à la fois sur l’étranger proche que sur l’étranger plus
1 Moscow News, Septembre 22-28 1995, p.1 et p.2.2 N. Arbatova, “Horror Mirror : Russian perception of the Russian Conflict”,chapitre 16 in A. Arbatov, A.H. Chayes, A.H Chayes et L. Olson, Managing Conflict in the former Soviet Union. Russian and American Perspectives, Cambridge, MA: MIT Press, 1997.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 40 -
lointain. L’effet miroir a eu de manière générale des effets positifs : la Russie a sans
doute vu, dans l’effusion de sang, la destruction, et dans cette atmosphère de haine
et de méfiance, son avenir avec effroi. 1». Si la chute de l’URSS ne s’est
pas faite sans morts, s’il y eut bien des conflits en
Azerbaïdjan, en Moldavie, en Géorgie et dans la Fédération
russe elle-même, le nombre de victimes fut sans commune mesure
avec le nombre de morts provoqués par les guerres de Slovénie,
de Croatie, de Bosnie et du Kosovo entre 1991 et 1999. Boris
Eltsine explique même que pour lui « La guerre dans l’Ex-Yougoslavie,
c’est la plaie de l’Europe et du monde entier 2» et ajoute que « la Yougoslavie
est un modèle réduit de l’Union soviétique ». Dans son dernier livre de
mémoires il narre sa crainte de voir s’installer des généraux
à la tête de la Russie, « je reste absolument persuadé convaincu que
durant toutes ces années, de 1990 et 1996, l’ombre de la guerre civile a plané sur la
Russie. La plupart des Russes, totalement désespérés, pensaient que tout finirait de
cette façon – un nouveau coup d’Etat militaire, l’établissement d’une junte, la
partition du pays en une multitude de petites républiques, à l’instar de ce qui s’est
passé en Yougoslavie 3». Cette gémellité effraie bien entendu
l’opinion, d’autant plus consciente après l’effondrement du
bloc soviétique qu’un tel éclatement pourrait se produire dans
la nouvelle République russe.
On peut comparer ces deux Fédérations selon plusieurs
critères, tout d’abord la question de la diaspora russe après
la chute de l’URSS représente environ 25 millions de
personnes4, ce qui causa des troubles en Moldavie, en
1 Ibid, 35. 2 Boris Eltsine, Sur le fil du rasoir. 3 Boris Eltsine, Mémoires, Flammarion, 2000, 96.4 James Headley, Russia and the Balkans, foreign policy from Yeltsin to Putin, Columbia University Press, 61.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 41 -
particulier en Transnistrie où une minorité de russophones
réclama l’indépendance tandis que la Moldavie tenta de
récupérer ce territoire en 1992 face à la XIVe armée du
général Lebed. Parallèlement à l’effondrement de l’URSS, celui
de la RFY laissa une minorité serbe importante en Croatie dans
la Krajina, qui, à l’instar des russophones de Moldavie,
établirent leur propre république indépendante. Le problème
survint également en Bosnie-Herzégovine où la minorité serbe
réclama la création d’une République autonome. A ces diasporas
s’ajoutent des minorités internes qui causent des problèmes
similaires d’intégration. La Russie doit donc composer avec la
minorité tchétchène tandis que la Serbie réclame le Kosovo,
une terre où vit une majorité d’Albanais (environ 90%) qui
demande l’indépendance. La question qui se pose c’est de
savoir si de telles similitudes peuvent pousser la Russie à
soutenir la Serbie car celle-ci, schématiquement, ferait face
aux mêmes « problèmes ». James Headley répond à cette question
en hiérarchisant les priorités de la diplomatie russe,
première priorité : les frontières de la nouvelle Fédération
russe, ensuite, l’étranger proche. En suivant cet ordre des
priorités la Russie est plus inquiète de voir la Tchétchénie
modifier les frontières de la Russie que du sort des diasporas
russes. Ce raisonnement impliquerait donc plutôt une volonté
de stabiliser les frontières, que ce soit en Croatie, en
Bosnie au sujet des minorités serbes ou en Serbie avec le
Kosovo et non de soutenir les minorités serbes ce qui pourrait
avoir des répercussions dans ses propres frontières. Difficile
en effet de soutenir le droit des peuples à disposer d’eux-
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 42 -
mêmes quand au sein de ses propres frontières des peuples
réclament le même droit.
La comparaison entre les deux pays est néanmoins
pertinente en ce que ces deux pays sont des Fédérations
multinationales orthodoxes ayant connu un régime communiste.
Ces deux pays sont dotés d’un sentiment national qui
outrepasse les frontières étatiques, la Serbie et la Russie
considèrent qu’ils ont un droit de regard sur certains
territoires extérieurs voire même un droit historique à
posséder des territoires de leurs étrangers proches. Ces deux
pays font également face à des menaces intérieures, des
populations non serbes ou non russes qui demandent plus
d’autonomie au risque d’aller jusqu’à la sécession. D’autre
part « la situation de la Russie est la seule qui ressemble à la Serbie 1» à cause
du nouveau tracé des frontières de la Russie qui laisse de
nombreux Russes à l’extérieur de l’Etat national, des
populations dispersées que l’on appelle « pieds-rouges ». Avec
l'éclatement de l'URSS, de nombreux Russes vivant dans les
Républiques périphériques se sont retrouvés dans des Etats
nouvellement indépendants dont ils ne parlaient pas la langue
et auxquels ils ne s'identifiaient pas. La crainte de lois
répressives, notamment sur l’obligation de parler les langues
nationales des nouveaux Etats ont poussé entre 5 et 6 millions
d’entre eux à revenir ou, pour certains, à venir dans une
Russie dans laquelle ils n'ont jamais habité mais qu'ils
voient comme leur patrie naturelle. Le retour se tasse
cependant au milieu des années 1990. Evalués à 23 millions à
1 Jean-Pierre Maury, « La nouvelle perception des menaces: l’ex-bloc soviétique et la Yougoslavie », Afers Internacionals, núm. 27, 40.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 43 -
la fin des années 1980, 18 millions de Russes vivraient encore
dans les républiques d’ex-URSS. Cependant, l’étude rappelle
que les Serbes de Croatie ont connu avec les Oustachis pendant
la Seconde Guerre Mondiale, un moment sans équivalent en
Russie, de même qu’il existe en Serbie un sentiment
d’injustice extrêmement prégnant lorsque les Albanais
« usurpèrent » les terres sacrées du Kosovo. L’auteur souligne
surtout que la « Serbie et la Russie peuvent être des Empires et des
démocraties, mais pas les deux 1». Pourtant, force est de constater
que Boris Eltsine ne fut pas Slobodan Milosevic, et si on peut
contester le clientélisme et la montée des mafias financières
sous sa présidence, il ne partage absolument pas cette
conception du pouvoir autoritaire et belliciste. La presse est
pluraliste, elle peut critiquer le pouvoir en place, les
élections sont libres, ce qui distingue très largement la
Russie de la Serbie. De fait, l’état d’avancement du
« fascisme » n’est pas le même dans les deux pays. En 1991,
Jirinovski réunit sous sa candidature environ 8% des suffrages
soit plus de six millions d’électeurs russes, plus inquiétant
cependant son parti, le LDPR, remporta 23% des suffrages lors
des élections de la Douma en 1993. Ces scores ne donnèrent pas
une majorité à Jirinovski, mais il est intéressant de
constater que ces résultats infléchirent la politique
étrangère de Kozyrev, auparavant nettement pro-occidentale. La
Russie « se comporta comme un allié politique et un protecteur militaire de la
Serbie fasciste 2» à partir d’avril 1994, selon l’auteur de cette
1 Richard Johnson, “Serbia and Russia: U.S. Appeasement and the Resurrectionof the Fascism”, National War College, 28 avril 1994, 6. 2 Ibid, 10.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 44 -
étude. Le succès militaire de la Serbie apporterait aux
nationalistes russes un succès idéologique qui permettrait de
contester l’autorité de Kozyrev et d’Eltsine. A la différence
de Samuel Huntington, qui perçoit dans la solidarité panslave
un trait civilisationnel, l’analyse de Richard Johnson
implique une solidarité idéologique et politique.
Malgré, ou à cause de ces différences, des nationalistes
ont considéré le régime serbe de Milosevic avec respect et
envie, accusant le gouvernement russe d’abandonner à la fois
les « Frères slaves » et les Russes de l’étranger, ces
accusations, nous l’avons vu, ont autant pour objectif de
saper les réformes libérales de Boris Eltsine que d’obtenir
des compensations après l’échec du coup d’Etat. Certains n’ont
d’ailleurs pas frémi d’horreur devant les atrocités commises
par la JNA à Vukovar ou devant le siège de Sarajevo. Edouard
Limonov, dont Eric Carrère a brossé le portrait dans son livre
éponyme, a par ailleurs déclaré devant la BBC en anglais,
« Vous êtes un peuple très courageux : malgré ce qu’il y a contre vous, une grande
puissance. Quinze pays sont contre vous, et vous résistez... Et je le répète encore,
nous Russes, devons prendre exemple sur vous. Vous, peuple de mon sang, de ma
religion. Je vous admire vraiment... J’ai trouvé le mot juste à présent, c’est
« admiration » 1». L’extrême droite et l’extrême gauche, la
coalition rouge et brune, bien qu’informelle, partage cette
admiration pour le courage serbe, et beaucoup regrettent que
la politique étrangère russe soit trop conciliante avec les
intérêts américains. La montée de cette coalition va de pair
avec la montée de la xénophobie, du racisme et d’un sentiment
national exacerbé. Une étude américaine du National War1 P. Pawlikowski, « Serbian Epics », BBC, Bookmark, 1992.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 45 -
College explique le renforcement des forces politiques dites
« fascistes » en Russie et en Serbie par le laxisme des Etats-
Unis. Par un jeu de miroir, les fascismes se renforcent
mutuellement ce qui conduit à la formation d’un cercle vicieux
favorisé par l’inaction des Etats-Unis.
Il est intéressant de contrebalancer cette analyse par
cette assertion du vice-ministre des Affaires étrangères
russes, Vitaly Churkin, qui, le 16 mars 1994, déclara que « pour
être honnête, lorsque je travaillais sur ce problème [la guerre de Bosnie] la
principale chose que j’essayais d’empêcher c’était une humiliation nationale pour la
Russie 1». En d’autres termes, la politique étrangère de la
Russie ne devait cesser d’être guidée par des considérations
intérieures, cette « humiliation » dont parle Vitaly Churkin,
pouvait justement renforcer la coalition rouge et brune, ce
qui n’était pas dans l’intérêt de Boris Eltsine. Cette étude
est néanmoins intéressante en ce qu’elle renverse le paradigme
énoncé par Gorbatchev, qui souligne que la politique étrangère
russe est d’avantage guidée par des obligations intérieures.
En effet, la politique étrangère nationaliste et panslave de
la Russie se nourrirait de cette même politique, exacerbée en
Serbie, ce qui aurait des conséquences internes, sur le
fonctionnement et l’idéologie du Ministère des Affaires
étrangères russe.
II.3] La Russie et la peur de l’islamisme, quel
rôle dans la guerre de Bosnie ?
1 Eric Shiraev, Deone Terrio, “Russian Decision-making Regarding Bosnia: Indifferent Public and Feuding Elites” in International Public Opinion and the BosnianCrisis, Lexington Books, 135.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 46 -
Dans sa logique civilisationnelle, Huntington affirme que la
« solidarité musulmane » fut la plus universellement active et
efficace, « l’aide vint d’une variété de sources, publiques et privées ; les
gouvernements musulmans, plus particulièrement ceux de l’Iran et de l’Arabie
Saoudite, rivalisèrent dans le soutien et pour tenter de gagner l’influence que celui-ci
générait 1». Effectivement, ces deux pays apportèrent un soutien
aux Musulmans de Bosnie, l’Arabie Saoudite en envoyant de
l’argent et une aide humanitaire comprenant nourriture et
soins médicaux tandis que l’aide de l’Iran incluait des armes.
Il ne s’agit pas ici de discuter de la véracité de telles
affirmations mais de constater que la solidarité, plus ou
moins fantasmée, a donné l’impression à la Russie que se
créait en Bosnie un front musulman contre « la civilisation
orthodoxe ». Si, comme l’affirme Shireen Hunter la religion n’a
pas joué un grand rôle dans la politique étrangère russe
pendant la guerre de Bosnie, ou tout du moins si ce rôle a été
exagéré, la possible création d’un Etat islamique a inquiété
l’élite politique russe2. La guerre de Bosnie ne provoqua pas
de réelles réactions au sein de la communauté musulmane de
Russie, notamment à partir de la guerre de Tchétchénie en
1994, où la préoccupation bosniaque passe au second plan, à
l’exception d’une conférence organisée par le gouvernement
turc en 1994 « la Monde et la tolérance religieuse » dont le
principal sujet était la Bosnie et où participa le mufti Ravil
Gainutdin, de Moscou. Néanmoins, la Russie fut attentive à la
tournure radicale que prirent les événements avec le massacre1 Samuel Huntington, Le choc des civilisations, Odile Jacob, 1996, 430.2 “Clearly Russia did not want to see a truly viable Muslim State emerge inthe heart of the Balkans” Shireen Hunter, Islam in Russia: The Politics of Identity and Security, New edition, 2004, 395.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 47 -
de musulmans en Bosnie qui provoquèrent l’indignation et la
révolte des pays arabes. Le schéma civilisationnel étant dans
tous les esprits, certains condamnèrent un front orthodoxe
proserbe, dont la Russie fait bien évidemment partie,
s’opposant à un front musulman mené par l’Iran, l’Arabie
Saoudite et la Turquie. Ces insinuations poussèrent Sergei
Shakhrai, vice ministre des affaires étrangères et autrefois
responsable des minorités vivant en Russie, à condamner
fermement certains médias russes coupables d’exagérer la
proximité slave et orthodoxe. Il dénonça notamment
l’insistance des médias russes à décrire la Russie « comme un
Etat antimusulmans à cause de son inclinaison envers les Serbes qui partagent une
foi orthodoxe avec la Russie » et « de délibérément surestimer l’importance des
15 millions de Musulmans vivant en Russie 1». Serguei Shakhrai, par la
voix de son parti, le Party of Russian Unity and Accord (PRES), ajouta
« qu’on a l’impression que quelqu’un veut transformer le conflit local de Bosnie en
une confrontation globale entre les civilisations Orthodoxes et Musulmanes ». Ces
déclarations visèrent à dénoncer un climat « anti-musulman » se
répandant dans le pays et accusèrent « les médias de vouloir un choc
avec les pays musulmans de la CEI et avec les alliés traditionnels de la Russie dans le
monde arabe 2».
II.4] Le renouvellement du personnel
diplomatique.
1 Ibid, 395.2 Ibid, 395.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 48 -
Les années 1991-1992 montrent une volonté radicale de
changer de politique étrangère. Ce changement passe par une
incarnation nouvelle de la politique étrangère, par des
visages neufs et occidentalistes. Ce changement de conception
des relations internationales fut amorcé par Gorbatchev lui-
même. La politique étrangère sous Gorbatchev fut en grande
partie déterminée par la volonté de créer un monde plus sûr,
donc de terminer la Guerre Froide, sans pour autant renoncer
au communisme. Il appelait à « accélérer le processus
d’intégration » au sein du camp socialiste et à « renforcer la
coopération entre partis frères »1. La « Nouvelle Pensée »,
entend repousser la guerre technologique et la course à
l’armement, pour mieux concentrer les efforts de l’URSS en vue
de créer un monde en paix qui lui permettrait de retrouver la
prospérité. Iakovlev, un des proches collaborateurs de
Gorbatchev, attend de l’URSS qu’elle change son orientation
vis-à-vis des Etats-Unis, pour se concentrer sur une
compétition de nature idéologique, sociale et politique2. Dès
1985 on peut constater que Gorbatchev a procédé à une
rénovation du personnel diplomatique, à Vladivostok, il
déclara que « l’étape en cours pour le développement de la civilisation [...] est
dictée par un besoin urgent d’une rupture radicale avec beaucoup des approches
conventionnelles en politique étrangère, une rupture avec la tradition de la pensée
politique 3». Une telle rupture ne peut s’effectuer avec le même
personnel que celui qui a obéi à Andropov. Le changement de1 Mikhail Gorbatchev, Perestroïka i novoe mychlenie dlia nacheï strany i dlia vsevo mira, Moscou, Politizdat, 1987, pp. 170, 173, 166 (trad. française Perestroïka, Paris, Flammarion, 1987).2 Pierre Hassner, « Gorbatchev à l’Ouest », Pouvoirs, 45, 1988, p.110. Disponible aussi aux éditions CERI. 3 Dmitri K. Simes, “Gorbachev: A New Foreign Policy?” Foreign Affairs, 1986.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 49 -
doctrine en matière de politique étrangère en vue de la
constitution d’un monde multipolaire ne s’est cependant pas
effectué dans le cadre législatif. La plupart des prérogatives
en matière de politique étrangère demeurent dans le cadre
exécutif. La Constitution de 1993 confère au président russe
les mêmes avantages que lors de la période soviétique, ne
donnant à la branche législative qu’un rôle secondaire. Le
monde multipolaire voulu par Kozyrev ne se traduit donc pas
par une véritable décentralisation du pouvoir1.
Ce renouvellement se poursuit naturellement avec Boris
Eltsine, lorsque celui-ci décida de s’entourer, à l’instar de
ses prédécesseurs du XIXe, de personnalité occidentalistes,
généralement plus jeunes, tels Andreï Kozyrev, G. Burbulis,
l’un de ses principaux conseillers et le Premier ministre Egor
Gaïdar. Ces personnalités entendaient faire table rase du
passé soviétique pour faire entrer la Fédération de Russie
dans un nouveau monde, multipolaire et démocratique. Egor
Gaïdar conduisit la réforme économique, « la thérapie de
choc », qui consistait en réalité en une libération des prix
et de l’activité et en une tentative de réduction du déficit.
Kozyrev, lui, fut nommé en octobre 1990, lorsque Boris Eltsine
était encore président du Soviet Suprême. La nomination de
Gennadi Burbulis comme premier adjoint à Andreï Kozyrev par1 “When a large part of the Soviet’s Union foreign policy function devolved to Russia in 1992 the Soviet pattern of centralizing foreign policy continued. The Russian constitution of 1993 gives the executive branch the chief role in making foreign policy, with the legislative branch occupying a distinctly subsidiary role. In the years since 1993, President Yeltsin has formed various organizations in the executive branch to assist him in formulating foreign policy. The mechanism of policy making has remained unwieldy, however, and the increasingly nationalistic parliament has used every power it commands to influence policy making.” Glenn E. Curtis, Russia:A Country Study, Washington: GPO for the Library of Congress, 1996.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 50 -
Boris Eltsine, a instauré une compétition entre les deux
hommes. Le premier jouissait d’une véritable confiance de la
part du président russe, et ce jusqu’en 19921. Son rôle,
coordonner la politique étrangère russe, lui accordait en
réalité une primauté sur Kozyrev. Un peu plus tard, furent
créés pour déterminer la politique étrangère russe, deux corps
exécutifs, le Conseil de Sécurité et la Commission
Interdépartementale de politique étrangère, dont l’efficacité,
faute de moyens, s’en trouva limitée. Le pouvoir diplomatique
échut donc plutôt à la Défense, dirigée par Pavel Gratchev et
au premier ministre Viktor Tchernomyrdine.
La volonté d’une politique étrangère pro-occidentale avait
un double objectif, tout d’abord rejeter Gorbatchev à droite
de l’échiquier politique russe, et deuxièmement mettre en
œuvre le redressement de la Russie selon un modèle libéral. Le
risque pris avec le démembrement de l’URSS était de reléguer
la puissance russe au deuxième plan. Cette politique pro-
occidentale subit dès le début de la crise yougoslave quelques
accrocs notamment avec le surprenant discours de Kozyrev à la
CSCE à Stockholm le 14 décembre 19922 qui condamnait les
sanctions à l’égard de la Serbie et les manœuvres des pays
occidentaux vers les Etats Baltes. Cette prise de position fut
interprétée comme une tentative de compromis avec les forces
intérieures, conservatrices, proserbes, lui-même déclara en
« off » qu’il s’agissait d’une manœuvre tactique mais que
Boris Eltsine n’avait absolument aucune envie d’appliquer ces
1 Eric Shiraev, Deone Terrio, “Russian Decision-making Regarding Bosnia: Indifferent Public and Feuding Elites” in International Public Opinion and the BosnianCrisis, Lexington Books, 138.2 Peter Truscott, Russia First: Breaking with the West, 1997, p.38.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 51 -
idées1. Vitaly Churkin, lui, fut vice-ministre des Affaires
étrangères entre 1992 et 1994 et envoyé spécial du Président
chargé de la question bosniaque, ce qui montre l’intérêt de la
Russie pour cette problématique. Ce fut le cas notamment en
1994 lorsque Vitaly Churkin négocia dans les quartiers
généraux serbes l’arrivée des troupes russes à Sarajevo en
échange du retrait des armes lourdes2. Les Serbes enlevèrent
rapidement les armes lourdes de « l’exclusion zone » le 20
février. Vitaly Churkin fut remplacé par Igor Ivanov, qui fut
ambassadeur à Madrid en 1991 avant d’être nommé vice-ministre
des Affaires étrangères en 1994. Cet homme est décrit par
Strobe Talbott comme un homme « solide, un diplomate
professionnel d’humeur égale », il ajoute qu’il a servi
Chevardnadze comme cadre du Ministère des Affaires étrangères.
Cet antécédent montre bien qu’après une période de
renouvellement au sein du ministère des Affaires étrangères,
la pression des nationalistes poussa Boris Eltsine à encadrer
Andreï Kozyrev d’un homme expérimenté et qui a servi sous
Gorbatchev. Cette nomination est assez symptomatique d’un
revirement conservateur à partir de 1993-1994. Un cran en
dessous, on distingue Gorgi Mamedov, un homme dont Talbott dit
qu’ils ont en commun un héritage musulman (Mamedov étant la
version slavisée de Mohammed). La discussion entre Mamedov et
Sacirbey du 20 Septembre 1995 reflète bien les échanges
diplomatiques entre la Russie et les Etats-Unis à cette1 Robert H. Donaldson, Joseph L. Logee, The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests, Fourth Edition, 2009, 114. 2 Un témoignage vidéo de Vitaly Churkin qui explique brièvement les négociations aboutissants à ce « succès » diplomatique : http://www.firstpost.com/topic/person/vitaly-churkin-churkin-in-bosnia-video-JNiiYv9yoxo-61544-2.html
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 52 -
période. Le premier dit à Mamedov qu’il est donc l’un des
leurs puisqu’il est musulman, Mamedov répliqua qu’il était de
Bakou. Sacirbey s’exclama et dit qu’il est donc plus
communiste que musulman. Mamedov continua et dit qu’il y a
beaucoup de Musulmans et beaucoup de communistes en Russie, ce
à quoi Sacirbey répondit qu’il y a environ vingt millions de
musulmans et qu’il n’a donc rien à craindre d’eux. Mamedov
répliqua « peut-être est-ce pourquoi nous avons peur de vous 1». A la
Douma, le député et président du Comité mixte sur les Affaires
étrangères et les relations économiques du Soviet suprême,
Yevgeny Ambartsumov fut l’auteur de nombreuses déclarations au
sujet de la guerre de Bosnie, celui-ci regrettait que chacune
des positions russes soit identique à celles des Américains2.
Le renouvellement du personnel diplomatique fut donc limité et
n’eut lieu que dans une période très courte, il convient
d’insister sur la longévité du ministre des affaires
étrangères, Andreï Kozyrev, qui survécut à son impopularité
jusqu’en 1995.
II.5] Le temps de la redéfinition des priorités
stratégiques : changement de doctrine militaire
et diplomatique.La Russie en 1991 est un Etat sans Constitution, qui, bien
que sans principes institutionnels clairement définis, se1 La retranscription en anglais de cet échange est disponible sur Internet :http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB171/ch06.pdf2 Izvestia, June 29, 1992, 3.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 53 -
fonde sur le rejet de l’ancienne URSS et par la conviction,
notamment au sein des élites russes, qu’un ralliement au
libéralisme économique et à un système démocratique
s’imposent. Tout reste donc à transformer, voire à créer, de
l’armée au bon fonctionnement de la démocratie en passant par
la libéralisation de l’économie. La période, extrêmement
courte, de décembre 1991 au 12 décembre 1993, date à laquelle
fut adoptée par référendum la Constitution de la Fédération de
Russie, est riche en nouveaux concepts stratégiques et en
discussions, qu’Igor S. Ivanov, ministre des affaires
étrangères russe en 1998, qualifie lui-même de « pointues et
argumentatives 1». Ces discussions portent notamment sur les
intérêts stratégiques russes, « les intérêts vitaux » ainsi
que le concept de « monde multipolaire » qui devaient
permettre à la Russie renaissante de retrouver l’influence qui
était la sienne avant l’émergence de l’hyper puissance états-
unienne. A ces premiers phénomènes, Igor S. Ivanov ajoute une
autre caractéristique propre à la période, « la privatisation de
l’ensemble des secteurs concernant les relations internationales qui étaient formelle
sous contrôle gouvernemental, c’est le cas dans l’économie et la coopération
commerciale, l’investissement, les échanges culturels et scientifiques etc. 2». C’est
avec enthousiasme et espoir que la Russie s’engage sur le
chemin d’une libéralisation, qui, selon ses dirigeants et en
premier lieu Boris Eltsine, devait attirer les investisseurs
étrangers en grand nombre. Economiquement, la Russie prend un
virage radicalement libéral, et cette idée, bien que
1 “pointed and argumentative”, Igor Ivanov, The New Russian Diplomacy, p. 32 “The privatization of whole sectors concerning foreign relations”, Igor Ivanov, Op. cit., p. 11.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 54 -
vigoureusement combattue par le parti communiste, est
largement acceptée par les élites russes au pouvoir dans la
première moitié des années 1990.
La formation d’une politique étrangère russe cohérente est
donc concomitante à l’établissement d’un ordre socioéconomique
nouveau, volontairement libéral. Les enjeux stratégiques, eux,
n’ont pas connu la même unanimité dans leur appréciation. Il y
a clairement une ambivalence entre une hostilité manifeste
vis-à-vis du bloc occidental, une vision catalysée dans le
bureau de l’Etat-major où les généraux Pavel Gratchev et
Rodionov se succèdent entre 1992 et 1997, et la volonté de
rejoindre un rang équivalent à celui de l’URSS qui permettrait
à la Russie de demeurer un acteur incontournable dans les
sommets internationaux, et ce même au détriment d’intérêts
nationaux russes. Igor Ivanov l’affirme, l’intérêt de la
Russie est de se porter garant des Russes de l’étranger et de
changer la politique russe vis a vis de l’Europe de l’Est et
Centrale1, mais ce qui réellement affecte la rédaction d’une
nouvelle doctrine militaire c’est la nécessité de redéfinir la
notion de menace. Existe-t-il des adversaires menaçant
l’existence même de la Russie ou des ses intérêts vitaux ?
Quels sont-ils ? Comment combattre et restreindre cette
menace ? Quel rôle donner à l’utilisation de l’arme
nucléaire ? La fin d’un monde manichéen, d’un monde divisé en
deux blocs bouleverse complètement la notion de menace, de
bien et de mal. L’ennemi d’hier devient le modèle idéologique
1 “It was necessary to defend the rights of Russians who now found themselves outside Russia’s borders, and to lay a new political foundation for relations with Central and Eastern European countries”, Igor Ivanov, The New Russian Diplomacy, p.13.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 55 -
à suivre. Les réponses à ces questions vont diverger, deux
lignes vont s’opposer au sein du ministère de la Défense
provoquant ainsi une paralysie et un retard considérable dans
l’adoption de ce texte qui n’a eu lieu que le 2 Novembre 1993
par décret présidentiel1. Les deux priorités énoncées
concernent « l’étranger proche », zone stratégique s’il en
est, dont l’objectif, à terme, serait de rétablir l’influence
russe par d’autre biais que l’impérialisme communiste mais à
des degrés plus ou moins équivalents. L’autre priorité réside
dans la « menace » ressentie concernant l’élargissement de
l’OTAN à l’Est. Pour beaucoup de dirigeants russes
traditionalistes ayant exercé des fonctions pendant l’URSS,
l’OTAN est le vestige du passé, il n’existait qu’en raison du
Pacte de Varsovie, oubliant ainsi que l’OTAN a vu le jour bien
avant le Pacte de Varsovie, le 4 Avril 1949. C’est le cas de
Rodionov, qui était à la tête d’un groupe important et très
influent au sein de l’administration militaire2 qui soutenait
que les principales directions stratégiques en matière de
défense sous l’URSS devaient être conservées, avec le maintien
des Etats-Unis comme ennemi et l’augmentation en conséquence
de l’armement stratégique, autrement dit nucléaire. Cette
position reste toutefois minoritaire au sein du Conseil de
Sécurité en 1993 qui considère de manière réaliste une
réduction des forces combattantes et une redéfinition des
menaces réelles3. Dès 1992 il apparaît très nettement dans le
1« Fondements de doctrine militaire de la Fédération de Russie », Krasnaïa Zvezda, 19 novembre 1993. 2 Yves Boyer et Isabelle Facon, La politique de sécurité de la Russie, entre continuité et rupture, Ellipses, 77.3 Kraznaïa Zvezda, 28 janvier 1997.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 56 -
« Concept de sécurité militaire des Etats membres de la CEI »
que la « menace d’une guerre mondiale engageant l’arme nucléaire est très peu
probable actuellement ». Il reste cependant « un grand danger à voir
apparaître des conflits militaires ou autre débouchant sur des guerres locales 1».
En cela l’approche militaire et stratégique traduit une
nécessité imposée par le contexte, l’armée russe doit être
réformée et cela avant même qu’une doctrine ne soit clairement
énoncée. Il s’agit sans doute d’une première réponse à
l’absence, à priori, de cohérence dans la politique étrangère
de la Russie. Se subdivisant en trois parties : politique,
militaire et économique, le « Concept de sécurité militaire
des Etats membres de la CEI » insiste dans sa partie militaire
sur l’importance des conflits d’ordre conjoncturel, sont pris
en exemple le conflit en Yougoslavie, le Haut Karabakh,
l’Abkhazie et le Tadjikistan. Ces conflits périphériques
devaient entraîner une riposte immédiate de la part de Moscou
pour maximiser les chances d’une résolution pacifique du
conflit. Ce document montre que la Russie reconsidère son
approche vis-à-vis de l’Occident, Pavel Gratchev écrivit
d’ailleurs « que la confrontation militaire entre l’Est et l’Ouest avec sa
considérable composante nucléaire et qui se nourrissait de l’existence même des
arsenaux nucléaires stratégiques et substratégiques énormes accumulés pendant la
guerre froide a été éliminée au cours des dernières années 2». Pavel Gratchev
redéfinit la notion de menace autour du terrorisme « qui inquiète
toute la planète », du nationalisme et des haines religieuses car
il craint que « l’Humanité ne se débarrasse pas aussi vite qu’elle le
1 Ibid.2 Nezavisimaïa Gazata, 8 juin 1993.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 57 -
souhaiterait de ce fardeau hérité du passé 1». Pourtant, l’armée russe
dans la première moitié des années 1990 demeure très largement
inadaptée aux contraintes et aux défis ainsi énoncés dans ces
doctrines. Ces inquiétudes liées à l’espace post-soviétique
vont de pair avec la diminution des craintes concernant une
agression de la Fédération de Russie, ainsi, la Russie ne
« considère aucun Etat comme son ennemi ». On peut relever également
dans les Fondements de la doctrine militaire de la Fédération
de Russie que « la menace immédiate d’une agression contre la Fédération de
Russie, a, dans les conditions actuelles, fortement diminué». La guerre de
Bosnie n’est pas une réelle menace pour la Fédération de
Russie, son impact et sa perception par les élites militaires,
politiques et diplomatiques nous révèlent que plus qu’une
question de sécurité collective il s’agit de maintenir
l’influence de la Russie dans la résolution de conflits
proches de ses frontières. Ainsi, les notions de « sécurité »
et « d’influence » sont adroitement liées par certains
militaires qui craignent qu’avec une redéfinition radicale
des menaces et de la sécurité, l’armée soit saignée à blanc au
profit d’autres secteurs. La guerre de Bosnie a donc été
l’occasion d’interprétations alarmistes sur la menace
occidentale, une manière pour le corps des officiers généraux
de défendre leurs intérêts (économiques et politiques) et ceux
de l’armée.
1 Nezavisimaïa Gazata, 9 juillet 1994.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 58 -
Deuxième Partie : La presse et
l’opinion publique, une perception
déformée ?
I. La formation d’une opinion publique russe,
entre désintérêt et crispations.
I.1] La naissance de l’opinion publique après
la chute de l’URSS.La chute du mur de Berlin et la progressive destruction de
l’ensemble du système communiste vit un premier décalage,
intéressant dans le cadre de la guerre de Bosnie, se créer
entre l’opinion publique russe et les dirigeants russes, les
élites financières et culturelles qui massivement virent d’un
très bon œil la disparition du régime communiste. A l’inverse,
l’opinion publique dans sa majorité fut pessimiste quant à la
disparition de l’URSS. A la fois inquiète de la perte
d’influence de la Russie face aux Etats-Unis et aux grandes
puissances émergentes, préoccupée par la situation économique
de la Fédération de Russie, l’opinion publique s’inscrit, dès
la première moitié des années 1990, dans le pessimisme et la
défiance. Un sondage mené par VIsIOM en 1994 révèle que 76%
des Russes pensent que la chute de l’Union soviétique produit
plus de dommages que de bonnes choses. Seuls 7% pensent le
contraire et 17% d’autres jugent que la chute de l’Empire
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 59 -
soviétique n’a pas de conséquences bonnes ou négatives1.
Paradoxalement, ce sentiment de rejet envers le libéralisme ne
s’accompagne aucunement d’un sentiment d’attachement à l’URSS.
Très peu seraient prêts à se sacrifier pour un retour à
l’ordre ancien, une situation très bien définie par le général
populiste Lebed, « Et l’URSS n’est plus. Ceux qui ne regrettent pas l’URSS
manquent de cœur, mais ceux qui pensent que l’on peut la recréer dans sa forme
originelle manquent d’intelligence 2». Il convint d’examiner ces
chiffres à la lueur des déclarations d’Andreï Kozyrev
d’octobre 1991 lorsqu’il annonça dans Izvestia la volonté des
dirigeants russes à mener la Russie dans le sillon des Etats-
Unis. Un vrai décalage semble exister entre une certaine
« euphorie 3» des leaders et l’attentisme teinté de défiance du
peuple russe. L’URSS n’est plus, et le pays qui le remplace se
cherche des frontières, une constitution et peut-être aussi
une idéologie. A cela l’opinion est sensible, d’autant plus
qu’elle doit se confronter à des crises consécutives, la crise
constitutionnelle de 1992-1993, l’utilisation de la force par
Eltsine pour dissoudre le Soviet Suprême en septembre-octobre
1993, les victoires de l’opposition en 1993 et 1995 et la
guerre de Tchétchénie en 1994. Les difficultés économiques de
la Russie vont en partie la guider à se réfugier dans le giron
américain, les Etats-Unis proposant une aide à la Russie. La
guerre de Bosnie survint donc dans cet environnement déjà
alourdi par les crises et se présente comme le premier défi de
1 Igor Zevelev, NATO’s Enlargement and Russian Perceptions of Eurasian Political Frontiers, EAPC, 2000, 9.2 Ibid, 10.3 Richard Sobel, Eric Shiraev, International Public Opinion and the Bosnia Crisis, Lexington Books, 2003, 136.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 60 -
la diplomatie russe. La société civile prend progressivement
conscience qu’elle peut jouer un rôle dans les décisions
prises par la Russie, cependant l’assimilation de certaines
valeurs « occidentales », ou considérées comme telles (la
démocratie, le libéralisme, le pluralisme…) n’a été en réalité
effective qu’au sein des élites, la guerre de Bosnie montre
bien que les crispations de la Guerre Froide n’ont pas
totalement disparu.
L’attitude du peuple russe pendant la guerre de Bosnie
doit également être jugée par le prisme de la situation
internationale, la question doit donc porter sur le regard que
porte la société civile sur les Etats-Unis et sur l’Europe en
construction. Les réponses apportées à ces questions ont un
impact direct sur la manière d’appréhender une crise telle que
celle de Bosnie. Une première étude intéressante1 prouve que
« l’homo sovieticus » n’est qu’un mythe et qu’en réalité un Russe
n’est pas foncièrement différent en terme de comportement
économique qu’un Américain, leurs attentes diffèrent cependant
de celles des Américains au sujet des problématiques
internationales. Les études ont souvent porté sur
l’élargissement de l’OTAN et sur la relation qu’entretient la
Russie avec son étranger proche, la question bosniaque reste
donc secondaire par rapport à ses problématiques, même si pour
les élites ces sujets peuvent être liés. Pourtant la guerre en
Bosnie fut couverte par des journaux communistes, comme la
1 Robert J.Shiller, Maxim Boycko, Vladimir Korobov, “Popular Attitudes Toward Free Markets: The Soviet Union and the United States Compared”, American Economic Review, 81, N°3, 1991, 385-400.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 61 -
Pravda, le quotidien des communistes fondé en 1912 par Lénine
et
tiré à 150 000 exemplaires ou Izvestia, qui commentèrent
quotidiennement les événements. Les autres journaux firent de
même, avec peut-être moins d’assiduité, une situation que l’on
peut expliquer par la position défendue par les journaux, plus
contrastée et moins critique de l’action de Boris Eltsine. La
couverture télévisuelle fut plus discrète et ménagea plus le
pouvoir que ne le firent les journaux pour des raisons de
conflits d’intérêts entre les magnats de la télévision et le
pouvoir en place. La logique de la diffusion de l’information
se déroule donc, contrairement à aujourd’hui, selon une
logique horizontale : des élites au peuple. L’opinion publique
peut donc difficilement se faire une opinion autre que celle
des élites qui pensent à leur place. Notre méthodologie va
donc consister à partir des élites et des journaux pour
ensuite considérer les convictions et parfois l’indifférence
de l’opinion publique russe.
I.2] La couverture médiatique du conflit
bosniaque.Cette couverture du conflit fut donc en grande partie
l’œuvre de journaux communistes, en comparaison, les journaux
d’analyse comme Argumenty i facty ne publièrent que trois articles
dans la période de 1991 à 19961. Pour des raisons éditoriales,1Richard Sobel, Eric Shiraev, International Public Opinion and the Bosnia Crisis, Lexington Books, 2003, 143.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 62 -
le public ne s’intéressant que très modérément aux affaires
politiques internationales, les articles d’analyse ne sont pas
légions. Nuzgar Betaneli, directeur de l’Institut de
Sociologie du Parlementarisme estima à 10 ou 12% la
population russe active politiquement1. Néanmoins, l’année 1995
est une année décisive, aux yeux de l’opinion occidentale : le
bombardement du marché de Sarajevo le 28 août 1995, révèle la
culpabilité des Serbes dans ce conflit. Cet attentat devient
un argument pour expliquer les raids de l'OTAN en Bosnie,
argument vivement contesté notamment dans le quotidien de
l'Armée russe Krasnaja Zvezda, organe officiel du Ministère de la
Défense, source d’information révélatrice des orientations
politiques du pouvoir central russe sur la sécurité
européenne. Ces contestations prirent de l’ampleur avec les
déclarations du colonel Demurenko, représentant des forces de
maintien de la paix de l'ONU dans le secteur de Sarajevo,
accusant les Bosniaques musulmans d’avoir orchestré cet
attentat. Pour lui, la chance est infime que les Serbes
puissent toucher, en se trouvant à quatre kilomètres de là,
une artère de neuf mètres de large, sans avoir de canons
120mm2. Il contredit ainsi les experts de l’ONU qui dans un
rapport accusaient explicitement les Serbes de cet attentat,
pour lui la trajectoire du tir au mortier ne peut correspondre
à celle invoquée par l’ONU. Il déclara « Personne au monde ne peut
dire que les documents de la Commission onusienne disent la vérité 3». Ces
déclarations jettent le trouble sur l’opinion publique russe
1 Ogonyok, N°12, Mars 1998, 6.2 AFP, 2 septembre, 1995.3 Ibid.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 63 -
d’autant plus que selon le colonel Demurenko, ces documents
falsifiés ont servi la décision politique d’engager la Force
de Réaction Rapide et le bombardement des Serbes. L’ONU ne
tarda pas à réagir en contredisant catégoriquement les
accusations du colonel par leur porte-parole Chris Vernon.
Néanmoins, le débat dura un certains nombre de jours, les
analyses du colonel furent diffusées en boucle sur la chaîne
de télévision serbo-bosniaque et provoquèrent l’ire des
militaires américains. Il est évidemment difficile de juger
l’impact de telles images et de telles informations sur
l’opinion publique russe déjà peu encline à s’intéresser à
l’extérieur, mais il est clair que cela renforça chez
certaines élites russes bien informées l’idée d’un acharnement
contre les Serbes, voire même contre les Russes. L’information
fut d’ailleurs reprise par l’historienne de l'Institut
d'Etudes Slaves et Balkaniques de l'Académie des Sciences de
Russie, Elena Gus'kova, qui écrivit un article dans le journal
Krasnaja Zvezda daté du 1er septembre 1995 et intitulé « L'OTAN
commence la guerre dans les Balkans 1». Sa théorie consiste à
accréditer la thèse d’un complot des Occidentaux visant à
remplacer l’ONU par l’OTAN, et des Musulmans pour qui les
négociations de paix d’étaient pas favorables. Elle souligne
que le Groupe de Contact s’est réuni à Paris et qu’il approuva
les frappes aériennes contre la Serbie. Plusieurs journaux,
comme Vek, qui propose dans la semaine du 8 au 14 septembre
1995, le compte-rendu d'un entretien d'un correspondant de
l'agence ITARTASS avec le colonel Demurenko, tente de montrer
la forte probabilité selon laquelle le bombardement du marché1 Krasnaja Zvezda, 1er septembre 1995, p.3.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 64 -
aurait été mené par les Musulmans et non par les Serbes.
L'article précise aussi que l'enquête privée menée par
Demurenko a immédiatement attisé la colère des structures
onusiennes et musulmanes. D’une manière plus générale, les
déclarations du colonel Demurenko ont interpelés les Russes
sur le sort fait aux Serbes. Il se dégage à la lecture des
principaux journaux russes une critique de « l’unilatéralité »
des décisions de l’ONU contre la Serbie et le manque de
soutien de l’OTAN quand c’est elle qui est attaquée, notamment
lors de l’attaque par les Croates en août 1995 qui
provoquèrent le départ d’environ 300 000 Serbes hors de leurs
terres ainsi que par le bombardement de ces mêmes réfugiés1. Du
côté des journaux communistes, la Pravda dénonça le 7 septembre
1995 en première page « le tabassage des Serbes continue : la barbarie
civilisée 2», le 21 septembre « Entrée interdite aux Serbes 3» et le 26
septembre « Ils mettent la faute sur le dos des Serbes 4». Ces titres,
outre qu’ils insistent sur « l’injustice » dont serait victime
les Serbes, remettent en cause l’action de la Russie dans
cette crise, coupable de ne pas assez soutenir « les frères
slaves ». On peut s’interroger sur la volonté réelle de ses
journaux à alerter l’opinion sur ce qu’il se passe en
Yougoslavie d’un point de vue moral et non politicien. Ces
journaux exercent une sorte de contre-pouvoir, d’opposition
constante et systématique à la politique de Boris Eltsine qui,
jusqu’à aujourd’hui, lui reproche d’avoir maintenu Andreï
1 Ibid. 2 Pravda, 7 septembre 1995, p.1.3 Ibid, 3.4 Ibid, 3.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 65 -
Kozyrev et d’avoir soutenu une politique d’apaisement envers
les Etats-Unis.
I.2] La perception russe de l’OTAN pendant la
guerre de Bosnie par le prisme de la presse
russe et des intellectuels.Le conflit en Bosnie devint progressivement, aux yeux de
la presse russe, comme un enjeu pour l’influence de la Russie
au sein de son « étranger proche » et même au-delà. La presse
russe dénonce ainsi une instrumentalisation du conflit par les
puissances occidentales qui, en intervenant militairement dans
ce conflit, redonnerait un but et une raison d’exister à
l’OTAN. Plus encore, c’est l’élargissement de l’OTAN vers
l’Est qui inquiète les Russes. Ainsi, comme le fait remarquer
Ana Pouvreau, le terme de « terrain de manœuvre » est utilisé
pour désigner la guerre de Bosnie, autrement dit celle-ci ne
serait qu’une répétition générale ou un entrainement en vue
d’une avancée vers l’Est. Cette « paranoïa » se nourrit d’une
réalité géopolitique, Richard Holbrooke confiait en début de
son livre qu’il avait deux objectifs, le premier consistait à
ramener la paix en Bosnie et le second à redonner un but à
l’OTAN qui depuis la fin de la Guerre Froide était contesté1.
Plusieurs articles de la Pravda mentionnent cette expression de
« terrain de manœuvre », le 13 septembre 1995 dans la Pravda2
1 Richard Holbrooke, To end a war, Random House. 1999. 432 p.2 Pravda, 13 septembre 1995, p.7.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 66 -
ou encore dans un article publié dans Krasnaja Zvezda intitulé «
L'OTAN utilise les missiles Tomahawk sur le terrain de manœuvres européen.
L'escalade du conflit bosniaque alarme de plus en plus les Russes 1». La Pravda
du 23 septembre se montre encore plus explicite, « Qui a dégagé la
route à la machine de guerre de l'OTAN? 2», et le 18 octobre « L'OTAN
avance à l'Est 3». Enfin, Krasnaja Zvezda du 6 octobre titre, « L'OTAN
décide ce qu'il faut faire en Bosnie et comment se comporter avec la Russie 4».
L’équilibre précaire de la position russe consistant à blâmer
l’action de l’OTAN pour satisfaire l’électorat nationaliste et
la relative collaboration des dirigeants russes avec les
Américains pendant les premières années de guerre est sur le
point de se briser. La voix populiste et nationaliste enfle
avec le déploiement en juin de la Force de Réaction Rapide et
les bombardements de Zepa et de Srebrenica. La presse, à ce
moment du conflit se scinde distinctement en deux tendances
lourdes, par ailleurs déjà présentes avant que les
bombardements n’aient eu lieu, entre les journaux pro-
occidentaux et slavophiles. Il faut bien comprendre que
derrière ce mot de « slavophile », qui implique une
solidarité, se cache un antiaméricanisme à peine voilé.
L’enjeu pour ces journaux n’est pas tant la dénonciation d’une
injustice faite aux Serbes, qui n’intéresse que peu de gens en
Russie, mais la dénonciation des positions de Boris Eltsine et
d’Andreï Kozyrev en vue d’un changement de pouvoir en Russie.
L’incapacité de l’ONU à prendre en mains les opérations
1 Krasnaja Zvezda, 13 septembre 1995, p.1.2 Pravda, 23 septembre 1995, p.2.3 Pravda, 18 octobre 1995, p.3.4 Krasnaja Zvezda, 6 octobre 1995, p.3.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 67 -
militaires en Bosnie, « faute d’avoir la force de son droit1 » comme le
fait remarquer justement le général Cot, profite à l’OTAN. Une
situation que s’empresse de dénoncer Elena Gus’kova qui, dès
le 1er Septembre, estimait que les organisations
internationales, et en particulier l'ONU, avaient globalement
renoncé à leurs fonctions en faveur de l'OTAN qui prit le
parti des Croates et des Musulmans. Le véritable transfert
d’autorité entre l’ONU et l’OTAN a lieu le 19 décembre 1995,
après de multiples différends, la seconde reprochant à la
première sa « timidité ». Le centre névralgique de la prise de
décision bascule de la politique vers le militaire, ce que
condamnent les Russes par l’intermédiaire de la presse mais
aussi de manière officielle, car un tel basculement remet en
cause l’idée de monde multipolaire.
Elena Gus'kova considère que grâce à la Russie et à
l'Ukraine, on s'était acheminé vers une solution politique de
la crise en Bosnie, tandis que l'Ouest s'était déjà
unilatéralement orienté vers une activation de l'OTAN dans le
but de forcer les Serbes à se retirer par la force. Cette
affirmation ne se base en réalité que sur les succès relatifs
de la diplomatie russe, lors de du retrait des armes lourdes
serbes de Sarajevo en Février 1994, le porte-parole russe
déclara d’ailleurs que « sans un seul tir, sans effrayer personne, sans
mettre la vie de soldats en danger, sans dépenser un rouble, la Russie a
effectivement remporté une bataille importante pour son statut dans le monde 2».1Nicole Gnesotto, « La puissance et l'Europe », Politique étrangère, 1999, Volume 64, Numéro 1, pp. 159-161.2Carey Goldberg, “Yeltsin 'Victory' Gives Russia That Old Superpower Feeling: Bosnia: The Kremlin leader's Sarajevo initiative is a rare foreignpolicy triumph. It offsets failures in former Soviet republics.” Los Angeles Times, 22 février 1994.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 68 -
Ce succès, mis en exergue par la diplomatie russe, ne doit pas
masquer la réalité des pressions exercées par l’OTAN qui
permirent le retrait des armes lourdes. Ainsi, ce sont les
pressions de l’OTAN, ici dénoncées par Elena Gusk’ova, qui
donnèrent un nouveau rôle à la diplomatie russe. Elena
Gus'kova est néanmoins critique du rôle joué par la Russie et
de Boris Eltsine car cette position fut « comme toujours peu claire
et contradictoire 1» et c’est cette ambigüité qui fit que la Russie
fut écartée du règlement de la crise bosniaque. Dans le
conflit bosniaque, Elena Gus'kova considère que l'Amérique
confirme son leadership et dicte les négociations
exclusivement selon sa propre vision du monde. Elle écrit à
cet égard que « l'Occident met à exécution ce qu'il pense. L'idée de la
préservation d'un Etat serbe fort dans les Balkans est exclue de ses projets, d'autant
plus lorsqu'il est question d'une alliance potentielle avec la Russie. Ils conseillent
ouvertement aux Serbes d'abandonner leur rêve d'une Grande Serbie et ils les
préviennent que la crise ne sera pas réglée tant que leur potentiel militaire ne sera
pas détruit 2». Elena Gus'kova cite une déclaration de Warren
Christopher lors d'une conférence de presse: « Les accords que nous
avons atteints ne dépendent pas de l'accord donné par les Russes », et écrit
qu'« à l'Europe toute entière, la démocratie américaine a donné sa leçon selon
laquelle la logique de la force dicte l'obéissance ». Ce qui incite Elena
Gus'kova à conclure, sur le même ton que la Pravda qui titrait
«Aujourd'hui la Serbie, demain la Russie », qu' « il n'est pas difficile de deviner
qui prochainement refusera de se soumettre comme l'ont fait les Serbes... ».
Cette méfiance, manifeste à l’égard de l’OTAN exprimée par les
journaux russes, n’est marginale que par son excès, néanmoins
1 Krasnaja Zvezda, 1er septembre 1995, p.3.2 Ibid.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 69 -
de nombreuses interrogations sur le rôle de l’OTAN sont
portées par des alliés des Etats-Unis comme la France qui par
la voix d’Hubert Védrine déclara que François Mitterrand
« considère l’OTAN comme un organisme militaire efficace, mais d’exécution, et qui
ne doit agir que sur base d’une décision politique1 ». Une défiance
évidemment amplifiée par la difficulté qu’éprouve la Russie à
jouer son rôle de médiateur avec la Serbie du fait de
l’affaiblissement de son armée. Ces différents journaux
évoqués par Ana Pouvreau témoignent d’une volonté d’égalité
entre la Russie et les Etats-Unis, une volonté qui n’est plus
conforme à la réalité. D’une certaine manière, à l’instar de
ce qu’a écrit Hubert Védrine, la crise des Balkans est arrivée
à un moment charnière où ni la Russie ni l’Europe n’ont les
moyens, pour des raisons différentes, l’Europe se cherchant
une identité politique après Maastricht et la Russie
s’employant à faire des réformes libérales pour se
reconstruire, de concurrencer les Etats-Unis devenus seule
hyper puissance. Pour autant la Russie tente d’affirmer son
indépendance, de même que la France, en refusant de se
soumettre inconditionnellement au commandement de l’OTAN.
L’organisation cristallise les critiques au sein des pays
européens mais essentiellement de la Russie qui, par le biais
de l’ancien général Alexander Ivanovich Lebed, réclame la
nécessité d’un contrepoids à celui de l’OTAN, « les sanctions de
l’OTAN poussent les anciens pays de l’URSS, et pas uniquement la Russie, à créer un
nouveau bloc pour les protéger. L’image qui me vient à l’esprit est celle d’un grand
hooligan soul dans un jardin d’enfants. Il est le seul adulte et il pense qu’il peut faire
1 Hubert Védrine, Les Mondes de François Mitterrand, Fayard, 1996, p.652.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 70 -
ce qu’il veut. Le monde a besoin d’un contrepouvoir 1». La menace d’un
élargissement de l’OTAN amène un débat dans la presse sur la
création d’un nouveau système de sécurité en Europe dont la
Russie ne serait pas écartée. Le journal Krasnaja Zvezda s’empara
de ce débat juste après les bombardements de l'OTAN en Bosnie
le 14 septembre dans un article écrit pas Aleksandr Gol'c
intitulé: « L'OTAN scinde l'Europe. Discussions sur la sécurité sur fond de ruines
bosniaques 2». L'article fait référence à une conférence
organisée à Bonn par la fondation Friedrich Ebert et par
l'Académie des Sciences militaires sur le thème de la sécurité
européenne. Cette conférence eut lieu pendant la semaine des
bombardements par l'OTAN en Bosnie. On y parla de la question
de l'élargissement de l'OTAN à l'Est ou de manière plus
voilée, comme le fait remarquer l'auteur, de « l'ouverture à
l'Est ». L'hypothèse de base restant celle de l'OTAN comme
seul garant de la stabilité sur le continent.
I.3 Les débats à la Douma, de la crispation à
l’indignation.De 1992 à 1993, Eltsine s’efforça de passer outre les
tentatives de l’Assemblée visant à influencer le vote de la
Russie au Conseil de Sécurité de l’ONU au sujet des sanctions
économiques et militaires contre la Serbie. Ces critiques de
plus en plus fortes amenèrent Boris Eltsine à dissoudre le
1 Michael O. Beale, “Bombs over Bosnia: the role of airpower in Bosnia-Herzegovina”, School of advanced airpower studies, 1996. 2 Krasnaja Zvezda, 14 septembre 1995, p.3.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 71 -
Parlement en Septembre. La nouvelle Constitution ratifiée en
Décembre 1993 partagea l’Assemblée Fédérale en deux chambres,
la Douma qui compte 450 députés et la chambre haute qui en
compte 178. En 1993, les élections législatives voient Eltsine
arriver en tête avec 175 députés élus contre 125 sièges
occupés par les communistes. Enfin, le parti de Jirinovski, le
LDP, place 64 députés à la Douma, ce qui confère à cette
Assemblée une tonalité antilibérale et très opposée à Eltsine.
Le rôle joué par la Douma dans la prise de décision en termes
de politique étrangère doit être discuté. Pour beaucoup la
période Boris Eltsine a correspondu à l’avènement d’une
politique étrangère russe plus « démocratique ». L’éclatement
des acteurs et le rôle de l’opinion publique a été ainsi
souligné, mettant en lumière le chemin démocratique parcouru
par ce jeune pays en comparaison de son aîné communiste.
Ainsi, Lukin souligna que la politique étrangère russe était
« plus ouverte, plus conflictuelle, et un plus grand nombre d’acteurs avec des
intérêts différents qui n’avait pas encore maitrisé l’art bénéfique de l’interaction
mutuelle 1». Le jeu démocratique et le jeu de l’élection avaient
pour but d’amener Moscou à prendre des décisions concertées et
à empêcher l’autoritarisme. L’intérêt porté par les Russes aux
affaires extérieures demeure néanmoins limité, même en période
d’élection. Une première explication pourrait résider dans les
réformes économiques entreprises par Igor Gaïdar qui
malmenèrent une grande partie de la population, les poussant à
s’intéresser bien plus à leurs affaires qu’à celles engageant
la Russie hors de sa sphère d’influence. L’absence
1 Lo Bobo, Russian Foreign Policy, Reality, Illusion and Mythmaking, Palgrave Macmillan, 2002, 27.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 72 -
d’organisations sociales explique également la difficulté
qu’éprouvèrent ceux qui souhaitaient se faire entendre. D’une
manière générale les décisions de politique étrangère
concernant la Bosnie ne furent que très peu dictée par la
« pression populaire », de même que le succès du parti de
Jirinovski aux élections de 1993 peut s’expliquer, certes par
la défiance envers la politique étrangère pro-occidentale de
Boris Eltsine et d’Andreï Kozyrev, mais surtout par la peur
des réformes économiques. La Douma, dite chambre basse, a donc
ce rôle d’amplificateur de l’opinion, voire même de
déformation, d’instrumentalisation. Alex Pravda définit son
rôle dans la prise de décision en politique étrangère comme
étant « moins un corps exerçant une responsabilité reconnue que comme un
forum articulant et amplifiant les opinions qui affecte le climat politique dans lequel
les décisions politiques sont prises 1». Toutes les tentatives de la Douma
pour prendre le pas sur l’Administration pour influencer les
décisions prises en politique étrangère n’ont néanmoins pas
abouti et ont, au contraire, plutôt affaibli celle-ci. Eltsine
n’a que peu consulté les autres organes pour conduire les
discussions avec ses interlocuteurs ou pour signer des
traités.
La Douma, bien que peu influente en réalité, est une
source d’inquiétude pour les Américains, car en se faisant
l’écho des nombreux journaux le Parlement russe rejette
fortement l’expansion de l’OTAN à l’Est et les mesures visant
à sanctionner la Serbie. Ce rejet pourrait affecter les
relations même entre Bill Clinton et Boris Eltsine car, comme
le signale Dimitri Gornostayev dans le journal Nezavisimaya Gazeta1 Ibid, 29.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 73 -
« les Républicains ont toujours réagi plus calmement à Moscou que les
Démocrates 1». Pour lui, les élections de mi-mandat côté
américain pourraient, si elles tournaient à l’avantage des
Démocrates, refroidir les relations entre le Congrès américain
et la Douma. Lukin, alors président du comité aux Affaires
étrangères du Parlement, déclara cependant que Washington
ferait moins attention qu’avant à l’impact des décisions
prises en politique étrangère sur les députés de la Douma. Les
exemples sont nombreux où la Douma tenta d’influencer la
politique étrangère interne à la Russie voire même à l’Europe
et aux Etats-Unis.
En 1995, M. Glotov (invité spécial de la Russie) prit la
parole le 9 Juin au Conseil de l’Europe pour énoncer les
recommandations de la Douma au sujet du conflit bosniaque2. Le
plan de la Douma à ce stade du conflit consiste en plusieurs
points. Le premier concerne la Serbie qui « s’abstiendra de toute
action hostile à l’égard des forces de maintien de la paix des Nations unies. Tous les
otages seront libérés et l’artillerie lourde évacuée […]. Simultanément sera instauré
un moratoire relatif au bombardement des positions serbes par l’aviation de l’OTAN,
tandis que les enclaves musulmanes sous protection de l’ONU seront démilitarisées,
et un contrôle établi sur toute tentative de livraison d’armes aux Musulmans et aux
Croates 3». Ces premières dispositions montrent bien la volonté
de la Douma à influencer le conflit dans le sens serbe alors
que du côté américain, la stratégie de « fin de partie » de
Tony Lake met l’accent sur des sanctions plus fermes à l’égard
1 Steven Erlanger, « The Election and the Kremlin”, The New York Times, 13 Novembre 1994. 2 Compte rendus des débats, session de 1995 (troisième partie), Tome III, séances 17-24, 26-30 juin 1995, p.676. (Disponible sur internet)3Ibid.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 74 -
des Serbes et sur la levée de l’embargo qui pour le moment
favorisait plutôt les Serbes. Deuxièmement, le Parlement russe
propose une trêve entre les belligérants à durée indéterminée,
pour faire gagner du temps aux Serbes de Bosnie. Le troisième
point met sur la table des négociations de paix « sous l’égide du
groupe de Contact entre Karadzic et Izetbegovic avec l’éventuelle participation de
Milosevic et Tudjman 1». Cette demande est particulière et
révélatrice à plus d’un titre, tout d’abord cette volonté de
négocier montre que les députés russes rejettent toute
tentative de renversement de la situation militaire, une
conception qui s’oppose à celle de Richard Holbrooke qui
considère qu’une négociation ne pouvait avoir lieu qu’après
une avancée militaire significative des forces croates et
bosniaques. Le choix des interlocuteurs interpelle, pour la
Russie ces négociations doivent avoir lieu entre Karadzic,
poursuivi par un mandat d’arrêt international et Izetbegovic.
Milosevic et Tudjman, ayant pourtant des responsabilités dans
ce conflit ne pourraient être que consultés et seulement s’ils
le désirent. Dans ce refus d’internationaliser le conflit, le
parlement russe fait le pari d’un arrangement local, niant
toutes implications d’acteurs extérieurs. Quatrièmement, la
Serbie devra accepter la division territoriale de la Bosnie
comme base aux négociations et celles-ci devront respecter
l’égalité des droits des participants. Les structures
constitutionnelles devront être négociées en même temps que
les négociations de frontières. Lors des négociations à Dayton
les Américains procédèrent bien différemment, Richard
Holbrooke sectionna les négociations en six parties et procéda1Ibid.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 75 -
par « petits pas » dans le but de parvenir à un découpage du
territoire selon le principe dogmatique du 49/51. Les Russes
demandent également comme condition sine qua non au commencement
des négociations l’arrêt des sanctions contre Belgrade à
l’inverse de Richard Holbrooke qui utilisa la menace des
sanctions contre Milosevic pour que celui-ci « abandonne » les
Serbes de Bosnie à cause de la pression populaire qui
commençait à se faire ressentir après des années d’embargo. Le
dernier point concerne le désengagement des troupes
bosniaques, croates et serbes pour qu’ils restent sur leurs
positions. En quelque sorte par cette proposition, les Russes
mettent l’accent sur un droit dicté par l’état de fait et non
par une possible remise en cause des avancées militaires
serbes ou croates. Le Président du Conseil de l’Europe
répondit d’ailleurs de manière catégorique aux points émis par
les Russes, « l’heure est venue de comprendre que les partis ne doivent pas être
traités à égalité ; force est de constater qu’il y a un gouvernement légitime et
internationalement reconnu qui se défend contre un agresseur, l’armée serbe de
Bosnie 1». Le relativisme russe qui fut également celui de la
France pendant les premières années de la guerre est combattu
pendant l’été 1995. La nécessité d’identifier un ennemi, de
changer « l’équilibre », de faire basculer la situation
militairement entre les forces serbes et musulmanes, sont
évoqués par des parlementaires du Conseil de l’Europe tel M.
Eörsi pour la Hongrie. Cette intervention au Conseil de
l’Europe montre bien un certain décrochage du Parlement russe
sur la question bosniaque, qui ne semble plus au fait de
l’opinion publique mondiale ni du changement opéré chez les1 Ibid, 678.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 76 -
parlementaires, les diplomates européens et américains. Le
« plan » proposé par M. Glotov n’a, lors de l’été 1995, aucune
chance d’être retenu, car à l’heure où les dirigeants mondiaux
considèrent quasi-unanimement qu’il y a un agresseur, les
Russes tentent de jouer la carte du relativisme pour
contrecarrer une intervention contre les Serbes.
I.4] La Bosnie, quelle place dans les débats
aux élections législatives de 1995.Les élections de la chambre basse, de la Douma, permirent
au parti communiste de confirmer sa progression, déjà sensible
à partir de 1993 où le Parti de Jirinovski avait rassemblé 23%
des électeurs. En 1995 c’est le parti communiste qui profite
de l’impopularité des ministres de Boris Eltsine, mais la
dynamique semble être la même, un rejet de l’occidentalisation
de la Russie. Le rapport de la CSCE1 insiste sur cette montée
des partis nationalistes et communistes pendant ces élections,
notamment du KPRF dirigé par Ziouganov qui rassembla environ
22% des votes. Contrairement à ce que Boris Eltsine a dit lors
de son élection en 1992, le communisme n’est pas mort, il
redevient même la première force du pays. Les commentateurs de
ces élections partagent un avis assez consensuel sur le fait
que les réformes économiques, l’inflation et la chute du
rouble ont probablement amené les Russes à suivre une autre
voix que celle que le Président Eltsine proposait. La place de
1 “The Russian Duma Elections” 17 Décembre 1995, 104ème Congrès, 1ère Session.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 77 -
la Bosnie dans ce débat est donc mineure d’autant plus que la
situation en Tchétchénie est préoccupante, néanmoins elle
occupe une place non négligeable lorsque les adversaires de
Boris Eltsine souhaitent critiquer la « soumission » russe aux
intérêts américains. Avant ces élections Boris Eltsine prit le
parti de critiquer ouvertement son ministre des affaires
étrangères, Andreï Kozyrev, sans pour autant demander sa
démission. Conscient de l’impopularité de son ministre des
affaires étrangères, de l’échec de la guerre de Tchétchénie et
du manque de cohérence de la politique étrangère russe au
sujet de la Bosnie, Boris Eltsine tenta de se démarquer pour
être considéré en homme « au dessus de la mêlée ».
La question des « intérêts vitaux » de la Russie a été
débattue pendant la campagne des législatives, de même que
l’élargissement de l’OTAN et la prépondérance de la position
américaine sur la Bosnie1. Dans la principale revue de
politique étrangère russe, Mezhdunarodnaya Zhizn, quelques
interviews ont été données par les principaux dirigeants des
partis politiques s’affrontant dans cette campagne. Vladimir
Lukin, alors à la tête du Comité aux affaires internationales
à la Douma et député du parti libéral Yabloko (pomme en
russe), qualifia la politique de la Russie en Bosnie comme
étant « un fiasco 2». Alexei Mitrofanov, représentant du parti
LDPR (Parti libéral démocrate) dirigé par Jirinovski, critiqua
l’engagement de l’OTAN en Bosnie ainsi que sa politique
d’élargissement à l’Est, pour lui il s’agit « d’une agression
1 Richard Sobel, Eric Shiraev, International Public Opinion and the Bosnia Crisis, Lexington Books, 2003, 162.2 Mezhdunarodnaya zhizn, N°4, 1995, 24.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 78 -
armée » et exigea un revirement de politique en ce qui
concerne la Bosnie pour une « vrai aide à la Serbie 1». Ce même
homme avait déclaré lors d’une rencontre avec Karadzic en mars
1994 que « les Etats-Unis avaient un intérêt à conserver cette source de
déstabilisation dans le centre de l’Europe 2». Cet intérêt, pour Jirinovski
et Mitrofanov, c’est l’élargissement de l’OTAN,
l’affaiblissement également d’une politique étrangère
européenne qui pourrait faire contrepoids et la volonté
américaine de s’opposer aux Russes. Alexander Shabanov et
Eduard Kovalev, vice-directeur et directeur de la presse du
KPRF (Parti communiste russe), furent également très critiques
à l’égard de la politique étrangère russe en Yougoslavie3. La
multiplication de ces déclarations confèrent à ces élections
une atmosphère de Guerre Froide, tandis que du côté américain,
certains analystes s’interrogent sur la nécessité d’un nouveau
containment envers ce changement radical de politique étrangère4.
Yuri Skokov, un allié du Général Lebed et président du Conseil
National du Congrès des Communautés de Russie (KRO), accusa
Kozyrev pour ce qu’il appela « son absence de politique étrangère » et
indiqua même que pour lui la guerre de Bosnie et
l’élargissement de l’OTAN sont des « menaces majeures 5». Le KRO
fit campagne sur le thème d’une nouvelle Russie, en
réutilisant la célèbre formule de Winston Churchill : « du sang,
1 Mezhdunarodnaya zhizn, N°4, 1995, 14-16.2Sonni Eefron, “In Russia, Bosnia Serb Leader Blasts U.S.”, Los Angles Times ,
3 Mars 1994. 3 Mezhdunarodnaya zhizn, N°4, 1995, 9-12. 4 Michael Mcfaul, “Russia’s Electoral Cycle and Foreign Policy” in Russia’s Many Foreign Policies, p.409. 5 Mezhdunarodnaya zhizn, N°4, 1995, 12-14.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 79 -
de la sueur et des larmes 1». La Russie, selon ce parti politique,
doit pouvoir rester maître de son destin, prônant ainsi une
politique étrangère isolationniste, en rupture avec la
coopération amorcée par Eltsine avec les Etats-Unis et surtout
très nationaliste. Le représentant du parti du gouvernement
Notre Maison la Russie (Nash Dom Rossiya), Sergueï Belyaev,
apporta bien sûr une voix discordante bien que peu audible sur
la Bosnie, celui-ci se contentant de rappeler que la paix en
Bosnie est essentielle et demandant la levée des sanctions
touchant la Yougoslavie2. Yevgenia Albats, journaliste à
Izvestia, prône un isolationnisme différent de celui proposé par
les partis politiques, pour elle la Russie n’a pas d’intérêts
vitaux en Yougoslavie, elle doit donc se désengager du conflit
et retirer ses troupes. Ces déclarations lors de cette
campagne législative ne constituent cependant pas un programme
mais juste des intentions, souvent électoralistes, dont
l’ambition est de démarquer autant que faire se peut les
partis nationalistes et communistes du gouvernement et
d’Eltsine. Pour beaucoup ces élections furent le premier tour
de l’élection présidentielle de 1996, elles marquèrent un
retour en force de la carte nationaliste dont chacun des
partis d’opposition se disputa la légitimité.
1 “Duma Elections Conference Summary”, Belfer Center Programs or Projects, 1996.2 Mezhdunarodnaya zhizn, N°4, 1995, 5-8.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 80 -
II. De « l’homme de la rue », à Vladimir
Jirinovski jusqu’aux mercenaires.
II.1] L’opinion publique russe, l’environnement
international et la guerre de Bosnie.La Bosnie, pour « l’homme de la rue », est un pays qui se
trouve assez loin de leurs préoccupations. La distance entre
Moscou et Belgrade est d’environ 1700 kilomètres, un gouffre,
qui, contrairement aux journaux occidentaux qui titrèrent sur
la proximité de l’horreur et la résurgence des camps de
concentration, ne fut jamais comblé. Rien à voir donc avec les
pays où se trouvent des pieds-rouges, ces minorités russes
vivant dans d’autres pays que la Russie après la chute de
l’URSS. Comment les Russes réagissent-ils face à cette
guerre ? Comme nous l’avons vu de nombreux journaux
s’expriment sur le sujet bosniaque néanmoins il faut se
demander si les lecteurs sont réceptifs à ces articles et
s’ils y accordent une grande importance. A l’évidence le
public n’accorde que peu d’intérêt à ce qui n’apparaît pour
eux que comme un sujet annexe à la politique étrangère globale
de la Russie. Plus généralement on peut affirmer que les
Russes sont peu enclins à s’intéresser aux relations
internationales dans les années 19901. Une étude menée par le
Centre Russe pour l’étude de l’opinion publique montre que 72%
des personnes interrogés considèrent que la priorité est aux
problèmes internes à la Russie tandis que 18% pensent que la
politique internationale prime sur le reste. Dans une autre1 Richard Sobel, Eric Shiraev, International Public Opinion and the Bosnia Crisis, Lexington Books, 2003, 143.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 81 -
enquête de 1994, conduite par le Nouveau Baromètre III, la
question portait ici sur la menace que représentaient huit
pays, une enquête qui aboutit à un très haut pourcentage de
personnes ne sachant pas, par ignorance ou désintérêt pour ces
pays, s’ils représentaient une menace. De même la question de
l’élargissement de l’OTAN, qui on l’a vu préoccupe les élites,
les partis politiques et les journaux, laissent insensible une
grande partie de l’opinion. Nous nous attacherons donc à
considérer les réactions de l’opinion publique russe lors des
crises majeures du conflit, engageant en quelque sorte la
politique étrangère russe. Ce fut le cas au début de l’année
1994 lorsque l’OTAN menaça de frappes aériennes le camp serbe,
le Centre pour la Recherche Sociologique Internationale mena
au même moment une étude sur la menace que représentaient des
frappes aériennes sur la Bosnie. 77% des personnes interrogées
répondirent qu’ils étaient opposées aux frappes aériennes et
même 2/3 approuvèrent les déclarations de Jirinovski
concernant les bombardements qui déclara que si ces attaques
étaient effectivement lancées cela reviendrait à attaquer la
Russie1. Le contexte, celui des menaces aériennes, est
évidemment essentiel pour comprendre ces chiffres, il ne doit
pas pour autant laisser entendre que les Russes sont prêts à
une guerre pour la Serbie, il s’agit plus d’une réponse
émotionnelle et circonstancielle que d’une réponse guidée par
un sentiment proserbe véritablement ancré. Il faut également
ajouter comme motivation principale aux craintes d’un
bombardement, la peur de la guerre en elle-même, la peur de
l’instabilité qui toucha durement la Russie en 1993 et la peur1 Daily Telegraph, 18 Février 1994, 14
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 82 -
que ces bombardements déclenchent un véritable mouvement de
soutien aux ultranationalistes russes. Ceux qui s’opposent aux
frappes aériennes ne sont donc pas forcément des soutiens de
Jirinovski ni même du parti communiste, mais des personnes
inquiète que ces bombardements servent de prétexte à un
engagement plus fort de la Russie alors que celle-ci a déjà
fort à faire avec la Tchétchénie. Deux raisons qui viennent
confirmer cet argument, tout d’abord les élections
législatives de 1995, qui, certes consacrèrent le parti
communiste (KPRF), mais qui montrèrent une forte décrue de la
vague Jirinovski après les élections de 1993, ce qui
laisserait à entendre qu’un parti belliciste ne pouvait pas
remporter la majorité des suffrages. Le second argument
concerne l’ancrage du pacifisme, ou plutôt du refus de guerre
dans une grande partie de la population. Une étude menée juste
après l’invasion de la Tchétchénie montre que les Russes sont
majoritairement1 opposés à cette guerre, ce qui, malgré de
grandes différences entre ces conflits, exprime la grande
défiance des Russes face à la menace d’une guerre. Néanmoins,
il faut également souligner que les Russes n’obéissent pas,
pour ces questions tout du moins, à une logique idéologique ou
dogmatique, ainsi en octobre 1992 une étude menée par Romir
(institut de recherche russe) montra que 47% des personnes
affirmaient que si la sécurité de la Russie était en jeu elle
devrait envoyer des troupes dans « l’étranger-proche », tandis
que 40% répondirent que même en de telles circonstances la
1 Pour quatre Russes soutenant la guerre de Tchétchénie, environ dix s’y opposent, Lee Hockstader, “Russian General Says He Refuses to Attack; Leader of Drive on Rebel Chechens Is Embraced by Women Guarding City”, The Washington Post, 17 Décembre 1994.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 83 -
Russie ne devrait pas intervenir et 14% n’exprimèrent aucune
opinion sur le sujet1. Cette étude nuance le « pacifisme »
russe qui aurait tendance à s’effriter lorsque la vie des
« pieds-rouges » est en jeu, tandis qu’à l’inverse en Bosnie,
ni les intérêts vitaux de la Russie ni des Russes de
l’étranger, à l’exception des mercenaires, ne sont en danger.
D’autre part, le contexte de 1992 n’est pas le même que celui
de 1995, la chute de l’URSS est récente et la nouvelle Russie
fédérale pas encore stabilisée, la crainte de voir l’étranger
proche menacé n’était donc pas une menace insensée.
Plus précisément, la question de la guerre de Bosnie fut
abordée en septembre 1995 par le Centre russe pour la
Recherche sur l’Opinion Publique et sur environ 1500 réponses
sur un ensemble de questions portant directement sur la Bosnie
pour savoir quel camp ils supportaient. Environ un tiers
répondit qu’il ne supportait aucun camp, 21% exprimèrent leur
sympathie pour les Serbes, et 2% pour les Croates et les
Musulmans2. Le fait qu’il y ait une part aussi importante de
personnes qui ne s’engagent pas dans le conflit démontre une
absence d’intérêt, par difficulté d’accès à l’information
(journaux trop spécialisés, une éducation trop faible etc.)
mais aussi par absence de raisons valables à s’engager.
L’année 1995 diffère en cela assez largement de février 1994
où la tension en Bosnie fut maximale avec l’engagement d’un
contingent russe à Sarajevo ce qui peut nous amener à conclure
que le sentiment proserbe était exacerbé par la tension
1 National Journal, “Opinion Outlook: Views on National Security”, Vol. 25 N°11, 654, 13 Mars 1993. 2 Richard Sobel, Eric Shiraev, International Public Opinion and the Bosnia Crisis, Lexington Books, 2003, 145.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 84 -
internationale. Concernant la manière dont la Russie doit
s’engager dans le conflit, une série de questions fut
également posée1, pour 30% des personnes ayant répondu,
l’engagement de la Russie dans les Balkans devait se faire
sous forme d’aide humanitaire et d’assistance économique, bref
d’un engagement qui ne met pas la vie de Russes en jeu. 8%
pensent que la Russie doit agir conjointement avec l’ONU et
l’OTAN et 4% préconisent un blocus économique contre les
Serbes de Bosnie, ce qui contraste fortement avec le très
faible taux de Russes (6%) qui souhaitent que la Russie
approvisionne les Serbes de Bosnie en armes. Ces chiffres
mettent en lumière que les Russes sont partagés, lorsqu’ils
ont un avis sur la question, entre soutenir les Serbes ou au
contraire condamner leur attitude mais ils s’accordent sur une
conduite plutôt mesurée de la Russie dans les Balkans. L’étude
ne révèle pas non plus si des Russes étaient favorables à un
engagement armé de la Russie, par le biais de troupes ou
d’officiers. Environ 12% des personnes interrogées manifestent
une attitude clairement pro-occidentale en soutenant soit une
action conjointe de l’OTAN, de l’ONU et de la Russie (8%) soit
par un embargo (4%), ce qui démontre un intérêt pour la
question bosniaque et sans doute un soutien à la politique
d’Eltsine pendant les premières années du conflit. La grande
majorité de ceux désirant un soutien humanitaire pensent
néanmoins que cette action doit se faire de manière
indépendante des grandes organisations mondiales. En
conclusion, la majorité des personnes interrogées ne savent
1 Richard Sobel, Eric Shiraev, International Public Opinion and the Bosnia Crisis, Lexington Books, 2003, 147.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 85 -
quelle position la Russie doit adopter (52%), cette majorité
silencieuse n’indique pas de positions fortes sur le conflit
ni même de sympathie pour un camp en particulier. Leurs
préoccupations demeurent proches de la vie quotidienne, des
questions économiques et sociales, reléguant les questions de
géopolitique et de relations internationales au second plan.
Pourquoi, cet « homme de la rue », ordinaire et sans intérêt
particulier pour les relations internationales, s’est-il
parfois mué en mercenaire prêt à combattre pour la cause
serbe ? Quels ont été les facteurs de ces engagements ?
II.2] Jirinovski, pensée et engagements. Les résultats du parti libéral-démocrate de Jirinovski
(23%) aux élections de 1993, provoquèrent un choc pour la
Russie et pour l’étranger. En Russie ces résultats montrèrent
un rejet, minoritaire mais virulent, de la politique
intérieure et extérieure de Boris Eltsine. Les invectives de
Vladimir Jirinovski ont surtout séduit les militaires
nostalgiques d’un ordre ancien1. Pour les Américains, les
« bons » résultats de Jirinovski aux élections rappellent que
la Russie n’est pas encore un Etat démocratique stable et que
l’hypothèse d’une arrivée au pouvoir de Jirinovski en Russie
remettrait en cause les principales tentatives de
rapprochement esquissées depuis la fin du régime soviétique
(Partenariat pour la Paix, accord START II etc.) ainsi que les
1 Stephen J. Blank, “Does Russian Democracy has a future?” Earl H. Tilford, Jr. Editors, 1994, 5.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 86 -
aides économiques accordées par Washington. La guerre de
Bosnie n’est pas le facteur principal des résultats de
Jirinovski aux élections, mais plus la ramification d’un arbre
plus imposant. Néanmoins, c’est bien la guerre de Bosnie qui
va lui permettre d’exprimer son anti-occidentalisme et
particulièrement lors de sa visite à Bieljina en Bosnie côté
serbe, le 31 Janvier 1994 où il déclara notamment qu’« étant
leader du parti d’opposition, le parti qui a gagné les élections, je veux avertir tous les
gouvernements des pays occidentaux que bombarder une ville en Bosnie signifie
déclarer la guerre à la Russie 1». Cette déclaration, qui fit date,
n’a pas de réel écho dans l’opinion, car nous l’avons vu, en
1995 les sondés n’envisageaient pas l’intervention militaire
comme une solution crédible mais préféraient toujours une
solution humanitaire qui n’engageait pas véritablement la
Russie. Jirinovski utilise donc les circonstances pour à la
fois se poser en alternative crédible à Boris Eltsine et pour
passer des messages populistes à l’adresse des
ultranationalistes, des panslavistes et des militaires qui se
sont groupés sous sa bannière. C’est lors de cette visite que
Vladimir Jirinovski rencontra les principaux leaders serbes de
Bosnie comme Karadzic et qu’il plaida contre le « génocide des
Serbes 2». Lors de sa visite en Bosnie il se rendit également
dans la ville de Vukovar qui fut détruite par les tirs des
paramilitaires serbes en 1991. On ne peut pas dire que le
voyage de Jirinovski passant par la Bulgarie et la Slovénie se
soit passé sans encombre, les autorités ont essayé d’écourter
1 “Zhirinovsky Threatens War Over Bosnia”, Los Angeles Times, 31 Janvier 1994. 2 John Pomfret, “Russian Ultranationalist Spreads Hate Message in Bosnia”, Bangor Daily News, 1er Février 1994.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 87 -
son passage dans chacun de ces pays. Il est intéressant de
noter que son voyage a été organisé par un homme d’affaire
viennois natif du Monténégro, Petar Ivanovic. Les propos de
Jirinovski sur la guerre de Bosnie illustrent assez bien sa
conception du monde, Serbes et Russes ont en commun d’avoir
des terres irrédentes où résident des minorités et leurs buts
est de faire la jonction, de créer ou de recréer un espace
commun. Jirinovski continua à brandir la menace d’une guerre
contre les Etats-Unis, notamment le 7 Juin 1995 où il déclara
à la Douma que l’engagement de l’OTAN dans les Balkans serait
le prélude à une troisième guerre mondiale1.
Ce politicien, souvent comparé à Adolf Hitler2, n’était au
début des campagnes législatives remarqué que pour ses
« bouffonneries » et ses bravades envers l’OTAN et les Etats-
Unis. Les résultats aux élections de 1993 révèlent que sa
pensée a un certain écho dans l’opinion publique, il convient
également de se demander si sa pensée et son influence ont
infléchi, voire radicalement changé, la politique étrangère
d’Andreï Kozyrev. En réalité la pensée de Jirinovski rejoint
sur certains points celle de Samuel Huntington, bien que le
premier nommé n’emploie guère le mot de civilisation. Leurs
conceptions d’un monde divisé en sphères d’influence pour
Jirinovski et en civilisations pour Samuel Huntington
s’opposent à celle d’un monde libéral et globalisé. Comme au
1 The Jamestown Foundation, “Zhirinovsky: NATO involvement in Bosnia a prelude to World War III”, Volume: 1 Issue: 29, 9 Juin 1995.2 “Like Adolf Hitler -- another energetic "geopolitician" with whom he is often compared -- Zhirinovsky views political life in purely Darwinian terms, recognizing neither God, nor conscience, nor morality”, John B. DUNLOP “Zhirinovsky's World”, Journal of Democracy, Volume 5, Number 2, April 1994.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 88 -
temps de la guerre froide, Jirinovski pense que le monde
devrait être partagé en sphère d’influence où les Etats ou des
coalitions d’Etats pourraient agir comme bon leur semble. Le
cas de la Bosnie, bien que ne faisant pas partie de l’ancienne
URSS, s’inclurait dans un ensemble slave et orthodoxe où les
Etats-Unis et l’Europe n’auraient pas droit d’accès. Ses
déclarations et ses conceptions ont influencé la politique
étrangère d’Andreï Kozyrev qui déclara le 21 Janvier 1994 dans
le Washington Post que le Kremlin défendra les droits non
seulement des Russes mais aussi des russophones en dehors des
frontières de la Russie et que l’Ouest doit accepter la
compétence de la Russie dans l’Union soviétique comme une
réalité. Dans son livre The Final Thrust South, on peut remarquer
des passages intéressants sur la supériorité de la religion
orthodoxe sur les autres religions, notamment musulmanes « ce
sera une nouvelle Russie… dans laquelle la religion Orthodoxe jouera un rôle
dominant. Nous ne devons pas permettre que des religions étrangères brisent la
conscience de notre jeunesse, parce que cela ne rapproche pas les gens, et même
cela interfère avec leur compréhension du monde autour d’eux. Nous devons aider la
religion Orthodoxe russe à atteindre sa juste place 1». Pour lui la Russie
doit s’étendre jusqu’au Sud car c’est le « destin de la
Russie 2», ce qui correspond à une stratégie expansionniste de
la Russie dont la Bosnie ne serait qu’une étape.
1 “Zhirinovsky in his own words, excerpts from The Final Thrust South”, des passages traduits par Ariel Cohen et Salvatori Fellow, 4 Février 1994, p.72 “Zhirinovsky in his own words, excerpts from The Final Thrust South”, des passages traduits par Ariel Cohen et Salvatori Fellow, 4 Février 1994, p.6.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 89 -
II.3] Les mercenaires russes, des aventuriers à
la recherche de l’Orthodoxie perdue.Au-delà des discours et des pensées, des mercenaires
Russes se sont engagés dans ce conflit, quelques centaines
selon des estimations forcément difficiles à vérifier et même
700 selon le tribunal de la Haye1. La question doit porter sur
la responsabilité des kontrackiniki (mercenaires) dans la guerre
de Bosnie et dans les crimes de masse qui s’y déroulèrent. Ces
militaires russes ont tout d’abord été engagés dans les forces
aériennes car l’armée serbe manquait de pilotes compétents. Le
rapporteur spécial du Secrétaire général de l’ONU, Enrique
Bernales Ballesteros, ne découvrit qu’en 1994 que des Russes
servaient dans l’armée serbe depuis 1991, ce qui indique d’une
certaine manière leur discrétion sur le terrain et sans doute
leur faible nombre. L’année 1995 marque sans aucun doute un
tournant dans l’engagement des mercenaires russes dans la
guerre de Bosnie, on constate d’ailleurs que l’Assemblée
Générale des Nations Unies traita le sujet le 30 Juin 1995,
dans une lettre adressée au Rapporteur spécial de la
Commission des droits de l'homme sur la question de
l'utilisation de mercenaires par le Vice-Premier Ministre et
Ministre des affaires étrangères de la République de Croatie2.
Cette préoccupation en Bosnie va de pair avec la tendance
observée dans le conflit du Haut-Karabakh où environ 3000
combattants de l’ex-URSS ont combattu. L’ONU dispose
1 Stanislav Varykhanov, “The Fate of Russian Volunteers in Bosnia”, Pravda, 13 Octobre 2003. 2 Assemblée Générale des Nations Unies, « Droit des peuples à l’autodétermination », 50e Session, 29 août 1995.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 90 -
d’informations assez précises quant à l’arrivée de combattants
russes en Bosnie, « Il est désormais prouvé que plusieurs ressortissants
russes ont été déployés à Mirkovci, leurs frais de voyage leur ont été remboursés, les
services qu'ils avaient rendus sur le plan militaire ont été rétribués et l'octroi d'un
terrain dans la région leur a été promis 1». Mirkovci, cette ville du sud-
est de la Croatie est connue pour avoir été le lieu où 107
Serbes avaient été tués par des Oustachis pendant la seconde
guerre mondiale.
Plusieurs officiers russes qui auparavant servaient dans
la FORPRONU se sont engagés aux côtés des Serbes de Bosnie à
Vukovar dans la République serbe de Krajina, c’est le cas du
colonel Vladimir Loginov qui, en 1995, est devenu conseiller
militaire de l’armée serbe de la République de Krajina affecté
à la formation et à la planification des opérations armées. De
même, le colonel Aleksandar Chromchenko, qui auparavant
commandait des troupes de la FORPRONU dans l'ex-secteur Est,
se trouve dans la région. En fin d’année 1993, ils avaient été
démis de leurs fonctions pour avoir vendu de l’essence
appartenant à la FORPRONU aux Serbes sur le marché noir2, ils
fournirent même des armes aux Serbes en échange de voitures de
luxe. Le colonel Chromchenko retourna en Russie et fut
remplacé par un autre colonel russe, tandis que le colonel
Loginov, bien que démis de ses fonctions, resta sur place,
mais dans le camp serbe. L’exemple de ces deux officiers pose
la question de la pertinence d’envoyer un contingent russe
dans un secteur particulièrement sensible et interroge sur la
1 Ibid. 2 Dusko Doder, “Russian commander in Croatia abruptly replaced 2 officers lose U.N. posts amid charges of corruption and collusion with Serbs”, The Baltimore Sun, 21 Février 1993.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 91 -
fiabilité des troupes russes et leur prétendue proximité avec
les Serbes. La volonté de l’OTAN et des Américains d’associer
les Russes dans la guerre de Bosnie puis dans le processus de
maintien de la paix se heurte à des dérives minoritaires de la
part de militaires russes, auxquels on pourrait ajouter les
cas d’Aleksandar Skrabov, ancien membre de l’infanterie navale
russe qui, après la fin de son mandat dans la FORPRONU devint
commandant des kontrackiniki de l’armée de la République Sprska
(VSR), jusqu’à sa mort sur le champ de bataille, près du
village de Gomolje en 19941. Ce fut le cas également du
Général russe Pereljakin qui, après avoir été démis de son
poste, fut nommé conseiller de la division de Baranja de
l’armée de Krajina (RSK). On constate qu’il s’agit
essentiellement d’officiers, de très hauts gradés ou des
vétérans ce qui, malgré le faible nombre de désertions et de
revirements, donne de l’importance à ces mercenaires qui par
ailleurs, selon l’ONU, sont à l’origine des pires atrocités,
« ce sont ces groupes qui ont commis les pires excès lors du nettoyage ethnique des
populations non serbes qui étaient demeurées dans les territoires occupés et dont ils
se sont acharnés à saccager le patrimoine culturel et historique 2». Il
semblerait que les Américains et l’OTAN aient choisi
d’associer les Russes aux combats davantage pour des raisons
d’ordre géopolitique que pour des raisons opérationnelles, les
revirements des hauts gradés n’ont d’ailleurs pas été ébruités
et la Russie n’a pas été « punie » puisque les colonels ayant
manqué à leur devoir ont été remplacé par des officiers1 Ali M. Koknar, “The Kontraktniki : Russian mercenaries at war in the Balkans”, Bosnian Institute, 14 Juillet 2003. 2 Assemblée Générale des Nations Unies, « Droit des peuples à l’autodétermination », 50e Session, 29 août 1995.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 92 -
russes. D’autre part, ces désertions sont révélatrices de la
rupture entre Boris Eltsine et son armée, comme nous l’avons
vu auparavant avec les résultats aux élections de Vladimir
Jirinovski, la plupart des militaires hauts gradés sont des
opposants à la politique étrangère conduite par Boris Eltsine
et Andreï Kozyrev. Il est donc surprenant de constater que des
hommes, n’ayant pas les mêmes opinions que les membres pro-
occidentaux du gouvernement, soient ainsi envoyés dans une
région aussi sensible. On peut même se demander si ce n’est
pas par pénurie de hauts gradés loyaux à Boris Eltsine que des
opposants ont été ainsi diligentés, ou même à une incapacité
des services de renseignement à comprendre les véritables
raisons pour lesquelles certains militaires ont accepté la
mission de la FORPRONU.
Les informations les plus nombreuses sur ces
« militaires » proviennent de la Pravda, mais à cause de son
parti-pris pour la cause de ces volontaires russes il est
difficile d’évaluer exactement la véracité des propos,
d’autant plus qu’ils se basent sur le récit très subjectif de
Mikhail Polikarpov, « historien » et participant à la guerre
de Bosnie1. Les troupes de mercenaires russes comptèrent
environ quatre unités. La première unité s’est formée en
Septembre 1992, non loin de la ville de Visegrad. C’était
Valery Vlasenko qui était le commandant de cette unité. La
seconde unité, les Tsarists Wolves, fut formée en novembre de la
même année et commandée par Alexander Mukharev, surnommé
« l’As ». Il y avait également une compagnie de Cossacks
1 Stanislav Varykhanov, “The Fate of Russian Volunteers in Bosnia”, Pravda, 13 Octobre 2003.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 93 -
commandée par Alexander Zagrebov, un ancien soldat de la
guerre d’Afghanistan, comme beaucoup des soldats russes partis
en Bosnie. Enfin, le dernier groupe fut commandé par le
Lieutenant Alexander Alexandrov qui avait combattu pendant les
guerres de Transnistrie et du Haut-Karabakh. En mai 1995, un
groupe de Russes et de Grecs sont arrivés dans la région de
Gacko-Avtovac à l’invitation du commandant de l’armée de
Sprska, dans le but d’organiser une « brigade internationale »
qui comptait environ 150 personnes1. Contrairement à ce
qu’affirme Mikhail Polikarpov, les volontaires russes sont
bien des mercenaires payés 200 marks allemands par mois et
dont les frais de transports ont été pris en charge par les
Serbes, on sait également que la paye de ces mercenaires
évoluait en fonction du territoire dont ils prenaient
possession. Ils étaient principalement engagés dans les
milices des « Tigres d’Arkan » de Željko Ražnatović et dans
les « Aigles Blancs » de Vojislav Šešelj. Ces mercenaires,
Grecs et Russes, ont eu un rôle dans la guerre de Bosnie où la
majeure partie des combats ont été le fait de milices, mais le
faible nombre de Russes s’étant engagés dans la bataille
rejoint le constat que cette solidarité fut faible en
comparaison des analyses mettant l’accent sur la proximité
religieuse et culturelle de ces pays.
1 Ali M. Koknar, “The Kontraktniki: Russian mercenaries at war in the Balkans”, Bosnian Institute, 14 Juillet 2003.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 95 -
Troisième Partie : Les relations russo-
américaines pendant la guerre de Bosnie,
l’association sans l’intégration.
I. La Russie conciliante.
I.1] L’ancrage de la Russie dans le camp
occidental et dans les institutions
internationales.La chute du mur de Berlin annonce une nouvelle ère pour la
Russie, une ère où l’idéologie ne serait plus déterminante
dans la conduite des affaires étrangères. L’effacement de
l’idéologie n’apparait cependant pas pour la première fois
lors du changement de régime politique, elle apparaissait déjà
en filigrane de la politique étrangère de Brejnev, mais la fin
de l’opposition entre capitalisme et communisme signifie de
nouvelles relations entre la Fédération de Russie et les
Etats-Unis. Ces derniers ont bien compris que plus la Russie
se stabilisait, plus elle était susceptible de s’arrimer à
l’ancien camp capitaliste. Des aides économiques ont été
octroyées par des pays occidentaux atteignant 113 milliards
entre 1990 et 1993 dont environ la moitié provenait
d’Allemagne1. Ces aides ont un impact sur la politique
étrangère de la Russie, difficile en effet de percevoir des1 Vladimir Baranowski, Russia and Europe: the Emerging Security Agenda, Sipri, 1997, 373.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 96 -
aides et pour autant continuer à se montrer critique envers
ceux qui investissent et qui aident. La notion de coopération
avec l’Ouest, développée par Mikhaïl Gorbatchev et sa Nouvelle
Pensée Politique, prend un autre tournant avec l’avènement de
la nouvelle Fédération de Russie le 1er janvier 1992. La
nouvelle administration dirigée par Boris Eltsine va
s’employer à transformer radicalement la Russie de telle sorte
que la coopération avec les Etats-Unis ait un même intérêt :
le triomphe du libéralisme et de la démocratie. Il s’agit ici
de bien comprendre, dans une démarche d’analyse inter
gouvernementaliste et libérale, que la politique extérieure
d’un Etat, et plus particulièrement nous l’avons vu au sujet
de la Russie, est guidée par des marchandages et des intérêts
internes. La politique extérieure de la Russie est donc « un
jeu à deux niveaux 1», une lame à double tranchant, car en plus
de la recherche d’un accord avec les partenaires
internationaux il faut également composer avec les attentes de
la société. Le rapprochement opéré par Eltsine vis-à-vis des
Etats-Unis a été un pari gagnant dans sa confrontation avec
Gorbatchev, le rejetant à la droite de l’échiquier politique.
Néanmoins, ce rapprochement doit-il être substantiel ou
conjoncturel ? La politique étrangère russe d’Andreï Kozyrev
est profondément liée à la réforme interne de la Russie, qui,
pouvant se transformer en Etat capitaliste, libéral et
démocratique aurait avec les Etats-Unis des intérêts
similaires : un monde plus transparent, plus démocratique et
plus libéral.
1 Dario Battistella, Théories des relations internationales, 3e éd. Mise à jour et augmentée, Paris : Presse de Sciences Po, 2009, 422.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 97 -
La première priorité pour Kozyrev est donc de faire entrer
la Russie « comme une grande puissance dans la famille des démocraties les
plus avancées avec des économies de marché, les dénommées sociétés
occidentales 1». Auparavant, Kozyrev avait même déclaré que les
Etats-Unis étaient « l’allié naturel de la Russie 2». Une déclaration
surprenante car à la lueur de leur histoire commune, Russie et
Etats-Unis n’ont été des alliés que de circonstance, pendant
les Guerres Mondiales et pendant la crise du Canal de Suez.
Cette attitude pro-atlantiste trouve cependant un écho dans
certains journaux, comme dans Argumenty i Fakty qui, durant cette
période (1990-1993), adopta une position atlantiste3. On
constate pourtant un décalage entre le traitement des journaux
et l’opinion publique, ainsi l’attitude pro-occidentale est
plus marquée chez une certaine génération (30-40 ans) tandis
que chez les jeunes et les plus âgés on remarque que
l’attitude est plutôt hostile aux Etats-Unis4. Ce constat peut
s’expliquer par la période Gorbatchev que certains ont vécue
comme une amorce de réformes visant à rapprocher l’URSS des
Etats-Unis, alors que les plus âgés y ont vu une menace pour
la souveraineté de l’URSS. Quant aux plus jeunes, qui n’ont
pas connu la période Gorbatchev, cette méfiance vis-à-vis des
1 Andreï Kozyrev, « Preobrazhenie ili kafkianskaia metamorfoza : Demokraticheskaia vneshniaia politika Rossii i ee prioritety », Nezavisimaia Gazeta, 20 août 1992.2 Andreï Kozyrev, Izvestia, 16 janvier 1992.3 Ce journal publia 54 articles sur les Etats-Unis, 32 articles contenaient des commentaires positifs sur les affaires, la politique et la situation interne aux Etats-Unis, 17 articles traitaient des célébrités américaines et seulement 9 articles étaient critiques sur la situation aux Etats-Unis, notamment les problèmes sociaux, cf. note 12 in Richard Sobel et Eric Shiraev, International Public Opinion and the Bosnia Crisis, Lexington Books, 2003, 169.4 Sergei Guriev, Maxim Trudolyubov et Aleh Tsyvinski, “Russian Attitude toward the West”, Centre for Economic and Financial Research at New Economic School, décembre 2008, 7.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 98 -
Etats-Unis peut s’expliquer par la difficulté des réformes
économiques à se mettre en place, n’ayant pas connu les crises
de la Guerre Froide, ils ne voient que l’aspect négatif d’un
rapprochement avec les Etats-Unis. Pour Kozyrev, bien que
conscient qu’une attitude pro-occidentale n’était pas la plus
populaire, l’important était de poursuivre la Nouvelle Pensée
de Gorbatchev consistant à soutenir les organisations
internationales telles que l’ONU ou la CSCE jugées
démocratiques, tandis que l’OTAN n’est pas reconnu comme étant
une sphère de discussion possible. Cette position légaliste de
la Russie sur les questions de sécurité internationale, visant
à toujours respecter les institutions, est surtout guidée par
le refus de laisser le champ libre à l’OTAN. Comme le souligne
Malcolm Neil, « il y eut un très fort écho de la Nouvelle Pensée Politique dans la
politique du gouvernement russe : l’attitude de Gorbatchev au sujet d’un conflit
régional avait été imprégnée de l’idée qu’en négociant, et essentiellement
politiquement, des solutions pourraient être trouvées pour faire cesser les conflits à
l’intérieur ou entre des Etats jusqu’à ce qu’une paix aboutisse. Eltsine et Kozyrev
ont semblé adopter une position similaire au sujet de la guerre de Bosnie1». Le
refus des sanctions et de s’engager dans le conflit est donc
tout autant la conséquence d’une certaine amitié pour les
Serbes, d’une crainte que l’OTAN profite de la guerre de
Bosnie comme un alibi à son élargissement, que d’une
conviction profonde en la diplomatie usant des canaux
légalistes et institutionnels. Dans sa volonté de coopération
la Russie a affirmé cependant, par la voix d’Andreï Kozyrev,
qu’il lui fallait participer à des opérations de maintien de
1 Malcolm Neil et Alex Pravda, Internal factors in Russian foreign policy, OUP Oxford,24 octobre 1996, pp. 57-69.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 99 -
la paix sous l’égide des Nations Unies, car pour lui, en tant
que grande puissance, la Russie a le devoir et la
responsabilité de travailler avec les autres grandes nations
pour maintenir la paix1. Dans les faits la participation de la
Russie dans les opérations de maintien de la paix après la
chute de l’URSS a été assez faible en comparaison de ses
moyens.
Entre la volonté russe de montrer un visage conciliant aux
Américains et aux Européens et la peur de s’engager trop
profondément dans une alliance ou des traités, s’esquisse une
troisième voie, celle de la « fausse-rupture ». Une rupture
d’apparence, qui, nous l’avons vu est essentiellement le fait
d’une pression intérieure. Cette pression n’éloigne que très
provisoirement la Russie de ses alliés américains et
européens. Cet éloignement est d’ailleurs plus le fait de
déclarations, de menaces que d’éléments concrets, tandis que
la signature du Partenariat Pour la Paix le 22 juin 1994 est
un pas supplémentaire de la Russie vers une collaboration, ou
tout du moins une cohabitation pacifique avec l’OTAN. La
signature de ce partenariat est d’autant plus surprenante
qu’elle fait suite à de très vives protestations de la part
des Russes après les bombardements des 10 et 11 avril 1994.
Que faut-il en conclure ? Il existe en réalité deux
hypothèses, soit la guerre de Bosnie, même lors d’événements
inquiétants pour les Russes, n’est pas une priorité pour la
diplomatie russe, soit, la collaboration avec les Etats-Unis
est plus importante que tout le reste. L’année 1994, surtout
1 Andreï Kozyrev, “Russia and Human Rights”, Slavic Review, N°51, 1992, pp. 287-293.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 100 -
après la victoire de Jirinovski et sa visite en République
Sprska, est l’année où la Bosnie occupe la place la plus
importante dans les préoccupations russes sur la sécurité
internationale avec la guerre de Tchétchénie et il convient de
rappeler que la signature du Partenariat Pour la Paix a été
retardée en grande partie du fait des bombardements de l’OTAN
en Bosnie, ce qui provoqua d’ailleurs une certaine stupeur
chez les diplomates américains pour qui la signature devait
être imminente en décembre 1994. On peut donc supposer que
malgré la gravité de la situation en Bosnie, Boris Eltsine a
choisi l’alliance qui lui semblait la plus naturelle ; celle
avec les Etats-Unis. La recherche de l’accord avec l’Ouest,
même tacite, est la clé de la politique étrangère russe en
Bosnie, même dans les moments de tensions il n’y eut pas de
rupture à l’instar de ce qui se passa pendant la crise du
Kosovo.
I.2] La diplomatie russe en Bosnie : les Etats-
Unis, l’OTAN et l’ombre du Parlement.La guerre de Bosnie représente un défi pour la communauté
internationale et pas seulement pour la Russie, il s’agit d’un
conflit international qui, de par sa proximité avec l’Europe
de l’ouest et les nouvelles Républiques de l’ex-URSS constitue
un enjeu majeur pour les diplomaties du monde entier. Les
sommets du G-7 de Vancouver et de Tokyo au printemps 1993
avaient pour but de traiter de différents problèmes, mais
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 101 -
comme le signale Strobe Talbott, « la plus sévère et récurrente source de
tensions était le conflit en Bosnie 1». Le constat, dès 1993, est que le
gouvernement de Boris Eltsine et peut-être lui-même se
trouvent en parfait désaccord sur la solution à appliquer pour
que la tension s’apaise entre les Serbes, les Croates et les
Bosniaques2. L’un des principaux points de désaccord concerne
l’usage de l’OTAN pour préparer et soutenir une intervention
militaire. Les Russes pensent que toute action doit passer par
l’ONU tandis que déjà en 1992, pendant la présidence de Bush,
l’Administration américaine ne considère que rien, ni la
négociation ni même l’intervention de l’ONU, sinon des
bombardements aériens ne peuvent faire plier les Serbes. Les
mémoires de Strobe Talbott sont intéressantes en ce qu’elles
proposent une analyse du refus russe selon le même paradigme
civilisationnel que Samuel Huntington : la solidarité panslave
et la peur de l’Islam. Avec le recul, il semble et nous avons
tenté de le démontrer que ces facteurs ne correspondent pas
aux convictions de Boris Eltsine et d’Andreï Kozyrev. Le refus
de la Russie, c’est avant tout un refus sur la méthode et une
véritable inquiétude, celle de l’élargissement de l’OTAN qui
pourrait être un angle d’attaque pour les forces nationalistes
de Russie. D’ailleurs, Strobe Talbott le reconnaît, la
préoccupation de Kozyrev est la dimension intérieure et le
risque d’une instrumentalisation d’une action de l’OTAN par la
coalition rouge et brune. Cette considération explique par
ailleurs les revirements successifs de la diplomatie russe sur
1 Strobe Talbott, The Russia Hand, Random House, 2002, 72.2 Ibid, “But Yeltsin’s government and the U.S differed over what to do aboutMilosevic and the warlords he was abetting in Bosnia”, 73.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 102 -
ce dossier car, si on analyse l’ensemble des votes de la
Russie au Conseil de Sécurité de l’ONU, on constate que
l’année 1992, l’année avant les élections législatives, la
Russie a voté la plupart des résolutions de l’ONU1. La seule
contradiction à cette logique de vote est la résolution votée
par le Parlement russe le 26 juin 1992 critiquant les
sanctions contre la Serbie, l’embargo remettant en cause des
traités de vente d’essence à la Serbie2. En 1993, la situation
intérieure russe change avec la pression des communistes, les
Américains veulent que le Conseil de Sécurité de l’ONU vote
une résolution contre le non-respect de la no-fly zone
avertissant les Serbes qu’en cas de non respect de cette zone
l’OTAN procéderait à un bombardement, alors qu’Andreï Kozyrev
craint qu’une telle résolution fragilise encore plus Boris
Eltsine. Il déclara même que si la Russie accepte de voter la
résolution cela pourrait coûter des voix à Eltsine dans son
combat contre la procédure d’impeachment au deux tiers et souleva
la menace de la possible arrivée d’un « Milosevic russe au
Kremlin 3».
130 mai 1992 : A l’initiative des Etats-Unis, la Russie vote les sanctions économiques contre la Serbie.10 juillet 1992 : La Russie vote l’exclusion de la Yougoslavie de la CSCE (Conference for Security and Cooperation in Europe) 19 Septembre 1992 : La Russie vote la Résolution 777 du Conseil de Sécuritéde l’ONU qui déclare que la Yougoslavie a cessé d’exister en tant que République Fédérale de Yougoslavie, cependant la résolution ne reconnaît pas l’existence, encore moins l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine.Octobre et novembre 1992 : La Russie approuve l’investigation concernant laviolation des lois internationales sur les droits de l’Homme et vote le renforcement de l’embargo contre la Serbie et le Monténégro. Cf. Chronologie en annexe. 2 Stanley Meisler, “Oil Embargo Against Serbia Pushed at U.N.”, Los Angeles Times, 29 mai 1992. 3 Strobe Talbott, The Russia Hand, Random House, 2002, 74.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 103 -
Dans ses mémoires Bill Clinton raconte son soutien à Boris
Eltsine, malgré la préférence de celui-ci pour Georges Bush1.
Pour le président américain il s’agit d’un axe essentiel de la
politique étrangère américaine, un changement de président
pour augurer un changement de régime en Russie. Le sommet de
Vancouver était l’occasion pour Bill Clinton de convaincre
Boris Eltsine de voter positivement à la résolution de l’ONU
concernant la Bosnie, mais sa préoccupation majeure fut que le
président russe ne sombre pas alors qu’il était sous le coup
d’une mesure d’impeachment. La discussion porta donc
essentiellement sur le montant de l’aide américaine pour
renforcer les structures russes. En réalité, réaliser à la
fois le sauvetage de la Bosnie et celui de Boris Eltsine s’est
révélé contradictoire. Le président russe refusa de voter les
sanctions contre la Serbie, non par conviction, bien au
contraire, mais parce que dit il « les Serbes sont communistes et ils
sont en train de travailler avec nos communistes qui me tiennent à la gorge 2».
L’abstention de la Russie lors du vote de la résolution du
Conseil de Sécurité accentuant les sanctions contre les Serbes
constitue néanmoins l’aveu que la Russie de Boris Eltsine et
d’Andreï Kozyrev est bien plus proche des Etats-Unis que de la
Serbie. Les sanctions contre la Serbie n’eurent pas
immédiatement l’effet escompté puisque les Serbes continuèrent
à attaquer Srebrenica et Andreï Kozyrev s’obstina dans une
diplomatie non agressive vis-à-vis des Serbes et à défendre le
plan Vance-Owen, « Andreï Kozyrev a entamé dès ce week-end une semaine
décisive en s'entretenant avec les médiateurs Lord Owen et Thorvald Stoltenberg,
1 Bill Clinton, My Life, Knopf, 2004, 504.2 Strobe Talbott, The Russia Hand, Random House, 2002, 74.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 104 -
réaffirmant sa détermination à mettre en œuvre le document approuvé par les
Nations unies et appelant à un renfort des forces de l'ONU sur place pour y
parvenir 1». Ce plan prenait acte de l’impossible partition en
trois cantons de la Bosnie-Herzégovine proposée par le plan
Carrington-Cutileiro, il gardait cependant comme principe la
partition ethnique en dix provinces (trois « serbes », trois
« croates », trois « bosniaques », et une « mixte » pour
l’agglomération de Sarajevo) et la décentralisation
(Présidence collégiale, gouvernement central, tribunal
constitutionnel2). Chaque province aurait eu un gouverneur
appartenant à l’ethnie « dominante » et deux vice- gouverneurs
représentants des minorités. La Bosnie-Herzégovine aurait été
démilitarisée et une force de police internationale aurait été
introduite pour faire respecter les accords. La Bosnie aurait
été sauvegardée sans toutefois posséder de « personnalité
juridique internationale » ou le pouvoir de signer des accords
avec des États étrangers.
Pour les Américains, Strobe Talbott et Bill Clinton en
tête, ce plan était trop compliqué et trop indulgent sur le
sort réservé aux Serbes. Radovan Karadzic accepta le plan de
l’ONU mais conditionna son effectivité au vote du Parlement
serbe de Bosnie qui rejeta finalement le plan Vance-Owen à
96%. Boris Eltsine et Vitaly Churkin se trompèrent sur la
volonté de Karadzic à faire accepter le plan de paix aux
Serbes de Bosnie, ils ne virent pas la manœuvre de Karadzic
qui, tout en tentant de montrer sa bonne volonté, ne pouvait
accepter un plan de paix quel qu’il soit sous peine de perdre
1 Edouard Van Velthem, « Les Balkans à l’heure russe », lesoir.be, 18 mai 1993.2 Xavier Bougarel, Bosnie anatomie d’un conflit, p.147.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 105 -
son autorité sur les milices serbes. Ce faisant le défenseur
de la partition, Boris Eltsine, considérant qu’il s’agissait
de la solution la plus viable1, ménageait l’opposition en
Russie, mais ce soutien resta lettre-morte puisqu’aucune aide
militaire ne fut apportée par la Russie avant février 1994.
Cet épisode montre bien néanmoins que la diplomatie russe ne
marche pas sur ses deux jambes, d’un côté les militaires et le
ministre de la Défense Pavel Gratchev préoccupés par la
possibilité d’un Etat musulman en Europe, « les Turcs et les Iraniens
gagneraient un appui sur le continent 2» et de l’autre Andreï Kozyrev
qui détestait tout autant l’idée d’un bombardement à
l’encontre des Serbes que de supporter Milosevic. Alors que le
ministre des Affaires étrangères russe veut encore croire dans
le plan de paix de l’ONU, Strobe Talbott a pour ambition de
lui faire adopter une ligne plus dure dans l’intérêt de la
Russie, « c’était dans les intérêts de la Russie de nous rejoindre dans des
représailles contre les Serbes, c’est la seule façon d’arrêter leurs assauts et de
prévenir l’escalade de la guerre à toute la région 3» dit il, ce à quoi
répliqua Kozyrev « c’est assez difficile comme ça d’avoir des gens qui nous
disent ce que l’on doit faire même si cela ne nous plait pas. N’ajoutez pas l’insulte à
la blessure en nous disant que c’est dans nos intérêts d’obéir à vos ordres 4».
Andreï Kozyrev sait pourtant pertinemment que la situation
n’est pas tenable, d’un côté les Serbes poursuivent les
massacres (l’attaque d’un stade à Sarajevo fit une douzaine de
morts et une centaine de blessés) et de l’autre la position
1 TV serbe, 29 juin 1993 et à la radio russe 30 Juin 1993 (SWB, SU/1730, 2 juillet 1993)2 Strobe Talbott, The Russia Hand, Random House, 2002, 75.3 Ibid., 76.4 Ibid., 76.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 106 -
russe qui, par peur de la réaction des communistes et des
nationalistes, se retranche dans l’abstention, « les enjeux de la
politique intérieure priment sur la politique étrangère russe et rendent impossible
pour lui (Kozyrev) de soutenir les bombardements aériens 1».
Le 4 juin 1993, avant le sommet d’Athènes, les Russes
durent convenir qu’un déploiement d’hommes pour maintenir la
paix était nécessaire, mais par le biais de l’ONU. La
résolution 836 fut votée2, son objectif était de sanctuariser
six enclaves musulmanes (Srebrenica, Zepa, Gorazde, Tuzla,
Bihac et Sarajevo) et en conséquence l’ONU décida de l’envoi
de 1000 hommes supplémentaires, qui n’eurent cependant
l’autorisation de tirer qu’en cas de légitime défense. En un
mot il s’agissait d’introduire la paix dans un territoire
hostile sans faire usage de la force alors que celle-ci est
omniprésente. En réalité, l’ONU ne fut pas comme le réclamait
les Russes le seul organe de décision, l’OTAN eut un rôle de
coordination primordial à jouer car c’est la seule
organisation internationale à avoir une structure militaire
intégrée. Le 30 juin, au sommet d’Athènes, le président russe
menaça, après avoir pourtant voté la résolution décidant de
l’envoi de troupes supplémentaires en Bosnie, d’un veto de la
Russie si quelqu’un « insiste sur l’usage de la force, sur la levée de l’embargo
sur les armes 3». Cette déclaration faisait écho à l’échec du vote
d’une résolution concernant la levée de l’embargo sur les
armes soutenue par les Etats-Unis. Cependant, la Russie par
son représentant à l’ONU Iulii Vorontsov maintient son soutien1 Ibid., 76.2 Conseil de Sécurité des Nations Unies, S/RES/836 (1993), 4 juin 1993. 3 M. Iusin, « Sovet Bezopasnoti OON otkazalsia sniat’ embargo na postavki oruzhiia bosniiskim musulmanam » Izvestia, 1 juillet 1993.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 107 -
à la résolution dans le sens entendu par les Américains,
« Dorénavant, tout tentative d’attaque militaire, de tirs ou de pilonnage des zones de
sécurité, toute incursion dans ces zones de sécurité et toute obstruction à l’arrivée de
l’aide humanitaire sera arrêtée par l’utilisation de tous les moyens, dont l’usage de la
force 1». L’éclatement et l’incohérence de la diplomatie russe
pendant le conflit est révélé par les prises de position
contradictoires des représentants de Boris Eltsine. La réserve
d’Andreï Kozyrev est ainsi balayée par les propos de
Vorsontsov, ainsi que par le vote russe aux résolutions 770 et
836 qui dans un sens large autorisent, selon les Américains,
le bombardement des positions serbes pour protéger les zones
de sécurité et les casques bleus. La décision impliquant des
frappes aériennes doit être prise par le secrétaire général de
l’ONU après une consultation du Conseil de Sécurité expliqua
Karasin, toute action doit être véritablement l’œuvre de l’ONU
et non de l’OTAN.
Malgré le glissement opéré par la diplomatie russe vers
encore un peu plus de conciliation vis-à-vis des Etats-Unis,
la préoccupation majeure reste l’importance que pourrait
prendre l’OTAN suite à une opération en Bosnie. La crainte
pour les Russes réside dans le fait que les résolutions 770 et
836 puissent être détournées de leur sens strict pour
légitimer une action préventive contre les Serbes. Le 9 août
1995 l’OTAN pris le contrôle des opérations, à la fois de
contrôle et de commandement, réduisant le rôle de l’ONU à
celui de forum de discussion mais non de décision. L’ONU
transféra son autorité à l’OTAN le 19 décembre 1995 mais de
manière non officielle la plupart des décisions était déjà1 UN document S/PV.3228, 4 juin 1993, p.46.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 108 -
l’œuvre de l’OTAN durant l’année 1994. Strobe Talbott décrit
d’ailleurs son entretien avec Yuri Mamedov avec lequel il
aborda le sujet de l’expansion de l’OTAN qui, selon lui,
devrait avoir lieu dès le début de l’année 1994. Maemdov
répliqua que pour lui il fallait d’abord « se concentrer simplement
sur les travaux difficiles – comme la Bosnie et l’Ukraine – et pas nous attribuer une
Mission Impossible 1». Ceci montre bien qu’au sujet de la Bosnie,
la Russie est prête à négocier, mais que l’élargissement de
l’OTAN constitue pour elle une véritable menace. Malgré les
protestations de Moscou la perspective de bombardements
aériens eut un effet sur les troupes serbes de Bosnie qui
durent se replier de Sarajevo. Ce fut la première fois que
l’ONU et l’OTAN menacèrent réellement d’intervenir
militairement, et la Russie, bien que désapprouvant le
transfert d’autorité de l’ONU à l’OTAN se rallia à la position
américaine.
I.3] La Russie au sein du Groupe de Contact, de
la coordination diplomatique à la coordination
militaire.A Genève le 27 avril 1994, Alain Juppé, ministre français
des affaires étrangères, rencontre Andreï Kozyrev2 pour parler
de l’avenir de la diplomatie américano-russe et européenne au
sujet de la Bosnie. Il évoque la création du Groupe de Contact1 Strobe Talbott, The Russia Hand, Random House, 2002, 95.2 Discours du 27 avril 1994 à Genève, http://discours.vie-publique.fr/notices/943127100.html
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 109 -
et justifie sa création en ces termes, « [la création du
Groupe de Contact] va permettre d'unifier les positions entre les grandes
puissances intéressées par la situation en Bosnie, c'est-à-dire les Américains, les
Russes, les Européens, les Nations unies, de façon à progresser vers un règlement de
paix. Les bases de ce travail sont connues, ce sont les grands principes qui figurent
dans le plan d'action de l'Union européenne, enrichis par l'accord croato-musulman
du 18 mars et par le cessez-le-feu intervenu à la suite de la médiation russe en
Croatie dans la Krajina 1». Juppé définit deux objectifs, la
cessation des hostilités et la création d’une carte « qui définira
l'implantation de chacune des communautés ». Les Etats-Unis ne sont
pas favorables à une telle diplomatie informelle, « elle offre à
leurs yeux le triple désavantage de laisser sur le bord de la route la diplomatie
américaine, de l’isoler de l’Allemagne et de déplaire aux Bosniaques 2». Pour les
Russes, au contraire, ce Groupe de Contact permet à la Russie
de sortir d’un affrontement avec les Etats-Unis pour
rencontrer le soutien de certains pays comme la France dans la
dénonciation d’une politique étrangère américaine trop
unilatérale. Depuis son succès diplomatique à Sarajevo en
décembre 1994, Moscou s’implique davantage dans la résolution
du conflit bosniaque et cette forme originale de diplomatie
multilatérale, qui sort du schéma classique de légitimation
par l’ONU et du simple outil militaire pour l’OTAN, peut lui
permettre de gagner une influence inédite depuis la fin de
l’URSS. Pour les Américains cela correspond à un changement de
cap, depuis le succès russe de Sarajevo, comme le signale un
diplomate dans le Figaro du 28 avril 1994, les Américains
13 Discours du 27 avril 1994 à Genève, http://discours.vie-publique.fr/notices/943127100.html2 Francine Boidevaix, une diplomatie informelle pour l’Europe, le groupe de contact Bosnie, Fondation études défense, 1997, 51.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 110 -
pensaient « qu’ils trouveraient un accord en s’entendant directement avec les
Russes 1». D’ailleurs, à l’ambassade russe de Zagreb, Peter W.
Galbraith et Vitaly Churkin entamèrent des négociations en vue
d’un cessez-le-feu, conclu le 30 mars 1994. Néanmoins, les
discussions concernant la création d’une Fédération Croato-
bosniaque sur des territoires rétrocédés par les Serbes ne put
aboutir faute d’accord avec les Serbes. Les Russes, malgré
l’avantage qu’ils pouvaient espérer d’une organisation élargie
ne souhaitaient pas avoir à parlementer avec toute l’Europe
séparément, ainsi Boris Eltsine proposa l’idée d’une
conférence internationale à cinq le 24 février 1994, avec les
Etats-Unis, l’Angleterre, l’Allemagne et la France. Une
proposition qui fut rejetée mais qui confirme le retour de la
politique étrangère russe.
Lors du choix des représentants pour chaque pays, la
négociation fut rude, Pauline Neville-Jones souhaitait la
présence de Vitaly Churkin, envoyé spécial de la Russie en
Bosnie, grand instigateur de la victoire diplomatique de
Moscou lors du siège de Sarajevo et de Charles Redman, un
américain ayant rempli la fonction d’observateur auprès de la
Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie. Finalement,
Churkin refusa et ce fut Alexeï Nikiforov qui représenta la
Russie d’avril 1994 à mai 1995 avant d’être remplacé par
Alexander Zotov. Le premier représentant russe est encensé par
les autres représentants du Groupe de Contact, Lord Owen écrit
que « la connaissance du dossier yougoslave par l’expert du ministère des Affaires
étrangères russe, Alexeï Nikiforov était incomparable 2». De son côté la
1 Ibid, 56. 2 Ibid, 66.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 111 -
représentante britannique explique « qu’une part du succès du Groupe
de Contact va à la qualité de la coopération que nous avons eue avec le premier
représentant russe. Il a accepté d’utiliser ses contacts avec les Serbes pour mettre en
œuvre une politique commune. Nous avons eu beaucoup de chance 1». Cette
décision de Moscou d’envoyer un expert aussi reconnu montre
l’importance accordée à cette nouvelle diplomatie initiée par
le Groupe de Contact, en dépit des déclarations publiques
soutenant les Serbes. De par son influence culturelle et son
volontarisme la Russie devint un pivot à même de faire
accepter les décisions prises en amont, notamment grâce à la
France et à Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères
français. Pourtant, le volontarisme dont fait preuve Alexeï
Nikiforov à collaborer avec le Groupe de Contact souligne la
modération des Russes à défendre les Bosno-serbe, au point que
Lord Owen, dans une lettre adressée à Alain Juppé le 6 juillet
1995, expliqua que « Les Russes n’ont pas représenté les idées des Bosno-
serbes avec la même vigueur que les Etats-Unis mettent à défendre les intérêts des
Bosniaques 2». Le Groupe de Contact fut unifié au sujet d’un
découpage territorial de la carte selon des pourcentages 51-49
% en faveur des Bosniaques, malgré des réticences les
Américains finirent par accepter ce plan européen. Mais Ce qui
préserva l’unité du Groupe de Contact c’est avant tout le
sentiment qu’en dehors de ce groupe ad hoc aucune solution ne
pouvait être trouvée de manière unanime. Cette unité se trouva
menacée après le rejet du plan du Groupe de Contact par les
Serbes le 29 juillet 1994, les Russes souhaitaient des
sanctions graduelles tandis que les Américains voulaient au
1 Ibid, 66.2 Ibid, 75.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 112 -
contraire des sanctions immédiates et plus coercitives contre
les Serbes.
L’autre problématique sur laquelle les membres du Groupe
de Contact furent en désaccord concerne l’attitude à adopter
envers Slobodan Milosevic. Certains parlementaires russes
s’entêtèrent, après avoir pourtant voté la résolution sur les
sanctions économiques contre les Serbes le 30 mai 1992, à
demander la levée de toutes les sanctions économiques contre
la Serbie, d’autant plus que celle-ci a rompu officiellement
ses relations avec Pale en juillet 1994. Andreï Kozyrev admit
qu’il y avait des personnes siégeant au Parlement russe qui
défendaient la levée des sanctions, mais il les qualifia de
« têtes-brûlées 1». Moscou chercha à gagner du temps pour faire
accepter son plan de paix à Milosevic, il y eut néanmoins un
vrai paradoxe à reconnaître que la Serbie de Milosevic n’avait
plus de liens avec Pale mais à vouloir encore s’appuyer sur
cet homme pour s’en servir comme d’un pivot. Cette stratégie a
pour intérêt de dissocier clairement Milosevic des Serbes de
Pale, une stratégie reprise par les Américains et leur
représentant, Richard Holbrooke, lors des négociations à
Dayton. Une série de réunions entre août et décembre 1994
furent organisées avec Milosevic par le Groupe de Contact pour
négocier les sanctions à l’égard de la Serbie, aucun accord ne
fut trouvé mais, comme le signale Charles Redman, cette
effervescence fut positive pour l’image de la Russie qui se
montra avec des homologues européens et américains « Les Russes
étaient toujours très désireux de ce genre de réunions. Elles ne résolvaient pas
1 Ray Moseley, “Russian Influence Holds Key To Bosnia”, Chicago tribune, 4 août 1994.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 113 -
nécessairement les problèmes, mais elles procuraient un bénéfice politique à leurs
ministres d’être ainsi vus en travaillant avec leurs partenaires occidentaux 1».
Soutenus par les Européens, les Russes vont réussir à imposer
aux Etats-Unis récalcitrants l’adoption des principes
constitutionnels plus favorables aux Serbes et du principe
fondamental pour Pale qu’il n’y aurait pas de retrait de leurs
troupes avant un accord sur les ajustements territoriaux.
Cette victoire diplomatique ne doit pas masquer le torpillage,
à terme, des négociations entamées par le Groupe de Contact
par les Etats-Unis. Dans leur volonté de puissance et
d’influence sur le continent européen, Washington profita de
la division européenne, pour exiger des sanctions contraires à
toutes négociations. Le fond du problème est que les Etats-
Unis n’ont pas reconnu les solutions proposées par le Groupe
de Contact comme acceptables, ils les ont considéré comme
étant trop européennes, trop russes, et surtout pas assez
américaines. Pourtant le Groupe de Contact permit d’aboutir à
une négociation directe avec Milosevic, une voie qui mena à
Dayton mais qui laissa les autres pays du Groupe de Contact en
dehors des négociations.
I.4] La diplomatie de Richard Holbrooke, quelle
place pour la Russie ?Les bombardements de l’OTAN le 30 août 1995, leur arrêt le
1er septembre et la reprise des frappes aériennes le 5
1 Francine Boidevaix, une diplomatie informelle pour l’Europe, le groupe de contact Bosnie, Fondation études défense, 1997, 85.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 114 -
septembre bouleversent radicalement la diplomatie européenne
et russe. Le Groupe de Contact s’est mué en un Groupe
d’accompagnement à la négociation dirigé par un triumvirat, le
représentant américain Richard Holbrooke, Carl Bildt pour
l’Union européenne et Igor Ivanov pour la Russie, qui était
Premier vice-ministre des Affaires étrangères auprès de
Kozyrev et numéro deux de Vitaly Churkin en 1994. La
négociation directe avec Milosevic a pour conséquence de
sortir les Russes d’une diplomatie éclatée et multilatérale où
ils pouvaient faire entendre leur différence. L’effectivité
des bombardements a également sapé les arguments de la Russie,
prompte à réagir lorsque ceux-ci n’étaient que brandis. La
Conférence de Genève représenta une occasion pour la
diplomatie russe de ne pas donner l’impression qu’elle
abandonnait toute participation au processus de paix,
d’ailleurs Andreï Kozyrev demanda publiquement que la Russie
puisse être coprésidente de la réunion de Genève. Pour Richard
Holbrooke cette prétention à coprésider la Conférence de
Genève interroge sur le rôle que doit jouer la Russie dans le
processus de paix alors que celui-ci a pris une tournure plus
agressive, laisser une place trop importante à la Russie
mettrait, selon lui, en péril le processus de paix du fait de
ses affinités proserbes et l’écarter serait la retrancher dans
un isolement préjudiciable à la perspective d’un élargissement
de l’OTAN. Le négociateur américain juge d’ailleurs que la
volonté de Moscou n’est pas tant de diriger ou de faire
échouer les négociations que de retrouver un prestige, même
symbolique, qui montrerait que la position russe est influente
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 115 -
sur le monde1. Il accepta donc que celle-ci siège comme
coprésidente de la Conférence de Genève à égalité avec les
Etats-Unis et l’Union européenne. La conviction de Richard
Holbrooke rejoint celle de l’Administration Clinton sur
l’importance d’un partenariat russo-américain en vue d’un
accord sur la Bosnie et en vue de la nouvelle architecture de
la sécurité européenne dans laquelle la Russie devra trouver
sa juste place. Du côté américain, certains conservateurs ont
accusé l’Administration Clinton d’être trop tendre avec les
Russes, leur cible fut notamment Strobe Talbott, pourtant
considéré comme un grand spécialiste de la Russie, tandis que
du côté russe, la nomenklatura de l’ancienne URSS, pressa pour
une attitude intransigeante de la Russie face aux Etats-Unis.
Le siège de Sarajevo fut l’occasion, comme en février
1994, de remettre la Russie au centre des négociations. Les
bombardements de l’OTAN furent l’objet de critique de la
Serbie et de la Russie mais aussi de la France, dont la
position fut assez proche de celle de Moscou. Le 11 septembre
une rencontre eut lieu entre la France, l’Espagne, le Canada
et la Grèce pour critiquer le bombardement de l’ouest de la
Bosnie avec des missiles tomawaks, avant l’usage de telles
armes, le 7 septembre, le président Eltsine adressa une lettre
au président Clinton pour dire que les Russes ne peuvent pas
« être indifférents au destin des enfants de nos frères Slaves 2». Les Russes
menacèrent de se retirer du Groupe d’accompagnement à la
négociation, de même Pavel Gratchev, ministre de la Défense
russe appela William J. Perry pour avertir que les
1 Richard Holbrooke, To end a war, Random House, 1999, 117.2 Ibid, 143.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 116 -
bombardements mettaient en péril la perspective d’une
coopération militaire entre la Russie et l’OTAN et menaça
« d’aider les Serbes de manière unilatérale 1». La Russie tenta également
le lendemain de faire adopter à la hussarde une résolution du
Conseil de Sécurité de l’ONU condamnant les bombardements de
l’OTAN. Les tensions entre les Etats-Unis et la Russie
pouvaient compromettre, non les efforts pour maintenir la paix
lorsqu’elle sera signée, mais les efforts entrepris jusqu’ici
par les Américains pour associer Moscou dans un partenariat
stratégique, le Pragmatic Partnership. Les Forces russes pour les
Américains et leurs alliés n’étaient pas essentielles, tout au
plus les Serbes seraient moins enclins à se révolter si les
Russes participaient activement. Selon Perry, inclure la
Russie dans l’opération était plus important que l’opération
en elle-même et donc que la paix en Bosnie2. La coopération
russe sur le plan diplomatique se devait d’avoir une suite
militaire sous peine d’être perçue comme un geste
inconséquent.
II. La collaboration militaire américano-russe.
II.1] La participation russe en Bosnie : la
recherche d’un compromis dans un contexte
d’élections.Avancer vers un partenariat stratégique entre la Russie et
les Etats-Unis répond à une inquiétude des Américains : une
1 Ibid, 144. 2 “We believed that the reason to include Russia in the Bosnian peace force was bigger than the Bosnian operation and had to do with Russia itself” in Ashton B. Carter et William James Perry, Preventive Defense: a new security strategy forAmerica, Brookings Institution, 2000, 32.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 117 -
possible division du continent européen1. Contrairement à la
guerre du Golfe, les Américains ont saisi l’importance d’un
tel partenariat avec les Russes lors de la crise de Bosnie,
même si pour les deux anciens adversaires la tâche n’est pas
aisée. Il nous faut tout d’abord réfléchir aux avantages que
pourrait procurer une action commune à la diplomatie
américaine et plus largement à l’influence américaine dans le
monde. Premièrement, la coopération militaire aurait pour
incidence de réduire la propension russe à se démarquer de
manière systématique, du moins de manière officielle, de la
position américaine. Le deuxième enjeu concerne la sécurité en
Europe, une Russie dans le giron américain permettrait de
traiter différemment les tensions en Abkhazie et en Ukraine,
tandis qu’isoler la Russie c’est en réalité lui laisser les
mains libres pour agir. Enfin, rallier la Russie à la cause
américaine d’un point de vue militaire c’est aussi faire
valoir la supériorité américaine et de ses valeurs, celles
d’un monde libéral et global.
En janvier 1994, une adhésion au Partenariat pour la Paix
fut proposée à tous les pays de l’ex Union Soviétique et du
traité de Varsovie, « les partenaires verront les guerres ethniques comme
celle de la Bosnie comme un problème de sécurité commun et coopérerons en tant
que partenaires pour le résoudre 2». Le but est clair, réaliser une
Europe unie intégrée dans l’OTAN et l’établissement d’un
partenariat privilégié avec la Russie, jusqu’à une possible
adhésion. Progresser vers cet objectif exige des rencontres
1 “Its first post cold war security emergency would create a division of thecontinent”, Ashton B. Carter et William James Perry, Preventive Defense: a new security strategy for America, Brookings Institution, 2000, 23.2 Ibid., 24.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 118 -
régulières entre les Ministres de la Défense et leurs équipes
dans des séances bilatérales, Bilateral Working Group, qui débuta en
1993. Ces rencontres, sous les auspices du Vice président Al-
Gore et du Premier Ministre Viktor Tchernomyrdine, sont
racontées de manière détaillée par Ashton B. Carter, adjoint
au secrétaire de la Défense américaine de 1993 à 1996 et par
William J. Perry Secrétaire de la Défense américaine de 1994 à
1997. Les difficultés de compréhension entre les deux pays, du
fait de la langue certes, mais également d’une manière de
penser totalement différente et indépendante l’une de l’autre,
ont laissé augurer un dialogue difficile, ce qui fut le cas au
début. Pavel Gratchev est décrit comme un homme jeune, vétéran
de la guerre d’Afghanistan et soutien de Boris Eltsine, ce qui
le rendit impopulaire, et dont les relations avec son
homologue américain sont excellentes, « la meilleure voie pour réaliser
un travail sérieux avec les Russes 1». Une voie parallèle et
essentiellement militaire à celle de Yuri Mamedov et Strobe
Talbott, considérée par Richard Holbrooke comme étant
également la meilleure au sujet de la crise bosniaque. Ces
bonnes relations entre homologues ne dissimulent pas
l’inquiétude américaine quant à la réforme encore incomplète
de l’armée russe qui, bien que très fournie en armement
conventionnel et bénéficiant d’un stock d’armes nucléaires
considérable, n’est pas adaptée aux missions de maintien de la
paix, en atteste l’opération menée en Tchétchénie en décembre
1994 qui révéla au grand jour les carences de l’armée russe.
D’un point de vue purement opérationnel il était donc
nécessaire pour les Américains « que les unités russes qui sont allées en1 Ibid., 26.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 119 -
Bosnie soient familières aux tactiques de l’OTAN, qui incluent l’utilisation de moyens
non létaux pour contenir les armées ennemies de Bosnie et traiter avec les
populations civiles en colère1». Cette assimilation des tactiques de
l’OTAN se fit par des entrainements communs en vue d’une
action en Bosnie à Fort Kinley au Kansas en septembre 1994.
Plusieurs difficultés sont soulevées, des difficultés d’argent
notamment et une méfiance réciproque du fait de l’image de
l’OTAN en Russie. Le rôle du Partenariat pour la Paix consiste
d’ailleurs également à changer l’image de l’OTAN pour que
cette organisation ne soit plus perçue comme une alliance
antagoniste à la puissance russe mais comme le lieu de
l’interopérabilité entre des forces aux fonctionnements
différents en vue d’opérations ad hoc comme celle en Bosnie et
comme un lien entre l’Europe occidentale et l’Europe de l’Est.
La fin de l’année 1994 et le début de l’année 1995 furent
mouvementées lorsqu’en décembre 1994, par un communiqué, fut
annoncée officiellement l’expansion de l’OTAN, ce qui provoqua
de fortes réactions en Russie. Pour beaucoup d’analystes
américains la Russie réagit vis-à-vis de l’OTAN de manière
« egocentrique » voire paranoïaque, chaque déclaration, fait
ou geste sortant d’un responsable de l’Alliance Atlantique est
perçu négativement2. On peut néanmoins s’interroger sur le
bienfait d’une telle annonce alors que le conflit en Bosnie
fait rage et que la coopération de l’ensemble de la communauté
internationale, et plus particulièrement de la Russie, est
fondamentale. La question bosniaque reste un épiphénomène pour
1 Ibid., 27.2 Jean Callaghan et Mathias Schönbom, Warriors in Peacekeeping: points of tension in complex cultural encounters: a comparative study based on experiences of Bosnia, Lit Verlag, 472p. 359.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 120 -
l’opinion russe tandis que « la menace de l’OTAN » est un
thème récurrent depuis la Guerre Froide, lier les deux
thématiques c’est prendre le risque de conférer à la guerre de
Bosnie l’idée de « répétition » avant l’élargissement.
Certains militaires de l’OTAN et de l’armée américaine
n’étaient d’ailleurs pas favorables à l’association des forces
russes, pour eux une telle opération compliquerait la mission
sans apporter de contrepartie. Pourtant, la réunion de l’OTAN
à Williamsburg en Virginie, insista sur la nécessité
d’associer la Russie au processus de paix. Au début du mois
d’octobre Perry demanda à rencontrer Gratchev pour discuter de
la place de la Russie dans la force de paix internationale
envoyée en Bosnie, il choisit Genève, un lieu « neutre » au
sens politique mais chargé du passé de la Guerre Froide. Le
principal point de discussion concernait la chaîne de
commandement, et plus particulièrement le fait que les Russes
refusaient, pour des raisons symboliques et politiciennes,
d’être placés sous l’autorité de l’Alliance Atlantique. L’idée
qui prévaut dans les missions de maintien de la paix est celle
de l’unité de commandement qui permet d’éviter les ordres
contraires qui peuvent être fatals sur le terrain, ainsi,
chaque niveau de commande est lié à un seul supérieur.
L’exemple de la Somalie rappelle aux Américains l’importance
d’une telle mesure. Perry exigea tout d’abord des Russes
qu’ils reconnaissent que la force de paix en Bosnie devait
être une force atlantiste, ce qui fut refusé par les Russes.
Perry proposa ensuite à la Russie d’accepter d’engager des
hommes dans des actions de logistique non combattantes où une
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 121 -
chaîne de commandement parallèle pouvait être instaurée.
Gratchev déclina et expliqua qu’il demandait une pleine
participation de la Russie dans des actions combattantes. La
question bosniaque souleva des questions plus anciennes comme
celle du traité des Forces Conventionnelles en Europe dont les
dispositions annexes, pour éviter un affrontement entre les
troupes du Pacte de Varsovie et les troupes de l’OTAN,
empêchaient la Russie de mouvoir ses troupes et ses tanks
comme elle le souhaitait. Perry affirme que les Etats-Unis ont
été ouverts sur ce sujet mais que Pavel Gratchev les mit en
face de deux options irrecevables révélatrices de l’irritation
de Boris Eltsine sur l’attitude de l’OTAN, soit la Russie
passait outre les annexes du traité soit elle ne respecterait
plus le traité dans son ensemble. Puis, Gratchev remit
également en cause la participation de la Russie à la
réduction des armes de destruction massive, nucléaires et
biologiques dans le cadre du Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction
Program. La participation russe à l’opération de paix en Bosnie
souleva donc des problèmes plus anciens ou des perspectives
qui dépassaient le cadre régional bosniaque et interroge plus
largement sur le cadre des relations entre la Russie et
l’OTAN. Pour sortir de cette impasse, Perry considéra que le
plus important n’était pas les points de désaccord entre la
Russie et les Etats-Unis mais la recherche d’un accord, même
partiel voire mineur, pour que la rencontre de Genève ne soit
pas un échec aux yeux du monde. Finalement, Perry proposa à
Gratchev d’organiser une rencontre au sein de la SACEUR
(Supreme allied commander in Europe) à Mons pour que les
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 122 -
officiers russes observent le travail fourni par les officiers
américains et qu’ils voient concrètement quelle aide ils
pourraient apporter à l’opération. Cette volonté de
démystifier l’OTAN est un signe majeur en faveur d’une rupture
complète avec le temps de la Guerre Froide. En donnant accès
aux quartiers généraux de l’OTAN Perry suscita à la fois de la
curiosité et du soulagement à Gratchev, car lui aussi
ressentait la pression du prochain sommet de Hyde Park entre
Bill Clinton et Boris Eltsine.
Le sommet de Hyde Park est attendu par beaucoup comme un
moyen de débloquer l’impasse dans laquelle se trouve la
coopération russo-américaine. Ce sommet du 23 octobre 1995
n’avait cependant pas pour vocation à régler tous les détails
sur lesquels leurs ministres de la défense respectifs
n’avaient pas trouvé de solution préalable. Le sommet de Hyde
Park est la neuvième rencontre entre les deux hommes1 et il
semblerait effectivement que les deux hommes s’apprécient,
malgré la préférence assumée de Boris Eltsine pour son
prédécesseur. Bill Clinton ne fut pas dupe des déclarations
d’un président russe la veille, pour lui elles ne sont
principalement qu’à destination des Russes eux-mêmes2. Le récit
fait par le président américain met en relief l’absence de
véritables discussions sur les sujets sensibles, ils
s’assirent sur les mêmes chaises que Roosevelt et Churchill
lors de la Seconde Guerre mondiale mais, malgré la dimension
symbolique d’un tel acte, les modalités d’une coopération
russo-américaine ne furent pas trouvées ce jour là. Lors de la
1 Bill Clinton, My life, Knopf, 2004, 675. 2 “Mostly for domestic consumption”, ibid, 675.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 123 -
conférence de presse, Bill Clinton assura qu’un pas important
avait été effectué au sujet de START II tandis que Boris
Eltsine défia les journalistes en disant : « Je suis plus optimiste en
repartant d'ici que lorsque je suis arrivé. Après mon discours d'hier, vous annonciez
que ma rencontre avec Bill serait un désastre. C'est vous qui êtes un désastre »1.
Sur la Bosnie, les présidents des deux pays furent plus
mesurés, annonçant que la question revenait à leurs ministres
de la Défense, Perry et Gratchev, et que c’était à eux de
trouver les solutions adéquates. Du fait des prochaines
élections, ils devaient faire face à leurs opinions publiques,
ce qui, en plus de la difficulté à trouver un compromis, à la
fois sur l’élargissement de l’OTAN comme sur la participation
russe à une opération en Bosnie, les mettait dans une
situation inextricable. D’un côté, Bill Clinton eut les pires
difficultés à faire accepter par le Congrès l’envoi de troupes
américaines en Bosnie sous commandement de l’OTAN, il est
certain que cet accord n’eut pas fonctionné si celui-ci avait
prévu un mandat sous l’autorité de l’ONU et de son côté le
président russe voyait s’approcher les élections
parlementaires ainsi que les élections présidentielles de 1996
ce qui ne lui laissait pas véritablement le choix, il fallait
qu’il montre sa fermeté et son engagement à défendre les
anciens pays satellites de l’URSS. Perry donne un compte rendu
plus détaillé de ce sommet qu’il qualifia de plus serein que
celui de Genève. Pour lui les discussions ont permis d’avancer
sur la coopération russo-américaine puisque des négociations
1 Ibid, 676. (Célèbre scène reprise par une publicité où l’on voit Boris Eltsine et Bill Clinton rire ensemble, ce qui rendra ce sommet décevant surle fond très connu sur la forme pour le moins inhabituelle)
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 124 -
eurent lieu sur le traité de la CFE concernant un changement
sur les annexes qui irritaient les Russes. Ce sommet permit
de faire valider par le président russe la prochaine visite de
Gratchev aux Etats-Unis fin octobre. De même, l’idée d’une
participation de la Russie dans des missions non combattantes
fut considérée par Eltsine comme envisageable si on les
qualifiait de « missions spéciales »1 pour une question
d’image. La réunion entre Gratchev et Perry eut lieu le 27
octobre 1995 à Fort Riley, là où s’entrainent les troupes
russes et américaines. Le but de la manœuvre consistait à
montrer à Gratchev que les troupes russes et américaines
pouvaient travailler ensemble efficacement sur le terrain et
qu’il ne restait plus aux dirigeants qu’à se mettre d’accord.
Le lendemain, ils assistèrent au sein de la Whiteman Air Force
Base à la destruction d’un stock d’armes nucléaires selon les
principes même du traité START I, puis Gratchev put monter
dans le cockpit d’un bombardier B-2, le premier russe à
approcher cet avion si secret. Toute l’énergie américaine
déployée pour satisfaire les Russes en vue d’un accord sur la
Bosnie doit être considérée à l’aulne des prochaines élections
où l’image compte autant, voire plus, que le contenu, ainsi,
de la visite de Gratchev, les Russes se souviendront de
l’image d’un ministre de la Défense activant le bouton
commandant à l’explosion du silo nucléaire et non des
discussions sur la Bosnie. Sur le fond, ces visites ne
servirent presqu’à rien mais elles permirent de rendre concret
ce qui auparavant pouvait apparaître comme très abstrait. A
1 Ashton B. Carter et William James Perry, Preventive Defense: a new security strategy for America, Brookings Institution, 2000, 42.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 125 -
Mons, dans les quartiers généraux de l’OTAN, il fut décidé que
l’officier russe prendrait le titre de « deputy commander of
Russian forces », le fait de choisir un titre avant les modalités
de l’opération montre bien qu’il s’agit pour les Russes de
faire bonne figure aux yeux de leur opinion publique. L’option
d’une opération non-combattante pour la Russie fut explorée
mais l’idée d’associer pleinement les Russes aux actions de
combat n’a pas été écartée puisque cette question revint aux
deux généraux, le général Joulwan et le général Chevtsov.
Les deux généraux vont mettre en place un schéma
opérationnel assignant à chacun un rôle, les Américains auront
en charge l’OPCON (ou contrôle opérationnel) tandis que les
Russes devront assurer le TACON (ou contrôle tactique). De
cette manière il était possible de distinguer des chaînes de
commande distinctes en apparence mais qui se rejoignaient au
final. Il est donc assez exagéré de dire, comme l’affirme
Perry, que les Américains ont eu ce qu’ils voulaient, c'est-à-
dire une unité de commandement et les Russes, un rôle « avec,
mais pas sous le commandement » de l’OTAN1. Les Russes avaient
à la fois autorité sur l’administration, sur l’ordre et la
discipline, mais en aucun cas la brigade russe n’avait
autorité sur l’ordre des missions, leur conception et leur
mise en application. L’OTAN est donc bien l’instance qui
dirige les opérations et l’autonomie russe est fort limitée,
mais l’essentiel est conservé : l’apparence de l’autonomie.
1 Ibid, 44.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 126 -
II.2] Le fonctionnement de la participation
russe à l’IFOR et à la SFOR.Après 1991 la Russie avait déjà engagé des missions de
maintien de la paix en Géorgie, en Moldavie et au Tadjikistan,
des opérations qui répondaient aux exigences de la Russie
concernant ses intérêts vitaux. Le Ministère de la Défense
créa même un Directorate of peacemaking operations dont le général
Eduard Vorobyev prit la tête, celui-ci considérait d’ailleurs
que la Russie était le seul pays capable d’amener les
belligérants à la table des négociations1. L’armée russe
souffre cependant de réelles difficultés à s’adapter aux
nouvelles contraintes de ces guerres localisées, de faible
intensité mais qui peuvent s’enliser et coûter la vie à de
nombreux soldats. La réforme de l’armée, lente et onéreuse, ne
donna pas les moyens nécessaires à la Russie pour régler ce
genre de conflit. La participation de la Russie à une
opération de maintien de la paix était donc risquée, d’autant
plus que l’opération de maintien de la paix en Tchétchénie
était un fiasco. C’est donc grâce au volontarisme américain
sur cette question et ce, malgré leur antagonisme originel,
que l’OTAN et la Russie sont parvenus à un compromis
opérationnel satisfaisant. Les soldats russes engagés pour
appliquer les accords de Dayton du 21 novembre 1995,
composaient la Russian Seperate Airborne Brigade (RSAB) au sein de la
division multinationale du Nord où se trouvent également deux
divisions américaines et une autre turque. Pour le général1 Jacob W. Kipp, Tarn Warren, “The Russian Separate Airborne Brigade – Peacekeeping in Bosnia-Herzegovina” in Regional Peacekeepers, the Paradox of Russian Peacekeepers, United Nations University, 1er juillet 2003, 36.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 127 -
Joulwan l’expérience commune de la coopération militaire en
Bosnie a été extrêmement positive, elle entérinait la fin de
la Guerre Froide définitivement et a mis la première pierre à
une construction solide d’un partenariat durable « Pendant l’IFOR
nos forces ont patrouillé ensemble, s’entrainaient ensemble et partageaient les
risques. Elles ont appris les unes des autres et ont appris à se respecter
mutuellement 1».
L’action du contingent russe fut dictée par le « Plan pour
la participation du contingent russe de maintien de la paix
dans l’opération onusienne en Bosnie-Herzégovine 2», qui
mettait en avant les actions à effectuer, le degré de risque,
les procédures, la coordination de ces actions et la chaîne de
commandement. La question du nombre de troupes russes à
envoyer fut largement débattue, d’un engagement au préalable
limité, le Ministre de la Défense russe approuva l’envoi de
troupes supplémentaires après les succès de Peacekeeper 1 et de
Peacekeeper 2 soit environ 1500 personnes, des troupes et des
officiers3. La question de la zone géographique fut également
un enjeu déterminant puisque Moscou a tout d’abord proposé que
ses troupes soient déployées à Brcko mais étant donné
l’importance de cette zone et l’absence de véritable consensus
sur cette question et du rôle stratégique du corridor de
Posavina, l’OTAN n’y fut pas favorable. Ce refus rencontra les
1 Georges A. Joulwan « Foreword » in Jacob W. Kipp (ed.), Lessons and conclusion on the Execution of IFOR Operations and prospects for a Future combined Security System: The Peace and Stability of Europe after IFOR, FMSO Special Study N°99-4, 1999, p. ii. 2 Jacob W. Kipp, Tarn Warren, “The Russian Separate Airborne Brigade – Peacekeeping in Bosnia-Herzegovina” in Regional Peacekeepers, the Paradox of Russian Peacekeepers, United Nations University, 1er juillet 2003, 50.3 Général Léonty P. Chevtsov, « La coopération militaire entre la Russie et l'OTAN en Bosnie, une base pour l'avenir ? », Revue de l’Otan, No. 2 Vol. 45, Mars. 1997, pp. 17-21
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 128 -
défiances des responsables russes de la mission qui avertirent
l’OTAN qu’ils n’accepteraient pas d’être marginalisés, et
d’être cantonnés à un « rôle fantôme » selon les termes du
colonel Andreï Demurenko1. La région d’Ugljevik fut donc
retenue, elle était occupée par des Serbes et des Musulmans.
Les troupes furent déployées après de nombreuses sorties
aériennes (75) et l’armée russe put accomplir son devoir le 2
février 1996, un an après la signature des accords de Dayton
et dans un moment de calme relatif. Leurs tâches consistaient
donc dans l’ensemble à s’interposer lorsque des conflits
mineurs pouvaient éclater pour les réduire par la discussion.
Le respect de la démocratie et la tenue des élections
municipales incombaient également aux soldats, ce qui, comme
le reconnaît le général Léonty Chevtsov, n’est pas tâche
aisée, « deux niveaux de la situation politique du pays peuvent être clairement
identifiés : au niveau gouvernemental les parties défendent leurs attachements aux
accords de Dayton, mais au niveau local (les chefs de communautés ou de cantons)
les accords sont constamment violés et ignorés »2. En ce qui concerne la
chaîne de commandement les militaires russes recevaient leurs
ordres de la SACEUR qui fixait les grands axes et de la
MND(N) au sein de la TACON pour le secteur russe. Le
commandant de la MD(N) (Division multinationale du Nord)
assignait les tâches à effectuer (FRAGOS : fragmentary
orders), fixait les priorités même s’il n’en avait pas, stricto
sensu, le droit. En théorie, la brigade russe pouvait donc ne
pas obéir aux ordres, en pratique, pendant cinq ans, les
1 Ibid, 50. 2 Général Léonty P. Chevtsov, « La coopération militaire entre la Russie et l'OTAN en Bosnie, une base pour l'avenir ? », Revue de l’Otan, No. 2 Vol. 45, Mars. 1997, pp. 17-21.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 129 -
Russes ne refusèrent que très peu de missions et quand ce fut
le cas l’explication résidait souvent dans les règles
d’engagement qui pouvaient être contraires à celles assignées
par le Ministre de la Défense à Moscou. Le déploiement des
troupes russes se fit sous l’égide de l’ONU et de la
résolution 1031 de décembre 19951, ainsi que d’un décret
présidentiel russe du 14 février 1996, d’un décret du Conseil
de la Fédération russe du 2 janvier 1996 et d’une Instruction
du ministère de la Défense du 9 janvier 1996.
Des études permettent de mieux cerner la réaction des
militaires à l’opération Joint Endeavour. Ces études concernent 45
officiers russes ayant participé à l’opération et des
officiers américains mais avant de rentrer dans les détails de
ces études, les réactions des principaux officiers russes et
américains laissent à penser que les satisfactions sont plus
nombreuses que les sources de discordes. Lors de l’annonce de
l’inclusion de troupes russes dans le secteur de la First Armor
Division, malgré le scepticisme de certains, le commandant de la
brigade, le colonel américain Fontenot, fit l’éloge du
commandant de la brigade russe, Lentsov, dont il dit « qu’il a des
capacités inégalables dans son domaine et demeure sans intérêt pour les intrigues
politiques ni pour son propre avancement de carrière ni pour quelque projet caché.
Je l’ai trouvé honnête, c’est un soldat franc et j’ai apprécié de le côtoyer 2». De
même, le général Léonty Chevtsov parle de manière élogieuse de
1 UN Security Council, Résolution 1031, 15 décembre 1995. 2 Georges A. Joulwan « Foreword » in Jacob W. Kipp (ed.), Lessons and conclusion on the Execution of IFOR Operations and prospects for a Future combined Security System: The Peace and Stability of Europe after IFOR, FMSO Special Study N°99-4, 1999, p. ii. ? Jacob W. Kipp, Tarn Warren, “The Russian Separate Airborne Brigade – Peacekeeping in Bosnia-Herzegovina” in Regional Peacekeepers, the Paradox of Russian Peacekeepers, United Nations University, 1er juillet 2003, 52.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 130 -
la relation entre le général William L. Nash et le colonel3
Lentsov qui s’entendaient à merveille depuis leur rencontre en
Allemagne sur presque tous les sujets, les deux hommes
reçurent d’ailleurs la médaille du mérite par la Russie et les
Etats-Unis. De manière plus précise, des études conduites
conjointement en Russie et aux Etats-Unis par le CMS (Russe)
et le FMSO (Américain) permettent de constater que les Russes
autant que les Américains sont d’accords sur le fait que les
missions multinationales doivent s’appuyer sur un plan
opérationnel fiable (CMSS 82.2% et FMSO 81%), sur
l’organisation de l’approvisionnement et la logistique (CMSS
80% et FMSO 77%), sur un commandement et un contrôle efficace
(CMSS 75.5% et FMSO 74%), sur une coordination permanente
(CMSS 75.5% et FMSO 84%) et dans un degrés différent les deux
parties s’accordent, pour le succès de la mission il faut une
coordination avec les différentes équipes des pays
participants et avec les agences civiles (CMSS 80% et FMSO
64%). L’importance de l’entrainement commun, dont on a vu
qu’il pouvait peut-être même infléchir des positions
politiques, est valorisé par les deux pays (CMSS 71.1% et FMSO
84%) de même que l’entrainement dans le domaine civil (CMSS
77.7% et FMSO 90%) mais on observe un léger décrochage en ce
qui concerne l’entrainement aux règles d’engagement (CMSS
64.4% et FMSO 100%) et un vrai sujet de différence en ce qui
concerne l’entraînement aux langues (CMSS 22.2% et FMSO 87%).
Des deux côtés on observe également un consensus négatif sur
le fait que l’OSCE pourrait avoir la responsabilité des
missions de maintien de la paix (CMSS 4,4% et 10% FMSO). On3 Le Colonel Lentsov fut promu Général après la guerre.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 131 -
peut conclure de manière attendue que la coopération et le
respect mutuel sont des aspects fondamentaux pour une mission
multinationale réussie. Le grand sujet de discorde concerne
néanmoins l’instance dirigeante des opérations de maintien de
la paix. Pour les Russes, qui ont pris part à l’UNPROFOR,
l’ONU demeure l’instance qui doit diriger les opérations (CMSS
77.7%) tandis que les Américains qui ont en mémoire la
Somalie, considèrent à une très large majorité que cela ne
doit pas être le cas (FMSO 10%). Ils plébiscitent par ailleurs
l’action de l’OTAN puisque pour eux c’est l’OTAN qui doit
mener ces opérations de maintien de la paix (FMSO 81%) et pour
les Russes seule une petite minorité se prononce pour l’OTAN
(CMSS 20%). En ce qui concerne l’opérationnel, on observe
également de grands décalages d’appréciation. Pour les
Américains le contrôle et le commandement opérationnel des
opérations multinationales peut se faire par des équipes
multinationales à tous les échelons (FMSO 90%) tandis que pour
les Russes, seule une petite minorité supporte cette idée
(CMSS 8,8%). Pour ce qui est du soutien économique et
financier à apporter par leur pays respectif on remarque un
profond décalage entre des Américains très favorables (FMSO
74%) et des Russes franchement opposés (CMSS 4.5%)1. Ces
chiffres s’expliquent par la crise économique qui touche la
Russie et par la catégorie de personnes interrogées car avant
l’engagement des Russes dans l’IFOR, les gens de la rue se
prononçaient très largement en faveur d’une participation
1 Dr. Jacob W. Kipp, “US-Russian Military Cooperation and the IFOR Experience: A Comparison of Survey Results”, non publié, septembre 1998.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 132 -
économique et financière de la Russie plutôt que par l’envoi
de matériel et d’hommes1. On peut regretter que certaines
questions plus spécifiques n’aient pas été posées :
Percevez-vous l’OTAN comme une instance alliée ?
Votre regard sur les pays ayant participé à l’opération
a-t-il changé ?
Considérez-vous que l’opération de l’UNPROFOR soit une
réussite ?
Nous pouvons néanmoins supputer que, bien que constituant un
précédent, cette opération n’a pas bouleversé la perception
russe de l’OTAN, elle a tout au plus infléchi une vision très
négative de cette organisation pendant une courte période
jusqu’à la crise du Kosovo.
II.3 La vie des soldats russes en Bosnie vue
par l’interprète du général Nash.L’interprète du général Nash dans ses relations avec le
colonel Lentsov, a écrit un journal de décembre 1995 à
novembre 1996 qui se révèle intéressant sur plusieurs aspects.
Tout d’abord il est révélateur des relations entre la brigade
américaine et la brigade russe et est surtout beaucoup plus
détaillé que les précédents comptes-rendus de Bill Perry et
d’Ashton B. Carter. On apprend de nombreuses informations sur
le parcours des militaires, sur leurs opinions politiques
voire même sur leurs salaires, toutes ces informations étant1 « Pour 30% des personnes ayant répondu, l’engagement de la Russie dans lesBalkans devait se faire sous forme d’aide humanitaire et d’assistance économique » Cf. chapitre 2 de la présente étude.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 133 -
mêlées aux plaisanteries russes récentes ou datant de l’URSS.
Les expériences antérieures de ces officiers sont
primordiales, ainsi du côté américain, le général Nash a, tout
comme Richard Holbrooke, vécu sa principale expérience au
Vietnam tandis que pour les Russes l’expérience marquante
réside surtout dans la guerre d’Afghanistan en 1980. Les
troupes russes sont parties de Moscou pour rejoindre Belgrade
afin de transiter par Brcko et le corridor de Posavina avant
de rejoindre Ugljevik près de Tuzla. L’opinion politique des
militaires russes est ici exposée de manière très directe, le
colonel Lentsov estime ne pas regretter la taille de l’URSS,
la Russie est déjà assez grande, et ne souhaite pas poursuivre
une idéologie coûte que coûte mais avoue n’avoir rien constaté
de défaillant dans le système politique communiste1. Pour lui,
Boris Eltsine est le fossoyeur de la démocratie, tout comme
Gorbatchev a été le fossoyeur du système communiste. A
l’inverse, on peut observer les remarques du colonel Denisov
qui lui considère que le plus important c’est la tenue des
élections en Russie, en 1996. Enfin, le colonel Ashkhimin,
expliqua son choix de voter communiste pour deux raisons,
premièrement pour le système d’aide sociale et médical, très
touché par les privatisations successives et deuxièmement, car
selon lui le parti communiste est le seul parti d’opposition
en capacité à diriger le pays. Concernant l’opération en elle-
même, des désaccords importants existent entre les officiers
russes et les officiers américains, notamment le colonel
1 James Nelson, Bosnia Journal: An American Civilian's Account of His Service With the 1st
Armored Division and the Russian Brigade, Infinity Publishing, 30 janvier 2005, 4.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 134 -
Denisov qui considère que le général Nash veut « tout régler
par la force » alors que pour lui il existe des forces autres
que celle de Milosevic à Belgrade. En d’autres termes, le
terrain est miné au propre et au figuré, ce qui signifie pour
les Russes de faire une plus grande œuvre de la diplomatie1. Un
autre incident eut lieu entre le général Nash et le général
Staskov au sujet de l’indépendance la brigade russe, le
général russe reprochant au général américain son désir de
tout commander. Ce journal nous apporte surtout des
informations de la vie quotidienne qui permettent de
reconstituer un camp où figurent 20 000 soldats. On apprend
que les officiers russes sont payés mille dollars par mois,
que les conditions de vie au sein de l’armée russe sont
difficiles, qu’il fait froid et que l’eau est presque
insalubre. En conclusion, la coopération vue de l’intérieur
montre quelques difficultés entre les Russes et les
Américains, des difficultés personnelles avec le général Nash
et des difficultés avec la répartition des tâches puisque pour
associer les deux pays il a fallu créer un cadre assez souple
pour satisfaire les Russes.
1 Ibid., 12.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 135 -
ConclusionLa Russie s’est positionnée tout au long du conflit en ex-
Yougoslavie comme un acteur incontournable au sein des
différentes institutions internationales, à l’ONU et dans le
Groupe de Contact. Son droit de veto au Conseil de Sécurité de
l’ONU lui a permit d’exercer des pressions pour que sa voix
soit entendue. Bien que parfois contradictoire et chaotique,
la politique étrangère de la Russie pendant cette période
n’est pas nulle en actes et en conséquences. Notre thèse de
départ a donc consisté à contredire dans un premier temps
l’analyse de Samuel Huntington qui vise à créer un paradigme
nouveau faisant de la solidarité culturelle et religieuse le
fondement des relations internationales. Dans une approche
plus réaliste, nous avons tenté de démontrer que les intérêts
premiers de la Russie n’étaient pas la solidarité mais la
notion d’intérêt national, ici substituée par les intérêts
nationaux, un concept largement débattu pendant la période
d’après Guerre Froide en Russie. Pour autant, nous ne nous
inscrivons pas dans une démarche néoréaliste qui consisterait
à sous-estimer voire à mépriser les acteurs non-étatiques, la
société civile et les enjeux économiques plus larges, ce qui
nous a amené à analyser également les opinions et la réaction
de ces acteurs à la suite de certains événements marquant
comme le siège de Sarajevo et le début des bombardements de
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 136 -
l’OTAN lors de l’été 1995. Les études très précises conduites
auprès des armées russes et américaines ainsi que les
différents sondages d’opinion au sujet de la guerre de Bosnie,
de l’élargissement de l’OTAN et de la sécurité de la Russie,
nous permirent de constater le décalage parfois très profond
entre la société civile russe et l’action du gouvernement de
Boris Eltsine. Aux études d’opinion il convient d’ajouter bien
entendu l’analyse des élections législatives russes qui ont
confirmé l’émergence de forces à vocation néo-fasciste qui
semblèrent influencer la politique étrangère russe.
Paradoxalement, malgré le décalage entre la politique du
gouvernement en matière de relations internationales et la
société, des analystes russes et américains ont souvent
qualifié la stratégie de Boris Eltsine et ses orientations en
politique étrangère d’électoralistes. En réalité, la
difficulté consiste à saisir le caractère apolitique des
Russes après la Guerre Froide, qui, pour beaucoup d’entres-eux
n’ont pas de convictions ancrées. Ils réagissent par humeur,
par mécontentement. Soutiennent-ils les réformes libérales de
Boris Eltsine ? Sans doute pas, mais ce dernier fut élu et
réélu malgré de sévères défaites et des sondages
particulièrement en sa défaveur. Ont-ils réellement adhéré aux
mouvements communistes et nationalistes ? Il s’agissait pour
la majorité de ces électeurs de manifester un mécontentement.
L’incohérence de la politique étrangère rejoint donc dans une
certaine mesure l’apolitisme des Russes. La deuxième source
d’incohérence, plus visible celle-ci, fut le décalage entre la
parole, parfois vindicative du président russe et l’acte.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 137 -
Boris Eltsine se distingua par des sorties médiatiques contre
les Etats-Unis et l’OTAN qui ne s’accompagnèrent cependant pas
de gestes de défiance significatifs, à l’exception de la
signature du Partenariat pour la Paix qui fut repoussée mais
qui eut bien lieu. Cette intoxication médiatique avait pour
but à la fois de satisfaire l’opinion russe, pourtant pas dupe
de la vrai attitude de Boris Eltsine à l’égard de l’Occident,
et d’affirmer la Russie comme soutien indéfectible des Serbes,
ce qui leur permettait d’occuper une position minoritaire mais
intéressante. Le troisième niveau d’analyse, plus consensuel,
concerne les négociations entre Américains et Russes au sujet
d’une opération commune en Bosnie. Les différentes liaisons
diplomatiques (Strobe Talbott et Grogi Mamedov) et militaires
(Perry et Gratchev) ainsi que la relation entre les généraux
(Georges Joulwan et Léonty Chevtsov) et enfin la relation
présidentielle entre Boris Eltsine et Bill Clinton nous ont
montré que les liens entre la Russie et les Etats-Unis ont été
très forts pendant la crise de Bosnie. Ces différents canaux
ont permit une concrétisation militaire qui fut saluée par
l’OTAN mais qui ne fut pas un précédent décisif dans la
collaboration entre la puissance russe et l’organisation
atlantique. Ces multiples niveaux d’analyse ont ainsi rétabli
une perception plus large de la crise de Bosnie et peut-être
plus objective que les articles très subjectifs traitant de
l’engagement des mercenaires russes dans les Balkans. Le
deuxième objectif de cette étude était de traiter du mimétisme
entre l’effondrement de l’ex Yougoslavie et celui de l’URSS,
d’analyser s’il y avait des points de comparaison dans
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 138 -
l’émergence des partis nationalistes russes avec le parti
communiste de Slobodan Milosevic. Ce type d’analyse n’est pas
très fréquent dans l’historiographie française, mais on pense
bien entendu aux œuvres d’Hanna Arendt, on retrouve plutôt ce
type d’approche dans la culture historique américaine. Ces
analyses souffrent malheureusement de raccourcis qui peuvent
nuire à la pertinence du discours, néanmoins la mise en
relation permet également de retrouver les grands axes de la
pensée occidentale sur le nationalisme. Enfin, cette étude
avait pour but de rétablir un certain équilibre de traitement
de la crise de l’ex-Yougoslavie, souvent abordée d’un point de
vue européen ou américain mais rarement d’un point de vue
russe, surtout pour la crise de Bosnie. En effet, la crise du
Kosovo, du fait d’un durcissement réel de la position russe, a
souvent fait l’objet d’une plus grande attention.
Index
Index des noms :Burbulis (Guennadi): 31.
Bush (Georges): 24, 63-64.
Chevtsov (Léonty): 78, 81, 85.
Churkin (Vitaly): 28-29, 32,
65, 69, 71.
Clinton (Bill): 8, 45, 64-65,
72, 77, 85.
Eltsine (Boris) : 8, 15, 17,
23, 25, 27-29, 31-34, 38, 41-
45, 48-54, 60-69, 72-78, 84-85.
Gaïdar (Igor) : 31, 45.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 139 -
Glotov : 46-47.
Gorbatchev (Mikhail): 13, 17,
22-25, 29-32, 60-62.
Gratchev (Pavel): 32, 34-35,
66, 72, 75-78, 85.
Holbrooke (Richard): 41, 46-47,
70-72, 75.
Ivanov (Igor): 18, 32-34, 44,
55, 71.
Izetbegovic (Alija): 7, 46-47.
Jirinovski (Vladimir): 9, 27-
28, 44-45, 48-49, 51-52, 54-55,
58, 62.
Joulwan (Georges): 78, 80-81,
85.
Karadzic (Radovan): 20, 46, 49,
54, 65.
Kozyrev (Andreï): 7-8, 15-17,
28, 31-33, 37, 41-42, 45, 48-
49, 55, 58, 61-68, 70-71.
Lebed (Alexander Ivanovich):
44, 49.
Lukin (Vladimir): 45-46, 48.
Mamedov (Gorgi): 32-33, 67, 75,
85.
Milosevic (Slobodan): 19-20,
22-23, 27-28, 46-47, 64, 66,
70-71, 85.
Mitterrand (François) : 43. Molotov: 12, 16.
Nash (William L.): 81.
Nikiforov (Alexeï): 69-70.
Perry (William James): 72-74,
76-79, 85.
Rodionov (Nikolaï): 34-35.
Sacirbey: 32-33.
Skokov (Yuri): 49.
Staline (Joseph): 13.
Talbott (Strobe): 17, 32, 63-
67, 72, 75, 85.
Tchernomyrdine (Vitkor): 32,
74.
Tito (Josip Broz): 13, 22.
Tudjman (: 22, 46-47.
Védrine (Hubert): 43.
Vorobyev (Eduard): 79.
Ziouganov (Guennadi):15, 48.
Zotov (Alexander): 69
Index des lieux :Abkhazie : 36, 75.
Angleterre: 10, 11, 69.
Allemagne : 14, 16, 60, 68-
69, 81.Bosnie : 5, 8, 11, 14, 19, 20,
22, 24, 26-29, 33, 36-39, 41,
44-49, 51-60, 62-69, 72-78, 84-
85.
Brcko : 81, 84.
Bulgarie : 10-13, 16, 55.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 140 -
Croatie : 6, 14, 24-27, 56-
57, 68.
Espagne : 32, 72.
France : 10, 12, 14, 43, 47,
68-69, 72.
Grèce : 10, 13, 20, 72.
Kosovo : 11, 25-27, 64, 84,
87.
Macédoine : 11, 13, 24.
Moldavie : 25-26, 80.
Monténégro : 10, 19, 24, 56.
Ugljevik : 81, 84.
Ukraine : 43, 68, 75.
URSS : 8, 13, 16, 18-19, 22-
27, 31-35, 37, 44, 51-53, 61-
63, 69, 72, 78, 85.
Sarajevo : 13, 28, 32, 40,
43, 54, 66-67, 69- 70, 73,
86.Serbie : 5-13, 16-17, 19-20,
22, 24-29, 32, 40, 43, 47, 49,
52, 64-65, 70, 72.
Tchétchénie : 26, 29, 39, 49,
53, 54, 64, 76, 80.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 141 -
5. Sources
5.1 Bibliographie.
Ouvrages Généraux sur la Politique Etrangère Russe
BOBO LO, Russian Foreign Policy, Reality, Illusion and Mythmaking, Palgrave
Macmillian, 2002, 235.
BUGAJSKI Janusz, Cold Peace : Russia’s New Imperialism, Greenwood Press, 2004, 250p.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 142 -
CARTER Ashton B., PERRY William James, Preventive Defense: a new
security strategy for America, Brookings Institution, 2000, 248p.
CURTIS Glenn E., Russia: A Country Study, Washington: GPO for the
Library of Congress, 1996.
FELKAY Andrew, Yeltsin’s Russia and the West. Westport, Connecticut :
Preager, 2002.
HUNTINGTON Samuel P., The Clash of Civilization and the Remaking of World
Order, Pocket Books, 1998, 367p.
IVANOV Igor, The New Russian Diplomacy, Washington Brookings
Institution Press, 2002.
KANET Roger E., The foreign policy of the Russian Federation, Macmillan
Press Ltd, 1997.
LARRABEE Stephen F., KARASIK Theodore W., Security Policy Decision-
making under Yeltsin, National Defense Institute, 1997, 54p.
MACKENZIE David, Serbs and Russians, East European Monographs,
1996, 400p.
POUVREAU Ana, Les Russes et la sécurité européenne, L’Harmattan, 15
octobre 1998, 160p.
ZORGBIBE Charles, Histoire de l’Otan, Complexe, 15 mars 2002, 300 p.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 143 -
WILLIAMS Christine, SEMPLE Mary Jane, ROCKWELL Kimberly A.,
Russia National Security: Perceptions, Politics and Prospects, Michael H.
Crutcher Editor, Novembre 2001, 396p.
Ouvrages Spécialisés sur la Politique Etrangère Russeen Yougoslavie
BAEV Pavel K., The Russian Army in a Time of Troubles, SAGE Publications
ltd, International Peace Research Institute, 1996, 224 p.
BARANOVSKI Vladimir, Russia and Europe: The Emerging Security Agenda,
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute),
1997, 600 p.
HEADLEY James, Russia and the Balkans, foreign policy from Yeltsin to Putin,
Columbia University Press, 544p.
KIPP Jacob W., WARREN Tarn, “The Russian Separate Airborne
Brigade – Peacekeeping in Bosnia-Herzegovina” in Regional
Peacekeepers, the Paradox of Russian Peacekeepers, United Nations
University, 1 juillet 2003, 224p.
LAITIN David D., Identity in formation: the Russian-speaking populations in the
near abroad, Cornell University Press, Juin 1998.
MALCOM Neil, PRAVDA Alex, ALLISON Roy, Internal Factors in Russian
Foreign Policy, OUP Oxford, 1996, 368p.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 144 -
POUVREAU Ana, « La perception de l’Alliance Atlantique par
l’opinion publique en Russie à travers la presse russe »,
Thèse bourse de recherche individuelle de l’Otan (1996-1998),
Juin 1998.
SANS Anne-Laure, L’intervention de l’OSCE dans les Balkans, heurs et malheurs
de la Mission de vérification au Kosovo, PSIO, 2004
SIMIC Predrag, « La Russie et le problème du Kosovo et
Metohija », Faculté des sciences politiques Université de Belgrade.
SOBEL Richard, SHIRAEV Eric, International Public Opinion and the Bosnia
Crisis, Lexington Books, 2003.
Articles spécialisés sur la Politique Etrangère Russeen Bosnie
BARANOVSKI Vladimir, “New Threat Perceptions: The case of the
former Soviet bloc and Yugoslavia”, Afers Internacionals, núm. 27, pp.
7-16.
CHEVTSOV Léonty P. Général, « La coopération militaire entre
la Russie et l'OTAN en Bosnie, une base pour l'avenir ? »,
Revue de l’Otan, No. 2 Vol. 45, Mars. 1997, pp. 17-21.
CHUDAKOV Aleksandr, "Yugoslav Fracture--It Has Deprived the
Balkans of Peace and Tranquility for a Long Time." Sovetskaya
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 145 -
Rossiya, 21 Mars 1992, traduit dans The Current Digest of the Post-Soviet
Press, XLIV, no. 12 (1992)
COHEN Lenard J. “Russia and the Balkans: pan-Slavism,
partnership and power”, International Journal, Vol. 49, No. 4,
Russia's Foreign Policy, Automne 1994, pp. 814-845.
CROSS Sharyl, “Russia and NATO toward the twenty-first
century: conflicts and peacekeeping in Bosnia-Herzegovina and
Kosovo”, Journal of Slavic Military Studies, Juin 2002, Vol.15, Issue 2,
p1-58, 58p.
CROW Suzanne, "Russia's Response to the Yugoslav Crisis." RFE/RL
Research Report, 24 Juillet 1992, 31-35.
FOGELQUIST Alan F., “Russia, Bosnia, and the near abroad”,
Eurasia Research Center, 1998.
JOHNSON Rebecca J., “Russian responses to crisis management in
the Balkans: how NATO's past actions may shape Russia's future
involvement”, Demokratizatsiya, Spring 2001, Vol. 9, Issue 2,
p292-309, 18p.
JOHNSON Richard, “Serbia and Russia: US appeasement and the
resurrection of fascism”, National War College, 28 avril 1994, 29p.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 146 -
KANET Roger E., SOUDERS Brian V., “Russia and Her Western
Neighbors Relations Among Equals or a New Form of Hegemony?”,
Demokratizatsiya,
KHIMENKO Anatoly, “Why Cut Off The Bough On Which Russian
Diplomacy In The Balkans Has Been Sitting For Centuries?”,
Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-
Soviet Press), No. 23, Vol.44, Juillet 2008, 1992, page(s): 19-
19
KLANJSEK Rudi, FLERE Sergej, “Exit Yugoslavia: longing for
mononational states or entrepreneurial manipulation?”,
Routledge, Volume 39, Issue 5, 2011
KOKNAR Ali M. “The Kontraktniki : Russian mercenaries at war
in the Balkans”, Bosnian Institute, 14 Juillet 2003.
KONONENKO Vadim, “From Yugoslavia to Iraq : Russia’s Foreign
Policy and the Effects of Multipolarity”, Working Paper 42 Finnish
Institute of International Affairs, 2003, 53 p.
KUBICEK Paul, “Russian Foreign Policy and the West”, Political
Science Quarterly, 22 Décembre 1999.
LARRABEE Stephen F. “Russia and the Balkans, Old Themes and
New Challenges” in chapitre 18 Russia and Europe the Emerging Security
Agenda, Oxford University Press, 1996.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 147 -
LYNCH Allen C, “The Realism of Russia’s Foreign Policy”, Europe-
Asia Studies, Vol. 53, No. 1, 2001, 7–31.
MARANTZ Paul, “Neither adversaries nor partners: Russia and
the West search for a new relationship”, International
Journal, Vol. 49 Issue 4, Autumn 1994, p725-750, 26p.
MARNIKA Maurice, “National notations: NATO », Peacekeeping &
International Relations; May/Jun95, Vol. 24 Issue 3, p15, 1/3p
MAURY Jean-Pierre, « La nouvelle perception des menaces: l’ex-
bloc soviétique et la Yougoslavie ». Afers Internacionals,
num.27. pp. 31-43.
O’LOUGHLIN John, TUATHAIL Gearóid “Accounting for separatist
sentiment in Bosnia-Herzegovina and the North Caucasus of
Russia: a comparative analysis of survey responses.” Ethnic and
Racial Studies, Volume 32, Issue 4, 2009.
RAVIOT Jean-Pierre, « Mythes et réalités de la convergence
russo-yougoslave pendant la crise du Kosovo », Balkanologie, Vol.
VII, n° 1 , Juin 2003 .
RAVIOT Jean-Pierre, « Mythes et réalités de la convergence
russo-yougoslave pendant la crise ou Kosovo ». Vol. VII, n° 1.
Juin 2003
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 148 -
ROBINSON Neil, “Russian policy towards the conflict in
Yugoslavia, 1991-1996” in Inter Balkan Relations at the end of
the Twentieth Century, South East European Institute of International
Affairs, 2001, pp.7-18.
RODIONOV Boris. "The UN Sanctions Against Yugoslavia Do Not
Take Russia's Interests into Account." Izvestiya, 4 Juin 1992,
traduit dans The Current Digest of the Post-Soviet Press, XLIV, no. 22
(1992):
ROMER Jean-Christophe, « La politique étrangère sous Boris
Eltsine », Annuaire Français de Relations Internationales, volume II,
2002.
RUPNIK Jacques, « L’Europe dans le miroir des Balkans » in
« La question du Kosovo. Vivre déplacé », Revue
Transeuropéennes n°12/13, 1998.
SANZ Timothy, “The Yugoslav Conflict : Review of the
Literature”, European Security, vol. 1, number 3, Automne 1992,
pp. 427-441.
SHARYL Cross, “Russia and NATO Toward the 21st Century :
Conflicts and Peacekeeping in Bosnia-Herzegovina and Kosovo”.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 149 -
SHCHIPANOV Mikhail. "Don't We Need Serbia?" Kuranty, 20 Mai
1992, traduit dans The Current Digest of the Post-Soviet Press, XLIV, no.
20 (1992).
SHIRAEV Eric, TERRIO Deone, “Russian Decision-making Regarding
Bosnia: Indifferent Public and Feuding Elites”, 2003.
STEVANOVIC Vidosav, JOHANSSON Trude, Milosevic: the people's tyrant, I.
B. Tauris. 1er octobre 2004. 288p.
THE JAMESTOWN FONDATION, “On the partnership for peace”,
Monitor, Volume 1, Issue 91, September 8, 1995.
THOMAS Timothy L., “Russian "Lessons Learned" in Bosnia”,
Military Review, September-October 1996.
TROUDE Gilles, “Le Retour de la Russie sur la Scène
Balkanique”, Géostratégie, Mai 2011.
TSYGANKOV Andrei P., “Russia’s foreign policy: change and
continuity in national identity”, Rowman & Littlefield Publishers, 25
Mai 2006, p.74-76.
ZAGORAC Sania, TINGUY (de) Anne (dir.), La politique de la Russie à
l'égard de la Serbie: approche comparative entre la guerre de Yougoslavie et la crise
du Kosovo : 1990-2000, S.I, 2005. (Disponible à science Po).
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 150 -
ZISK Kimberly Marten, “Contact Lenses: The Realist Neglect of
Transparency and US-Russian Military Ties”, Columbia
University, Septembre 1997.
Articles de la Presse Généraliste.
AKSENYONOK Alexander, “Paradigm Change in Russian Foreign
Policy”, Russia in Global Affairs, 16 Novembre 2008.
AKSENYONOK Alexander, “Self-Determination: Between Law and
Politics”, Russia in Global Affairs, 10 février 2007.
ALEXIEV Alex, “Mercenaries Whose Prime Motivation Is Ideology:
Bosnia: The conflict has been turned into the ideologically
correct--from the nationalist view--Orthodox Slav vs. Muslim
“Turk””, The Los Angeles Times, 12 Septembre 1993.
BRUMLEY Brian, “Russian Nationalists aim to restore glory”, The
Spokesman-Review, 6 Octobre 1992.
DAHLBURG John, “The Man Behind Yeltsin”, the Los Angeles Times, 23
Septembre 1991.
FROM ASSOCIATED PRESS, “Yeltsin Eases Up on Threat to Fire
Foreign Minister”, The Los Angeles Times, 21 Octobre 1995.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 151 -
GREENHOUSE Steven, “Russia Joins the West in a Push to End the
Bosnian War”, The New York Times, 14 Mai 1994.
KEMPSTER Norman, “Just Kidding, Russian Says After Cold War
Blast Stuns Europeans”, The Los Angeles Times, 15 Décembre 1992.
KIRCKPATRICK Jeane, “Russia in the Toils of the 'Iron Logic'
of Geopolitics”, The Baltimore Sun, 15 décembre 1994.
LEFEVRE Pierre, « Christopher et Kozyrev a Genève, le
difficile réchauffement russo-américain », lesoir.be, Jeudi 23
mars 1995
LUKYANOV Fyodor, “Lessons from Bosnia”, Russia in Global Affairs, 28
Juillet 2008.
MATHIL Pol, « Moscou-Belgrade, contre-la-montre ! », lesoir.be,
26 Août 1994.
REUTERS, “A Russian Official Says Bosnian Serbs Let Moscow
Down”, The New York Times, 30 Juillet 1994.
SHARP Jane M.O, BARONOVSKI Vladimir, “For a NATO-Russian UN
Intervention to End the War in Bosnia”, New York Times, 26
février 1993.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 152 -
SOBELL Vlad, NATO, “Russia and the Yugoslav War”, World Today,
Nov. 1995, p. 210-15.
VAN VELTHEM Edouard, « Les Balkans à l’heure russe », lesoir.be,
18 Mai 1993.
VAN VELTHEM Edouard, « Une diplomatie sur le fil du rasoir
plutôt l’incident que le doigt dans l’engrenage », lesoir.be,
Mercredi 19 mai 1993.
VAN VELTHEM Edouard, « Les ministres russes et yougoslaves dela Défense MM. Gratchev et Bulatovic, peaufinent un accord decoopération militaire », Mercredi 1er Mars 1995.
WILLIAMS Carroll J., “Can Russians Deliver if Given BiggerRole in Balkans?”, The Los Angeles Times, 14 Septembre 1995.
Résolutions, rapports du Conseil de Sécurité de l’ONUet de la Douma.
Official Report of Debates Vol IV 10-14 mai 1993
DEMURENKO Andrei (col.), NIKITIN Alexander (Dr.), “BasicTerminology and Concepts in International PeacekeepingOperations: an Analytical Review” Foreign Militaries Studies Office,20p.
UN Security Council, Résolution 1031, 15 décembre 1995.
UN Security Council, Résolution 777, 19 septembre 1992.
UN Security Council, Résolution 836, 4 juin 1993.
Mémoires
BALLADUR Edouard, Deux ans à Matignon, Omnibus, 1998, 269p.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 153 -
CLINTON Bill, My Life, Knopf, 2004, 957p.
ELTSINE Boris, Mémoires, Flammarion, 2000, 558p.
ELTSINE Boris, Sur le fil du rasoir, Albin Michel, 1994, 435p.
HOLBROOKE Richard, To End a War, Random House. 1999. 432 p.
TALBOTT Strobe, The Russia Hand, Random House, 2002, 478p.
RomansHENRY-LEVY Bernard, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, 552p.
CARRERE Emmanuel, Limonov, P.O.L, 2011, 489p.
5.2 Sitographie
PIKE John, Globalsecurity.org, dernière mise à jour le 9 juillet
2011 [consulté le 25 juin 2012], disponible sur
http://www.globalsecurity.org/military/world/serbia/sdb.htm
Timothy L. THOMAS, Foreign Military Studies Office, [consulté le 17
février 2012] disponible sur
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 154 -
http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/bosleslr/bosleslr.h
tm
Ed VULLIAMY, The Guardian, [consulté le 5 mai 2012], disponible
sur
http://www.guardian.co.uk/world/2005/mar/15/warcrimes.russia
Freeman HARRIS, Balkan Institute in Washington D.C., [consulté le 10
décembre 2012] disponible sur
http://www.barnsdle.demon.co.uk/bosnia/clindeb.html
OFFICE OF INFORMATION AND PRESS NATO, [consulté le 9 décembre
2012] disponible sur
http://www.nato.int/docu/presskit/010219/brocheng.pdf
Irnerio SEMINATORE, IERI [consulté le 12 novembre 2012]
disponible sur
http://www.ieri.be/en/publications/ierinews/2009/june/larchite
cture-europ-enne-de-s-curit#09062009-6
Scott PARISH, Transition Online, [consulté le 17 juillet 2012],
disponible sur http://www.tol.org/client/article/2784-dayton-
at-midpoint-russias-marginal-role.html?print
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 155 -
Table des Annexes
1)Chronologie de la diplomatie russe pendant la
guerre de Bosnie : p.98
2)Résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU :
p.100
3)Organigrammes : p.103
4)Cartes : p.105
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 156 -
Chronologie de la diplomatie russependant la guerre de Bosnie
Juin 1991 : Conflit pour l’indépendance de la Slovénie.
Août 1991 : Coup d’Etat en Russie.
Janvier 1992 : conflit pour l’indépendance de la Croatie.
30 mai 1992 : A l’initiative des Etats-Unis, la Russie vote
les sanctions économiques contre la Serbie.
10 juillet 1992 : La Russie vote l’exclusion de la Yougoslavie
de la CSCE (Conference for Security and Cooperation in
Europe).
19 septembre 1992 : La Russie vote la Résolution 777 du
Conseil de Sécurité de l’ONU qui déclare que la Yougoslavie a
cessé d’exister en tant que République Fédérale de
Yougoslavie, cependant la résolution ne reconnaît pas
l’existence, encore moins l’indépendance de la Bosnie-
Herzégovine.
Octobre et novembre 1992 : La Russie approuve l’investigation
concernant la violation des lois internationales sur les
droits de l’Homme et vote le renforcement de l’embargo contre
la Serbie et le Monténégro.
26 juin 1992 : Le Parlement russe vote une résolution
critiquant les sanctions contre la Serbie.
23 septembre 1992 : O.G Rumiantsev, président de la Commission
Constitutionnelle Russe, déclare que la politique menée contre
la Serbie est « une traîtrise aux intérêts russes ».
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 157 -
Déclaration qui coïncide avec le départ de mercenaires russes
en Yougoslavie.
14 décembre 1992 : Discours de Kozyrev à Stockholm qui marque
un tournant dans la position russe, le ministère des affaires
étrangères soutenant ouvertement la Serbie contre des mesures
unilatérales, « the present government can count on the
support of Great Russia ».
20 décembre 1992 : Elections présidentielles en Serbie, le
candidat défendu par la Russie Milan Panic est battu par
Slobodan Milosevic.
17-18 avril 1993 : Moscou s’abstient dans le vote de la
résolution 820 du Conseil de Sécurité de l’ONU qui renforce
les sanctions contre Belgrade et demande à l’inverse des
sanctions contre les Croates après une offensive contre des
zones de l’ONU.
Mai 1993: première visite à Belgrade de Kozyrev après plus
d’un an.
29 juillet 1993 : Refus de la Russie d’une levée de l’embargo
pour la Bosnie-Herzégovine, ce qui de fait favorise la Serbie.
Octobre 1993 : Elections à la Douma remportées par
l’ultranationaliste Vladimir Jirinovski et son parti Liberal
Democratic Party.
31 janvier 1994 : Visite de Jirinovski à Bieljina en Bosnie
côté serbe.
Février 1994 : En visite à Belgrade Jirinovski déclare que
« la Russie et la Serbie ont uniquement deux ennemis, le
Catholicisme à l’Ouest et l’Islam à l’Est ». La Russie négocia
par ailleurs avec les Serbes de Bosnie pour que l’aide
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 158 -
humanitaire puisse arriver et que des observateurs russes
puissent assister à l’ouverture de l’aéroport de Tuzla.
5 février 1994 : L’attaque au mortier sur le marché de Markale
à Sarajevo fait 68 morts et 200 blessés.
11 février 1994 : L’OTAN et la Communauté Européenne adressent
un ultimatum aux Serbes menaçant de bombardements aériens si
les armes lourdes n’étaient pas retirées du périmètre de
Sarajevo. La Russie, et Eltsine en particulier, s’engage pour
que l’ultimatum soit respecté.
10-11 avril 1994 : Bombardements de l’OTAN contre les
positions serbes qui provoquèrent de très vives protestations
de la part des Russes.
Mai 1994 : Contribution des Russes à l’élaboration du Plan
Vance-Owen et tentatives pour le faire accepter par les Serbes
de Bosnie.
30 juillet 1994 : Rejet du plan de paix par les Serbes de
Bosnie après des négociations entre Moscou et Pale.
11 juillet 1995 : Bombardements pour empêcher la chute de
Srebrenica
12 juillet 1995 : La Douma vote une résolution à la quasi
unanimité qui engage la Russie à se retirer des sanctions
économiques contre la Yougoslavie. Ce même jour une procédure
d’impeachment contre Eltsine est repoussée, notamment en
raison de son opération du cœur.
28 août 1995 : Second attentat au mortier à Sarajevo,
30 août 1995 : Boris Eltsine demande une session d’urgence du
Conseil de Sécurité de l’ONU après les bombardements de
l’Otan.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 159 -
23 octobre 1995 : Sommet de Hyde Park entre Boris Eltsine et
Bill Clinton.
27 octobre 1995 : Rencontre entre Bill Perry et Pavel Gratchev
à Fort Kinley pour discuter des modalités d’une entente
militaire entre la Russie et l’OTAN.
21 novembre 1995 : Accords de Dayton qui mettent fin à la
guerre de Bosnie en séparant le territoire en deux entités
dirigées par un gouvernement central.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 164 -
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
Pouvoir exécutifBoris Eltsine : Président de la
République Fédérale de RussieViktor
Tchernomyrdine : Premier MinistreIegor Gaïdar : Vice-premier Ministre
Pavel Gratchev : Ministre de la
DéfenseValeriy Mikhailov : vice-ministreAndreï Kokoshin : vice-ministre
Andreï Kozyrev : Ministre des Affaires EtrangèresVitaly Churkin : vice-ministre
Nicolaï Staskov: Général, commandant du contingent russe en Bosnie.Léonty Chevtsov: Général Viktor Denisov: Général, en charge du transport aérien.Aleksandr Lentsov: Colonel
Gennadia Burbulis : Premier adjoint du ministre des Affaires Etrangères.Gorgi Mamedov : Chargé des relations avec les Etats-Unis de 1991-2003.Vladimir Lukin : Chargé des relations internationales à la Douma.
Organigramme militaire et diplomatique sous Eltsine
- 165 -
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
Pouvoir exécutifBill Clinton :
Président des Etats-Unis
Al Gore : Vice-président des Etats-
Unis
William Perry : Secrétaire d’Etat à la DéfenseAshton B. Carter : premier assistant
Warren Christopher : Secrétaire d’Etat aux Affaires EtrangèresStrobe Talbott : premier assistant
William L. Nash : GénéralGeorge Joulwan : Général, commandant de la SACEURGregory Fontenot : Colonel
Charles Redman : Envoyé spécial en BosnieRobert Frasure : Chef de mission en BosnieRichard Holbrooke :DiplomateMadeleine Albright : Ambassadrice auprès de l’U.NRobert Frowick : Supervise les accords civils de Dayton
Organigramme militaire et diplomatique sous Clinton
- 167 -
1 Secteurs de la SFOR. Source: Université du Texas à Austin.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2
- 168 -
2 Agrandissement de la zone d'Ugljevik. Source : Université du Texas à Austin.
Perception Russe de la Guerre de Bosnie, chapitre 2