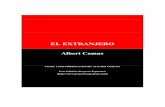Hilbert coefficients and sequentially Cohen–Macaulay modules
Albert Cohen, un Hébreu en Helvétie
-
Upload
pepperdine -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Albert Cohen, un Hébreu en Helvétie
1
21 juin 2013
Joëlle Zagury
Albert Cohen, un Hébreu en Helvétie
Né à Corfou, Albert Cohen a grandi à Marseille. À la fin de son adolescence, il a choisi de faire ses
études à Genève où il a passé la plus grande partie de sa vie d’adulte. Un mois avant d’épouser
Elisabeth Brocher, en octobre 1919, il a acquis la nationalité suisse.1
La position d’Albert Cohen vis-à-vis de ce qu’il nommait « ses patriotismes » font de lui un être qui
n’était pas tiraillé entre ses différentes identités. Bien au contraire. Il s’en était longuement expliqué
au micro de Jacques Bofford : « Je me suis pris d'un amour extraordinaire pour la langue française,
c'est une patrie pour moi. (…) J'ai le patriotisme français (…) ». Il ajoute : « Vous savez, j'ai
beaucoup de patries. La Suisse c'est une patrie d'adoption (…). Et enfin je suis un Hébreu à 100%
aussi. (…) Je me sens Hébreu beaucoup plus que Juif. (…) On me dira mais il y a bien des nationalités
mélangées là-dedans, et je vous dis : ‘N'aimez-vous pas votre père et votre mère et votre femme et
votre enfant? ‘ Quand on n'a pas un coeur étriqué on peut avoir plusieurs amours et moi mes
amours, je vous les ai dits, il y en a trois en tout cas, et Israël n'est pas le moindre. »2
Comment cet Hébreu à 100% évoquait-il la Suisse et que représentaient ce pays et ces habitants
pour lui et pour les personnages de son œuvre ?
La représentation des lieux et de leurs habitants, dans laquelle s’articulent réel et imaginaire,3 fait
l’objet de cette étude sur Albert Cohen et la Suisse, pays qui sert de toile de fond à la quasi-totalité
de ses œuvres. Certains personnages sont même emblématiques comme le pasteur Sarles, la tante
Valérie ou l’oncle Agrippa. Porteurs des vraies valeurs chrétiennes, ils sont aussi et avant tout
d’authentiques Genevois. L’imaginaire de Cohen en tant que mode d’appréhension du monde
helvétique sera en outre examiné à l’aune des mythes fondateurs de l’identité suisse. On utilisera ici
les concepts de topophilie définis comme une affection pour un lieu et de sociophilie désignant une
prédilection pour ses habitants.4 À l’opposé, la sociophobie renvoie aux signes de désaffection vis-à-
vis de la population de ce lieu.
Les symboles de la Genève humaniste
D’emblée, l’un des premiers textes publiés de Cohen, pourtant intitulé « Après-Minuit à Genève », a
été exclu de cette analyse car hormis son titre, rien ne le rattache à la Suisse, si ce n’est le caractère
cosmopolite de cette ville. Il existe en revanche une autre trace des toutes premières
représentations de la Suisse et plus particulièrement de Genève, par Albert Cohen. C’est un
document dactylographié de 17 feuillets, sans titre, dont le dictant est MC, qui se trouve dans le
dossier de correspondance entre Albert Cohen et Albert Thomas (1920 - 1932) aux Archives du
Bureau International du Travail5. C’est un texte qui n’a pas été publié sous son nom, ni sous la forme
que son auteur avait conçue. En réalité, il s’agit de l’ébauche d’un chapitre d’un ouvrage qui
1Christel Peyrefitte, Chronologie in Albert Cohen, Belle du Seigneur, 1986.
2 Jacques Bofford, « En Question », Albert Cohen, RTSR, 13 février 1978.
3 Antoine S. Bailly (1989) « L’imaginaire spatial. Plaidoyer pour la géographie des représentations » in Espace
Temps 40-41 pp 53-58. 4 Bertrand Lévy, Genève ville littéraire : de la topophobie à la topophilie, in Revue des Sciences humaines, 284,
oct-déc 2006, pp.135-149. 5 Fonds Cabinet Albert Thomas (CAT), Dossiers nominaux de correspondance, M. Albert Cohen 1920-1932.
2
21 juin 2013
s’apparente à un manuel scolaire : il a pour titre Lectures historiques et pour sous-titre « Histoire
anecdotique du travail ». Il a été signé par Albert Thomas qui a daté la préface en novembre 1925. Le
texte de Thomas qui nous intéresse compte 8 pages au format in-octavo et il constitue la 38e et
dernière lecture du recueil intitulée « Bureau international du Travail ».
Comme nous allons le voir, tout indique après examen de ces deux textes que c’est Albert Cohen qui
en a écrit le premier état. Thomas l’aurait repris ensuite en le modifiant à des fins didactiques et
militantes. Ce socialiste de la SFIO qui fut le premier directeur du BIT après avoir été ministre en
France alors qu’il n’avait que 36 ans, était aussi un intellectuel. Cacique de l’agrégation d’histoire en
1902, puis Docteur en histoire en 1910, il a écrit notamment une Histoire du Second Empire6et a
fondé la Revue syndicaliste7. Autant dire qu’il avait une solide expérience de la chose écrite.
Pourtant, il a sollicité l’aide d’Albert Cohen pour la mise en forme de ce texte et lui a fourni une
documentation pour son élaboration. Albert Cohen a travaillé comme volontaire au cabinet
directorial du BIT de mars à juin 1924. Le dossier de correspondance entre les deux hommes contient
des échanges entre un collaborateur du cabinet, M. Galois, et Albert Cohen dont ce texte est
vraisemblablement l’objet. « Avez-vous commencé l’étude dont le Directeur vous avait parlé sur
l’ «ouvrier» ? Dans ce cas, le Directeur serait très heureux que vous envoyiez par notre intermédiaire
ce que vous avez fait ou, en tout cas, que vous lui renvoyiez les documents qu’il vous a prêtés. »8
Quelques jours plus tard, M. Galois a relancé Cohen sur le thème des documents que Thomas
souhaitait récupérer car ce dernier avait « l’intention de rêver un peu à cette question et qu’il était
très désireux d’avoir, pendant ses vacances, quelques éléments pour s’occuper lui-même de celle-
ci. »9
Hormis ces indices, on trouve dans le texte dactylographié du dossier de correspondance la première
référence aux symboles de la Genève humaniste et internationale. Ce sont précisément ces
symboles que Cohen reprendra dans son œuvre, de Solal à Belle du Seigneur et sur lesquels il
reviendra longuement dans un entretien donné à la radio Suisse romande en 1978.
Dans le texte du prête-plume, le Mur de la Réformation avec les statues des quatre grands
réformateurs de Genève semblent « soutenir la vieille ville de leurs épaules gigantesques ». Ce lieu
de mémoire joue un rôle topographique (puisque le parc des Bastions prend appui sur le mur lui-
même) dans le même temps qu’il sert de base spirituelle sur laquelle la ville de Genève s’est
construite.
Dans l’œuvre de Cohen, les Valeureux ne s’y trompent pas et l’identifient à la Suisse. Ils s’inclinent à
diverses reprises avec respect devant le monument : « (…) et [contemplent] chapeau bas, la haute
statue du seigneur Calvin. - Il me plaît dit Saltiel. – Sévère dit Mangeclous. J’aime ça. – Vive la Suisse
dit Salomon. » (…) Après avoir chanté l’hymne national suisse, ils [vont] à la synagogue(…). » (Mg10,
614-615) Du reste, avant de se rendre à Genève, Salomon avait projeté de « baiser la main du
seigneur Calvin, le grand rabbin des Genevois ! » (Mg, 436)
6 Thomas, Albert, Le Second Empire, Histoire socialiste, Volume 10. Sous la direction de Jean Jaurès.
7 Gilles Candar, « Albert Thomas et la constitution des réseaux : les années 1878-1914 », Cahiers Irice n°2, article 370.
8 Lettre de M. H. Galois à Albert Cohen, Villa Annie, Chemin des Tulipiers, 15 juillet 1924.
9 Lettre de M. H. Galois à Albert Cohen, Villa Annie, Chemin des Tulipiers, 28 juillet 1924.
10 Sol = Solal, Mg = Mangeclous, BS, Belle du Seigneur, LV = Les Valeureux, LM = Le Livre de ma Mère, FH = Ô
Vous Frères Humains
3
21 juin 2013
Saltiel aussi s’approprie en quelque sorte Calvin en lui trouvant une ressemblance avec Moïse : « (…)
enfin un peu seulement car notre maître Moïse est incomparable, il a été le seul ami de l’Éternel (…)
Mais enfin ce Calvin me plaît beaucoup, sévère mais juste, et on ne plaisante pas avec lui ! » (BS, 132)
Les Valeureux observent une minute de silence devant le Monument « parce que le protestantisme
est une noble religion. » (BS, 132)
Les paroles du père de Rousseau à son fils Jean-Jacques, inscrites sur ce qui s’appelait autrefois le
bâtiment électoral à Genève, sont lues dans le texte du prête-plume de Thomas par un enfant à son
père : « (…)’Mon père m’embrassant fut saisi d’un tressaillement que je crois sentir et partager
encore : ‘Jean-Jacques, me dit-il, aime ton pays.’ » Un peu plus loin dans ce texte, l’enfant et son
père vont sur l’île où se trouve la statue de Rousseau, un « (…) grand homme de pierre qui semblait
méditer sans fin (…). » Dans l’entretien avec J. Bofford, Cohen évoque la découverte de cette
inscription lorsqu’il était tout jeune homme comme un des moments les plus importants qui aient
contribué à faire grandir en lui son amour pour la Suisse : « Et là, l'étranger sans véritable patrie
puisque je n'étais pas français, puisque j'étais né en Grèce, tout d'un coup a eu un sentiment de
tristesse ; il n'avait pas auprès de lui un père qui pouvait lui dire :"Aime ton pays" et ça a été le
commencement très vague, très incertain, d'une affection (…). »
On trouve la statue de Rousseau dans Solal (Sol, 144). Elle joue un rôle de contrepoint qui met en
exergue le clivage de la société genevoise. Il y a d’une part les privilégiés, qui appartiennent à la
bonne société et d’autre part il y a les humbles: « Devant lui [Solal] était la statue officielle et
romaine du vagabond pisseux traqué par les officiels. ‘Jean-Jacques Rousseau, je suis perdu. J’ai
vingt-et-un ans et je n’ai pas un sou. Si tu savais comme Adrienne m’a parlé. (…) Elle vit
confortablement chez le pasteur Sarles. Tu n’as jamais eu une maison comme ça, toi. C’est là-bas à
Cologny, juste en face de toi. Beau parc. Elle souffre moralement et elle a de beaux bijoux.‘ » (Sol,
144) La statue de Rousseau représente le Suisse modeste qui a une haute valeur morale. L’humilité
de Jean-Jacques Rousseau est antithétique des maisons du quartier huppé où vit le pasteur ainsi que
de la description du lac que la métaphore gemmologique rend précieuse et poétique: « (…) « Les
lampes à arc (qui) faisaient des stries dans l’émeraude où des perchettes vivaient leur vie. » (Sol, 144)
En fait, dans le texte définitif d’Albert Thomas, seule la statue de l’écrivain sur l’île Rousseau est
mentionnée11. Il n’a donc pas retenu l’idée de faire lire par les personnages la citation de Rousseau à
la gloire de la patrie.
Enfin, les mots inscrits sur le fronton de l’université, « Le peuple de Genève, en consacrant cet édifice
aux études supérieures, rend hommage aux bienfaits de l’instruction, garantie fondamentale de ses
libertés. » achèvent de nous convaincre que l’auteur de ce texte est bien de la main de Cohen. En
effet, ils sont murmurés par la mère de l’écrivain dans Le Livre de ma Mère qui ajoute : « Comme
c’est beau, (…) regarde les belles paroles qu’ils savent trouver. » (LM, 727)
Ils sont lus également par Saltiel : « Après nous sommes allés regarder l’université qui est juste en
face. J’ai appris par cœur la devise qui est gravée au-dessus de la grande porte (…) Cette phrase, c’est
un grand peuple qui l’a pensée, crois-moi. » (BS, 132)
11
Albert Thomas, Histoire anecdotique du travail, Lectures historiques, édition Bibliothèque d’Éducation, Paris, 1925, p.298.
4
21 juin 2013
Enfin, Cohen évoque, dans son entretien avec J. Bofford, les premiers jours après son arrivée en
Suisse et sa découverte du fronton de l'université, « J'avais été vraiment très frappé par cela, je
venais de Marseille qui était une ville un peu orientale, laisser-aller, on n'y parlait pas des garanties
fondamentales des libertés. » Il ajoute un peu plus loin, « Je me trouvais devant une cité d'une
noblesse qui m'étonnait.»
Lorsque Cohen a écrit le texte de commande destiné à servir les intérêts du BIT pour Thomas, il s’est
référé à un événement fondateur de sa propre identité de Suisse d’adoption. Qu’apprenons-nous de
ces représentations de la ville de Genève d’après la mention de ces trois symboles de l’esprit
genevois ? Au fond, dès le premier texte de 1924, Cohen nous fait entrer dans la Genève que nous
connaissons aujourd’hui, celle des organisations internationales sous les auspices des Réformateurs
qui donnent une dimension spirituelle à la ville tandis que la mention de Rousseau et du fronton de
l’université sont là pour en rappeler la vocation humaniste.
La topophilie
Tous les romans de Cohen comportent des mentions de la Suisse qui est présentée comme un gentil
pays (Mg, 370), sage et noble (BS, 129), solide (LM, 727), un chic pays (BS, 582) toutefois vulnérable
si l’on en croit Mangeclous qui lui destine trois mille drachmes, en 1938 il est vrai : « Pour vous
acheter quelques bons canons et faites attention, s’il vous plaît, du côté d’une certaine frontière,
hum, hum ! » (Mg, 438) À l’inverse, la mère de Cohen est admirative de sa solidité et de sa sagesse.
Elle « (…) faisait pour la Suisse des rêves de domination universelle, élaborait un empire mondial
suisse. (…) on devrait mettre de bons Suisses bien raisonnables, bien consciencieux, un peu sévères à
la tête des gouvernements de tous les pays. Alors tout irait bien. Les agents de police et les facteurs
seraient bien rasés et leurs souliers bien cirés. Les bureaux de poste deviendraient propres, les
maisons fleuries, les douaniers aimables, les gares astiquées et vernies, et il n’y aurait plus de
guerres.» (LM, 727) L’idée de la propreté de la Suisse découle de l’hygiène scientifique au XIXe siècle
alors que le pays s’illustre par ses établissements de cure en montagne pour les tuberculeux. La
propreté est amalgamée à l’image des cimes enneigées d’une blancheur immaculée qui font la
réputation de ce pays à l’étranger12. C’est une représentation commune à laquelle adhèrent à la fois
les Suisses et les touristes de passage13.
Dans l’œuvre de Cohen, Genève est plus particulièrement mise en valeur car les personnages
principaux (Solal, Aude, Ariane) y résident. Quand les Valeureux et Scipion s’y rendent, l’occasion est
donnée de montrer d’autres aspects de la ville vue par des Méditerranéens, un peu à la manière des
Persans qui découvrent Paris. Tous en louent la propreté : « la gare est repeinte une fois par mois »,
(LV, 834), d’après Mangeclous. Bien sûr, c’est aussi la patrie des banques que les Valeureux « en
quête d’un absolu bancaire » (Mg, 612) explorent avant que la salle des coffres « tout en acier » du
Crédit Suisse trouve grâce à leurs yeux. La ville est magnifiée et personnifiée par Scipion qui entonne
un chant à sa gloire en pleine rue, « Salut belle Genève, Ô ville de mes rêves ! » (Mg, 486). L’oncle
Saltiel, quant à lui, fait référence aux qualités morales prônées par la ville : « Petite république mais
grande par le cœur, patrie de la Croix-Rouge et de la bonté ! Quelle différence avec l’Allemagne ! »,
(BS, 131). Les métalepses de l’auteur résument bien ces points de vue : « Chère et belle Genève de
12
Geneviève Heller, Propre en ordre, Habitation et vie domestique 1850-1930 : l’exemple vaudois, Lausanne, 1979, 248 pages. 13
Jean-Bernard Racine, Claude Raffestin, Nouvelle Géographie de la Suisse et des Suisses, Vol 1, éditions Payot Lausanne,1990, p.36, 329 pages.
5
21 juin 2013
ma jeunesse et des joies disparues. Chère Suisse. Dans la chambre nocturne, je revois tes monts, tes
eaux, tes regards purs. » (Mg, 583) Il reprend presque mot pour mot la même formulation au terme
du chapitre consacré à l’oncle d’Ariane avec une coloration plus morale : « Chère Genève de ma
jeunesse et des joies anciennes, noble république et cité. Chère Suisse, paix et douceur de vivre,
probité et sagesse. » (BS, 565).
Toutefois Saltiel ose mentionner, devant le Sous-Secrétaire Général de la SDN, l’époque où Genève
n’était que marais putrides alors qu’en Orient « une ville superbe s’étendait (…) majestueuse et
couronnée, et peuplée d’une multitude d’enfants de Dieu(…). » (Mg, 558) La grandeur de Genève est
moins ancienne que celle de Jérusalem mais elle lui est tout de même comparable.
Tout comme la ville qu’il borde, le lac est propre, voire «probe» (Sol, 144). La mère de Cohen en
admire la pureté: « ‘Même leur eau est honnête’, disait-elle. », (LM, 727), rattachant cette
particularité physique à la qualité morale des habitants du pays et rejoignant le point de vue du
narrateur. Des métaphores inattendues définissent le lac comme « stylographique », dans Solal (Sol,
173), ou comme « une cuve d’encre bleue extra-fluide » (Mg, 609) et renvoient à l’activité littéraire
importante de l’auteur au début des années 30. Cette image insolite rappelle en outre le style très
libre du texte, « Après-minuit à Genève ».
Dans les œuvres postérieures à Solal, les représentations sont plus convenues quoique teintées
d’humour. « Quelle belle eau si propre, on paierait pour en boire. Ils en avaient de la chance ces
Suisses. » dit Saltiel (BS 133). Scipion Escargassas avec son parler marseillais savoureux admire le lac
en marin avec une petite restriction toutefois : « Le lac n’était pas mal du tout, un peu juste peut-
être (…). Et comme propreté, qué merveille ! Ils devaient le draguer tous les jours. Qué belle ville
quand même. Pas un papier par terre et ce lac qu’on dirait de l’eau minérale. » (Mg, 487).
Autre marque de la topophilie de l’auteur, la douceur d’un paysage aux tons pastel qu’Adrienne et
Aude traversent: « (…) elles se promenèrent sur la route d’automne où des promeneurs chantaient
un cantique en l’honneur du Jura bleu, du Salève rose un dernier moment et du lac cendré, aux rives
piquées de clignotements. » (Sol, 176). Nous sommes là dans le registre poétique de la
représentation d’un paysage comme un élément de décor, à la manière d’un arrière-plan reflétant
les états d’âme des personnages. Le Salève, synecdoque territorialisante14 de Genève, souvent
surnommé « la montagne des Genevois » est un lieu attribut très présent dans l’imagerie populaire
de la ville.
Les Alpes constituent l’un des éléments fondateurs de la conscience helvétique15. La Suisse est
perçue par les Suisses, mais pas seulement par eux, «comme le pays de l’idylle alpestre, non
corrompu par le progrès de la civilisation, synonyme de tous les maux (…).»16 En 1752, Albrecht de
Haller, dans son long poème intitulé Les Alpes, faisait de la Suisse un lieu privilégié où il fait bon vivre:
« L’eau pure est ta boisson, et le lait fait ta nourriture, mais l’appétit prête du goût aux glands
mêmes. Les mines profondes de tes montagnes ne te donnent qu’un fer grossier, mais le Pérou envie
ta pauvreté. » Certes la frugalité y est de mise mais le pays fait des envieux : « Toutes les peines sont
14
Bernard Debarbieux, Le lieu, le territoire et trois figures de rhétorique, Espace géographique, 24, 2, 1995, pp. 97-112. 15
André Reszler, Mythes et Identité de la Suisse, Georg, Genève 1986, p. 48. 16
Malgorzata Szymanska, «Construction et déconstruction des mythes suisses» in Acta Philologica, 31, Warszawa 2005, pp. 99-108.
6
21 juin 2013
légères où règne la liberté, les rochers y portent des fleurs et Borée [le vent du Nord] y radoucit son
souffle impétueux. ».17 La liberté a autant d’effets miraculeux sur les personnes que sur
l’environnement naturel, même le vent du Nord mollit.
Cependant, pour les Valeureux, le paysage alpin joue un rôle dramatique car les montagnes
impressionnent ces Méditerranéens. Avec leur exagération coutumière, ils projettent sur l’ensemble
du pays la rudesse du climat en altitude. Ils relayent du même coup l’idée que les habitants des
hautes montagnes mènent une vie courageuse, ce qui correspond à une autre vision emblématique
de la Suisse, le milieu hostile façonnant une « humanité forte »18 aux bras noueux.
Pour Salomon, Genève est «la ville des glaciers sublimes » (Mg, 434). Afin de se prémunir contre le
froid terrible qui, croient-ils, les attend, les Valeureux se procurent des caleçons fourrés et se
tapissent la poitrine avec des journaux (Mg 485), ou encore Mangeclous, prêt à quitter l’île de
Céphalonie pour la Suisse, «chausse des souliers de montagne, déclarés indispensables en Suisse et
ferrés de crampons à glace » (LV, 956). C’est la mère d’Albert Cohen qui, en orientale, exprime avec
le plus de force le sentiment d’étrangeté que lui inspire l’attrait de la montagne : « Mon fils explique-
moi ce plaisir que tu as à aller à la montagne. Quel plaisir, toutes ces vaches avec leurs cornes
aiguisées (…). Mon cœur tremble comme un petit oiseau quand je vois ces skis dans ta chambre. Ces
skis sont des cornes du diable. Se mettre des yatagans aux pieds, quelle folie ! (…) mais toi tu es un
Cohen, de la race d’Aaron, le frère de Moïse, notre maître. Je lui rappelai alors que Moïse était allé
sur le mont Sinaï. Elle resta interloquée. Évidemment, le précédent était de taille. » (LM, 710)
Dans Solal, la Suisse est évoquée en des termes qui rappellent ceux que l’on utilise pour la terre
promise, pays où coule le lait et le miel. Du reste, le parallèle établi entre les Alpes et le Mont Sinaï
corrobore encore cette idée. Les Valeureux, consolant Saltiel de l’absence de son cher neveu, lui
proposent de faire un petit voyage d’agrément : « Un bon petit tour en Suisse où toutes les villes
sont sur des montagnes et où le lait a un goût d’amande qui te rajeunit. » (Sol, 243)
La sociophilie
Dans un registre analogue - on ne parlera plus de topophilie, car cela ne concerne plus les lieux mais
de sociophilie puisqu’il s’agira de la représentation des habitants - Ariane dans sa marche triomphale,
croise « trois vierges aux tresses de miel, (…) trois petites paysannes suisses qui allaient d’un pas
hardi et incertain de bergeronnette, chantant avec des décochements brusques, avec une
miraculeuse sécurité instinctive. » (BS, 584). Nous sommes ici à la croisée de plusieurs mythes : celui
des paysans qui peuplent la Suisse : « une race de montagnards simples, aux mœurs austères, mais
au cœur pur et à l’esprit frais, [qui] habite ce paysage encore intact. »19 Il y a aussi le sentiment de
sécurité inhérent à la topographie de la Suisse, son « insularité foncière »20, qui la tient à l’abri des
difficultés, car les Alpes forment une sorte de «citadelle naturelle et providentielle»21 mettant ses
habitants à l’abri des invasions étrangères. Haller, en 1752, évoquait la Nature qui a élevé les Alpes
pour séparer la Suisse du monde «parce que les hommes procurent aux hommes les plus grands
malheurs».
17
Albrecht de Haller, Les Alpes, éditions Heidegger et Compagnie, Zurich, 1752, p. 5. 18
Jean-Luc Piveteau, « L’Ancien Testament a-t-il contribué à la territorialisation de la Suisse ? », Social Compass, 40, 1993, pp. 159-177. 19
André Reszler, Mythes et identité de la Suisse, Georg éditeur, Genève, 1986 p. 59. 20
Ibidem, p. 10. 21
Ibidem, p. 60.
7
21 juin 2013
Le sentiment de sécurité provient également de la régularité des jours :
« La vie s’écoule dans une paix inaltérable,
« Le présent ressemble au passé. »22
Quant aux tresses de miel des petites paysannes, elles renvoient à la Suisse paradisiaque23, l’Eden
helvétique où coulent le lait et le miel, leur allure de bergeronnette les rend proches de la nature au
sein de laquelle elles se fondent dans leur grande simplicité.
L’intensité du rapport à Dieu est une des caractéristiques de l’identité suisse. Il arrive même que le
rapprochement entre la Suisse et Israël soit fait car, pour les deux pays, le sentiment national
procède d’un « lien » originel avec Dieu. En effet, si la fondation de la Confédération résulte de la
volonté divine, rien n’empêche les Suisses « d’entretenir l’idée qu’ils étaient un peuple choisi ». C’est
ce qu’ils ont fait vers la fin du XIXe siècle.24 L’examen détaillé de cette problématique par Piveteau à
propos de la territorialisation de la Suisse inspirée par l’Ancien Testament, c’est-à-dire des
rapprochements que l’on peut faire entre « l’Israël vétéro-testamentaire » et la Suisse25, montre à
quel point l’idée peut encore être prégnante aujourd’hui.
Le pacte fédéral signé au Grütli commence ainsi : « AU NOM DU SEIGNEUR, AMEN. C'est accomplir
une action honorable et profitable au bien public que de confirmer(…) les mesures prises en vue de la
sécurité et de la paix. » Il se termine par ces mots : « Les décisions ci-dessus consignées, prises dans
l'intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité; — Fait en l'an du Seigneur
1291 au début du mois d'août. » 26 Aujourd’hui encore, le préambule de la Constitution fédérale
acceptée en votation populaire le 18 avril 1999, et entrée en vigueur le 1er janvier 2000, débute par
ces mots : « Au nom de Dieu Tout-Puissant! Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur
responsabilité envers la Création, résolus à renouveler leur alliance, arrêtent la Constitution que voici
[…] .»27
Comment s’étonner dès lors, que quelques personnages, dont certains présentent de nombreuses
ressemblances, incarnent l’esprit suisse associé aux valeurs chrétiennes dans ce qu’elles ont de plus
exemplaire. Ce sont le pasteur Sarles, le grand-père d’Aude dans Solal, la tante Valérie (tantlérie) et
l’oncle Agrippa d’Ariane, dans Belle du Seigneur.
La famille d’Ariane appartient à l’aristocratie genevoise. Sa tante est connue à Genève pour
l’austérité de son apparence (BS, 13). Très charitable, elle consacre une grande partie de ses revenus
à de bonnes œuvres ainsi qu’à une société qui a pour but de « sauvegarder la beauté de Genève.»
(BS,13) Elle a une vision dichotomique du monde qui se partage entre élus et réprouvés, la plupart
des élus étant genevois (BS, 13), les autres pouvant (à la rigueur) être écossais car l’Écosse tout
comme Genève fut profondément marquée par le calvinisme. Toutefois, pour elle, il ne suffit pas
d’être genevois et protestant, il faut aussi « se sentir genevois et non suisse : (…) ‘La république de
Genève est alliée à des cantons suisses, mais à part cela nous n’avons rien de commun avec ces
22
Albrecht de Haller, Op.Cit., p. 8. 23
Peter Bichsel, La Suisse du Suisse, L’âge d’Homme, La Cité , 1970, p. 15. 24
Georg Kreis, « La question de l’identité nationale » in Paul Hugger, Les Suisses, modes de vie, traditions, mentalités, Tome II, Payot, Lausanne, 1992, pp. 781-800. 25
Jean-Luc Piveteau, « L’Ancien Testament a-t-il contribué à la territorialisation de la Suisse ? », Social Compass, 40, 1993, p. 159-177. 26
Pacte fédéral du 1e août 1291 http://www.admin.ch/org/polit/00056/index.html?lang=fr.
27 http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/101.fr.pdf.
8
21 juin 2013
gens.‘ Elle considère tous les autres Confédérés comme « des étrangers, au même titre que les
Chinois.», explique Ariane(BS, 13).
C’est une patriote affirmée qui se brouille avec une princesse anglaise car elle a osé faire « une
plaisanterie sur Genève. » (BS, 16) Tout ce qui concerne sa ville la touche au point qu’elle tance des
membres du gouvernement genevois si elle remarque au cours d’une promenade «quelque
imperfection (…) rampe descellée, ferrure menaçant de tomber.» (BS, 15) Ce sont là des traits bien
observés par Cohen tant il est vrai qu’en Suisse chacun se sent personnellement concerné par les
aménagements urbains et se tient prêt à intervenir auprès des autorités compétentes s’il remarque
une dégradation d’un lieu ou d’un monument public. Ce comportement résulte d’un esprit citoyen
bien enraciné.
Le pasteur Sarles et l’Oncle Agrippa forment des figures tutélaires aussi sympathiques qu’attachantes
pour lesquelles le narrateur dit son affection : « (J’aime ce vieux pasteur.) » (Sol, 150) Solal, lui-
même, exprime sa tendresse aussitôt qu’il l’aperçoit : « Il (…) considéra avec soulagement la calotte
et les mains tremblantes du pasteur et aima le cher vieil homme qui (…) entreprit aussitôt le jeune
Israélite sur la langue araméenne. » (Sol, 165).
Tous deux débordent d’amour pour leur protégée, que ce soit Aude dans Solal ou Ariane dans Belle
du Seigneur et accèdent à toutes ses demandes. Le pasteur, malgré son âge, accepte de prendre
Aude dans ses bras et de la porter dans sa chambre (Sol, 242). Ariane téléphone en pleine nuit à son
vieil oncle Agrippa afin qu’il vienne lui tenir compagnie car elle ne trouve pas le sommeil (BS, 563-
564).
Autre trait commun, par bonté, ils supportent vaillamment la présence de femmes qui les
tyrannisent. Le pasteur Sarles, « timide hors les moments de religion » (Sol, 152) a une épouse qui
sous une apparente douceur est une sorte de «mante religieuse qui croque son mari. » (Sol, 151)
L’oncle Agrippa, par un sens aigu du devoir, héberge charitablement Euphrosine, vieille, capricieuse
et malade, qui est l’ancienne cuisinière de sa sœur (BS, 556).
Enfin, ils partagent la même passion pour la vie de Calvin qui allie la spiritualité au patriotisme
genevois. On sait ce que le théologien a apporté comme rayonnement à la ville de Genève que l’on
nomme par périphrase « la cité de Calvin » et ce qu’il représente pour Cohen depuis son arrivée à
Genève. Le pasteur Sarles souhaite distraire sa petite fille de la tristesse par une anecdote sur
l’enfance de Calvin. « Il paraît que notre réformateur, lorsqu’il avait dix ans, jouait aux billes. » (Sol,
242) L’oncle Agrippa est lui-même rédacteur d’une biographie de Calvin (BS, 564).
Ancien médecin bénévole pour les Missions évangéliques en Afrique (BS, 554), Agrippa vit très
modestement, porte des vêtements sans vanité ni coquetterie. « Malgré costume râpé et souliers
ferrés, très distingué » dit Ariane. Elle ajoute : « Peu de besoins matériels, et pourtant il habite une
belle villa. Il n’y a contradiction qu’en apparence. Dernier descendant mâle des Auble, il croit devoir à
son nom de vivre dans un cadre digne de ses ancêtres. C’est un petit travers. Quel saint en est
dépourvu ? » (BS, 553) Le beau portrait qu’Ariane dresse de son oncle dans une lettre à Solal, montre
les différentes facettes du Genevois dans son humilité réelle et perceptible par tous. Roger
Francillon28 voit dans l’absence d’ostentation et l’hostilité au luxe certaines des spécificités
helvétiques en matière de valeurs morales. Il en parle à propos de M. de Wolmar dans La Nouvelle
Héloïse (1761). Ce que confirme Albrecht de Haller pour qui la frugalité est garante du bonheur des
Helvètes : Peuple heureux (…) à qui le Destin favorable a refusé l’abondance, cette riche source de 28
Roger Francillon, De Rousseau à Starobinski, « Littérature et identité suisse », Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2011, p. 26.
9
21 juin 2013
tous les vices. Celui qui est satisfait de son état, trouve son bonheur dans l’indigence même, pendant
que la pompe et le luxe sapent les fondements des Etats. »29.
L’oncle Gri, qui possède des décorations dont la Légion d’honneur, et qui est un grand médecin
auquel le journal de Genève consacre un article élogieux (BS, 554) reste malgré tout d’une timidité
maladive.
Il est aussi modeste que charitable et généreux : « C’est un vrai chrétien, une sorte de saint, si plein
de bonne volonté, si prêt à aimer et à comprendre, à être l’autre, ayant détruit tout amour de soi,
préférant autrui à lui-même. » (BS, 555). Il n’envoie de notes d’honoraires qu’aux patients les plus
fortunés et n’en garde qu’une partie pour subvenir à ses modestes besoins, le reste étant destiné aux
nécessiteux. (BS, 555). Dans une métalepse, Cohen conclut ainsi son portrait : « Cher vieil Agrippa,
bon et doux chrétien, je t’ai aimé et tu ne t’en es jamais douté. » (BS, 565)
Il est encore un Suisse qui attire la bienveillance du narrateur et témoigne de sa sociophilie : le petit
père Deume, « le gentil Hippolyte, petit barbichu moustachu», « un tout petit bourgeois d’origine
vaudoise, ancien comptable.» (BS, 23) Lui aussi est affligé d’une femme au caractère difficile, la mère
Deume, et est attendri par sa belle-fille Ariane. Il valorise une Suisse pragmatique et confortable où
les trains arrivent à l’heure. De retour de Nice, il se réjouit d’être en Suisse « où on savait se
chauffer», pays sans histoire dont les « ouvriers si raisonnables ne demandaient pas tout le temps
des augmentations ! La petite Suisse avec son franc solide, à la bonne heure ! Et les conseillers
fédéraux une fois élus, eh bien on leur laissait faire leur travail en paix pendant de longues années,
jusqu’à leur mort. Tandis qu’en France, tous les trois mois un nouveau ministère ! » (BS, 633)
Hippolyte vante les fonctionnaires de poste, de chemin de fer ou de douane bien vêtus et si corrects :
« Il avait le frisson rien que de penser à ces douaniers français avec leurs pantalons en tire-bouchons,
leur képi de travers et leur mégot socialiste à l’oreille. Tandis que les bons douaniers suisses si
gentils avec leur beaux uniformes (…) à la bonne heure ! » (Mg, 630)
Sociophilie encore, lorsque les Valeureux mentionnent les qualités morales des habitants. Saltiel
compare quelques peuples d’Europe : « Les Français ont la gentillesse, les Anglais sont plus hauts que
les Babyloniens, les Italiens ont le cœur jeune et les Allemands des mélodies qui font pleurer. Et qui
est honnête, libre, indépendant comme le Suisse ?» (Sol, 340) Ce sont les mêmes traits qui sont
repris par Salomon, qui y ajoute la vertu et la tempérance des comportements dans une Suisse où les
opinions extrémistes n’existent pas, du moins de son point de vue car Salomon est le plus candide
des personnages : « Les pâtres ! La liberté ! L’honnêteté ! La vertu ! L’indépendance ! Pas de fascistes
ni de communistes qui [lui] donnaient la chair de poule ! » (Mg, 613) Dans son université à
Céphalonie, Mangeclous transmet le même message lorsqu’il propose à ses « étudiants » « un cours
de géographie avec description de Genève, ville honnête où tu peux laisser ton portefeuille sur le
banc d’un jardin, et la police te le rapporte tout de suite à l’hôtel, sans te demander un pourboire. »
(Mg, 888). Cohen, dans son entretien avec J. Bofford, avait raconté sa surprise lorsqu’un jour, il avait
oublié son portefeuille sur la banquette de la brasserie Landolt à Genève et que le serveur l’avait
poursuivi dans la rue pour le lui rendre : « Je me suis dit, tiens, c'est un pays où on rend les
portefeuilles. J'étais un peu épaté, ce garçon de café qui vient me rendre mon portefeuille, ces
gendarmes qui sont si bien habillés, alors que les agents de police de Marseille ont toujours une
cigarette à l'oreille, ils ont des rouflaquettes, on voyait ces agents de police, ces facteurs, tous
29
Albrecht de Haller, Op.Cit., p. 4.
10
21 juin 2013
tellement ‘ordrés’, comme on dit à Genève, tout cela faisait pour moi un tableau de quelque chose
de nouveau et vraiment de très important. » 30
La modestie et l’honnêteté sont depuis longtemps l’apanage des Suisses. En fait, depuis le XIXe
siècle, les récits de voyage ont véhiculé en Europe « une image idéalisée de la Suisse », « un paradis
sur terre habité par un peuple doté de toutes les vertus, libre, simple, travailleur, vivant en symbiose
avec une nature splendide (…) fidèle à ses traditions ancestrales et par là même capable de résister à
la corruption du monde moderne. »31 Dans sa Lettre sur les voyages écrite en 1728, Beat de Muralt
n’exprimait pas autre chose lorsqu’il évoquait la grandeur de son peuple : «Heureuse nation (…) la
simplicité et la droiture ont été son partage. (…) Une heureuse obscurité, un genre de vie éloigné de
toute ostentation, autant que de toute mollesse(…). »32
Quant à la liberté et l’indépendance soulignées par Salomon, ce sont deux valeurs âprement
défendues qui reposent sur le même socle mythique désignant la Suisse comme le « berceau de la
démocratie européenne » ou encore comme une « démocratie témoin ». La mentalité collective
suisse s’est construite sur le concept de « Sonderfall Schweiz » : la Suisse est considérée comme un
cas particulier, une île au sein de l’Europe.33 Elle occuperait une position singulière au sein des
nations. Petit pays comparé aux grands pays qui l’entourent, son régime était républicain alors que
les états voisins étaient encore des monarchies, la diversité linguisitique et religieuse qui la
caractérise lui confère ainsi un statut d’exemplarité.34
En ce qui concerne l’indépendance, elle était encore assez récemment d’actualité35 avec le refus
opposé par le peuple suisse à une éventuelle adhésion à l’Union Européenne pour divers motifs dont
le principal était justement la volonté de conserver la neutralité et l’indépendance en cas de conflit.36
La fameuse neutralité helvétique ne résulte pas d’une volonté d’abstention, ce serait une forme de
solidarité universelle se concrétisant sous la forme d’activités humanitaires et de lieu de rencontres
internationales.37
La sociophobie
En fait, Cohen ne verse pas dans l’angélisme et il lui arrive de souligner sur divers modes,
humoristique ou ironique, les travers des Suisses.
La spontanéité méridionale de Scipion Escargassas qui, chantant son ode à Genève dans la rue, est
prié par un gendarme de se taire, donne à Cohen l’occasion de montrer à quel point les Suisses sont
réservés : « Évidemment, les Genevois étant distingués, il fallait pas les brusquer. » Il décide de
s’adapter aux mœurs locales sans plus de succès : « L’âme aimable, il alla le long de la rue du Mont-
30
J. Bofford, entretien cité. 31
Malgorzata Szymanska, « Construction et déconstruction des mythes suisses » in Acta philologica, 31, Warszawa, 2005, pp. 100-108. 32
Cité par Roger Francillon, De Rousseau à Starobinski, Littérature et identité suisse, Presses Polythechniques et universitaires romandes, pp. 22-23. 33
Didier Froidevaux « Construction de la nation et pluralisme suisses : idéologies et pratiques » Swiss Political Science Review, 3 (4) :pp. 1-58. 34
Georg Kreis, Dictionnaire historique de la Suisse, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F49556.php. 35
Référendum de 1992, 50.3 % opposent un non à l’adhésion à l’Espace Économique Européen. 36
Paul Luif, « L’élargissement de la Communauté aux pays de l’AELE » in Politique étrangère, n°1, 1993, Vol 58, pp. 63-77. 37
Yves Fricker, « La construction européenne et la cohésion nationale suisse : une fois encore le ‘Sonderfall Schweiz’ ? », La Suisse et son avenir européen, Payot, Lausanne, 1989, pp. 253-259.
11
21 juin 2013
Blanc, avide de sympathie et décidé à trouver tout bien. La bise était un peu aigre. Eh bien c’était pas
désagréable. (…) Fais anttention, pas de gros mots, qué Scipion ? Que ici, ils sont polis, genre les
riches. Te fais pas mal voir, hé ? » (Mg, 486)
Les déambulations des Valeureux dans leurs déguisements leur valent les huées amusées des
promeneurs genevois (Mg, 541, 612). Ce conformisme de la population reste toutefois bon enfant.
Lorsque Cohen avoue que pour que sa mère se sente à l’aise, il leur « est arrivé de manger
subrepticement des pistaches salées dans la rue, comme de bons frangins méditerranéens qui
n’avaient pas besoin, pour s’aimer, d’avoir une conversation élevée et de se jouer des comédies de
distinction» (LM, 727), en creux, c’est la même retenue des Genevois qui est désignée, augmentée
d’une pointe sur l’affectation des rapports sociaux.
Enfin, le calme qui règne en Suisse ne satisfait pas Mariette qui s’y ennuie : « (…) vous savez la Suisse
moi c’est pas dans mon tempérament étant française parce que chez nous la France c’est varié il y a
toujours du nouveau, tandis qu’ici la Suisse c’est la tranquillité ça fait monotonie (..). » (BS, 494)
Le pays n’est pas toujours accueillant. Pour peu que l’on soit assez puissant comme le père d’Aude de
Maussane qui est sénateur, il est possible de demander à Berne l’expulsion d’un étranger (Sol, 169).
Il arrive également que des personnes qui pourraient être de grands talents, voire des génies comme
leurs homonymes, au prétexte qu’elles sont démunies, soient dépréciées et tenues de se contenter
de petits emplois, ce que raille à sa façon Cohen : « Sur le quai le commissionnaire Einstein discutait
avec son ami Samuel Spinoza, le petit changeur et vendeur de pistaches. » (Sol, 173)
Par moments, Cohen a une vision plus aiguë d’une société où les inégalités sont importantes et qu’il
dénonce de façon cinglante. Que l’on songe à Ariane aménageant son petit salon afin d’y accueillir
son amant : tout y est savamment étudié, le miroir, le canapé, le tapis. « De plaisir, elle aspira
longuement tandis qu’au même moment un nommé Louis Bovard, ouvrier âgé de soixante-dix ans,
dépourvu de piano et même de tapis persan, trop âgé pour trouver de l’embauche et seul au monde,
se jetait dans le lac de Genève, sans même en admirer les teintes délicates et les subtiles harmonies.
Car les pauvres sont vulgaires, ne s’intéressent pas à la beauté, à ce qui élève l’âme, bien différents
en vérité de la reine Marie de Roumanie qui dans ses mémoires a béni la faculté que Dieu, paraît-il,
lui a donnée ‘de ressentir profondément la beauté des choses et de s’en réjouir ‘. Délicate attention
de l’Éternel. (…) » Peu après Ariane essaie un peignoir de soie : « Parvenue à la conclusion que le
peignoir était bien, elle sourit amicalement à Mariette et, de satisfaction, aspira de nouveau par les
narines tandis que l’eau du lac de Genève entrait dans celles de Louis Bovard. » (BS, 568-569)
Avec l’habileté narrative que nous lui connaissons, Albert Cohen opère le glissement d’un tableau à
l’autre par le truchement de l’aspiration de contentement d’Ariane à laquelle fait tragiquement écho
le suicide de Bovard dans les narines duquel l’eau du lac s’infiltre et le noie. L’aspiration (de l’air et de
l’eau) forme un parallélisme qui souligne avec force l’antinomique condition des deux personnages
et rend la critique d’autant plus incisive qu’elle se fait à froid, de façon distancée. La charge vise la
société suisse qui n’échappe pas aux inégalités sociales, tant s’en faut, mais elle n’est pas
exclusivement menée contre elle dans la mesure où la cible se déplace ensuite vers la reine de
Roumanie et même vers Dieu.
Dans une longue scène à la fin de Belle du Seigneur, Solal erre de café en café à Genève. Sa
candidature à un poste même subalterne vient d’être refusée, les clients parlent de la dévaluation
du franc suisse qui vient d’être annoncée. Il se joint alors à la conversation : « (…) l’apatride s’est
rapproché j’ai soutenu avec feu que la dévaluation était le salut pour notre pays le vieux m’a
approuvé il a dit parfaitement tous les bons citoyens doivent penser comme monsieur il m’a serré la
12
21 juin 2013
main (…) c’était bon de dire notre pays (…) notre chère patrie suisse. » (BS, 876) L’homme se
présente mais Solal n’ose pas dire son nom et prétend, peu après, qu’il est consul de Suisse à
Athènes : « (…) il m’a demandé si le consul de Suisse était aussi bien vu que les consuls des grands
pays je lui ai dit mieux vu parce que nous sommes honnêtes nous on le sait et on nous respecte il a
eu un petit rire rengorgé il a dit ah nom d’un chien nous les Suisses on n’est pas des brigands comme
tous ces Balkaniques alors j’ai renchéri j’ai dit chez nous en Suisse on ne fraude pas le fisc il m’a offert
un cigare noir dangereux je l’ai fumé jusqu’au bout pour l’amour de la Suisse (…). » (BS 876)
L’apatride se fait aussi patriote que les «vrais» suisses. L’insistance marquée par le choix du pronom
«nous», marque d’inclusion et d’assimilation, est en même temps forcément un renoncement à son
identité. Ce renoncement se concrétise par l’usurpation d’un nom de famille typiquement tessinois,
Motta, qui se trouve être le nom d’un conseiller fédéral dont Solal prétend être le neveu : «(…) alors
il (M. Sallaz) m’a regardé avec un respect une tendresse qui m’ont fait mal (…).» (BS, 877) Solal se
cache derrière une fausse identité pour se faire accepter, surenchérit dans le patriotisme et
l’exaltation des vertus helvétiques, - c’est lui qui parle de l’honnêteté des Suisses qui force le respect
des autres, - et en même temps il dit son amour de la Suisse qui est réel malgré le rejet dont les
étrangers et par conséquent lui-même font l’objet. Ce que Sallaz confirme en parlant avec mépris des
Balkaniques qui sont, dit-il, des brigands.
Puis Solal exalte « les libres institutions helvétiques leur stabilité leur sagesse les monts indépendants
le Ranz des vaches ». Les monts indépendants est le titre de l’ancien hymne national suisse
abandonné en 1961 et remplacé par le Cantique suisse. Le Ranz des vaches est une très ancienne
chanson que les bergers (les «armaillis» en patois) entonnaient pour appeler les vaches au moment
de la traite. Il était déjà connu au XVIe siècle. Rousseau avait mentionné dans son Dictionnaire de la
Musique (1768) le fait que le chant était interdit pour les gardes suisses. Solal explique que Louis XIV
avait interdit de chanter le Ranz en France sous peine d’emprisonnement à perpétuité car « lorsque
les soldats au service du roi entendaient le Ranz des vaches ils désertaient si grand est notre amour
pour notre patrie si grande notre nostalgie de nos montagnes nos chers alpages, je ne plaisantais pas
j’étais ému (…). » (BS, 877) On le voit, les symboles les plus forts de l’identité suisse sont convoqués
dans ce moment pénible de la vie de Solal . Bien qu’il souffre d’exclusion, l’étranger témoigne de sa
connaissance et de son amour pour les rites typiquement helvétiques. Mais dans ce cas, c’est un
amour à sens unique.
L’antisémitisme existe en Suisse même s’il est loin d’être généralisé ; on se souvient de la réaction du
pasteur Sarles lorsqu’il apprend que celui qui a enlevé sa petite fille Aude est Juif : « La pensée que le
jeune homme appartenait au peuple de Dieu avait été d’un certain réconfort pour le bon pasteur
(…). » (Sol, 268) Mais il arrive que Solal soit confronté à l’insulte antisémite lorsqu’il marche dans la
rue des Pâquis « que de pâles ampoules pendues à un fil badigeonnaient de lait frelaté. Après un
coup d’œil en stylet sur un mur où était tracée à la craie une injure aux Juifs, il entra dans un bar. (…)
Une heure plus tard, (…) accoudé à une fenêtre de l’hôtel Ritz, (…) il contemplait Genève, sagement
illuminée. » (Mg, 583) La dénonciation de l’antisémitisme prend toute sa force dans ce contraste
avec la paix nocturne de la ville à laquelle on comprend alors qu’il ne faut pas trop se fier.
À la fin de Belle du Seigneur, la descente aux enfers de Solal se poursuit dans un autre café. Ce
passage rappelle à plus d’un titre l’épisode du camelot dans Ô Vous Frères Humains. Les clients
désapprouvent la dévaluation et en imputent la responsabilité aux Juifs : « (…) le béret basque avec
de la couperose a dit c’est les Juifs qui ont voulu la dévaluation et puis tous ces grands magasins ces
13
21 juin 2013
prix uniques c’est tout youpin et compagnie ça ruine le petit commerce ils mangent notre pain après
tout on leur a pas demandé de venir chez nous à mon idée on devrait les traiter un peu comme en
Allemagne vous voyez ce que je veux dire mais quand même sans exagérer parce que quand même il
y a une question d’humanité, un petit enfant comment me réjouir en le voyant sourire je suis hanté
par l’adulte qu’il sera adulte à canines rusé affreusement social haïsseur de Juifs lui aussi, (…). » (BS,
878) Le cynisme de l’homme imprègne ce passage mais on ne sait rien de la réaction de Solal. Le
monologue intérieur conduit par association d’idées au point de vue de Solal qui est aussi celui de
Cohen sur les enfants qui deviendront, une fois adultes, des méchants. C’est cette idée qui est
reprise dans Ô Vous Frères Humains : «Car j’aime, et lorsque je vois en son landau un bébé
aimablement m’offrir son sourire édenté, angélique sourire tout en gencives, ô mon chéri, cette
tentation de prendre sa mignonne main, (…) mais aussitôt cette hantise qu’il ne sera pas toujours un
doux bébé inoffensif, et qu’en lui dangereusement veille et déjà se prépare un adulte à canines, un
velu antisémite, un haïsseur qui ne me sourira plus. » (FH, 1042)
Albert Cohen porte un regard nuancé sur sa patrie d’adoption. En même temps qu’il adopte l’angle
de vue des étrangers sur la Suisse (par le biais des Valeureux ou de la mère), il fait siens certains
auto-stéréotypes positifs des Helvètes comme l’action humanitaire ou le modèle de liberté et
d’indépendance.38 Les observations de Cohen sont très ancrées dans la réalité helvétique. Il y a près
de 23% d’étrangers en Suisse39. Il est fréquent que la population immigrée vive en vase clos, a fortiori
à Genève, ville internationale , sans trop se soucier d’intégration et encore moins d’appropriation des
valeurs helvétiques. Ce n’est pas le cas de Cohen. Les représentations de la Suisse et des Suisses
dans son œuvre dessinent les contours d’une géographie imaginaire riche qui puise aux sources des
mythes fondateurs helvétiques et qui témoignent d’une connaissance approfondie du pays.
38
Yves Fricker, Les traits d’Helvetia, Revue suisse de sociologie, 1988, pp. 95-112. 39
Données de l’Office fédéral de la statistique pour l’année 2011, disponibles à l’adresse ci-après : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/07/blank/key/01/01.html