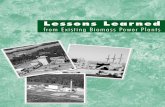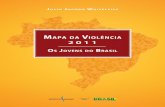AAC056 - HMONP 01 - L IMPRUDENCE de S BURLAT
Transcript of AAC056 - HMONP 01 - L IMPRUDENCE de S BURLAT
H a b i l i tat i o n . a . l a . M a i t r i s e . d ' O e u v r e .en.Nom.Propre-HMONP-ENSAL-2012-HAYET
19072012
L'IMPRUDENCEde Stéphane BURLAT
L'IMPRUDENCEStéphane BURLAT
Synthèse des travaux pédagogiques du postulant
Stéphane BURLAT dans le cadre de "L'Habili-
tation à la Maitrise d'Oeuvre en Nom Propre",
H.M.O.N.P., École Nationale Supérieure d'Archi-
tecture de LYON, sous la direction de William
HAYET. 19072012
AAC056-7029
SOMMAIRE
AAC056-7031 SOMMAIREAAC056-7034 MEMOIREAAC056-7035 - Stephane BURLATAAC056-7035 - L'IMPRUDENCEAAC056-7041 - INTRODUCTIONAAC056-7045 - LE CHOIXAAC056-7055 - THEORIE(S)AAC056-7057 - QUELS ARCHITECTES PRÉPARONS-NOUS?AAC056-7065 - QUELLES COMPÉTENCES VISONS-NOUS?AAC056-7069 - QUELLE STRATÉGIE POUR L'E.N.S.A.L.?AAC056-7073 - EXEMPLE CONCRET POUR LES PLUS SCEPTIQUESAAC056-7077 - ARCHITECTURES ET PHILOSOPHIESAAC056-7079 - LES FONDEMENTS THÉORIQUESAAC056-7087 - POLITIQUE ET MOUVEMENT MODERNEAAC056-7095 - MOMENT POSTMODERNEAAC056-7107 - PRATIQUE(S)AAC056-7111 - LA RELATION ENTREPRENEURS-MAITRISE D'ŒUVREAAC056-7111 - SUIVI DE CHANTIERAAC056-7119 - LA RELATION MAITRE D'OUVRAGE-MAITRE D'ŒUVREAAC056-7119 - LA DÉLÉGATION DE POUVOIRAAC056-7125 - NOUVEAU PROJETAAC056-7129 - LA RELATION ARCHITECTE-MAITRE D'ŒUVREAAC056-7129 - LES DEVOIRSAAC056-7133 - CONCLUSIONAAC056-7139 - L'IMPRUDENCEAAC056-7143 - ANNEXES - FICHES PROJETS:AAC056-7146 BIBLIOGRAPHIEAAC056-7148 INDEX
AAC056-7031
AAC056-7037
« Dans leur dérive, Clément et Anne-Marie devenaient plus durs, plus compacts, plus rapides et intuitifs. Ils apprenaient, sans le connaître, le mot irrémédiable. Ils savaient qu'on les rattraperait forcément, mais que le temps ne comptait pas et que ces minutes passées ensemble, sur le bord d'une route, sur une grève ourlée d'écume, dans les bras de l'autre, valaient des années d'attente, d'école, de savoir. »
POUY, Jean-Bernard (1990) : cinq nazes, L'atalante, p.61.
AAC056-7039
Mémoire Professionnel rédigé dans le cadre de la forma-tion pour l'Habilitation à la Maîtrise d'Œuvre en son Nom Propre, sous la direction de Monsieur William Hayet.
Mise en situation professionnelle effectuée à l'Atelier d'Architecture J.B., du 04 juillet 2011 au 30 juin 2012.
AAC056-7041
INTRODUCTION
30 juin 2011. Je venais de terminer mes études d'architecture. J'avais terminé des études pas finies, puisque j'avais un diplôme d'architecte délivré par l'État, mais l'impossibilité de m'inscrire à l'ordre des archi-tectes. Mais tout ça n'avait pas vraiment d'importance. Après tout je n'étais pas encore vraiment diplômé, je n'avais toujours pas fait mon stage de MASTER II. Il fal-lait faire ces 2 mois de stages et après, advienne que pourra. J'avais pas mal de plans dans la tête, partir en Norton 750 Commando, devenir taxi dans une ville es-pagnole, partir rejoindre cette fille « aux beaux mollets tout ronds »1 qui m'attendait là-bas, sur son île. Je ne voulais plus entendre parler d'architecture comme on nous en parle à l'école. Je voulais me laisser pousser la barbe, vivre dans une amphore et tutoyer ALEXANDRE.2 Et puis je n'avais pas un rond en poche. J'adorais ça au fond, je ne risquais pas grand chose.
La H.M.O.N.P. et les plans de carrière pouvaient at-tendre, après tout, ce ne sera utile que quand on voudra s'installer, qu'ils disaient. Et moi je savais même pas si je voulais « m'installer ». Alors je prends deux trois sous à droite et à gauche, et je pars à LAS PALMAS, rejoindre la fille aux mollets qui revient du MEXIQUE. On discute d'avenir, d'architecture, de responsabilité. Et puis on
1 PAGNOL, Marcel : Le château de la mère.2 Référence à DIOGÈNE, le cynique.
AAC056-7042
parle des pavés sur les plages, des tours au milieu du désert. Je lui raconte des histoires. Je décide de rester, travailler à droite et à gauche en attendant qu'elle ter-mine ses études. Et puis on nous raconte des histoires avec des chiffres qui font peur, des 52%, des 24%, des salaires minimums et des oracles de malheur. Moi, on me dit que travailler ici c'est pas possible. Alors on en discute encore, FRANCE vs ESPAGNE, petite agence vs grosse agence, petite ville vs grosse ville. On parle beaucoup de notre âge, des portes qui se referment très vite et des priorités. On parle de lenteur, d'artisanat. Je connais une agence dans la petite ville où habitent mes parents, je me renseigne pour les voir, on m'accueille avec un café, on discute de tout et de rien. On se sert la main. Je retourne en FRANCE, faire ce stage qui tom-bait si mal. La fille quant à elle retrouve sa place dans mon portefeuille, format 5x3. Encore quelques mois. À l'agence, on parle de lenteur, d'artisanat. On parle de transmission. On rigole de ma jeunesse, je me moque de leurs certitudes. Je lui propose la H.M.O.N.P., il est d'accord. Je me dis qu'il n'y a pas de mauvais départ, qu'il n'y a que des mauvaises courses. Je pense à La fon-taine, je me marre. Bref, il était temps, de commencer vraiment. L'imprudence.
AAC056-7045
LE CHOIX
Être postulant à l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre moins d'un an après avoir terminé sa formation initiale n'est pas un acte facile. Ça ne coule pas de source. Ce n'est pas la conclusion d'une vie professionnelle, une promotion. On pâtit indéniable-ment d'un manque de légitimité. Manque d'expérience, manque de recul. On s'invite très souvent à penser que cette habilitation se ferait dans la foulée, sorte de prix de gros du diplôme. Je le confesse, tout au long de mes cinq années à l'école d'architecture, je l'ai souvent pen-sé moi aussi. Je me disais « tant que je suis en études, autant le faire tout de suite ». J'y voyais une continuité, un aboutissement. Et puis bien évidemment, les choses changent, et ce ne fut plus du tout la priorité au cours de ma dernière année de MASTER.
D'autres engagements, d'autres histoires avaient ma préférence. Le choix de me présenter à l'habilitation dès juillet 2012, ne s'est fait que quelques mois avant la clôture des inscriptions, en septembre 2011. Comme beaucoup il est le résultat d'opportunités et de ren-contres, mais il est surtout lié à l'agence dans laquelle j'ai effectué mon stage de MASTER II, au sortir de mon projet de fin d'études en juillet 2011. Il me semble im-portant avant toute chose, d'expliquer où et pourquoi j'ai effectué ma mise en situation professionnelle, d'en comprendre l'origine et la motivation; car cette déci-
AAC056-7046
sion est intimement liée à ma volonté de me présenter si tôt à l'habilitation pour la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
AAC056-7047
Je suis né en 1987, à VILLEFRANCHE S/SAÔNE au nord de LYON. Ma famille maternelle, beaujolaise et ma famille paternelle, Lyonnaise, témoignaient des valeurs d'effort et de modestie typiques des familles ouvrières. Le rêve des années 60 et de l'accès à la propriété grâce au fruit de son travail. Après la naissance de ma seconde sœur, poussés par des opportunités de travail, mes parents et mes deux sœurs déménagions en région parisienne, dans un petit village à une heure et demie de Paris. Le village, autrefois de pierres et de champs, laissait place petit à petit aux constructions de promoteurs pour les cadres parisiens, cherchant dans cet agglutinement les quelques racines familiales perdues. A la fin des années 90, alors que la FRANCE redécouvrait la fraternité ap-posée au fronton des mairies, nous avons de nouveau déménagé, les aléas de la vie qui touchèrent ma famille sont le reflet d'une banalité qui s'installait durablement dans la société.
La perte d'un emploi et le monde qui nous disait de bou-ger, internet débutait, les portables aussi. C'est donc dans cet ailleurs que nous sommes arrivés en BOUR-GOGNE, en SAÔNE ET LOIRE. Pour un enfant qui n'avait jamais connu que le plat pays de l'Ile-de-FRANCE, le changement fut au niveau des haut-le-cœur provo-qués par le relief moyenâgeux des vallées brionnaises. La vie reprit son cours, nous nous installions durable-ment, semblait-il, dans ce paysage. Un fois mon lycée terminé, cherchant par tous les moyens à échapper à cette FRANCE des ingénieurs et des classes prépara-
AAC056-7048
toires, je partis à BEAUNE, où, au milieu des vignobles je m'inventai un futur d'artiste. Mais, l'art conceptuel était mort à MILAN le 6 février 1963, et mes amis d'alors me semblaient perdre leur temps assis sur les marches de l'ÉCOLE DES BEAUX ARTS à griller son clope comme on grillerait des priorités. J'ai donc passé le concours d'entrée à l'ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE LYON, laissant à ceux que ça motivait le Nationale et le Supérieure. Je ne me souviens plus des deux premières années dans cette école, j'ai l'impression d'avoir répondu présent aux différents check-points sans trop savoir ni comment ni pourquoi. La rencontre s'est faite avec le temps, comme très souvent, elle fut liée à quelques histoires, quelques conversations et quelques personnes. On a visité ROME, la dalle des fosses ardéatines de Giuseppe PERUGINI et l'arrivée au Panthéon m'ont marqué bien plus qu'il ne fallait. Je marchais dans la rue en discutant, me fichant de savoir ce qu'il y avait à voir, préférant depuis long-temps les yeux de la fille d'à côté à la couleur rouge des monuments passés. Dans la rue que nous empruntions alors, la perspective était fermée par un bâtiment en briques vieillies. Je n'arrivais pas à en voir la globalité, je me rappelle simplement remarquer la beauté de ce mur, les briques vieillies, leur couleurs d'aquarelles, et cette idée magnifique d'achever la rue sur ces briques-là. Ce n'est qu'en tournant la tête sur la gauche que j'aperçus la place, et ce n'est qu'en longeant ce mur de briques que je m'aperçus qu'il était panthéon. Ensuite plus rien n'a eu d'importance, l'oculus aussi grand soit-il, et cette lumière qui scintillait sur la coupole ne m'émurent
AAC056-7049
d'aucune manière. Pour moi le panthéon était ce pan de mur qui se transformait, cette banalité exposée en exception.
Cette surprise des sentiments comme moment d'archi-tecture. En revenant de ce voyage, on nous a demandé de nous positionner sur l'Erasmus. À moi et à tous ceux de ma génération, on avait vendu l'auberge espagnole, ce mélange des cultures et ce grand bond en avant. La société incapable d'assumer l'anarchisme des grands voyages qui forment la jeunesse offrait désormais l'Erasmus avec la promesse qu'on n'y perdrait pas au change. Soit! Avec le même dégoût qui m'avait poussé à me perdre au fin fond de la BOURGOGNE du Nord, dans une école de Beaux Arts anonyme, alors que l'intelli-gentsia poussait au crime pour réaliser la FRANCE des connectés, je m'inscrivis à l'Universidad de LAS PALMAS de Gran Canaria. Parce qu'il y faisait beau. Et que je n'ai jamais pensé qu'il fallait mourir de froid pour s'acheter une crédibilité intellectuelle. Durant cette année à la manière des souris loin du chat, j'ai dansé. Beaucoup. Jusqu'à trouver une partenaire dont la couleur des yeux et le noir des cheveux me fit homme, chaque jour. Bien plus que le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière3, pour qui pense que l'architec-ture est une tournure de l'esprit. Et puis il a fallu reve-nir, faire tomber le sable coincé dans les cheveux longs, choisir un domaine d'étude de MASTER II, avec le mot
3 LE CORBUSIER, 1923 : Vers une architecture, champs arts flammarion, 1923.
AAC056-7050
liberté à la bouche4. J'ai choisi le département Straté-gie et Pratique Architecturale Avancée. Parce que c'était le seul qui proposait cette liberté. De sujet et de traite-ment pour le Projet de Fin d'Études. On n'avait qu'une seule consigne : qu'il soit « juste, intelligent, novateur mais-pas-trop, sérieux mais-pas-trop, indiscipliné mais-pas-trop, qui parle de vous en tant qu’architecte et sur-tout, surtout ! en tant qu’homme, qu'il nous intrigue, qu'il nous intéresse ».
On avait 100 jours pour être arrogant mais-pas-trop. Alors j’ai tout jeté, en vrac. J'ai fait un grand cirque. Ça parlait d'errance, de berger et de paysan, d'Abel et Caïn, de nostalgie. Y'avait des haïkus un peu partout et des passages entier d'Oh Yoko! et ensuite avec diverses personnes qui se reconnaîtront, nous avons mis un peu d’ordre, rajouté du sens où il en fallait, gommé certains gestes, encouragé les débordements des histoires et des mots, tous plus jolis les uns que les autres. Parce qu’on était convaincus que Caresse était plus joli que Trans-mutagène, on a utilisé LE CLEZIO, pour ses mots, Fellini pour la nostalgie des grandes largeurs, Wenders et cette fille assise dans le cercle de sciure, BOUCHAIN pour faire plaisir à tous, Ella ZENGHELIS pour se faire plaisir, et DIOGÈNE pour son panache. On a beaucoup écouté le Live at Pompei de 1972, on en a gardé des pho-tos et des mises en scène. Après, je crois que j’ai aussi beaucoup écrit. Des mots à chuchoter aux oreilles des
4 CAMUS, Albert, 1956 :La chute, Gallimard, 1956.
AAC056-7051
filles. On a pioché dans des histoires finies et d’autres qui commençaient. J’ai fait des traductions dans des langues pas possible. Ils m’ont encouragé, elle m’a en-couragé. On avait le titre : Chimère, Chĭmæra et cette phrase d’HUGO qui en disait l’essentiel : « Nos chimères sont ce qui nous ressemble le mieux ». Après deux jours d'oraux, on nous a annoncé des notes en lisant un lis-ting, sans relever la tête, hommage du vice à la vertu5. On ne s'est pas serré la main. Y'avait pas de diplôme. On a bu une bière sur la terrasse du café des arts, et puis c'en était fini.
Durant les cinq années de formation initiale à l'ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE LYON, une certaine rigu-eur intellectuelle m'a été demandée pour concevoir des espaces utiles, réponses justifiées aux problèmes envi-ronnants. Si les premières années nous inculquent les bases de représentation et de conception, s'en suit une grande liberté dans la fabrication du projet. Lors de ma dernière année à l'école, dans mon domaine d'étude de MASTER, j'ai été amené à poser des questions et à y répondre de manière inventive, créant mes propres outils et faisant un aller-retour incessant entre concepts et réalités. Bien qu'intellectuellement très riche, cette façon d'apprendre le métier, semblait m'éloigner petit à petit de l'aspect technique et constructif de la pro-fession, poussant le paradoxe jusqu'à ne plus imaginer
5 « L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. » LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, 218.
AAC056-7052
d'architectures réelles. C'est donc avec ce sentiment d'inachevé que j'ai cherché une agence pour réaliser mon dernier stage de MASTER II. J'avais une vague idée de ce que je ne voulais pas. Faire le zouave, me mettre des lunettes en plastique noir, des jean's slim, un nœud papillon sur un pull-veste échancré, chercher LA grosse agence pour cliquer devant son ordinateur toute la jour-née et être sûr d'avoir la plus grosse face aux copains ar-chis tout juste sortis. J'avais une vague idée de ce que je voulais. En sortant de l'autoroute A6 à MÂCON, prendre la route centrale, suivre la ligne TGV, quitter petit à petit les vignobles jusqu'au point culminant, là où la route et la ligne de train se séparent, l'une passant au dessus de l'autre. On aperçoit alors CLUNY, en contrebas, des bois un peu partout. La terre y est grasse, généreuse, les bovins charolais, gros et forts y poussent comme des champignons atomiques. Le soleil qui disparaît à bout de souffle, donne au foin sauvé ça et là, ses derniers instants dorés. À choisir, je voudrais être de ce coin-là.
C'est pour cela que j'ai demandé à effectuer un stage dans une petite agence d'architecture de SAÔNE ET LOIRE. Elle est dirigée par un architecte, J.B. qui, après avoir étudié à GRENOBLE et en ALGÉRIE à l'Ate-lier du désert d'André RAVEREAU, à participé pendant une dizaine d'années à de multiples concours sur GRE-NOBLE et sa région avec l'équipe MEGARON. Ce n'est qu'au début des années 90, qu'il décide de reprendre une agence à PARAY-LE-MONIAL. L'équipe d'alors est
AAC056-7053
la même qu'aujourd'hui, deux dessinateurs projeteurs G.B. et P.D. et une secrétaire G.P.. Au début de l'année 2010, la fille de J.B., C., prend le relais au secrétariat, Gi., comme toute l'équipe, approchant de la soixantaine. C'est une des raisons de mon choix, cette vieillesse sup-posée se transformer en sagesse. Avoir devant moi une agence en fin de cycle, lorsque les égos sont tannés, lorsque l'œuvre, est collective. Ne laissant place qu'à la volonté d'un travail bien fait, sans discours théoriques superflus. Cette partie de la SAÔNE ET LOIRE, le Charo-lais-Brionnais, est une terre d'éleveurs, d'agriculteurs, d'artisans. La dernière réalisation de GEHRY passe ina-perçue, parce qu'elle n'a aucun impact sur la vie locale. Les commandes de centres culturels et de zéniths sont inexistantes, et pourtant, au quotidien, les agences font de l'architecture. C'est cette architecture, si loin des sujets traités en formation initiale qui m'attirait. Non parce que je développais une passion secrète pour les hangars de stockage de fourrage, ni pour les maisons à tuiles mécaniques et enduits ton ocre, mais parce que j'avais dans l'idée de faire passer un crash-test à la formation dispensée par l'E.N.S.A.L., et par ce biais, à l'architecte diplômé que j'étais. Choisir au plus vite ce moment où la théorie est censée rencontrer la pratique.
AAC056-7055
THEORIE(S)
Le programme pédagogique disponible sur le site internet de l'école met en avant sept questions pour définir la formation souhaitée par l'E.N.S.A.L. à ses futurs architectes. Il me semble intéressant de par-tir de trois de ces questions pour mettre en lumière les moments où la théorie rencontre la pratique, et donc où l'architecte tout juste diplômé met à l'épreuve sa manière de penser avec sa manière de faire.
AAC056-7057
QUELS ARCHITECTES PRÉPARONS-NOUS?
Tout au long de mes cinq années d'études à l'E.N.S.A.L. L’enseignement a mis l'accent sur la conception, au détriment parfois, du principe de réalité. À trop vouloir nous initier à l'art sensible de l'Architecture, les pre-miers jours dans une agence sont déconcertants.
Résumé sur les grandes lignes de l'enseignement du projet dispensé à l'ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE LYON:Apprendre les bases du dessin d'architecture et de re-présentation, comprendre ce qu'est la lumière (KAHN, MEIER, CAMPO BAEZA), comment mettre en place des volumes, ce qu'est une séquence en architecture, la promenade architecturale, le dimensionnement, etc. Puis, ce qu'est un concept. L'idée, le discours, la volonté de notre architecture, sa politique parfois. Et enfin, l'ar-chitecture de notre concept, la matérialité, le langage architectural qui traduit notre langage intellectuel. Et puis en MASTER, c'est un peu tout ça encore.
En somme, et si ce n'était pas l'objectif, qu'ils m'en excusent: on nous apprend à penser avant de réaliser. Quitte à perdre en route la notion même de réalisation. Combien de fois se retrouve-t-on avec des bâtiments aux porte-à-faux gigantesques, certes, réalisables tech-niquement puisque tout se fait, mais non réalisables économiquement? L'expérience professionnelle est très claire avec ça: ce qui compte avant tout c'est la viabilité
AAC056-7058
du projet. C'est parfois même un peu plus insidieux que ça, ce qui compterait semble-t-il, ne serait que la viabi-lité de l'agence.
08 juillet 2011, exemple concret. Ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai commencé à travailler dans cette agence, ma place n'est pas encore totalement cer-née, délimitée. Les tâches ne sont pas acquises, mais la confiance est là. On me donne un projet de maison indi-viduelle pour un jeune couple. C'est un entrepreneur qui nous demande des plans pour ce couple, quatre chambres, bureau, salle de bain, séjour-cuisine et ga-rage double. Il attend une proposition. Mon tuteur me propose de faire les esquisses. Je suis ravi. C'est un peu comme à l'école: un programme + un site, et au final un jury à convaincre: mon architecte, l'entrepreneur et les clients. Bille en tête, je m'invente un scénario: 4 chambres = des enfants, construction d'une maison = en bas âge, 3000m2 de terrain plein sud = orientation principale de toutes les ouvertures. Nous sommes en BOURGOGNE du Sud, au mi-lieu des fermes en pierre et aux tuiles rouge brun, les charpentes bois disposent toutes du coyau local, mais je m'imagine un jeune couple recherchant une architec-ture différente. Je m'imagine un hommage à ANDO et à la Maison Rudin, d'HERZOG ET DE MEURON. Je sors de l'école, je cherche une écriture, une démonstration. Cette maison sera en béton banché. Simple, puissant, radical. Cette maison aura une âme forte, différenciée au milieu des fermes brionnaises. Elle marquera le pay-
AAC056-7059
sage comme la vie de ses occupants, point singulier dans une histoire cohérente.
Premières esquisses, premières obsessions: la vue sur toute la vallée est au nord, les 3000 m2 de terrain au sud. Je découpe le projet en trois blocs articulés: le double garage au nord-est, les chambres au sud et le séjour-cuisine traversant nord-sud.Chaque bloc soutient la logique du scénario:La cuisine au sud pour maximiser la prise de soleil sur la terrasse, profiter du soleil couchant, garder un œil sur les enfants qui jouent dans le jardin.Le salon au nord, pour manger ou lire dans le salon tout en ayant un vue imprenable sur toute la région.Les chambres au sud, sont toutes aux mêmes dimen-sions, parents et enfants sur un pied d'égalité. Les quatre chambres en fil indienne s'ouvrent par des baies vitrées sur le jardin, au soleil.
Quelques réglages plus tard et le toit devient en zinc, les menuiseries en bois clairs, quelques motifs seront à prévoir sur les banches, pour des parties très précises de l'édifice. Il me semble arriver à un travail abouti, cohérent. La notion de plaisir est au centre de la conception, et l'utilisation que je perçois de ces espaces, idyllique. Les enfants devraient s'épanouir pleinement et les parents vivre agréablement dans leur espace mai-son à l'intérieur de leur espace nature.Et puis présentation de mes plans, coupes, façades à l'agence: Premiers encouragements, mais aussi pre-
AAC056-7060
miers recadrages, amusés, de mes collègues: « Oula la la... mais tu peux plus faire ça, maintenant c'est BBC! » Comprendre: Bâtiment Basse Consommation... c'était mes grandes ouvertures plein nord, pour la vue sur la vallée. Trop coûteux en énergie, selon les nouvelles normes. Il faudra les diminuer un peu, tant pis pour la vue plongeante sur la vallée, elle existera mais sera ré-duite. Je comprends le compromis et l'intérêt.
Deuxième point: « Pour le BBC, c'est mieux les chambres à l'est, faut un peu minimiser les grandes ouvertures sud sans protection... C’est quoi en plus comme fenêtres là? Des porte- fenêtres? Les enfants vont sortir et rentrer comme ils veulent de leur chambre pour aller courir dans le jardin? Mais ça, personne n'en voudra, faudra quand même un contrôle des sorties. En plus, les chambres, les enfants n'y vont que la nuit pour dormir, ils n'ont pas be-soin d'avoir le soleil du sud. » Grosse remise en question du projet: La parcelle est orientée nord/sud, un voisin à l'est et un voisin à l’ouest. 3000m2 de terrain sans voisin au sud, vue plongeante sur toute la région au nord... Les chambres tournées à l'est chez le voisin, quand on pourrait les ouvrir sur leur propre terrain? Ce BBC com-mence à prendre trop d'importance sur la logique du projet. C'est un problème, mais au-delà de cet aspect technique, c'est surtout un gros choc des cultures: dans mon scénario, la maison était faite pour les enfants, dans celui de mes collègues, pour les parents. Je tente de m'expliquer, de remettre en avant une logique d'uti-lisation tout autre, de penser à une vie avant une écono-
AAC056-7061
mie d'énergie ou d'argent. Je leur parle des enfants qui jouent dans leurs chambres, de l'inconfort d'un jardin coupé du reste de la maison à tel point qu'il ne devient plus pratiqué.
Troisième uppercut: « Le béton banché, et la ferme apparente en double hauteur dans le salon, laisse tom-ber, ici, si les gens demandent de la charpente tradition-nelle, ce n'est pas pour la voir, c'est juste qu'ils ne font pas confiance à la fermette. Et le béton banché, aucune entreprise de la région n'en fait, trop coûteux » Com-prendre: que mon hommage béton ça sera pour une autre fois, et ce que souhaite la famille, c'est une mai-son très simple en brique, enduit ton ocre, tuiles rouges de BOURGOGNE et fenêtres PVC blanches; coller au plus proche de ce qui existe dans la région. Le rêve promu par nos promoteurs de maisons individuelles.
Passage de l'éponge sur ma conscience tuméfiée: « Mais sinon, au niveau de l'organisation et du dimensionne-ment, ça marche! » Comprendre: désolé et bienvenue dans la réalité: ce qui compte avant tout c'est de savoir ce qu'attend le client. Avant nos états d'âme d'archi-tecte, aussi jeunes soient-ils.
L'architecte tout juste sorti de l'école vient de prendre une petite claque. La mère conception a pris du plomb dans l'aile. Il existe tellement de règles, de lois et de réflexes constructifs qu'il me semble impossible d'inno-ver. Ceci durera deux jours, le temps pour moi de com-
AAC056-7062
prendre qu'au-delà de la jouissance égoïste de parler d'architecture comme un grand, il y a un contexte, éco-nomique et social. Je m'inventais un scénario, que je considérais idéal. Je me targuais de comprendre le fonc-tionnement d'une famille et de penser architecture. Mais j'en oubliais la demande première et son contexte: un entrepreneur demandant les plans à un architecte car nous dépassions les 170m2. Notre premier client était l'entrepreneur, pas la famille, qui, si elle souhaitait parler d'architecture pouvait toujours franchir la porte de l'agence, où nous l'accueillerions avec plaisir.
Ce fait est sûrement un joli concours de circonstance, et les faits sont peut-être légèrement caricaturaux, mais ils traduisent bien un des premiers malaises que peut ressentir un jeune diplômé. Et donne une première indi-cation sur le crash-test des études face à la première expérience professionnelle. Certains architectes que j'ai eu en études nous répétaient souvent qu'il fallait faire de l'architecture avec le mauvais goût des gens. C'est un peu drôle, et un peu méprisant aussi. On en rigole bien, sûrs et certains, qu'on ne nous y prendra pas. J'ai passé ma dernière année d'études à penser Les Contre-Architectures, c'était mon concept-phare. Je vomissais toutes ces architectures de CONFLUENCE, ces gesticu-lations prises entre RHÔNE et SAÔNE, oranges, vertes, micro-perforées, ces je suis là et ces regardez-moi. Trop solides, trop ancrées. Elles ne cessaient de refléter ce qui me faisait peur chez mes confrères: la masturbation indélicate au service de notre égo gogo d'intellectuel de
AAC056-7063
l'espace. Cette manière de philosopher pour soi et son groupe d'irréductibles gaulois. Une fois de plus face au dilemme racinien entre l'amour et le devoir.
On passe cinq années à nous persuader que nous œuvrons pour le bien public et la grandeur de l'archi-tecture, discipline millénaire. Déchirés entre la réalisa-tion courtoise, affable, taxée de banalité, de manque flagrant d'ambition et la réalisation fiévreuse, insolente, légèrement despotique, celle qui met au dessus de tout, même des hommes, l'Architecture, avec un grand tas. Les années estudiantines penchent très clairement vers la deuxième, et ce malgré toutes les précautions d'usages que nos professeurs ne manquent pas de po-ser sur l'architecture utile. Nous sommes, et c'est bien normal, enthousiastes de parler d'architecture, de la discipline, de son histoire, de son futur.
Je venais de me faire prendre au premier de tous les pièges, le complexe de narcisse. Le moi, le ça et le sur-moi en vrac6.
6 LASCH, Christopher, 2006 : la culture du narcissisme, champ-flamma-rion, 2006.
AAC056-7065
QUELLES COMPÉTENCES VISONS-NOUS?
Lors de mes deux premiers mois de vie professionnelle, j'ai réalisé des esquisses, jusqu'à L'APS (Avant projet sommaire), j'ai suivi des chantiers, participé aux récep-tions, j'ai fait des relevés et constitué des permis de construire. Et tout ceci à chaque étape largement épau-lé par chacun des membres de l'agence, tous extrême-ment impliqués et bienveillants.
Sur ces cinq années d'études, j'ai suivi des cours d'art, de communication, de sociologie, de psychologie, de construction, de structure, d'histoire de l'architecture, et de projet. Beaucoup de projet. Au final, durant ces deux mois, j'ai vraiment eu l'impression d'être parfaite-ment formé pour la conception de l'espace. Ces cinq an-nées de projet à construire des centres culturels et des logements collectifs, ont été bénéfiques pour tourner dans tous les sens les espaces à construire. L'utilisation de l'informatique, sorte de prolongement naturel de notre main d'enfant des eighties, un avantage certain.
Toutefois sur ces deux mois en agence, la théorie de nos études se confronte inlassablement à la pratique et à la nécessité de viabilité de nos réponses architec-turales. Et ça, nous n'en n'avons pas la compétence à la fin de nos études. C'est un fait, l'exemple conté pré-cédemment l'illustre bien: les architectes formés par
AAC056-7066
l'E.N.S.A.L. n'ont aucune notion économique7.
Pour un étudiant, et ce malgré les cours de construction, d'économie de la construction et de projet, construire en béton banché ou garder la charpente apparente n'est qu'une question architecturale de langage, jamais éco-nomique. Et c'est bien là, la limite des enseignements de projet à l'école, nous concevons avec des critères esthétiques, volumétriques, constructifs, sociologiques, voire phénoménologiques, mais jamais en cinq années de projets architecturaux nous n'avons conçu avec un critère économique. L'école semble laisser cet aspect du métier à la charge de nos premières pratiques profes-sionnelles. Il n'est pas facile d'en faire la critique tant les avantages de laisser ça de côté durant les cinq années de cours semblent évidents, toutefois il est important de savoir qu'à la question quelles compétences visons-nous?
En aucune manière on ne peut répondre l'économie de projet, car le temps des stages est trop court, trop coupé du reste du temps de formation. Et comme le stage est à la charge de l'étudiant, on se retrouve avec une dispa-rité des expériences qui rend impossible toute réutilisa-tion dans le cadre de l'enseignement dispensé à l'école,
7 Il est intéressant et primordial de noter que les stages de formation pratique font parti du programme pédagogique dispensé par l'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE LYON, et donc participe au même titre que les enseignements dispensés à l'école à la formation. Ainsi, lorsque que critique de la formation il y a, il est important de la nuancer, car elle se réfère très souvent aux seuls enseignements dispensés dans les locaux de l'E.N.S.A.L..
AAC056-7067
alors qu'une fois sorti de l'école, c'est l'une des pre-mières compétences attendues par le maître d'ouvrage.
AAC056-7069
QUELLE STRATÉGIE POUR L'E.N.S.A.L.?
Nous avons vu que l'école met en place un programme pédagogique. Elle cherche donc à introduire une pen-sée dans la formation, même si elle ne paraît plus dog-matique, elle se veut intelligente et donc fruit d'une ré-flexion. (J'ose espérer que les cinq années proposées à l'école ne sont pas qu'une simple improvisation laissée aux susceptibilités des enseignants).
Au cours de ma dernière année de MASTER II, je me suis penché sur les relations qu'il existait entre architecture et philosophie. Comme on nous poussait, dans le cadre du projet de fin d'études à trouver notre propre lan-gage, à montrer qui nous étions et ce qu'on avait à dire sur l'architecture, je me suis tout naturellement tourné vers la construction d'un véritable discours sur l'archi-tecture (Les Contres-architectures comme expliqué plus haut). C'était bancal, balbutiant, mais ça avait le mérite de poser les premières craintes, et les premières certi-tudes. Ce qui est toujours une bonne base à trahir.
En sortant de l'école, et dans l'optique de préparer son habilitation, mettre en rapport ce début de discours théorique avec une application concrète me semblait plus instructive que les projets fantasmés.
Les premiers travaux réalisés en agence, et les premières discussions avec l'équipe qui m'entoure et me soutient
AAC056-7070
dans cette habilitation à la maîtrise d'œuvre me per-mettent aujourd'hui de continuer cette recherche entre architecture et philosophie, lorsque la stratégie comme moment pensé entre en compte dans la construction d'un futur professionnel personnel.
Dans le rapport Architecture/Philosophie et Enseigne-ment E.N.S.A.L./ Pratique Professionnelle de grandes si-militudes existent: comment ne pas prendre les études comme le moment où l'on pense tout dans sa tête et le moment professionnel celui où l'on agit de manière empirique?
Lorsque nous entrons à l'école, on répète à qui veut bien l'entendre qu'il n'y a plus de dogme, plus d'école de pensée. Qu'ici, maintenant, c'est le parcours individuel qui importe... Connais-toi toi-même... et tu sauras faire de l'architecture. Utopie pédagogique. Toute l'école, les professeurs, les enseignements poussent invaria-blement au même point: trouve ton langage d'abord, ensuite tu feras. De nouveau, Utopie pédagogique. Au cours de ces cinq années je me souviens entendre un de mes camarades (ou professeur, je ne me rappelle plus) dire: « Les études d'architecture c'est un peu comme si on nous faisait apprendre tous les mots du dictionnaire, et que subitement on nous demandait de construire des phrases parfaites; mais personne ne nous a appris la grammaire... ». C'est discutable, mais intéressant.L'école, infiniment plus qu'elle ne le revendique, pousse à la conception d'un positionnement philosophique de
AAC056-7071
notre architecture: une manière de vivre8.Qui se construit en amont, à 90% de notre temps avec les enseignements dispensés à l'école, et à 10% lors des stages de mise en situation pratique. Comment alors reprocher aux étudiants lors de la première expérience professionnelle d'être déphasé?Ce que je trouve navrant dans cette situation, et me pousse à employer ce terme d'Utopies pédagogiques, est le manque de préparation à une part importante de l'exercice du métier: La réalisation de ce qu'on projette. Cette négligence, ou cette volonté, semble nous éloi-gner toujours plus d'une formation professionnalisante et responsable. D'où une certaine difficulté à envisager une installation rapide d'un jeune diplômé, dont c'est surtout, au-delà du manque d'expérience, le manque de vision globale des responsabilités personnelles et so-ciétales qu'implique l'acte de construire qui fait défaut. Cette partie étant laissée totalement à la charge de nos premières agences employeuses et souvent, à l'entre-prise de l'habilitation.
8 HADOT, Pierre, 2002 : La philosophie comme manière de vivre, Albin Michel, 2002.
AAC056-7073
EXEMPLE CONCRET POUR LES PLUS SCEPTIQUES
Durant l'année 2011, l'école a construit une extension d'atelier. Durée des travaux: 8 mois environ, marquage au sol, coulage de la dalle, édification de la structure, mise en place de l'espace intérieur... Toutes les étapes (à petite échelle) d'une construction très classique, se déroulait à... 2m50 de notre bâtiment et de ses 30 pro-fesseurs et 500 élèves! Une explication et un suivi du chantier aurait pu être organisés pour les étudiants. Non. Bien sûr que non. « Pas le temps », « planning trop chargé », « pas intéressant », « vous pouvez y aller tout seul », ou je ne sais quelles raisons ont prévalu à celui du bon sens. Ce qui me pose de nouveau cette question formulée par la CPR: Quels architectes formons-nous? Réponse: des trouillards.Voilà, c'est dit, c'est un peu amusant, et un peu mépri-sant aussi. Je comprends assez facilement qu'on veuille intellectualiser le travail, après tout il faut bien justifier ces cinq années d'études et toutes ces bourses versées...
Passé le temps de la colère, réfléchissons encore un peu, lors de mes premiers mois en agence, j'ai effectué de nombreuses réunions de chantier (deux voire trois par semaines), entouré par sept corps de métiers diffé-rents, qui ont des problèmes à résoudre pour poursuivre le chantier, des questions, des réglages et des discus-sions toujours à mi-chemin entre la simple conversation d'agrément et la demande sérieuse d'autonomie. Et
AAC056-7074
bien, après cinq années d'études à l'école d'architec-ture et l'obtention de mon P.F.E., alors que je n'étais plus étudiant, mais architecte, professionnel; je ne me suis jamais senti aussi incapable, aussi peu à même de donner des réponses que lors de ces réunions de chan-tier. Et si mon tuteur m'avait laissé suivre ce chantier tout seul, j'aurais certainement fini par répondre à tous de faire au mieux, avant de me réfugier honteusement derrière mon ordinateur. Ce qui est très proche du com-portement du trouillard. En tout état de cause, très loin du comportement supposé d'une personne capable de prendre les décisions que lui confère son grade de MASTER. Il n'y a aucune autorité des connaissances dans ce cas-là. On s'agite dans tous les sens en se di-sant: « p**** qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années? ». Je sais faire de très belles perspectives et je sais empiler des volumes dans l'espace, ne pas dessi-ner un couloir de 8 m de long qui débouche sur un mur, penser à ouvrir les portes de secours vers l'extérieur et tout un tas d'effets architecturaux, mais tranquil-lement assis devant mon ordinateur. Une fois de plus (et je m'acharne), je pense que nous formons de gen-tils petits monstres, qui se feront un plaisir de travailler chez KOOLHAAS et compagnie. De gentils intellectuels, qui aiment leurs ordinateurs plus que les êtres humains. Mais qui passeront sûrement dix ans de leur vie à n'être que de parfaites petites mains, faisant de très jolies 3D ou perspectives pour ses saigneurs de l'architecture mondiale, tous très satisfait de faire avancer L'ARCHI-TECTURE du On pense, nous, ici; mais qui jamais plus
AAC056-7075
n'envisageront de suivre un chantier et mettre la main dans le cambouis. Parce que nous l'acceptons, nous ne sommes pas bons pour ça. Utopie Pédagogique. Il m'a semblé primordial après mes premiers mois passés en agence, et durant ma mise en situation professionnelle officielle pour l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, de comprendre ce rapport complexe entre les architectures et les philosophies, entre les théories et les pratiques, entre ce que je pensais et ce que je ferai.
AAC056-7077
ARCHITECTURES ET PHILOSOPHIES
« L'architecture devrait-elle, aujourd'hui, se ressourcer théoriquement? Autre formulation: la théorie serait-elle une référence obligée pour les architectes, voire pour les artistes? Mais quel genre de théorie? Une théorie de l'architecture? Une théorie de l'art? Ou, pourquoi pas, une théorie de l'homme? Pourquoi pas une philosophie? »9
9 AGACINSKI, Sylviane, 1992 : Volume (Philosophies et politiques de l’archi-tecture), Galilée, 1992, p.5
AAC056-7079
LES FONDEMENTS THÉORIQUES
On pourrait croire que le schéma hiérarchique qui place la tecture sous l’autorité de l’arché émane directement de l’architecture comme si, celle-ci n’était pas seule-ment un exemple mais un modèle pour la pensée phi-losophique. C’est pourtant le philosophe, et non pas le bâtisseur, si longtemps considéré comme l’homme des techniques empiriques, qui a opéré l’identification de ce schéma hiérarchique.
C’est bien le philosophe qui a placé «le bâti sous l’auto-rité des principes et le bâtir sous l’autorité d’un chef ca-pable de juger des principes. C’est dans le discours phi-losophique que s’invente, sous le nom d’archè, le nœud de ces deux instances fondatrices : le commencement et le commandement».10
Le recours à ARISTOTE semble approprié pour explici-ter cette hiérarchie entre l’essence d’une chose et la manière de cette chose. La fin et les moyens... Le rôle majeur qu’occupe ces catégories ne dérive pas «d’une théorie de fabrication mais la distinction entre ceux qui sont capables de juger de la fin d’une chose, dans tous les domaines, donc ceux qui peuvent commander, et ceux qui exécutent les ordres et agissent sur la réalité empirique».11 L’architecte et l’abeille...
10 Ibid, p.1011 Ibid., p.10
AAC056-7080
Dans la pensée grecque, lorsque l’art n’est pas l’imita-tion du monde sensible, comme la peinture, il est do-miné par l’intelligence théorique. Comme le montre PANOVSKY : «Le vrai modèle, pour l’architecte, ne peut être que l’idéal, comme le répétera la tradition clas-sique. Et rien n’indique qu’il doive composer avec des éléments empiriques».12
Le schéma classique de l’invention en art privilégie le rôle de l’anticipation pensée d’un résultat, au détriment d’un ajustement progressif des décisions.Cette exigence de l’autonomie du process construc-teur répond également à une conception esthétique de l'œuvre comme totalité ordonnée et cohérente. La belle totalité de l'œuvre doit être soustraite aux aléas et aux accidents des événements empiriques.Cette conception rationaliste et autoritaire a prévalu en philosophie avant de s’imposer aux architectes du XVIIIe siècle, coupant la pratique architecturale avec ce qu’elle avait encore d’empirique. L’ordre, les lois, la rationalité, tous ces concepts habitent le processus architectural de l’Antiquité jusqu’aux Lumières. Cette longue progres-sion linéaire nous fait passer de DESCARTES, parangon d’une cohérence rationnelle, à VALERY et son Eupalinos, si attaché à l’idée d’un système symétrique.
Que l’on se souvienne de l’éloge que fait DESCARTES des bâtiments conçus par un seul architecte : ils sont
12 Ibid., p.22
AAC056-7081
toujours mieux tracés, dit-il, que ceux qui résultent d’un «raccommodage». Le philosophe établit alors une ana-logie entre ces constructions parfaites qui sont l'œuvre d’un seul, et la plus belle législation, qui est aussi celle d’un unique et prudent législateur. « Des lois ainsi créées, poursuit DESCARTES, seront toujours meilleures que celles établies peu à peu par les peuples, à mesure que les crimes et les conflits les y contraignent ».13
On notera que la première est l'œuvre d’un seul homme : s’il est prudent, si la raison l’inspire, qu’aurait-il besoin de partager ? La seconde est partagée : c’est l'œuvre des peuples.
Pour Paul VALERY, «toute philosophie est une affaire de forme»14. Liée à l’usage de mots abstraits, pri-vée de contact avec le réel, la philosophie est une cible facile pour ce penseur qui songe volontiers à la rempla-cer par une critique du langage.
Tout change dès lors que la philosophie est placée sous le signe de l’art. Il faut «ranger le philosophe dans les artistes»15. Ici intervient une figure chère à VALERY : Léo-nard de VINCI, cet homme qui avait «la peinture pour philosophie»16.
Il existe deux types de philosophes pour VALERY : «Les
13 ibid., p.2314 LAGUEUX, Maurice, 1993 : la tête de l'architecte, dans Antonia Soulez, L'architecte et le philosophe, Mardaga, 1993, p.6915 Ibid., p.6916 Ibid., p.69
AAC056-7082
premiers, le développement de leurs tendances les conduirait aisément selon quelques pentes insensibles, vers l’art du temps et de l’ouïe : ce sont les philosophes musiciens. Les seconds, qui supposent au langage une armure de raison et une sorte de plan bien défini; qui en contemplent, dirait-on, toutes les implications comme simultanées, et qui tentent de reconstruire en sous-œuvre, ou de parfaire comme œuvre de quelqu’un, cet ouvrage de tout le monde et de personne, sont assez comparables à des architectes...».17
C’est à l’architecte que revient la préférence de VALERY. Chez lui, l’architecte est une métaphore fondamentale pour désigner les œuvres de la connaissance.Très tôt apparaît chez Eupalinos, l’architecte de VALE-RY, ou Léonard de VINCI, héros du construire et para-digme du philosophe, la notion de symétrie, c’est-à-dire donner à leurs œuvres une structure qui soit «celle des formes et des lois».18
Qu’ils viennent de Dieu, de la Nature (VALERY) ou de la Raison (DESCARTES), ces principes assurent à l’architecte sa maîtrise et son autorité, et à l’architecture son auto-nomie. «Philosopher, c’est mettre ou chercher de l’ordre, un ordre uniforme de toutes les choses possibles».19
Comme l’architecte impose à l’espace une structure propre déterminée par ses choix et ses lois, ainsi le phi-
17 Ibid., p.7018 Ibid., p.7119 Ibid., p.73
AAC056-7083
losophe, maître de l’art de l’ordre des idées, le fait du monde de l’esprit conçu comme un espace intelligible : «Nous ne pouvons concevoir, construire, que dans «l’es-pace» - c’est-à-dire dans la symétrie ou réciprocité».20
Ce type de conception est peu présent chez les archi-tectes, excepté à certaines périodes. On la rencontre au début de la Renaissance, chez ALBERTI qui fait passer «le tranchant du couteau» entre la conception et l'exé-cution.
Mais c’est surtout au XVIIIe siècle que l’emprise du théo-ricien sur l’artiste, ou l’identification de l’un à l’autre, s’impose.
Jusque-là, en effet, comme l’a souligné Antoine PICON, «la référence privilégiée de l’architecte n’avait pas été le travail de conception «dans la tête», ni ce qu’on appelle maintenant le projet. La référence de l’architecte était d’abord la singularité exemplaire des œuvres déjà bâties, d’où l’on tentait de tirer certaines règles et certains prin-cipes. On allait du bâti au bâti en passant par la théorie ; du singulier au singulier en passant par des généralités destinées autant à éclairer l’amateur que l’architecte. Ce n’est qu’à l’époque des Lumières, dominée par l’idée de maîtrise rationnelle du réel, dans tous les domaines, que la première place revient à la conception, au projet, et à
20 Ibid., p.73
AAC056-7084
la théorie, chez les architectes eux-mêmes».21
Etienne-Louis BOULLÉE est ici exemplaire. Il écrit dans son Essai sur l’art :« Qu’est-ce que l’architecture ? La définirais-je, avec VITRUVE, l’art de bâtir? Non. Il y a dans cette définition une erreur grossière. Vitruve prend l’effet pour la cause. Il faut concevoir pour effectuer. Nos premiers pères n’ont bâti leurs cabanes qu’après en avoir conçu l’image. C’est cette production de l’esprit, c’est cette création qui constitue l’architecture... »22
Par ailleurs, pour conquérir la maîtrise totale de son projet, l’architecte doit s’approprier théoriquement toutes les contraintes qui lui viennent du dehors. Il le fait en intégrant les savoirs nécessaires : science de la nature, économie, sociologie, politique. A la limite, il doit fonder philosophiquement son art. Et en répondre seul. C’est d’ailleurs au XVIIIe siècle, en FRANCE, qu’on voit reculer le partage des responsabilités. La part empi-rique que comportait encore le travail de l’architecte, modifiant ses plans sur le chantier, s’efface devant un travail centré sur le projet, fondé théoriquement, et programmant tous les aspects et toutes les phases de l’édification. Ainsi s’affirme l’antériorité d’une construc-tion idéale par rapport au travail concret de la construc-tion. Désormais l’architecte sera celui qui construit a
21 AGACINSKI, Sylviane, 1992 : Volume (Philosophies et politiques de l’archi-tecture), Galilée, 1992, p.2622 Ibid., p.26
AAC056-7085
priori, celui qui imagine d’abord «dans sa tête». Cette conception fera s'effriter petit à petit le mur qui séparait l’acte politique du geste architectural.
AAC056-7087
POLITIQUE ET MOUVEMENT MODERNE
L’intention initiale de PLATON est politique ; il croit à la possibilité de changer la vie politique par l’éducation philosophique des hommes qui sont influents dans la cité. Pour PLATON sa «tâche de philosophe» consiste à agir. Il considère qu’il suffit d’être philosophe pour pou-voir diriger la cité; à ses yeux, il y a donc unité entre phi-losophe et politique. Au contraire, l’école d’ARISTOTE, ne forme qu’à la vie philosophique. ARISTOTE distingue en effet le bonheur que l’homme peut trouver dans la vie politique, vie active, et le bonheur philosophique qui correspond à la théoria, c’est-à-dire à un genre de vie qui est consacré tout entier à l’activité de l'esprit.
Le travail d’éducation, ARISTOTE considère que c’est à la cité de l’effectuer par la contrainte de ses lois et par la coercition. C’est donc le rôle de l’homme politique et du législateur d’assurer la vertu de ses concitoyens, et ainsi leur bonheur, d’une part en organisant une cité où les citoyens pourront effectivement être éduqués de façon à devenir vertueux, d’autre part, en assurant au sein de la société la possibilité du loisir qui permettra aux philo-sophes d’accéder à la vie théorique.
ARISTOTE, comme PLATON, fonde sur les hommes poli-tiques son espoir de transformer la cité et les hommes. La philosophie avait pour rôle la formation citoyenne. Soit grâce aux philosophes-rois de PLATON ou aux légis-
AAC056-7088
lateurs, à l’homme politique d’ARISTOTE. On voit que dès l’antiquité, la séparation entre politique et philoso-phie est très fine voire quasi nulle.
L’architecte, depuis le XVIIIe siècle, fonde son jugement sur un socle théorique mêlant principes issus de l’Anti-quité, ordre cartésien et universalisme des Lumières. La particularité du mouvement moderne réside dans le fait que désormais l’architecte endosse lui aussi le rôle du politique. Non pas dans le discours employé mais plus dans les aspirations à changer la société. Il devient un idéologue. MARX dans un passage célèbre du Capi-tal où il entend mettre en relief ce qui fait le propre de l’homme, souligne que si l’abeille, guidée par son seul instinct, peut confondre «l’habileté de plus d’un architecte»23, il n’en reste pas moins que «ce qui dis-tingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit dans sa tête avant de la construire dans la ruche».24
Ce passage témoigne d’une conviction fort caractéris-tique d’une philosophie qui se veut à la fois socialiste et résolument moderne.
Le socialisme propose de dresser les plans d’une socié-té meilleure et la modernité peut se reconnaître à la volonté de l’homme moderne de prendre en charge sa destinée.
23 LAGUEUX, Maurice, 1993 : la tête de l’architecte, dans Antonia Soulez, L’architecte et le philosophe, Mardaga, 1993, p.6924 Ibid., p.79
AAC056-7089
Ce que MARX donne à entendre dans ce passage, c’est que s’il y a une supériorité de l’homme sur l’animal, elle se manifeste avant tout dans le pouvoir qu’a l’homme de construire d’abord «dans sa tête» le plan de ce qu’il s’emploiera ensuite à réaliser, un peu comme l’archi-tecte construit d’abord «dans sa tête» la maison qu’il réalisera ensuite dans le monde réel.
Or qu’est-ce que le socialisme sinon la ferme volonté de construire un monde qui soit le résultat, non pas des aléas d’un marché impersonnel, mais d’un plan que des personnes éclairées ont d’abord construit dans leur tête ?
Déjà, quand on a affaire, par exemple, à un projet d’habitation collective, où de nombreuses familles se verront proposer un nouveau mode de vie, la distance s’amenuise considérablement entre l’acte politique et le geste architectural.
Si dresser les plans d’une unité d’habitation collective est déjà un geste politique, dresser ceux d’un centre ville, voire d’une ville ou d’une région entière, l’est en-core bien davantage.
Les architectes avaient donc en commun avec les socia-listes une propension caractéristique à dresser des plans avant de s’attaquer à la réalisation d’un quelconque projet.
AAC056-7090
Pour les maîtres les plus respectés du Style Internatio-nal qui triomphait dans les années 50 et 60, comme pour les pionniers du mouvement moderne encore bien marginal qui prenait forme au cours des années 20, construire ne signifiait pas s’adapter à un contexte particulier et composer avec des traditions historiques, mais bien plutôt «repartir à zéro» pour appliquer systé-matiquement une technologie éprouvée à la réalisation d’un objet conçu comme devant remplir sa fonction de façon efficace et, par là même, de façon élégante.
Ainsi apparaît l’idée chez LE CORBUSIER d’un esprit nouveau : «Il y a un esprit nouveau : c’est un esprit de construction et de synthèse guidé par une conception claire. Quoi qu’on en pense, il anime, aujourd’hui, la plus grande partie de l’activité humaine. (...)L’art comme la science, comme la philosophie, c’est l’ordre mis par l’homme dans ses représentations. Il n’y a pas d'œuvre d’art sans système esthétique plus ou moins conscient, plus ou moins élaboré chez celui qui l’a créée, comme il n’y a pas de travail scientifique ou philo-sophique auquel n’ont présidé des conceptions systéma-tiques plus ou moins avouées, des hypothèses plus ou moins dégagées. Les systèmes esthétiques, scientifiques, philosophiques sont des édifices, des constructions qui mettent en œuvre des matériaux déterminés».25
25 EPRON, Jean-Pierre, 1992 : Architecture une anthologie, Tome 1, La culture architecturale, Mardaga, 1992, p.291
AAC056-7091
Esprit nouveau que l’on retrouve dans une période qui se caractérise par la faible distance entre le politique et l’architecte, l’architecture rationaliste Italienne.«Il existe donc particulièrement en architecture un es-prit nouveau. […]C’est à l’ITALIE de ramener l’esprit nouveau et ses consé-quences extrêmes jusqu’à dicter aux autres nations un style comme dans les grandes périodes du passé. […] L’expérience futuriste et l’expérience cubiste, si elles ont apporté quelques avantages, ont dégouté le public et déçu ceux qui en attendaient de grands résultats. Et comme déjà elles semblent lointaines : surtout la pre-mière avec son attitude de destruction systématique du passé, concept encore tellement romantique. Or les jeunes d’aujourd’hui poursuivent un tout autre chemin. Nous avons tous un grand besoin de clarté, de révision, d’ordre. […]La nouvelle architecture, la véritable architecture, doit résulter d’une stricte adhérence à la logique, à la ratio-nalité. […]Il faut se persuader que pour un temps au moins la nou-velle architecture sera faite en partie de renoncement. Avoir ce courage est nécessaire : l’architecture ne peut plus être individuelle. Dans l’effort organisé pour la sau-ver, pour la ramener à la logique la plus rigide, [...]Il faut maintenant sacrifier notre personnalité propre : et seulement de ce nivellement temporaire, de cette fusion de toutes les tendances en une seule tendance, pourra naître notre architecture, vraiment notre. […]Notre temps a d’autres exigences, des exigences ma-
AAC056-7092
jeures, d’impérieuses exigences. Il faut les suivre, et nous les jeunes sommes prêts à les suivre, prêt à renon-cer à notre individualité pour la création de «types» : à l’éclectisme élégant de l’individu nous opposons l’esprit de la construction en série. […]La nouvelle génération semble proclamer une révolu-tion architectonique : révolution toute apparente. Un désir de vérité, de logique, d’ordre, une lucidité qui a le goût de l’hellénisme, voila le véritable caractère de l’esprit nouveau.»26
Les architectes «modernes», dans la mesure où ils entendaient demeurer fidèles à leurs inspirations, se devaient de se laisser guider par des normes et des principes universels. De ce fait, ils ne pouvaient guère accepter que leurs projets soient affectés par des parti-cularités locales et par l’affirmation subjective de désirs et de besoins souvent irrationnels et changeants.
Les mouvements évoqués ci-dessus, qui se voulaient ré-volutionnaires ne faisaient qu’appliquer à l’architecture des idées assez représentatives de tendance qui exis-taient depuis l’époque des Lumières et même depuis celle de DESCARTES :- Au nom de la raison, qui est à l’origine de la science et de la technique, il convient de faire table rase de toutes traditions et de repartir à zéro en n’acceptant aucune autre autorité que celle de cette Raison.
26 Ibid., p291
AAC056-7093
- Puisque la Raison et la science permettent d’arriver à des conclusions objectives et universellement valables, il faut rechercher ce qui est objectif et universel aux dépens de ce qui vise à tenir compte des dimensions subjectives, locales ou idiosyncratiques.- La science et la technique étant à l’origine de l’im-mense progrès qu’a connu l’humanité, leur application aux problèmes de tout ordre dont souffre encore celle-ci ne peut que contribuer puissamment à leur solution.
Tout comme les socialistes qui pensent comme eux qu’il est essentiel de construire d’abord «dans la tête» le plan de ce qui doit être réalisé, les architectes modernes ont fait l’expérience qu’une telle volonté de planifica-tion se concilie bien mal avec un idéal de participation. Le drame du socialisme moderne, c’est qu’il entendait attacher une égale importance à la planification et à la participation. Les partisans du mouvement moderne en architecture entendaient bien répondre d’abord aux be-soins des usagers, mais, comme les premiers socialistes, ils étaient convaincus qu’ils pouvaient le faire dans le cadre d’une planification rationnelle, armée des res-sources de la science et de la technique.
AAC056-7095
MOMENT POSTMODERNE
Ce rapprochement entre le politique et l’architecte provoquera de vives critiques notamment chez MALE-VITCH27 qui dans Suprématie-Architecture dira : «À mon vif regret, la plupart des jeunes artistes, ici, pro-clament que l’esprit de renouvellement artistique se trouve dans l’ordre nouveau des idées politiques et des améliorations apportées dans les rapports sociaux; ils sont donc devenus en quelque sorte des suiveurs de gouvernements...».28
Le mouvement moderne avait poussé à la limite une idée qui était en germe chez DESCARTES et chez les Lu-mières et qui invitait à rompre avec le passé, à «repar-tir à zéro» et à reconstruire l’avenir en ne s’appuyant que sur des conceptions rationnelles dictées par une approche scientifique, seule capable de fournir une ré-ponse adéquate aux véritables besoins de l'humanité.Le mouvement moderne se proposait de transformer la société pour l’améliorer en évitant la révolution ou en la réalisant comme le crurent les constructivistes sovié-tiques. Il s’était chargé d’enseigner à l’homme à devenir moderne, à changer ses façons de vivre et de cohabiter.La plus grande erreur de l’architecture moderne fut «la
27 ALBERTI, Léon Battista, 2004 : De re aedificatoria (L’art d’édifier) , traduc-tion du latin par CAYE, Pierre et CHOAY, Françoise, Éditions Seuil, Collection Sources du Savoir.28 Ibid., p.257
AAC056-7096
rupture avec la continuité de la culture»29. Il ne faut pas oublier que la destruction de la ville traditionnelle s’ef-fectuait au nom de sublimes idéaux : droit de l’homme à une vie radieuse.
La Charte de Solidarnosc, par bien des points, nous renseigne sur les échecs inhérents à cette période : «L’architecte n’est ni le maître omnipotent, ni l’esclave des modèles spatio-culturels, universels ou locaux. Son rôle proposé est de les interpréter dans le cadre d’une continuité de la civilisation. Réduire l’architecture à ses fonctions utilitaires c’est lui enlever son rôle de moyen de communication sociale. Du moment où le langage des modèles a été remplacé par le new speak des tours, des barres et des grands ensembles, la ville est deve-nue monotone, illisible et morte pour ses habitants».30 Au moment même où l’on prenait conscience de l’échec des grandes planifications socialistes des années 80, le constat d’un échec de l’architecture moderne parais-sait inévitable. La façon la plus radicale et la plus iro-nique de nier les prétentions du modernisme, c’était sans conteste de le reléguer à son tour au passé. Pour ce faire, il s’imposait de le dépasser en insistant sur le fait que, du coup, une ère post-moderne se trouvait ou-verte. Les changements dans le domaine des rapports sociaux et de production est à l’origine d’une rébellion incarnée par le mouvement postmoderne.
29 PORTOGHESI, Paolo, 1982 : Le postmoderne, Electa moniteur, 1982, p.4630 Ibid., p.48
AAC056-7097
PORTOGHESI définit ce mouvement comme : «un refus, une rupture, un abandon, beaucoup plus qu’il n’est le choix d’une orientation. Pour le définir poétiquement on pourrait redire les célèbres vers de MONTALE : «Ne nous demandons pas la clé qui ne peut t’ouvrir... Aujourd’hui nous pouvons te dire ceci seulement / ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne voulons pas».31 Ce texte d'introduction est baigné d'une révolte faisant penser à celle des Cyniques en leur temps. Notamment dans le retournement des valeurs établies. En parallèle avec la falsification de la monnaie si chère aux Cyniques, cette dernière amène à prendre le contre pied des coutumes et des croyances, à user de la provocation, de l’ironie en paroles et en actes.
L’exposition réalisée à VENISE en 1980 nommé «La pré-sence de l’histoire» , en plus d’être la première expo-sition Internationale, était le symbole de ce renouveau postmoderne. Cette exposition avait pour but de mon-trer «le retour de l’Architecture au sein de l’histoire et le recyclage des formes traditionnelles dans les nouveaux contextes syntaxiques».32 Le mouvement moderne, au cours du temps, s’était sclérosé. Son immobilisme était devenu le symbole d’un pouvoir à combattre et à renverser. «L'Exposition servira à annoncer la fin des interdits qui pendant des années ont étouffé l’instinct d’utiliser comme matériaux du présent tout ce qui nous permet de communiquer, de mêler avec le maximum
31 PORTOGHESI, Paolo ,1982 : Le postmoderne, Electa moniteur, 1982, p.4632 Ibid., p.14
AAC056-7098
d’efficacité la mémoire à l’imaginaire, la projection dans le futur et le désir de qualité de l'environnement».33 Le retour à certaines valeurs traditionnelles est une des ambitions des post-modernes. Non pas un retour vers un passé glorieux comme celui des Grecs, mais un passé qui peut aujourd'hui contribuer par sa présence à nous rendre plus totalement fils de notre époque, le passé du monde. « La relation de l'histoire avec l'architecture, que rend possible la condition post-moderne, n'a plus besoin de la méthode éclectique car elle peut compter sur une forme de désenchantement, sur un détache-ment psychologique beaucoup plus grand. La civilisation de l'image qualifiée, la civilisations des simulacres qui connaît la barbarie du nouvel impérialisme et son effri-tement progressif, peut se servir du passé sans se laisser entraîner dans des "revivals" illusoires ou de candides aventures philosophiques ».34
Jean-François LYOTARD donne une autre définition du moment postmoderne :«En simplifiant à l'extrême, on tient pour postmoderne l’incrédulité à l’égard des métarécits».35
Selon LYOTARD on retrouve l’emploi des Grands Récits chaque fois que l'État prend directement en charge la formation du «peuple» sous le nom de nation et sa mise
33 Ibid., p.1834 Ibid., p.2635 LYOTARD, Jean-François, 1979 : La condition postmoderne, Les éditions de minuits, 1979, p.7
AAC056-7099
en route sur les voies du progrès. Cette conception du récit propre à la modernité nous rappelle le rôle très politisé et formateur qu’avait endossé l’architecture moderne. Les «machines à habiter», l’appel à l’ordre, le recours à la logique et à la rationalité, les grands désirs d’émancipation des peuples, tout cela, l’architecture l’a porté par essence dans la période moderne. Avec l’ap-parition du mouvement postmoderne se pose désor-mais la question dela légitimité de ces récits. «Dans la société et la culture contemporaine, société post-industrielle, culture post-moderne, la question de la légitimation du savoir se pose en d’autres termes. Le grand récit a perdu sa cré-dibilité, quel que soit le mode d’unification qui lui est assigné : récit spéculatif, récit de l'émancipation. On peut voir dans ce déclin des récits un effet de l’essor des techniques et des technologies à partir de la deuxième guerre mondiale, qui a déplacé l’accent sur les moyens de l’action plutôt que sur ses fins ; ou bien celui du redé-ploiement du capitalisme libéral avancé après son repli sous la protection du keynésisme pendant les années 1930-1960, renouveau qui a éliminé l’alternative com-muniste et qui a valorisé la jouissance individuelle des biens et des services.»36
Le postmodernisme en architecture apparaît comme une réapparition des archétypes ou comme un retour aux conventions architecturales et, donc, comme une prémisse à la création d’une «architecture de la commu-
36 LYOTARD, Jean-François, 1979 : La condition postmoderne, Les éditions de minuits, 1979, p.63
AAC056-7100
nication», une architecture de l’image pour une civilisa-tion de l’image.
Cette «délégitimisation» propre au mouvement post-moderne se traduit par le travail de différents philo-sophes, WITTGENSTEIN, BUBER, LEVINAS, qui ouvrent la voie à un courant important de la postmodernité : « la science joue son propre jeu, elle peut légitimer les autres jeux de langage. […] Dans cette dissémination des jeux de langage, c’est le sujet social lui-même qui paraît se dissoudre. Le lien social est langagier, mais il n’est pas fait d’une unique fibre. C’est une texture où se croisent au moins deux sortes, en réalité un nombre indéter-miné, de jeux de langages obéissant à des règles diffé-rentes, WITTGENSTEIN écrit : «On peut considérer notre langage comme une vieille cité : un labyrinthe de ruelles et de petites places, de vieilles et de nouvelles maisons, et de maisons agrandies à de nouvelles époques, et ceci environné d’une quantité de nouveaux faubourgs aux rues rectilignes bordées de maisons uniformes.» Et, pour bien montrer que le principe de l’unitotalité, ou de la synthèse sous l’autorité d’un métadiscours de savoir, est inapplicable, il fait subir à la «ville» du langage le vieux paradoxe du sôrite, en demandant : «A partir de combien de maisons ou de rues une ville commence-t-elle à être une ville ?»De nouveaux langages viennent s’ajouter aux anciens, formant les faubourgs de la vieille
AAC056-7101
ville [...]».37
L’application architecturale qu’en fait Charles JENCKS abonde dans ce processus sémantique. Un édifice post-moderne est un édifice qui «parle simultanément sur deux niveaux au moins : d’une part aux autres archi-tectes et à une minorité engagée préoccupée de signi-fier spécifiquement architectonique, d’autre part au public dans son ensemble ou aux habitants du lieu dont les problèmes sont plutôt le confort, la construction tra-ditionnelle et la qualité de vie».38 L’architecture postmo-derne se doit d’employer un langage hybride.
Cette nouvelle délégitimisation des grands récits, et des institutions qui les portent, passe également par le questionnement de la place de l’homme au sein de la société. Souvent on a reproché aux villes américaines, de part leur démesure, leur gigantisme d’être devenues hors échelles. Comme si leurs Bigness avaient complè-tement annihilé toute forme de contexte urbain.Pour autant Henri LEFEBVRE y voit, non pas un change-ment d'échelle urbaine, mais tout simplement un chan-gement d’échelle humaine.LYOTARD nous apporte un autre éclairage sur ce chan-gement : «La nouveauté est que dans ce contexte les anciens pôles d’attractions formés par les Etats-nations, les partis, les professions, les institutions et les traditions historiques perdent de leur attrait. Et ils ne semblent pas devoir être remplacés, du moins à l’échelle qui est la leur.
37 Ibid., p.6738 PORTOGHESI, Paolo, 1982 : Le postmoderne, Electa moniteur, 1982, p.10
AAC056-7102
[…] Les «identifications» à des grands noms, à des héros de l’histoire présente, se font plus difficiles. [...]Chacun est renvoyé à soi. Et chacun sait que ce soi est peu. Le soi est peu, mais il n’est plus isolé, il est pris dans une texture de relations plus complexes et plus mobile que jamais».39
André GORZ rajoutera : «Avec la croyance au progrès par le développement des industries, sciences et tech-niques, est morte une conception positiviste assimilant l'État au Bien suprême et la politique à la religion et même à la morale. Désormais nous savons qu’il n’y a pas de «bon» gouvernement, de «bon» État, de «bon» pouvoir, et que la société ne sera jamais «bonne» par son organisation mais seulement en raison des espaces d’auto-organisation, d’autonomie, de coopération et d’échanges volontaires que cette organisation offre aux individus».40
Peter EISENMANN dira même que depuis FREUD l’homme n’est plus tout à fait le même, «il n’est plus complet, il est maintenant fragmenté en conscience et inconscience (...). Il faut trouver une architecture qui corresponde à l’homme fragmenté (...) qui soit adaptée à la condition actuelle de l’homme. »41
Le recours aux grands récits est dorénavant exclu : «on
39 LYOTARD, Jean-François, 1979 : La condition postmoderne, Les éditions de minuits, 1979, p.3040 PORTOGHESI, Paolo, 1982 : Le postmoderne, Electa moniteur, 1982, p.5341 AGACINSKI, Sylviane, 1992 : Volume (Philosophies et politiques de l’archi-tecture), Galilée, 1992, p.32
AAC056-7103
ne saurait donc recourir ni à la dialectique de l’Esprit ni même à l’émancipation de l’humanité comme valida-tion du discours scientifique postmoderne».42
Vers quoi l’architecture doit-elle tendre ? Doit-on suivre les prédictions de Sylviane AGACINSKI qui imagine une refonte théorique de l’architecture ? Doit-on, comme elle le suppose, soustraire toute métaphysique à l’ar-chitecture et ainsi revenir à une forme beaucoup plus empirique que l’architecture avait délaissée?L’architecture sous la période moderne était devenue un de ces grands récits qui voyait en la réalisation de l’Es-prit, la société sans classe, l’émancipation du citoyen, un but à atteindre. L’arrivé d’une remise en question de la légitimité de ces grands récits a fait vaciller les fonde-ments de ces principes idéologiques.Doit-on pour autant avec la fin de ces grands récits en conclure la fin de l’architecture, en tout cas l’architec-ture pensée sous l’ère moderne ?La fin des grands récits voit apparaître ce que LYOTARD appelle des «petits récits».
Les années 80 voient les architectes s’approprier tout un tas de discours et de figures philosophiques. Jean NOUVEL citant Michel FOUCAULT, Steven HOLL adepte de la phénoménologie d’un MERLEAU-PONTY, et EISEN-MANN travaillant en étroite collaboration avec le dé-constructivisme de J. DERRIDA.
42 LYOTARD, Jean-François, 1979 : La condition postmoderne, Les éditions de minuits, 1979, p.98
AAC056-7104
Cette fin des grands récits en point d'interrogation: L'ap-parition des petits récits est-elle un retour à une cer-taine forme d'empirisme?
AAC056-7107
PRATIQUE(S)
Passé les premiers mois, à mesure qu'avançait ma H.M.O.N.P., de plus grandes responsabilités m'ont été données au sein de l'agence. De l'élaboration d'un per-mis de construire pour particulier, pour un ERP, d'un APS de maison individuelle, d'un APD de maison BBC, des plans d'exécution pour une rénovation, un CCTP et un DPGF pour une rénovation de salles de classes, un appel d'offre et son analyse, le choix des entreprises avec le conseil municipal, le suivi de chantier d'une extension et ses comptes-rendus, l'appel aux entrepreneurs pour régler des problèmes techniques, la présentation des avant-projets aux maitres d'ouvrages, en tout une ving-taine de projets. Pour la plupart, tous nouveaux.
Les situations se sont succédées, apportant à chaque fois leur part de réjouissance d'exercer le métier, mais aussi de désillusion et d'incompréhension parfois. En sortir quelques unes, ne donnera jamais l'exhaustivité de ce que m'a appris cette première année d'exercice en agence, mais aidera toutefois à comprendre un peu mieux ma détermination à postuler à l'habilitation. Car sur chacun de ces travaux, l'agence m'a informé, pas-sant du temps à me réexpliquer chaque détail, chaque sens-caché, chaque subtilité. Ils ont pris chaque fois le temps d'écouter mes remarques, mes colères, mes incompréhensions, mes suggestions. M'ont donné chaque fois que je le sollicitais de la liberté, de l'initia-
AAC056-7108
tive. L'ex-étudiant, jeune diplômé faisant place, petit à petit, au professionnel de plus en plus responsable.
Parfois, je ne me sentais pas encore prêt à assumer tout, tout seul, sachant mes lacunes dans tel et tel domaine, ils ont à chaque fois répondu présent me réexpliquant, m'accompagnant, me soutenant. Avoir votre tuteur, vous présentant face à de nouveaux maîtres d’oeuvres comme « architecte », est certainement la plus grande preuve de confiance qu'il existe, et il faut l'assumer. Car si l'exercice du métier n'est pas le mont GOLGOTHA, parfois, les épaules sont lourdes, et les mains si petites. Les saynètes qui suivent n'ont donc pas pour objectif de pointer du doigt des défaillances. Elles ne tiennent ni du « rapport de stage » ni d'une entreprise arrogante du jeune qui voudrait en apprendre aux moins jeunes. Elles cherchent à cibler des moments clefs de ma formation H.M.O.N.P.. Des moments, où j'ai ressenti une respon-sabilité différente de celle que je percevais à la fin de ma formation initiale. Des moments enfin, où j'ai su que très vite, je voudrais prendre mes propres responsabili-tés, et les assumer.
AAC056-7111
LA RELATION ENTREPRENEURS-MAITRISE D'ŒUVRESUIVI DE CHANTIER
Le lundi nous avons l'habitude avec G. de faire une pré-visite de chantier afin de préparer celle officielle du mercredi. Cette visite nous permet généralement de re-cueillir des informations off sur l'avancement et les diffi-cultés rencontrées; et de régler les problèmes survenus depuis la semaine précédente. C'est une « prise de tem-pérature » en quelque sorte. Le vendredi précédent, la chape liquide devait être coulée dans un des bâtiments. La maîtrise d'ouvrage et l'agence étaient assez tendues sur ce point, car lors de la réalisation du précédant FAM43 des problèmes étaient survenus de retrait de la chape, créant un décalage avec le seuil des portes-fenêtres de 2 cm. L'agence avait donc pris les devant et bien porté l'attention de la nouvelle entreprise sur la réalisation parfaite de la chape et du niveau final à atteindre. Nous passions donc le lundi matin pour jeter un œil. Avec le maçon présent, faisant office de chef de chantier, nous avons mesuré le niveau de la chape par rapport au seuil, une différence d'1 cm est apparue. Après en avoir discu-té assez longtemps avec le maçon, qui n'était pas celui qui avait coulé la dalle, nous sommes rentrés à l'agence pour informer notre architecte. La tension est mon-tée avec la crainte de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Nous avons appelé l'entreprise responsable de la chape
43 Foyer d'accueil médicalisé
AAC056-7112
pour savoir comment s'était passé le coulage. L'entre-prise affirmait une parfaite maîtrise de son produit. Lors de la réunion du mercredi, nous sommes de nouveau arrivés un peu en avance, pour que l'architecte puisse aller constater de lui même. La dalle semblait encore plus basse qu'auparavant. Nouvelles discussions sur les « causes » avec le maçon chef de chantier. Lorsque les entrepreneurs convoqués et la maîtrise d'ouvrage déléguée arrivèrent, nous allâmes directement voir la chape. Après découverte pour ces derniers de la diffé-rence supposée de niveau, nous nous dirigeâmes tous vers une autre partie du bâtiment, là, pour en être sûr, un artisan, le menuisier bois prit son mettre et mesura le niveau de la dalle par rapport à l'emplacement prévu de l'interrupteur, nous annonçant une différence de quelques centimètres. Ça commençait à grincer tout autour, de la part de la maîtrise d'œuvre. Le chapiste n'étant pas là, chacun donnait son avis sur la question. Au final, après plusieurs minutes à discuter chacun dans son coin, la visite continua.
En rentrant, et après plusieurs appels, la situation s'enli-sait avec des positions de plus en plus fermées. Le cha-piste accusait le support polystyrène du chauffage au sol de se comprimer, diminuant le niveau global fini, le chauffagiste assurait que son polystyrène était conforme au DTU, le bureau de contrôle assurait le polystyrène sans vouloir se déplacer, et la maitrise d'ouvrage mena-çait de casser toute la chape pour la refaire. Après plu-sieurs jours, et de multiples suppositions, de réunions
AAC056-7113
sur le chantier, et de décisions non-prises car personne ne voulait en assumer la responsabilité (et engager son assurance), nous sommes retournés mesurer le niveau de la chape par rapport au seuil des portes-fenêtres, nous avons découpé le polystyrène qu'il y avait entre le seuil et la chape pour protéger le seuil et supporter les dilatations. Surprise générale, la chape était au niveau attendu, à quelques millimètres, et la mesure avait été prise précipitamment dans le trou qui il y avait entre la chape et le seuil. La mesure effectuée par le menuisier par rapport à l'emplacement de l'interrupteur, n'était pas l'emplacement définitif, mais celui d'un autre élé-ment. Il y avait eu toute une succession d'erreurs, mais la chape était au niveau prévu, avec la tolérance prévue. Chacun s'est alors félicité de s'être inquiété pour rien, « il valait mieux ça » et les entreprises mises en cause ont repris de la superbe.
Ce chantier est un foyer d'accueil médicalisé (FAM) et une petite unité de vie (PUV) pour personnes âgées handicapées, six bâtiments pour 4000m2 de constructions. C'est une des plus grosses affaires de l'agence, pour un coût des travaux engagés de cinq mil-lions d'euros. C'est la deuxième fois que l'agence traite ce type de programme. Le premier FAM, s'est construit dans une ville voisine, entre 2008 et 2010. L'agence a terminé l'année de parfait achèvement des travaux au mois de septembre dernier et assume aujourd'hui sa responsabilité décennale. La maîtrise d'ouvrage sur les deux projets était la même. À part quelques entre-
AAC056-7114
prises, l'équipe entrepreneurs-maitrise d'ouvrage-mai-trise d'œuvre était identique sur les deux chantiers. Depuis cinq ans, lors de la prise de contact et de la défi-nition du programme, l'agence et la maitrise d'ouvrage se voient au moins une fois par semaine. Et l'agence est en contact quasi quotidien avec les entrepreneurs, que nous retrouvons pour la plupart sur d'autres chantiers, et dont l'entreprise porte souvent la mention « & fils » à la fin du patronyme. Ceci pour expliquer les liens de proximité qui existent entre chacun des intervenants. Cette ville, et plus généralement la région où se trouve l'agence, est un endroit où la plupart des artisans et des personnes qui travaillent sont nés. Où, pour la plupart, des parents aussi, et où il n'est pas rare de faire affaire avec une personne exactement comme leurs aïeux ont pu le faire 30 ans auparavant. « Mais, c'est le fils? À l'époque du père, c'était pas pareil. » voilà qui résume si bien le contexte dans lequel se forment les relations. Je ne suis pas vraiment d'ici, je suis arrivé quand j'avais 11 ans, une éternité, mais mon nom n'est pas d'ici. Les personnes ayant un lien mémoriel avec moi ne sont pas encore des « décideurs ». Pour moi, et parce que j'ai été élevé comme ça, peu importent les noms, les antécédents et les gloires passées, ce qui compte c'est le présent, l'instant, le travail. Cette vision très rigide des choses s'accommode mal à l'exercice dans une telle région. Là où j'aurais très certainement agit de manière plus distanciée, plus neutre, me référant à ma mission, celle mandatée par notre maitrise d'ouvrage afin de li-vrer un bâtiment conforme aux qualités prescrites, aux
AAC056-7115
qualités payées; j'ai à contrario, suivi une intervention qui me paraissait plus douce, moins intransigeante, ne se fâchant ni avec la maitrise d'ouvrage, ni avec les entrepreneurs, passant plus de temps, jouant sur des limites, des discussions, s'arrangeant des détails, et par-fois des objectifs initiaux. Là on attendait un architecte fort, impartial, soucieux de la qualité du travail exécuté et n'hésitant pas à assumer ce rôle ingrat de contrôle, de direction, de suggestion et parfois de sanction; j'ai vu un traitement qui sauvegardait l'intérêt réel et véri-table, celui d'un édifice livré dans les temps et dans la légalité, d'une maitrise d'ouvrage satisfaite, d'entrepre-neurs travaillant correctement et de relations sociales sauvegardées.
J'ai eu du mal à le comprendre, et aujourd'hui encore, même si je comprends pourquoi l'agence a réagit de cette manière, et dans bien d'autres cas, en tenant compte en premier lieu de la relation avec l'arti-san, je reste persuadé que le rôle de la maitrise d'œuvre est de satisfaire le contrat passé et d'arriver à la qualité exigée. Que notre rôle social dans une économie locale, ne doit pas oublier que nous sommes avant tout man-datés par la maitrise d'ouvrage. Et c'est souvent ingrat, ça ne m'amuse pas plus qu'à d'autres de « faire le flic », mais il me semble important de ne pas oublier qu'avant de sauvegarder la santé financière de l'artisan, et de conserver une bonne humeur générale, nous sommes réunis, maitrise d'ouvrage, maitrise d'œuvre et entre-preneurs, pour réaliser un travail, que chacun, à des
AAC056-7116
temps différents a accepté, sciemment. Et donc, que ce travail mérite qu'on donne le meilleur de nous- mêmes, pour en être fiers, ensemble.
AAC056-7119
LA RELATION MAITRE D'OUVRAGE-MAITRE D'ŒUVRELA DÉLÉGATION DE POUVOIR
Aujourd'hui nous allons avec P.D. à la deuxième réunion de chantier du projet SU-DEK. Ce projet consiste à réa-ménager un local de vente de vélo, en zone de bureau pour un atelier de contrôle technique et de faire une extension structure métallique pour le contrôle tech-nique.
Le maitre d'ouvrage est quelqu'un de dynamique, d'une quarantaine d'années, très soucieux de comprendre son projet. Il connait bien les entreprises qui vont tra-vailler sur le chantier, pour être voisin avec certaines, et pour compter personnellement d'autres dans son cercle d'amis. C'est la quatrième réunion de chantier sur le site ce matin, j'avais moi-même rédigé le dernier compte-rendu, je savais donc exactement ce qui était à l'ordre du jour, et l'avancée attendue des travaux. Lorsque nous arrivons, le maçon nous prend tout de suite à part pour régler rapidement une hauteur des longrines en fonc-tion de l'état réel du terrain. Nous définissons tout cela, tous les trois ensemble. Puis nous appelons l'entrepre-neur chargé de la réalisation du bardage métallique, qui est aussi chargé de la structure métallique, pour lui ex-pliquer les changements à prendre en compte et donc, les quelques petits réglages. Au détour de la conversa-tion nous lui rappelons qu'il commence lundi prochain son intervention. Il s'arrête net, et nous dit que pour la
AAC056-7120
semaine prochaine, « il ne faut pas y compter ». On lui rappelle alors que tout ça était prévu et que le planning est défini. Il nous répond, qu'il veut bien, mais que lundi prochain, de toute façon il ne pourra pas puisqu'il n'a pas la ferraille. Stupeur de notre part. On se regarde, interdits. Alors le maitre d'ouvrage, prend les devants et lui dit que là « ça commence très mal », et que « ça va pas du tout, qu'on a fait des réunions trois mois à l'avance pour s'entendre dire qu'on sera pas dans les temps, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi? »-« Et bien, parce qu'on a pas commandé la ferraille. »-« Et pourquoi donc? Vous attendiez quoi? »-« Ben on avait pas des cotes définitives, on ne com-mande jamais rien tant que c'est pas définitif »-« non, mais enfin, vous les aviez bien, on vous les a transmises il y a trois semaines. »-« Oui, mais il y avait un doute, ça c'est éclairci il y a peu de temps, on a commandé y a deux jours, et avec les ponts... »P. prend alors la parole, « oui enfin, je vois pas en quoi ça vous empêchait de commander la ferraille, alors que le doute qu'on avait concernait la limite de terrain et donc au pire un changement de quelques millimètres. Enfin bon, on verra ça plus tard ».
Et alors tout le monde se dirige vers un autre bout du chantier, on continue avec d'autres corps de métier, n'hésitant pas à reparler de ce changement qui se profilait dans le planning. On s'aperçoit qu'il va falloir créer une cloison provisoire pour rendre « étanche »
AAC056-7121
l'ancienne partie des locaux non concernée par la démo-lition et l'extension. Je n'avais pas convoqué l'entreprise responsable de ce lot, menuiserie intérieure. Par chance, c'est un des amis du maitre d'ouvrage, qui s'empresse de l'appeler pour lui demander de monter sur le chan-tier, moins de dix minutes plus tard, l'entrepreneur est là, vu qu'on en a bien discuté tous ensemble en l'atten-dant, le maitre d'ouvrage se charge de lui expliquer ce qu'on attend de lui, ils partent ensemble avec un plan, et commence à définir les modalités. Pendant ce temps-là, avec P., nous mettons en place la prochaine phase des travaux avec l'entreprise responsable des menuise-ries extérieures et puis avec l'électricien. Une fois fini, l'entreprise chargée de réaliser la cloison intérieure provisoire nous salue, et s'en va. Quelques minutes plus tard alors que les entreprises encore présente discutent entre elles, nous rangeons nos plans dans la pochette rouge marquée CHANTIER SU. On fait le compte des crayons et on s'en va.
Lors d'un suivi de chantier, la maitrise d'ouvrage « alloue » à la maitrise d'œuvre la direction et l'exécu-tion des travaux. La maitrise d'œuvre en accepte les res-ponsabilités, ce qui veut dire qu'elle en accepte aussi, la partie moins agréable qui consiste à « faire le flic ». C'est à dire exiger de la part des entrepreneurs que le travail qu'ils ont signé et pour lequel personne ne les a forcé à s'engager soit exécuté. Correctement. C'est très certai-nement parce que j'ai vingt-cinq ans, et que je sors tout juste de l'école que je suis plus sensible à cet aspect
AAC056-7122
là, mais le jour où, en arrivant sur le chantier, c'est le maitre d'ouvrage qui a remis en ordre de marche les en-trepreneurs, à la place de mon collègue maitre d'œuvre, je me suis senti décrédibilisé et avec moi, toute la pro-fession. Qu'un maitre d'ouvrage soit ami avec un entre-preneur, qu'il l'impose pour un chantier, très bien. Nous savons dès lors qu'il sera plus difficile d'avoir une réelle « prise » sur son travail, mais il me semble important de ne pas renoncer trop vite. La maitrise d'œuvre telle que je la conçois nécessite des cadres très clairs. Le maitre d'ouvrage nous demande, et ensuite on transmet aux entrepreneurs. Je continue de penser que, chaque fois qu'on met à mal cette étape, on met en péril notre cré-dibilité, notre autorité et par là même le travail qui est censé s'exécuter. La maitrise d'ouvrage doit rester à sa place lorsqu'elle demande à la maitrise d'œuvre une mission de suivi de chantier. Accepter de rester en re-trait et surtout comprendre qu'elle a délégué une partie de son autorité. Mais c'est toujours difficile de deman-der au payeur de ne pas interférer dans son chantier.
C'est pourquoi, il me semble parfois plus judicieux, lorsque les conditions le permettent, d'effectuer deux réunions le même jour. Une première « suivi de chan-tier » avec les entreprises concernées, permettant de parler librement des difficultés, de trouver des solutions rapides et de diriger le travail. Et une seconde, qui pour-rait facilement suivre la première qui serait une « visite de chantier » avec la maitrise d'ouvrage, permettant
AAC056-7123
en une dizaine de minute de faire le tour des travaux effectués, de présenter le projet et son évolution, de recueillir les suggestions, sans interférence direct avec les entreprises. Bref, de reprendre notre rôle de maitre d'œuvre.
AAC056-7125
NOUVEAU PROJET
Ils viennent de refermer la porte, Monsieur et Madame Genre, après une poignée de main. Un « bon courage » lâché un peu désespérément, avec mon architecte nous sommes restés cois. Nous venions de discuter pendant une heure, dans les locaux de l’agence. Mon-sieur et Madame, sont nos clients. Ils sont venus la pre-mière fois il y a un mois pour construire leur maison: 140 m2, « moderne », piscine et tout le Barnum Art & décoration. Division des tâches: mon tuteur, les a vus en premier, discuté des détails, du budget, des envies. J'ai fais les esquisses. Nous en avons discuté, retravaillé, échangé et validé avant de proposer. Premier échange face aux clients, mon tuteur me demande de rester, de présenter. Il me fait confiance et ce n'est pas rien. Nous discutons bien tous les 4. Première surprise des clients, les dimensions de leurs pièces, « trop petites ». Une di-zaine de pièce dans 140m2... Premier reflex: le budget. Trop petit. Effet M&Ms, 30% en plus pour le même prix. Nous avons modifié le programme, pris en compte les « vraies dimensions des pièces », supprimé la piscine, supprimé des détails, supprimé des envies.Nous savions ne pas tenir le budget, nous avons merdé. Nous aurions dû être plus attentifs, plus réactifs, avec ce terrain, sa situation, être plus durs, puisqu’en fait « c’est à nous de faire redescendre les clients sur terre », et dire: non, tout ceci à ce prix est impossible. Mais nous sommes là. Nous avions envie, et nous avons pris du
AAC056-7126
temps, beaucoup. 150 heures, pour faire simple. Et nous sommes de nouveau arrivés au même point: terrain coûteux, désir coûteux, budget énorme pour ce début de famille, mais insuffisant.Nous nous sommes serré la main. Nous avons dit « bon courage ». Nous avons échoué dans notre rôle de bâtis-seur, mais nous y avons mis du cœur, passé du temps comme des enfants, posé des limites, expliqué et ensei-gné. Nous avons conseillé. Nous avons dit « Bon cou-rage ».
Il y a un certain risque, toujours, à se lancer bille-en-tête dans un nouveau projet. Mon tuteur, m'avait laissé quartier-libre, je pouvais passer tout le temps que je voulais, toute l'énergie que je souhaitais. Quand je serais prêt, on contacterait le jeune couple qui attendait un enfant. Je ne savais pas combien l'agence avait négo-cié pour cette première phase d'étude, je n'avais qu'une seule consigne, noter les heures passées. J'aurais dû me méfier... J'avais bouffé la feuille, toutes ces heures pas-sées dépassaient largement le temps « estimé » pour ce travail, et donc les honoraires prévus. Mon tuteur vou-lait me faire comprendre un autre aspect de la maitrise d'œuvre, et du gérant d'une agence: la maitrise finan-cière de son agence, pour une viabilité. La maitrise du temps à répartir, entre désir et rentabilité. Trouver le juste milieu. C'était réussi.
AAC056-7129
LA RELATION ARCHITECTE-MAITRE D'ŒUVRELES DEVOIRS
J'avais une certaine conception de la justice, jeunesse oblige. Pour moi les choses sont carrées. Justes ou injustes. Sans hiérarchie. On apprend un peu au jour le jour, on réajuste son fusil sur l'épaule, prêts à tirer au cœur des quelques lignes de conduites fixées trop jeune, sans expérience.
Alors voilà, nous avons décidé de réunir des lots, dans notre Cahier des Clauses Techniques Particulières, par facilité. Parce que « après tout », ça facilitait le travail. Mais lequel? Le nôtre. Nous avons donc accepté que les garde-corps en aluminium soit traités par le lot Menui-serie Aluminium, alors que c'est un travail de Serrurerie, et puis petit à petit, nous avons passé la commande des portails aluminium, toujours, dans le lot du menuisier, encore. Alors que c'est un travail de serrurerie. Et puis arrive un jour où, il n'y a plus que les portes de garages, dans ce lot Serrurerie, alors on le bascule dans le lot du menuisier alu, après tout, il trouvera bien un endroit où se fournir. Cette découverte d'une incroyable banalité, ne choque plus personne, toutefois elle pose quelques questions. À quelle qualité de travail supposons-nous arriver lorsqu'on se passe volontairement d'un corps de métier spécialisé pour redistribuer à un autre, transfor-mé alors en supermarché de la construction; spécialiste en rien, mais négociant en tout? Cette manière de faire,
AAC056-7130
rongée par l'habitude, est comme les petits mensonges qu'on se fait tous les jours, il ne suffit pas de les répé-ter pour les transformer en vérités. L'architecte maitre d'œuvre, n'est pas qu'un maitre d'œuvre, c'est aussi un architecte. Prière de ne pas faire du canada dry, « ça en a le goût, ça en a la couleur, mais ça n'en est pas » disait un de mes professeurs. En attendant, des métiers meurent, et d'autres s'enrichissent.
C'est la vie, disent certains.D'autres patiemment, démontent les pavés pour trou-ver la plage.
AAC056-7133
CONCLUSION
30 juin 2011.
Je venais de terminer mes études d'architecture. J'avais terminé des études pas finies, puisque j'avais un diplôme d'architecte délivré par l'Etat, mais l'impossibilité de m'inscrire à l'ordre des architectes. Mais tout ça n'avait pas vraiment d'importance. Après tout je n'étais pas en-core vraiment diplômé, je n'avais toujours pas fais mon stage de MASTER II. Il fallait faire ces 2 mois de stage et après advienne que pourra. Et bien évidemment, il s'en est passées des choses, pas plus qu'à d'autres, pas moins non plus. Au mois de juin je percevais encore mal ce que m'apporterait une inscription précoce à l'ordre des architectes, je résumais ça à un acte précipité. Je me serai inscrit pour des raisons très simples, difficiles à assumer. Parce que je ne savais pas bien de quoi serait fait l'avenir, que je ne voulais pas me retrouver dans dix ans, pris dans des projets, à crier à tous de s'arrê-ter et de m'attendre, parce que « je n'étais pas inscrit à l'ordre », que « je n'étais pas référencé, que je n'étais pas coopté ». Une inscription en prévision, prend donc ton parapluie, on sait jamais. Et puis, parce que je vou-lais aussi, comprendre la différence: ce qu'il y avait der-rière cette habilitation. J'ai commencé à suivre les cours théoriques à l'ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE LYON. Petit à petit, des aspects que j'avais mis de coté ont resurgit. La prise de responsabilité, la prise de décision, la curiosité
AAC056-7134
pour les choses et leur fonctionnement, comprendre les rouages, apprendre pour pouvoir entreprendre, et vice versa. Je partage avec d'autres ce sentiment que j'analyse comme une des motivations primitives à deve-nir architecte. Curiosité, pour les choses, pour les êtres, pour le fonctionnement d'un carré dans une serrure, les béquilles, la gâche et le canon. Faire des belles pers-pectives, passer du temps à détourer les bons arbres, choisir les plus beaux personnages pour créer l'image idéale, m'a toujours ennuyé. Profondément. J'admire, les architectes qui proposent des perspectives de leur projet à leur client avec, non plus une herbe en fleur où volent délicatement les papillons, mais celle d'un bâti-ment les deux pieds dans la boue, marron et liquide, comme il arrive parfois qu'elle devienne. Bref, j'ai peur de l'ennui. Les choses pour se faire plaisir à l'œil m'ont toujours semblé un excès de paresse, une réponse à une question qu'on nous avait pas demandée. Il ne sert à rien de se battre sur les terres de Valerie DAMIDOT & Co, mais c'est plus facile, il est vrai, que d'aller cha-touiller le maçon sur sa manière de faire la colle entre les briques, ou le charpentier sur la faiblesse de ses en-traits. J'espérais donc, une première année d'exercice en rupture avec ce qu'on m'avait enseigné, une année où loin d'avoir fait le tour de la question j'aurais posé les premières bases, les premiers cadres, les premières envies. Où j'aurais appris, puisqu'à mon âge, il n'y a que ça à faire, des manières de faire qui, bientôt, me servi-raient.
AAC056-7135
Comme souvent, j'ai eu du mal à faire exactement ce qu'on attendait de moi, certains imaginaient des ave-nirs intellectuels, j'allais au plus profond du concret, choisissant d'autres personnes, d'autres voies, d'autres pensées. Agir en primitif et prévoir en stratège44. Car je savais bien que j'y apprendrais des choses différentes, que fatalement, j'allais douter de moi, des autres, mais qu'une fois l'heure du bilan, je ne regretterais rien. Que de jeune diplômé, ex-étudiant, je serais devenu jeune architecte, maître d'œuvre. C., Gi., G., P. et J.. Cinq personnes qui ont à chaque instant partagé leurs expériences, enseigné, complété. Mon père, citant Paul CLAUDEL sans le savoir, me disait petit pour me responsabiliser: nos actes ne nous suivent pas ils nous précèdent. Je suis fier d'avoir commencé ma vie profes-sionnelle avec eux. J'ai appris, un peu, à infléchir mon jugement, à être exigeant dans le travail et le résultat, voir la multiplicité dans la manière d'y arriver. À faire preuve d'humilité, sur les compétences, les attentes, les rapports. À décomplexer des architectures, à travailler avec plaisir, dans le dialogue, à inviter n'importe quelle personne qui entrait dans l'agence à partager un café et à discuter. Sachant pertinemment que l'essentiel ne se trouvait ni derrière son ordinateur ni derrière son bureau. J'y ai appris, patiemment, à prendre des res-ponsabilités, à découvrir des lois, des freins, la valeur du temps passé, la complexité et l'énergie qu'il y a derrière
44 CHAR, René, 1967 : Agir en primitif et prévoir en stratège, in Fureur et mystère, Gallimard, p.73
AAC056-7136
une architecture réelle. L'éloge de l'ombre45. J'ai appris à aimer ça. Difficile d'imaginer moins, maintenant.
31 mai 2012. Je suis tout proche de commencer autre chose, avec d'autres gens, d'autres lieux. Je ne sais pas encore sous quelle forme, ni combien de temps. Certains parlent de former des groupes, des brigades, d'autres des alliances ponctuelles, nous verrons bien. Ce qui m'importe plus que tout, c'est de défendre, par mes actes, une architecture et la manière dont on me l'a transmise.
Pas celle, égoïste, des é-nièmes musées sur la seconde guerre mondiale, aux millions d'euros pour se faire plai-sir, alors que toujours 10% de la population est sans em-ploi, que des milliers de personnes s'endorment triste-ment tous les jours, que des choses, plus directes, plus petites, plus essentielles sont à faire. Ce n'est pas une architecture politique, socialisante et bien pensante. Le cœur à gauche, et le paradis pour tous. C'est une archi-tecture de priorités. Les miennes. C'est une architecture qui ne cherche pas la publication, c'est une architec-ture anonyme, patiente, lente. Celle d'une personne au milieu d'autres, parce qu'il y aura, je l'espère toujours, des choses plus importantes. Solliciter une inscription à l'Ordre c'est s'engager, un peu. Pour quelqu'un qui n'a pas connu le service militaire, ça semble une substitu-tion bien plus belle. Celle d'assumer des responsabilités
45 TANIZAKI, Junichiro, 1933 : Éloge de l’ombre, Éditions Publications orien-talistes de France .
AAC056-7137
et de dire que « cette manière de faire » parfois hési-tante, parfois troublante n'est pas vaine.
Dans quelques années, lorsque C., Gi., G., P. et J. auront définitivement rebouché leurs stylos, lorsque les der-nières feuilles de calque ne serviront plus qu'à dessiner des images à colorier pour leurs petits enfants et qu'on décollera les lettres peintes en blanc sur la façade de l'agence, j'espère qu'ils seront fiers d'avoir, bien plus que transmis un peu d'architecture, partagé du temps. À ces vieux là, merci.
AAC056-7139
L'IMPRUDENCE
Nous étions arrivés tout en haut de la montagne, après avoir parlé en anglais pendant une heure. Chacun s'es-crimant dans une langue qui n'était pas la sienne. Le groupe faisait une pause, il fallait laisser passer le trou-peau de moutons, libres, qui descendaient par le même chemin. Chacun prenait des photos de la vallée plongée dans la brume, de ces herbes jaunies, de ces cailloux silencieux. Nous même nous sortions déjà nos appareils lorsque le vent a soufflé, déplaçant cette robe blanche jusqu'à nous. En un instant, les arbres s'animaient, gigantesques héros aux bras effrayants, la pluie s'est abattue tout doucement, juste le temps de mouiller nos joues. Nous nous sommes regardés un instant, captifs d'un sentiment océanique. Nous avons rangé nos appa-reils. Aucune photo ne pourrait traduire cela.
Les questions, les grandes réponses, les quelques étapes et les grands barrages. C'est la vie toute entière qui répond à l'intranquilité, les malles de Bernado de nou-veau, pleines à craquer. Jeunesse oblige on s'échangeait des soupirs au creux de l'oreille. Entourés de quelques amis, on tapait sur la table en hurlant No Pasaran. Tra-versant LISBONNE, BARCELONE. S'assurant en se pres-sant, d'être toujours vivants. On finit par se faire des promesses, à trahir. Un jour ou l'autre.
AAC056-7140
Ces derniers temps, j'aime regarder des films italiens sur les brigate rosse, lorsque le réalisateur, au delà des obli-gations morales classant tour à tour le respectable et l'intolérable, ne garde de ces années que les chimères. Ces années, dures et douces. Dures. Une société qu'il fallait changer. Douces. L'espoir qu'on pouvait encore le faire. Aujourd'hui, je sais très bien que je n'aurai jamais le courage de changer tout ça. Il me suffit de la voir sou-rire par en dessous, éclairant à chaque instant sa fragi-lité, pour en oublier le reste. Alors quand nous parlons d'architecture et d'avenir, je n'ai à répondre que le pré-nom de ce sourire.
Certains partent en croisière contre des démons plus grands qu'eux-mêmes, d'autres cherchent des trésors à troquer, quelque part, dans un ailleurs. Je n'ai toujours eu l'impression de partir que pour avoir des histoires à raconter. A ceux que je rencontrais là bas, à ceux que je rejoignais ensuite. Je pollinisais le monde à ma manière, les fleurs d'alors me semblaient toujours belles et mon bourdonnement, essentiel.
Autrefois, il suffisait de descendre du bateau pour être arrivé. Alors debout sur la proue, entrant dans le port de ELLIS ISLAND, on savait avoir fait le plus dur. Lors de la grande traversée des sentiments, subissant des tem-pêtes, connaissant la détresse, les amis imaginaires,
AAC056-7141
l'espoir, la nuit. Cœurs voyageurs, au coin du lampa-daire, c'est ALEXANDRIE qui s'éclaire. Les premières rues empruntées et les premières gens à qui parler, le commencement simple de ces quelques idées rêvées alors, accrochés au bastingage, les yeux à l'horizon, cal-feutré dans ce manteau aux manches trop courtes. On rêvait d'aventures. On la vivait. Dès lors s'accomplissait l'imprudence.
AAC056-7143
ANNEXES - FICHES PROJETS:
• Maison individuelle • Extension d'un atelier artisanal • Logement collectif• Hangar de stockage fourrage• Extension d'un groupe scolaire• Rénovation Maison Individuelle• Extension Maison Individuelle• Extension Maison Individuelle• Rénovation d'un restaurant• Extension d'un bâtiment commercial• Rénovation Maison Individuelle• Rénovation Maison Individuelle• Maison Individuelle• Foyer d'accueil Médicalisé (Gueugnon)• Foyer d'accueil Médicalisé (Ferreuil)• 24 stalles pour chevaux• Maison Individuelle• Extension d'un appentis de stockage bois• Rénovation en lieu de culte et logement• Maison Individuelle• Aménagement et remise aux normes de 2 salles de classes• Extension Maison Individuelle• Extension Maison Individuelle• Extension d'un bâtiment commercial• Extension Maison Individuelle• Mise aux normes Accessibilité PMR pour magasin• Construction d'un centre réparation pare-brise A+glass
AGACINSKI, Sylviane, 1992 : Volume (Philosophies et politiques de l’architecture), Galilée, 1992,
p.5###-AAC056-7077
AGACINSKI, Sylviane, 1992 : Volume (Philosophies et politiques de l’architecture), Galilée, 1992,
p.26###-AAC056-7084
AGACINSKI, Sylviane, 1992 : Volume (Philosophies et politiques de l’architecture), Galilée, 1992,
p.32###-AAC056-7102
ALBERTI, Léon Battista, 2004 : De re aedificatoria (L’art d’édifier) , traduction du latin par CAYE, Pierre
et CHOAY, Françoise, Éditions Seuil, Collection Sources du Savoir.###-AAC056-7095
CAMUS, Albert, 1956 :La chute, Gallimard, 1956.###-AAC056-7050
EPRON, Jean-Pierre, 1992 : Architecture une anthologie, Tome 1, La culture architecturale, Mardaga,
1992, p.291###-AAC056-7090
HADOT, Pierre, 2002 : La philosophie comme manière de vivre, Albin Michel, 2002.###-AAC056-7071
LAGUEUX, Maurice, 1993 : la tête de l’architecte, dans Antonia Soulez, L’architecte et le philosophe,
Mardaga, 1993, p.69###-AAC056-7088
LAGUEUX, Maurice, 1993 : la tête de l'architecte, dans Antonia Soulez, L'architecte et le philosophe,
Mardaga, 1993, p.69###-AAC056-7081
LASCH, Christopher, 2006 : la culture du narcissisme, champ-flammarion, 2006.###-AAC056-7063
LE CORBUSIER, 1923 : Vers une architecture, champs arts flammarion, 1923.###-AAC056-7049
LYOTARD, Jean-François, 1979 : La condition postmoderne, Les éditions de minuits, 1979, p.7###-
AAC056-7098
LYOTARD, Jean-François, 1979 : La condition postmoderne, Les éditions de minuits, 1979, p.30###-
AAC056-7102
LYOTARD, Jean-François, 1979 : La condition postmoderne, Les éditions de minuits, 1979, p.63###-
AAC056-7099
LYOTARD, Jean-François, 1979 : La condition postmoderne, Les éditions de minuits, 1979, p.98###-
AAC056-7103
PAGNOL, Marcel : Le château de la mère.###-AAC056-7041
PORTOGHESI, Paolo, 1982 : Le postmoderne, Electa moniteur, 1982, p.10###-AAC056-7101
PORTOGHESI, Paolo ,1982 : Le postmoderne, Electa moniteur, 1982, p.46###-AAC056-7097
PORTOGHESI, Paolo, 1982 : Le postmoderne, Electa moniteur, 1982, p.46###-AAC056-7096
PORTOGHESI, Paolo, 1982 : Le postmoderne, Electa moniteur, 1982, p.53###-AAC056-7102
BIBLIOGRAPHIE
AAC056-7146
INDEX
A
Abel et Caïn AAC056-7050
AGACINSKI, Sylviane AAC056-7077, AAC056-7084, AAC056-7102, AAC056-7103
ALBERTI, Léon Battista AAC056-7083
Algérie AAC056-7052
ANDO, Tadao AAC056-7058
ARISTOTE AAC056-7079, AAC056-7087, AAC056-7088
B
BEAUNE AAC056-7048
Bigness AAC056-7101
BOUCHAIN, Patrick AAC056-7050
BOULLÉE, Etienne-Louis AAC056-7084
BOURGOGNE AAC056-7049, AAC056-7058
BUBER, Martin AAC056-7100
C
Cahier des Clauses Techniques Particulières AAC056-7129
CAMPO BAEZA, Alberto AAC056-7057
CAMUS, Albert AAC056-7050
CHAR, René AAC056-7135
CLAUDEL, Paul AAC056-7135
CLUNY AAC056-7052
CONFLUENCE AAC056-7062
D
DAMIDOT AAC056-7134
DERRIDA, Jacques AAC056-7103
DESCARTES AAC056-7082
DIOGÈNE AAC056-7041, AAC056-7050
DTU AAC056-7112
E
ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE LYON AAC056-7057
INDEX
AAC056-7148
ÉCOLE DES BEAUX ARTS AAC056-7048
EISENMANN, Peter AAC056-7102, AAC056-7103
EPRON, Jean-Pierre AAC056-7090
Erasmus AAC056-7049
ESPAGNE AAC056-7042
F
FAM AAC056-7111
FOUCAULT, Michel AAC056-7103
FRANCE AAC056-7042, AAC056-7049, AAC056-7084
FREUD, Sigmund AAC056-7102
G
GEHRY, Frank Owen AAC056-7053
GOLGOTHA AAC056-7108
GORZ, André AAC056-7102
GRENOBLE AAC056-7052
H
HADOT, Pierre AAC056-7071
haïkus AAC056-7050
HERZOG ET DE MEURON AAC056-7058
HOLL, Steven AAC056-7103
HUGO, Victor AAC056-7051
J
JENCKS, Charles AAC056-7101
K
KAHN, Louis Isadore AAC056-7057
keynésisme AAC056-7099
KOOLHAAS, Rem AAC056-7074
L
LAGUEUX, Maurice AAC056-7081, AAC056-7088
LA ROCHEFOUCAULD AAC056-7051
AAC056-7149
LASCH, Christopher AAC056-7063
LAS PALMAS AAC056-7041
LE CLEZIO, Jean-Marie Gustave AAC056-7050
LE CORBUSIER AAC056-7049
LEFEBVRE, Henry AAC056-7101
LEVINAS, Marc AAC056-7100
Live at Pompei AAC056-7050
LYON AAC056-7066
LYOTARD, Jean-François AAC056-7098, AAC056-7099, AAC056-7101, AAC056-7102, AAC056-7103
M
machines à habiter AAC056-7099
MÂCON AAC056-7052
MALEVITCH, Kasimir AAC056-7095
MARX, Karl AAC056-7088
MEGARON AAC056-7052
MEIER, Richard AAC056-7057
MERLEAU-PONTY, Maurice AAC056-7103
métadiscours AAC056-7100
métarécits AAC056-7098
MILAN AAC056-7048
MONTALE, Eugenio AAC056-7097
N
NOUVEL, Jean AAC056-7103
O
Oh Yoko AAC056-7050
P
PAGNOL, Marcel AAC056-7041
PANOFSKY, Erwin AAC056-7080
paradoxe du sôrite AAC056-7100
PARAY-LE-MONIAL AAC056-7052
PERUGINI, Giuseppe AAC056-7048
PICON, Antoine AAC056-7083
PLATON AAC056-7087
AAC056-7150
PORTOGHESI, Paolo AAC056-7096, AAC056-7097, AAC056-7101, AAC056-7102
POUY, Jean-Bernard AAC056-7037
R
RAVEREAU, André AAC056-7052
réunion de chantier AAC056-7119
RHÔNE AAC056-7062
ROME AAC056-7048
S
SAÔNE AAC056-7062
Solidarnosc AAC056-7096
Stratégie et Pratique Architecturale Avancée AAC056-7050
Style International AAC056-7090
suivi de chantier AAC056-7121
T
TANIZAKI, Junichiro AAC056-7136
U
Universidad de LAS PALMAS de Gran Canaria AAC056-7049
V
VALERY, Paul AAC056-7080, AAC056-7081, AAC056-7082
VENISE AAC056-7097
VILLEFRANCHE S/SAÔNE AAC056-7047
de VINCI, Léonard AAC056-7081, AAC056-7082
visite de chantier AAC056-7111
VITRUVE , Marcus Vitruvius Pollio AAC056-7084
W
WITTGENSTEIN, Ludwig AAC056-7100
Z
ZENGHELIS AAC056-7050
AAC056-7151