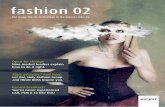AAC050 - ARCHITECTURE ET CREATION 02
Transcript of AAC050 - ARCHITECTURE ET CREATION 02
Séminaire.Matérialité.Architecture.&.CréationM A S T E R - E N S A L - 2 0 1 2 - H A Y E T
18052012
02ARCHITECTUREET CRÉATION
ARCHITECTURE ET CRÉATION02
Synthèse des travaux pédagogiques des étu-diants dans le cadre du séminaire "Matérialité - Architecture et Création", MASTER MATÉRIA-LITÉ, École Nationale Supérieure d'Architecture de LYON, sous la direction de William HAYET. 18052012
AAC050-6111
SOMMAIRE
AAC050-6113 SOMMAIREAAC050-6117 - DIDELON, Valéry (2011) : La Controverse - Learning from Las Vegas, Editions Pierre Mardaga.AAC050-6125 - MANGIN, David (2010) : La ville franchisée, Formes et structures de la ville contemporaine, Editions de La VilletteAAC050-6111 - CHARMES, Erik; SOUAMI, Taoufik (2009) : Villes rêvées, villes durables, Éditions Gallimard, coll. Découvertes.AAC050-6119 - COLLECTIF (2006) : Eco-quartier, Revue Urbanisme No 348, mai-juin 2006.AAC050-6125 - Etude de cas : La «ville-archipel» de Rennes.AAC050-6135 - LECLERCQ, François (2006) : Pour la ville, quel que soit l’état du monde, Editions NEJMP, Collections Passage VéritéAAC050-6143 - COLLECTIF (2005) : Food and City, Revue Architectural Design, Vol 75 No 3 May/June 2005.AAC050-6149 - VIRILIO, Paul (2010) : L’administration de la peur, Editions Textuel.AAC050-6153 - DANTEC, Maurice G. (2003) : Villa Vortex, Éditions Gallimard, Collection La Noire.AAC050-6161 - BAUDELAIRE, Charles (1857) : Les fleurs du mal, Éditions Poulet-Malassis et de Broise, Paris.AAC050-6165 - BECHER, Bernd; BECHER, Hilla (1979-1991) : La série Typologie des monuments industriels.AAC050-6169 - SINCLAIR, Iain (2011) : Londres 2012 et autres dérives, Manuella Editions.AAC050-6175 - GUILHEUX, Alain (2012) : Action architecture, Éditions de La Villette.AAC050-6181 - LEWIS, Duncan; FRANCOIS, Edouard (1999) : Construire avec la nature, Editions Edisud.AAC050-6186 BIBLIOGRAPHIE
AAC050-6113
VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, 1977 : L’enseignement de Las Vegas, ou le symbolisme oublié de la forme architecturale, MITpress, Cambridge.
DIDELON, Valéry (2011) : La Controverse - Lear-ning from Las Vegas, Editions Pierre Mardaga.
AAC050-6116
DIDELON, Valéry (2011) : La Controverse - Learning from Las Vegas, Editions Pierre Mardaga.
Valéry DIDELON est étudiant au début des années 1990. Il lit Learning from LAS VEGAS paru quelques 20 années plutôt. Il l’interprète comme une remise en question par ces auteurs du mouvement moderne. Après une dizaine d’années d’exercice, il souhaite porter sa réflexion sur le rôle de l’archi-tecte au sein de la société, à travers un doctorat en histoire de l’architecture. C’est à ce moment là qu’il se replonge dans l’ouvrage des VENTURI. Ce qui a suscité des réactions à l’époque, fût la position des VENTURI face à leurs confrères, qui réduisaient l’architec-ture à un simple outil de communica-tion. La controverse est lié au fait que les VENTURI défendent l’architecture populaire, souvent jugé par
L’auteur s’est attaché à l’écriture de cet ouvrage suite à une confrontation personnelle de l’interprétation de celui-ci. Il l’avait lu lors de ces études et quelques années plus tard, eu de nouveau l’opportunité de le relire. Il en fit une toute autre analyse et nous fait partagé le parcours qui a suivi cet « relecture ». L’ouvrage se décline en phase, correspondantes à l’évolution de son travail de recherche.
CHAPITRE 1CONTEXTE
Ces deux jeunes architectes sont consi-dérés comme des marginaux. Il profit d’études qu’ils encadrent, dans le cade d’ateliers universitaires, pour étudier l’évolution de la ville de LAS VEGAS et son changement qui a lieu à la fin des années 1960. La ville est prise en main par le pouvoir des grandes multinatio-nales, qui influe une ère capitaliste en-
gendrant une architecture populaire, à l’image du mouvement pop art. Ce qui sera donc décriée, par une caté-gorie d’architectes plutôt élitistes.Le souhait de s’engager socialement pour Denise SCOTT BROWN passe par l’urbanisme comme il se produit aux USA.
La ville de LAS VEGAS, nommée la ville qui ne dort jamais a connu un dévelop-pement rapide d’abord point de halte ferroviaire, puis installation d’une base aérienne, construction d’une barrage hydroélectrique, ...Construction des premier club et hôtel permettant le divertissement de la population de LOS ANGELES. «Ce mé-lange de bon procéder entre électricité et industrie» va engendrer une crois-sance linéaire entre les deux villes. La place «du désert» permit l’étalement de parking, la création de voies larges, ..., et des enseignes colorées et lumi-neuses.Cette ville est créée à l’image des ces différents concepteurs, gangsters pas toujours très sages.
CHAPITRE 2INTÉRÊT DU PAYSAGE COMMERCIAL ET VERNACULAIRE AMÉRICAIN
En s’appuyant sur la particularité de cette ville, la revendication d’une ar-chitecture de la communication plu-tôt que de l’espace, est mise au jour. Les VENTURI constate sa vitalité. Le chaos du Strip de LAS VEGAS montre une appropriation de l’architecture populaire, et reflète un bien vivre de celle-ci. Toute une description de l’ar-chitecture et du mouvement moderne de l’époque conduit à remettre en
AAC050-6117
VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, 1977 : L’enseignement de Las Vegas, ou le symbolisme oublié de la forme architecturale, MITpress, Cambridge.
question le mouvement qu’un certain éclectisme.Un élan international est constaté, il remet en cause, partout, les élites. Les VENTURI revendiquent de la possibi-lité de poursuivre une ville avec ce qui la compose déjà et non la tabula rasa.
CHAPITRE 3 RÉCEPTION 1968-1971
L’auteur s’appuie sur le principe de Jean Paul SARTHE selon lequel un live n’existe que sil est partagé, c’est le lec-teur qui donne le sens à un texte. Ce chapitre s’intéresse plus précisément aux réactions des journalistes, archi-tectes et historiens entre 1968-1971 sur les deux articles publiés par les VEN-TURI et sur leur studio. Le travail des VENTURI au sein de l’école de Yale est considéré comme un atelier où l’expé-
AAC050-6118
rience passe « autant à désapprendre qu’à apprendre ». En octobre 1971, le travail des VENTURI et de leur studio est exposé. The NEW YORK TIMES ma-gazine écrit « les VENTURI ont rendu furieux les autres architectes, fasciné les étudiants, et sont peut-être deve-nus les figures les plus controversées de l’architecture américaine d’aujourd’hui », le paysage pop de LAS VEGAS. Du-rant cette période pas moins de 21 textes sont publiés autour de Learning from LAS VEGAS. La mie en valeur de notions de contradictions et de com-plémentarités mettent en exergue le mouvement naissant autour de thé-matiques : signe et/ou espace ; ordre et/ou chaos ; révolution et/ou statu quo ; utopie et/ou contre utopie ; avant-garde et/ou contre avant garde ; pop et/ou camp ; élitisme et/ou popu-lisme.
SIGNE ET/OU ESPACE : Selon un architecte argentin, les enseigne du Strip engendrent « une somme de significations complexes à travers une multiplicités d’associations », pour d’autres ce paysage évoque « une communication fictive, un simu-lacre de communication, rien que des bavardages, rien que du bruit »Analogie en architecture et langage est un mouvement de l’époque. A NAPLES, en 1967, Roland BARTHES affirme, que « la cité est un discours et ce discours est véritablement un langage : la ville parle à ses habitants, nous parlons notre ville… » Ce qui mets les VENTURI en confrontation avec leurs confrères c’est que ces derniers recherche plu-tôt de réponses d’ordre sociale et ne pense pas que la réponse soit dans les enseignes.
ORDRE ET/OU CHAOS : Le strip est considéré comme un chaos de par les enseignes, … pour certains, c’est la « posture sociale, esthétique et intellectuelle adoptée par la plus récente avant-garde ». La position des
VENTURI s’élève contre W. GROPIUS. Pour ce dernier, comme beaucoup d’autres, la ville de bord de route est considérée comme architecture popu-laire, avec les supermarchés, stations-services, motels, lampadaires, et sans planification urbanistique.
RÉVOLUTION ET/OU STATU QUO :La critique faite aux VENTURI est de ne plus jouer leur rôle social, et de construire pour l’élite. La révolution est ressentie en Amérique et en Europe. Le soulèvement est de tout ordre. En réponse à leur postulat et pour ap-puyer leur volonté en tant qu’acteur social, il explique que leur parti est : « l’architecte qui commence avec ce qui existe » est « moins dangereux et plus efficace »
UTOPIE ET/OU CONTRE UTOPIE :Considéré comme conservateur, il est question d’utopiste anti-utopiste.
ÉLITISME ET/OU POPULISME : Les VENTURI sont accusés de pro-mouvoir le capitalisme, et l’urbanisme populiste. Dans la tourmente politique et la campagne présidentielle, ils sont pris à parti comme soutien au pré-sident sans tenir compte des besoins des « masses ».
AVANT-GARDE ET/OU ARRIÈRE AVANT GARDE :
La réaction que suscite le livre s’inscrit pleinement dans cette thématique té-moignant d’un changement d’ère.
POP ET/OU CAMP : En situation de changement, Denise SCOTT BROWN, parle de la ville « comme un assemblage de sous-cultures » et valorisant les « besoins » des hommes. La confrontation des arts, l’inspiration du pop sur l’architec-ture, débat esthétique.
« Elle (la période) met en évidences
AAC050-6119
VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, 1977 : L’enseignement de Las Vegas, ou le symbolisme oublié de la forme architecturale, MITpress, Cambridge.
AAC050-6120
la variété, et souvent la qualité des arguments qui ont été mobilisées par les différents acteurs. ( …) On a ainsi beaucoup discuté, … du devenir de l’architecture et des formes qu’elle doit prendre dans une société dominée par les mass média. L’interrogation s’est donc posée sur le développement ur-bain, et suburbain, le long des voies, avec l’architecture commerciale.Remise en question de la place de l’ar-chitecte et de son rôle
CHAPITRE 4 LEARNING FROM LAS VEGAS
Ce chapitre va reprendre l’évolution des réflexions des VENTURI, les ar-ticles, interviews, conférences, exer-cices d’atelier, … avec pour réflexion de fonds, le devenir du modernisme, et aussi la composition de celui-ci. Cet ouvrage permet de regrouper et for-maliser l’ensemble de leurs écrits sur LAS VEGAS. Ils attachent une impor-tance toute particulière sur le rap-port entre la forme et le fond. Ils vont pourtant rencontrer des difficultés avec la graphiste qui propose une « expérimentation visuelle hors normes » de leur ouvrage. Il s’avère que les reproches qu’ils révèlent chez d’autres architectes, ils n’arrivent pas au sujet de leur livre à l’appliquer. Pour les VEN-TURI, c’est l’aspect matériel qui crée le premier lien avec le lecteur.
Le titre de l’ouvrage est largement « pesé » par leur auteurs, renvoyant à d’autres textes comme « la leçon de Rome » dans Vers une architecture.
L’ouvrage se décline en trois parties. La première est le travail d’étude sur l’architecture de la rue commerçante, le strip. La seconde s’appuie sur cette dernière afin de mettre en place une généralisation sur le symbolisme dans l’architecture et l’iconographie de l’étalement urbain. Enfin la troisième
tracera le travail de leur agence à par-tir des théories de la seconde partie. « Nous regardons en arrière vers l’his-toire et la tradition pour aller de l’avant ; nous pourrions aussi bien regarder vers le bas pour aller plus haut » La position des VENTURI dans la contro-verse qu’ils suscitent et expliquée ainsi : « ils déplorent la manière dont les modernes ont réduits, selon eux, l’architecture à une simple spatialité ; comme la façon dont ils ont assujetti le « sens » à la « forme ».
CHAPITRE 5 INTERTEXTE
Le principe de ce chapitre est de s’inté-resser à l’ensemble des textes du mo-ment qui ont pu permis la réflexion. Cela passe par différentes formes, Valéry DIDELON le cite d’Annick BOUIL-LAGUET1. D’après la citation l’auteur a pu relevé un grand nombre de per-sonnalité que les VENTURI ont étudié. Après avoir répertorié les auteurs ins-pirants, il s’est attaché aux textes litté-raires et les a classés en trois groupes thématiques. Le premier regroupe vingt textes sur l’architecture moderne et la crise, le seconde, dix-huit textes portant sur la ville américaine et la meilleure manière de l’aménager, le dernier, onze textes associant architec-ture, sémiologie, et littéraritéValéry DIDELON s’est attaché à six ouvrages parus à cette époque et en développe quelques lignes.
CHAPITRE 6RÉCEPTION 1972-1976
1 Annick Bouillaguet : Elle a recensé quatre mo-dalité de l’intertextualité ; la « citation » qui est un emprunt littéral et explicite, le « plagiat » qui est littéral et non explicite, la « référence » qui est non littérale et explicite et l’ »allusion » qui est non littérale et non explicite.
AAC050-6121
La tendance, et la controverse vont légèrement dévier vis à vis de l’édition précédente. Peu de modifications sont apportées à cette nouvelle édition. Cet ouvrage, à son époque est considéré par certains comme important. Jayne MERKEL explique : « Learning from LAS VEGAS est important parce qu’il est dé-battu, et il est débattu parce qu’il est stimulant et hérétique ».
Cette autre phrase : « L’architecture de la culture populaire et de la culture savante sont étudiées, distinguées et comparées, et leurs possibles mises en relations et hybridations sont vues comme significatives et bénéfiques pour une société qui prend consciences d’elle-même. » montre combien la so-ciété est en plein changement, de tout ordre et que le domaine de l’architec-ture permet donc de débattre large-ment (politique, sociologique, idéolo-gique, …). Les publications toucheront l’Europe, dont le mouvement moderne de l’époque et plutôt pour un retour à la ville historique qu’à la suburbanisa-tion automobile qui n’en est qu’à ces débuts de ce côté de l’Atlantique.
L’analyse de cette réception s’est effec-tuée pour Valéry DIDELON pour l’inter-médiaire de cinq thèmes.
Le médium est-il le message ?
On en revient au problème rencontré avec la maison d’édition et l’image que cet objet (le livre lui-même) laisse per-cevoir. CONTEXTE DE FOND ET DE FORME.La chasse au canard – aborde la ques-tion du symbolisme et de l’esthétique.L’architecte bouffon du prince – toute la critique négative se manifeste, pen-sant que les VENTURI sont contre cou-rant. Forrest R. WILSON dit « LFLV nous apprend à regarder là où nous avions décider de ne pas le faire. L’architecte comme roi est apparemment nu. Mais VENTURI est un architecte, et la cri-tique la plus important sur l’architec-ture vient des architectes eux-mêmes. L’architecte-roi peut être nu, il reste en bonne forme physique »
LE GOUT DE L’ORDINAIRELes VENTURI se sont attachés à un « territoire maudit », à ce qui est d ‘ha-bitude rejeté, ils considèrent le strip commercial non pas comme un non lieu mais comme un lieu.
Le manque d’engagement social – Beaucoup considéreront le travail des VENTURI sans engagement social. Les architectes, critiques, se voient certainement dans leur rôle (parfois, une seule personne avec les deux cas-quettes) comme des savants devant
AAC050-6122
inculquer et montrer le bon goût, le sens de LEUR vérité. Cependant cer-taines critiques souligneront que les VENTURI ont su habillement appliquer leurs théories à leurs projets d’agence. La controverse dynamique Pour ré-pondre à la controverse, Denise SCOTT BROWN dit un jour, « nous prenons une chose répandue, qui est la culture populaire, que je n’appellerai pas pré-cisément sous-culture parce qu’elle est tellement répandue, et nous essayons de la rendre acceptable à une sous-culture élitistes ».
La conclusion de ce chapitre était à mon sens à méditer à l’époque, la mé-diter aujourd’hui et surtout à re-mé-dite demain : « les VENTURI ont heurté au /plus profond « la morale des archi-tectes », ou plutôt l’obligation qu’ils se font d’en avoir une » Stanislaus von MOOS
En effet, l’architecte doit concevoir avec un minimum d’éthique, un enga-gement moral, politique et social.
CHAPITRE 7THE FORGOTTEN SYMBOLISM OF AR-CHITECTURAL FORM
La troisième édition sera cette fois-ci totalement composée graphiquement
par Denise Scott BROWN et non par la graphiste de la maison d’édition. Le ré-sultat est bien diffèrent, format, qua-lité de papier et surtout présentation de textes principalement. La quantité de sera bien moindre, ils ne dévelop-peront plus leur travail en agence. Leur philosophie est que les architectes peuvent apprendre de tout ce qui les entoure.
VERLUCCO C.
VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, 1968 : A signifiance for A&P parking lots or learning from Las Vegas, in Architectural Forum 128 no.2, pp36,43.VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, 1977 : L’enseignement de Las Vegas, ou le symbolisme oublié de la forme architecturale, MITpress, Cambridge.LE CORBUSIER, 1923 : Vers une architecture, PARIS.VINEGAR, Aron; GOLEC, Michael (2009) : Relear-ning from Las Vegas, Minneapolis & London, University of Minnesota Press.VENTURI, Robert (1966) : Complexity and Contradiction in Architecture, New York, Editions Doubleday.SCOTT BROWN, Denise, 1971 : Learning from Pop, in Casabella 359-360.
AAC050-6123
MANGIN, David (2010) : La ville franchisée, Formes et structures de la ville contemporaine, Editions de La Villette
AAC050-6124
MANGIN, David (2010) : La ville franchisée, Formes et structures de la ville contemporaine, Editions de La Villette
Le terme de franchise énonçait au moyen age l’idée d’exception juridique et politique, l’idée de territoire libre. Aujourd’hui il raisonne comme globali-sation, uniformisation, mondialisation.Les franchises contemporaines enva-hissent le paysage et le vocabulaire, « on trouve ses repères dans un pay-sage jalonné de marques, on connaît les couleurs dès le plus jeune age (…) » Mais l’idée de franchise ou d’unifor-misation va au delà de ces premiers principes.
En montrant les formes franchisés au delà des simples constructions des groupes commerciaux et industriels qui dessinent les paysages de nos entrées de ville, cet ouvrage désigne ceux qui font la ville, les politiques, les géomètres maître d’œuvre des lotisse-ments à raquettes, en passant par les industriels, les architectes etc.
Il donne à voir les origines de l’urba-nisme de secteur qui a engendré au XX siècle les non lieux que les tracés de routes, et autres gestes urbanistiques ont laissé derrière eux. David MANGIN parle de ces lieux comme des vides programmés. Ces vides programmés sont aussi le résultat de l’accumulation de normes, de prévention des risques, de règlement d’urbanisme, de catas-trophes... Les règles qui cadrent notre quotidien causent d’autres dysfonc-tionnements encore, elles tuent la sin-gularité et l’innovation. L’auteur invite à construire avec le risque si le lieu y gagne par la question : « Combien de voies et d’espace attendent la crue cen-tennale ? »
Il fait état des constats sur la ville dé-dié à la voiture, qui exclut parfois en-
core les autres modes de transports… Pourtant les idées de ville centrée sur l’homme existaient déjà hier. L’idée de l’urbanisme décomplexé qui « au nom de la bonne économie et des libertés individuelles » a manger les terres nourricière des villages en périphérie urbaine et a massacré l’image des en-trées de ville par des boites de bardage porte enseigne avait pour opposition d’autres modèles de société, comme celui de Franck Lloyd WRIGHT qui pensait un urbanisme qui voulait faire bénéficier à l’homme des aménités de la nature.
URBANISME DE SECTEURS
David MANGIN compare le piéton et l’automobile dans leur espace appro-prié et montre que cette dernière par-coure bien plus rapidement un secteur, qu’un piéton traverse un faubourg. Chandigarh est un exemple majeur de cet urbanisme, la ville elle même ne se divise pas en quartier avec des noms qui évoquent une histoire, mais par des numéros que LE CORBUSIER a poser dans des rectangles. David MANGIN, remémore que dans cette ville les relations entre secteur étaient problématiques dès la création de cette ville. Aujourd’hui, Chandigarh parait uniforme sur les grands boule-vards, les voies, les ronds points. Les arbres semblent être tous les mêmes. La diversification se joue simplement au cœur des secteurs.
En FRANCE, les secteurs sont des zones industrielles, des zones pavillon-naires, des zones commerciales, des cités de barres de logements sociaux repoussées au delà des périphériques.
AAC050-6125
MANGIN, David (2010) : La ville franchisée, Formes et structures de la ville contemporaine, Editions de La Villette
AAC050-6126
La priorité à la vitesse a généré les nouveaux remparts urbains incarnés par des grands boulevards de ceinture infranchissables qui rejettent au delà de l’enceinte des centres villes, les po-pulations les plus modeste comme le montre l’exemple de BRON-PARRILLY. Et paradoxalement, dans cette même agglomération, quand certain su-bissent l’enclavement urbain, d’autre le choisissent dans des morceaux de ville privatisé comme le montre le quartier CONFLUENCE de LYON.
MAISONS INDIVIDUELLES ET LOTISSE-MENTS
Le succès de la maison individuelle dans les années 70 est du au fait d’une incitation des classes moyennes par l’état qui se dégageait progressive-ment du secteur locatif. Cette politique a réduit la maison à un produit patri-monial et financier. Ces maisons indi-viduelles sont pour la grande majorité implantées en lotissement dans des zones en périphérie d’agglomération. L’auteur explique que les lotissements sont créés dans sans le concours d’ar-chitectes dans la majorité des cas et par des professionnels non formé aux principes de l’urbanisme comme les mairies, les agences immobilières, les géomètres et les promoteurs.
La conséquence est que ces maîtres d’œuvre conçoivent « l’urbanité » sur des mêmes modèles « franchisés » sur l’ensemble du territoire avec des mai-sons sur catalogue. La réflexion n’a pas toujours sa place !
Aujourd’hui devant l’impossibilité de densifier ces zones urbaines, les maires multiplient les lotissements les uns après les autres. Enfin, pour les villes et villages qui construisent ces lotissements le casse tête se joue dans la course entre démographie scolaire, et nouveaux lotissements. Ils voient
AAC050-6127
ne devons pas oublier que les choix qui nous ont mené à l’impasse de l’urba-nisme du réel ont été à leur époque des idéaux de société qui collaient au contexte qui les a vu naître.
DUMAS P.
MANGIN, David (2010) : La ville franchisée, Formes et structures de la ville contemporaine, Editions de La VilletteASCHER, François (2005) : La société hypermo-derne : ces événements nous dépassent, fei-gnons d’en être les organisateurs, Edition de l’Aube, Essai-2005 .CHARMES, Eric (2011) : La ville émiettée, PUF, 2011.MASBOUNGI, Ariella; BOURDIN, Alain (2004) : Un urbanisme des modes de vie ,PARIS : Ed. du Moniteur, 2004 , 96 p.MAURIN, Eric (2004) : Le ghetto français. En-quête sur le séparatisme social, PARIS, Seuil, coll. « La République des idées », 2004.
disparaître peu à peu leur agriculture, importent des produits d’ailleurs dans des supermarchés, élèves leurs ani-maux en batterie et se transforment en ville dortoir. Bienvenue dans le meilleurs des mondes.
3 SCÉNARII , 2 POSSIBILITÉS
"L'urbanisme du réel" ou du laissé faire consiste à poursuivre l’étalement urbain et le développement de la voi-ture, qui s’alimente l’un l’autre dans une échange de bon procédé. Les pro-duits immobiliers sont vendus clef en main, les responsabilités sont transfé-rées du public au privé, et les règles de rentabilité et de privatisation des villes opèrent.
"L’urbanisme du fantasme" serait un urbanisme vertueux et écologique qui favoriserait les transports en commun et les modes doux, en renforçant les poches urbaines près des gares. Mais cette idée reste de l’ordre du fan-tasme, car nous devons faire avec un contexte existant qui interdira encore pendant longtemps cette idée de ville sans voiture.
"L’urbanisme du possible" consiste à optimiser les contraintes de dépla-cements et à inventer des formes urbaines moins productrices de dé-pendances automobiles et d'enclave-ments. Il vise à rendre l’homme moins nomade dans son quotidien en lui pro-posant activités, travail, etc, à proxi-mité du lieu d’habitation.
Mais on ne peut considérer unique-ment la temporalité et la mobilité pour établir un projet urbain, on doit égale-ment intégrer les pouvoirs publics et garder l’humilité et un recul néces-saire pour penser le projet urbain, car chaque époque est porteuse d’idéaux. Idéaux qui ne doivent pas nous rendre aveugle. En critiquant le passé, nous
AAC050-6109
CHARMES, Erik; SOUAMI, Taoufik (2009) : Villes rêvées, villes durables, Éditions Gallimard, coll. Découvertes.
AAC050-6110
CHARMES, Erik; SOUAMI, Taoufik (2009) : Villes rêvées, villes durables, Éditions Gallimard, coll. Découvertes.
BUT & ORIGINE :
L’IVM (Institut de la ville en mouve-ment) dirige et organise un grand nombre d’échanges et d’actions inter-nationales depuis l’année 2000 sur le sujet du mouvement dans les villes.
L’IVM s’axe essentiellement sur le sujet des «mobilités urbaines durables» et porte ses réflexions autour de l’évolu-tion des modes de vie mais également sur l’enjeux des formes urbaines et de ce que l’ont appel la gouvernance.
Villes rêvées,villes durables ? Est avant tout une exposition destinée au grand public, aux experts et spécialistes afin de leurs faire prendre conscience des défis auxquels «l’urbanisme d’au-jourd’hui» est confronté.
Le CREDOC (Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie), nous annonce que «la maison individuelle est le logement idéal de 82 % des Français» bien que les villes continuent d’exercer une attraction forte en permettant un accès simple aux emplois, aux écoles, mais aussi aux commerces et leurs grand nombre de loisirs. L’exposition propose une «immersion» dans la contradiction des rêves du citadins, où l’espace et la cen-tralité s'opposent.
Nos préoccupations citoyennes portent au coeur du débat public ces sujet d'actualités, s’est pourquoi l’ex-position cherche à offrir aux visiteurs des clés pour les aider à comprendre les enjeux des villes de l’avenir.
La ville ne se résume pas à «une ma-chine» qui serrai réglable au grès des
techniques acquises. Elle se constitue des projets individuels ainsi que des projets collectifs. Ces techniques pro-fessionnels assistent les projets mais ne les déterminent pas.
Les années 60 sont celles des grands ensembles et le moyen de cumuler les deux avantages ceux de la ville et ceux de la nature, ces ensembles sont devenus synonymes d’insécurité et de précarité. L’étalement urbain pavil-lonnaire répond à un certain besoin d’espace mais favorise la dépendance à l’automobile. Les pouvoirs publics et les experts en matière d’aménagement du territoire s’efforce de répondre aux problème de la gestion des déchets et des pollutions, ainsi que le phénomène de création de logements sociaux, des dépenses d’énergie et de l’eau.
«Les quartiers durables, le verdisse-ment de la ville, les villages urbains sont des projets qui avancent des réponses à ces questions essentielles : comment offrir un contact quotidien avec la nature ? Faut-il réglementer l’usage de l’eau et de l’énergie ? Faut-il rendre autonomes les quartiers qui composent la ville ?»
L'exposition invite d’abord le public à s’immerger dans la diversité des «rêves» de ville. Cette découverte «sensible» des différentes facettes de la ville et de ses rêves, propose la compréhension et l'appréhension de ce contexte. La densité et la centralité que les urbanistes souhaitaient impo-ser ne justifie pas toujours l’images désastreuse que certains s’en font. Par exemple TOKYO,souvent représenté surchargée de piétons et de tours, est moins densifiée que la ville de PARIS.
AAC050-6111
Au même titre l’alignements de mai-sons de corons du Nord sont égalent en densité que les cités des périphé-ries. L’analyse ne suffisant pas, il faut prendre position.«Le visiteur est donc emmené vers de nouveaux rêves : quartier durable, ville verdie, ville-village.»
Les principaux thèmes de l’exposition sont:
1. LA VILLE À LA CAMPAGNE:
Nombreux sont les attraits de la vie en ville mais ils subsiste nombres d'incon-vénient, la campagne quant à elle offre la proximité avec la nature, l’espace et la lumière mais reste synonyme d'éloi-gnement. Nombreux également sont ceux qui ont chercher à rassemblé les avantages de ces opposés et tenté d’en soustraire les aléas.
• La cité-Jardin …• Le rêve dénaturé & l’étalement urbain• La barre comme solution ?
« En France, les transports routiers émettent 24 % du total des gaz à ef-fet de serre, la voiture particulière 13 %» (Ministère de l’Écologie, données 2006).
Jean-Pierre Attal, Intra-muros #03 (détail), 2008
AAC050-6112
Homme et femme, transats et parasols jaunes, Suède, ÖLAND, 1991
2. LA DENSITÉ, UN NOUVEAUX RÊVE:
Le fameux rêve de «ville à la cam-pagne» s’est transformé en «étale-ment urbain». Aujourd’hui le rêve est «la ville dense» où «le regroupement des biens et des services» permet-tant d’économiser, ou simplement dit «d’être durable». Mais celle-ci reste a ce jour «un cauchemar» de promis-cuité, d’entassement, de pollutions et de bruits…
• Rêve des urbanistes cauchemars de citadins ?• L’effet «barbecue».• La densité n’est pas toujours où l’on croit• La densité recherchée
3. ÊTRE AU CENTRE:
«La cité noyée dans la campagne», ne
concilient pas totalement nos rêves «contradictoires» de la villes idéale. Chacun d’eux se transforment en cau-chemars lorsqu’il est employer seul. «La clé réside dans l’accès, à partir des différents lieux de résidence, aux centres urbains, à leurs services, à leur intensité.»
• Le polycentrisme• Val d’Europe est un nouveau centre urbain au milieu des champs.• Nouveaux pôles urbains
4. LE VILLAGE DANS LA VILLE
«Même au coeur des grandes mé-tropoles, le village fait rêver. La vie urbaine est pourtant tout sauf villa-geoise et c’est en partie la nostalgie qui s’exprime. Le rêve du village tra-duit toutefois des attentes fortes. Si
AAC050-6113
Alex Mac Lean, Sun City Arizona
Village de Poundbury, Dorset, Angleterre
Façade d'immeuble des olympiades, dans le 13ème arr. PARISien
AAC050-6114
l’anonymat des villes offre une grande liberté d’action et de penser, il peut être angoissant. On a parfois besoin de se sentir connu et de rencontrer des gens. Ce rêve, c’est aussi le besoin d’un point d’ancrage dans la ville, le besoin d’habiter un lieu à échelle humaine et non pas qu'une mégalopole. Il renvoie enfin à un besoin pratique, celui d’avoir accès rapidement à pied à toutes les commodités.»
• Le village . la campagne : une me-nace pour l’environnement ?• La forme du village, favorable au piéton ?• L’exemple de POUNDBURY• Des villages comme pôles autour de gares
5. VERDIR LA VILLE
«Faut-il accepter de vivre dans des en-vironnements plus denses pour rendre les villes plus durables ? Doit-on pour autant sacrifier son désir de jouir du contact quotidien avec la nature ? Comment verdir les centres des villes ? L’une des solutions est de créer des parcs, squares et jardins. Du jardin du LUXEMBOURG à Central Park les exemples réussis abondent. Mais ils demeurent en nombre insuffisant et les espaces manquent. Certains rêvent alors de couvrir les rues de pelouse, d’étendre les espaces verts sur les toits et ailleurs. D’autres se mobilisent pour empêcher les parcelles libres d’être bâties et y créer des jardins partagés. Ce rêve de verdissement de la ville est-il un fantasme et est-il vraiment utile de le réaliser ?»
• Verdir pour l’environnement• Les îlots de chaleur urbains• Des tramways sur la pelouse• Des autoroutes enfouies• De la verdure sur les toits• Faire des citadins des jardiniers• Cultiver la ville
AAC050-6115
• Les guérilleros de l’espace vert
6. LE RÊVE DU QUARTIER «DURABLE»
«Avec les quartiers durables, les cita-dins et des urbanistes tentent de pro-poser un habitat écologique proche de la nature dans un environnement offrant toutes les facilités et les amé-nités de la vie urbaine. Ils sont une ten-tative de réalisation de la « ville rêvée », respectueuse de l’environnement, polluant moins, utilisant un minimum de ressources naturelles, accueillant et favorable au développement éco-nomique. Ils sont aussi appréciés pour leur cadre de vie : verdure, espaces de jeux sécurisés, voies piétonnières et cyclables occupent l’essentiel des espaces publics. La réussite n’est ce-pendant que partielle : il reste à pas-ser de l’échelle du quartier à celle de la ville...»
• Les quartiers durables, rêves de certains qui poussent partout• Les quartiers durables, qu’est ce que c’est ?
CHARMES, Erik; SOUAMI, Taoufik (2009) : Villes rêvées, villes durables, Éditions Gallimard, coll. Découvertes.CHARMES, Eric (2003) : Les tissus périurbains français face à la menace des « gated communi-ties », in Eléments pour un état des lieux, PUCA, 258 p.ASCHER, François (2008) : « Effet de serre, chan-gement climatique et capitalisme cleantech », in Esprit, février, pp. 150-164.CLOCHARD, Fabrice; ROCCI, Anaïs, VINCENT, Sté-phanie (2008) : Automobilités et altermobilités, quels changements ?, PARIS, L’Harmattan, 286 p.DONZELOT, Jacques (2004) : « La ville à trois vitesses : gentrification, relégation, péri-urbani-sation », in Esprit, Mars/avril, pp. 14-39.GHORRA-GOBIN, Cynthia (2006) : La théorie du New urbanism : perspectives et enjeux, LA DÉ-FENSE, Editions de la DGUHC, 89 p.JOUVE, Bernard; LEFEVRE, Christian (1999) : Villes, métropoles, les nouveaux territoires du politique, PARIS,Anthropos, 305 p.REIGNER, Hélène; HERNANDEZ, Frédérique; BRENAC, Thierry (2009) : « Circuler dans la ville sûre et durable : des politiques contemporaines
ambigues, consensuelles et insoutenables », in Métropoles, 5, Varia, [en ligne], mis en ligne le 6 avril 2009. URL : http://metropoles.revues.org/document3808.htmlOFFNER, Jean-Marc (2006) : Les Plans de dépla-cements urbains, PARIS, La Documentation Fran-çaise, 96 p.VANIER, Martin (2008) : Le pouvoir des terri-toires, PARIS, Economica-Anthropos, 160 p.VAYSSIERE, Bruno (1988) : Reconstruction-dé-construction. Le hard french ou l’architecture des trente glorieuses , PARIS, Picard, 1988, 327 p.SOUAMI, Taoufik (2009) : Ecoquartiers, secrets de fabrication, PARIS, Les Carnets de l’Info., 207 p.THEYS, Jacques (2000) : « La confusion des (bons) sentiments », in Développement durable, villes et territoires, Innover et décloisonner pour anticiper les ruptures, Note du CPVS, n° 13, DRAST, Ministère de l'Équipement des Trans-ports et du Logement, 135 p.
• Le quartier d’Hammarby à STOC-KHOLM• Les quartiers durables ne sont pas parfaits
LANCTUIT J.E.
AAC050-6117
COLLECTIF (2006) : Eco-quartier, Revue Urbanisme No 348, mai-juin 2006.
Urbanisme est une revue qui relate et analyse les évolutions des territoires urbains, français et étrangers, ainsi que leur impact sur un paysage rural en voie de disparition.Ce numéro propose un dossier sur un thème lié aux préoccupations contem-poraines – politiques, sociales, écono-miques, culturelles, internet...Les thèmes de la politique de la Ville, des éco-quartiers et du développe-ment durable, de l'avenir des ville moyennes, des grands ensembles, de la place des jeunes dans nos sociétés y sont abordés.
Composé en trois parties: • Un dossier central• Une séquence "magazine" • Une séquence "idées en dé-
bat" – qui comprend notam-ment "l'invité, RICHARD RO-GERS, architecte.
La revue se termine par la chronique "librairie" (présentation et critique de nombreux ouvrages récents, chacun apportant sa pierre au vaste corpus de la pensée sur "la ville"...).
Le sujet principalement abordé dans la première partie et celle d’une réflexion sur la responsabilité des urbanistes dans le mal-être actuel des grands ensembles.Plusieurs articles abordent la problé-matique de façons différentes tout en gardant un œil d’urbaniste…
Colère Urbaine La leçon de Los AngelesArticle de Cynthia GHORRA-GOBIN.
L’auteur se base sur du vécu, de l’his-toire et montre les évolutions et les prises de consciences qui ont permis l’accès à la scène politique à des per-sonnes venant de quartiers sensibles, ou n’ayant pas la « bonne couleur » de peau. Leur présence sur la scène politique à permis de mieux refléter la diversité sociale, raciales, ethnique et culturelle de la population. Émeutes des noires de 1965.
C’est donc par le biais de la scène politique que la population se rend compte de la dimension symbolique de la représentativité politique. Il est essentiel que les habitants des quartiers sensibles aient accès à l’édu-cation et à l’enseignement supérieur.
QUELQUES AUTRES ARTICLES:
Des espaces communs aux lieux publicsAlexandre BOUTON, Enseignant au DSA d’architecture, ur-baniste à MARNE-LA-VALLÉE.
Traite de la perte de spontanéité sur des lieux publics et privés. Ces lieux hybrides qu’on appelle « jardin » ré-sultent de la tension entre sphère pu-blique et privée. Avec le renforcement du règlement, le lieu devient moins précaire, mais perd peu à peu de sa qualité évolutive.
La question est soulevée: Quelle consistance doit donner à la limite publique et privée, celle qui génère du sens et de l’intégrité à la vie urbaine?
L'art contemporain au coeur du renou-
AAC050-6119
vellement urbainChristian RUBY
"L’art n’est pas d’enjoliver une opé-ration une opération urbaine, en revanche, l’artiste construit par son œuvre une expérience de ville et la pro-pose à la discutions."
ÉditorialRédigé par Thierry PAQUOTUrbaniste philosophe
« la ville n’est plus la ville mais un ur-bain éparpillé, diffus, essaimé. Qui la considère écologiquement?...d’un côté des habituels dysfonctionnements ré-sultant du chacun pour soi et de l’autre les bons sentiments.…..L’exemplarité est souvent inspiratrice d’un changement, une sorte de conver-sion? Non, un désir de vie… »
ENTRE ECO-VILLAGES ET PROJETS D'ARCHITECTES : LES ECO-QUARTIERS
Regroupe les valeurs environnemen-tales, économiques et sociales. Des choix technique très convainquant avec l’objectif de prouver qu’il est pos-sible de construire en milieu urbain, en respectant les valeurs écologique et la qualité de vie qui séduit les classes moyennes.
HQE... DE LA BONNE ARCHITECTURE
Une transformation plus profonde est requise pour enrayer la destruction de l’écosystème: les usagers doivent apprendre à utiliser correctement ces technologies et surtout les maintenir.Parler d’éco-quartier, d’architecture, d’urbanisme, d’écologie, c’est parler d’architecture, c’est évoquer la procé-dure dite HQE.14 Cibles: pas d’obligation de traiter les 14 points.
AAC050-6120
4 Architectes donnent leurs avis sur la question du H.Q.E et cite leurs donnent leurs références:
-Philippe MADEC, Architecte: « Dans cette procédure Française, visant à répondre à la norme européenne de qualité des constructions environne-mental, on ne trouve pas une seule foi le mot « Architecture ». Avec un bonne pensée technique vous êtes sûr de rentre dans le durable. Aucune des cibles HQE n’établit de rapport au ter-ritoire »
- Catherine FURET, Architecte: « Et l’on croit qu’in fine cela ne change pas grand-chose, rien n’est hiérarchisé, il suffit de piocher cinq cartes sur qua-torze pour être labéliser. Un techni-cien saura manipuler les bons para-mètres!."
-François TIROT, directeur de l’urba-nisme et du paysage, EPA Sénart: Donne en référence son projet qui res-pecte les 14 cibles HQE avec un surcoût (1500€/ 1000€/m²)
-Patrick BOUCHAIN, Architecte: «On devrait faire de la HQH avant de faire de la HQE. Haute Qualité Hu-maine, tout en découlerait plus simple-ment et plus naturellement."
PEREZ S.
AAC050-6122
Etude de cas : La «ville-archipel» de Rennes.
LE CONTEXTE: RENNES métropole et le Pays de RENNESLes chiffres du Pays de RENNESQuatre communautés de communes et une communauté d’agglomération ; 140 communes 460 000 habitants en 2008 ; 114 000 ha d’espaces agricoles (76%), naturels (13%) et urbanisés (11%) ; 120 000 nouveaux habitants attendus entre 2000 et 2020 ; 85 000 créations d’emploi poten-tielles d’ici 2020.
• Croissance démographique conti-nue
• De 1% à 1,31% /an ces dernières années
• Pôle économique • Croissance de l’emploi 1,29% /
an taux de chômage inférieur à la moyenne nationale
• Territoire bien desservi• Aéroport, futur TGV, étoile ferro-
viaire, routes nationales• Paysage agricole et naturel• 90% du territoire du Pays de
RENNES est composé d’espaces naturels et agricoles, Maillage de cours d’eau qui irrigue l’ensemble des communes du pays
Le développement urbain, économique et résidentiel a été particulièrement dyna-mique dans la dernière décennie. L’effet conjugué de facteurs locaux (un relatif manque d’offre foncière pour le logement à RENNES métropole) et d’aspirations indi-viduelles (la maison en accession à la pro-priété) a induit un étalement conséquent de l’aire urbaine, et de la place de la voiture,
LE SCOT DU PAYS DE RENNES:
Le SCoT du Pays de RENNES a été approuvé en décembre 2007Le SCoT constitue en partie le prolonge-
AAC050-6125
ment et l’enrichissement du schéma direc-teur de 1994 et sa révision sur un territoire élargi au pays de RENNES.Son projet s’appui sur la charte du Pays de RENNES,La préservation de la trame paysagère et le maintien du fonctionnement biologique ont constitués des orientations fondamen-tales dans la définition du projet,
Trois axes retenus• Le peuplement• L’économie
• Les déplacements
Pour répondre aux mutations identifiées à l’horizon 2020, les principaux objectifs du SCoT sont les suivants :• Répondre aux enjeux démogra-
phiques ;• Intensifier le développement écono-
mique pour affirmer le territoire au niveau européen.
Il s’agit de conforter l’image et le rayonne-ment du Pays de RENNES, de développer
AAC050-6126
les fonctions métropolitaines, de renforcer le potentiel « d’intelligence » du territoire, et de renforcer l’offre de foncier d’activité pour répondre aux besoins des entreprises et aux exigences du développement du-rable ; cultiver la qualité de la vie, source essentielle d’attractivité. Atout reconnu du Pays de RENNES, la qualité urbaine et environnementale est au centre de la ville-archipel :il s’agit d’articuler le développement poly-centrique avec le maintien des espaces agricoles et naturels, en économisant for-tement l’espace et en préservant les res-sources naturelles ; optimiser le fonction-
nement de la ville-archipel, pour accroître l’efficacité des déplacements en donnant la priorité aux transports en commun, éco-nomes et durables, et utiliser les transports en commun et alternatifs comme levier d’organisation de la « ville des proximités ».
LA VILLE ARCHIPEL:
Préserver le modèle de ville-archipel consiste de fait à s’opposer à l’étalement urbain, Limiter la consommation d’espace par une compacité de l’urbanisation et notamment par la densification des pôles
AAC050-6129
structurants et la délimitation des zones urbanisées.Imaginez un groupe de communes de dif-férentes tailles, reliées par une trame verte, alternant espaces naturels, cultivés et urba-nisés : c’est le pays de RENNES. C’est aussi le modèle de la « ville archipel », une forme d’organisation qui associe la proximité au rayonnement, réconcilie la mobilité et l’en-vironnement.
LES CHAMPS URBAINS:
Les champs urbains sont des espaces agri-coles qui se situent à l’interface de plusieurs communes proches. Ce sont fondamenta-lement des espaces de production agricole, mais ils ont été repérés pour la qualité de leur paysage (schéma des vallées, forêts, etc.), de leur environnement naturel et en raison de la fréquentation de loisirs dont ils sont le support (cheminements, activités équestres, etc.)
LE PEUPLEMENT:
CONSTATHypothèses de développement de 120 000 nouveaux habitants (+60 000 logements)Selon un développement « homothétique »:• 50% cœur de métropole• 36% première couronne• 15% couronne métropolitaineEn contradiction avec les orientations
d’équilibre de la charte de paysOrientations du SCoT• > Objectif PLH avec un effort de crois-
sance accentué sur certaines com-munes hors de RENNES Métropole, Pôles de vie affirmés
• > Rassembler des communes autour de 5 000 à 10 000 hts, seuil de popu-lation permettant d’élever le niveau des équipements et services. Plus de « cités dortoir »
LES DEPLACEMENTS:
Place prépondérante de la voiture en contradiction avec les orientations environ-nementales,Mauvais usage des transports en communOrientations du SCoT• > Définir des axes transports en com-
mun prioritaires• > Améliorer la proximité des services
pour renforcer l’usage des transports en mode doux
• > Axes stratégiques sur la ville archipel de desserte en transports en commun
AAC050-6130
EXTENSION URBAINE : SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - LE QUARTIER DE LA MORINAIS Création d’un centre-villeLe quartier, s’appuie sur un mail central le long duquel on retrouve les collectifs. Dans les rues transversales, prend place l’habitat intermédiaire. Enfin, l’habitat individuel dense s’insère dans les cœurs d'îlots ainsi formés. De nombreuses venelles et voie piétonnes maillent le quartier.
ECOCITÉ – RENNES QUADRANT NORD-EST - VIASILVA
Porté par la communauté d’agglomération RENNES Métropole et les trois communes de CESSON SÉVIGNÉ, RENNES et THORI-GNÉ-FOUILLARD, vise à développer le qua-drant Nord-Est du cœur d’agglomération, secteur stratégique par son positionne-ment et sa faible urbanisation actuelle sur presque 600 hectares.
QUARTIER BEAUREGARD
Situé entre les vallées de l'Ille et de la Vilaine, cette nouvelle ZAC sera aménagée en cité-jardin, agrémentée d'un parc. Deux projets majeurs, signés par des architectes PARI-Siens, s'y inscriront. En juin 2007 ouvriront les Archives départementales de l'Ille-et-Vilaine, abritées dans les cinq magasins de ce bâtiment conçu par Jean-Marc IBOS et Myrto VITART. En 2010, le Frac (Fonds régio-nal d'art contemporain), dessiné par Odile DECQ, comprendra trois salles d'expositions et des réserves. Cet objet architectural joux-tera les 72 stèles sculptées par l'artiste Auré-lie NEMOURS, œuvre intitulée L'Alignement du XXIe siècle.
LE STADE RENNAIS (2004)
En 2004, la ville a inauguré un parc des sports complètement transformé par le pro-jet de l'architecte Bruno Gaudin. Posé tel un vaisseau avec ses mâts et ses haubans, ce
grand équipement est un majestueux signal d'entrée sur la route de Lorient. Les nou-velles tribunes offrent un meilleur confort à ce lieu qui peut accueillir jusqu'à 35 000 spectateurs.
ESPLANADE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE
L'arrivée, en 2006, du nouvel équipement culturel les Champs Libres avait déjà embelli l'emplacement de l'ancienne gare routière.
AAC050-6132
LELOUP, Michèle (2007) : 2007:cap sur la ville archipel, in L'EXPRESS, 08/03/2007.TANDILLE, Claire; POIRIER, Bernard (2010) : Les champs urbains du SCoT du Pays de Rennes, in Territoires 2040, n°2, DATAR, 2010, p149.
Réalisé par l'architecte Christian de PORT-ZAMPARC, ce bâtiment en verre et granit regroupe une bibliothèque, le musée de BRETAGNE et l'Espace des sciences. L'espla-nade lui faisant face est actuellement mise en valeur par Nicolas MICHELIN. Cet archi-tecte et urbaniste PARISien a dessiné une place au mobilier urbain mobile, de façon à pouvoir accueillir une série d'événements en plein air
VERDIER C.
AAC050-6133
LECLERCQ, François (2006) : Pour la ville, quel que soit l’état du monde, Editions NEJMP, Col-lections Passage Vérité
AAC050-6134
LECLERCQ, François (2006) : Pour la ville, quel que soit l’état du monde, Editions NEJMP, Collections Passage Vérité
PRÉLIMINAIRES
La ville est faite de lumières, elle repré-sente le rêve américain, l’avenir, l’es-poir d’un devenir. La ville permettait de prendre en main son propre avenir et surtout d’en décider, il ne s’agissait plus de perpétuer un cycle familial au-quel on ne pouvait échapper.
Les trente glorieuses a permis aux rêves de devenir réalité. La croissance économique et le pleine emploi a per-mis la modernité et l’indépendance, l’individualisme et la mobilité.
Mais l’urbanisme de ces trente glo-rieuses se fait rapidement mauvaise fi-gure, les crises urbaines apparaissent, les grands ensembles deviennent l’en-droit où se croisent malheur et sans es-poir, la ville devient un espace de peur et sans horizon : chômage de masse, situation de rupture, déconnexion des bassins d’emploi et de l’habitat.
Face à la pression sociale, les politi-ciens ont pointé une génération « de culture de la violence » liée au quar-tier de ces grands ensembles. Ces bâtiments sont devenus responsables de ce mal être. Il fallait rénover ces quartiers, ces cités, les normaliser, les rendre éligibles au bonheur, prendre ce qui fonctionnait et reconnaissait en mieux. Ce désespoir social ne peut être que passager, l’homme a façonné ses villes d’opportunité, elle ne peut pas être autrement. Mais les pro-blèmes ont fait que s’étaler entraînant un peu plus la ville dans la crise, car il s’agissait bien d’une crise de la ville et non des quartiers. En pointant les pro-blèmes uniquement aux cités, la crise a continué son chemin dans les villes entraînant « rupture, éloignement, et
dépendance ».
En 2006, le constat est que l’on construit toujours la ville à l’identique de l’après guerre, croissance, rentabi-lité, pleine emploi. L’urbanisme conti-nue de concevoir comme si la crise était passagère, elle s’accroche à un rêve perdu, à une nostalgie d’un bon-heur à retrouver. Mais si finalement c’était les trente glorieuses que l’on considérait comme la crise, si la réalité était le sous emploi et que la société acceptait que la croissance favorisait la stagnation, la précarité et l’inéga-lité et donc toutes sortes de ruptures, est-ce que l’on construirait la ville de la même façon ? Dans une société où il faut allé vite autant pour se déplacer que pour se dépasser, est ce que l’on ne finit pas par se battre contre des moulins à vent.
Et si le pari n’était pas la ville pauvre, celle au tout le monde peut être pris en compte, une ville moins rapide mais avec plus de linéarité. Une ville où l’homme se satisfait pour son utilité et non pas pour son profit. La ville doit être une ville de toutes les ressources afin que chacun puisse trouver sa place dans n’importe quelle circonstance et dans chaque évolution de la vie.
François LECLERCQ étaye ses prélimi-naires à travers 5 exemples.
AAC050-6135
1- Tout d’abord “ROSETTA fait ses études“, cet exemple montre l’évolu-tion de l’occupation des immeubles dans sa verticalité et notamment du rapport que pouvait entretenir un immeuble avec la rue, avec son sol. En effet, le cas de ROSETTA montre la difficulté pour les jeunes étudiants de se loger et inévitablement de finir soit dans des résidences pour étudiants où le prix est de plus en plus exorbitant où bien loger dans des caravanes dans des conditions très précaires mais avec des loyers peu coûteux, ce qui le cas de ROSETTA.
On constate que l’immeuble du XIX se décomposait dans se verticalité en fonction des classes sociales, chaque étage correspondait à ses ressources mais tout le monde vivait ensemble et trouvé sa place en attendant de gagner plus d’argent et de changer d’étage. La modernisation comme l‘ascenseur a permis de gravir les étages en modi-fiant ces couches sociales verticales, en créant des regroupements sociaux mais à l’horizontale ce qui à conduit à créer des quartiers aux fonctions bien spécifiques.
L’étage le plus touché par cette modi-fication est le rez de chaussée, il n’y a plus de concierge et ce niveau n’ap-porte pas les qualités requises pour la société d’aujourd’hui, trop bruyant, pas assez intimes, et peu de lumières. Aujourd’hui les personnes préfèrent monter alors que ces étages étaient réservés aux étudiants et aux classes sociales inférieures. Le rez de chaus-sée est déserté pour faute de rentabi-lité économique et pourtant il repré-sente plus de 10% de l’occupation en ville. Si les gens ne souhaite pas le rez de chaussée dans sa valeur définitive rendant dont le transitoire. Créons des logements étudiants, qui pour-ront prendre la fonction de bureaux associatifs. Permettons à chacun de trouver une place dans des conditions
acceptables, trouvons des solutions modulables pour permettre l’évolu-tion de ces rez de chaussée tout en recréant une véritable mixité.
LE GUAY, Philippe (2011) : Les femmes du 6e étage, film, 106'.
AAC050-6136
2- Le chapitre « les dames des échan-geurs » montrent l’intérêt pour le com-merce de proximité. Ces femmes au-jourd’hui sans permis font des détours invraisemblables pour arriver jusqu’à leur hypermarché. Ces magasins de grandes distributions ont radicale-ment changé l’urbanisme des années 60 entraînant la création des zones industrielles, des zones pavillonnaires et des zones d’emplois. Les petits com-merçants meurent un peu plus chaque jour éloignant les personnes avec leur cœur de ville. Mais aujourd’hui l’hyper arrive a ses limites, et à du mal a se renouveler, les slogans publicitaires changent et favorisent la proximité et la flexibilité. Le modèle du magasin change et se réinvente, la tendance est au « small is beautiful ». Il faut saisir l’opportunité de ce changement pour le banaliser et offrir des commerces à toutes les populations.
3- Comme, François LECLERCQ a pu le citer dans le chapitre précédent, le zoning des années 60 a entraînant la création de zones pavillonnaires. Le droit au bonheur se démocratise par une maison individuelle pour tous. En soi, le rêve est beau mais il devient plus complexe quand le pavillon devient un produit de marchandise, et qu’il est associé à plusieurs pavillons formant ainsi un lotissement synonyme d’éloi-gnement. Alors on n’achète plus un pavillon mais un mode de vie régit par les règles du lotissement. Cela créer des personnes indépendantes et donc consommatrices. De plus ces lotisse-ments sont éloignées des villages et des villes et leur forme n’est dictée ni par l’histoire, ni par les demandes des habitants, ces lieux sont complète-ment standardisés du nord au sud et ne répondent à rien. Ils favorisent le déplacement en voiture sans qui la so-litude et la dépendance s’installe. Cela se vérifie quand les familles se décom-posent, quand les revenues manquent où que les personnes vieillissent, la distance et l’éloignement se font encore plus grands. Ce mal être n’est pas loin de celui connu pour les grands ensembles. Au lieu d’avoir des drames collectifs, il y a des drames individuels.Il faut sortir du lotissement et ap-prendre à réconcilier la maison indivi-duelle avec la proximité des gens, des services, et du transport, en la remme-nant prêt des villages.
AAC050-6138
Carrefour - Aulnay sous bois
ABRIL, Philippe (2009) : Lotissement, Huile sur toile, 60 40 cm.
AAC050-6139
4- François LECLERCQ met l’accès aussi sur la définition d’une ville durable. Elle se veut « ville intermédiaire, ville passagère, ville qui voyage dans ses propres murs ». C’est à dire qu’il s’agit plutôt d’accepter qu’une ville évo-lue avec son temps et qu’elle puisse prendre plusieurs formes dans la jour-née mais surtout plusieurs usages dans les années. Il ne s’agit plus de créer dans des bâtiments intemporels souvent désastreux mais que l’archi-tecture s’approprie et conçoit un bâti-ment pour des temps.
5- Mais dans tout cela, il ne faut pas voir tout ce qui a été bâti durant ces trente glorieuses comme le mal à ban-nir entièrement de la planète. François LECLERCQ prend pour exemple la voi-ture, objet détestable du XXI siècle, mais qui à SAIGON est considéré comme lieu. Là où la densité est très présente et l’intimité rare, la voiture est un moyen de se retrouver seul ou à deux, de se sentir libre : libre de chan-ter, de parler, de rêver, de s’évader, de faire l’amour… A travers ces exemples, François LECLERCQ tente de nous faire com-prendre qu’il faut savoir saisir les op-portunités de changement quand elles sont nécessaires en fonction de l’évo-lution des besoins. Il est inutile, voir perdu, de vouloir contrôler le change-ment afin que le bonheur soit parfait, que c’est en cela que les catastrophes sont de plus en plus fréquentes entraî-nant des malaises sociales. Il ne s’agit plus de raisonner individuellement mais rendre la ville à portée de tous.
DEPERROIS A.
AAC050-6140
LECLERCQ, François (2006) : Pour la ville, quel que soit l’état du monde, Editions NEJMP, Collec-tions Passage Vérité.LE GUAY, Philippe (2011) : Les femmes du 6e étage, film, 106'.ABRIL, Philippe (2009) : Lotissement, Huile sur toile, 60 40 cm.
AAC050-6141
COLLECTIF (2005) : Food and City, Revue Archi-tectural Design, Vol 75 No 3 May/June 2005.
AAC050-6142
COLLECTIF (2005) : Food and City, Revue Architectural Design, Vol 75 No 3 May/June 2005.
Food + CityMagazine bimestriel anglais - Archi-tectural Design publié en mai / juin 2005.Les différents articles, s’ils datent un peu, donnent un aperçu assez exhaus-tif du rapport de la nourriture en ville ou comment se nourri-t-on en ville à l’heure mondialisée.
Un petit historique nous rappelle qu’il n’y a pas si longtemps avant l’urbani-sation de la fin du XX ème siècle les hommes pourvoyaient à leurs besoins alimentaires de façon autonomes. Tous disposaient d’un bout de terre.Le « concept » de restaurant a été créé en France dans les années 1850. L’alimentation est passée du besoin physiologique à celui d’une nécessité sociale.
Si l’eau potable et la santé publique on été les principaux obstacles aux progrès du XIX e siècle, l’alimentation et l’accès à la nourriture saine seront les problèmes importants du XXI ème siècle avec l’accroissement de la popu-lation mondiale, la raréfaction des res-sources..
L’objectif des différents articles de ce magazine est de faire un état des lieux en 2005 de la façon dont la population, de plus en plus urbaine, s’alimente gère sa relation au fait de se nourrir qui si elle est une nécessité physiolo-gique engage les hommes dans leurs rapports sociaux aux autres.Le dossier traite une vision assez anglo-saxonne du rapport à la nourri-ture dans le monde occidental.
LA VILLE COMME SALLE À MANGER, MARCHÉ ET FERME – PAR KAREN A FRANK
La nourriture a été de tout temps ven-due dans la rue. Facteur d’échange social et humain, cette situation est le témoignage de la vitalité et de la convi-vialité de la vue urbaine.On constate depuis les années 2000, une recrudescence des vendeurs am-bulants de produits frais, signe d’une prise de conscience
LES TYPOLOGIES DES ESPACES AUSTRALIENS DÉDIÉS À L’ALIMENTATION : CRUE, MOYENNE, OU RECHERCHÉE – PAR RACHEL HURST ET JANE LAWRENCE
Cet article présente la particularité de l’AUSTRALIE, peuple de colonisateur venu de tous les coins de l’EUROPE.Il identifie 3 façons dont l’australien se nourrit.La Manière crue, ou rapide constitué pour l’essentiel de petites échoppes étroites ouvertes sur la rue. Elles dis-posent de peu de tables.Un autre type d’alimentation dans la rue, est représenté par ce qui est nom-mé moyen. Il est constitué des restau-rants du quotidien qui disposent en général d’un cornet prêt à emporter. Les tables sont en général disposées en longueur et sont ainsi propices à l’échange entre clients.Le mode identifie comme well-done correspond à une restauration plus gastronomique où la recherche culi-naire est plus précise et l’environne-ment architectural accompagne cette mise en scène.Ces trois statuts, ont en commun une reconnaissance instantanée de l’éta-blissement dans son site urbain.A ce sujet Claude LÉVI-STRAUSS émet-
AAC050-6143
tait l’hypothèse que la cuisine formait un langage au travers de laquelle émergeait les codes, des messages inconscients qui révélaient la struc-ture de la société. Une expérience hollistique sensorielle de l’architecture semble être mise en exergue par la combinatoire de ces trois typologies.
LE GOUT, LES SENTEURS ET LE SON DANS LES RUES DE CHINATOWN ET LITTLE ITALY – NISHA FERNANDO
NEW-YORK ville cosmopolite par excel-lence révèle chacune des communau-tés au travers de ses spécialité culi-naires; les marchés de CHINATOWN témoignent de la vivacité de cette communauté qui au très des étals foi-sonnant de choses inconnues où se mêlent les sons, les voix et les odeurs diverses des épices de poissons frits et la vision de légumes inconnus.La cuisine, les marché, les restaurants de spécialités italienne deviennent une expérience culturelle et riche de sens , elle foisonne de diversité.Au moment où les villes occidentales deviennent de plus en plus multicul-turelles, le compréhension du rôle des activités autour de l’alimentation re-présentation d’enclaves culturelle de-vient un élément à prendre en compte de le cadre du planning urbain.La ville de NEW-YORK est particuliè-rement attentive à ce phénomène, dans l’organisation des rues, où les ter-rassent jouxtent les piétons.
NOUVEAUTÉ ET RARETÉ ; LUXE ET FACILITÉ DANS LES CENTRE COMMERCIAUX DU JAPON – BRIAN MCGRATH & DANAI THAITAKOO.
Cet article sur la société Japonaise donne un aperçu assez symptoma-
tique des sociétés « occidentalisées ».Comme de nombreuses civilisations statistiques, le JAPON avait un rapport particulier à la nourriture, proche des cultures auto vivrières.L’avènement des grands ensembles commerciaux, importés des ETATS-UNIS a fait progressivement dispa-raître, hormis dans les quartiers tradi-tionnels, les échoppes de rues. L’offre de l’alimentation était donc présentée dans les étages à l’abri des regards.L’ « occidentalisation » a induit un mode de vente particulier. La culture japonaise étant très codifiée quant aux divers événements de la vie, où la notion du présent est particulièrement importante.L’alimentation devenant de plus en plus un objet choyé, par sa présenta-tion « à la française » la cuisine rede-vient petit à petit plaisir et l’objectif de toutes les convoitises au point que cer-tains présentes peuvent être culinaire.La prise de conscience de cette atten-tion a fait revenir aux rez-de-chaussée des ces immeubles commerciaux de
AAC050-6145
nombreuses devantures de restau-rants ou de traiteurs.Il est indiqué par ailleurs, que la « li-béralisation » des femmes, dans une société très patriarcale, devenant de plus en plus autonomes, et travaillant un engouement certain a été observé par le déploiement de ces commerces en rez-de-chaussée.
NOURRITURE POUR LA VILLE, SE NOURRIR EN VILLE :
L'hyper urbanisation des villes comme NEW-YORK, on repoussé au loin les lieux de production agricole au point, et du fait du marketing très en pointe, les américains n’ont plus de proximité avec les aliments de base. Les produits lyophilisés, tout préparés ont créé une distance assez inquiétante avec un taux d’obésité très important.Les municipalités périphériques de NEW-YORK recréent des marchés ma-raichers avec des producteurs locaux de façon à retisser le lien avec l’agricul-ture. De nombreuses expériences sont en cours.Aussi, pour compléter et sensibiliser les jeunes populations, des cours de cuisines ont été réintroduits dans les classes de façon à prendre conscience de le nécessité du bien manger.La cuisine comme vecteur social et d’échange.
AGRI ET AQUACULTURE À BANGKOK AU-DELÀ DU PÉRIPHÉRIQUE :
BANGKOK ancienne ville royale, est historiquement organisée selon des trame fluviales des des trois fleuves qui la compose. Cette région soumise aux typhons est très propice à l’agri-culture et la riziculture, était la terre
nourricière de la grande ville.Avec le développement occidental et anglo-saxon de la ville depuis la période de la colonisation à celle plus récente des grandes mégalopoles urbaines, le schéma directeur urbain a tissé un réseau urbain composé de routes et autoroutes sur pilotis dans la maille du réseau de canaux.La ville est ainsi toujours alimentée au travers de grenier à blé tout proche, tout en repoussant les limites urbaines qui tendent à modifier le fragile équi-libre de cette ville géante.La question de la pollution urbaine n’est pas abordée dans cet article qui se veut assez angélique.
AGRICULTURE URBAINE, PETITE, MOYENNE OU GRANDE.
Cet article met en exergue la prise de conscience de la population à son alimentation. Il interroge sur la né-cessité d’une agriculture urbaine en tant que révolution urbaine. Prise de conscience du bien manger au regard de la prise de conscience écologique. La question de l’architecture est au cœur de cette réflexion. Réflexion au niveau de l’échelle de ces interven-tions, l’échelle individuelle des balcons ou d’une démarche plus collective inspirée des jardins ouvriers… ou des associations type AMAP comme elles tendent à se développer en France
BESSON D.
AAC050-6146
COLLECTIF (2004) : Small Sidewalk Cafés Pro-ject, Department of City Planning, NEW YORK City, 2004.COLLECTIF (2004) : Winter 2004,Progressive Planning: The Magazine of Planners Network, No 158.COUTTS, James (1999) : "Brisbane Revives its Suburban Centres", Landscape Australia 2, 1999, pp 95–8.DE GREGORI, Allessandro (2004) : "Two farmers markets in New Jersey", New Jersey Institute of Technology, 2004.GLEESON, Brendon (2004) : "The Future of Australia"s Cities: Making Space for Hope", pro-fessorial lecture , Griffith University"s Nathan Campus, BRISBANE, June 2004.HOWARD, Ebenezer (1902) : Garden Cities of To-Morrow, (London, 1902). IYER, Pico (2000) : The Global Soul, Vintage (NEW YORK), 2000, p 6.LE CORBUSIER (1987) : The City of Tomorrow and Its Planning, Dover Publications (NEW YORK), 1987.LÉVI-STRAUSS, Claude (1973) : From Honey to Ashes (1973) ; The Origin of Table Manners (1978), trans John and Doreen WEIGHTMAN, Harper & Row (NEW YORK), pp 323 and 495.MACLEAN, Alex S (2003) : Designs on the Land: Exploring America From the Air, Thomas & Hud-son (NEW YORK), 2003, p 131.MARTINOTTI, Guido (1994) : "The New Morpho-logy of Cities", online edition, Fev. 1994. MAZUMDAR, S. (2003) : "Sense of place consi-derations for quality of urban life", in NZ GULER-SOY and A OZSOY (eds), Quality of Urban Life: Policy vs Practice, Istanbul Technical University, 2003.
POTHUKUCHI, Kameshwari; L KAUFMAN, Je-rome (2000) : "The food system", Journal of the American Planning Association 66:2, 2000, p 113.REES, Richard (2004) : "Planning on the Edge", Urban Design Forum, No 65, March 2004.SPITZER, Theodore; BAUM, Hilary (1995) : Public Markets and Community Revitalization, Urban Land Institute and Project for Public Spaces (WASHINGTON DC), 1995.TAKAYA, Yoshikazu (1987) : Agricultural Develop-ment of a Tropical Delta: A Study of the Chao Phraya Delta, University of Hawaii Press (HONO-LULU), 1987.VILJOEN, Andre (1999) : CPULs Continuous Pro-ductive Urban Landscapes (CPULs): Designing Urban Agriculture for Sustainable Cities, Archi-tectural Press (LONDON), 2005; WIGGLESWORTH, Sarah (2002) : "Cuisine and architecture: A recipe for a wholesome diet", in Karen FRANCK (ed), "Food + Architecture", 4 Vol 72, No 6, Nov/Dec 2002, p 102.WINICHAKUL, Thongchai; MAPPED, Siam (1997) : A History of the Geo- Body of a Nation, Univer-sity of Hawaii Press (HONOLULU), 1997.WRIGHT , Frank Lloyd (1970) : The Living City, Meridian Books, 1970.ZUKIN, Sharon (1991) : Landscapes of Power: From Detroit to Disney World, University of Cali-fornia Press (BERKELEY, CA), 1991, p 268.
AAC050-6147
VIRILIO, Paul (2010) : L’administration de la peur, Editions Textuel.
" La peur est le pire des assas-sins, elle ne tue pas, elle em-pêche de vivre. "
AAC050-6148
VIRILIO, Paul (2010) : L’administration de la peur, Editions Textuel.
Paul VIRILIO est un urbaniste et essayiste français, né en 1932 à PARIS. Fondateur du groupe « Architecture principe » avec l’architecte Claude PARENT, il est profes-seur émérite au sein de l’école spéciale d’architecture. Il est principalement connu pour ses écrits sur la technologie et la vitesse, et sur la réalité issue de leur rencontre, la dromosphère.
L’ouvrage se présente sous la forme d’un entretien mené par Bertrand RICHARD (Les éditions textuel, 2010)
Le monde actuel semble dominé par les catastrophes. Le climat, la science, l’éco-nomie, tout semble hors de control. S’ins-talle alors une angoisse collective relative à ces facteurs non maîtrisé. Paul VIRILIO montre dans cet entretien que la peur qui a dorénavant envahi notre quotidien n’est pas qu’une illusion médiatique. Elle est viscérale et systémique, et elle s’est instauré progressivement tout au long du 20ème siècle et trouve son paroxysme aujourd’hui, à l’heure des crash boursier, des drames écologiques et des attentas suicides.
Dans un premier temps Paul VIRILIO éta-blie une chronologie des événements qui ont conduit le monde à la terreur. Le grand changement selon lui a débuté lors de la seconde guerre mondiale. La guerre éclaire, les rapports ambigu de l’occu-pant et du résistant, l’instrumentalisation massive de la science à des fins meur-trières. Le monde a changé de dimension et l’accomplissement de ce bouleverse-ment s’est produit avec l’explosion de la bombe atomique. Dès lors le phéno-mène provoqué par l’homme le dépasse.
Et avec l’instauration de la guerre froide, s’installe un climat de peur permanente. Celle de la guerre totale, de l’anéantisse-ment instantané. C’est « l’équilibre de la terreur ». Un monde dans lequel c’est le militaire et le scientifique qui surpasse le politique. La science ouvre la brèche de la relativité, avec elle la question de la vitesse. La philosophie et la politique ne sauront pas intégrer cette nouvelle donne dans leur pensé. La deuxième étape dans le processus de terreur est celui du terrorisme. Le fait qu’un homme seul puisse être la cause de catastrophes est un phénomène nou-veau. Il y a un nouveau rapport de force entre les institutions (militaires et poli-tique) et l’individu qui peut dorénavant assumer seul une déclaration de guerre totale. Ensuite il y ace que Paul VIRILIO nome « déséquilibre de la terreur ». Il s’agit d’une rupture dans la perception du monde à travers une temporalité bouleversé. Avec l’informatique, tous les flux ont été réduit jusqu’à la vitesse de la lumière. On assiste alors à une transmis-sion instantané des information, une glo-balisation mondiale des connaissances, et ainsi une « synchronisation des de l’émotion ». C’est selon l’auteur une nou-velle forme de communisme des affects. La société devient toute entière régie par l’émotion, par l’instantané et les poli-tiques cèdent aux solutions courtes-ter-mistes. Cette contraction de l’espace temps, Paul VIRILIO l’identifie comme un nouveau type de pollution qu’il englobe dans le terme d’écologie grise. La contrac-tion du temps des actions ne laisse plus le temps de la communication et rend la réalité « inhabitable ». Cette réalité qui par le biais des nouvelles technologies, dont nous sommes peu à peu dépossé-dé. Les technologies nous proposent une réalité augmenté qui nous prive d’une
AAC050-6149
"a mon avis, la domination du complexe militaro-industriel, c’est cela : cette chose d’autant plus redoutable pour la philosophie po-litique d’aujourd’hui que celle ce n’a pas pensé la question de la vitesse et de la vitesse articulé à l’espace. "
"L’effet de serre de la fièvre obsidionale, la claustrophobie de masse d’individus assiégés, voilà ce qui éveille et requiert mon attention . (…) "
" La forclusion. A la pression atmosphérique accrue du réchauffe-ment climatique se surajoute la pression dromosphérique, c'est-à-dire la tension exercée par la vitesse sur la vie quotidienne et le travail. "
" La peur est devenu un environnement en ce sens qu’à été réalisé la fusion du sécuritaire et du sanitaire. "
" Je crois que le grand enfermement réel, lui, est devant nous. La claustrophobie de masse qui s’empare des peuples est l’une des raisons de la grande peur écologique qui caractérise notamment par la crainte d’une planète incapable d’assumer notre développe-ment. C’est pour cela que le mouvement, l’échappement, l’exode, deviennent des phénomènes permanents. La seule solution désor-mais, c’est de bouger constamment ou bien de fuir définitivement. "
" L’insécurité sociale contemporaine se lie en effet à cette insécu-rité du territoire de la contraction temporelle. Nous ne sommes qu’au début d’une dissuasion civile qui entrainera la confirmation que les idéologies sécuritaires et sanitaires se confondent désor-mais dans l’écologie dévoyée de l’espace vital, par opposition à l’écologie authentique qui est celle de l’ici et maintenant. "
" Avec cette vitesse limite, j’ai même des scrupules à qualifier notre temps de « contemporain » ; je qualifierais plus volontiers la séquence dans laquelle nous sommes placés d’in-temporaine , au sens ou le régime de vitesse qui est le notre ne se situe pas dans le cadre de la tripartition habituelle passé-présent-futur. L’instanta-néité est outre-monde, et outre-temps. "
AAC050-6150
athéisme » comme définit par l’auteur.
La connaissance et la recherche elle-même finit par être touché par le bou-leversement de la vitesse. Ainsi la peur écologique peut être définit par trois composantes, la polutiondes substances, la polution des distances et la pollution delà connaissance. A partir des essais nucléaires, l’homme a abandonné la maîtrise de l’expérimentation en jouant à l’apprenti sorcier.
Enfin Paul VIRILIO explique que cette contraction du temps et des distances a engendré cette peur qui est devenue une composante essentielle de la société. Hors, la peur rend la vie insupportable. D’où les suicides professionnels constaté ces dernières années. La société doit donc impérativement se saisir de cette nouvelle donne et se reconstruire sur d’autres paradigmes, sur d’autres règles, avant de sombrer dans un totalitarisme nouveau.
Cette vision qui semble assez pessimiste doit nous alerter sur les bouleversement qu’a subit notre monde depuis quelques dizaines d’années. La révolution indus-trielle a engendré la standardisation des objets. Aujourd’hui on risque la standar-disation des individus. L’individualisme se confond finalement avec la synchroni-sation de nos émotions alors que les poli-tiques s’adaptent et s’inscrivent eux aussi dans l’instantané, rendant toute action dans la durée obsolète.
LANHER M.
parti de notre champ perceptif et n’est en fait qu’une « réalité accéléra »
Le monde est maintenant visible sous la perception de la vitesse, alors qu’il était dominé par la lumière. Paul VIRI-LIO revient sur les trois grandes peurs, l’équilibre de la terreur avec la bombe atomique, le déséquilibre du terrorisme avec l’informatique, et la peur écolo-gique avec la bombe génétique. Face à ces peur, la société succombe à une fièvre « obsidionale » c'est-à-dire relative à l’enfermement. Il y a un phéno-mène de claustrophobie collective face a la superposition des peurs ajouté à la vi-tesse de la vie quotidienne. Car il y aune perte de la rythmologie sociopolitique, il a une arythmie, une accélération et un dénie des temporalités naturelle. La peur devient permanente et omnipré-sente, elle est institutionnalisé et accepté comme un standard. « La peur est deve-nu un environnement en ce sens qu’a été réalisé la fusion du sécuritaire et du sani-taire ». Cela abouti à l’instauration d’une dissuasion civile, d’une écologie dévoyé de l’espace vital. Cette accélération du tempo est symp-tomatique, désormais on est toujours en retard. Il s’agit là d’un « masochisme quo-tidien et d’une mise sous tension consen-tie ». il y a une réelle perte de repère dans la temporalité. L’accélération qui mène à la synchronisation abouti à une forme d’immobilisme. On est en quelque sorte partout chez soi, grace aux nouvelles technologies. Par contre, il y a aussi ceux qui ne sont nulle part chez eux exclus et qui seront amené être exilé partout. Face à la claustrophobie d’un monde trop petit pour l’humanité, la solution c’est de bouger constamment ou de fuir définitivement. Désormais c’est l’accélération qui domine sur l’accumulation. Plus de stock et uni-quement des flux. Et cette instantanéité de toute chose abouti à un manque de confiance, qui ne peut s’instaurer que dans la durée. On finit par ne plus croire en rien et d’entrer dans l’ère du « mono-
VIRILIO, Paul (2010) : L’administration de la peur, Editions Textuel.
AAC050-6151
DANTEC, Maurice G. (2003) : Villa Vortex, Éditions Gallimard, Collection La Noire.
Maurice G DANTEC est né en 1959 à Grenoble, il est naturalisé canadien et se défini comme « un écrivain nord-américain de la langue française ». Il a été l’élève de Gilles DELEUZE et fonde en 1998 avec Richard Pinhas, le duo de musique expérimentale Schizotrope en hommage à ce dernier.
SYNTHESE
« L'an 2000 aurait dû être la Fin des temps … Finalement il n'en est rien.Le 11 Septembre 2001 sera le Dernier Jour du Monde tel que nous l'avions connu.Quatre sites. Quatre cavaliers venus du ciel. Le Monde d'ici-bas avait trouvé son régime de croisière : la destruction généralisée enclosait l'homme dans l'éternel recommencement du même, la mort, d'infinie différence, était deve-nue la finitude équivalente qui se refer-mait sur Porbicule où l'homme avait décidé de s'éteindre ».
Le narrateur, KERNAL, jeune flic de la banlieue PARISienne nous fait revivre les dix dernières années avant sa mort. Le 11 Septembre 2001 à midi, KERNAL explose dans son bureau de banlieue, victime lui aussi d'un attentat. Avant son décès il raconte :"Les dossiers criminels dont j'avais, ou avais eu la charge, recoupaient en partie cette ligne de fuite vers la ca-tastrophe, ma vie personnelle n'était plus à l'évidence que le prolégomène à un effondrement plus général, j'en avais pris conscience peu à peu, lors de mon lent éveil à ce monde qui venait de naître. Ces chemises de carton, je les contemplais bien moins comme les ruines d'une vie à moitié ratée, sem-
blables en cela à toutes les autres, que comme la promesse d'un avenir déjà ruiné par l'ensemble de nos actions. Dix ans, c'était à la fois largement suf-fisant pour comprendre qu'on pouvait en savoir beaucoup trop, et pas assez pour pleinement assimiler à quel point on n'apprenait jamais rien."Au fil des pages, nous partageons sa vie depuis son entrée dans la police en 1991 alors qu'il est témoin des grands événements internationaux. KERNAL plante le décor et nous fait découvrir la Préfecture de Police en 2001, son collègue MAZARIN raciste misogyne et violent.Il décrit les rouages de la bureaucra-tie et s'identifie comme rouage de la Machine, de la Préfecture de CRÉTEIL, flic de la France républicaine de la « fin des temps ». Il revient ensuite sur l'année 1991 et l'assassinat d'une jeune fille dans une centrale à charbon désaffectée, la « centrale Arrighi" près de VITRY.L'enquête révèle un crime odieux : les organes ont été remplacés par des électro mécanismesPuis, KERNAL nous ramène quelques années en arrière lors de sa rencontre en 1989 avec Milena et Maroussia en HONGRIE. Avec elles il assistera à la Chute du Mur de BERLIN, Porte de BRANDEBOURG.Lors de ses digressions autour du crime, il repart sur les plages du Dé-barquement (le D day) pour mieux comprendre la guerre en IRAK (la Guerre du Désert).
Il nous fait découvrir la centrale EDF voisine de la scène de crime, ses ou-vriers et RUNGIS. Il rencontre NITZOS, caméraman sur le site, chargé de filmer la destruction
AAC050-6153
Les deux enquêtes sont menées en pa-rallèle, KERNAL pour le premier corps et la gendarmerie pour les trois autres."Ce sont des types généralement édu-qués alphabétisés et cultivés. Je dirais même que c'est ça leur problème : la culture. Il n'y a rien de pire qu'une connaissance dont on ne sait rien faire. D'inutile, elle devient vite nuisible."Un an après la centrale ARRIGY, on retrouve le corps de Catherine TRAUS-SNER, près d'une usine de pétrochimie à côté de l'étang de BERRE. Alors que le 4ème crime est commis près de la centrale de CREYS-MALVILLE, le corps de Nadia, une jeune bosniaque, le cou-peret tombe. KERNAL et son équipe se voient retirer l'enquête au profit de la gendarmerie.
Nous sommes en 1995 et KERNAL ap-prend à surfer sur le WEB et décide de continuer l'enquête en off.NITZOS est tué à SARAJEVO et lui adresse à titre posthume son manus-crit. Parallèle étonnant, alors que KERNAL découvre la bibliothèque de WOLFMANN, NITZOS découvre la bi-bliothèque du docteur Yossip Shapin.Dans le même temps WOLFMANN quitte PARIS, le quartier qu'il connait a été rasé pour faire place à la Grande Bibliothèque MITTERAND. KERNAL se réfugie dans les livres et la religion.
LA VILLE DANS LE ROMAN
« Voici la ville, la mégapolis de Grand-PARIS, celle qui désormais s'étend en tous sens à cinquante kilomètres du point zéro gravé sur le parvis de Notre-Dame : c'est le PARIS que personne n'ose encore décrire. C'est le PARIS du siècle qui s'en vient, et qui est déjà là.Il fallait envisager le territoire méga-politain de nos existences comme une sorte de fantastique simulateur chargé de sélectionner de nouvelles formes de vie. La ville, jusqu'il y a peu construite et élaborée contre les principes du
de la « Centrale Arrighi » : ce dernier sera d'abord suspecté par KERNAL puis deviendra pendant les premiers mois d'enquête presque intime. Ils sont tous deux photographes, pro ou amateur et ancien rockeur pro ou amateur: "Nous partagions cette maladie de l'œil, cette nécrose du regard qui fai-sait de nous des enregistreurs de la vie"
Il découvrira avec lui les nouvelles techniques vidéo et la cybercrimina-lité.
Au départ de NITZOS pour l'ex YOU-GOSLAVIE en 1992, après avoir mis au point un logiciel de profilage psycholo-gique, il va avoir comme nouvel équi-pier MAZARIN.
La résolution du meurtre de la centrale est toujours au cœur de son activité et MAZARIN lui ouvre les portes de CAR-NAVAL, indic-journaliste et surtout de WOLFMANN ancien flic, de sa biblio-thèque et de sa « Théorie du crime absolu ».
"Grâce à lui je faisais se rejoindre la police de l'état des lieux et l'anti-police des non lieux de l’Etat"
Il aura grâce à eux des recoupements sur d'autres victimes de pédophiles et des réseaux en Europe. Il décou-vrira également le Méthédrine (Juillet 1994), une amphétamine lui permet-tant de tenir le rythme en dormant un minimum. Un deuxième crime va être commis 7 mois après le premier dans la centrale de BELLEVILLE SUR LOIRE, la Gendarmerie va filmer le corps :
"La marionnette est humaine. Ou plus précisément elle l'a été. Son corps est devenu la prothèse organique d'un ensemble de composants technolo-giques."
AAC050-6155
de tunnels, de cités à jeunes délin-quants et à réseaux terroristes.Le futur de la ville lui échappait. Aucun plan d'urbanisme ne serait en mesure de rendre compte de la grâce d'un aé-roport à la tombée de la nuit, lorsque chaque avion suit un ami qui ne vous attend pas. Aucun programme poli-tique ne serait en mesure de prévoir le casse qui un jour s'actualiserait par ici, comme un épisode sans doute inclusif de ce processus de sélection.Si vous ne croyez pas en la science-fic-tion, c'est, bien sûr, que vous n'avez jamais vécu en banlieue. Je veux dire la vraie banlieue. Je ne parle point-là du faubourg désuet situé aux limites du périphérique (frontière urbanistique et psychosociale qui a fait de PARIS la caricature muséale d'elle-même), ni de la zone pavillonnaire pittoresque sur les hauteurs de Meudon, des pe-tits ponts-au-dessus-de-la-Marne, ou même de la vieille école républicaine sentant bon les encriers et les livres d'histoire de la HP République, encore moins de la cité vachement multi-eth-nique et hyper-cool de mon enfance, tous ces trucs de prestidigitateurs verbeux qui encombrent la littérature contemporaine. Non, je vous parle de la vraie banlieue, celle que personne ne voit, celle dont personne ne se sou-vient, celle qu'on traverse, celle des spectres, celle qu'on atteint avec une seule et mystérieuse petite clé : la clé de contact ».
LE LOUP DU PONT DE TOLBIAC
« La nuit qui tombe sur la ville est une forme humaine de l'obscurité primi-tive. PARIS est une caverne, une vie souterraine, cryptique, en tout cas elle l'était à l’origine, et quelque chose sans doute a survécu de l’inframonde, en dépit des hautes tours de verre qui tend d'imiter platement, et sans la moindre grandeur ni impétuosité, la verticalité impériale des villes améri-caines. Il n'est rien dans cette cité qui
monde naturel, se voyait désormais propulsée dans un au-delà de la nature et de l'artifice, elle laissait alors appa-raître les flux parfaitement schizoïdes d'un cerveau dont les centres de com-mandement disparaissaient au profit de périphéries autonomes.Au quadrillage urbain se substituait le biotope réticulaire. La ville devenait à son tour une machine cybernétique, elle présupposait la mise en circulation constante de signaux et de paquets d'informations au service desquels les humains s'agitaient. Dans cette ville rendue au régime sauvage de la jungle, quelque chose pourtant s'agençait comme caché dans un pli secret à la beauté, plastique fulgurante, quelque chose qui faisait de cette ultime termi-naison de la maladie un spectacle au-trement plus poignant et-tragique que toutes les Très Grandes Bibliothèques du socialisme universel.Cela indiquait en tout cas quelque chose : la beauté ne pouvait naître désormais que de sublimes désastres agencés dans quelques cerveaux soli-taires, elle ne pouvait surgir que d'une vision, une vision supraterrestre née de machines perdues dans la nuit, en compagnie des derniers hommes.Je comprenais peu à peu que PARIS n'existait plus, que la ville de PARIS, ce musée métropolitain qui ne rassem-blait désormais plus qu'un sixième de la population de toute la conurbation, n'était pas plus réelle que le Village du Prisonnier. L'idée en vogue prenait corps : PARIS ressemblerait peu à peu à un village médiéval de téléfilm régio-naliste, ou bien à la capitale du XIXe siècle style Balzac joué par Depardieu, le tout reconstitué façon Hollywood-le-Pont. Autour du parc à thèmes pour touristes s'étendraient les territoires en imblocation de la réalité, un monde d'échangeurs géants, de lignes de TGV et de RER, de tours de bureaux, d'es-paces posturbains en friche, de centres commerciaux, de zones industrielles, d'usines, de centrales, de souterrains,
AAC050-6157
Centrale nucléaire de BELLEVILLE SUR LOIRE
Ambiances musicales
Les entrepots frigorifiques de la Ville de PARIS, XIII°
Les Grands Moulins de PARIS XIX°
Usine pétrochimique sur l'Etang de Berre
AAC050-6158
INFLUENCES MUSICALES
« Achtung baby » de U2« Diamond dog » de David BowieTangerine dream« I am a Warlus » des Beatles« Trans Europe Express » de Kraftwerk
AVIS PERSONNEL
C’est roman est assez fourni. Le style et les multiples digressions de l’auteur rendent la lecture compliquée. Le syn-thétiser en quelques pages est une gageure. En revanche, l’ambiance des lieux est formidablement transcrite, tout y est présent jusqu’aux sons et odeurs.
POULET O.
DANTEC, Maurice G. (2003) : Villa Vortex, Édi-tions Gallimard, Collection La Noire.TATI, Jacques, 1967 : Playtime, film, FRANCE, 126'.GILLIAM, Terry, 1984 : Brazil , film, USA, 131'.DANTEC, Maurice G. (1999) : Babylon babies, Éditions Gallimard, Collection La Noire.KASSOVITZ, Mathieu (2008) : Babylon A.D., film, France, 141'.MEGATON, Olivier (2002) : La Sirène rouge, film, France, 114'.
ne se soit édifié sur un cadavre.Nous sommes ici au carrefour du temps pour une grande ville-lumière. Nous voici à l'aube de la dernière phase de sa destruction. Les anciennes halles aux vins de Bercy viennent d'être trans-formées en un immense complexe ul-tramoderne spectacle, à l'architecture de bunkers militaires, recouverts de gazon artificiel dont le vert hurle sous la lumière électrique. Des concerts de Prince, Johnny Hallyday compétitions de motocross, voire de planche à voiles sont tenus. En face, les vieux Moulins de PARIS dressent leurs silos comme des cathédrales Art nouveau sous un ciel que la lune nimbe d'une lumière douce, fragile, et trouble. Mésas crayeuses vouées à l'érosion urbaine, à la destruction incorporée dans la vie même de la cité, elles tremblent sur elles-mêmes, dans une oscillation invisible du temps, de toute la fragilité d'un siècle qui va mourir.Un peu plus loin vers l'ouest, les an-ciens entrepôts frigorifiques de la SNCF, sorte d'improbable château fort industriel sorti de l'imagination déli-rante d'un ingénieur du rail, servent désormais d'abri pour des compagnies de danse, des studios de répétition, des groupes de roi et des plasticiens sub-ventionnés par la Ville de PARIS, veille de sa hauteur médiévale, et impro-bable, sur un réseau de chemin de fer, un lot de hangars abandonnés aux illu-sions de la culture.La culture a peu à peu raison de la vie. Bientôt, selon les dires de presse, sur-giront les premiers étages de la Très Grande Bibliothèque, molosse qua-drilatéral en forme de living qui vien-dra s'élever sur le quartier de vieilles bicoques et de bistrots à prolos que je vois s'étendre encore jusqu'au métro Nationale, avec sa ligne aérienne tra-versant la Seine vers l'Institut »
AAC050-6159
BAUDELAIRE, Charles (1857) : Les fleurs du mal, Éditions Poulet-Malassis et de Broise, Paris.
AAC050-6160
BAUDELAIRE, Charles (1857) : Les fleurs du mal, Éditions Poulet-Malassis et de Broise, Paris.
Charles-Pierre BAUDELAIRE est un poète français, né à Paris le 9 avril 1821 et mort à Paris le 31 août 1867. Considéré comme le premier poète moderne, il occupe une place particu-lière dans l'histoire littéraire. Il est le premier à parler de la ville dans la poé-sie et à populariser le poème en prose.Il est contre la bourgeoisie incarnée dans sa vie par sa mère et son beau père.BAUDELAIRE a été journaliste et cri-tique d’art.Il meurt en 1867 de la syphilis à cause de la vie mouvementée qu’il a mené.
RÉSUMÉ :
Ce livre est construit sous forme de recueil de poèmes qui inclut la quasi-totalité de la production poétique de l’auteur depuis 1840.
Les Fleurs du Mal, édité par la première fois en 1857 reçoit une grande critique négative (ex : dans la réaction de Gus-tave BOURDIN « Il y a des moments où l’on doute de l’état mental de M. BAU-DELAIRE, il y en a où l’on ne doute plus ; c’est, la plupart du temps, la répétition monotone et préméditée des mêmes choses, des mêmes pensées. L’odieux y côtoie l’ignoble ; le repoussant s’allie à l’infecte… »).
Ceci lui cause la poursuite judiciaire puis la censure de certains des poèmes trouvés dedans pour « offense à la morale religieuse » et « outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs ». Il doit donc retirer six de ses poèmes de l’ouvrage, lesquels seront publiés plus tard à BRUXELLES.
BAUDELAIRE dans un esprit très fu-
turiste et avant-gardiste détache la poésie de la morale, la proclame tout entière destinée au Beau et non à la Vérité. Il est devenu aujourd’hui un classique de la littérature française. Dans cet ouvrage, il a tenté de « tisser des liens entre le mal et la beauté, le bonheur et l'idéal inaccessible (À une passante), la violence et la volupté (Une martyre), entre le poète et son lecteur (« Hypocrite lecteur, mon sem-blable, mon frère »), entre les artistes à travers les âges (Les Phares) », etc.…
SYNTHÈSE ET ANALYSE CRITIQUE :
Cet ouvrage s’inscrit dans un recueil de poèmes qui est divisé en six parties et organisé par thèmes de la manière suivante :• Spleen et Idéal : où on perçoit la
double postulation dans laquelle l’auteur s’inscrit. (enfer, détresse – ciel, idéal, bonheur)
• Tableaux Parisiens : poèmes qui font allusion à la ville. BAUDE-LAIRE est le premier à parler de la ville dans la poésie.
• Le Vin : poésie dédiée au vin et à ses vertus bienfaisantes.
• Les Fleurs du Mal : c’est ici que l’on peut identifier le plus grand désir d’échapper au plus grand malheur : la souffrance.
• Révolte : il exprime sa colère contre Dieu, et son alliance avec Satan.
• La Mort : dernière ressource de BAUDELAIRE pour échapper à sa souffrance.
Dans ce contexte on peut relever plusieurs poèmes qui relient poète et urbaniste. Le choix se fait de cette manière:
AAC050-6161
LA BEAUTÉ : « JE SUIS BELLE », ÉLOGE DE LA BEAUTÉ. BAUDELAIRE décrit une femme à la beauté glaciale, froide. Elle possède des miroirs qui font des choses plus belles, tel un poète fait un poème, un sculpteur une sculpture, un architecte une ville. etc.…
LE CRÉPUSCULE DU MATIN : L'auteur décrit l’environnement au-tour du lever du soleil sur la ville, les maisons et les habitants à cette heure et les paysages qui ornent ce moment de la journée.
LE CRÉPUSCULE DU SOIR :L'auteur qualifie le soir « charmant », il décrit la tombée de la nuit dans une ville comme le réveil pour certains in-dividus (voleurs, prostituées...) ; ainsi qu'à une fin pour d'autres (malades, ouvriers...). L’auteur utilise le cynisme d’un monde inversé.
L’INVITATION AU VOYAGE : L'auteur invite une femme à un en-droit « singulier, superbe », où « tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté » où « désordre, turbulence et imprévu sont exclus »
PAYSAGE : L'auteur assimile son propre paysage comme un endroit calme, quelle que soit la saison. Il s’imagine à sa fenêtre pour écrire. Il décrit encore un paysage urbain avec des tuyaux, des fleuves de charbon, des clochers, portières et volets, etc.…
LES PHARES : BAUDELAIRE écrit ce poème comme un hommage à Léonard de VINCI, REMBRANDT, MICHEL-ANGE, GOYA, DELACROIX, etc.… Il définit un point commun à tous : l'exclamation des sentiments.
BAUDELAIRE a été un auteur qui se situait dans un contexte classique de-
dans un énorme esprit moderne qui est à nos jours impressionnant. Il se positionnait dans un esprit du « bizarre », dans un esprit de la « souffrance », ce qui se reflète dans ces poèmes sur le thème de la ville. Cette ville qui est traitée par lui même comme person-nage principal et non pas comme dé-cor. Cette ville qui est transcrite comme ville aux ruelles sombres, tuyaux, ville de fleuves de charbon, d’endroits dé-gradés et jamais des quartiers les plus beaux ni de la nature.
L’expression poétique de BAUDELAIRE relate un désir de modernité, un désir de renouveau pour la ville, sujet prin-cipal dans l’urbanité du présent mon-dial.
PAGOADA-CRUZ V.
AAC050-6162
BAUDELAIRE, Charles (1857) : Les fleurs du mal, Éditions Poulet-Malassis et de Broise, Paris.BENJAMIN, Walter (1994) : Charles Baudelaire. Unpoète lyrique à l'apogée du Capitalisme, trad. Jean LACOSTE, PARIS, Payot, 1994.PICHOIS, Claude (1996) : Baudelaire devant ses contemporains, PARIS, Klincksieck, 1996.
"Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ?
C'est surtout de la fréquenta-tion des villes énormes, c'est du croisement de leurs innom-brables rapports que naît cet idéal obsédant. Vous-même, mon cher ami, n'avez-vous pas tenté de traduire en une chan-son le cri strident du Vitrier, et d'exprimer dans une prose lyrique toutes les désolantes suggestions que ce cri envoie jusqu'aux mansardes, à travers les plus hautes brumes de la rue ?"
AAC050-6163
BECHER, Bernd; BECHER, Hilla (1979-1991) : La série Typologie des monuments industriels.
Bernd BECHER est né en 1931 à Siegen dans une région minière. Après un apprentissage de peintre décorateur, il étudie la peinture à l’Académie des beaux-arts de STUTTGART. Il peint les paysages de sa région natale avant de recourir pour la première fois à la pho-tographie en 1957 pour faire le portrait d’une mine en cours de démolition.
Née en 1934 à Potsdam, Hilla BECHER, photographe de formation, quitte Ber-lin Est pour suivre sa carrière profes-sionnelle en ALLEMAGNE de l’Ouest.
Bernd et Hilla BECHER se rencontrent en 1959, l’année où débute leur colla-boration avec une série de photogra-phies de mines et maisons ouvrières de la zone industrielle de SIEGEN. Ils ont, d'emblée, une démarche « typo-logique », qui consiste à photographier les bâtiments en séries, en les classant souvent par destinations et usages. Leur travail est tout d’abord estimé par les ingénieurs et théoriciens de l’archi-tecture.
En 1969, l’exposition « Sculptures ano-nymes », de Bernd et Hilla BECHER, est organisée simultanément avec une rétrospective de l’art minimal amé-ricain. De nombreux commentaires soulignent des affinités entre les deux projets, notamment la sobriété des formes et la présentation en série. La « pureté » et la simplicité de leur dé-marche, ainsi que le choix de la répé-tition et de la sérialité, les rapprochent en effet de certains artistes minima-listes et conceptuels, mais, avec leur aspect purement documentaire voire « encyclopédique », ils s'inscrivent aussi dans la lignée de la tradition de la photographie objective.
Typologies industrielles et artistiques
Les séries typologiques ont été déve-loppées sur une période de 30 ans pendant laquelle Bernd et Hilla BE-CHER ont recensé et photographié des bâtiments industriels : châteaux d’eau, tours de refroidissement, puits de mine, silos et hauts-fourneaux. Avec une technique invariable et ri-goureuse, ils procèdent de manière systématique en plaçant le bâtiment ou la structure photographié au centre de l’image, l’isolant autant que pos-sible de son environnement et ban-nissant du cliché toute source de dis-traction (individus, nuages, ou fumée). Ces images montrent que l’intention esthétique précède le projet docu-mentaire. Présentées dans un accrochage dense, sous forme de tableau de 9, 12 ou 15 photographies, sur plusieurs rangées, leur sens de lecture peut être horizon-tal, vertical ou diagonal. Par ce pro-cédé, Bernd et Hilla BECHER veulent mettre l’accent, avant tout, sur les qua-lités plastiques des bâtiments :
« Si les atouts ou les habillages esthé-tiques restent possibles jusqu’à un certain degré pour les autres construc-tions industrielles massives, la cha-leur, la pression et le dégagement de gaz des hauts-fourneaux les excluent. Leurs différents éléments restent visibles de l’extérieur. D’un point de vue anatomique, le haut-fourneau est donc semblable à un écorché. La forme est donnée par les organes internes, les vaisseaux, le squelette… Les paysages urbains de PITTSBURGH, BIRMINGHAM, CHARLEROI, LONGWY et DUISBURG sont dominés par leurs hauts-fourneaux tout comme les cités médiévales l’étaient par leurs cathé-
AAC050-6165
Bernd et Hilla BECHER, certains bâti-ments industriels, part leurs configu-rations et les volumes qu’ils dégagent, permettent une ré-exploitation par un changement de fonction (silo, usines, gazomètres…). Pour d’autres en re-vanche, dont l’esthétique reste très empreint par leur fonction première (haut-fourneaux, cheminés,…), leur reconversion en œuvre d’art ou en mémorial apparait comme leur unique salut.
GAUCHON D.
drales.»(B. BECHER 1990)
MONUMENTALITÉS INDUSTRIELLES
Ainsi, les travaux de Bernd et Hilla BECHER donnent la mesure de ce que peut représenter le « patrimoine industriel » et son impact sur les pay-sages urbains. Cette notion sera d’ail-leurs largement reprise et exploitée dans le projet de l’équipe GRUMBACH et Associés sur « le GRAND PARIS », pour qui les grands équipements de services collectifs, les ports, les silos, les usines, les centrales électriques, les usines de traitement des déchets, etc, deviennent les monuments de la Métropole du XXIème siècle. Formant ainsi le long du fleuve l’identité géo-graphique d’un territoire riche en his-toire.
QUESTIONNEMENT
Mais quel devenir pour ces sites indus-triels ? A l’heure de la ville des courtes dis-tances, de la lutte contre l’étalement urbain, sur fond de crise du foncier, quelles mutations possibles pour ces vastes friches industrielles (existantes ou en devenir) situées au cœur de nos villes ou dans leurs périphéries immé-diates ?
Au regard des différentes typologies présentées dans les photographies de
BECHER, Bernd; BECHER, Hilla (1979-1991) : La série Typologie des monuments industriels.LEJEUNE, Claire (2006) : Typologies anciennes : Bernd & Hilla Becher, catalogue d'exposition, Hornu (BELGIQUE), Musée des arts contempo-rains de la communauté française de Belgique, BRUXELLES.ZWEITE, Armin (2004) : Bernd et Hilla Becher, catalogue d'exposition (du 20 octobre 2004 au 3
janvier 2005), PARIS, Centre Pompidou, 93 p., ill.BECHER, Bernd; BECHER, Hilla (2002) : Indus-trial Landscapes / Bernd & Hilla Becher, with an interview by Susanne Lange ; Cambridge (Mass.), LONDON, the MIT press, 11 p. - 180 p. de planches.
AAC050-6167
SINCLAIR, Iain (2011) : Londres 2012 et autres dérives, Manuella Editions.
Iain SINCLAIR est né en 1943 à Cardiff. Ecrivain et cinéaste, il vit désormais dans le quartier très populaire d’Hac-kney de l’est londonien. Depuis les années 80, il se définit comme un mar-cheur urbain ...
Dans l’ouvrage étudié, qui est en réali-té un recueil de quatre textes : les bar-rières de la guerre, le premier départ, trois portraits et les jardins du paradis, il nous fait partager ses errances, ses dérives, au cœur des oubliés de la ville.
D’ailleurs nous pouvons définir le terme dérive de plusieurs manières : Dérive • Fait de s'écarter de la voie nor-
male, d'aller à l'aventure, de déra-per (Définition Larousse)
• Passage rapide entre les am-biances urbaines
« La dérive est une technique de dé-placement sans but, elle se fonde sur l’influence du décor » Guy DEBORD, 1954(Définition du site http://www.urbain-trop-urbain.fr)
C’est cette seconde définition qui cor-respond le mieux au travail de Iain SIN-CLAIR.
On peut d’ailleurs établir une corres-pondance entre sa démarche littéraire et certaines démarches artistiques, comme par exemple, le travail de Richard Long, un autre marcheur. En effet, depuis 1998, Iain SINCLAIR rend compte par ses écrits de ses marches urbaines, qu’il s’agisse de leur pré-paration, de leur accomplissement (l’action) ou bien de leur souvenir. Tou-
tefois, là où il se distingue des artistes du land’art tel que Long c’est qu’il n’y a pas de volonté à laisser son empreinte, si éphémère qu’elle puisse être, dans les lieux traversés. Ses flâneries ne sont, la plupart du temps pas solitaires et il est souvent accompagné de ses amis.
La première définition, le dérapage, correspond plutôt à l’état des lieux qu’ils nous décrits, les impensés de la ville, les territoires en marge victimes de dérives urbaines.
Le 1er texte qui nous est donné à lire s’intitule les barrières de la guerre, c’est le dénominatif trouvé pour les palissades fraîchement peintes et repeintes de bleu qui viennent clore le chantier du village des athlètes des JEUX OLYMPIQUES 2012. L’opération est appelée par le service communica-tion des J.O « des lits pour les athlètes, des logements pour les londoniens ».
Un territoire jusqu’alors pollué, colo-nisé par les sans papiers chinois, les sans-abris, les ouvriers polonais de-vient subitement le lieu de toutes les spéculations foncières. La condition n°1 au démarrage du chantier est de vider le quartier de ses habitants. Les maisons brûlent, un théâtre victorien brûle, toute la faune est reconduite à la porte. C’est la tabula rasa.
« Le Stratford circus a avalé le Théâtre Royal (...) provoquent du même coup une éruption de Pizza Express, de res-taurants Carribean Scene et de multi-plexes à bas prix » (p. 38)
Dérive, flânerie sont interdits dans l’enclos mais un circuit autorisé est
AAC050-6169
mis en place où Iain SINCLAIR s’engage avec le photographe, Stephen GILL qui connaissait bien les lieux ... avant. La permission de prendre des photos lui est refusée, il dira « J’ai eu le sentiment qu’on m’avait tout pris dans mon ter-ritoire ... »
SINCLAIR révèle quelques scandales : les fuites du produit polluant Thorium, le déplacement de jardins ouvriers correspondants à l’idéal du quartier en devenir mais malheureusement situés à l’emplacement choisis de la barrière. Ainsi il dénonce une prise de site vio-lente et irréfléchie « où tout est voué à disparaître ou à être corrigé ». Selon SINCLAIR l’héritage des jeux est « dé-possession, visions futuristes imposées aux forceps, honte durable ». Reste à voir si, malgré tout, le succès du nou-veau quartier sera au rdv ?
Le second texte, le premier départ, est un regard posé lors de marches en compagnie du photographe Marc ATKINS sur les graffitis du quartier d’Hackney. La description des œuvres, simple graff apposé sur une porte ou plus risqué perché sur un toit ou en-core véritable fresque m’ont rappelé une exposition de 2009 à la fondation quartier « né dans la rue ». Dans un monde où tout s’achète, ironie du sort, le graffiti a passé la porte des galeries d’art !
Les taggueurs partagent avec l’auteur le goût de la marche : « Marcher est la meilleure façon d’explorer et de tirer parti d’une ville : de ses transforma-tions, de ses glissements, des endroits où le heaume de nuage se brise, du mouvement de la lumière sur l’eau. Pour cela rien de mieux que la dérive volontaire : arpenter le bitume dans un état de rêverie éveillée, pour laisser surgir la fiction d’un motif sous-jacent ».
Trois portraits, est comme son nom l’indique l’écriture de trois portraits d’amis de SINCLAIR. L’un d’entre eux est David GASCOYNE, décrit comme un psycho géographe.
Je m’interroge et cherche alors sur cette discipline de la psycho géogra-phie : Selon Guy DEBORD qui l'a défini en 1955, « La psycho géographie se pro-poserait l'étude des lois exactes, et des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé ou non, agis-sant directement sur le comportement affectif des individus. » (source wikipédia)
A mon sens SINCLAIR est lui aussi psycho géographe, ses écrits per-mettent de dresser des cartes men-tales évidemment subjectives de sa ville. D’ailleurs dans l’ouvrage étudié tous les lieux décrits sont soulignés et référencés sur la carte en couverture, permettant d’associer l’image que l’imagination construit à la lecture à un emplacement géographique.
Enfin, les jardins du paradis, est le récit d’une marche, en compagnie de son ami peintre Renchi BICKNELL au delà du périphérique de la M25 qui cein-ture LONDRES. Ce territoire en marge accueille prisons et hôpitaux psychia-triques en ruine, repoussés aux limites de la ville. Ils ont été abandonnés, il semble, du jour au lendemain, et les fantômes sont nombreux sur le lieu abandonné trop vite.
Cette description fait écho à des sou-venirs personnels de relevés dans des bâtiments ayant été squattés et murés brutalement ou encore aux bureaux de la rotonde ferroviaire à Grigny, déser-tés soudainement après la faillite de l’entreprise. Il reste des affaires qui ne retrouveront jamais leur propriétaire, recouvertes de poussière, offrant un
AAC050-6171
arrêt sur image et révélant la présence incroyable des vies antérieures réson-nant dans les murs.
SINCLAIR et BICKNELL marchent le long de l’autoroute puis dans un parking. « Watford ne faisait sens que si vous conduisiez (...) Incapables de prendre une décision, nous avons décidé de marcher plus vite. Dans le crépuscule, à la lueur des pleins phares, il était impossible de différencier un collège théologique d’un centre de réhabilita-tion. Ou d’un ancien asile. »C’est sans doute une sensation étrange de se déplacer à pied dans un lieu conçu uniquement pour l’automobile et il est surprenant que de tels espaces aient été conçus alors que la marche, comme le rappelle DUTHILLEUL n’est pas un mode de transport mais tout simplement l’état normal de l’homme debout. Il est donc des espaces dont le corps est exclu, la marche est un moyen de reconquête et de réappro-priation possible de ces lieux.
Tous ces textes, récits de dérives ur-baines sont l’émergence d’un nouvel engouement pour les oubliés des villes.
SINCLAIR, Iain (2011) : Londres 2012 et autres dérives, Manuella Editions.FORBIDDEN PLACES (2012) : http://www.forbid-den-places.net/SINCLAIR, Ian (2011) : http://www.iainsinclair.org.uk/2011/05/01/londres-2012-et-autres-de-rives/URBAIN TROP URBAIN (2012) : http://www.urbain-trop-urbain.fr
Les arpenteurs sont aussi peintres, écrivains, photographes et rendent compte de leurs découvertes. Ils sont quelquefois appelés par les médias les nouveaux explorateurs urbains. Serait ce des nouveaux romantiques attirés par une esthétique de la ruine diffé-rente : la friche industrielle, héritage du 19ème et à présent 20ème siècle ?Ils soulèvent parfois la question de comment réinsuffler de l’urbanité avec justesse en ces lieux ? La marche peut sans doute aider à comprendre ...
AZE C.
DEBORD, Guy, 1957 : Rapport sur la construction des situations, Internationale lettriste.DEBORD, Guy, 1967 : La Société du spectacle, Buchet-Chastel.
AAC050-6173
GUILHEUX, Alain (2012) : Action architecture, Éditions de La Villette.
Il est important pour aborder ce livre de faire dans son esprit une sorte de tabula rasa de tous les préconçus que l’on peut avoir concernant la chose architecturale.
Nous sommes, et ce livre tente à le démontrer, à l’aube d’une nouvelle dialectique de la forme architecturale comme de la forme urbaine. De tout temps l’architecture était conçue pour durer. Cette durée permettait de mar-quer le territoire, imposé des fron-tières, des limites. Mais elle avait pour but aussi de symboliser une culture, une ethnie, une religion.
Aujourd’hui nous sommes dans tout autre débat, avec les nouveaux mé-dias, les modes les transports, nous vivons sur un monde fini, qui tend aussi à s’accélérer. Nous ne sommes plus dans la durée mais dans l’immé-diateté. L’image fait et défait. Exister sur l’écran c’est déjà exister tout court. La mondialisation a tombé les fron-tières, plus de limite non plus. On est dans le temps du vif pour reprendre une expression de Paul VIRILIO où il est question de la vitesse et du mouve-ment. On est plus dans la profondeur de champ, mais dans la profondeur de temps. Être dans une perspective du temps réel, celle de l’accélération. Le vide et le vite donne le vif c'est-à-dire le vivant.
De l’ensemble du livre je n’ai retenu que deux auteurs dont le travail sem-blait suivre une certaine cohérence et une continuité dans l’esprit. Cette trame est à la foi lier aux nouveaux réseaux informatiques, qu’a la déma-térialisation de l’architecture connue jusque-là. L’usage systématique du préfix « hyper » dans l’ensemble des
textes fait comprendre que nous sommes passé dans un autre temps. Une autre façon d’habiter, de ce dé-placé de penser même. Une nouvelle perception du monde en soi
1/ POST-SÉDUCTION. L’INVENTION DE NOUS-MÊMES, LE MÉTIER DE L’EMPIREAlain GUIHEUX
L’Exposition Universelle de NEW YORK de 1939 semble pour Alain GUIHEUX la date charnière où l’architecture est passée d’un objet signifiant et durable à une fabrication d’objets plus anec-dotiques animés par des intérêts plus spéculatifs. Cette appréciation concer-nant l'exposition universelle et due à la présence de designers dans le rôle d’architecte tel Norman Bel GEDDES associé à Edward BERNAYS1. L’architecture est devenue un objet de consommation mais aussi un objet qui nous transforme. Car tout ce qui nous touche tout ce que nous voyons nous transforme. Ce qu’avait compris Edward BERNAYS2 en travaillant avec les cigarettiers, il installait la société de consommation. On peut en déduire que l’homme s’invente continuelle-ment. Et qu’il crée les objets de cette invention. L’invention de nous-mêmes est accélérée par la modernité même. Et l’architecte suit le mouvement
1 Norman Bel GEDDES (1893 -1958) est un déco-rateur de théâtre et un des pionniers du design industriel aux ÉTATS UNIS durant les années 1930. architecte, il réalisera des projets tels que le pavillon de General Motors à la Foire interna-tionale de NEW YORK en 1939 2 Edward Louis BERNAYS, (1891-1995) il est considéré comme le père de la propagande politique institutionnelle et de l'industrie des relations publiques, Joseph GOEBBELS s'est for-tement inspiré de ses travaux.
AAC050-6175
comme le designer, le publicitaire, le chef de produit marketing ou l’homme politique. L’architecture participe de cette transformation de nous-mêmes.
C’est aussi pour cela que les archi-tectes tentent de théoriser leur métier. Pour lui donner la valeur qu’il a per-due, mais n’est ce pas déjà trop tard. L’architecture du début du XXème siècle à tenter de créer « l’homme nou-veau » Celle de la fin du XXème siècle à elle créée « l’homme consommant » dans les années 80 l’architecture fut comprise comme un code social. Une image de représentation. Mais cela aliéna l’architecte à un certain nombre de codes. Les objets, pardon !, les bâti-ments doivent être repérable, immé-diatement traduisibles.
Une autre menasse avec laquelle l’ar-chitecte doit tenir compte c’est le no-madisme. La tente, la caravane reste des objets à habiter mais peuvent être conçues par d’autres comme les ingé-nieurs ou les designers.
À propos de déplacement, la voiture a aussi transformé la ville, la question urbaine ne ce pose plus vraiment, puisque l’ensemble du territoire est devenus une ville. Si les bâtiments deviennent objet de consommation pourquoi la ville ne suivrait pas ce chemin. Il suffit de voir les entrées de ville, immenses magasins à ciel ouvert où l’architecture a perdu toute raison d’être. L’architecture devient une tête de gondole. Dans les années 30, aux ÉTATS-UNIS, l’architecture a poussé à consommer, mais elle s'est prise à son propre piège.
LA POST-SÉDUCTION.
À force de dispositifs et de mise en scène la ville et l’architecture sont devenus des étrangers. Cette distance nous libère de la contrainte consumé-riste. C’est une occasion pour l’archi-
tecte de reprendre la main. À partir de nouveau mode de vie proposait une nouvelle forme d’habiter. Sans attache mercantile, redonner du fond à l’archi-tecture.
2/ L’HYPERElizabeth MORTAMAIS
Définition : HYPER - Préfixe - du grec ancien ὑπέρ, hypér (« au-dessus, au-delà »)C’est à partir de ce préfixe qu'Eliza-beth MORTAMAIS pense désormais à une réorganisation des modes de vie. Le terme hyper ayant envahi la phra-séologie des sociologues. La société ne serait plus binaire, image propre à la modernité, mais serais perçue comme de l’hypertexte. Hypertexte est un des systèmes qui a permis de développer en parti internet. C’est le moment de l’instantanéité, du réactif. C’est aussi le moment de concevoir d’autres modes de pensée, de productions et d’organi-sation. Les objets nomades comme le GPS (Global Positionning Système) ou d’in-formation comme le SIG (Systèmes d’Informations Géographiques) ou les liens informatiques comme Internet 2.0 sont des exemples de cette coexis-tence dans une société. La preuve de l’hypertexte au niveau mondial. À l'heure ou seulement 17% des travail-leurs Européens fabriquent un bien, tous les autres fabriquent du savoir, de l’information ou du service. Une activi-té complètement dématérialisée. C’est cette nouvelle activité qui dessine un nouveau paysage. À l'instar de routes et des voies de chemin de fer. C’est un paysage immatériel cette foi.
L’hypertexte crée des paysages vir-tuels. Tous les objets nomades parti-cipent à la création du flux, deviennent eux-mêmes des flux, des routes. Mais sans les contraintes géographiques. Ils redessinent la planète. Ces cartes
AAC050-6177
numériques ont créé de nouveaux univers. Certes très précis mais n’invo-quant plus le corps. L’hyper a effacé les frontières physiques, les frontières de la fatigue et du temps.Autre grande modification c’est le fractionnement des activités immaté-riel, que devient l’architecture. Quelle forme nouvelle sera engendrée de ses mutations. Comment appliquer du tangible à de l’abstrait. Le terme de foyer est devenu obsolète, est que le foyer n’est-il pas l’écran de l’ordina-teur? Cet écran qui nous fait ressortir aussitôt. L’architecte saura-t-il recréer des «foyers» ou deviendra-t-il pas un technicien de la domotique.L’hyper condense toutes les informa-tions et les redéployes instantané-ment. Il fabrique la « rizomatisation » du monde. Tout est à flux tendus, le monde est au vif (à vif ?) C’est un monde qu’il faut réapprendre. En par-ticulier pour l’architecte qui vit encore dans un temps long.
Entre architectures objet ou total dé-matérialisation, l’architecture doit se faire une place. Deux solutions s’offre à elle : soit elle anticipe les futures mutations comme par exemple dès aujourd’hui la question de l’environ-nement, soit elle attend une nouvelle révolution post-numérique. Dans tous les cas de figure, elle ne sera plus l’ar-chitecture du passé, des monuments faits pour l’édification des peuples. Et pour paraphraser LE CORBUSIER elle ne sera plus seulement une machine habitée, mais aussi à travailler, à voya-ger, à se divertir, à se cultiver. Elle sera en continuelle reconstitution et se mo-difiant au gré des innovations. Comme nous l’avons vu plus haut, au-delà de la simple représentation formelle c’est une interdépendance continuelle entre l’habiter et l’habitant.
MOUCHET P.
GUILHEUX, Alain (2012) : Action architecture, Éditions de La Villette.VIRILIO, Paul, 1977 : Vitesse et Politique, Editions GALILÉE, 151p.GUIHEUX, Alain, 2004 : La ville qui fait signe, PARIS : Éditions du Moniteur, 2004, 296 p.MORTAMAIS, Elizabeth; MAGERAND, Jean (2009) : Vers l'hyperpaysage, Editions L'Harmat-tant, 2009. MORTAMAIS, Elizabeth; MAGERAND, Jean (2003) : Vers la cité hypermédiate: Du moder-nisme-fossile à l'hypercité-immédiate, Editions L'Harmattant, 2003.PICON, Antoine (2010) : Culture Numerique Et Architecture: Une Introduction, Birkhauser, 2010.GEDDES, Norman Bel (1939) : General Motors Highways & Horizons: New York World's Fair, General Motors Corporation, 1939.COLLECTIF (1939) : Futurama, General Motors Corporation, 1939.BERNAYS, Edward Louis (1939) : Propaganda, 1936.
AAC050-6179
LEWIS, Duncan; FRANCOIS, Edouard (1999) : Construire avec la nature, Editions Edisud.
Cet ouvrage écrit par Duncan LEWIS et Edouard FRANÇOIS présente la démarche et expose les principaux projets de l'agence d'architecture épo-nyme, ouvrage paru avant que cha-cun des associés ne crée leur propre agence. Cet ouvrage reflète une pro-duction singulière dans le paysage architectural puisqu'elle met en avant une problématique particulière : « construire avec la nature ». En ce sens les auteurs mettent un point d'hon-neur à dépasser les cloisonnements traditionnels entre l'architecture, le paysage, le territoire et l'écologie.
De leurs propres mots, «l'architec-ture est faite pour enchanter ». Elle doit être désirable pour répondre aux besoins contemporains (envie de nature...) et elle doit s'inscrire dans le territoire. Leur démarche exprime avant tout un compagnonnage avec la nature. Il ne s'agit pas de s'opposer ou de s'imposer à la nature mais de faire en sorte que l'architecture intègre les différentes facettes de la nature (pay-sage, parfums naturels, inclusion du végétal dans le bâti).
Cette pratique n'est pas nouvelle, « la végétatisation est un courant per-sistant de l'architecture » (dixit Fran-cis RAMBERT). Plusieurs architectes reconnus se sont confrontés à l'inté-gration de la nature dans leur produc-tion (HUNDERTWASSER, MALLET STE-VENS, Jean RENAUDIE...) chacun avec leur propre style. FRANÇOIS et LEWIS quant à eux métissent à travers leur architecture deux courants artistiques : le Land Art et l' Arte povera. Ils font du « Land Arch ». Ils prônent d'une certaine manière une disparition de l'architecture non seulement comme objet formel mais aussi comme disci-
pline, les limites entre architecture et paysage étant dépassées. Ce dépasse-ment des limites apparaît à travers les différentes interventions de l'agence : celle-ci travaillant aussi bien sur des projets d'infrastructures linéaires, des projets d'architecture manifestes, d'immenses sites en déshérence que sur des micro-réalisations. Ils arti-culent pérennité et éphémérité.
Les murs végétalisés de Patrick BLANC ont été déclencheurs dans leur dé-marche (intégration du végétal dans le construit). Cela leur à donner goût à la simplicité, au low tech, à l'utilisation de matériaux bruts sans pour autant parler d'architecture écologique d'un point de vue technique. FRANÇOIS et LEWIS travaillent sur des images et des concepts de Nature « forts » où les questions du visible et de l'invisible se posent.
20 projets ou réalisations à travers toute la France, d'échelles et de pro-grammes différents, ont été sélec-tionnés. Ils traduisent leur manière de construire avec le paysage :
• La conception d'un viaduc de 450m de long dans la vallée clas-sée de la BIÈVRE dans le cadre de la réalisation de l'autoroute A125 (1993) : les concepteurs ont opté pour une réalisation mimé-tique où les poteaux du viaduc prennent l'apparence des arbres environnants et le projet se fond dans le paysage.
• La conception des têtes de tunnel de l'autoroute A20 entre BRIVE et MONTAUBAN (1994) : dans un environnement marqué par des grottes exemplaires (Lascaux),
AAC050-6181
FRANÇOIS et LEWIS conçoivent des entrées de tunnel prenant l'apparence de grottes.
• L'extension du groupe scolaire BUFFON à THIAIS (1995) : ils réa-lisent une école dans les arbres
• La construction du collège Saint-Prix (1993) : en réaction à la dispa-rition programmée d'îlots boisés, ils réalisent un collège compact qui apparaît comme une « par-celle boisée équipée et habitée ».
• La reconstruction du lycée tech-nique MONGE à SAVIGNY-SUR-ORGE (1996) : l'agence reprend l'idée du mimétisme en réalisant un lycée sur pilotis dans le cadre d'un environnement boisé.
• L'aménagement intérieur d'un bar parisien : disposant d'un budget minimal, les concepteurs inspirent l'idée de nature dans un espace confiné par le simple enchevêtre-ment de bambous et la réalisation d'un plafond végétalisé.
• La réalisation de serres dans le cadre du festival des jardins de CHAUMONT-SUR-LOIRE (1996) : le principe de la bambouseraie est repris et affiné par rapport à l'aménagement du bar mentionné précédemment.
• La construction d'une maison dans les arbres à SAINT-CLOUD (1997)
• La conception d'une station de traitement des eaux à NANTES (1995) : LEWIS et FRANÇOIS dé-cident de dépasser les limites opérationnelles de leur interven-tion se limitant à la parcelle d'une station d'épuration en proposant un traitement d'ensemble d'un secteur déqualifié (regroupant dé-chets et polluants) sur près de 100 ha. L'aménagement d'ensemble se présente comme le parcours et la transition d'une eau trouble en eau claire.
• Un immeuble de bureau à ROUEN (1994) : le dialogue envisagé avec
la forêt environnante et une auto-route se traduit par le traitement de l'enveloppe. La façade corres-pond à une double peau remplie d'aiguilles de pins. L'échos avec l'environnement est renforcé par les propriétés isolantes (acous-tique et thermique).
• Un centre des conférences à AIX-EN-PROVENCE (1992) : l'enve-loppe de la construction consti-tuée de tiges fines de métal brut oxydé disparaît entre les troncs d'arbres.
• La conception d'un restaurant et des aménagements paysagers au sein du technopôle de CHÂTEAU-GOMBERT à MARSEILLE (1995) : les concepteurs cherchent à conforter l'ambiance champêtre des abords.
• Un restaurant sur le toit du centre Georges POMPIDOU à PARIS (1998) : le projet « plug-in forest » initie une terrasse comme un pro-longement de l'intérieur du bâti-ment dont l'ambiance souhaitée doit correspondre à un sous-bois.
• La conception d'un immeuble de 25 logements sociaux au bord du canal de l'Ourcq à PARIS (1996) : à la charnière de deux zones, les concepteurs choisissent de réa-liser deux bâtiments dont les fa-çades traduisent pour chacun leur environnement immédiat distinct
• Une maison individuelle à OR-LÉANS (1997) : ils combinent deux archétypes architecturaux contradictoires. Celui de la « tour élancée » et celui du concept de « forêt habitée », visibilité contre invisibilité.
• La conception d'un hameau de 10 logements de vacances à JUPILLES (1996) : en alternative aux lotis-sements pavillonnaires lambda, l'agence LEWIS et FRANÇOIS re-groupent dix logements derrière une paroi végétale, une « haie » qui correspond à un traitement
AAC050-6183
particulier des limites entre le construit et le naturel.
• La conception de 62 logements sur les berges du Lez à MONT-PELLIER (1998) : les architectes utilisent le gabion en référence aux empierrements rustiques des berges du Lez. Ce dispositif per-met à la végétation de coloniser les parois. Ce rempart minéralo-végétal est surmonté de cabanes perchées dans les arbres.
Les réalisations de l'agence Edouard FRANÇOIS Duncan LEWIS & associés font apparaître une relation intime entre la nature et le construit où les limites sont floues et poétiques. Leur architecture intègre les différentes di-mensions du développement durable (souci de réponse à des besoins so-ciaux, vision économique par l'emploi de matériaux low tech, dimension environnementale où le végétal est un élément d'architecture). Leur architecture mimétique paraît simple mais non simpliste, plus portée sur l'image globale que sur la précision du détail mais elle inscrit une position affirmée à l'environnement et au ter-ritoire.
PIERRE S. LEWIS, Duncan; FRANCOIS, Edouard (1999) : Construire avec la nature, Editions Edisud.OTTO, Frei (1985) : Architecture et bionique : constructions naturelles, Editions Delta et Spes (DENGES)SCHOFIELD, Maria (1980) : Architecture et na-ture : 18 exemples internationaux, Editions du Moniteur (PARIS)FRANCOIS, Edouard (2000) : Flower tower : exposition à l'Institut français d'architecture, 31 mai-17 septembre 2000, Institut français d'archi-tecture (PARIS)QUEYSANNE, Bruno (1998) : Nature d'architec-ture, Ecole d'Architecture de GRENOBLE (GRE-NOBLE)
AAC050-6185
ABRIL, Philippe (2009) : Lotissement, Huile sur toile, 60 40 cm.###-AAC050-6141ASCHER, François (2005) : La société hypermoderne : ces événements nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs, Edition de l’Aube, Essai-2005 .###-AAC050-6109ASCHER, François (2008) : « Effet de serre, changement climatique et capitalisme cleantech », in Es-prit, février, pp. 150-164.###-AAC050-6117BAUDELAIRE, Charles (1857) : Les fleurs du mal, Éditions Poulet-Malassis et de Broise, Paris.###-AAC050-6163BECHER, Bernd; BECHER, Hilla (1979-1991) : La série Typologie des monuments industriels.###-AAC050-6167BECHER, Bernd; BECHER, Hilla (2002) : Industrial Landscapes / Bernd & Hilla Becher, with an inter-view by Susanne Lange ; Cambridge (Mass.), LONDON, the MIT press, 11 p. - 180 p. de planches.###-AAC050-6167BENJAMIN, Walter (1994) : Charles Baudelaire. Unpoète lyrique à l'apogée du Capitalisme, trad. Jean LACOSTE, PARIS, Payot, 1994.###-AAC050-6163BERNAYS, Edward Louis (1939) : Propaganda, 1936.###-AAC050-6179CHARMES, Eric (2003) : Les tissus périurbains français face à la menace des « gated communities », in Eléments pour un état des lieux, PUCA, 258 p.###-AAC050-6117CHARMES, Eric (2011) : La ville émiettée, PUF, 2011.###-AAC050-6109CHARMES, Erik; SOUAMI, Taoufik (2009) : Villes rêvées, villes durables, Éditions Gallimard, coll. Découvertes.###-AAC050-6117CLOCHARD, Fabrice; ROCCI, Anaïs, VINCENT, Stéphanie (2008) : Automobilités et altermobilités, quels changements ?, PARIS, L’Harmattan, 286 p.###-AAC050-6117COLLECTIF (1939) : Futurama, General Motors Corporation, 1939.###-AAC050-6179COLLECTIF (2004) : Small Sidewalk Cafés Project, Department of City Planning, NEW YORK City, 2004.###-AAC050-6147COLLECTIF (2004) : Winter 2004,Progressive Planning: The Magazine of Planners Network, No 158.###-AAC050-6147COLLECTIF (2006) : Eco-quartier, Revue Urbanisme No 348, mai-juin 2006.###-AAC050-6123COUTTS, James (1999) : "Brisbane Revives its Suburban Centres", Landscape Australia 2, 1999, pp 95–8.###-AAC050-6147DANTEC, Maurice G. (1999) : Babylon babies, Éditions Gallimard, Collection La Noire.###-AAC050-6159DANTEC, Maurice G. (2003) : Villa Vortex, Éditions Gallimard, Collection La Noire.###-AAC050-6159DEBORD, Guy, 1957 : Rapport sur la construction des situations, Internationale lettriste.###-AAC050-6173DEBORD, Guy, 1967 : La Société du spectacle, Buchet-Chastel.###-AAC050-6173DE GREGORI, Allessandro (2004) : "Two farmers markets in New Jersey", New Jersey Institute of Tech-nology, 2004.###-AAC050-6147DONZELOT, Jacques (2004) : « La ville à trois vitesses : gentrification, relégation, péri-urbanisation », in Esprit, Mars/avril, pp. 14-39.###-AAC050-6117FORBIDDEN PLACES (2012) : http://www.forbidden-places.net/###-AAC050-6173FRANCOIS, Edouard (2000) : Flower tower : exposition à l'Institut français d'architecture, 31 mai-17 septembre 2000, Institut français d'architecture (PARIS)###-AAC050-6185GEDDES, Norman Bel (1939) : General Motors Highways & Horizons: New York World's Fair, General Motors Corporation, 1939.###-AAC050-6179GHORRA-GOBIN, Cynthia (2006) : La théorie du New urbanism : perspectives et enjeux, LA DÉFENSE,
BIBLIOGRAPHIE
AAC050-6186
Editions de la DGUHC, 89 p.###-AAC050-6117GILLIAM, Terry, 1984 : Brazil , film, USA, 131'.###-AAC050-6159GLEESON, Brendon (2004) : "The Future of Australia"s Cities: Making Space for Hope", professorial lecture , Griffith University"s Nathan Campus, BRISBANE, June 2004.###-AAC050-6147GUIHEUX, Alain, 2004 : La ville qui fait signe, PARIS : Éditions du Moniteur, 2004, 296 p.###-AAC050-6179GUILHEUX, Alain (2012) : Action architecture, Éditions de La Villette.###-AAC050-6179HOWARD, Ebenezer (1902) : Garden Cities of To-Morrow, (London, 1902). ###-AAC050-6147IYER, Pico (2000) : The Global Soul, Vintage (NEW YORK), 2000, p 6.###-AAC050-6147JOUVE, Bernard; LEFEVRE, Christian (1999) : Villes, métropoles, les nouveaux territoires du politique, PARIS,Anthropos, 305 p.###-AAC050-6117KASSOVITZ, Mathieu (2008) : Babylon A.D., film, France, 141'.###-AAC050-6159LECLERCQ, François (2006) : Pour la ville, quel que soit l’état du monde, Editions NEJMP, Collections Passage Vérité.###-AAC050-6141LE CORBUSIER, 1923 : Vers une architecture, PARIS.###-AAC050-6123LE CORBUSIER (1987) : The City of Tomorrow and Its Planning, Dover Publications (NEW YORK), 1987.###-AAC050-6147LE GUAY, Philippe (2011) : Les femmes du 6e étage, film, 106'.###-AAC050-6141LEJEUNE, Claire (2006) : Typologies anciennes : Bernd & Hilla Becher, catalogue d'exposition, Hornu (BELGIQUE), Musée des arts contemporains de la communauté française de Belgique, BRUXELLES.###-AAC050-6167LELOUP, Michèle (2007) : 2007:cap sur la ville archipel, in L'EXPRESS, 08/03/2007.###-AAC050-6133LÉVI-STRAUSS, Claude (1973) : From Honey to Ashes (1973) ; The Origin of Table Manners (1978), trans John and Doreen WEIGHTMAN, Harper & Row (NEW YORK), pp 323 and 495.###-AAC050-6147LEWIS, Duncan; FRANCOIS, Edouard (1999) : Construire avec la nature, Editions Edisud.###-AAC050-6185MACLEAN, Alex S (2003) : Designs on the Land: Exploring America From the Air, Thomas & Hudson (NEW YORK), 2003, p 131.###-AAC050-6147MANGIN, David (2010) : La ville franchisée, Formes et structures de la ville contemporaine, Editions de La Villette###-AAC050-6109MARTINOTTI, Guido (1994) : "The New Morphology of Cities", online edition, Fev. 1994. ###-AAC050-6147MASBOUNGI, Ariella; BOURDIN, Alain (2004) : Un urbanisme des modes de vie ,PARIS : Ed. du Moni-teur, 2004 , 96 p.###-AAC050-6109MAURIN, Eric (2004) : Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social, PARIS, Seuil, coll. « La République des idées », 2004.###-AAC050-6109MAZUMDAR, S. (2003) : "Sense of place considerations for quality of urban life", in NZ GULERSOY and A OZSOY (eds), Quality of Urban Life: Policy vs Practice, Istanbul Technical University, 2003.###-AAC050-6147MEGATON, Olivier (2002) : La Sirène rouge, film, France, 114'.###-AAC050-6159MORTAMAIS, Elizabeth; MAGERAND, Jean (2003) : Vers la cité hypermédiate: Du modernisme-fossile à l'hypercité-immédiate, Editions L'Harmattant, 2003.###-AAC050-6179MORTAMAIS, Elizabeth; MAGERAND, Jean (2009) : Vers l'hyperpaysage, Editions L'Harmattant, 2009. ###-AAC050-6179OFFNER, Jean-Marc (2006) : Les Plans de déplacements urbains, PARIS, La Documentation Française,
AAC050-6187
96 p.###-AAC050-6117OTTO, Frei (1985) : Architecture et bionique : constructions naturelles, Editions Delta et Spes (DENGES)###-AAC050-6185PICHOIS, Claude (1996) : Baudelaire devant ses contemporains, PARIS, Klincksieck, 1996.###-AAC050-6163PICON, Antoine (2010) : Culture Numerique Et Architecture: Une Introduction, Birkhauser, 2010.###-AAC050-6179POTHUKUCHI, Kameshwari; L KAUFMAN, Jerome (2000) : "The food system", Journal of the American Planning Association 66:2, 2000, p 113.###-AAC050-6147QUEYSANNE, Bruno (1998) : Nature d'architecture, Ecole d'Architecture de GRENOBLE (GRENOBLE)###-AAC050-6185REES, Richard (2004) : "Planning on the Edge", Urban Design Forum, No 65, March 2004.###-AAC050-6147REIGNER, Hélène; HERNANDEZ, Frédérique; BRENAC, Thierry (2009) : « Circuler dans la ville sûre et durable : des politiques contemporaines ambigues, consensuelles et insoutenables », in Métropoles, 5, Varia, [en ligne], mis en ligne le 6 avril 2009. URL : http://metropoles.revues.org/document3808.html###-AAC050-6117SCHOFIELD, Maria (1980) : Architecture et nature : 18 exemples internationaux, Editions du Moniteur (PARIS)###-AAC050-6185SCOTT BROWN, Denise, 1971 : Learning from Pop, in Casabella 359-360.###-AAC050-6123SINCLAIR, Iain (2011) : Londres 2012 et autres dérives, Manuella Editions.###-AAC050-6173SINCLAIR, Ian (2011) : http://www.iainsinclair.org.uk/2011/05/01/londres-2012-et-autres-derives/###-AAC050-6173SOUAMI, Taoufik (2009) : Ecoquartiers, secrets de fabrication, PARIS, Les Carnets de l’Info., 207 p.###-AAC050-6117SPITZER, Theodore; BAUM, Hilary (1995) : Public Markets and Community Revitalization, Urban Land Institute and Project for Public Spaces (WASHINGTON DC), 1995.###-AAC050-6147TAKAYA, Yoshikazu (1987) : Agricultural Development of a Tropical Delta: A Study of the Chao Phraya Delta, University of Hawaii Press (HONOLULU), 1987.###-AAC050-6147TANDILLE, Claire; POIRIER, Bernard (2010) : Les champs urbains du SCoT du Pays de Rennes, in Terri-toires 2040, n°2, DATAR, 2010, p149.###-AAC050-6133TATI, Jacques, 1967 : Playtime, film, FRANCE, 126'.###-AAC050-6159THEYS, Jacques (2000) : « La confusion des (bons) sentiments », in Développement durable, villes et territoires, Innover et décloisonner pour anticiper les ruptures, Note du CPVS, n° 13, DRAST, Ministère de l'Équipement des Transports et du Logement, 135 p.###-AAC050-6117URBAIN TROP URBAIN (2012) : http://www.urbain-trop-urbain.fr###-AAC050-6173VANIER, Martin (2008) : Le pouvoir des territoires, PARIS, Economica-Anthropos, 160 p.###-AAC050-6117VAYSSIERE, Bruno (1988) : Reconstruction-déconstruction. Le hard french ou l’architecture des trente glorieuses , PARIS, Picard, 1988, 327 p.###-AAC050-6117VENTURI, Robert (1966) : Complexity and Contradiction in Architecture, New York, Editions Doubleday.###-AAC050-6123VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, 1968 : A signifiance for A&P parking lots or learning from Las Vegas, in Architectural Forum 128 no.2, pp36,43.###-AAC050-6123VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, 1977 : L’enseignement de Las Vegas, ou le symbolisme oublié
AAC050-6188
de la forme architecturale, MITpress, Cambridge.###-AAC050-6118VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, 1977 : L’enseignement de Las Vegas, ou le symbolisme oublié de la forme architecturale, MITpress, Cambridge.###-AAC050-6120VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denise, 1977 : L’enseignement de Las Vegas, ou le symbolisme oublié de la forme architecturale, MITpress, Cambridge.###-AAC050-6123VILJOEN, Andre (1999) : CPULs Continuous Productive Urban Landscapes (CPULs): Designing Urban Agriculture for Sustainable Cities, Architectural Press (LONDON), 2005; ###-AAC050-6147VINEGAR, Aron; GOLEC, Michael (2009) : Relearning from Las Vegas, Minneapolis & London, Univer-sity of Minnesota Press.###-AAC050-6123VIRILIO, Paul, 1977 : Vitesse et Politique, Editions GALILÉE, 151p.###-AAC050-6179VIRILIO, Paul (2010) : L’administration de la peur, Editions Textuel.###-AAC050-6151WIGGLESWORTH, Sarah (2002) : "Cuisine and architecture: A recipe for a wholesome diet", in Karen FRANCK (ed), "Food + Architecture", 4 Vol 72, No 6, Nov/Dec 2002, p 102.###-AAC050-6147WINICHAKUL, Thongchai; MAPPED, Siam (1997) : A History of the Geo- Body of a Nation, University of Hawaii Press (HONOLULU), 1997.###-AAC050-6147WRIGHT , Frank Lloyd (1970) : The Living City, Meridian Books, 1970.###-AAC050-6147ZUKIN, Sharon (1991) : Landscapes of Power: From Detroit to Disney World, University of California Press (BERKELEY, CA), 1991, p 268.###-AAC050-6147ZWEITE, Armin (2004) : Bernd et Hilla Becher, catalogue d'exposition (du 20 octobre 2004 au 3 janvier 2005), PARIS, Centre Pompidou, 93 p., ill.###-AAC050-6167
AAC050-6189