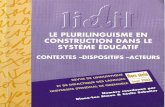2015 : La parure prédynastique en contexte funéraire : technique et usage. Le cas d'Adaïma....
Transcript of 2015 : La parure prédynastique en contexte funéraire : technique et usage. Le cas d'Adaïma....
Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales
Thèsepour obtenir le grade de Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
Discipline : Archéologie
Présentée par Mathilde Minottile 9 janvier 2015
La parure prédynastique en contexte funéraire : technique et usage
Le cas d’Adaïma
Volume I
Sous la direction de Béatrix Midant-Reynes
Jury
Beyries Sylvie, Directrice de recherche CNRS CEPAM - UMR 7264 (Nice) Rapporteur
Hendrickx Stan, Professeur, MAD university Leuven (Belgique) Rapporteur
Crubézy Éric, Professeur, Université Paul Sabatier (Toulouse) Président du jury
Midant-Reynes Béatrix, Directrice de recherche CNRS UMR 5608 (Toulouse) Directrice
Boissinot Philippe, Maître de conférences EHESS (Toulouse) Examinateur
Bonnardin Sandrine, Maître de conférences, Université de Sophia-Antepolis (Nice) Examinateur
Toulouse 2015
Je dédie ce travail à Jean Louat,
professeur des écoles,
pour m’avoir donné les moyens et l’énergie de persévérer dans les études.
. Sommaire
. Remerciements 11
. Introduction 15
Chapitre 1 : Contexte, Méthode, outils 21
. Chapitre 1 — Introduction 231-1. Le cadre de l’étude et problématique 241-2. Méthode d’analyse multiscalaire : de la tombe au stigmate 371-3. Outils : l’enregistrement et les catalogues d’études 71
Chapitre 2 :De la matière première aux grains d’enfilage 93
. Chapitre 2 — Introduction 952-1. Confectionner des grains d’enfilage 962-2. Les matières dures animales 1042-3. Les matériaux lithiques 1382-4. Les Matériaux artificiels 1702-5. Synthèse et discussion : des territoires d’acquisition aux objectifs de fabrication 194
Chapitre 3 : Constituer des parures 219
. Chapitre 3 — Introduction 2213-1. Les parures massives 2223-2. Les parures simples 2333-3. Les parures composées 2443-4. Les perles « non-définies » 2893-5. Synthèse et discussion : les traditions ornementales 298
Chapitre 4 : Le rôle des parures dans les pratiques funéraires 333
. Chapitre 4 — introduction 3354-1. Cadre interprétatif 3374-2. Les inhumations dans l’habitat et dans la nécropole Ouest 3534-3. Les inhumations dans la nécropole Est 359
4-4. Synthèse et discussion : De la diversité des pratiques aux fonctions des parures 400
Synthèse : l’apport du mobilier de parure à la construction d’un discours sur les sociétés passées 425
5-1. Introspection, qu’étudions-nous ? 4275-2. Le cas d’Adaïma 4325-3. Conclusion 447. Bibliographie 451 Table des figures 473 Tavle des tableaux 481 Table des matières 485
11
Remerciements
. Remerciements
En premier lieu, je tiens à remercier Béatrix Midant-Reynes, directrice de recherche au CNRS et directrice de l’Institut Français d’Archéologie Oriental du Caire (IFAO) pour avoir proposé et accepté d’encadrer cette thèse qui fait suite à un master 2 déjà sous sa tutelle.
J’adresse mes sincères remerciements aux rapporteurs et membres du jury pour avoir pris le temps de lire et de juger ce travail.
Le présent travail a été effectué sous la tutelle de L’École de Hautes Études en Sciences So-ciales au sein de l’UMR TRACES et de l’équipe du PRBM, et je tiens à remercier tous les membres de l’équipe qui m’ont soutenue et suivie durant ces années.
Plus spécifiquement, je tiens à exprimer ma gratitude à I. Carrère, pour ses relectures et ses conseils réguliers ; à T. Perrin, pour ses conseils en statistiques et pour m’avoir suggéré l’utilisation du logiciel R. J’exprime également ma reconnaissance à J. Coularou, F. Durand, V. Ard, G. Bréand, M.-H. Dias-Merinos et F. Briois, pour avoir partagé leur espace de travail ces derniers mois, et à tous les collègues-doctorants pour avoir partagé des moments de pauses salvatrices.
Ce travail n’aurait pas été possible sans les travaux de l’équipe qui a fouillé le site d’Adaïma sous la direction de B. Midant-Reynes. Il va sans dire que l’archéologie est un travail d’équipe et j’exprime donc ma gratitude à toutes les personnes qui ont participé aux fouilles archéologiques sur ce site pour avoir mis à ma disposition des données issues de leurs travaux respectifs. Je tiens à remercier plus particulièrement Nathalie Baduel et Christine Hochstrasser-Petit pour leur travaille sur le mobilier de parure.
Je tiens ici à exprimer ma reconnaissance à N. Buchez et S. Duchesne pour leurs relectures et corrections, pour m’avoir aiguillée dans les données de fouilles. Je tiens également à remercier H. Dabernat pour son aide et les quelques échanges que nous avons pu avoir à propos des jeunes inhumés d’Adaïma, et W. Van Neer et V. Linseele pour leur aide dans la détermination des espèces de coquillages et les précisions sur les espèces animales.
Mes études de mobilier en Égypte ont été possibles avec l’aide de l’Institut Français d’Archéo-logie Oriental au Caire, qui a offert son aide logistique et attribué deux bourses d’études d’un mois. Merci à R. Malek pour son aide précieuse et sa disponibilité. Je tiens également à exprimer ma gra-titude au regretté M. Wutmann pour son aide et le prêt de matériel optique.
Le Centre Franco Égyptiens d’Étude des Temples de Karnak (CFEETK) sous la direction de C. Thiers m’a accueillie lors de ces deux missions. Je tiens à remercier tout particulièrement Véro-nique pour son accueil, sa gentillesse et sa disponibilité.
12
Avant-propos
I would like to thanks the Council Supreme of Antiquities (CSA) which allowed me study arti-facts in Abou Said, especially Adel Satar Director of the store-office in Abou Said for his help and his cordial welcome, and Hamdy Hamda Director of sites security for CSA in Luxor region for his help for the administrative formalities.
Il m’importe de remercier les différentes personnes et institutions qui m’ont permis de me former en tracéologie :
• Lors du stage Stigos (en 2009) à l’université du Mirail à Toulouse avec A. Averbouh, M. Chris-tensen, J.-M. Petillon et B. Marquebielle.• Lors du stage Traceos à l’université de la Sorbonne (en 2010) à Paris, avec Y. Maigrot et M. Christensen.• Et finalement lors du stage de Tracaologie au CEPAM à Nice (en 2011) organisé par S. Beyries.
Je souhaite exprimer ma gratitude pour leurs aides et leurs expertises :• Au professeur J. Harell pour les informations fournies sur la « cornaline » égyptienne.• À D. Bar-Yosef Mayer pour son aide dans les déterminations des coquillages marins.
Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui se sont attachées à traquer les fautes d’orthographe et les problèmes de syntaxe dans ce manuscrit : merci à P.-J. Rey, V. Rousseau, E. Ryon, ainsi que pour les relecteurs occasionnels sur des points plus spécifiques M.-H. Dias-Me-rinos, G. Granier, S. Philibert et F. Briois, G. Breand.
J’exprime ma gratitude aux différentes entreprises d’archéologie qui m’ont permis par des contrats de financer ce travail, et merci à l’ami Pôle qui a financé les intermèdes.
Dans un registre moins scientifique, je tiens également à remercier mes amis et ma famille qui m’ont suivie et soutenue ces dernières années.
Un grand merci à Pierre-Jérôme Rey pour m’avoir mis le pied à l’étrier de la préhistoire et pour son amitié sincère.
Aux Lyonnais qui depuis sont éparpillés, mais toujours présents : Chacha, Steph, Emma, Gaelle, Éliane, la bande du 27…
À Jérôme qui m’a toujours accueillie lors de mes recherches et travaux dans la région pari-sienne, et pour nos discussions philosophiques pas toujours sobres, mais toujours enrichissantes.
Aux Toulousains, collègues archéologues : Cécile, Benoit, Pierre, Noémie, Manu, Alex, Steph, Guillaume et tous les autres croisés sur les chantiers de fouilles préventives, étudiants, thésards, et doctorants de l’EHESS et du Mirail : Gaëlle Bréand, Tiphaine Dachy, Marie-Hélene Dias-Merinos, Delphine Bousquet, Frédérique Durand… et tous les autres.
13
Remerciements
À ma sœur de cœur depuis plus de 25 ans, Houekessi, pour ta présence, nos entrevues, tes conseils pragmatiques, merci d’avoir toujours ouverte ta porte (parisienne) pour mes passages éclairs entre deux avions.
À tous les colocataires du 47 à Ramonville, plusieurs années de délices dans cette « maison du bonheur », où apéros et barbecues m’ont fait paraître ces années de travaux, mes allées et venues entre ici et ailleurs, comme une fête quotidienne.
À mes voisins d’alors, Mic et Ginny pour leur amitié et leur soutien lors de mes combats avec la langue de Shakespeare, thank you very much.
Aux collègues de Tell el-Iswid et de Douch, pour le bon esprit préservé durant ces mois de mis-sion : Rachid, Bubu, Béa, Chouchou, Loulou, Sam, Julien, Doudou, Jérôme, Kiki, Aline, Jo, Fran-çois, Yann, Titou, Michel, Bertrand, Sylvie, Hassan, Amr, Ali, Mohamed, Ahmed, Reis Mohamed et Rafat, ainsi que toutes les petites mains qu’il serait trop long de nommer ici, je vous remercie.
La thèse est une aventure, une aventure personnelle dans laquelle on teste à tout moment ses limites et son endurance. Ce travail de doctorat aura été également une aventure humaine, et culturelle. Deux années de suite durant un mois je me suis rendue au « Marsane » du Service des Antiquités Egyptiennes (CSA) dans lequel est conservée la collection d’Adaïma. Ce magasin se situe à 40 kilomètres environ au sud de Louxor, chaque matin j’ai donc emprunté deux à trois micro-bus locaux pour m’y rendre et le train pour en revenir. Ces trajets, durant ces quelques 40 jours de travail cumulés, ont été l’occasion de regards échangés, interrogateurs, étonnés et parfois de discussions qui m’ont valu au moins une dizaine de demandes en mariage, mais également de découvrir des personnes, une culture aux antipodes de la mienne, majoritairement avec sourire et bonne humeur. C’est pourquoi je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait de cette étude une telle aventure et tous ces inconnus dont les visages et les regards ont parlé d’un pays, d’une culture, de la vie. Je veux croire que la compréhension des sociétés passées passe aussi par l’appré-hension de nos altérités.
Nous sommes tous des conteurs d’histoires dans un genre différent, nous avons une unité et une singularité particulière, psy, conteuse, acteur, artiste, musicien, gestionnaire dans les domaines culturels ou de communautés… Vous savez parler aux autres pour mieux les intégrer dans l’au-jourd’hui et le demain, alors moi qui parle d’hier, je vous remercie d’être ce que vous êtes et suis chanceuse d’avoir été accompagnée tous les jours de ma vie par vous : Mamoune, Papa, Maman, Charlotte, Marion, Florent, Elvire, Emma, Jean-Louis et Véronique, Lolo et Seb, un merci n’est pas suffisant pour vous exprimer tout ce que je vous dois.
Finalement la liste ne serait pas compléte si je ne t’ajoutais pas, merci Thibaut pour ces dépay-sements, ces bouffées d’air frais entre deux semaines de travail, et ton soutien quotidien dans ces derniers mois : Ariège tu m’as pris dans ton piège ...
15
Introduction génèrale
. Introduction
Depuis le Paléolithique, les individus modifient leur apparence par du maquillage, des ta-touages, des scarifications, des bijoux et des vêtements. Des éléments isolés (grains d’enfilage, résidus de pigments, palettes à fard et broyons) retrouvés dans les contextes d’habitat témoignent de leur présence dans la vie quotidienne. De tout temps ces apparats ont accompagné les hommes dans la mort. Des traces de maquillage et de peinture corporelle ont été découvertes sur les corps dans certains contextes de conservation exceptionnels. Ces indices rares relèvent de la cosmétique (Mauss 1967). L’étude menée ici s’attache uniquement aux parures, dans le sens où l’entend Marcel Mauss, comme l’ajout d’artefacts sur les corps (ibid. et Batholeyns 2011). Ces derniers sont discer-nables en archéologie sous la forme d’objets en matériaux non périssables comportant des moyens de suspension et ils peuvent être associés ou isolés.
La période prédynastique se déroule sur plus d’un millénaire (3900-2685 avant notre ère) du-rant lequel les sociétés villageoises néolithiques vont se transformer progressivement pour aboutir à l’une des premières civilisations étatiques. L’Égypte, située au carrefour de l’Afrique et de l’Orient, est riche d’éléments culturels d’où sont nées des représentations cosmogoniques et idéologiques aux origines de la société pharaonique. Durant ce IVe millénaire, témoin de mutations profondes, nous nous intéresserons au contexte funéraire comme une source d’information particulièrement fertile. En effet, il offre la possibilité de travailler sur des séries « d’ensembles clos » contemporains où des données biologiques et le mobilier caractérisant la culture matérielle sont associés.
Le site prédynastique d’Adaïma situé en Haute Égypte a révélé un secteur d’habitat et deux né-cropoles contenant plusieurs centaines de sépultures. Les nécropoles explorées par des méthodes pluridisciplinaires, associant archéologie et anthropobiologie, présentent un cadre d’étude idéal concernant les ornements en contexte funéraire. Du mobilier de parure a été mis au jour dans 187 sépultures. Chaque tombe a fait l’objet d’une interprétation par des spécialistes permettant de res-tituer les gestes menant aux dépôts. Les parures ont été prélevées in situ, en respectant l’ordre des éléments les composant et en enregistrant précisément leur emplacement sur les corps. Par ailleurs, un article sur le rôle des parures dans les cérémonies funéraires à Adaïma ouvrait de nouvelles pers-pectives quant aux possibilités d’interprétations de ces artefacts (Duchesne et al. 2003). Face à une telle qualité des données, inédites pour la plupart, il fut difficile de ne pas être ambitieux au moment de définir les contours de notre sujet.
La parure corporelle, mobilier archéologique, doit être examinée comme tout artefact (indus-trie lithique, céramique ou industrie osseuse), en fonction de contraintes économiques, techniques et traditionnelles qui déterminent sa création. Ceci étant, elle ne représente pas une nécessité vitale et son caractère superfétatoire en fait toute l’originalité, elle est donc souvent aussi considérée sous un éclairage symbolique. Il semble pourtant que ce soit seulement au prix d’une réinsertion dans un scénario historique et social que l’on pourra démontrer ces aspects proprement symboliques. Hors de son contexte, la parure est dépossédée d’une partie de son signifiant et n’a de valeur qu’esthé-
16
Introduction génèrale
tique pour l’observateur actuel, spectateur d’un bel objet muet. Le contexte funéraire est favorable à une étude archéologique aux visées palethnologiques. Bien que l’on puisse reprocher à l’archéologie préhistorique son ambition à restituer des concepts passés sans disposer du discours des acteurs (Boissinot 2011a et b), peut-elle faire, en tant que science humaine, l’économie de ce niveau analy-tique ? Dès lors, un retour épistémologique apportera un éclairage sur le potentiel informatif réel de la parure en archéologie.
Dans une volonté de travailler sans préjugés, le mobilier (378 parures et 5304 grains d’enfilage) a été abordé au travers d’une méthodologie systémique. Il s’agissait d’abord de caractériser les en-tités en présence par la mise en place d’une typologie à deux niveaux, celui des constituants de la parure (les grains d’enfilage) et celui des parures elles-mêmes (bracelet, collier, ceinture…). Puis des études macro et microscopiques ont été menées pour rendre compte des matières premières et des stigmates techniques et fonctionnels. Finalement, une remise en contexte au sein de chaque sépulture et de l’espace funéraire a permis d’approcher les pratiques funéraires en lien avec ce maté-riel. Pour mener à bien ces étapes, un système d’enregistrement rationalisé a été conçu pour rendre possible la confrontation aux différents niveaux de l’analyse.
En préambule, nous définirons exhaustivement le contexte, les méthodes, les problématiques et les outils utilisés dans ce travail (chapitre 1). Puis nous déroulerons le cycle de vie des parures pour interroger les moyens dédiés à leur confection (chapitre 2), les choix esthétiques (chapitre 3) et leur rôle dans les pratiques funéraires (chapitre 4). À travers ces différentes étapes, nous nous intéresserons plus particulièrement à dégager des règles ou des normes qui pourraient caractériser les fonctions symboliques ou sémiologiques souvent associées de facto aux ornementations cor-porelles par comparaison aux données ethnographiques. Avec l’appui des études pluridisciplinaires déjà effectuées à Adaïma, il est alors possible d’aborder ce que la parure révèle de l’organisation sociale de cette communauté.
Ce premier volume est accompagné de deux volumes substantiels d’annexes :• Le volume II avec l’ensemble des données funéraires et les détails de l’étude des parures ar-chéologiques.• Le volume III - Les expérimentations mises en œuvre pour les approches techno-fonctionnelles
du matériel (cahier des expérimentations) - Les résultats des analyses statistiques appliquées tout au long de ce travail
(cahier des statistiques).