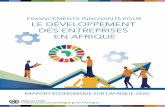La Communauté Andine des Nations, CAN : quelle intégration économique régionale
[2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs
Transcript of [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs
LA SOCIOLOGIE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES ET DESENTREPRENEURS (TRADUCTION D'ASHVEEN PEERBAYE ETPIERRE-PAUL ZALIO) Mark Granovetter ENS Cachan | Terrains & travaux 2003/1 - n° 4pages 167 à 206
ISSN 1627-9506
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2003-1-page-167.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Granovetter Mark, « La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs (traduction d'Ashveen Peerbaye
et Pierre-Paul Zalio) »,
Terrains & travaux, 2003/1 n° 4, p. 167-206.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour ENS Cachan.
© ENS Cachan. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 167
Mark Granovetter
La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs
(traduction d’Ashveen Peerbaye et Pierre-Paul Zalio1) [Texte issu de « The Economic Sociology of Firms and Entrepreneurs ». In: Swedberg (R.) (ed.), Entrepreneurship: A Social Science View, Oxford Management Readers, 2000, pp. 244-275 ; initialement publié dans Portes (A.) (ed.), The Economic Sociology of Immigration, Russel Sage Foundation, New York, 1995, pp. 128-165.]
L’homo economicus et le problème de la confiance dans l’entreprise
Si l’on en croit les économistes néo-institutionnalistes, l’échelle des activités économiques s’ajuste toujours, dans un système donné, au niveau le plus approprié aux types et aux coûts des transactions qu’on y observe. Pourtant les travaux en économie du développement donnent, pour le même problème, un son de cloche différent : dans de nombreux contextes de moindre développement, le niveau observé est trop petit, de sorte qu’il faut rechercher les « obstacles » à l’organisation des entreprises et à leur déploiement à une échelle plus large. Selon la conception traditionnelle de la théorie du développement – pour laquelle l’encastrement des actions économiques dans un ensemble d’obligations non économiques entrave l’expansion économique, – le problème réside dans l’insuffisance du nombre des homines economici, c’est-à-dire des individus dont les motivations sont purement économiques, et par conséquent détachées de toute 1 Avec l’aimable participation, et la vigilante relecture, de Caroline Vincensini. Nous adressons nos remerciements chaleureux à Mark Granovetter, pour avoir autorisé la publication de cette traduction.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
168 — terrains & travaux — n°4 [2003]
forme d’obligation sociale, comme la parenté. Pourtant, les études empiriques des contextes où l’existence de tels individus justifie qu’on applique un modèle d’action sous-socialisée 2 montrent clairement, selon moi, que les problèmes de confiance qui en découlent deviennent primordiaux, et ont un effet négatif sur le développement de l’activité économique.3 Je vais exposer ici une série d’exemples frappants, issus de recherches sur Java4 et les Philippines5, en me penchant sur leur portée théorique. Dewey note à propos de la ville javanaise de « Modjokuto » (ainsi appelée dans son étude, et également étudiée par Geertz) que les relations commerciales se caractérisent par leur non-recoupement avec celles de parenté ou de voisinage, et qu’elles sont de nature presque purement économique.6 Bien que la plupart des commerçants urbains soient d’origine rurale, la densité de population est si élevée que peu d’entre eux ont transposé des relations villageoises dans le contexte urbain. Les contrats sont par conséquent très difficiles à faire respecter, étant donnée l’absence de soutien de la parenté mutuelle, des voisins ou d’autres formes de groupes sociaux.7 À Modjokuto, il y a un déficit de liens durables entre acheteurs et vendeurs. Il en est de même pour les liens entre marchands. Quelques produits, comme les oignons, se prêtent à un commerce de gros, et dans ce cas les marchands javanais se regroupent, mettant en commun capital et travail, pour acheter en grande quantité à meilleur prix. Mais ces groupes ne sont constitués que le temps d’une seule transaction, et se dissolvent ensuite ; qui plus est, chaque marchand est affilié à plusieurs groupes à la fois, pour répartir les risques. 8 Il est difficile de trouver du crédit, notamment parce que l’information sur les risques de crédit est rare
2 Cf. Mark Granovetter, “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness,” American Journal of Sociology 91, no. 3 (novembre 1985): 481-510. 3 Le concept de confiance mérite des développements théoriques plus approfondis, qui ne peuvent être exposés ici faute de place. Voir les pages 38-47 de mes “Problems of Explanation in Economic Sociology,” in N. Nohria et R. Eccles, eds., Networks and Organizations: Structure, Form and Action (Boston: Harvard Business School Press, 1992). 4 Alice Dewey, Peasant Marketing in Java (Glencoe, Ill.: Free Press, 1962); Clifford Geertz, Peddlars and Princes (Chicago: University of Chicago Press, 1963). 5 William G. Davis, Social Relations in a Philippine Market: Self-Interest and Subjectivity (Berkeley: University of California Press, 1973); David L. Szanton, Estancia in Transition: Economic Growth in a Rural Philippine Community (Quezon City, Philippines: Ateneo de Manila University Press, 1971). 6 Dewey, Peasant Marketing, p. 31. 7 Ibid., p. 42. 8 Ibid., p. 88.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 169
et coûteuse dans un contexte aussi atomisé.9 Geertz met quant à lui davantage l’accent sur la fréquence des alliances entre petits commerçants, mais souligne également leur labilité.10 Il montre que ce qui manque à ce type de petits entrepreneurs musulmans « ce n’est pas le capital […] car leurs ressources sont suffisantes ; ce n’est pas la motivation, car ils manifestent, presque à l’excès, les vertus typiquement “protestantes” du sens de l’industrie, de la frugalité, de l’autonomie et de la détermination ; ce n’est certainement pas non plus le marché qui fait défaut. […] Ce qui leur manque, c’est le pouvoir de mobiliser leur capital, de canaliser leurs motivations de façon à exploiter les possibilités du marché. Il leur manque la capacité à constituer des institutions économiques efficaces : ce sont des entrepreneurs sans entreprises. »11 L’individualisme forcené qui caractérise les marchands de l’économie de bazar de Modjokuto ouvre certes la voie à des tentatives entrepreneuriales, mais « limite très fortement leur capacité à se développer, en restreignant les possibilités réelles d’organisation collective. Les entreprises de Modjokuto semblent croître puis marquer le pas ; maintenir l’allure supposerait d’élargir la base sociale de l’entreprise au-delà des connexions de la famille immédiate, auxquelles elles sont circonscrites faute de confiance, laquelle est l’inverse de l’individualisme. »12 Dans l’économie de bazar étudiée par Geertz au Maroc, les relations entre acheteurs et vendeurs sont, en comparaison, des relations de long terme, même si la coopération entre vendeurs reste minime. Corrélativement, l’intégration verticale entre marchands et artisans est absente : il n’existe pas d’entreprise intégrant production artisanale et commercialisation, ni de connexion durable entre les deux ; les artisans cherchent plutôt au contraire à éviter de telles connexions par crainte de la dépendance qui pourrait en découler. Il en est ainsi malgré une très nette division des tâches : les artisans ne mettent presque jamais eux-mêmes leur produit sur le marché, mais vendent plutôt à des grossistes ou à des détaillants.13 Même les
9 Ibid., p. 92. 10 Geertz, Peddlers, p. 40. 11 Ibid., p. 28. 12 Ibid., p. 126. 13 Clifford Geertz, “Suq: The Bazaar Economy in Sefrou,” in C. Geertz, H. Geertz, et L. Rosen, eds., Meaning and Order in Moroccan Society (New York: Cambridge University Press, 1979), pp. 183-185.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
170 — terrains & travaux — n°4 [2003]
ateliers où un groupe d’artisans travaille ensemble sont conçus comme un assemblage d’arrangements dyadiques.14 Aux Philippines, le cas de la ville d’Estancia illustre le fait qu’une configuration empiriquement très similaire à celle mise en évidence à Modjokuto ou au Maroc peut émerger dans un contexte culturel et une structuration sociale fort différents.15 Comme à Modjokuto, il y a des achats groupés, là aussi ce sont des arrangements variables et temporaires. À Estancia, en dépit d’une croissance économique rapide tirée par l’industrie de la pêche, les petites entreprises familiales n’ont pas cédé la place à de plus grandes sociétés. Même dans les plus grandes entreprises, tout le monde est sous la dépendance totale du propriétaire, et le destin de l’entreprise est étroitement lié au sien. Pourquoi ? À Estancia, un des
obstacles les plus puissants et évidents aux activités des sociétés est une défiance généralisée vis-à-vis des autres, alimentée par les innombrables récits d’arnaques qui circulent. Au sein même de la famille nucléaire, dès qu’il s’agit de parler affaires, la confiance entre les personnes est souvent limitée. Chacun part du principe que les autres ne cherchent avant tout que leur propre bien-être ou des bénéfices à court terme, et se contenteront de profiter d’une situation de confiance pour en tirer avantage dès que possible. […] Les dirigeants de grandes organisations – économiques ou autres – sont toujours soupçonnés d’user de leur position, des personnels ou des ressources de l’institution pour leur propre usage, et c’est en effet souvent le cas. Ceci justifie des actions du même type de la part du petit personnel. On s’attend tellement à ce que les autres ne travaillent que pour leur intérêt propre que même des associations entre parents ou amis ne durent jamais plus de quelques semaines ou quelques mois. […] Les groupes qui vont au-delà d’une simple association sont évidemment d’autant plus fragiles. Étant donnée cette atmosphère de défiance, les accusations les plus anecdotiques et les moins fondées sont souvent prises pour argent comptant.16
14 Ibid., p. 191. 15 D. Szanton, Estancia. 16 Ibid., p. 51.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 171
Voilà qui rappelle la défiance observée à Modjokuto. Mais contrairement aux marchands musulmans très individualistes, les habitants d’Estancia sont majoritairement catholiques, vivent dans une petite ville où des réseaux élaborés de relations non économiques recouvrent les relations économiques, et où existent des liens personnels bien établis entre clients et commerçants, et entre ces derniers. 17 Il y a, chez les commerçants d’Estancia, une morale gouvernant l’économie ; c’est donc un contexte où, au moins au sein d’un groupe local bien défini, les gens ont un sentiment de responsabilité les uns envers les autres.18 Cependant, en considérant plus largement la culture et la structure sociale, on voit que malgré ce sens aigu du « droit de survie », et malgré un réseau élaboré de liens horizontaux, un sens marqué de la concurrence entre individus se manifeste au même niveau hiérarchique. À Modjokuto, une concurrence similaire provient de l’absence de connexions sociales. À Estancia, elle semble au contraire émerger d’une structure sociale densément connectée, marquée par des relations hiérarchiques verticales entre patrons et clients. Ce système caractéristique des plaines philippines, hérité des relations entre propriétaires terriens et fermiers, a perduré, avec désormais au sommet les hommes politiques locaux. Sur un plan culturel, Szanton affirme que dans un tel système, où les différences de statut sont nettes et les obligations mutuelles comprises de tous, les interactions sont policées. Pourtant, parmi les « gens relativement pauvres, qu’ils soient fermiers ou simples ouvriers, les liens horizontaux entre personnes de statut égal ont une valeur limitée à la fois parce qu’ils disposent généralement de peu de ressources à offrir, et surtout parce qu’ils sont souvent en concurrence entre eux pour obtenir l’appui et le soutien financier d’une même personne de statut plus élevé. […] La société traditionnelle aux Philippines n’est pas caractérisée par une solidarité horizontale. » 19 En période de crise, ce sont les liens 17 Voir Maria C. B. Szanton, A Right to Survive: Subsistence Marketing in a Lowland Philippine Town (University Park, Penn.: Penn State University Press, 1972). 18 Le concept d’ « économie morale » est utilisé dans cet article au sens introduit par E. P. Thompson dans son essai séminal sur l’action collective en Angleterre au dix-huitième siècle, “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century”, Past and Present 50 (février 1971): 76-131. Il sert à décrire un contexte où il existe un large consensus au sein d’une population sur le fait que les processus économiques, pour être légitimes, doivent répondre à certaines exigences morales. Il s’agit là d’un cas particulier du postulat de « l’action économique socialement orientée » que propose Alejandro Portes, 1995, “Economic Sociology and the Sociology of Immigration”, in Portes, A. (ed.), The Economic Sociology of Immigration, New York: Russell Sage Foundation. 19 D. Szanton, Estancia, p. 87.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
172 — terrains & travaux — n°4 [2003]
verticaux qui font la différence. Schématiquement, au sein de la hiérarchie sociale, les biens économiques circulent de haut en bas, alors que la loyauté politique circule de bas en haut. Ainsi, « les solidarités, clivages et oppositions les plus significatifs dans la pyramide sociale tendent à être verticaux (liés à des factions) plutôt qu’horizontaux (et idéologiques) comme dans les sociétés structurées en classes. »20 À ce stade, nous pouvons voir que les systèmes sociaux marqués par l’absence de solidarité horizontale – laquelle peut se manifester de diverses façons – le sont aussi par l’absence de confiance nécessaire à la constitution d’entreprises dépassant le cadre individuel ou familial. Le contraste entre les cas philippin et javanais illustre le fait qu’un manque de confiance entre individus ne résulte pas nécessairement d’une structure sociale atomisée, mais peut tout aussi bien advenir dans le cas d’une structure densément connectée, à cause des caractéristiques particulières de ses connexions. Doit-on en déduire qu’un haut niveau de solidarité horizontale est la condition nécessaire au développement économique ? Ce serait à l’opposé des résultats de la théorie traditionnelle du développement, et il est rare que les théories, même les moins vérifiées, ouvrent la voie à leur exact opposé. Voyons le récit de Geertz sur les activités économiques dans une petite ville balinaise (12 000 habitants). 21 Bien que Tabanan soit, comme Modjokuto, sous administration indonésienne, et que les deux villes ne soient pas très éloignées géographiquement, elles sont à des années-lumière sur le plan de la culture et de la structure sociale. Il y a encore peu, Tabanan était dirigée par des princes et des aristocrates qui, bien que dénués de pouvoir sous le nouveau régime, sont toujours impliqués dans « un réseau complexe de liens objectifs et spécifiques les reliant à la fois entre eux et à l’ensemble de leurs anciens sujets. »22 Ceci a une grande importance, puisqu’à Tabanan la classe d’entrepreneurs a émergé presque entièrement de ce groupe d’anciens dirigeants. 20 Ibid., pages 89 et suivantes. Les études sur une telle configuration sont largement répandues dans le cas des pays méditerranéens, mais elle existe aussi dans diverses régions du monde, comme les Pays-Bas ou la Thaïlande, où Hanks se réfère aux factions sous le terme d’ « entourages ». Cf. L. M. Hanks, “The Corporation and the Entourage: A Comparison of Thai and American Social Organization,” in S. Schmidt, L. Guasi, C. Lande, et J. Scott, eds., Friends, Followers and Factions (Berkeley: University of California Press, 1977), pp. 161-167. 21 Geertz, Peddlers. 22 Ibid., p. 83.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 173
On observe ici la même force des solidarités verticales que dans les plaines des Philippines. Mais Bali se distingue par la force conjointe des solidarités horizontales. La structure sociale balinaise se caractérise par des groupes sociaux appelés seka, formés sur des bases religieuses, politiques, économiques ou autres. « Tout balinais relève de plusieurs de ces groupes, dont le nombre peut varier de trois ou quatre à une douzaine ; la loyauté à la seka, qui fait passer les intérêts du groupe avant ceux des individus, est, avec la fierté de caste, une valeur centrale de la vie sociale balinaise. Cette configuration en seka confère à la structure sociale des villages balinais une forme assez étrange, à la fois fortement collective mais aussi complexe et souple. Les Balinais font presque tout, y compris les activités les plus simples, en groupes qui […] mobilisent presque toujours beaucoup plus de personnes que matériellement nécessaire. »23 Étant donnée la centralité de ces groupes, « presque toute la vie économique balinaise passe par l’une ou l’autre de ces seka, et l’activité strictement individuelle y est plutôt l’exception. »24 Il semblerait donc que les problèmes de Modjokuto et d’Estancia soient résolus avec élégance à Tabanan. Les entrepreneurs y sont, aux yeux de tous, des personnages éminents. Ce sont des aristocrates, qui à ce titre « disposent d’un capital culturel important sous forme de loyauté et d’attentes traditionnelles qui font totalement défaut aux boutiquiers de Modjokuto, ces derniers ne devant leur réussite qu’à eux-mêmes. »25 Si on y ajoute la solidarité horizontale propre à la culture balinaise, comment les entreprises pourraient-elles échouer ? Et, de fait, les entreprises émergent spontanément à Tabanan et se développent même jusqu’à un certain point. Mais il y a une ombre au tableau, justement relevée par les théories du développement : les firmes ancrées dans des obligations non économiques de loyauté « ont tendance à se comporter de manière non économique, du fait de la pression des membres – qui le plus souvent ne se soucient pas de la croissance de l’entreprise – pour obtenir d’elle une “protection sociale”. Cela se traduit non seulement par une forte pression en faveur de la redistribution du profit au détriment de son réinvestissement, mais aussi par une
23 Ibid., p. 84. 24 Ibid., p. 85. 25 Ibid., p. 106.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
174 — terrains & travaux — n°4 [2003]
tendance de la direction à employer pléthore de salariés pour apaiser les ouvriers de la base. L’ancien roi de Tabanan, qui dirige en personne un hôtel, me confiait avec une certaine perspicacité que “le problème avec les entreprises privées balinaises, c’est qu’elles finissent par devenir des centres d’aide sociale.” » 26 Une forme d’économie morale s’oppose ici à la rationalisation des firmes si celle-ci paraît se faire aux dépens de la communauté. Les gens ordinaires comme les nobles attendent et exigent des décisions économiques qu’elles « visent à améliorer le bien-être de l’ensemble de la communauté et pas seulement à enrichir une classe managériale émergente poursuivant ses propres intérêts. »27 Ainsi, tandis que les entreprises de Modjokuto ne parviennent pas à se développer jusqu’au niveau économique optimal, celles de Tabanan ont tendance à croître au-delà de ce niveau à cause de leurs engagements non économiques. Tout ce qui précède pose la question de savoir pourquoi un système fortement hiérarchisé, mais aux solidarités horizontales faibles, comme aux Philippines, n’utilise pas ces liens verticaux pour bâtir des entreprises rationalisables, puisque la pression pour en faire des centres sociaux y est moins forte que dans le système balinais. Et les faits montrent qu’il y a de réelles possibilités en ce sens à Estancia. Szanton signale que le modèle philippin de relations verticales a été mis en œuvre dans toutes les entreprises. Ainsi, dans les pêcheries, le propriétaire « était investi du rôle de patron et d’homme politique responsable du sort de son personnel et de leurs familles. Les salariés étaient structurellement équivalents aux fermiers et apportaient un soutien politique à leurs patrons. » 28 Mais étant donné le manque de solidarité horizontale, une telle configuration fonctionne mieux dans une entreprise de pêche, où le niveau requis de coopération horizontale et la complexité des tâches sont faibles, que pour une activité exigeant une division du travail plus élevée, et qui requiert coopération et confiance plutôt que de la compétition pour obtenir les faveurs du patron. Ce point constitue déjà en soi une sérieuse limitation.
26 Ibid., p. 123. 27 Ibid., p. 125. 28 D. Szanton, Estancia, p. 89.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 175
Or il peut arriver de surcroît que même de telles pêcheries soient plus vulnérables qu’elles n’en ont l’air. Szanton indique qu’une telle configuration fonctionnait bien avant la Deuxième Guerre mondiale, mais que depuis le sens des obligations mutuelles a décliné entre propriétaires et salariés, les premiers se sentant moins responsables, et bénéficiant par conséquent moins des soutiens politiques, ou d’une autre nature, de la part de leurs salariés. Cette situation découle de l’accroissement de la part des pêcheurs jeunes migrants et sans famille. Le système clientéliste, comme tout système d’économie morale vertical, est toujours hautement personnalisé et localisé. Il est plus facile pour les patrons de décliner leurs responsabilités traditionnelles vis-à-vis de jeunes nouveaux venus célibataires que vis-à-vis de personnes connues et disposant de longue date d’un ancrage familial local. Bien qu’il n’y ait pas de données systématiques de longue période sur les causes de ce phénomène, il ressort du récit de Szanton29 qu’un processus de délitement s’est mis en place : après la guerre, les coûts des propriétaires ont commencé à s’accroître, notamment le coût des investissements. Cela les a conduit à réduire le partage des profits opéré auparavant. La dégradation de la situation des salariés a conduit au départ de ceux qui étaient ancrés familialement, et à l’entrée de jeunes nouveaux venus ayant peu conscience des obligations, et moins soucieux des aides qu’ils pouvaient espérer en cas de coup dur que de la maximisation de leur revenu personnel. Mais ces changements dans les attitudes des salariés, et par conséquent dans leurs pratiques – par exemple, la vente en mer d’une partie de la pêche à l’insu du patron – ont encore accru la pression sur l’économie morale patronale, ce qui a ensuite approfondi la recomposition des équipes, par un processus de rétroactions mutuelles. Tout ceci prouve que la configuration d’origine n’était stable que tant que les personnes impliquées restaient ancrées localement. Cependant, lorsqu’un certain nombre de forces provoqua cette arrivée de nouveaux travailleurs, extérieurs aux arrangements locaux initiaux, le système s’effondra. Il ne pouvait se maintenir qu’avec une idéologie proche de celle de l’ « économique morale ».
29 Ibid., pp. 89-91.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
176 — terrains & travaux — n°4 [2003]
Les clés du succès de l’entreprise : le cas des tontines
Jusqu’à présent, nous avons vu que la création d’une entreprise, que ce soit par des individus ou des groupes, se heurte soit à l’insuffisance de la solidarité interne, génératrice d’un déficit de confiance, soit aux effets d’une solidarité débridée, qui fait peser des obligations non économiques excessives sur l’entreprise. À quelles conditions ces deux écueils symétriques peuvent-ils être évités ? L’étude d’une institution informelle de financement, mondialement couronnée de succès – la tontine (association rotative de crédit) – offre une première piste d’approfondissement de ces questions. Dans les pays développés comme dans ceux en voie de développement, les petites entreprises à leurs débuts peinent toujours à obtenir des financements auprès d’institutions formelles comme les banques. Ces dernières ont en effet du mal à évaluer les risques de tels engagements et, étant donnée la modestie des entreprises, jugent peu rentable d’investir dans l’acquisition d’une telle information. On observe donc fréquemment le recours aux parents et amis pour lever des fonds. Cependant, les sommes qui peuvent ainsi être rassemblées sont toujours modiques, ce qui explique l’avantage comparatif de la tontine. Ces tontines sont largement répandues dans le monde, et ont été particulièrement étudiées au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Inde, en Afrique de l’Ouest et aux Caraïbes. Le phénomène connaît bien des variations, mais comme l’indique Geertz :
Le principe de base de la tontine reste partout le même : chaque participant verse une cotisation d’un montant forfaitaire à un fonds commun, qui est distribué à tour de rôle et dans son intégralité à chaque membre de l’association, et ce à intervalles réguliers. Ainsi, si l’association compte dix membres, si elle se réunit sur une base hebdomadaire, et si la contribution hebdomadaire de chaque membre est d’un dollar, alors chaque semaine sur une période de dix semaines un membre différent recevra une somme de dix dollars. […] Si des paiements d’intérêt sont pris en compte […] on perd la
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 177
simplicité numérique, mais le principe essentiel d’un accès cyclique à un fonds reconstitué en permanence reste intact. Que la somme soit en nature ou en espèces ; que l’ordre dans lequel les membres la reçoivent soit fixé par tirage au sort, par convention ou par enchères ; que l’association perdure quelques semaines ou plusieurs années ; que les montants en jeu soient minimes ou assez conséquents ; que les participants soient nombreux ou pas ; et que l’association soit composée de négociants urbains ou de paysans ruraux, d’hommes ou de femmes, la structure générale de l’institution demeure constante.30
À partir d’une telle description, il apparaît clairement que la tontine est un système d’épargne et de crédit. Comparée à l’épargne domestique individuelle, elle a le mérite macroéconomique de toujours maintenir l’argent en circulation. Par rapport aux systèmes où un individu désigné joue le rôle de banque, et garde les dépôts des autres, elle présente l’avantage de redistribuer périodiquement les fonds aux membres, sans possibilité de détournement.31 Se déroulant souvent chez un des membres, lesquels sont normalement liés socialement les uns aux autres d’une manière ou d’une autre, chaque réunion a toutes les caractéristiques d’un événement social valorisant. Elle est donc chargée d’une dimension personnelle et collective qui densifie les liens sociaux, et fournit des incitations supplémentaires à participer. Contrairement à la plupart des situations où contracter un prêt revient à s’abaisser dans une supplication avilissante, dans une tontine, « le récipiendaire, loin de souffrir d’une perte de dignité, est souvent le membre d’honneur ou l’hôte d’une fête ou d’une autre forme de réjouissance. »32 Ardener remarque que le succès d’un tel arrangement repose sur le respect par tous de leurs obligations, mais suggère que
la pression du groupe sur les membres peut y suffire. Il est intéressant de noter la très grande valeur accordée à ces obligations dans certaines communautés. […] Le membre
30 Clifford Geertz, “The Rotating Credit Association: A ‘Middle-Rung’ in Development,” Economic Development and Cultural Change 10, no. 3 (1962): 243. 31 Shirley Ardener, “The Comparative Study of Rotating Credit Associations,” Journal of the Royal Anthropological Institute 94, Part 2 (1963): 217. 32 Ibid., p. 221.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
178 — terrains & travaux — n°4 [2003]
d’une tontine qui faillit à ses obligations peut en pâtir au point de se voir refuser l’adhésion dans une autre. Dans certaines communautés, la tontine fait à ce point partie intégrante du système économique et social que l’exclusion serait une privation grave. […] Un membre peut en arriver à des extrêmes comme voler […] ou prostituer sa fille […] afin de remplir ses obligations envers l’association ; un échec peut même conduire au suicide.33
Ces pressions sont une belle illustration de ce que Portes nomme « la confiance performative » (enforceable trust) – où les transactions entre membres d’une communauté sont « sous-tendues par la certitude que personne ne fera faux bond au moment du remboursement. »34 Ardener fait aussi ressortir que de telles associations peuvent fonctionner comme des marchés de liquidités, les membres qui n’ont pas encore reçu des fonds pouvant obtenir des prêts auprès de ceux qui en ont déjà reçu.35 Ces dimensions bancaires posent évidemment la question de la place de ces associations par rapport aux banques dans des communautés disposant des deux systèmes. Geertz, à une période où la théorie du développement considérait les institutions impersonnelles comme le mode de fonctionnement économique le plus efficient qui soit, décrivait la tontine comme un « échelon intermédiaire » du développement économique,
parce qu’elle ne peut évidemment soutenir qu’une activité commerciale limitée en envergure et en complexité. […] Dans les contextes économiques plus développés, le poids des éléments traditionnels s’affaiblit et l’accent se déplace vers […] l’organisation bureaucratique. […] En ce sens, la tontine […] tend vers sa propre dissolution, étant remplacée au final par des banques, des coopératives, et d’autres institutions de crédit économiquement plus rationnelles. Cependant ces dernières ne peuvent fonctionner que si des normes spécifiquement économiques ont émergé – lorsque les tribunaux assurent l’exécution des contrats, lorsque les
33 Ibid., p. 216. 34 Portes, op. cit. 35 Ardener, “Comparative Study,” p. 220.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 179
managers s’inquiètent de leur réputation et tiennent des comptes sincères, et lorsque les investisseurs se sentent suffisamment en sécurité pour confier de l’argent à de parfaits inconnus. De tels changements culturels n’adviennent toutefois que progressivement, et aux stades intermédiaires la tontine remplit une fonction appréciable, en façonnant des attitudes économiques traditionnelles et rationnelles propres à favoriser l’émergence d’une telle configuration, et à éviter un enlisement dans l’anomie.36
Ardener relativisa cet argument, faisant valoir que les traits purement économiques ou rationnels ne caractérisent pas forcément les tontines les plus grandes ou les plus sophistiquées, et que même au sein des plus professionnelles, des éléments comme la célébration et la convivialité peuvent compter. Elle note que
Au Vietnam, par exemple, où les associations sont relativement « pros » (avec un enregistrement auprès du gouvernement, la tenue d’une comptabilité, etc.), un banquet est néanmoins de mise et les réunions se doivent d’être « enjouées » et « élégantes ». […] La persistance des tontines dans des communautés disposant de banques et de coopératives, comme en Grande-Bretagne, au Japon ou en Afrique du Sud, et la formation récente d’une association par des employés de banque au Soudan, suggère qu’il y a encore une place pour de telles institutions à côté d’autres institutions de type « plus économiquement rationnel ».37
Même dans des pays comme le Cameroun, où les tontines sont interdites par la loi, elles sont très populaires auprès de pans entiers de la communauté, y compris auprès de ceux qui sont activement impliqués dans des activités bancaires plus formelles. Ces institutions basées sur des relations personnelles persistent donc, on le voit, bien au-delà du point où, selon certains, elles devraient disparaître pour céder la place à des marchés efficients optimaux basés sur des transactions impersonnelles.
36 Geertz, “Rotating Credit,” pp. 262-263. 37 Ardener, “Comparative Study,” p. 222.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
180 — terrains & travaux — n°4 [2003]
Nous remarquons aussi que puisque les tontines rassemblent nombre d’individus qui ne seraient pas d’ordinaire considérés comme solvables par des institutions bancaires formelles – notamment parce que les recherches d’informations requises pour consentir de petits prêts ne seraient pas rentables, – elles assurent efficacement la liquidité d’un segment important du marché du crédit, qui serait autrement incapable de financer l’entreprenariat. C’est pourquoi certaines institutions formelles ont explicitement copié les techniques de la tontine, en créant un nouvel ensemble d’institutions, souvent nommées « crédit de pairs » ou « micro-crédit », dans lesquelles les emprunts sont garantis non pas par des biens mais par un ensemble d’autres individus, réunis par l’emprunteur, qui partagent collectivement la responsabilité de l’emprunt, et ne peuvent en contracter eux-mêmes avant que le prêt initial ne soit en partie remboursé. C’est la Banque Grameen, au Bangladesh, qui a consenti le nombre le plus important de tels prêts, et le phénomène semble faire boule de neige.38 Vue sous cet angle la tontine, loin de constituer un maillon intermédiaire et transitoire, appelé à être remplacé par des institutions plus avancées, apparaît à bien des égards comme plus avancée que les modèles impersonnels habituels en ceci qu’elle utilise du capital social existant39, ce qui est une stratégie bon marché. L’importance de la tontine pour les entrepreneurs des sociétés industrielles développées a été mise en évidence par l’étude qu’Ivan Light consacre à la performance comparée des entrepreneurs noirs, d’origines chinoise et japonaise aux États-Unis.40 Chinois et Japonais (en particulier avant la Deuxième Guerre mondiale), et en une certaine mesure les Noirs antillais, sont tous parvenus à monter de petites affaires en obtenant des financements grâce aux tontines. Mais les Noirs qui migrèrent du sud des États-Unis vers les cités industrielles n’utilisèrent pas de tontine, et eurent grand-peine à réunir des fonds pour monter leurs entreprises. Comment expliquer une telle différence ?
38 Marguerite Holloway et Paul Wallich, “A Risk Worth Taking,” Scientific American 267, no. 5 (novembre 1992): 126. 39 Voir Portes, op. cit. 40 Ivan Light, Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare Among Chinese, Japanese and Blacks (Berkeley: University of California Press, 1972).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 181
Nous savons que les tontines ont besoin pour fonctionner correctement d’un ensemble de membres suffisamment solidaires pour ne pas faillir à leur devoir de contribution régulière. Ceux qui mettent en place de telles organisations doivent détenir suffisamment d’informations sur les membres potentiels pour jauger avec pertinence cette solidarité. Dans les pays où les membres des tontines sont des indigènes, les réseaux locaux de parenté et d’amitié suffisent à garantir cela. Parmi les immigrés, une autre forme de garantie est nécessaire. L’élément clé, nous dit Light, est que les Japonais et les Chinois qui immigrèrent aux États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale n’étaient originaires que de certaines régions de leur pays d’origine. 89% des Japonais provenaient de onze préfectures du sud, et presque tous les Chinois d’un des sept districts de la province du Guangdong, dont la ville principale est Canton (aujourd’hui Guangzhou).41 Les deux groupes érigèrent chacun une structure élaborée d’organisations fondées sur le lieu exact d’émigration. Ces organisations étaient ascriptives (c’est-à-dire que des critères d’origine géographique déterminaient à eux seuls l’adhésion) et il était donc impossible aux différentes organisations de se faire concurrence pour les adhésions, ou qu’il y ait une dissolution de la loyauté à travers des adhésions multiples. D’autre part, les obligations dues les uns envers les autres par les natifs d’une même région avaient pour pendant le fait que ceux issus d’autres régions n’étaient pas disposés à apporter leur aide (pour trouver du travail, par exemple, ou financièrement). En plus de remplir d’autres fonctions, de telles associations devinrent les supports de tontines qui connurent ainsi beaucoup de succès, et offrirent les capitaux nécessaires à l’ouverture de petites affaires et à l’investissement dans l’immobilier. La partie que consacre Light aux Noirs antillais est beaucoup plus brève, mais une configuration similaire apparaît, dans laquelle la région d’origine aux Antilles constituait la base de leur version des tontines, qui furent introduites dans les îles par les esclaves en provenance d’Afrique de l’Ouest. Pour les Noirs américains en revanche, cet arrangement organisationnel avait été effacé de leur « répertoire culturel ».42 Ils
41 Ibid., pp. 62, 81. 42 Ibid., p. 36.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
182 — terrains & travaux — n°4 [2003]
avaient perdu le contact d’avec leurs origines africaines et n’eurent pas l’occasion pendant l’esclavage, contrairement aux Antillais, de monter et de financer leurs propres affaires. Et il était peu probable qu’ils puissent acquérir de telles affaires après l’émancipation. Les migrants noirs qui arrivaient dans les villes du Nord ne se sentaient en outre pas très attachés à leurs origines dans le Sud et, tout comme les migrants blancs, ne disposaient pratiquement pas d’organisations fondées sur ces origines. Light explique cette différence entre l’expérience des Noirs et celle des Asiatiques en suggérant que « la migration internationale est une forme plus drastique de déracinement que la migration inter-état. […] Il n’est donc pas surprenant que ni les migrants blancs, ni les migrants noirs n’aient jugé nécessaire d’ériger des monuments organisationnels à leurs origines. »43 Aussi, alors que Chinois et Japonais éprouvaient de la nostalgie à l’égard de leur pays d’origine, et avaient souvent (en principe du moins) l’intention d’y retourner un jour, les Noirs nés dans le Sud étaient satisfaits de laisser derrière eux leur passé. Ceci ne signifie nullement que les Noirs du Nord n’avaient aucune vie associative. Au contraire, il existait une abondante variété d’associations non lucratives, ce qui pour Light constituait justement le problème : ces organisations ne pouvaient pas compter sur la solidarité morale pour contrôler leurs adhérents, et étaient en concurrence les unes avec les autres pour l’adhésion. De nombreuses associations fraternelles se recoupaient au niveau des adhésions, ce qui faisait disparaître toute emprise que l’une pouvait avoir. Toute affaire fondée au sein d’une de ces organisations devait alors faire face à des obligations non économiques envers des membres appartenant aux autres organisations du réseau associatif. Il était tout simplement impossible de créer de la solidarité morale « dans un contexte d’adhésions multiples à des associations ascriptivement non reliées. »44 La discipline éthique et la solidarité auraient été facilitées si l’adhésion était socialement isolée au sein de la communauté, de manière à ce que les membres soient toujours en compagnie les uns des autres. Les groupes d’Asiatiques pouvaient y parvenir parce qu’il existait entre eux une différence culturelle putative : « Les Cantonais de Tao-shan passaient spontanément leurs heures de veille en compagnie les uns des autres. Cette
43 Ibid., p. 102. 44 Ibid., p. 131.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 183
situation reflétait en partie une préférence […] mais reflétait aussi le fait que les non-Tao-shanais n’étaient pas disposés à s’associer avec des Tao-shanais (et vice versa), d’où la nécessité pour ces derniers de faire bande à part. »45 Ainsi la communauté noire ne parvint pas à générer les solidarités locales nécessaires à la maintenance des institutions comme les tontines, même si ces dernières avaient fait partie de leur répertoire culturel. Au contraire, des organisations vastes et impersonnelles comme la Ligue Urbaine ou la Ligue Nationale des Affaires Noires, composée de membres de l’élite noire, tenta de convertir de pauvres Noirs à l’idée de la petite entreprise ; mais comme les « sections des ligues étaient des associations de bénévoles structurellement isolées et regroupant des riches, elles furent incapables d’atteindre la jeunesse noire des classes inférieures. »46 Au-delà du problème de levée de fonds, les associations de Japonais et de Chinois procuraient des aides de toute sorte aux entreprises ethniques, comme la réglementation de la concurrence et le soutien des prix. Ceci était rendu possible par le fait que, au sein d’une structure clairement organisée, ces groupes ne se recoupaient pas. De telles aides ne pouvaient voir le jour dans la communauté noire. En effet, les seules exceptions à la sous-représentation générale des Noirs dans les affaires se rencontraient lorsque des associations étaient fondées qui parvenaient à créer des solidarités ascriptives. La territorialité ne pouvant être mobilisée en ce sens, la secte religieuse constituait une alternative. Father Divine, chef religieux noir apparu durant la Grande Dépression, sut mobiliser au moins un demi-million de disciples noirs, et dès les années 1950 avait mis en place un vaste réseau de petites entreprises qu’ils possédaient et géraient. Le « secret des miracles de Father Divine tenait à sa capacité particulière à conduire ses membres à la coopération. »47 Mais tout cela reposait sur la croyance, nécessairement fragile, en sa nature divine. Ainsi, quand il mourut en 1965, son « royaume » s’effondra.
45 Ibid., p. 133. 46 Ibid., p. 117. 47 Ibid., p. 148.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
184 — terrains & travaux — n°4 [2003]
L’équilibre entre couplage et découplage :
le cas de la diaspora chinoise Ces considérations sur les tontines montrent que la solidarité nécessaire à l’assemblage cohérent d’activités économiques passe par un ensemble bien défini d’individus se reconnaissant les uns les autres comme membres d’un même collectif, selon l’appartenance ethnique ou plus spécifiquement selon le lieu d’origine. On voit donc qu’une frontière clairement définie, au-delà de laquelle le niveau de confiance et d’intensité des interactions s’effondre, est tout aussi importante que le niveau de cette intensité en-deçà. Une telle frontière est nécessaire pour maintenir la confiance en interne, mais aussi pour restreindre le nombre de personnes ayant un droit de revendication sur l’organisation économique ainsi mise en place. Ceci est particulièrement bien illustré par le cas des Chinois d’Outre-mer, groupe qui a réussi à monter avec succès des entreprises dans le Sud-Est asiatique, ce qui constitue un exploit remarquable et peu fréquent, compte tenu du contexte difficile des Philippines et de l’Indonésie tel que nous l’avons présenté. Empiriquement, ce succès a été bien étudié.48 Il est très tentant de l’expliquer par la culture chinoise, et il est difficile en effet d’ignorer l’importance de la culture des Chinois d’Outre-mer dans le succès de leurs affaires. Mais les modes de compréhension et les pratiques culturelles ne naissent pas d’eux-mêmes. Ils sont façonnés par et en tant que structures d’interaction sociale. Tous les récits s’accordent à dire que les affaires chinoises bénéficient de coûts de fonctionnement beaucoup plus faibles, liés à l’existence de la confiance à l’intérieur de cette communauté. Le crédit est accordé et le capital mis en commun avec l’idée que les engagements seront tenus ; la délégation d’autorité a lieu sans crainte que l’agent poursuive son intérêt propre aux dépens du principal. Les tontines sont simplement un mécanisme efficace utilisé à ces fins. 48 Pour l’Indonésie, voir Dewey, Peasant Marketing, pp. 42-50 et Geertz, Peddlers ; pour les Philippines voir Davis, Social Relations, pp. 198-202 et D. Szanton, Estancia, pp. 97-99.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 185
Pourquoi en est-il ainsi chez les Chinois ? Les Chinois d’Outre-mer constituent des minorités soudées, avec des connexions familiales et organisationnelles étendues, qui façonnent à la fois des activités économiques et non économiques. À Modjokuto par exemple, Dewey rapporte que les familles chinoises s’organisent en bangsa, des groupes basés sur une origine familiale et géographique communes en Chine. « De tels groupes parlent le même dialecte chinois et sont pour la plupart endogames. Les relations entre les groupes sont formalisées à travers différentes sortes d’associations : sociétés funéraires, sportives, associations commerciales, etc. » 49 Les membres d’une bangsa ont tendance à travailler dans le même secteur et à faire des affaires essentiellement entre eux. Au sein de ces groupes, et dans une certaine mesure (que Dewey ne spécifie pas clairement) au sein de la communauté chinoise dans son ensemble, « des liens de parenté et d’appartenance simultanée à différents types d’association renforcent, et sont renforcés par, des relations commerciales, de sorte qu’une série de communautés étroitement soudées voit le jour, avec des connexions partout dans Java et souvent au-delà. »50 En constituant de telles structures, les Chinois locaux mobilisent la culture chinoise traditionnelle comme une « boîte à outils »51 : « Les vieux modèles chinois de la famille, la société secrète et l’association sont utilisés comme un moyen d’étendre les relations commerciales au-delà de la famille nucléaire et du groupe local. »52 Dans cette communauté soudée et intégrée, les normes de comportement sont clairement objectivées et internalisées ; la déviance ne saurait y être dissimulée et elle est promptement réprimée. Étant donné l’avantage qu’il y a à traiter à l’intérieur de la communauté d’affaires fermée que constitue la bangsa, il est très pénalisant de devoir faire des affaires en dehors de ce cadre. Cependant cette structure sociale chinoise qui facilite les relations d’affaires ressemble étrangement à celle des Balinais, décrite par Geertz53 , dans laquelle le fonctionnement efficace des affaires se heurte à la multiplicité des revendications de parents et d’amis sur
49 Dewey, Peasant Marketing, pp. 44-45. 50 Ibid., p. 45. 51 Ann Swidler, “Culture in Action: Symbols and Strategies,” American Sociological Review 51, no. 2 (1986): 273-286. 52 Dewey, Peasant Marketing, p. 45. 53 Geertz, Peddlers.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
186 — terrains & travaux — n°4 [2003]
les ressources économiques des entreprises. Les entreprises chinoises ne semblent pourtant pas souffrir de ce problème. L’ancien roi de Tabanan expliquait à Geertz que si l’on va dans une entreprise balinaise, « on trouvera une demi-douzaine de directeurs, un comptable ou deux, quantité de clercs, quelques chauffeurs de camions et une horde (sic) d’employés à moitié désœuvrés ; si l’on va dans une entreprise chinoise de même taille, on trouvera simplement le propriétaire, sa femme et son fils de dix ans, qui pourtant abattent autant de travail, voire plus. »54 Qu’est-ce qui protège les affaires chinoises des revendications excessives des parents et amis ? Dewey suggère à propos de Java que « le fait que les Chinois soient une minorité pourrait avoir son importance. […] Par rapport aux Javanais ils sont une petite communauté (à Modjokuto, ils sont à peu près 1 800 sur un total de 18 000 habitants). Le nombre des personnes susceptibles de faire appel à un traitement de faveur auprès d’un marchand est donc limité par la taille de la communauté, et plus encore par la séparation entre Peranakan (Chinois de Java depuis plusieurs générations) et Totok (immigrants récents), et par la division de ces derniers en bangsa. Cette limitation empêche les revendications de surcharger l’entreprise au point de lui faire perdre toute rentabilité économique. […] [En revanche] pour les Javanais […] l’absence de groupes restreints conduit un marchand à faire face à un nombre illimité de demandes de la part d’autres Javanais. » 55 Les Balinais aussi disposent de groupements bien délimités, comme la seka déjà citée. Mais contrairement aux membres des bangsa chinoises, chaque Balinais – comme les Noirs nord-américains décrits par Light – est habituellement affilié à plusieurs seka 56 , et bien que ces groupements organisent la vie économique, le recoupement des appartenances entre ces groupes fait que si une seka est au cœur d’une affaire, les membres de ce groupe peuvent être soumis aux revendications de membres des autres seka. Davis développe un argument corrélatif à partir de ses observations à Baguio aux Philippines. Cherchant à expliquer pourquoi les marchands chinois ont tellement plus de succès que leurs homologues philippins, il contredit, preuves à l’appui, le lieu
54 Ibid., p. 123. 55 Dewey, Peasant Marketing, p. 46. 56 Geertz, Peddlers, pp. 84-85.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 187
commun selon lequel les commerçants chinois travaillent plus dur et sont plus intelligents en affaires. Il note en revanche que la parenté philippine est bilatérale, de sorte que les groupes de parenté ne sont pas clairement définis. Comme vous héritez d’une parentèle de chacun de vos parents, votre propre groupe de parenté est différent du leur et n’est exactement le même que pour vos frères et sœurs issus du même lit. Dans ce contexte, Omohundro, dans son étude sur la communauté des marchands chinois, observe que « les employés et les fournisseurs se basent pour agir sur l’hypothèse, qui n’est pas infondée, qu’un homme qui a épousé une Philippine est financièrement fragile ou en passe de le devenir, dès que des parents philippins lui feront des réclamations », et ainsi désormais ne lui font plus crédit.57 Les Chinois, en revanche, disposent en affaires de groupes de parenté patrilinéaires – un ensemble bien défini de parents, qui facilite l’action collective, la mobilisation et la gestion des ressources. L’aîné mâle est responsable de ce groupe, alors que dans les groupes philippins équivalents personne n’est chargé de la direction. « Ainsi, les groupes de parenté chinois partagent plusieurs caractéristiques importantes avec les sociétés par actions, la différence principale tenant peut-être au fait que la parenté limite la participation. »58 Les groupes de parenté chinois, mieux définis, tendent non seulement à limiter la généralisation des revendications non économiques sur les entreprises, mais constituent de surcroît une base plus solide pour l’action collective et une structure d’autorité plus efficace. Un informateur chinois disait à Davis que « les membres des familles philippines se battent toujours entre eux, tandis que nous, nous désignons un responsable. »59 Il apparaît donc que la recette du succès de l’activité entrepreneuriale est un savant dosage entre d’une part une cohésion sociale suffisante pour faire appliquer des normes de moralité dans les affaires et créer une atmosphère de confiance, et d’autre part des circonstances qui limitent les revendications non économiques pesant sur une entreprise et freinant sa rationalisation. Les groupes minoritaires, de taille relativement petite, et possédant une 57 John Omohundro, Chinese Merchant Families in Iloilo: Commerce and Kin in a Central Philippine City (Athens, Ohio: Ohio University Press, 1981). 58 Davis, Social Relations, p. 200. 59 Ibid., p. 200.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
188 — terrains & travaux — n°4 [2003]
structure sociale très soudée dans le lieu où ils sont implantés (et s’il s’agit de minorités menacées et méprisées, elles auront encore plus tendance à se regrouper socialement et culturellement) peuvent souvent présenter la bonne combinaison de ces facteurs, ce qui permet de rendre compte du succès économique, souvent relevé, des groupes minoritaires d’expatriés.60 Même dans des contextes où l’on trouve peu d’entreprises intégrées, il y a fort à parier que celles qui existent ont de telles origines – les quelques entreprises intégrées d’artisanat et de commerce que Geertz décrit à Sefrou au Maroc, par exemple, sont issues de la communauté juive.61 Plus généralement, les immigrants ont un avantage sur les indigènes pour atteindre ce point d’équilibre entre ce que l’on pourrait appeler le « couplage » et le « découplage ». Les Chinois en Chine, en dépit de l’omniprésence de la culture chinoise, peuvent également souffrir d’un excès d’obligations. Ainsi, Wong suggère que le fait de « quitter son lieu d’origine pour monter une affaire » est une attitude typique des entrepreneurs chinois, qui s’assurent ainsi qu’« il n’y aura pas trop de parents dans les communautés au sein desquelles ils travaillent. »62 En s’installant dans des régions où ils ont moins d’attaches, ils bénéficient alors de certains des avantages des immigrants.63 Réciproquement, les minorités d’immigrants souffrent rarement de ces revendications excessives, en partie parce que leur solidarité, en voie de construction, est contenue dans des frontières bien définies.64 Il peut aussi advenir que les entreprises d’immigrants, en particulier aux premiers stades, soient d’une fragilité propre à faire taire toute revendication sur leurs ressources. Ensuite, quand la réussite est au rendez-vous, l’entreprise peut continuer à éviter les revendications, surtout dans un environnement multiethnique, par le recours à une main-d’œuvre issue d’autres groupes ethniques, vis-à-vis desquels elle n’a aucune obligation d’allégeance.65
60 Voir, par exemple, Landa, “Homogeneous Middlemen.” 61 Geertz, “Suq,” p. 252 no. 101. 62 Siu-Lun Wong, “Industrial Entrepreneurship and Ethnicity: A Study of the Shanghainese Cotton Spinners in Hong Kong” (thèse de doctorat, Wolfson College, Oxford, 1979), p. 284. 63 Wong défend aussi l’idée qu’en Chine il est humiliant pour un parent de faire valoir ses revendications auprès d’un entrepreneur (Ibid., p. 284). 64 Voir Portes, op. cit. 65 Alejandro Portes et Bryan Roberts ont particulièrement insisté sur ces points lors de nos discussions au séminaire de sociologie économique de l’immigration, à la Fondation Russell Sage.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 189
Relations inter-groupes et avantages des minorités
Jusqu’ici j’ai analysé les caractéristiques des groupes qui créent, avec succès ou non, des entreprises. Cette argumentation doit cependant être complétée par une analyse des relations entre ces groupes et d’autres, au regard notamment de leurs différences culturelles. Ainsi, pour les Chinois d’Outre-mer, aucun stigmate n’était attaché au fait d’emprunter ou de prêter de l’argent – cela dénotait tout simplement une grande ambition. 66 Mais pour d’autres groupes, comme les Thaï ou les Malais, il était honteux d’être endetté, et les indigènes préféraient emprunter en secret auprès de commerçants chinois plutôt qu’auprès de leur famille ou d’institutions locales, les dettes pouvant sinon être de notoriété publique. 67 Les relations débiteur/créancier sont alors stigmatisées par les normes de l’économie morale, ou ce que Gosling nomme « l’éthique distributive », renforcée par le bouddhisme et l’islam : si vous avez un surplus, vous devez le partager. Le statut provient de la
66 Peter Gosling, “Chinese Crop Dealers in Malaysia and Thailand: The Myth of the Merciless Monopsonistic Middleman,” in Linda Y. C. Lim et L. A. Peter Gosling, eds., The Chinese in Southeast Asia, Vol. I, Ethnicity and Economic Activity (Singapour: Maruzen Asia, 1983), p. 143, et Maurice Freedman, “The Handling of Money: A Note on the Background to the Economic Sophistication of Overseas Chinese,” Man 59, item no. 89 (1959): 64-65. 67 Linda Lim, “Chinese Economic Activity in Southeast Asia: An Introductory Review,” in Lim et Gosling, eds., The Chinese in Southeast Asia, Vol. I, Ethnicity and Economic Activity, p. 9. Un informateur faisait remarquer à Gosling que passer par des coopératives locales pour emprunter de l’argent, c’était « mieux que la radio si vous vouliez que tout le monde sache combien vous deviez. » (Gosling, “Crop Dealers,” p. 144). Le fait d’emprunter de l’argent auprès de marchands chinois était donc non seulement une procédure plus informelle dans la mesure où elle ne s’embarrassait pas de paperasserie, mais permettait aussi à la transaction d’avoir lieu en tenant compte finement du besoin culturel de lui éviter l’apparence d’un prêt. Le récit qu’en fait Gosling mérite d’être intégralement cité : « J’ai observé des Malais empruntant de l’argent auprès d’un épicier chinois, et qui à aucun moment n’avaient l’impression qu’une transaction financière se tenait. On partage une cigarette ; l’épicier demande si le client a besoin de quoi que ce soit. Le client, sur un ton badin, fait vaguement référence au fait que sa femme lui casse les pieds en lui réclamant une machine à coudre, que ses enfants aiment les sucreries, et ils échangent quelques lieux communs sur la hausse brutale des prix, le coût élevé de la vie, et les manies dépensières de leurs femmes et enfants. L’épicier laisse ensuite entendre qu’il n’a pas encore déposé en banque les recettes de la boutique, et que si le client a besoin d’un petit quelque chose pour le dépanner, il n’y a pas de problème. Le client achète alors d’habitude un paquet de cigarettes (qui est mis sur son compte) et reçoit l’argent, plié en quatre, en même temps que les cigarettes – une transaction invisible pour quiconque ne regarde pas attentivement. Une fois le client parti, l’épicier note le prêt ainsi que le paquet de cigarettes sur son livre de comptes » (p. 166).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
190 — terrains & travaux — n°4 [2003]
distribution de ce surplus pour obtenir du « capital social ». Les obligations qui en résultent peuvent se payer en travail – ce qui crée dans les faits un système clientéliste.68 D’autres facteurs expliquent que les indigènes aiment à faire affaire avec les Chinois. Notamment parce qu’on peut ainsi contourner des systèmes de contrôle bureaucratique comme le fisc, qui pourraient intervenir dans le cas d’un emprunt contracté auprès d’une banque.69 Par ailleurs, entrer en contact avec un membre d’un groupe différent, raccordé à un vaste réseau extérieur, c’est disposer d’informations non redondantes avec celles qui circulent au sein de son propre groupe, informations précieuses pour qui veut comprendre la conjoncture des affaires.70 S’il y a des raisons pour lesquelles les indigènes préfèrent traiter avec des marchands en dehors de leur propre groupe, la réciproque est également vraie. Notamment parce qu’il est difficile de tenir jusqu’au bout le rôle de commerçant au sein d’une communauté aux liens étroits, structurée par des normes d’entraide et d’obligation mutuelle. Foster fait remarquer au sujet de la Thaïlande que
un commerçant sujet aux obligations et contraintes sociales traditionnelles aurait beaucoup de mal à faire tourner une affaire viable. S’il faisait par exemple partie intégrante de la société du village et était soumis à ses contraintes, on s’attendrait à ce qu’il soit généreux envers les nécessiteux, comme l’exige la tradition. Il lui serait difficile de refuser le crédit, et impossible d’en obtenir le remboursement. […] Le conflit d’intérêt inhérent à toute transaction marchande bilatérale compromettrait sévèrement le respect de l’étiquette, dimension essentielle des relations sociales thaï. […] Mais si l’individu ne fait pas partie de la société, ses obligations peuvent être différentes, de même que le pouvoir dont la société dispose sur son comportement. Ceci a des implications importantes sur la conduite des affaires. Les
68 Gosling, “Crop Dealers,” p. 143-144. 69 Aram Yengoyan, “The Buying of Futures: Chinese Merchants and the Fishing Industry in Capiz, Philippines,” in Lim et Gosling, eds., The Chinese in Southeast Asia, Vol. I, Ethnicity and Economic Activity, pp. 117-130. 70 Gosling, “Crop Dealers,” p. 138; cf. Mark Granovetter, “The Strength of Weak Ties,” American Journal of Sociology 78, no. 6 (mai 1973): 1360-1380.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 191
membres de groupes ethniques différents sont extérieurs à la communauté à plus d’un titre. […] Les attentes de générosité sont bien plus faibles vis-à-vis des membres d’autres groupes ethniques que du sien propre.71
On retrouve des variations sur ce thème dans bien d’autres cultures. Waldinger et al.72 citent l’étude de Wong sur les épiciers chinois du quartier de Watts, à Los Angeles, dans laquelle il montre que « la distance sociale qui les sépare de leurs clients noirs permet […] des pratiques concurrentielles que les épiciers noirs, ayant des attaches sociales avec la communauté, ne peuvent se permettre. »73 Dans le cas d’Amsterdam, Boissevain et Grotenberg notent que plus des trois-quarts des clients des marchands chinois ou hindous du Surinam « sont extérieurs à leur groupe ethnique, ce qui permet plus facilement aux marchands de refuser le crédit et d’exiger, avec une rigueur toute professionnelle, le paiement des dettes. »74 Certes il peut advenir que le groupe des commerçants soit moins soumis que ses clients aux normes de l’économie morale. Cependant l’avantage provient surtout du découplage par rapport aux clients que d’une idéologie différente ; ainsi, cet avantage persiste dans les situations où commerçants et clients sont issus de groupes ethniques qui, quoique différents, sont virtuellement identiques d’un point de vue culturel, comme par exemple la minorité môn qui commerce avec des clients thaï.75 En fait, rien n’exige qu’une minorité locale soit ethniquement différente de la majorité pour bénéficier de ces avantages. Szanton raconte qu’à Estancia la minorité protestante, divisée en quatre sectes, a plus de succès en affaires que la majorité catholique. Il montre qu’ « alors qu’un entrepreneur catholique peut avoir des difficultés à refuser les faveurs exigées par ses nombreux co-religionaires, les hommes d’affaires protestants disposent de liens sociaux plus limités avec des personnes ayant des dispositions d’esprit similaires, et peuvent ainsi refuser avec plus de facilité, et 71 Brian Foster, “Ethnicity and Commerce,” American Ethnologist 1, no. 3 (1974): 441. 72 Roger Waldinger, Robin Ward, et Howard Aldrich, “Ethnic Business and Occupational Mobility in Advanced Societies,” Sociology 19 (1985): 585-597. 73 Charles Choy Wong, “Black and Chinese Grocery Stores in Los Angeles’ Black Ghetto,” Urban Life 5 (1977): 439-464. 74 Jeremy Boissevain et Hanneke Grotenberg, “Culture, Structure and Ethnic Enterprise: The Surinamese of Amsterdam,” Ethnic and Racial Studies 9 (janvier 1986): 13. 75 Brian Foster, “Minority Traders in Thai Village Social Networks,” Ethnic Groups 2 (1980): 223.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
192 — terrains & travaux — n°4 [2003]
continuer à entretenir des relations plus étroitement contractuelles avec les autres. » 76 Les migrants d’Estancia, également moins empêtrés dans les obligations locales, sont surreprésentés dans le groupe des chefs d’entreprise à succès.77 Ainsi, tout dispositif culturel qui permet de découpler un groupe d’un autre peut faciliter le commerce. Les avantages du découplage sont tels que les groupes peuvent cultiver à cette seule fin leur différence ethnique. Contre l’idée sociologiquement naïve de l’éthnicité comme caractéristique première des individus, fait naturel et biologique, plusieurs auteurs récents ont mis en avant les motifs politiques et économiques de la « construction de l’ethnicité ». 78 L’économie néo-institutionnaliste propose une vision extrême de cette construction, en considérant que dans certaines situations, la stratégie optimale des groupes consiste à « choisir » d’accentuer leurs caractéristiques ethniques pour maximiser leur revenu. La Croix, par exemple, suggère que, pour résoudre leurs problèmes économiques, les groupes se choisissent « un actif commun (“homogène”) – un ensemble de caractéristiques – qu’il leur est moins 76 D. Szanton, Estancia, p. 97. 77 Ibid., p. 95. Szanton raconte qu’en plus des migrants, des Protestants et des Chinois, il existe à Estancia un autre groupe qui est surreprésenté parmi les entrepreneurs : il s’agit des femmes. La configuration culturelle locale est telle que celles-ci parviennent plus facilement que les hommes à contrôler les revendications diffuses qui peuvent entraver le fonctionnement efficient de leurs affaires. Les hommes sont jugés « en grande partie sur leur adhésion aux normes traditionnelles, hiérarchiques et interpersonnelles régissant rôles et comportements, lesquelles exigent qu’ils fassent preuve de générosité et de magnanimité vis-à-vis de l’ensemble de la société. » Les femmes, par contre, sont principalement jugées sur la manière dont elles gèrent l’économie domestique. Elles sont ainsi tenues « d’être économes et de marchander sur la place du marché, ce qui, d’un point de vue culturel, est objectivement indigne d’un homme. » De sorte que si vous voulez emprunter de l’argent ou du riz à une femme, elle peut plus facilement refuser ou exiger d’être remboursée, en invoquant les besoins de sa famille. Les épouses, dans un tel contexte, font souvent office d’agents commerciaux à leurs maris pêcheurs ou fermiers (D. Szanton, Estancia, p. 94). En outre, les femmes sont moins enclines, contrairement aux hommes, à avoir recours à la violence physique en cas de provocation. Il est donc « littéralement plus sûr pour une femme d’avoir des relations économiques “dures” et étroitement contractuelles avec les autres. Leur capacité à refuser le crédit ou exiger le remboursement des dettes sans craindre de représailles violentes est un atout crucial pour les entreprises commerciales dans lesquelles des biens produits à l’extérieur […] sont achetés à des négociants qui n’appartiennent pas à la ville, et qui eux aussi exigent le paiement intégral en temps et en heure. » (Ibid., p. 95). Il est difficile d’apprécier l’étendue d’une telle configuration culturelle, mais à l’exception du Moyen Orient – où les rôles que peuvent jouer les femmes sont sévèrement contraints par la culture islamique – la plupart des comptes rendus sur les stratégies commerciales dans des contextes de moindre développement font état du rôle prépondérant des femmes. Cependant, il me semble difficile, sur la base des seules études dont on dispose, d’établir l’existence d’avantages entrepreneuriaux spécifiquement féminins dans d’autres contextes qu’Estancia. 78 Voir, par exemple, les contributions à Susan Olzak et Joanne Nagel, eds., Competitive Ethnic Relations (Orlando, Fla. : Academic Press, 1986).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 193
coûteux d’acquérir au sein du groupe que pour les outsiders, et qui engendre un flux d’utilité ou de revenu rapportant un taux de rendement normal, et qui est suffisamment spécifique et précieux pour engendrer un flux assez grand de quasi-rentes. Le choix de caractéristiques ethniques, religieuses ou généalogiques satisfait ces critères… »79 La prudence commanderait de tenir compte des contraintes historiques, culturelles et socio-structurelles qui pèsent sur de tels « choix », ainsi que des contextes qui peuvent, pour des raisons non économiques, générer des identités ethniques fortes. Cela dit, on peut en effet démontrer que la différence ethnique est cultivée dans des situations où elle a une valeur économique. Foster rapporte que les Môn de Thaïlande sont bien plus enclins à préserver leurs caractéristiques ethniques propres dans le cadre d’activités commerciales, où elles sont profitables, que dans le cadre d’activités agricoles, où elles ne le sont pas.80 Gosling remarque que les Chinois en Thaïlande et en Malaisie cultivent leur identité chinoise car elle « autorise un comportement anti-social nécessaire au commerce, et leur permet d’imposer leurs règles du jeu. Dès qu’un Chinois se met à agir comme un Malais ou un Thaï, on s’attend à ce qu’il se comporte en Malais ou en Thaï, et il perd l’avantage de la différence ethnique. »81 Le degré de « choix » de la différence culturelle peut être précisément calibré selon les situations. Gosling a observé un épicier chinois dans un village malais qui « semblait s’être considérablement acculturé à la manière malaise, et était scrupuleusement proche des Malais, portant le sarong, parlant malais de manière douce et polie, et ayant un comportement humble et affable. Cependant, au moment des récoltes, lorsqu’il partait au champ récupérer les récoltes sur lesquelles il avait avancé des crédits, il se mettait en short et débardeur à la mode chinoise, et parlait de façon plus abrupte, se comportant, comme le dit un paysan malais, “exactement comme un Chinois”. Ce comportement devait assurer qu’il ne serait pas traité comme un Malais, dont on attend davantage de générosité sur les prix ou les termes du crédit. »82
79 Summer La Croix, “Homogeneous Middleman Groups: What Determines the Homogeneity?” Journal of Law, Economics and Organizations 5, no. 1 (1989): 219. 80 Brian Foster, “Minority Traders in Thai Village Social Networks,” Ethnic Groups 2 (1980): 223, 239. 81 Gosling, “Crop Dealers,” p. 156. 82 Peter Gosling, “Changing Chinese Identities in Southeast Asia,” in Gosling et Lim, eds., The Chinese in Southeast Asia, Vol. II, Identity, Culture and Politics (Singapour: Maruzen Asia, 1983), p. 4.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
194 — terrains & travaux — n°4 [2003]
Bien qu’il soit éclairant de penser à la conservation et la manipulation de l’identité ethnique comme une question de choix rationnel, une telle analyse considère d’habitude comme donnée la partie la plus intéressante du problème, à savoir les facteurs qui rendent initialement un tel choix efficient pour un groupe donné. Ainsi, une des raisons pour lesquelles les Chinois d’Outre-mer encourent de lourdes sanctions en cas de malversation au sein de leur propre groupe est que dans la majeure partie de l’Asie du Sud-Est, leurs opportunités en dehors des affaires sont limitées. Dans la ville des Philippines étudiée par Omohundro, « ne plus être un marchand, c’est ne plus être Chinois. »83 Ceci est dû au fait que les groupes indigènes dédaignent le commerce, mais aussi au fait que les Chinois ne disposent pas des contacts requis pour s’introduire dans d’autres secteurs d’activité, et que la politique officielle s’efforce activement d’y faire obstacle. Ainsi, même si les colons chinois avaient voulu pénétrer le domaine de l’agriculture, il leur aurait été difficile d’y parvenir. Comparez la situation des Chinois d’Outre-mer avec celle des hommes d’affaires Kenyans étudiés par Marris et Somerset : ils « parviennent rarement à faire cohabiter liens de parenté et structure d’autorité managériale », ce qui, contrairement aux préceptes de la théorie du développement, les place en situation de désavantage massif par rapport aux entreprises d’origine asiatique, en particulier indienne, qui sont elles construites autour de lignages.84 Ceci provient en partie du fait que les Asiatiques, « en tant que minorité exclue de l’agriculture par la politique coloniale, pouvaient faire peser des sanctions beaucoup plus lourdes dans leurs relations d’affaires. Un homme qui trompait sa famille ou sa caste pouvait être banni de tout emploi commercial, et avait peu de sources alternatives de revenu. »85 Or le commerce est une activité périphérique dans les communautés africaines, de sorte que les sanctions que l’on peut mobiliser contre un parent malhonnête sont faibles, puisqu’il existe normalement des domaines d’emploi alternatifs. En effet, selon plusieurs des hommes 83 Omohundro, Merchant Families, p. 12. 84 Peter Marris et Anthony Somerset, The African Businessman: A Study of Entrepreneurship and Development in Kenya (Londres: Routledge and Kegan Paul, 1971), p. 135. 85 Ibid., p. 145.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 195
d’affaires africains interviewés dans le cadre de l’étude citée, jalousie et insubordination se rencontraient plus facilement chez des parents que chez des étrangers. Marris et Somerset suggèrent qu’à mesure que le commerce prend de l’importance, que la terre en perd, et que se consolide une classe d’affaires, le rôle de la famille pourrait prendre plus d’ampleur dans les affaires africaines. Notons la beauté ironique du renversement : loin de refléter un premier stade dans le processus de développement économique, l’implication de la famille est difficile à ce niveau initial, et ne peut prendre place qu’une fois atteint un certain plateau dans le processus de développement. La discrimination qui touche les groupes minoritaires peut en fait produire un avantage dans la constitution d’entreprises familiales, puisque même si les enfants de propriétaires d’affaires prospères atteignent un niveau élevé d’éducation, leurs opportunités en dehors du secteur d’activité ethnique seront sévèrement limitées, et la probabilité qu’ils demeurent dans une affaire familiale et y emploient leur talent sera bien plus élevée. Une fois que la discrimination s’estompe, il est plus dur de maintenir une continuité intergénérationnelle dans les affaires, puisque la plupart du temps les enfants éduqués de parents entrepreneurs cherchent des emplois mieux adaptés à leur niveau d’éducation, comme par exemple dans les professions libérales.86 Marion Levy fait valoir qu’une des raisons pour lesquelles le Japon a mieux réussi son industrialisation que la Chine est que la Chine avait un système de classes beaucoup plus ouvert, de sorte que les fils de marchands et d’industriels pouvaient s’élever dans les rôles sociaux mieux estimés de hauts fonctionnaires et de propriétaires terriens, alors que dans le cas du Japon ces rôles économiques incombaient à des groupes précis au sein d’une hiérarchie féodale, auxquels étaient assignés des traits quasi-ethniques, et qui ne pouvaient se mouvoir dans d’autres sphères institutionnelles. Le talent se trouvait de ce fait confiné à l’intérieur de la communauté d’affaires, à un niveau de cohésion moins accessible dans le contexte chinois, où talent et ressources étaient continuellement drainés des affaires.87
86 Cf. Edna Bonacich et John Modell, The Economic Basis of Ethnic Solidarity: Small Business in the Japanese American Community (Berkeley: University of California Press, 1980). 87 Levy, “Contrasting Factors,” p. 187.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
196 — terrains & travaux — n°4 [2003]
On observe aussi plusieurs cas contemporains dans lesquels la discrimination à l’encontre d’un groupe a servi d’arme à double tranchant, lui barrant l’accès à la plupart des métiers, mais le poussant dans une niche qu’il a été capable de dominer, en partie grâce à une cohésion ethnique renforcée au sein de cette niche. L’argument général est que les conditions « qui font saillir les frontières et l’identité des groupes, amenant des individus à se créer des liens sociaux et des répertoires d’action nouveaux, augmentent les probabilités de tentatives entrepreneuriales par des individus de ce groupe, de même que les chances de succès. »88 C’est clairement le cas pour la domination japonaise de la culture maraîchère dans la Californie de l’entre-deux-guerres.89 Ainsi, l’équilibre optimal entre couplage et découplage peut être ironiquement imposé à un groupe par des circonstances échappant à son contrôle. Le découplage entre un groupe et d’autres groupes locaux peut en fait favoriser la mise en place d’un réseau de liens faibles entre celui-ci et d’autres groupes similaires ailleurs, en libérant du temps et de l’énergie pour de telles relations. Ainsi des groupes d’affaires prospères ont souvent, comparativement à d’autres groupes, un réseau plus large de relations avec des individus – typiquement de leur propre groupe – dans des endroits différents. Geertz fait ressortir, par exemple, que les entrepreneurs musulmans de Modjokuto ainsi que les entrepreneurs aristocratiques convertis à l’hindouisme de Tabanan « tout comme les groupes traditionnels dont ils ont émergé, ne sont pas circonscrits à la structure sociale immédiate du village. En outre, ces deux groupes sont avant tout à visée interlocale, puisqu’ils entretiennent certaines de leurs relations les plus importantes avec des groupes et des individus dans des zones extérieures à la leur. Cela aussi est un héritage de leurs ancêtres. » 90 Des relations étendues dans des communautés extérieures caractérisent aussi les Chinois d’Indonésie et des Philippines 91 , de même que les groupes minoritaires comme les
88 Howard Aldrich et Catherine Zimmer, “Entrepreneurship Through Social Networks,” in Raymond Smilor et Donald Sexton, eds., The Art and Science of Entrepreneurship (Cambridge, Mass.: Ballinger, 1985), p. 14. 89 Leonard Broom et Ruth Riemer, Removal and Return: The Socio-Economic Effects of the War on Japanese Americans (Berkeley: University of California Press, 1949); Bonacich et Modell, Economic Basis; et Robert Jiobu, “Ethnic Hegemony and the Japanese of California,” American Sociological Review 53 (juin 1988): 353-367. 90 Geertz, Peddlers, p. 148. 91 Dewey, Peasant Marketing, p. 45 ; D. Szanton, Estancia, p. 99 ; Davis, Social Relations, p. 203.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 197
Parsis et les Marwaris qui dominent l’économie industrielle de l’Inde.92 Ce réseau étendu peut être à la fois la cause et l’effet de l’intégration verticale existant au sein d’une branche contrôlée par un groupe, comme dans le cas de la mainmise des Japonais sur la culture maraîchère, à la fois au niveau de la production, de la vente en gros et en détail dans la Californie de l’entre-deux-guerres.93 De telles relations interlocales peuvent naître de diverses manières. Les entrepreneurs musulmans de Modjokuto sont les descendants de commerçants itinérants, qui entretenaient il y a plusieurs siècles des relations commerciales dans tout Java, relations qu’à leur tour ils continuent de perpétuer. À Bali, « l’horizontalité provenait d’une culture de cour sophistiquée. […] L’aristocratie de Tabanan formait non seulement un groupe religieux régnant, mais entretenait, et entretient toujours, des relations sociales importantes et intimes avec des groupes similaires dans les autres capitales régionales de l’île. »94 Les deux groupes sont « préservés, par le métier ou le rang, des contraintes locales de la société villageoise »95, ce qui doit donc être considéré comme la cause et la conséquence de leurs liens étendus avec l’extérieur. Les minorités chinoises sont d’autant plus isolées qu’elles disposent typiquement d’un statut social très inférieur, et sont méprisées dans le village ou la ville, ce qui rend leurs énergies sociales disponibles pour des relations de plus longue distance – relations qui peuvent également être facilitées par la capacité à identifier des parents et des migrants originaires de la même région de Chine que soi, dans d’autres villes et villages. Cette capacité à mobiliser des contacts personnels sur une vaste aire géographique est un avantage considérable pour assurer la fluidité des transactions amont et aval. Elle apporte également des avantages en termes d’informations, comme Davis nous l’apprend à propos des grossistes chinois à Baguio, aux Philippines, dont « les relations commerciales avec les fournisseurs de Manille […] leur donnent des informations sur les prix bien meilleures que celles dont disposent les revendeurs philippins avec lesquels ils traitent. […] Ils sont capables de tirer parti des anticipations à la hausse en stockant
92 Thomas Timberg, The Marwaris: From Traders to Industrialists (New Delhi: Vikas, 1978). 93 Broom et Riemer, Removal. 94 Geertz, Peddlers, p. 149. 95 Ibid., p. 149.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
198 — terrains & travaux — n°4 [2003]
des articles afin de les vendre à des prix plus élevés dans le futur. »96 D’autre part, ne pas avoir d’enracinement local peut être un avantage considérable quand le vent de l’opportunité économique tourne : « Au début des années 1960, quand la pêche industrielle arriva aux îles les plus éloignées et la côte sud de Masbate grâce à l’expansion de la mécanisation, et qu’Estancia devint une plateforme pour le commerce et les opérations de chargement, […] les Chinois furent prompts à s’établir dans ces nouvelles zones en plein essor, et étaient souvent les seuls marchands qui achetaient le produit de la pêche locale et vendaient des biens d’équipement ménagers et maritimes. […] Comme c’était avec les marchands chinois des autres zones urbaines qu’ils entretenaient leurs relations essentielles, ils purent plus facilement abandonner les relations locales temporaires afin de se diriger vers des lieux plus profitables. Les marchands philippins, qui ont des attaches tout à la fois sociales, politiques et économiques avec leur communauté d’origine, semblent davantage forcés d’y demeurer, même si des profits plus substantiels les invitent à se rendre ailleurs. »97
Les conditions de l’avantage du groupe ethnique Le raisonnement que nous avons mené jusqu’ici suggère que dans des contextes où des entreprises émergent d’une base plus indifférenciée d’activités économiques, des groupes sociaux bien définis ont des avantages particuliers qui leur permettent d’éviter le double écueil du défaut de confiance et de la dilution du succès de l’entreprise dans la contribution au bien-être de la communauté. Ce sont surtout les groupes d’immigrants et autres groupes minoritaires qui ont particulièrement (quoique non exclusivement) été jusqu’ici mis en avant dans les récits. L’histoire économique nous suggère cependant que même s’il est possible de présenter plusieurs cas exemplaires où de tels groupes ont un avantage et dominent l’activité économique et entrepreneuriale, dans certains contextes où l’activité économique 96 Davis, Social Relations, pp. 202-203. 97 D. Szanton, Estancia, p. 99.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 199
est émergente, il est pourtant impossible d’identifier de tels groupes. Ce constat peut s’expliquer de diverses manières. Il se peut tout d’abord que malgré l’existence de conditions avantageuses, aucun groupe n’arrive à construire ses marqueurs, ethniques ou autres, afin de jouer le rôle que nous avons décrit. Les arguments fonctionnalistes suggèrent que de bonnes solutions peuvent toujours être construites, mais ne prennent pas en compte la nécessité de les construire à partir de matériaux existants. Les Chinois d’Asie du Sud-Est et les Indiens d’Afrique orientale étaient déjà présents dans les lieux où ils furent appelés à dominer certains pans de l’activité économique, en partie parce qu’ils y virent des opportunités et migrèrent, et en partie parce que les pouvoirs coloniaux en place utilisèrent volontairement ces groupes comme tampons entre eux-mêmes et les groupes locaux, afin d’adoucir l’impact de la domination (ceci était particulièrement évident dans la doctrine britannique du « gouvernement indirect »). En d’autres termes, ce que Portes a appelé le « mode d’incorporation » de ces groupes créa le potentiel d’un avantage économique.98 Cependant, même là où des groupes minoritaires sont dans une situation prometteuse, rien ne garantit qu’ils seront capables de gérer leur structure sociale de façon à optimiser leurs opportunités. Il se peut également que bien qu’aucun groupe ne soit clairement identifié par les chercheurs, ni même par les contemporains, il existe néanmoins dans ce contexte certains groupes de familles dont la structure sociale s’approche de celle qui résout le double problème dont il est ici question. L’analyse des entreprises à succès n’a pas l’habitude de prendre en compte de telles considérations sur les structures sociales, de sorte que, à moins d’être clairement marqués par des caractéristiques ethniques, de tels groupes peuvent passer inaperçus dans les tentatives d’explication du contexte économique. Dans ces deux explications de l’apparente absence de minorités cohérentes ayant pourtant fréquemment un rôle important dans l’activité économique, je faisais l’hypothèse que les conditions étaient favorables aux minorités pour qu’elles puissent jouer ce rôle, ce qui n’est pas toujours le cas. Par exemple, une condition favorable, et historiquement répandue, est de nature culturelle : elle survient 98 Voir Portes, op. cit.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
200 — terrains & travaux — n°4 [2003]
lorsque le groupe majoritaire méprise la recherche du profit. Ce mépris est patent lorsque ceux qui vendent des biens de subsistance sont exclus de la communauté morale si leur commerce est orienté vers le profit, et se fait à des prix fixés de manière exogène à la morale économique locale. Là où une telle séparation se rencontre, seuls peuvent se constituer en entrepreneurs efficaces les outsiders qui ne participent pas de l’économie morale, et sont relativement peu affectés par ses sanctions. Ainsi Ortiz remarque que parmi les Paez, seules les personnes les plus marginales de la communauté vendaient la nourriture aux prix du marché, violant ainsi les mœurs locales.99 En Asie du Sud-Est, comme je l’ai fait ressortir plus haut, ce sont les Chinois qui remplissaient ce rôle. L’historien économique Gerschenkron réfutait l’argument sociologique des années 1950 et 1960 selon lequel une transformation des valeurs était un préalable requis au développement, en faisant remarquer que ceci est « en contradiction évidente avec les faits », puisqu’il existait en Europe des situations « où de magnifiques entreprises étaient conduites en bravant le système de valeurs dominant, farouchement opposé à de telles activités, et qui continuait à considérer le travail de la terre […] comme la seule activité économique qui agréât au Seigneur. »100 Si de telles valeurs n’empêchent pas l’activité entrepreneuriale, elles peuvent tout de même lui imposer des coûts importants, et je suggère que ce sont exactement de tels contextes qui créent un avantage comparatif pour les groupes ethniques minoritaires. Réciproquement, au dix-septième siècle, à Philadelphie, les entrepreneurs n’étaient pas issus d’une origine ethnique particulière, et Doerflinger décrit un contexte historique caractérisé, comme peu l’ont été, par « un esprit d’entreprise, une motivation compulsive à développer rapidement une économie dynamique et puissante »101, dans lequel faire fortune était une ambition tout à fait respectable. Nous pouvons donc en conclure que dans des contextes où le système de valeurs dominant est largement favorable à la recherche du profit
99 Sutti Ortiz, Uncertainties in Peasant Farming: A Columbian Case (New York: Humanities Press, 1973). 100 Alexander Gerschenkron, “The Modernization of Entrepreneurship,” in Myron Weiner, ed., Modernization: The Dynamics of Growth (New York: Basic Books, 1966), p. 253. 101 Thomas Doerflinger, A Vigorous Spirit of Enterprise : Merchants and Economic Development in Revolutionary Philadelphia (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1986), p. 5.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 201
et à la poursuite d’objectifs économiques, les groupes d’immigrants et les groupes minoritaires seront moins à leur avantage. Nous devons aussi nous demander si ces avantages apparaissent quelle que soit la conjoncture économique. L’argument macroéconomique dirait indifféremment que « la marée montante fait soulever tous les bateaux. »102 Nous nous attendrions alors à ce que les groupes minoritaires, comme les autres, aient des difficultés en temps difficiles, et réussissent en période de boom économique. J’ai pourtant envie de défendre l’argument contraire, à savoir que les groupes minoritaires ou autres, dont les configurations de couplage et découplage résolvent les problèmes que j’ai décrits, sont à leur avantage maximal dans des conjonctures économiques difficiles. Ceci semble être le cas pour les exemples javanais et philippins cités, dans lesquels les Chinois dominent le commerce. Dans le cas d’Estancia, aux Philippines, M. Szanton note que les conditions du marché empirèrent considérablement après la Deuxième Guerre mondiale : il y eut une affluence considérable de commerçants et « le commerce de subsistance » garantissait une sécurité économique à des personnes qui seraient autrement au chômage. Elle suggère que « le marché semble organisé de manière à pouvoir absorber sans cesse de nouvelles personnes et à leur fournir au moins le minimum vital. »103 À Modjokuto, Geertz et Dewey démontrent l’avantage des Chinois sur les négociants musulmans locaux.104 Tel ne fut pas cependant toujours le cas : avant la Grande Dépression, il existait de vastes organisations commerciales fort bien intégrées, dominées par les musulmans, qui parvenaient à « mettre en commun les ressources, partager les itinéraires et récupérer les dettes au sein des groupes. […] Après la Grande Dépression, l’effet combiné d’une économie affaiblie et la saturation du réseau par un nombre croissant de marchands marginaux entraîna l’essoufflement de la dynamique de la classe marchande », et maintenant, « les quelques efforts spectaculaires des membres de l’ancienne classe marchande pour créer des institutions productives et distributives plus efficaces sont 102 Ivan Light et Carolyn Rosenstein Light, “Demand Factors in Entrepreneurship” (Department of Sociology, University of California, Los Angeles, 1989, ronéo). 103 M. Szanton, Right to Survive, p. 138. 104 Geertz, Peddlers ; Dewey, Peasant Marketing.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
202 — terrains & travaux — n°4 [2003]
presque balayés par les centaines de marchands à la petite semaine qui tentent de survivre à la marge en recourant au commerce traditionnel. »105 Dans le récit de Doerflinger à propos des grossistes de Philadelphie aux XVIIIe et XIXe siècles, il semble évident qu’aucun groupe ethnique en particulier ne dominait le commerce, même s’il existait des divisions ethniques ou quasi-ethniques objectives. Ce que cet exemple a en commun avec celui de Modjokuto dans les années 1920, c’est une conjoncture macroéconomique hautement favorable dans laquelle l’entrée des firmes est relativement aisée, de même que la levée de capitaux, et dans laquelle les profits n’ont pas encore été comprimés. Doerflinger note par exemple qu’une grande partie du commerce à Philadelphie était dans l’import-export, et que les capitaux étaient disponibles auprès de marchands anglais, qui les mettaient volontairement à disposition sans connaître grand-chose de leurs débiteurs.106 Ce raisonnement général peut aussi nous aider à identifier les secteurs d’une économie dans lesquels un groupe aura un avantage. Dans son étude des firmes textiles originaires de Shanghai établies à Hong Kong, Wong défend l’idée que c’est dans des industries à barrières d’entrée particulièrement faibles, comme le textile – où il y a peu d’économies d’échelle, de technologies déposées et de différenciation des produits – qu’on peut s’attendre à trouver l’utilisation de critères particularisants pour former des solidarités de groupe, et ainsi tenir les intrus à l’écart.107 En d’autres termes, des liens de solidarité de groupe peuvent se substituer aux facteurs « naturels » qui créent des barrières à l’entrée, et nous pouvons anticiper d’observer de telles solidarités dans des marchés dont on penserait, selon des critères purement économiques, qu’ils seraient concurrentiels, mais qui ne le sont pas empiriquement. Un autre facteur réside dans le fait que l’avantage des affaires ethniques est le plus fort là où la ressource la plus problématique est la confiance. Quand au contraire il s’agit de la connaissance technique, l’avantage ethnique peut s’estomper. Ceci explique en
105 Geertz, Peddlers, pp. 13, 17. 106 Doerflinger, Spirit, p. 68. 107 Siu-Lun Wong, “Individual Entrepreneurship,” p. 254.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 203
partie pourquoi les métiers d’intermédiaires conviennent particulièrement aux étrangers ethniques. 108 Non pas que toute dimension technique soit absente à ces métiers : assurément des aspects complexes comme la comptabilité doivent être maîtrisés au préalable. Une telle connaissance est cependant relativement statique et, une fois acquise au sein d’un groupe, cesse de faire problème. Ce qui fait toujours problème, c’est la confiance en ses collègues de travail. Là où les employés doivent maîtriser des connaissances techniques constamment réactualisées, les avantages des réseaux de parenté ethniquement circonscrits peuvent diminuer, et Lim montre que les firmes chinoises de Hong Kong qui sont spécialisées dans des domaines high-tech ne trouvent plus aucun avantage aux traditionnelles pratiques de gestion chinoises. Ceci est confirmé par son étude empirique des firmes d’électronique chinoises, orientées vers l’exportation, à Singapour et en Malaisie, où l’accès au capital, à la technologie, à la main-d’œuvre et aux marchés extérieurs passe « par les relations qu’entretiennent ces firmes chinoises non pas avec d’autres organisations chinoises, mais avec des firmes étrangères d’une part et les autorités locales de l’autre. » 109 Or peu de secteurs dans toute économie moderne nécessitent un tel degré de changement technique, de sorte que l’avantage ethnique peut être relativement important pour un vaste pan de la vie économique. Pour résumer, il semble donc que les avantages des groupes d’immigrants ou des groupes ethniques minoritaires soient particulièrement pertinents là où le profit est méprisé, sous des conjonctures économiques difficiles, là où le financement par le crédit est difficile à obtenir et l’industrie balbutiante, dans des industries à faibles barrières d’entrée, et où la confiance, plus que la compétence technique, est la ressource la plus précieuse. Sous de telles conditions, même des aléas temporaires peuvent faire couler une affaire, et on n’a pas droit à l’erreur. Dans des conditions plus favorables, l’avantage ethnique s’estompe. Un groupe ethnique peut même en venir à être sous-représenté dans un tel cas puisque sa capacité à constituer un monopole dans des conditions adverses est
108 Voir Edna Bonacich, “A Theory of Middleman Minorities,” American Sociological Review 38 (octobre 1973): 583-594. 109 Linda Lim, “Chinese Business, Multinationals and the State: Manufacturing for Export in Malaysia and Singapore,” in Lim et Gosling, eds., The Chinese in Southeast Asia, Vol. I, Ethnicity and Economic Activity, p. 246.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
204 — terrains & travaux — n°4 [2003]
éliminée, et sans un tel monopole, son statut de groupe de citoyens de seconde zone peut être accentué et militer en sa défaveur pour le succès entrepreneurial. Il ne s’ensuit pas que les groupes majoritaires dans des conjonctures économiques favorables n’aient pas de problème de confiance ou d’obligations non économiques. Ces problèmes apparaissent sous toutes les conjonctures, et ne peuvent être résolus sans en payer le prix. Sous des conditions macroéconomiques suffisamment favorables, comme à Java dans les années 1920, il est possible de surmonter les difficultés et les coûts liés aux besoins de financement, à la mise en place d’une organisation, et de dispositifs de confiance ou de surveillance des subordonnés en l’absence de groupe social cohésif. Mais même dans un tel contexte je défendrais l’idée que ce sont toujours des difficultés et des coûts qui, dans des conditions difficiles, ne peuvent tout simplement plus être surmontés, et voueront à l’échec toute tentative d’expansion de l’activité économique. Alors, seuls les groupes qui peuvent gérer ces problèmes à un coût moindre pourront entretenir leurs commerces.
Conclusion Mon analyse fait clairement ressortir l’importance des facteurs non économiques et institutionnels de l’entreprenariat. Elle ajoute une dimension plus concrète à l’étude des normes et des valeurs en regardant comment sont façonnés les échanges et la structure sociale. Je ne considère pas ces facteurs comme inconciliables avec les variables économiques, mais plutôt comme un moment d’une description qui doit aussi les prendre en compte. J’ai particulièrement mis en lumière un certain nombre de configurations de solidarité qui confèrent aux immigrés et aux autres minorités des avantages dans la constitution d’une entreprise. La thèse défendue ici est que, même si le contexte est favorable, de tels groupes doivent aussi être caractérisés par un équilibre délicat entre le couplage interne et le découplage par rapport aux autres groupes. Cet équilibre est déterminé pour l’essentiel par des conditions
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
terrains & travaux — n°4 [2003] — 205
économiques et sociales échappant aux individus, bien que ces derniers puissent le manipuler à la marge. Il ne faut pas négliger l’importance de cette action à la marge, qui est l’objet que privilégient les économistes institutionnalistes quand ils recourent à la théorie du choix rationnel. Ce type d’analyse ne vaut cependant que s’il est combiné au type d’analyse historique et contextuelle que j’ai suggéré. Je me suis concentré sur le seul niveau de la constitution des entreprises, en laissant de côté certaines des questions plus générales de l’analyse du développement économique, comme par exemple la manière dont les entreprises s’agglomèrent en grands groupes économiques, ou comment elles interagissent avec d’autres secteurs institutionnels, comme le monde du travail, les gouvernements ou les consommateurs. La question de la concentration, qui dépasse le champ d’une étude sur la place des immigrants et des groupes minoritaires dans l’économie, n’en est en réalité que le prolongement naturel, dans la mesure où de tels groupes peuvent se constituer en vastes conglomérats industriels – ou en ensembles d’entreprises aux liens plus lâches – susceptibles de dominer le secteur industriel le plus moderne d’une économie, comme ce fut le cas pour les Chinois d’Indonésie ou les Marwaris d’Inde.110 Des développements supplémentaires seraient nécessaires pour éclairer ce mécanisme. À ce stade, j’ai mis en évidence, comme solution au problème de l’entreprise, une stratégie basée sur la confiance et la limitation des obligations qui semble convenir fort bien à la fondation de petites entreprises prospères, mais qui contient ses propres limites à l’expansion future. Le nombre d’individus de la même famille ou groupe ethnique qu’un entrepreneur peut suffisamment connaître pour leur accorder sa confiance est nécessairement limité. Plutôt que de s’étendre par l’expansion vers la taille la plus profitable, plusieurs propriétaires dont l’affaire repose sur des liens familiaux ou ethniques préfèrent s’étendre au contraire en plaçant un individu de confiance à la tête d’une autre affaire, parfois dans la même branche, mais parfois pas. Ceci explique en partie pourquoi on observe couramment que les entrepreneurs de pays en développement ont plusieurs marmites sur 110 Richard Robinson, Indonesia: The Rise of Capital (Sydney: Allen & Unwin, 1986); Timberg, Marwaris.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
206 — terrains & travaux — n°4 [2003]
le feu – souvent dans des secteurs fort divers de l’activité économique.111 Cependant, il ne s’ensuit pas que le chemin menant au progrès, qui part de la petite entreprise et se dirige vers les unités capitalistes plus vastes qui nous sont familières, se parcourt plus aisément en recourant à des institutions économiques impersonnelles et « modernes ». Au contraire, plusieurs empires industriels, dont des institutions financières très puissantes, ont été bâtis sur la base de plus petits arrangements personnels entre parents et amis. Des structures d’alliance et de contrôle fort élaborées ont été construites par les minorités ethniques, qui ont utilisé les liens de parenté et d’amitié en les combinant savamment avec les structures bureaucratiques, qui leur ont permis d’échafauder des opérations d’une envergure plus grande que ne le permettrait la famille seule.112 Il nous suffira ici de conclure en faisant remarquer que plus notre compréhension de la sociologie économique avance, plus nous rencontrons de rôles inédits et surprenants joués par les catégories soi-disant archaïques d’ethnicité et de parenté. L’idée selon laquelle ces catégories seraient rendues caduques dans l’économie du monde moderne par l’efficience des institutions impersonnelles est un utopique vestige de l’idéalisme des Lumières, et ne résiste pas à une analyse scrupuleuse.
111 Voir, par exemple, Norman Long, “Multiple Enterprises in the Central Highlands of Peru,” in S. Greenfield, A. Strockon, et R. Aubey, eds., Entrepreneurs in Cultural Context (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1979). 112 On lira un compte rendu plus complet de ces processus dans Mark Granovetter, “Business Groups,” in Neil Smelser et Richard Swedberg, eds., Handbook of Economic Sociology (New York: Russell Sage Foundation et Princeton University Press, 1994), Chapitre 22.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 68
.6.1
84.1
38 -
30/
09/2
013
19h2
5. ©
EN
S C
acha
n D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 68.6.184.138 - 30/09/2013 19h25. © E
NS
Cachan
![Page 1: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: [2003] Mark Granovetter - La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010709/631242155cba183dbf06907f/html5/thumbnails/41.jpg)