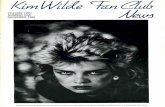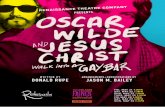« Salomé de Wilde et le Cantique des cantiques : de l’orientalisme à la subversion », Wilde,...
-
Upload
republique-des-savoirs -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of « Salomé de Wilde et le Cantique des cantiques : de l’orientalisme à la subversion », Wilde,...
Actes des Journées d'études(23 & 24 ovril 2012)
'Wrron, W'eucn, CunstnRton,
trois humeurs britanniques
Institut Catholique d'Etudes Supérieures
$::iiiï#
'Wrron,'W.rucu, CHrstrntoN,trois humeurs britanniques
Actes des Journées d'études
23 & 24 avril 2012
Presses Universitaircs de l'ICESCo||e.i\in C0 tb qu6 (2(t1 4)
l7 Bd dcs Belees'85000 L3 RochcalrYor
Salomé deVrdde et le Cantique des cantiques !
de I'odentalisme à la subversion
Jean-Bapriste Avaorau
C^RS. inîet\e dnt à I'ICES
La seulc pièce de théâire composée par \\rildc en languc ûançaisc,Sd/o7rl (1891-1893), reprend et translormc 1a célèbre scène lors delaquelle la fi1le d'Hérodiadc darse devant le tétrarque Hérode Lamodilication la plus ftappante que \ÀIilde fait subir au récii ivangétiqueporte sur 1e personnage de lajcunc û11e- nommée Salorné dans I'histoircde Flavius Josèphe. L'héroitle de \\ri1de del1lande de sapropre initiativc 1a
tête de Iokanaan dont e1le est éprise d'unc passion non réciptoque. Aprèsqu'on lui aprésenté la téte slllunplaleâu d'argenr, elle baise labouche duprophète décapité. Si 1'amoul de ]a 1ll1e d'Hérodiadc pour Iokaraan esléûanqù au Nouveau Testament. \\'ilde sc sertpoutant d'un autre livre delô Bible poul mettrc c11 scène la con\.oitise de Selomé. La célébmtion ducolps du prophète el I'expression du désir de lajeune lille reprenncnt desexplessions du Cantiquc d,.s canti{]ues. l\,lais les réminiscences du poèDcbiblique ne conccrnent pas seulement la corlcupiscence dc Salomé:les échos du Cantique affectent la plupal1 des perso1lnages. y comprissul des sujets sims rapporl avec la passion amoureuse. L'impÉgnationdu Cântique 'Jans Salonlë nc va pas de soi. Quel cst 1e sens produitpar la co ftontation inattendue enûc ies récits néotestamenlaires de ladécolletion de Jean-Baptiste er 1e poème érotique dc 1'Ancien Tcstanentlongtemps intclpré1é comne une allégorie 1nystique de 1'a1l1our de Dieuenvers Israël oLr l'Eglise I
Les iDages ct lcs expr'essions du Cantique imprègnent lapièce dansla bouchc dcs pcrsonnages amoureux! mais cncorc dens l é\'ocation dc ladivinité. Sj, à première \-rre, la rcpdse de roLLrs doDne au texte un stvle
t2
oriental. les échos capitaux invited à une comparaison entle les deux
textes, tant le alrame subvertit les velseis fondameûtalrx du Cantique Au-
delà du Cantique lui-même, 1a pièce iûterroge la tradition helméneutiqre
du texte biblique qui descelle une iûterprétatiot spirituelle sous le sens
erotique littéral.
I - Présence du Csntique duîs Salomé
De nombteuses images du Caûtique des cantiques apparaisseût
daas Salomé de Wilde Le jeuûe Syden s'adresse ainsi à Salomé :
< Pûncesse, priûcesse, toi qui es coûme ur1 bouquet de m)'nhe, toi qui es
la colombe dis colombes, De regalde pas cet homm€, ne le regalde pasrl >
Les images rcûvoient au Calrtique : ( Mot bien-aimé est pour moi ùn
bouquet-de myrrhe > (1, 13) ; la bien-aimée est comparée régulièrement
à uni colombe : ( ma colombe > (lI, 14 ; v, 2 ; vI, 9) L exgession
< colombe des colombes >i r€nvoie au superlatif odeûtal à la rnanière de
< ca[lioue des canliques t Herode s'adresse à Salomé : ' vous qul etes
la plLrs ùelle de routes les filles de Judée "'. reprenaDt le même éloge de
l'époux du Cantique à sa bien-aimée : < ô la plus belle des fe$rnes ))
(I,8;V 9;\4, 1).
Les échos De se limitent pas aux rep.ises littérales ; le spectateur
ou le lecteu trowe des fomulations qui condensent plusieurs images
épaxses du Cantiqùe. La princesse Salomé s'adrcsse ainsi au prophète :
( Je tr'Âiûe pas tes cheveux. C'ost de tâ bouche queje suis
amoureuse, lokaÊâaû Ta bouche est corlme uîe bande d'écarlate
sul ùne tow d'ivoùe. Elle est comme une pomme de grenade
coupée pal un couieau d'ivoires )
i viiii s,r-;, ea. u*l ,"6.n, tuit Fla@ion, o!1 GE 2006, P 87 ta tÉdurions
f-*" a, *,.*. t-j--, de ç-;rr o' sav a o' FÙÙ l è_ di6c L de dèerninÛ
, ta,l* -"." .. pl' vta. , È ..ho, ;"Porcl n I Jts"r '- nerr or chaue dcq tntoo"
a. bA., p. 83'85.
Le propos mpproche divdscsbiblique :
Saloné deWildeTâ bouche €st coûùtre rme brlibd'écarlate
sùr une toùr d'ivoir€
Elle est cornme rme ponme rbgrenade
Si le langage imagé du CaCià I'amour, au point d'avoir maqrrÉ ircprises par Wilde coDcem€ût d'dimages ûr Caûtique pour pârl€f, de r
( Il y en a qui dtscdqmais je ne les cloir Êmontâgnes, les ch€æùdles ai appelés parlaEq
La replique coDdeNe lil-€&poru les appliquer à ule aùhe !éatril
( Sois semblable, rbiches, sur ies moùtugripendant les nùits, j'ai ûche.ché, etje rc l'aipdd
( Mon bieÈaimé s'echerché, et je ne I'ai pddrepondu. ) (V 6.)
4, Ibid.,p.53,
l3
Le ploposrapprochc diverses expressjons dispctsées dans 1e poènebiblictue :
,Sdlarrl de Wilde
Ta borLche est comme une bân.1e
srr une rorrr d'ivoirc
EUe esl comme xne tromnle degrenade
Cantique des cântiques
Connne un lil d'écarlare sont leslèvres. (nl 3.)
To. cou esl comme Lrne lour d ivoirc(vll i.)Le pfflun de ton souf8e comùrecelui des ponlnes (VIl, 9 )Ta joue esi comlne !L.e moillé de
srenade (I\', 3.)
Colnlne lâ Loû de David est knr colr.Comme une rmnche de grenade esr
ton cou. (l\i.1.)
Si le langage imâgé du Cartique s'appli$rc prcsquc erclusivemenià l'amour, au point d'avoil merqué 1â topique amoureuse occidentale. 1es
repdses par Wildc concement d'aurres sujets. Le Cappadocien utilise desimages du Cantique pour parler de ses dicur chassés pâr les roûratns i
( Il,y en a qxi disent qu'iLs se som r'él'uglés dâns les rnoùtagnes,mais le ne les crois pâs. Moi, j âi passé ùois l lrs sur 1es
rnonlâgnes.les cherchân r parlout. Je ne les ai pas lroLrvés. Enlqjeles ai alpelés par leum nons ei ils n'onl pas paru'. r
La réplique condensc là-encorc dcs inaqcs tirées du Cantique,pour lcs eppliquer'à une autre réaiité que I'amoul :
( Sois sernblâble. lnon bien âjmé. à lâ gâzelle or au faoû desbiches. sor les montâgnes qui nous sépareû. i Sur ma colrche.pendânt les .ujts, j ai cnerché celui que mon cæur ânre ;je l'aicherché, et te ne l'âi poilrl lrouvé... ' (II-17 IIl, 1.)
< Nlon bierl-aimé s en élait a1lé, il avali dispaùr. 1...1 Je laicberché, elje ne l'âi polnl trouvé : Je l al appelé, et il ne m'â poirr#pondu r (\: 6.)
14
( Fuis, motr bien_aimé | sois semblable à la gazelle ou au faon
des biches, Sur les monlagnes des aromates | ) (l/m, 14.)
Wilde déplace les images aûorùeuses à la question des dieux
cachés ; le transfett, s'il semble ha.hir le Cantique, t'est cependant pas
inldèle à la tvadition itterprétative du Cantque qui voit dans le poème
érotique rlne allégorie des rapports etrtre l'hùmmité et la divinité
Sslorné àeWilàeTes cheveu-{ ressemblent à ibsgrappes de misins, à des grapp€s èûisins noirs qui pendent des vigEd'Édom dans 1e pays des Édomiùes,
Tes cheveux sont comme tes cÈd!€rdu Libai! comm€ les gânds (ÈdrEs
du Liban b.83-85)
En outre, le laûgage imagétblet d'une profonde éhangete. tr accûrles polysémies, les disslméhies Époint de \,1re, il offre uD modèle pomystères. Il foumit des imag€s;rEfiÈd'un style exotique, par ex€rnple houne tour où sort susperdus les bdsorte le corps de Iokanaan : ( C'ffid'ivoirc6 )), en écho à un verset ù Clde David, bâtie pour êtle ur axsd(rv 4).
À l'étangeté des compeai!d'auires traits d'écritwe. L éloge de fdoublée d'un compaxatif. Le Cadgenle : < Cofilne uD lis au mfiqr dles jeunes filles > (II, 2), se nï@Ëcôté, parle un laûgage similaire : { Iil se distingue etrhe dix mille. Sa €flottântes, noires colnme le cdùeaprocédés stylistiqùes semblableg dIokanaar par Salomé :
( Ton corps est blæ r
n'a jamais fauché. Tm ccouchent sur les !ûônl'gE
II - Sens et usages du C ùnliqlùe d^\s Salomë
1) Le choix d'un lLngage ofientûliste
Wilde puise dans le Cattique des expressions et des toÙs palticÙ-
liùement imagés (double ou triple comparaisoû), plopÎes à un style jugé
oriental, au seDs ou il déûiÉit de façon analogique en multipliatt les
compaÉisons, plutôt qu'il ne définirait directement et de manière immé-
diate. Cette domination ilo la seNation et de la poésie sul la pensée Étion_
nelle, propre au Cantiqùe, incamerait un laûgage orieDtaliste idoine pour
le &ame biblique. L odedalisme à l'âge romattiqùe et poshomantiqre
(ou emor€ décadent) repose sur un ensemble de thèmes : rcssourcement
iûitiatique, exotisme, couleù locale, Orient conme lieu de fantasmes
or) la tyranDie se mêle à l'&otisme, la pourpre au sang, lieu fasciflant et
rcdoutâble, lieu de volupte, de bizarrerie et d'ivresse L oriettalisme n€
se limite pas seulement à des thèmes, i1 existe aussi un style oriental, non
sans lien avec les motifs eux-mêmes La volwte et la sensualité attribuées
à l'Orienl supposeDt eD eflet une acuilé des cinq qens : musique. par-
fum de fleurs et d'encens, goût de ftuit, de ûie1, d€ vin, caresses, beauté
plastiqùe, couleu$ chatoyalltes. Le Cantique foumit une sorte de réper-
toire d'images dans lequel l'écriture orientaliste peut puiser. Cos images
servent à étoffer les blasons de l'êtle almé :
Salrnrl de Wilde
Tes cheveux r€ssemblen! à des
eïappes de raisins. à des srappes demisils noirs qui pendenr des vigesd'Edon] dans 1e pays des Edomit€s.
Tes cheveu{ soni comme 1es cèdrcs
du Liban, comme les erands cèdr€s
du Liban (p. 83-85)
Cântiqu€ des cântiques
Ta taille ressemble âu palmier, e!res seins à des srappes. [...] Que tesseins soient comme les graples de lavigne (\ill,8-9.)X{on bier-ain1é esr poru moi unegrappe de roëne des vignes d'En-Guédi. (I. 14.)
Son visage esl com111e le Liban,disti.gué conme 1es cèdres (V 15.)
Elr oulle,le langagc imagé du Cantique est dépaysant ct m] stéricux,et d'une profonde étrangcté. Il accumule les comparaisons etmétaphores,1cs polysémies, les dissymétries et les qucstions sans réponses. De ccpoint de vue- il offie un modèle poul l'imeginâiæ .le l'Orient pénétré demystères. ll fourn it des images inattuldues etsurprenantes, caractéristiquesd'un style exotique, par cxemple lacomparaison ducorys de l'être aimé àune tour oir sont suspendùs les boucliers de $rcûiers. Salomé décrii de lasode le corps de IokenaâI ; ( C'était une tour d'arge11t omée de boucliersd'ivoirc6 r, en écbo à Lrn ve$et du CâDdquc : ( Ton cou est comme latourde David. bâtie pour être ur1 anenal ; mille boucliers y sont suspendus t(r\" 4).
À l'étra geté clcs compar'aisons. s'ajoute lelu supcrposition à
d durrc,[a r.d icr:r, e.] e ogeoel èrre,rimepa..ep" rrccô'np"rar.odoublée d'Lrn compârâtil Le Cantique abonde en lonnularions de cegcnre : ( Colnme un 1is au milieu dcs épincs, tcllc esl mon amie parmiles jeunes filles ) (II. 2). sc réjouit 1e bien-aimé La Sulamite, de soncôté, parle ùr langagc similaire : ( N,Ion bieD-aimé cst blanc et vcmeil :
il se distinguc cnfie dix mille. Sa tête est dc ]'or pur ; ses boucles sontflotlantes, noires comme lc corbcau. )) (V, l0-11.) Witde utilise desprocédés stvlistiques scmblables. telle cette contempletion du colps deIokanaan par Salomé :
( Ton co4rs cst blanc colnme ]e lys d'un pré qùe le faucheurn'a Jamais fâLLché. Ton coes esi blanc comme les ueiges quicouchenr sul Les nonLâgnes. comme les nejges qui coucheni sû
16
les montagnes de Jude€, et descetrdent dans les vallées' Les roses
du jardin de la reiDe d'Atabie ne soût pâs aussi blanches que lon
corps. Ni les roses dujarditr d'Arabie, dÙjardin partumé de la reine
d'Arabie. ni les pieds de l'êuore qul trépigænt sur les feuiles, ni
le scin de la hme quand elle couche sul le sein de 1a mer' 11 tr'y a
den au moûde d'aussi blanc que ion corPsr' )
oulre les compan isons-compamd lç. l'imagerie puise dans le
Cantique les ûétaphores dujardin parfuûé (VI, 11 et ry 16), de l'aulore
(vI, lô), du lys, de la descente dans les vallées Cepen'lant, les tours et
ies images du Cantique ne se limiteût pas au seul rôle de dictionnaire pour
une compositioû orientaliste
2) Le choi* de la subvefiion : Saloûté co' me antils lLmile
Dans le canÙque' lâ bieD-aimée célebre le corps du bien-aimé :
< Ses jambes sont des colonnes de mâxbre blaûc, posées sut des bases
d'or pur. > 1V, 15.) L'image est repdse mais travestie chez Wilde dans
une célébration du corps de Iokanaan par Salomé | ( Ton corps était Ùne
colonn€ d'ivoire sur ut socle d'aryelrt > (p.163) Lh&oihe compare le
colps à rme coloDne posée sul llII socle Mais le matédau diffère I i'ivoire
se substitue au marbre blanc : cette différcnce reste minime dans la mesule
or) elle nraintient la blaacheur' Plus significative esi ia mo'hûcatioû du
socle : 1'or alû Cantique cède à l'argeDt chez wilde ce détail est révélateul
de la transfoûnatiot subie par le Cantique dans Salomé Uimaginure
solaire du chatt bibliqre dispaÉît dans le drame au plofrt d'ùn imaginatue
lunaire.
Cette sùbve$ion du solaire en lunairc conceme surtout le
Dersomase ceDral Îémioin. La Sulamite du Cantique se décril en
iLrvertnre-du premier cbant comne noire. selor le larrteltx Nigra sun sed
ôrzrosa : < Je suis noire, mais je $ris belle [. ] Ne prenez Pas garde à
iooi"io, noi., "'"ut"
s;bii qui m'abrûlée )) (I,5-O À l'éciat solaiæ et
bnrn de la Sùlamite, s'oppose la pâlerir lunaire de Salomé Elie entretient
en effet uD rapport déterminaDt avec I'asfte de la Buit La pièce aûnonce
dès l'expositon cette prcximité eûtre lejerrne fille et la lune selon un
ïapprccÉement commun dans la litténture 6n-de-siècle :
L! I!(JI\E S\TEN.- CGLE pac! D'IIÉRoDras_ Rr
dirait lme feme qifemme morte- Or(Ë
L! JIUI,E syrEr.- EIb Ipetite pdnæsse qli FE1le ressemble à e
. perires colonbestL
Outre la beauté, Saloûé €s{le coûstate le jeune Syrieû : < Cdl'ai \,Ùe si pâle. Elle resseûbtre 4rd'argent7. > De même Hé.ode cdhès malaale, votre ûlle. Jamaisjc Imanière, Salomé pourait dire, à lTmais je suis belle. > Mais es-€e Lpar le jeune Syieû de la l@ à.ressemblent à de petites colodÊs Ila description de Salomé s'EIrnêE
Salord. J'atr€ù& qÉlles sept voiles dm'û
Les esclavs qp.udasa dalet desaloDâ
HÉRoDE.-AI ! vG&pieals seroar clmià des petites ûâE lù
L'a.nalogie enûe Salomé €aiemédiate de ce dialogue. Tdt ùd'une modification de la lme:
6.
7.8-
9.
t1
LE$L a SyruEN. Coln1ne iaprincesse Salomé es!be11e cesoir l
Lr p!.cr D'HÉÀoDr.{s.- Regârdez la lune. La lune â l'ajr éra.ge. Ondirair une femme qlri soû d'un iombeau. Elte ressenbte à rnlefeame norte. O dimil qu'elle cherche des morts.
LF rE]r\F stFl!\. Elle a l'â1r Lrès éirunge. _E1le rcssemble à unepetite prjncesse qui pone u. voilejaune et a des lieds d,a.geni.Elle rcssenble à Lu1e prillcesse qui a des pieds comn1e despeirles colombes blâncles... On dirait qu'elle danse6
Outle la bcauté. Salomé est décrite d'emblél3 colnr11e pâle, commcle constatc lejeune Syrieû ; ( Comme la pdnccssc cst pâle I Janaisje nc1'ai r.ue si pâle. Elle ressemblc aù rcflet d'une rose blanche dans un miroir.d'argenr7. ) Dc môme Héro.le conie plus tard à Hérodias : ( Elle a I'airtrès maladc, \iotl€ fille. Jamais je ne l'ai \,ue si pâ1er. ) D unc certainemanière, Salomé pounait dire, à f inverse de ]a Sulamitc : ( Je suis pâle,mais jc sùis belle. ) Mais est-ce la lunc qui 1'a temie ? La comparaisonpar 1e jeune Syrien de Ia lunc à une plincesse voilée donr 1es picdsressemblent à de petites cololnbes blanches et qui danserait correspond àla description de Salomé s'âpprêtant à danser devant Hérode ;
S,\roù. J'aLte11ds que n€s esclaves m'apporrenl les pariiLms etles sepL voiles et m ôtenr les sandales.
Le! e\.ltes arporle t .les patjms et les \ept wiles et ôlent tesv dales de Salône
HÉRoDr. Ah I vous allez dânser pied nu I C'esr bjen I Vos pedtspieds serom conme des colorubes bLanches. ILs ressembLeront
à des pedLes lleurs blanches qui dansent sul un arbre,
L'analogie enûe Salomé et la lutlc se prolonge dans la sùiteimmédiate de ce dialogue. Tout changement chez Salomé s'accornpagned'rue modilication de la lune :
HiroDE. 1...1ELle vâdanserdans 1e sang llly adu sangpartelle.Je ne veLLx pâs qu'e1le dênse dans le sang. Ce selâù un très
mauvais présâge.
HËnoDt,\s. Qu'esi ce que cela vous fail qu'elle danse dans lesans I Vous avez bien marché dedans, vous...
HERoDr. Qu es!-ce que celâ nle fâii ? Ah l regardez 1a Lune I ELle
est devenue rouge. Ell€ esr devenue rcuge cor ne du sang1o.
Comme dans 1e Cantiquc, le dnme de Wilde éablil ùne
cofespondâncc cnlre le personnage féminin cenûal et un astre doot i1
esl 1c rcflet. Alors que le solcil iûadie la Sulamite du Canticluc. La luncdcvient I'asfle emblématique de Salomé. Sa pâ]eu s'oppose au hâle de
la Sulamire, comme l'argent se substitue à l'or. L'imaginaire éclâtent dLr
CantiquÈ est ainsi subverti, ou penefii dans la mesule oil la pâleul est
le \.e6ant morbide de la blancheur. Lc désir lui-même de Salomé pourIokanaan vire à lapen'eIsité. La passjon châmellc dc lajeune frllc se môlcd u'c llaine ron;lè e - ig.rrd dc érre "ime
La subversion du Cantique tient aussi aux rapports amoulcux,Alors que le Cantiqùc célèbre I'amour réciproque et patagé, les relations
amolueuscs dans Sdlor?é sontunilatéralcs. Hérode poulsuit de ses ardcusla pdncesse Salomé ;cetle dcmière, indilTérente à ]'amour du roi. brû]epour le seul lokanaan;mais le prophète nepartagepas cet amorr,lui dontles affcctions sont consâcr'ées à Dicu seul. Dans ce tdo. Salotné est ie
personnage central : elle est aimée par'celui qu'el1e n'aimepas ;e11e aimequi ne l'aime pas. C'est clle qui emploie le pllts lc langage amoureux
du Cantique pour témoigner de sa passion polu lokanaan. Cette Èpriseper'vertie du chant bibli{:luc par Salomé s'appliquc aux deux moments-
ctés du Cantique : l'ouverture du premier chant et l'envolée du chant
final. Le premier vers dLl Ca tique exprime le désir dc la bicn-aiméc :
( Qu'il rnc bâise des baisers de sa bouche | ) Salomé reprend le nêmedésir; mais le simplc souhait de la Sulamite dcvient chez Salomé u11c
injonciion et une prophétie mcnaçante : ( Laisse-lnoi baiser tabouche )"(paI rois fois) et ( Je baiserai ta bouchc, Iokanaan ,r: (sû fois). La
prophétic se réalise après la décol-:::ibouche de la têie décapitée de loli::::j'ei baisé ta bouche. r Le n1onoloÈ_:reprcnd aussi lcs vel.sets clu deml: :de Iokanaan présentée sur un D;è:-.:cadatre :
< Er ni te lir ni t!. :_ferâisje. rokanaar. r]:::::ne pounâierr érernd,- -:est phrs grand qre te :..!:1'âno!ri,. )
Ce rnonologue final de Sa-o::J:chant du Caltique :
( Me15_1noi co!r::: i:sur ion bras : car i e-,.ri :nfexibte côlnme tr !-:.- :de Îeu. lrne flâmlnÈ Èi .:érelndre i,amour e:.:! :(vrll,6_7.)
Il reprend aussi la seconde :=beise des baisers de sa bouchc I C::(répété dans IV 10) er du rersci: .
qLLe lc vin ) (t,4).La ptésence de versets lbr.:-
momcnls capitaux dc l.il1d.ig]e. aa:.dénouements, invitcnt àune Lccr-,rra ;a :( l'a our estplus fo quelamon,,:::dans le conrexte de Selomé et rle I cr.::une interprétation pencrse de l c\f:alrepose sur un débat intelptéralil O: :a soulevé le plus dc colnmentaires :: aavec lui des strates d'interyrétalion s :::sont devcnues indissociables.
t9
prophérie se réalisc après la décollarion du prophète : Salomé embmsse labouche de latête décapitée dc lokanaan : ( J'ai baisé û boûche. Iokanaan.j'ai baisé ta bouchc. ) Le monologue dc Selomé. avant ces dcmiers motslreprcnd aussi les versets du dcmicr chânt du Cantique. El1e saisit 1â rêtcde Iokanaan préscntée sur un plateau dlargc11t et déclare sa flemmc eucadavre :
( Ei ni le vù ni les liuiis ne peuvent apaiser 1non désir eueferâis-je. Iokanaa., nainlenant I -'{i 1es fleu ! es ni les grandes eauxne pourÎâienl éleindre ma passjon. 1...1 le mystère de L'âmolrrest plus grand que Le mystère de la rnolt. Il re faul regarder que
i'amoLrr'r. r
Cemonologue finâl de Salomé reprend I'envoléc llrique dudeniercbant du Caotique i
( l4els-moi comme un sceâu sur lon ccur. corùne un sceaù
sur ton bras ; car L ân1our esl fo{ comrne la molt. lajâlousie eslinffexible con1me le séjourdes morts ises arde|rs sonr des ardeursde îeu, une flâlnlne de l'Etemel. Les grandes eaux ne peùventéteindre l'ârnorLr ei les fle ves ne 1e subrnergeraienr pâs )(vrrr, 6 7.)
Il reprend aussi 1a seconde panie du preDier \,crset : ( Qu'il ûebaisc des baisers de sa bouchc I Car ton amour vaut mieux que le vin )(lépété dans I\i l0) et du verset,+ i ( Nous célébrcrons ron amoùr plusquc le vin ) (I,,t).
La présencc de \'ersets londamentaux du Cantiquc au sein desmoments capitaùx de l'intrigue, notaûnncnt lcs échos entre lcs deu\dénouements, invitelli àunc lccturc compal€e des deux textes. L'cxpression( l'amour cstplus fon que lamort) acquiert une signifrcarion pafiiculièredans le contexte de Salomé et de l'exécution du prophète. Ne serair-ce pas
une inieryrétation pcNcrse de l'expression ? La subversion du Cantiquerepose sur un débat intclprétatil Or lc Canlique est le texte biblique quia soulevé lc plus dc conmentaires et d'interprétations. Le poème chafieâvec lui des strates d'intelprétations rabbiûiques et ecclésiastiques, quiluisont deveûucs indissociables.
III - LÀ fradition interprétative du Crntique dÀns Suloné
t) Copftsence .tu Cahtique el .le sa trudition inlerptétLtive e|1
La présence du Canti+re dans dcs ceuvres littéraircs s'accompagne
parlois d'une présence de la radilion inicryrétative du poème bibliclue,
des hésitations sur Le sens dc I'i:euvre, en pafiiculier de l'hésitation enûe
ulle 1ecùre liuémle c! érolique el une lectule allégorique et spirituellc
Dominique N{illet-Gérard a monlré. daûs Ze Slqre el le scealttl lneielle présence de 1e fadition illierprétative dans Le Lts dans la wllée dc
Belzac. Lc roman ne Lloit pas seulemcnt au Cântiquc son litle (1( /lli?r/,
canvatliun t clcII,l), des citadons et dcs réminiscences. ùlài! unc pa
du resson romanesque. 11 nc sullt pas de percevoir lcs échos du Cantique
dans Le L,tr dans la tallée ; i1 làLr! aussi considérer l héritage interyrétaiil
dc l'hésitetion entre la lectllle châmellc et la spirilucllc Grâce à cette
perspective. 1c tiraillement d'HeDdette enllc un amour physiquc ct un
amour argé1ique. el le conversion de I attiràncc seruelle qu'évei11e cn
elle Félix en alnoul chasle, plesque nlyslique. prenncn! une prolondeur
inédite. De même, i] esl possible de \,oir dans 'Sdlorré rlon seulemcnt u1]e
réécrituc parlielle el subveÉie dù CatrtiqLle, mais une préscnce des débâts
heméneutiqucs autour du Cantique.
2) Dëbat entrc cottprëhe sion sensaelle et compréhe sion
spirit elle
Le clébat herménculique eùtrc corrpréllension seDsueLle et
intcryrétâtion spiiruellc lient à 1a lois à 1'usage dcs citations du Cantique
parlcpersonnagc de Salomé ci au sens qucics divers personnagcs donnent
aux paloles sibyllincs du prophèie Iokânâân. Les reprises du Cantiquc
pâr Salomé prcn]rent touies u1re sigûifrcation litiérele c! érotique, paÉois
mêùc ( hvpellil!érale )). Aillsi. ( I'amoùr cst plus fon que la morr , esi à
eniendrc dans un sens paficuit:r :cadavrc de Tohanaau ne décou:::: :
Cepcndânr lc débat h.r j::..pièce. potte srn l'inter?riiaticir ::.pes inrmédiar. lout conrne lc C: ::déroulant dcs livres de ia Bib : ::::l Ecclésiasrc et le li\le de t: S:,:::proprc à embanesser les lecle..r. : -
parlcnt- se perdert ct se chcr..: : j
sont. oil ils sont. dc quoi rls ::: ::dialogue, ce double soliloqu..- :::des dil'ûcuttés de svnralic : l: :::.discemcr les changerncnts cic - .-::..au sein dc la phrase et brolt ::rnélaDge du passé ei du furLû. :; .lrttéra1n'est pas transparcni à r: : .
des oontlcntaircs el]égoriqu:!. l ::-qLosateurs religieur ont propL,,ridu Cantiquc. qui lgurerel ùr:,:-1'amour de l)icu pour 1'Éellt:. ::du Christ poùr I'âmc hunain:. . :::richatologique du Créatcur N..: .::interprératil colnplique le seû! : :saisir
Dans Ia piècc de \\ rlc:. : -:Iokanaân. Onnc saitniqui r-.i: :: :_l oicrten iûi (unsai.thomi:,ou le prophùre Étie lui-môine _
_r \r:ilt:,.s,n ,i, id .1., | _iila l.!(.nd soldr! innr,f. jt: qlFde i sri,mi : . e nrir sû .:
l.r. D.ù,riqù. -\liLlcr Cé1!i, i? Silv i L QrL Uûi1.û^ !rt;1r,6 ltt i ' ta!,'ilùt Js ù,ii4!ù '.G.nirî Libn;i! Dtuz, .olL. ll(roil .1:, i&û .t rt qùe lnrânft lol 160l, :0l0 L1nith.I LL!
p eir rti.h dù:t betrL..up i.rtt érùre n:gi.tuLe liJée rl( (. ijril r: :nrr à Io(.?iion Ji Lr
l
L.h€ t !jr. .fr a .r r! J,! Lrsrlori lolLlrrrttiqLrri,.i i : .'onrle \rârim, l'idÉf,tr:(riôr : F.:: r:: = :
rtuphèr Éi. [Ur \rzd.n_ rtli :, ., : : .
2l
cntendre dans un sens parliculier. plus que littéral voire nécrcphilique : lecadawe de Iokanaan ne décorrage pas Salomé de baiser 1a bouche d'un1110ft.
Cependant le débat herrnéneutique, lel qu'i1 est verbalisé daûs lapiècc, pofie sur l'interprétation des paroles du prophète, dol1t 1c sens n'estpâs immédiat, tout coûme le Cantique. Lc chant cst sans doute le plusdéloutant des livres de la Bib1e, bjen sûrpar son érotisme inattendu entrel'Ecclésiaste et le livre de la Sagessc, mais suriout par sa compositionpropre à cmbanasser les lecteurs cartésiens, Deux amants s'appcllenl, se
parlent, se perdenl et se chcrchent sans qu'on sache exactcmenl qui ilssont, où ils sont, de quoi ils parlent, ni même lequel des deux parlc. Cedialogue, ce doùble soliloque ou cctte compilation dc poèmes, renconhedes ditlicultés de syntaxe ; la conslruction ne permet pas toujours dediscemer les changemcnts de voix, peut passd dLl masculill âu fémininau sein dc 1a phrase et brouiller I'hânnonie temporellc du textc par lemélange du passé et du fùtllr, de 1'accompli ct de f inaccompli. Le sensiit!érâ1n'est pas ransparent. A cette difôculté pteûi ère s'ajoute la variétédes commentaircs allégoriques. Depuis 1e Midrash jusqu'à Claudel, lesglosatcùrs religieux ont proposé toutes sofies de lectures symboliquesdu Cantique. qui flgl]Ierait tour-à-touI l'amoul de Yahvé pour Isreè],I'anour de Dieu pour l'Égfise, 1'amou dir.in pour la Viergc, l'amour.du Cfuist poÙ1 1'âme humaine, I'amoul tdnitaire, 1'amour béatifique eteschatologique du Créateu poul ses sâints, erc. De la softe, I'héritagcinterprétatil compliquc le sens d'un texte déjà littéralement difllcile àsaisir.
Dans la pièce de Wildc, le mâne problème sc pose au sujet dclokanaan. Onne saitni qui i1est, ni ce qu'il racontc. Cetajns pcr.sonnagesvoient cn 1ui ( un saint honnlte ))rr, < un prophète )'6, uû cnvoyé de DieuLrou le prophète Elic 1ui-mêmelr. L'incefiitùdc sur son identiié se double
li. \r'ildc, $/,,1, éd. .ir, r. tt16. fur.ond\oldr, /,id., p tt.17 Hérode à S?loné:. Je suis sù qù iLlienr de Did'. Ci\r un Jint hônme l-c doiÂr de Dieu t,trmrdié. l. ..1 DùiJ le pâlan, onne drx le désr D,a en Ftrjùrs xvc. lùi. " fôr.1, p. I5ll13 rtse.ordlndrexiiqu!ainsi .onneLstrps ilf ènâqui Ji.!ûque.d.ÉlÈ."i|ùrl.,f.67)
'\.. 'oe ' 'q'." ...1.. -' \l .. e
22
d'uûe iûcefiitÈd€ sur le seûs de sot propos. Hérodias est persuadée que
les paroles de malédiction prcfétées par Iokanaan concement son ûr:!ri et
e1le ; Hérode De partage pas son point de l'ue, puisque le prophète ne cite
aucun nomle. Face aux éûigmes du laûgage Fophétique, trois attitudes
interprétatives sont possibl€s :
-une interprétation sacée : par exemple, celle d'Hérode : < Je ne
comprends pas ce qu'il a dit, mais cela peùt êhe un présage )l'zo ;
- ùæ interyrétation absurde : celle d'Hércdias : < Ce Fophètepâde comme utr honrme ilte?l . . . > ;
1m9 interprétation sensuelle : celle de Salomé : < Parle elcote,
Iokanaa[ Ta voix m'etir'Te". > À f iwe$e d€ la tladition interprétatire
du Caûtique, qui lit dans ulr poème éroti$1e ùne parole prophétique,
Salomé saisjt la parole propbérique de lokanaan comme une musique
érotique. Lorsque le Fophète f invite à houver la guérisoD et le salut
auprès du Fils de l'homme, loin de se repeDtir, Salomé se montre attùée
par le sauveu : < Qui est-ce, l€ lils de i'homlne ? Est-il aussi beau que
toi, Iokanaan?r ? ) Salomé ne pelveftit pas seulement le Cantique, e1le
sub\e,lii aussi la tradirioD inl-erprétative du poème.
3) Légirtm é des cot tpÉhensiorls dllégoriques : images .la sens
scellé
l-a réflerion sur la compréhension allégoriqre dù Cantique s'est
appuyée sur les ve$ets 6 et 7 dù chant final, cites plus haut aù sujet de
l€ur perversion par Salomé :
des ardeuis d€ feu, @lpeuvent éteindie l'@
Selon Dominique Millet4éCântique et de ses interyétatiG-version hébmique, explique-t-elle, 1
imFoaonçable YIIWH. Cefie ùitDieu daas le poème concorde ay€c I
main, à la manière des phylaaGr€s- ,est le pacte qi unit les amants. .færiainsi que les corutrentateùIs l'(É rqui < Dieu ne se colnmudque qE a
au sujet du vemet eD questior : c (de cacher et qui selt au cotrtàitÊ l
continuité de la lectuÎe métalilt&dtde f inteûogation de Ricceur se dælde cet amour] n'est pas daûs le clGâard voit dans le srgn aculuml,jsaheméûeutique c4rpté€: < il fu(fmarqué du sceau de I'amorll diviû Fà ce contact, éûe illu-rninée et aiNi Èou cachet du verset représeûte à hle baiser qui scelle la renconhe akcoftpréheDsion entle le lecte|rr et best littéraleûent le tétragamme abnqinvitation à décoùvrir te sens ûystltriAu sceau conclet, s'ajoute le srigrû.rmétaphodque.
L€ monologne fnal de Saldrles vemets, à l'exceptior de laprotnce qùi est scellé, cacheté ou caché ecamont, comûe elle apparaît aùssi d8ma sceur, ma fiancée, une sounce jRr!L€ lieu felmé et scellé dans le (hâJrE i
( Mets-moi coûrme Lm sceau biSTrac?lûnl sur totr caeur, colmne
un sceâu sur ton bras ; car l'aûollr est fod comme la mort, lajalousie est fuflexible comme 1e séjoùr des molts ; ses arileus sont
pd le psphèe Élc, , (.Irid, p. 109).
19. Voir t d.,p,10t d n9.
2L lbnl.,p,125.22. It l.,p.aL23, Jbid.,p. a1, 24, Dooinique Milld-cétrd, L e SiEne et te @
23
des ardeurs d€ feu. une ffamrne de l'Érenret. Les gïâDdes eâux nepeuvenr éreindre I'a 1out. et les fleuves ne le submer gerâielrr pas. )
Selon Dolniniquc \lillel-Cérard, ce verse! conliendrait 1a clé dùCanticluc ct de ses interprétalions. Le sufixe du demicr tenne deis 1a
version hébraT$re, cxplique-i-e11e, est la lô1.mc abrégée du tétragranmeinlprononçable YHWH. Cette uniquc et discrète apparition du nom deDieu dans le poème concorde avec l'image du sceau sur le cceur et sur lamain. à 1a manière des phylactères. ArL sens littér'Âl et amourcux, le sceaucn 1e pâcte qui ulit les amants. .$grdrrrrm est aussiun indice d'allégorie,aiDsi quc 1es commentateurs l'ont compds, par exemple Bossuet sclonqui ( Dieu ne se coûlmunique qu'en se cachant r, ou C1âudel écrivaniau sujet du vc$et eù question i ( Cudcux mot que ce cd.rc1 qui vicntdc &cher eT qui seft au conuairc à montrer, à authentiû* ) Dans laconlinuilé de la lccture métaliitérajre que proposc Claudel du Candque etdc f inteûogation de Ricæul se delnandant ( si la véritâble colrsommation
lde cet amour] n'cst pes dens le chant lui-môme ), Dominiquc Mille!Gérard |oit dans le.T/grd.r/a,r? l'imagc dulivtepoédque eture inclicationhcrméneutique cryptée : ( il laut d'abord que le cæur du lecteur ait étémarqué du sceau de l'amour divin pour que son Ârdeu1 inrérieure puisse,à ce contact, êtr]: illuminée et ainsi enirc\'of le scns du texte )):r. Le sceauou cachet du verset rcprésente à 1a lois la rencontre des dcur amants.lc beiser qui scelle la rencontre dc l'àne et du Seigneur, lc pacie dcconpr'éhension entlc lc iecteùr ei le livre énigmatique, dont la signatLrreest littéralemdli lc tétragramrne abrégé linal La mention du sceau estuneiûvitation à découvdr 1e sens mystique caché ct c acheté pat Te signacului11.ArL scealr concret. s'ajoutc ic r€/?rn abstrait propre à l'écdture poético-métapholiquc.
Le monologue liDal dc Salonéchargéde la tête de IoLaneân reprendles versets, à l'exccption de la proposition sul le sceau. Mais l'image dcce qui esl scellé. cacheté ou caché est poufant présente dans lâ pièce, enamont, co nc cllc apparaît aus s i dans leCantiquc (Tues un jardinfernlé.ma sæur, ma fiâncée, une source feméc, une fontaine scellée. r (l\', 12.)Le Lieu felmé ci sccl1é clans le drame est le puits. la cilcme ou le tombeau
li Domnriqù. illillÉr-(iéûd, I e SEr. d i ye1u,.! .t , u010, p 1.10.
'"i&i
24
dans lequel est emprisoDûé Iokanaaû et d'or) sott sa paxole prophétique.
Hûode a iûterdit l'ouverture &1lieu scellé La demande de Salomé au
ieune Sj.rien d'ou,'rir la geôle de Iokânar! polu voir le prisoonier luiatthe un Éppel de la défe6e formulée par Hérode : ( Mais le tétralque a
formellement défendu qu'on lève le couvercle de ce puits'zs > Le mlthede Pandore s'ajoute au.x éventuelles analogies avec le Cantique. comme
daûs 1â tadition allégorique, ce qui est cacheté, c'est 1a parole sacrée aù
sein d'un univers sensuel. Les paroles de lokamaû, ùsant de pédpbrases
sibyllines da,rls le style imagé du Cantique, d'Isaïe et de I'Apocal)?se,
foÀt l'objet de débats interprétatifs par la cour d'Hérode Lun de ces
débats porte précisément sur Dieu, afn de dételmiûer s'il se cache ou
s'il se manifeste :
LA Volx D'IoKAN,q-aN.- Voici le temps ! Ce que j'ai prédit est
arivé, dit le Seigneu Dieu. Voici le jotu dontj'avais paxlé.
IIÉRoDIAS.- Faites-le tate Je ne veux pas enteûdre sa voix Cet
homme vomil loujoùrs des injures contre moi.
HÉRoDÊ.- Il n'a den dit contle vous. Aùssi, c'est un hès gland
Fophète. 1...1 C'est uD holnme qui a w Dierl
UN ruiF.- Cela, c'est impossible. Personne n'a Iu Dieu depuis le
Fophète liie. Lui c'est 1e demier qLd ait \'u Dieu Eû ce temps-
ii, Dieu ne se montre pas. 11 se cache. Et par coûséquent il y âde gmnds malheurs daff le PaYs
lJ\a rR! tLn. Ln-6n,on ôesaitpas sileprophèIe Éliea rêeuemenr
vu Dieu. C'était plutôt 1'omble de Dieu qu'ii a ure.
UN rRolslÈrG nrF._ Dieu ne se cache jamais. Il se montre toùjouset dans toule cho6e Dieu est dans le mal comme dans le bien'16
Le débat, représentatif des discussions cotsécutives aux paroles
de lokalraaû, se poursuit au-delà de cet extait. I1 fait écho au propos
dù Cappadocien slrI ses dieux ayaat fui da.ns les montagles, dans une
éplique composée d'expressions du Cantiqu€. Le débat suivalrt met en
scène, autour d'Hérode, un phadsien, ut saducéen et delrx Nazaréens Il
Vilde Sal,ré, éd- cit., p. 71.
Ibid., p. 103-105,
est lancé par rrtre nouvelle declat*fermée : ( Le jour est venu, le |rmontagles les pieds de Celui qûi savoir écarté I'hlpoihèse qu'il s'agiJésus. Le second Nazaréen dit à s.n,il est très difncile de le houvqa- ,passages font écho à la tradition iæ
- dans la forrne, par les r
contmdictoires ente les comûreûi&
- dans le fond, au sujet de la1
Médusé par le baiser blaqùÉles réflexioûs sur la divinité c'.+ÊÊconhe uû dielr inconnure. > Iæs ércachée. en particùlier dâns les EÉà trouver. en lien avec Ia positim ùpeuvent renvoy€r au texte du C',rildu Cappadocien. ies images 6 ,allégoriques du Cantique, lismt b tprophétique, scellée au sens difficr]cim4édiate ni évidente. Elle est lm xsemble-t-i1, par le choix et la place ddans la pièce.
Quel est ie sens de la pIfuSnlomé de Wllde ? Pour rçoa&e àl'oralre textuel et I'ordæ stnrcullrltexhrel olr stylistique, le CantiEæ fmcoLeûant au sujet : une la.ngue ori€d:de l'amour. Les échos du Cânri.IEomementstiot < couleur locale )r. Dæs
27.24.25.
26.
est lancé par une nouvellc déclaration énigtatique sortie dc la citcmele née : ( Lc joul est venu, le jolu du Selgneul et j'cnrends sur lesmo tagnes les pieds de Cclui qùi sela le Sauveur dù monder?. ) Aprèsevoir écar1é i'hypoûèse qu'il s'agissc de Césat. iâ discussion ponc surJésus. Lc second Nazaréen dit à son sujer ; ( Il est parioLrt, seigncut, maisil est très dilllcile dc lc trouver:!. ) Dans la foûnc et dans le fond, ccspassagcs lont écho à la tradition interprétative du Cantique I
dans la forme, par les débats, discussions et hvpothèscsconlradictoires enirc lcs commentateurs de Iokanaan i
- dans le fond. au sujct dc la présence divine cachéc ou manilcste.
Médusé par ]c baiscr blasphénratoire de Salomé, Hérode conclut1cs réflexions sur 1a divinité cachée . ( Je suis sûr qlle c'est un crjDccontre un dieu incoraur'!. > Les é\'ocations régulières de la divilirécachée, en particulier dâns les montagnes. préscntc perlour mais dilficjleà trouver, en lien avec la position du ptophère enfe|mé dans une citeme.peuverlt rcnvoyer au lcxtc du Cantique (les expressions dans 1a répliquedu Cappadocien, les images du sccau) colnme aux intclprérationsel]égoriques du CaDtiquc, lisa11t 1e poèrne érotique conrme LLne peloleprophéticluc, scellée au sens dilllcile et incefiain. Cctte lecture n'est niilnmédiate ni é\'ideltc. Ellc cst un second degr'é de lecturc. appelé, llesernblc-i-i1, par le choix et la place des échos au Cantique des cantiquesdans la pièce.
Quel est 1e sens de la pÉscnce dLL Cantique des cattiques dansS.r1or?l dc Wilde ? Pour répondre à la question, unc dissociation erttcl'ordrc textuel et l ordrc shxcturel est nécessaire. Du point dc \,Lre
textuel ou stylistique, 1e Cântique loumit à ]a piècc dc Wilde un largageconvenant au sujet : une langlc oricntale imagée, uûe expression bibli{lrede l'amorù. Les échos du Cantique dépassent néaûnoins la sinpleomernentation( couleullocalc). Dans 1'ordrc stlucturcl de lacomposition,
la construction de.td/orlé se définil enpanie parcomparaison, opposiiioD
ou subversion dLr poème biblique, tant dans son sens littéral que dans les
allégories spirituelles. Parrappolt au sens littéml du Cantiquc, la pièce se
différcncie per la rupture dc récjprocité entre l'amant et l'eimé (Hérode
âime Selomé : Salomé aime lokanaan ; Ioka aan se toume vers Dieu), et
par 1Àhansformetion de l'imaginaire solaire en imaginaire lunaire Lc sclts
spilituel est, cluant à 1ui, nié ou mis en échcc L'association du Cantiquc
avec ses commeniaircs inlelptétatils inrite à une nouvelle lcclure de
Sdlo é. Les nombreu\ débais insolubles enlle les écolesjuives renvoienl
dans lapièce, à lavariété dcs inleryrétations du Cantique ; la parolc divjne
est érigmatique, sujette à inlcærétation et toujous iocerlaine Mais Ie
débât heméneutique est i11\'ersé : alors quc la tradition alLégorique de
lccture du Cantiquc cherche un sens spirituel dans uo chant éroticluc. les
propos donl lc sens se dércbe dâns ,tdlorrl soot ceux du prophèle sacré,
dofli l'hérolne éponyme ne voit que selNualité Lire Sdlor?e à 1a lumière
du Cantique et de se lradition hennéneuticluc lbuùit ainsi au dmme une
noùrelle prolondeur polysémique.
" On dit qu'il u vehl ion ànre ,
Dorian Gray au-x Enfers :
\1iri.:
<II t'env1. abs. /. dah. .: -dans 1es prolondeurs des Enti:j : ::quête dc vérité. ce1le de son boÉ:_image tou.joLrrs digne. toujour: :::des sièc1es après. lc romanci.: i.r.l
lu$lbre dc son héros Dodan.la rj::.majestueuse, même désir rle cc:: "c'est un mcutriff que lc rom:-::::gouflre d'un quartier popuiaire - ln1eurtlc de son a.mi Basil Hallç:::de 1'abjection er souhailc passc: _:peut-êtfe. dans la drogue. !ro:i -::.lccteul commcnce le seizième c:=:ion héros dans une sofle Ca.:irappelle cc11e d'Énée au chani \l :,dans la littératute. la catabase rri :-el latines. Termc tec|rique ti:r.:-n desccnte. action dc descenircun héros qui s'avcntulc. à ses risc_:celui des trépassés. Ainsi. lc Gr;: -
Oscar \0ildc, Eveiyn \faugh, Cilberr K. Chesteton: trois
hunours bricanniqucs, miis rlrssi, ct plus profondément
peut-êrre, ûois u humeurs r, c'est-à_dirc, trois disPositions
ôndamcntales se réâlisaûl par l'hLùnour, la causticité, Ie
sarcasm€ cl les mors d'csprit innombrables Mais anuser,
pour quoi faire ? Pout le seul plaisir ? L)c la parr de ces trois
conl.ertis àû carholicismc, donr dcux ('{/augh cl Chcsterton)
furent de vérirables apologètes de leur foi, c'est peu probable.
En fait. cer humour rclèr'e sans doutc d'une stratégi( Entelldons
par 1à qu'il n'est pas seulement un procédé littéraire, rnais unc
façon d'exprimcr cette vision c1u monde rlui est la leur. . €t d€
sc moquer des imbôciles, de sottcs convenances ct d'ut] celtâin
nornbre cie préjugés. Des imbéciles ? P€ûsons à ce ( rrronsûc,
qucst le public anglais, seion Wildc Aux convenrnr:es ? Pensons
aux cérénonies mortlraircs âméricaines, selon \&âugh. Aurprélugés l Pelsons aux idées progressistes, chtétiennes eJr réalité,
mals devenues o lolies ,, selon Chcsterton. Pour ne Plx ûroluir
idior, i1fallait que cesJolrrllé€s fussent orgatjsées. Êlles 1c furcnt
et en voici les,{ctes.