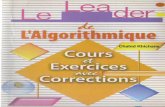Résumé des Travaux en Statistique et Applications des Statistiques
« Les compoix montpelliérains : approche qualitative des archives fiscales médiévales »,...
Transcript of « Les compoix montpelliérains : approche qualitative des archives fiscales médiévales »,...
Memini. Travaux et documents, 1:1 (2010 ). p q; - 1:l
Les compoix montpelliérains : âpproche qualitativedes archives fiscales médiévales
Lucie Laumonier(Université de Sherbrooke-Université Montpellier 3)
Les sources fiscales médiévales, en raison de leur état inégal,
souvent partiel voire fragmentaire, ne peuvent prétendre à l'exhaustivitédes archives de l'époque modeme, plus abondantes et détaillées.
Cependant, au cæur des travaux en histoire sociale et démographique, elles
ont'suscité pendant une vingtaine d'années un intérêt très soutenu' Ce sont
aujourd'hui les historiens de la fiscalité qui les étudient, dans une
perspective nettement inlluencée par l'histoire culturelle. Ce renouveau
épistémologique offre en effet aux chercheurs l'opportunité de réviser leurs
approches des documents fiscaux, s'éloigrrant de l'étude sérielle pour se
toumer vers une analyse qualitative. En tenant compte de leurs écueils et
en les interrogeant différemment, ces archives s'avèrent être des sources de
choix pour l'étude des sociétés. Après quelques remarques d'ordrehistoriographique, principalement axées sur les travaux francophones
contemporains, nous soulignerons la diversité des champs de recherches
offerts par les archives fiscales, d'après l'étude des compoix de
Montpellier, conservés à partir de 13801.
Les archives fiscales dans l'historiographie française
Entre les années 1960 et 1985, l'histoire économique et sociale
incite les historiens à s'intéresser arrx sources fiscales: compoix, livresd'estimes et rôles de tailles. Elles sont l'objet de nombreuses recherches et
nourrissent les monographies urbaines et régionales. En 1989, dans son
r Cet arlicle est une version profondément remaniée d'une communication donnée au 9"
colloque de la SEMQ le l6 avril 2010 à l'Université de Montréal.
Memini. Travaux et documents98
bilan sur l'histoire économique et sociale de la France au Moyen Âge'
Robert-HenriBautieraenombreplusdetrentemémoiresetarticlesquileursont consacrés', sans compter les éditions de textes' Saint-Flour par Albet
Rigaudière, Toulouse p".if iiipp" Wolff ou Paris' par Jean Favier3'
Ces recherches poursuivent principalement deux objectifsa' Le
pr"*i* "rt-i'etud"
de'la f'scalite, ^au
pÀint de vue politique - dans
l'affrmation de l'autonomie urbaine par exemple - et du point de vue.de la
i""iîü"" it"ules d'allivrement, perànnel-municipal' etc')' Le deuxième'
d'une plus grande Ài;;;'àst l'analys" toiio-é"ot'omique de la
p"pJ"i"", peimettant le'<lressement de cartes " fi*i^q::::::":"i:* '
hiérarchie géographique et sociale des fortunes' Cette entreprise nécessite
preJ"uiÀ*Z*L"à etira" 1lpàgtupt'iq*.de.la ville' une étude sérielle des
allivrements, 0", ui"r* Jt àà' i"ii'ia"t (métier' sexe' possessions) et enfin
le croisement de ces dÀées. La thèse d,Anne-catherine Marin-Rambier
sur Montpellier est t";;-t fait caractéristique de cette démarche : après
,*it t"ppae l'histoire de la ville, elle s'intéresse au mode de dressement
;;;;"C;t "t
uu, potiti[''"' n'"ât"t--*icipales' Elle s'interroge ensuite
sur l'assiette a" f i-pOt, ii Àmb'" d'exempGs' et la relation entre valeur
réelle et valew fiscale'a"r-ui"rrrr puis procède à l'étude socio-économique
de la populatior,, .epunitio" d"' se"e' "t des métiers6' des forhrnes et des
üLr. à" *i" des différents quartiers de la ville7. Ses propos sont soutenus
par des cartes et d"t g.;;hiti;es variés'.dressant un portrait aussi complet
que possible a" fu pâptifution montpelliéraine entre 1380 et les années
i+ioi-sg"a*t q"" j'étod" de la topographie urbaine' partiellement
2 R.-H. Baurmn, « L'histoire sociale et économique de la France médiévale de l'an mil à ia fin
du XVe siècle ,, a^, t'iitii'" médietjale en'France' Bilan et pnrspe"tiÿes' actes du 20è^"
"rti'q"" de b §ruursp,1989, p' 49-100' ici p' 66'
3A.RIGATTDIÈRE,L'Assiettedel'impôtdirectàlalindu'ilV"siècle:lelivred'estimesdes
consuls de Saint-Flour poli Lt'"i""A"t 1380-13iJ5,Rouen, Publications des Universités de
RouenetduHawe,lglT;Ph'WorEr'Ies«estimes»toulousainesdesXlWetXWsiècles'Toulouse, Bibliothèque aà'r:e.rà"iuiio" Marc Bloch de Toulouse, 1956; l. Fer'rsn, Ies
Contribuables poriri"nrîU în a"-ii 5""u, de Cent ans, les rôles d'impôt de 1421, 1423 et
I 4 3 B, Genève, Droz, 197 0'
a voir par exemple B. suAu-NowsNs, « La cité de Rodez au milieu du XV" siècle d'après le
liwe d,,,estimes,, a" vqir"'àïo:iiothàq", i" t'a"a, des chartes, vol. 131-1 (1973), p. 151-
iit, ,. iË.i., , rrd", ';;i"";;;j'i';"tis d'après tes estimes de 1464 '
Positions des thèses
de llÉcole nati,onale des chartes, 1974,p'91'99'
s A.-c. MAR,N-R x"mrex, Montpellier à laJin du Moyen Âge d'après les compoix (1380-1450)'
;rresî;;îÉ";i" næio*t. JËt chartes, 1980' partie 1 « L impôt »' p' 1-61'
6 lbid.,pafiie2 « Les contribuables »' p' 62-104'
' Ibid., partie 5 « Les contribuables dans la ville >>' p' 207'237'
,1
Les compoix montpelliérains
réalisée à l'aide des compoix, avait e,té réalisée à la fin du XIX" siècle par
l'archéologue Louise Guirauds.
Bien que relativement fidèles à la réalité, les reconstitutions de ces
répartitions spatiales des richesses doivent être prises avec quelques
précautions, immédiatement signalées par les chercheurs. Plusieurs
problèmes se posent en effet, inlassablement rappelés depuis les premières
publications : quel rapport établfu entre le feu réel et le feu fiscal ? Quelleest la proportion d'exemptés, qui échappent à toute évaluation ? Commentdéterminer le montant et l'assiette de f impôt ? Comment calculer la valeur
réelle des biens estimése? Des questions semblables se posent pour les
études démographiques menées à partir des sources fiscalesto : dans quelle
mesure le nombre de feux correspond-il à la réalité ? Quel coefiicient
appliquer pour trouver le nombre effectif d'habitants ? De multiplesprécautions sont prises par les historiens qui, comme Arlette Higounet-Nadal pour la ville de Périgueuxrl, se lancent dans l'exercice.
Dans ce contexte historiographique, les sources fiscales ont servi, si
leur richesse le permettaitr2, à déterminer la taille moyenne des ménages,
estimer des tarx de natalité, mortalité, des âges moyens au mariage, au
décès, au veuvage. Néanmoins, les écarts très importants dans l'évaluationde la population des villes font douter de la fiabilité des documents fiscaux
en matière d'études démographiques. La fourchette proposée par Jean
t L. Gutt,quo , Recherches topographiqtes sur Mttnlpelliet' uu )loy',-n igc, Montpellier'Mémoire de la société archéologique de Montpellier, 1895 et, plus récemment, G. F.qsRr et
Th. LocHe.no. Montpellier : laville tnécliéyale, Montpellier, Editions de l'lnventaire, 1992.
" Pour un tour d'horizon des difiicultés posées par les sources fiscales pour I'histoireéconomique et sociale. on peLlt se réferer aux introductions des ouvrages cités ci-dessus et
plus spécifiquement à J. FIr:r.ns. « Les limites des rnéthodes statistiques pour les recherches
en dérnographie médiévale »t, Annales de tléntog'aphie historiqtte. 1 968. p. 43-73.
r0 Pour le Moyen Âge central. on peut consulter R. Fosslrn. « La dénrographie médiévale:
problèmes de méthode (X"-XIll" siècles) ». Annales tle déntogt'ophie historiqtte. 1975'
p. 113-165. Pour un aperçu pour global, voir les actes du premier congrès de la SHMESP :
La déntographie médiévale ; soloce.\ et méthocles, Actes du colloque de Nice (iuin I970),
Paris, Les Belles Lettres. I972 - par exemple la contribution de R. Brn,qrlln. « Démographie
rnédiévale dans le midi méditerranéen. Sources et rr-réthodes ». p. 9-16.
I A. Ill,,ôr \r r-N r rr P.it iguitx uur .YlV rt X/ .sr,1,'/,'.*. Ettdi J, J.trnographi, hi\lurique.Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, I 979.
't Ce lut le cas pour D. Henltlrv et Ch. Kleptscr-Zuel*, Les Toscans et leurs .làmilles tme
éttLde du «catosto».florentin de 1127, Paris. Fondation nationale des sciences politiques et
EHESS. I978.
99
100 Memini. Travaux et documents
Favier pour Paris va de 58 000 à 146 000 habitantsl3. L'estimation de lapopulation de Mon@ellier a, quant à elle, donné lieu à trois tentatives, dont
les écarts sont cependant moins élevés14. Une fois les limites de l'histoiredémographique atteintes, qualifrées par Michael Anderson de
« meaningless meanls )), l'on a finalement affirmé que les documents
f,rscaux et les recensements constituaient des « instantanés >>, qui ne
reflètent la composition des ménages qu'à un moment précis, masquant le
cycle de développement familial, un concept désormais plus central en
histoire de la famillel6.
Pendant quelques années, les monographies mettant en valeur les
documents fiscaux se sont faites rares17, cerlainement parce que ces
archives semblent avoir montré leurs limites. À Montpellier, elles sont
écartées des recherches de Kathryn Reyerson, qü étudie pouftant l'histoireéconomique de la ville. Mais, depuis le début des années 2000, les sources
fiscales font l'objet d'un regain d'intérêt en histoire de la fiscalité,
s'éloignant par là même de l'étude des populations. Une série de tables-
rondes et de colloques françaisl8 rassemblent presque annuellement les
médiévistes qui étudient les méthodes d'imposition, les techniques fiscales,
lr J. Frvnn, Le.s conh'ibuables parisiens..., p. 10.
'' J. Russr:r" « L'évolution t1émographique de Montpellier au Moren Age ». lrriulcr du Muli,
vol. 7.1. (1962). p.345-360;A.-C. MrnrN-Revura, Montpellier à laJin du Moyen Age...,
p.88-104 et enfin A. Got;noN, « De l'impôt communal à I'inipôt royal. Le cas de
Montpellier», dans D. MFrNror e, alii, L'impôt dans les villes tle l'oct'itlent méditerranécn.
Xilf -Xf slèc/e, Actes du colloque de Bercy" 3-5 octobre 2001, Paris. Comité poul I'histoireéconomiqne et financière de la France, 2005. p. 291-301. Selon Josiah Russel. la ville
compterait à la veille de la peste de 1348 entre 35 000 et 40 000 habitants. Ce chiffre est
conteslé par A.-C. Marin-Rambier qui I'estime trop élevé et critique la méthode de Russel.
André Gouron, quant à lui" ernploie des sources difTérentes pour mener ses évaluations. Il
atTrme que la ville intra-muros ne peut contenir plus de 18 000 habitants, le reste vivant à
l'extérieur des enceintes. ll propose Llne estimation allant de 33 à 37 000 habitants.
'' M. ArnEnsoN, Approaches to the History ol the Western Famill', 1500- 191'1-
London, MacMillan, 1980, p. 30.
r" A. BuncurÈtr:, « Pour une typologie des formes d'organisation domestique de I'Europe
moderne. XVI" - XIX" siècles», Arunles ESC. vol.4l-3 (1986). p. 648. Plus largemenl, on
peut se référer aux deux articles de Tamara Hareven qui proposent un bilan des approches et
méthodes en histoire de la famille jusqu'aux années 2000 : T. Hrnrvr.N. « L'histoire de la
famille et la complexité du changement social », ('ahiers d'hisktlre, vol. 45-1 (2000).
p.9-34 et vol.,15-2 (2000), p. 205-232.
'' Citons tout de même. dans une tradition d'histoire économique et sociale. les recherches de
L. Fossnn. « L'artisanat parisien à ia fin du XIII" siècle d'après les rôles de taille : critiqLte
d'une source ,'- ltl,llungc.,,)< l Ecul<]runçui.,e Jt Romc. .V,,.r;p-irr. Tttnl.' ntodttnt.s.tol.100-1 (198S). p. 125-135^et Ch. BnuN, « Les structures physiques et sociales de la villed'Uzès à la fin du Moyen Age >>. Histoire et Me,sure, vol. 14, 3-4 (1999), p. 219-298 .
Les compoix montpelliérains
les stratégies politiques sous-tendant la levée des impôts, les résistances quileur sont opposées, la « création identitaire associée aux pratiques de lafiscalitéte », le tout « dans la perspective d'une histoire culturelle2o »profondément politique. Ce ne sont plus les propos des archives quiretiennent l'attention, mais la manière dont elles sont pensées, élaborées etperçues, leur sens idéologique et syrnbolique. Ces approches des sourcesfiscales s'inscrivent dans le renouvellement épistémologique qui s'opèredepuis une quinzaine d'années et qui se traduit par de nombreuses étudesen histoire culturelle et des représentations2l, ici dans une optique fiscale etpolitique22. Renouvellement ne signifie pas oubli. Les travaux en histoireéconomique, sociale et démographique sont précierx pour l'historiographieactuelle: ces recherches offrent un appui statistique servant de basecomparative et transmettent une image, certes déformée mais probablementassez fidèle, de la population des sociétés étudiées. Malgré les précautionsqu'elles nécessitent, les sources fiscales et les dénombrements de feuxn'ont jamais cessé d'être exploités, même avec parcimonie. Les inventairesdes compoix de Montpellier sont ainsi étudiés au début des années 2000par Cécile Béghin-Le Gourriérec, parallèlement à des actes notariés, afinde mesurer la place des femmes dans l'économie de la sénéchaussée de
't D. Mr:N.rcrr, et M. S,qNcsrz-Mrnrurz (coord.), Lafscülité J.,.r ll1lei uu ,\lqen Àge tFranceméridicnale, Cutalogne et Castille), Toulouse. Privat.4 volumes publiés entre 1996 et2005. Ph. CoNr,A.r4rNE. J. Kpnuurvl. et A. Rrc,quorÈnr (dir.). L'inp,ir tu M,5'en Àgc. L impôtptûlic et le prélèyement seigneurial../in XII'-début XVf siècles. Actes du colloque de Bercy.1,1-16 juin 2000, Comité pour l'histoire économique et financière. Paris,2002. D. MÈrN.ro'r etalii. L'impôt dans les vil.les de I'Occident méditetanéen. XIII"-XV slàcle. Actes ducolloque de Bercy, 3-5 octobre 2001. Paris. Comité pour l'histoire économique et frnancièrede la France, 2005. A. Rrc,ru»rens (dir.), De I'esrime au cudastre en Europe. Le Moyen Àge.Actes du colloque des l1-13 juin 2003, Paris. Comité pour l'histoire économique etfinancière de la France. 2006.
"' M. Hraear, « "Bonnes villes" et capitales régionales : fiscalité d'Etat et identirés urbaines enProvence autourde 1400 ». dans D. Mr:N.rcrr et alii, L'impôl tlans Lesvilles....p.526-541.
r! D. Mpi'r.ror et M. SÀxcur:z-Manliulz, « lntroduction », dans D. MEN.ror et M. SÀr'rculz-MrRriNez (coord.), La Fi.scalité desvilles..., t. 1. p.12.
:r Voir R. CHenrrrn. « Le monde comme représentation». Annales À. S. C'. vol. 14-2 (1989),p.1505-1520; entretien avec Roger Chartier, « Les représentations du passé». dansJ.-C. RurNo-Boneer-rN (coord.), L'histoire aujourd'hui. Auxere. PUF, coll. SciencesHumaines, 1999, p. l5-19. Pour une remise en question, S. VlN,rrnr, «L'invention del'inventiorr, l'histoire des représentations en France depuis 1980». dans L. MARTTN etS. Vr.rnvnr (dir.), L'histoire culhrelle du contemporain. actes du Colloque de Cerisy. 23-30août 2004, Paris. Nouveau Monde" 2005, p. 3 I -54.
r: Pour une étude culturelle de I'impôt royal" on peut consulter L. Sconore, « Le roi doit vivredu sien ». La théorie de l impôt en France (XIil''-Xl,' jièclesl, Paris. Institut d'ÉtuclesAugustinienties, 2005.
101
102 Memini. Tiavaux et documents
Beaucaire23. outre les aléas de ra conservation des documents et leursnombreuses lacunes, les _archives fiscales peuvent être exproitées trèsefficacement par le biaisd,une méthode qualitative, *ir"
"rîu*if,* t",historiens de la fiscalité. L'histoire curtureile offre en "rr"t
ru porriliire o"poser un regard neuf sur ces sources. Les compoix de'Montpellier,exemplaires de la fiscalité des villes du Midi, nous permettront d,illustrerla diversité des approches qu,ils autorisent.
Montpellier au Moyen Âge
Montpellier est une fondation seigneuriare du X" siècle. Longtempsobscures, les circonstances entourant la création de la ville ont été bienanalysées par Claudie Duhamel_Amado2a: la fondation .epoJ-a u,redéploiement patrimonial.cle t: t-il" seigneuriale des Guilhem, quichoisit ce lieu.stratégique à la fin du X" sièie pour installer sa nouveilecapitale. Plusieurs facteurs permettent le déielopp"-"rt ,upià" a"Montpellier : l'emplacement àu site sur une route empruntée par lespèlerins, les politiques l-r*bl des seigneurs et le faible aeï"fopp"ri""t a"Maguelone, siège de l'évêché éloig[é d'une quinzaine de kilomètres.
Guilhem V (1074-fi21) dote Mànçellier d,un débouché sur laMéditerranée en réaménageant le Lez pour permettre la circuration de9:1:""" plus imposants et en restaurant i" port de Lattes25. Au milieu duXII" siècle, les habitants se révoltent, u"".r.àrt Guilhem Vf a,i"g?."rr""
"ttt C BucutN-l I counntrnr.c, Le. rôle éconttmique de,s femmes clun-ç lu sénécJtaussée tleBeattcaire à lo.fin du Moven Âge 6I],,-^ir s'iècre.9,dir. a. docrorât sous ra direction deCh. Kr.eprsu-Zusln. École des Hautes Études en Sciences Socialer, ZOOO «r"L ""fr-,."rj.tt C. DuHrr,,rpr.-Aue»o, << Les origines, gg5_ I 1 03 », dans G. F,ceHr et Th. Locueno.Montpellier: la vire médiévare, Montperier. Éoitiâns ae'rnventaire, rooi, p. îi-ia
"« Aux origines des Guilhems de Montperier (X"-XI" siècle) ' qrestion, genà"iogiq*, .,retour à l'hisroriographie ». Études.sttr l,Hérattli.7_g (199t_1992). p. g9_10g.
:' Le pionnier des recherches sur Montpeilier est sans cônteste Arexandre Germain (Histoirede kt commune.de MonQterier' 3 tomes, rrlortp.iii.., :. Maner, Ig54). pour une histoireplus récente-mais descriptivq voir les trois tor., ,.ejige, par J. Br.uvr,r : Histoire d,une'seigneurie du Midi de ra France. Naissance tre Mrïntpe:rier rçs: riui,-ru,onipltti.r.causse. 1969; Montpeilier so.trs ra s.e,igneurin rt, Jo"q)o, k (,onquérant et cres rris creMajorque. Rattocllement tle,Montpellif,ret
"r an iori)nttier à la Fronce 0213_13"19),Montpellier, causse, r 97 r ; La fin t|une seigrtettrie ar, rtui a, u rron"":, ionri"'tii"r." ,ittnn)oli tlJlq-l54jr. Monrpellier. Caussc. lozl. O.rn poinr de ',r" ptrr'u,,1ui1iiqr",G. Cttnt vr tdir.\. Hi.,ruire ,le M,ntfellicr. foulouse. prirat. I9g,l. ar". ,,n" uiprà.f-,.
;11::::.:,.o;^!ïll '"- ldir: , Hitr.,,irt Ju Jiocè,,.Ji Monrp;ili,.r. parir. Beauehesne. lq7ô.r uril res eruoes ropographrques, L. Guruul. Les recherches topographiques à MontperieaMontpellier, Mémoire de Ia société archéologique ae vonipeilier, rg95 et, plus récemmenr,G. Frsnr et Th. Lrrurno. Mrmtpellier . to "iiti rùie",r/o'...
Les compoix montpelliérains 103
1e chassent de la i'i11e pendant deur ans. Ils constituent un consulat ets'octroient des pouvoirs judiciaires. situation qui ne dure guère. C'estfinalement au début du XIII' siècle. à la faveur du mariage de Marie, fillede Guilhem \,'IIl et d'Eudorie Comnène avec le roi d'Aragon, que\{ontpellier obtient sa !-harte des coutumes et liber1és26, et qu'elle se doted'un gouremement r-!-onnu par son seigneur. En 7276, la ville passe à lacourorule de \la.iorque : elle dei.'ient française en 1349.
Sll. 1: ::rtelle des rois d'Aragon et de Majorque, Montpellierdei ien: ,e :r.r-. grand centre urbain du Languedoc. Sa croissanceeconon::c"-e est rarticulièrement vigoureuse, s'appuyant sur le commercemediterrane:nt- par 1e port de Lattes2s et sur la présence de la papauté à
Ar isno:. i..uie proche. On échange à Montpellier principalement desépices et ce. draps:- (la r,ille est réputée pour lateinture rouge), mais aussides den:ees alimentaires et des produits de luxe. La ville attire donc deqrands marchands intemationaux, mais aussi des intellectuels. Montpellier
t C:::.' :-: .-:-:l:.\lerandre Cerntain dans son Histoire de la Commme... Voir aussi1. C -::.,,--rr it,tntitttltt ntonlispessttlanurr, Rédaction et diflusion des coutumes de\1.r::.-..:.-: .1,:,:-r:;s ,fu -\[idi, 90 (1978), p. 289-318 et A. Ross I.ewrs, « TheDer: --:l:::: :: T..ln Gourernment in Twelfth Century Montpellier>>, Speculum, 221v1- .3 < -À-
:- S:r l .r:.:r:re ic.rromique de la rille. voir principalement les travaux de Jean Combes etK:::.:1. r: R:1. e:.pp. -1. f 1,11s;.r. « Les investisserr.rer.rts immobiliers à Montpellier au.!-l'.î.r..nrin: du \\'' siècle ». Rectteil de mémoires et lrûÿûLtx publié par la Sociélé
-; ,:;ri;:,'.. .it ,it,t!t .t d.s institutions des anciens pay.s de droit écrit, fàsc. 2, MontpellierLnirersir.i de \lontpellier. i951. p. 2l-28; avec A.-E. Sevous, « Les commerçants et lescapitalistes de \fontpellier aux XIII" et XIV" siècles >>, Retue hi.storicltte, 188-189 (1940).p. -l-11--lrl. De K. R:r'rnsox. voir: Montpellier de 1250 à 1350. centre commercial etlin,rtcier. Thèse de droit. Université Montpellier l, 1917 : « Commercial Fraud in the\liddle Ages : The Case of the Dissembled Pepperer >>. Jotrrnal ol' Meclieval History, 8
{1982). p. 63-73: «Le rôle de Montpellier dans le commerce des draps de laine avantI-150»,. Annales du Midi,94 (1982), p. 17-40: « Land. Houses and Real Estate Investmentin Montpellier: A Studl ofthe Notarial Property Transactions, 1298-1348 », Studies inllecliet,al and Renai,ssance History, 6 (1983), p. 39-112; « Women and Business in\{edieral Montpellier », dans B. A. Hl'N,tn.a.rr (dir.). Women and llork in PreindustrialÀzrrope. Bloomington. Indiana University Press. 1986, p. 117-114 : et The Art ofthe Deal :
Intermetliaries of Trade in Medieval Montpellier Leyde. Brill. 2002. Voir aussi A. GEnnrarN.
Hi.sroire cltt commerce à Montpellier, Montpellier J. Martel. I 861 .
:: Pour la fin du Moyen Âge, voir B. Dour"mnc, « La lente agonie des ports du Midi :
\arbonne. Montpellier et Marseille confiontés à l'évolution des circuits d'échanges (finX\i'-début XVI'siècJe) >>.Annales du Midi. 106 (1991), p. 317-331.
:' .I. CorrBrs. ,< Industrie et commerce de la toile à Montpellier de la fin du XIII" siècle à la findu X\'" siècle >t. Rectreil de mémoires et lravaux ptrblié par la.société d'histoire du droit ettlts irt.stittttiorts des anciens pays de droît écrit. lasc.9, Mélange,s à Roger Aubenas. 1971.p.181-111.
104 Memini. Travaux et documents
est en effet réputée pour son enseignement précoce de la médecine et du
droit ; ses deux universités'o connàissent un rayonnement important qui
p*iAp*, à l'expansion rapide de la ville et à sa dimension très
multic'ulturelle. Le dlmamismê de la communauté juive en est un exemple
probant3l.
Au plus fort de son expansion, au toumant du XlV" siècle' la ville
compteraitïutour de 35 0OO hàbitants, au maximum 18 000 dans les murs'
Elle se développe avec vivacité jusqu'aux crises de la fin du Moyen Âge
qui l'atteignent durement : dérèglements climatiques' mauvaises récoltes'
àia, ,ep'"tet des Grandes Compagnies, s'accompagnent d'un
alourdissàent des impôts, et d'épisodes de peste32' Si la population et le
èonsulat s'appauvrissént pendanfcette période, les grands marchands ne
cÀaissent 'qu'un
ralentissement de leurs activités, creusant l'écart des
fortunes33. Lâ crise sociale se traduit, d'abord en 1325 par une forte
opfosition, par les populares, aux impôts municipaux' puis' en 1379 pat
,#" ,euoit" poprtuii" sanglante contre f impôt royal' qt-lTq"udurablement lËs èspritsro. Màntpellier se relève lentement au XV" siècle,
]oA.GounoN,«Deuxrrniversitéspouruneville»,dansG.Crrorw(dir.),Histoire'de.Monlpellier
Toulouse, privat, 1gg4, p. ro:-izs ; A. Gor,noN, « Médecins et juristes montpelliérains au XII"
,;oJi" , .n" "onr..g"*à
OÀ.iein".'z » dans lio-mage à Jean Combes (1903-1989). Etudes
t*gu"dorirn ^ o6"nu p,' i" anciens élèves' colligues et amis' Motûpellier' Mémoires de
iu §o.iàe X.frOologiqu"à" frtortpellier, 1991 ; D. Lr Brrvec (dtr.), L'Université de médecine
de Montpellier et son rayonneme,i (XUI"-XV" tiè"les)' Tumhout' Brepols' 2004'
3r uhistoire des Juifs de Montpellier est très bien documentée : M.-H. Vrcernr (dir'), Juifs et
iuàriri, ,, Languedoc, fo'jtout", Privat,1977; C' Iercu (dir')' Les juifs de Montpellier et
'ior§ ln Longuùo" au uiy"n ige à nos jours' \Iontpellier' Centre de recherches et
d'études juives et neUraiques' Uiiversité Éaul Valéry i988; Y' A:t:l .ltf:: Juifs de
Montoelliersousladominationaragonaise>>,Revuedesétudesjuives'1480989)'p'5-16;;. ;#;;; *rOr".rr.i.rÀ à ü Faculté de médecine de Montpellier, demier quart du
XIV" siècle >>, Jewish aistoÇ A (1992), p' 244'255; D' IeNcu-Acou' « Les ceuvres traduites
des médecins montpelteraiis oÀs tes'ûiutiott èques des Juifs du Midi de la France au XV "
;iè"i" r, dans D. Le n"t*c 1air.;, L'Université àe médecine de Montpellier"' ' p' 295-306 ;
D. Ir,rcu-Acou .t n. n,.o*r'(aii.j, Des I'ibbonides à Maimonide, rayonnement des Juifs
andalous en pays d'Oc médiéval,Patis, Cerf, 2009'
,, J. Cor"æes, « une ville face à la crise (milieu XIV"-fin XV" siècle) » dans G. cnolw (dir'),
Histoire àe Montpelliet Toulouse, Privat, 1984, p' 71-101 '
,.J.Col,gesetA.-E.Sevous,«LescommerçantsetlescapitalistesdeMontpellierauxXlll"et
XIV" siècles >>, Revue historique, 188-189 (19a0), p' 341-377 'y
J. Covers, « Finances municipaies et oppositions sociales à Montpellier * gorlTtlTt"nl du )(V "
siècle », Fédération historique du tntguedoc méditerraneen et du Roussillon, 64" Congrès, Privas'
22_23 mai 1g71, Vwarais à L*Sr"d;, Montpellier, université Paul valéry, 1972'p.99-119. Pour
larevoliepopulaireentantqueielte,voirJ.Bernm, Histoired'ltteseignettrie.-.,t.2,p'247-250;
it p tb'; vurcent chailet 1a mentiorne dars son article, «Émouvoir !" qT." Révoltes
fÇriuio. "t .."o"o au roi en Languedoc ven 1380 », Hypothèses Q001)' p' 325-333'
Les compoix montpelliérains105
mals ne retrouve sa vigueur d,antan qu,à l,Époque Modeme.
La ville et les compoix
. Les registres fiscaux de Montpellier, les compoix, sont parvenusjulq''à nous à partir des années r3g03i Le terme « compoix », qui vient dulatin cum pensus, pesé, évalué ensemble, se rencontre surtout dans le Bas_Languedoc. À Montpellier ces registre, ,À upp"tés dans les archivesconsulaires libri manifestorum. référence à
- la décraration fiscale,
<< manifeste », des contribuables. Ils constituent t,""pr"rrio, ^î,,._"
« technique fiscale purement méditerranéenne36 », ai.""t",Tr"p"nioàeleà la fortune des habitants et fondée sur le principe de l,impot.."t - "" ,ontles biens et nor les personnes.qui sont imposérrr. C"t
" ii"ilt;;. àu air"
ad solidum et libram, c'est-à-dirè que la foitune passe d,une vareur réele àune valeur fiscale. En plus de l,impôt p.opo.tior-"1 on lève dans lespremières années un imgôt__gersonnel, uppËte focatge i"
""poÇ)', qri
disparaît des registres dès le XV" siècle.
. . L'imposition proportionnelle est attestée à partir de 116g, à Cailardans la région nîmoise38.-À Montpellier, c,est la ôfrurt" a" f, ,ifü à"i f"signale pour la première fois, en ti,+. , semble que, A" _r"iÀ* gÈrË.U",les registres soient tenus avec rigueur et rendus publics à partirîu Xrv"siècle, dans un souci de transparence, d,équité, et sous tâ p."rrlon a",prélèvements royaux, ce qui explique que la plupart ai"" *"frirr",conservées datent de cette période3e. Les prerniers documentsmontpeiliérains dont nous disposons datent en effet âes années r3g0ad; ilsdemeurent à usage inteme jusqu'à la création de ra cour des aides duLanguedoc en1437.
ri La couverture du registre Joffre 240. cornpoix de SainfJacques indique à tort r3g4. Lecompoix Iui-mêrne signare des mutations dè patrimoine à pariir de I:s'd ip"."lr","pr. r"r.3l et 74v). Il est donc de cette année-rà ou antérieur. L'archiviste Maurice oudot tieDainville arnonce un peu arbitrairement l,année 137t. Il r.,r, dans les noi.r,-à.n,itecomme registre de 1380.
'u B' csr:re*n' « Introduction », dans D. MrN:.r er arii (dir.), L'impôr dans res viile,s treI 'Ocidenl..., p. 5.
" La noblesse est imposée sur ses biens « d,antique contribution ».
'' Sur.l'histoire- de Iimposition et res premiers registres fiscaux, voir A. Rrc.luorÈnp" « Lesorigines médiévares de 'impôt
sur ra fortune ». dans ph. c...revrNr:, J. Krnrrcnvr: etA.Rrc,qr.rorÈnr: (dir.1.L'impûatr MoycnÀge. t,i*pAtp,,nio ,t. 1.p.227-2g7.'" J'-L
-Brcrr. « La gestion de Iimpôt dars Ies viiles (xil1"-xv). essai de synthèse », dansD.MrN;rrretM.SÀ^-csr-.2-Merrrinrz,Za Fiscctlitédoriiltnr....t.4,p.317-3 19.
106 Memini. Travaux et documents
Ce sont les prud'hommes de la ville qui sont en charge de la bonnelevée des impôts. Leur rôle dans la fiscalité est mentionné dans la charte de1204, article 95, dans le cadre d'un impôt destiné à la construction desmurailles, prélevé en fonction de la fortune des habitants.
Il est ordonné que des prud'hommes, gens de bien etbourgeois de Montpellier, seront élus avec serment pourestimer, en qualité d'arbitres assermentés, les biens et lesressources de tous les habitants, et déclarer dans quelleproportion chacun devra subvenir à la construction desmurailles de la ville. Ces prud'hommes pourront réduireou augmenter la part d'impôt de chacun des contribuables,comme ils croiront devoir le faire de bonne foi, selonI'exiguïté, la médiocrité ou l'opulence des diverspatrimoines. [...]41
Ces prud'hommes sont appelés les Quatorze de la Chapelle, car ilsprêtent serment aux consuls, qui les nomment, dans la chapelle duconsulat. Leur mandat dure un an et ils doivent seconder les consuls danstoutes les activités relatives aux impôts. Ils sont deux pour estimer lessepten, quartiers intérieurs (Saint-Paul, Saint-Mathieu, Saint-Firmin, Saint-Thomas, Sainte-Croix, Sainte-Anne, Sainte-Foy) et æuvrent ensemble danslesforas,les faubourgs (St-Jacques, St-Thomas et St-Firmin). Ils procèdentà l'établissement de l'assiette fiscale, des grilles d'allivrement, à Iarépartition de l'impôt, et aux dégrèvements, en accord avec les consulsa2.
Dans les villes du Midi, les compoix, cadastres ou livres d'estimesont dressés d'une manière assez semblablea3. Convoqués par le crieurpublic, les Montpelliérains se rendent à la maison consulaire pour déclarerleurs biens, inscrits dans des registres par les notaires du consulat et leursassistants. Les biens meubles et immeubles sont ensuite alliwés. On estimedonc la valeur de la fortune des habitants et on calcule le montant total de
a0 La couverture contemporaine du registre.loffre 240 (Saint-Jacques de foras) indique« i384 » mais le compoix lui-même signale des mutations de patrimoine à partir de 1380(par exemple fol. 31 et 74v). Il est donc de cette année là ou antérieur. L'archiviste MauriceOudot de Dainville annonce un peu arbitrairement l'année 1375. A.-C. Marin-Rambierretient, dans sa thèse, l'année 1380. C'est également comme cela qu'il est réferencé auxarchives municipales de la ville et qu'il sera identifié dans les réferences.
o' A. Grnuen, Histoire de la Commune..., t. 1, p. 110. Le manuscrit original est aux archivesmunicipales, sous la cote AA-9, Petit Ihalamus; l'article est au folio 39.
a2 A.-C. Mmnq-Ramrcx, Monryellier à lafin du Moyen Âge..., p.32-37.
Les compoix montpelliérains 101
f impôt dont ils devront s'acquitter. Les registres sont utilisés pendant unecertaine période, d'une dizaine d'années à un quart de siècle, jusqu'audressement de nouveaux. Pendant ce temps, les déclarations desimposables sont corrigées et les mutations de patrimoine figurent en margedes estimations.
Les déclarations des Montpelliérains sont appelées « manifestes )).
On y trouve le nom du chef de feu; parfois sa situation conjugale oufamiliale ; sa profession dans plus de la moitié des cas ; la liste de ses biensimmeubles, oslals (maisons) en premier, puis vignes, champs, prés etautres lopins de ter:re, boutiques et tables de vente, avec leur localisationprécise (confronts avec tels biens appartenant à telles personnes), les
usages qui leur sont attachés, et leur estimation; puis une estimation des
biens meubles (vaisselle, argerfi comptant, animaux, rentes, etc.). Vientensuite l'allivrement final, qui « traduit en livres cadastrales la valeur [desbiens] d'après l'estimation des expertsaa » et, parfois, la mention dusement prêté au consulat. En marge des manifestes ou à la suite de
l'allivrement final, figurent les dégrèvements dont bénéficient les
contribuables. Ces dégrèvements correspondent soit à des charges
déductibles du capital, c'est-à-dire aux différents usages qui pèsent sur les
biens et grèvent leur valeur, soit à des situations exceptionnelles, et
répondent dans ce cas à des demandes spécifiques des Montpelliérainsadressées aux consuls. Ces demières déductions fiscales « traduisent de lapart des autorités municipales la prise en considération de la personnemême du contribuable dans la mesure où elles essaient de déterminer uneréduction d'allivrement en relation avec la situation du contribuableas >> : en
cas de deuil dans la famille ou, par exemple, de paiement d'une dotimportantea6.
tt Sur les modalités de dressement des registres, voir A. RrcruorÈnr. « Les origines médiévalesde l'impôt sur la loftune », dans Ph. CoNr.qvrNr: et alii. L'impôl ctu M,'y'en )ge. L'impôtpublic.... p. 247-249; J.-L. Brcl, « La gestion de l'impôt dans les villes (Xlll'-XV"siècle)... », dans D. Mr.^-:or et M. SÀucsrz-MrnrrNrz, Za Fisculité des ville.s..., lbme 4.
p.311-336 : et A. Rrc.r,r.rorÈRE. « De l'estime au cadastre dans l'Occident médiéval :
réflexions et pistes de recherches ». dans A. Rrcer.rnrÈne (dir.). De l'eslùne au cadastre...,p.3-22.
o' M. Or.,nor or. Drr..vrr-r-r:, « Remarques sur les compoix du Languedoc méditeranéen ».
Folklore, vol. 15 (1939). p. 133.
ot A.-C. Mn«rN-R avatei.. Montpcllicr à lu lin Ju Moycn Àgc...,p.44.
'o Sur les dégrèvements. voir L. Laur'«rNrEn, « Les Montpelliérains fàce à la fiscalité (fin XIV"et XV' siècle) ». Bullelin hi.storique de la ville de Mtntpellier.35, à paraître.
108 Memini. Travaux et documents
.i A. Ccx_ror,rp, La maison ctu père . ./àmitle et ÿilldge en Ilaute-Prctvence aux wII' et y',rlil"
slècles. Paris, PUF, 1983. P.63.It Les noms des individus sont restitués tels qu'ils apparaissent dans les registres.
Avarrtlafindesannées1450-avantlamiseenplacedelacourdesaides du Languedoc - les compoix sont personnalisés paI les notaires du
consulat. czux-ci ajoutent çà et 1à des détails sur f identité des
contribuables, et détaillent plus ou moins longuement les raisons pour
lesquelles le consulat leur a accordé des allègements fiscaux. Dans
queiques cas, des actes notariés, encafiés ou dont on a recopié des extraits'
justifient des situations exceptionnelles. Loin d'être normalisés et
systématisés, les compoix de Montpellier se révèlent riches de détails sur la
ville et ses habitants : au-delà de l'étude des forlunes, ces archives peuvent
être interrogées par des problématiques plus contemporaines, comme l'ont
fait ailleurJ", hirtori"* de la fiscalité. Nous veffons tout d'abord que les
compoix montpelliérains permettent de dépasser l'apparente fxité de ce
type de ,o*"". E, effet, ifs révèlent la complexité des relations de parenté
qüi ,'etuUtitsent au cours d'une ou plusieurs générations au sein de
1'espace urbain.
Le cycle de développement familial : le cours de la vie et la ville
Parce qu,ils servent pendant plusieurs années, et sont régulièrement
mis à jour, fi'gurent dans lès marges des compoix les modifications des
déclarations eiles raisons pour lesquelles elles ont lieu : mariages et décès,
successions en cours, dissolution d'affrèrement, etc' Ces archives
témoignent de périodes correspondant au « cycle de développent familial »,
qui peut se définir comme suit :
l'évolution dans le temps de la composition d'un ménage'
au cours de laquelle des individus de la même famille
naissent, se marient, meurent et vivent sous le « toit
paternel », y entrent ou le quittent' En fonction des
circonstances démographiques, au fil des ans, la
composition du ménage varie, passe par des phases
d'eÇansion [...] et des phases de contraction'47
Ainsi, en 1384 un dégrèvement exceptionnel est accordé à Peyre et
Gregory Salâs,*, frères et teinturiers du quartier de Sainte-Croix. Aisés" ils
décÉra:ient quelques années plus tôt cinq habitations, leur patrimoine était
alors estimé à 860 liwes. Làrsque le dégrèvement intervient, le consulat
Les compoix montpelliérains
accorde aux frères une réduction, en raison de plusieurs dépenses
occasiorrnées par le décès de l'épouse de Peyre et son remariage avec une
nouvelle femme, enfin par les noces de la fille de Gregory avec un certain
Johan Masreae.
Certaines réorganisations familiales donnent davantage de fil à
retordre aux notaires du consulat. Dans le registre de Sainte-Croix de
l'année 1404, on trouve au folio 53v un manifeste raturéso. Uen-tête a été
modifié à trois reprises : « les héritiers de senhor R. Sancho », puis
« Rayrnon Delpueg >> et enfin << La femme de senhor Ramon Sancho et
Florensa sa fille femme de feu R. Delpueg ». L'estimation des biens s'élève
à 424 livres, dont 300 de meubles. Plutôt riches en biens mobiliers, les
héritiers de Ramon Sancho possèdent trois habitations de valeur moyenne.
Une annotation précise que le meuble n'a pas été imposé l'année 1407 car
une nouvelle déclaration a ûé fafte. En effet, en vis-à-vis se trouve le
manifeste de « La femme de senhor R. Sancho ». Son manifeste,
incompletsl, s'achève par un renvoi au folio 100. À cet endroit, nous
trouvons le manifeste de « Dona Calarina, femme de feu Ramon Sancho et
sa fille Florensa et son mari P. Frichan ». Ce manifeste est suivi par deux
textes qui signalent des évolutions de l'estimation. Que peut-on
comprendre de ces ratures, listes de biens et mentions de dégrèvements, à
première vue un peu confuses ?
Lorsqu'en 1404 l'on procède à la première estimation, Ramon
Sancho vient de décéder et sa succession est en cours de liquidation,
comme f indique l'expression « les héritiers de ». Par la suite, c'est le
gendre, Ral,mon Delpueg, époux de Florensa, qui s'est déclaré chef de feu.
I1 décède et c'est Dona Catarina, la mère de Florensa qui prend la tête du
ménage. Elle déclare alors les biens pour elle et sa fille veuve. Le notaire
n'a pas cru bon de préciser ici le nom de Catarina, ni son veuvage
d'ailleurs, en l'identifiant simplement comme la « femme de senhor
R. Sancho ». Le veuvage des deux femmes les a-t-elles encouragées à
s'installer ensemble ? Elles demeuraient peut-être déjà sous le même toitavec leurs époux respectifs mais rien ne permet de l'affirmer. Dans tous les
1' AMM, Joffre 241. Sainte-Croix. 1380. fol. 23v. « Lan .lxxxiiii. a .xxiiii. novembre los
senhos cossols a rendat so que a pagar senhor P per lo testament de sa primieyra molher
non obstant so que a pres am la.ii.da (secunda) rnolher. E atenduda la dot que senhor
Gregory a donat a sa filha am senhor Johan Marsre, los an amarmaz de dos C ll. »50 AMM. Joffre 243. Sainte-Croix. 140,1, fol.53v, 54, 100 et 101v.
i\ Ibid., fol.54. Le manifeste est presque vide, à I'exception de I 50 livres de meubles.
109
110 Memini. Travaux et documents
cas, elles vivent ensemble lorsque Florensa perd son époux.
C'est encore comme « femme de R. Sancho »> que Catarina déclare
ses biens à part en 1407, peut-être en raison du remariage de sa fille avec
Peyre Frichan. Cette situation ne dure pas et un nouveau manifeste est
farts2. cataina, désormais désignée par son nom et son veuvage, déclare
ses biens aveÇ celt)( de sa fille et de son nouveau gendre. Une communauté
familiale avec matrilocalité de résidence s'est formée, semble-t-il sous la
houlette de Catarina, qui gouveme l'ensemble du patrimoine, meubles et
immeubles, hérités de son mari et acquis après sa mort. Sa fille en possède
une part puisqu,elle apparaît dans l'en-tête du manifeste, au même titre que
son -époux.
Peut-être Florensa a-t-elle hérité des biens de son père et
Cûarna jouit-elle de leur usufruit, comme cela est courant dans les
dispositions testamentaires de Montpellier et du Languedocs3. L'on peut
raisonnablement supposer que Peyre Frichan a, quant à lui, été exclu de la
succession paternelle au profit d'un de ses frères, et doté en vu de son
mariage, suivant là aussi les habitudes méridionalessa. Quelques
modifications sont appoftées à l'estimation des biens, qui a augmenté
d'une cinquantaine de livres depuis 1404, en partie par l'apport des biens
de Peyre Frichan au foyer conjugal.
En !409,le groupe domestique rencontre des difficultés financières
et le consulat accorde une exemption de 180 livres pour cause de dettesss.
Catarina,Florensa et Peyre forment toujours une communauté familiale, de
biens et de vie. Deux ans plus tard, en 1411 un nouveau texte vient
" 1bil." fol. 100.
tt Voir à ce propos J. Hlletnr. Les régimes tles biens entre épott dans la régit»t de
Montpellier. dr) Xr à la .fin ttu XVI' siècle. Contribtiion aux étutles d histoire de tlroit
lcr;t.]'hèse cle droit. Université de Montpellier, 1956, livre III : « Aspects successoraux du
droit matrimonial », p. 473-564 et R. Aur:ENrs. Ctntrs d hi,stoire du droil privé, Anci':ns
pays cle clroil écrit, Aix-en-Provence. La pensée universitaire. 195,1 pour le tome 2:« Aspects cltt mariage et du droit des gens mariés ».
t'J. Hrt..qrnE. l,es régintes.... p. 473-564, R. AtlslN,cs. Cours d'histoire^ , t'2, p 39-52 et L nlCrrrnnrN. Les test;ment.\ dans lu région de Monlpelliet au Moyen lge. Arrrbill.v, Les presses
de Savoie. 1961. P.8l-84.55 Le texte suivant est rayé : « Dona Catarina. molher que fbnc de senhor Ramon Sancho, sa
filha et son marit Peyre Frican, per lur moble per cent et setanta 1l si que [ainsi] monta
rnoble et heritages tres cens sinquanta ll. Item lan mccccix a xxviii doctobre totz los siels
senhors cossols ordoneron que non paguesson per lur moble mays per cent setanta ll
attendut de grans deutes que an paguat e que an jurat que non val aquo. En que resta mÔble
et heretages per tres cens sinquanta ll. » AMM. Jolïre 243, Sainte-Croix. 1404. fbl. 101v.
Les compoix montpelliérains
modifier le premier, qui est rayé, et annonce l'augmentation de
l,estimations6. Le nom de Catarina n'apparût plus mais on rencontre celui
de Johan Dyonisi « son frère », et les sommes sont « au compte de
P. Frichan ». Dona Cüarina est-elle décédée ? Johan Dyonisi est-il son
frère ou celui de Peyre Frichan ? Les archives notariales permettent bien
souvent de répondre aux questions que soulève la brièveté de ces textes.
Néanmoins, en trois estimations successives, et grâce aux dégrèvements
dont les raisons sont exposées par les notaires, l'on parvient à saisir
plusieurs restructurations du groupe domestique: deux décès entraînant
à".r" ,"rrouges - et la mort, possible, de Catarina -' un remariage, la
dissolution de deux régimes matrimoniaux et la constitution d'une
communauté familiale sous la responsabilité d'une veuve'
Si les renvois au sein d'un même registre sont fréquents, ils le sont
aussi d'un registre à l'autre, et offrent l'opportunité de suivre les
contribuables dans leurs déplacements. Les Montpelliérains quittent parfois
leur domicile pour changer de quartier entre le dressement du registre et sa
première réfection. Les notaires indiquent ces changements d'adresse en
indiquant par exemple « a mudat en san TomastT », « mudat a Santa
Annà* », « mudat en san Paul5e »>. Dans quelques rares cas ils ajoutent le
folio auquel l'on trouvera la nouvelle déclaration. L étude de la mobilité
géographique des individus au sein de l'espace urbain est réalisable à l'aide
àes compoix et des index alphabétiques de l'inventaire, bien que
l'anthropônymie soit variable pour la période étudiée. Il s'agit d'une
entrepriie d'une certaine ampleur qui n'a pour le moment pas été menée,
au càntraire de l,étude de l'immigration vers Montpellier6o. L objectif
poursuivi par le consulat au travers la tenue des registres n'est pas de
repérer les individus mais leurs biens : la plupart des changements indiqués
par les notaires grâce à la mention « mudat... » réfèrent soit à des ventes de
,,, « ltem lan mil ccccx.i a xvj dezembre lo senhors [...] cossols li an mes son moble a dos cens
et detz e set 11 punt volent et consenten Johan D.vonisi son flra,vre si que motrta moble et
heretages a tres cens et vint e sieys lievras contat P. Frican », Ibid.
" AMM, Joffre 252, Saint-Paul, 1435. flol. 56v.
58 AMM, Joffre 252, Saint-Paul. 1435, fol. 199.
5" AMM. Joffre 257, Saint-Mathieu. 1447 , fol.l .
,.0 K. Rr:vr:nson, « Patterns of Population Attraction and Mobilitl, : the Case ol Montpellier
1293-1348 >>. Viator l0 (1979), p.257-281 et A.-C. M.nnrN. « L',immigration à Montpellier
au XV" siècle d'après les registres d'habitanage (1422-1442)t. Actes du 110" Cr»tgrè.s
ncttirnol tles.sociétés saÿdntes. 1.2, RecherchesSur I'histoire de Montpellier et du
Langtrcdoc. section d histoire ntédiévale et de philologie. Paris. cTHS, 1985, p.99-123.
K. Reyerson esquisse aussi une étude de l'émigration.
111
t12 Memini. Travaux et documents
"r AMM. Joffie 250. Sainte-Anne. 1435. fbl. 13,1.ur AMM, Joflie 257, Saint-Mathieu, 14,17, fbl. 34v.or AMM, Jollre 241. Sainte-Croix. 13g0, tbl.24v.ot 65 francs qui annulent le rneuble.
"' Il déclare 540 livres. AMM, Joflie 241. Sainte-Croix. 13g0. fbl. 23.u6 AMM. Jofïre 2,13, Sainte-Croix, 1,104. fol. Igv. Il est nom,é ici Esteve Cosra.6r AMM. .loflre 243, Sainte-Croix. 1404. fôI. t9v.68 « Un hostal en que esta ».
biens immeubles, et se situent alors dans la marge des registres, soit à desdispositions juridiques précises quant à la jouissance et t h propriété desbiens constituant un manifeste. cela se traduit par la prise erchige de ladéclaration d'une personne par une autre persollne, avec ou sansdéplacement physique des individus en question : (( mudat en santm[a]thieu sus la molher de Bertran Granier6l )) ou « a mudat en santa crossus Johan Gaulert son gendre62 ».
Les changements de domicile et les bouleversements qui lesenkaînent parfois sont aussi perceptibles dans le temps, d'un registie à unautre. En 1380, Peyre cavadolh et steve costa, compagnons teinturiers desainte-croix rendent leur manifeste, estimé à 116 livres63. Ils déclarent unemaison dans laquelle ils résident, constituant une communauté familialed'au moins trois individus. car pey'e cavadolh est marié et la maisonappartient à sa femme : c'est une part de la dot, donnée par son père JohanBoysel, qui comprend aussi une vigne et un petit pécule6a. Johan Boysel estun teinturier plutôt aisé6s qui réside à proximité, dans le même iâté demaison. En 1404 de nouveaux registres sont rédigés. vingt-quatre annéesont passé et les trois hommes résident toujours dans le quartier de sainte-Croix, « île de senhor Jacme Arquier ». pey.e et Steve, autrefoiscompagnons, n'habitent plus ensemble. steve66 pratique encore la teintureet s'est enrichi, il possède deux maisons, dont une dans raquelre il vit. s,ildemeure avec sa famille, le registre ne le précise pas. pey.e cavadolh deson côté déclare les biens pour lui et son beau-père Johan Boysel67. Lamaison que ce demier possédait entre dans l'estimation, avec ceilé reçue endot par sa fille. Les deux hommes et leur famille vivent ensemble : leursbiens sont considérés coflrme une unité, et une maison est notée derésidence68. Johan Boysel est probablement venu s'installer dans lademeure de sa fille à l'approche de la vieillesse. Ici encore les compoixrévèlent de nombreux détails sur l'évolution des groupes domestiquesmontpelliérains. Les noces de Peyre cavadolh avec la fillode Johan Boysel
Les compoix montPelliérains 113
réduisentleménagedecedemier.Maislemariageentraînelacréationd,un nouveau feu, qui s'agrandit par l'arrivée de steve costa. Les deux
compagnons s,affrèrènt et s'installent dans la maison reçue lors des noces.
f.L,'*,ie"t passent et les compagnons se séparent, Steve devient chef de
*r, p-pt" fzu et fonde probablement une-famille' Quant à Johan Boysel' il
i":"i" le domicile de son gendre et de sa fille, causant la disparition de son
grorp" domestique d'oriline. Le temps -d'une
génération 1e cycle de
&r"iopp"*"nt AmiUat a-suivi ,o'"o*t' Les réaménagements successifs
àÀ "", gro"pes domestiques sont par ailleurs variés sur le plan des formes
de paràte àir", "t
æuvïe. Le feu constitué par Peyre, sa femme et.Steve
est fondé sur une parenté d'alliance et une parenté artificielle, tandis que
celui constitué "nrrit"
par Peyre, sa femme et Johan s'appuie sur des liens
d'alliance et de consanguinité6e'
Les histoires familiales de Peyre et Gregory Salas' de Catarina ou
Steve Costa et Peyre Cavadolh sont des exemples de la complexité des
.ôport. familiaux qui se déploient dans le temps et dans l'espace' La
u*iete de ces situatiôns ainsi que les enjeux personnels et sociaux qu'elles
soulèvent soulignent la multiplicité des champs de recherches offerts par
les compoix dé Montpellier. un de ces axes d'analyse est celui des
,VrtJr""Ë d,identificatioï au Moyen Àge. Cette entreprise, amorcée.par les
t uuu* de Monique Bourin et Éascal chareille sur l'anthroponyrnieTo, est
urr;o*a'frri relue dans une perspective d'histoire des identités et des
,"pràr""i",i"ns71, au sein de iaquelle l'histoire du genre tient une place
fondamentaleT2.
Nommeretqualifier:l'histoiredesidentitésetl'histoiredesreprésentations
Les notaires et greffiers du consulat veillent à désigner les
contribuables par leur ,roÀ, l"r. métier, parfois 1e,r statut familial ou leur
., p"ra ,In p-r"r- btl"n, voir A. GuEnnreu-JalngERr, « sur les structures de parenté dans
I'Europeàédiévale>>,Annales E- S. C.,36-6 (198i), p' 1028-1049'
,o M, Bounnr et P. cuAI{En-re, Genèse médiévale cle I'anthropotrytnie moderne' Tours, P' U' de
Tours, 5 volumes publÉs entre 1989 et 2002' Voir aussi' par exemple' -P' Becr'
« Antirroponymie et comportements démographiques : les ''cherch91^ -d1 feux"
bourguignonnesdesXlV"etiV" siècles>>,AnnalesE'S'C',3S-6(1983)'p' 1336-1345'
''Parexemple:A.Morno.,«Noms,mémoire,identitépubliqueàFlorenc-e-à.lafin-duMoyen-Ag"rr,L'tbhng", de t'École française de Rome,.Moyen-Âge' 110 (1998)' p' 137-157 et
ch. Kreptscs-ZwER, « Les faux-semblants de I'identité' Noms de lignée, noms cachés'
noms-refuges à Florence au XIV" siècle », Mélanges de l'Écolefrançaise de Rome, Moyen-
Âge,1r0 (1998), P. ts9-r72.
tt4 Memini. Travaux et documents
statut conjugal. Comme l'explique Dominique Iogna-Prat, « les systèmes
d'identification au Moyen Âge obéissent à une logique de mise en
conformité; si l'individu est doté d'une visibilité particulière, c'est pour
les nécessités du contrôle au sein de son réseau de sociabilité (famille,
communauté d'habitant, paroisse, seigreurie, etc.)73 ». Ainsi, si un
contribuable ne réside plus dans l'irla (le pâté de maison) au sein de
laquelle i\ a été initialement estimé et qu'il n'a pas sigrralé son
déménagement au consulat, l'on peut faire appel au voisinage, à la charité
du métier ou à la famille mentionnée dans le manifeste pour le trouver. Les
autorités municipales procèdent ici à une identification publique des
contribuables, signifiante en ce qu'elle les intègre à un ordre social défini.
Si le propos est de compter et d'estimer les biens, il est aussi de lever un
impôt personnel, à charge pour les notaires de permettre aux Quatorze de la
Chapelle de repérer et d'identifier les personnes qui le paieront. Les
qualificatifs qui permettent de désigner un individu, mais aussi les
arguments qui justifient des abattements fiscaux, sont notables et
significatifs ar])( yerx des notaires. Pour l'historien, ils sont le reflet d'une
perception spécifique de I'organisation de la société et témoignent des
sensibilités à l'égard de ceftaines situations.
Dans les compoix, la proportion de femmes déclarant leurs biens est
stable jusqu'à la période de rédaction 1430, entre 15 o et 22Yo selon les
registresTa. Cette proportion baisse alors pour atteindre l0 %o en 1446-
14491s. La part de femmes chefs de feu augmente ensuite jusqu'à la fin du
XV" siècle et reprend un niveau semblable à celui d'un siècle auparavant,
17 oÂ. Ces taux sont semblables à ceux observés dans les villes du Midi de
la France76, et s'expliquent surtout par le faible nombre de femmes mariées
déclarant leurs biens paraphernaux' Ensuite, l'on a pris en compte ici, pour
7r C'est le cas de l'article cle Caroline Jeanne qui s'intéresse attx rôles de taille, entre autres
sources. « "Je suis vesve. seulete et noir vestue" : Constructions et stratégies identitaires des
veuves parisiennes à la fin clu Moyen Age », Hypothè.ses (2006). p. 191-201. Pour r.tn état
de l'histoire du genre: O. Hurrlrr, « Férninin/masculin: I'histoire du genre >s. Revue
d'Histoire de l'AmériqtLe Fronçaise, 57-1 (2004), p.173-479. Voir aussi P SrerronD et
A. MuL-oEn-B.\Krr.r< (clir.). Gentlering the MiddLe ]1.ge,s, (nurnéro spécial de la tevue Gender
and History), Oxfbrd. Blackrvell, 2000.
n B. M. Bp»os-Rrz« et D. Ior;Nr-Pner.(dir.), L'indivicln ctu f[oyett Àgc. inLlit'iJuution et
individualisation avant la tnodemité, Paris, Aubier, 2005, p. 25.
,t Statistiques réalisées à partir du dépouillement systématique des 39 registres rnédiévaux,
entre 1380 et 1480. AMM. Jofiie 239 à 274 et Joflie 280.
7t Les registres dressés en 1146 et 1447 ont donné lieu à une grande réfectiot't, en I 448, devant
la colère des habitants qui les trouvaient injustes. Voir A.-C. M,qnlN-RrNlelln^ )vfontpellier à
taJin du MoyenÀge..., p.35.
Les comPoix montPelliérains 115
des raisons pratiques, uniquement les femmes dont le nom figure dans I'en-
tête des manifestes, n# ce[es dont le nom apparaît au détour d'un
confront ou de la mention d'une vente' Quant à la proportion d'hommes
estimés, elle est remarquablement constante et se maintient au-dessus de
gO %",'rurf pour l'année de dressement 1404 où elle est autour de 77 %ô et
celle de 1480, 76"/i'. Au-delà du ratio sexué des contribuables
mon@elliérains, les "o*poi"
témoignent de. la manière dont le consulat
identifre ces hommes "i'""' f"*à, c'est-à-dire sur les représentations
L"*l"t q"i transparaissent à travers quelques mots brefs portés à l'en-tête
des manifestes.
Dans la plupart des cas, les notaires et greffrers-du Consulat^ne se
limitentpasàdonnersimplementlenomdescontribuables'Entre1380et1480, les trois-quarls A"r'f"*"'"' et des hommes sont identifiés par leur
profession, leur statut "à";"g"f,
des liens de consanguinité ou plusieurs de
ces éléments' Il existe;#;i"t compoix des disparités assez.Jorles : d'une
part entre les registres Ji,t'" -Crn" période de rédaction' d'autre part de
manièrediachronique,"t""f"'dans^larépartitionsexuéedesidentif,rants'Ài"ri, p"* le registre de Sainte-Croix dressé en 1380' les notaires ont
;;ré i" professtn de 85 % des hommes ou I'on relié à un groupe
familial. Ils ont pro"JJe j" tê'n" pour près de 66 Yo des femmes' En
revanche, dans le ,.gi;" àu faubourg Saint-Jacques de la même.année'
seulement 63 yo dest o,nÀ", "t
35,6 %o'des femmes ont reçu de semblables
qualif,rcatifs. C", e"utttl"*ent s'expliquer par la forte personnalisation
des compoix de la part â'' f"tto*tt "o"trtuite : chaque registre contient
un certain nombre O" ÀÀ"Utions qui lui sont propres et qui diffèrent de
celles contenu", Aars d'autres' De même' chaque notaire attache une
i-fàrt*"" variable à certaines situations familiales ou sociales'
Malgré ces variations entre les registres d'une même période' l'on
observe que la propo.tiot' d" femmes qualifrées par leur mélier',leur statut
conjugal ou consanguin s'accroît dans le temps' F,n revarrche'. dans le cas
des hommes, l'augmentation de la fréquence des qualificatifs cesse au
,.riti"., du )fÿ" siècle pour se stabiliser à un taux moindre'
iît, t" ",,rr*
d* Rrc.*rnrÈnq « Les origines médiévales de f impôt sur la fortune »' dans
Ph. Cor.rrann'le, l. r**-J "ia*'
Rrc'quorË (dir')' L'impôt au Moyen Âge' L'impôt public"'
t.1,p.227-287T,Lapartrestanteestconstituéemajoritairementparlesestimationsd,héritiers(quirenvoient
à des succession, .,.""* à" fiq'idation) dont le sexe est non identifié car la formule est
« manifest dels heretiers de ' ' ' »'
" Parce que les femmes estimées sont plus nombreuses'
Thbleau l' Proportion et nombre de femmes identifiées par leur métieretlou leur statut conjugal etlou l*" g"rup" lamilialTe
Thbleau 2' proportion et nombre d'hommes identifiés par reur métieretlou leur statut conjugal etlou teur groupe tamilial
116
''' Il s'agit ici d'un échantilion cle 26 registres sur 39.
Memini. Travaux et documents
AnnéeSepten Croix Faubourgs Firmin Foy Mathie
u Paul
1380 65,7 yo
(67)35,6 yo
( l6)
1404-16 67,6%(.7s)
4s,8%(60)
33,3 %( 16)
1429-35 78,7 %(37) 77,8 % (1) 71,2%
(37)77,4 %
(.24)73,s %(2s)
1446-49 100,0
% (1e)82,6 yo
(1e)91 ,3 Yo
(21)84,6 yo
(1 l)67,7 %(2t)
89,7 y;o
(26)
1469-70 92,0 yo
(46) 58,3 % (7) 83,3 yo
(40)91,7 %(22)
83,3 yo
(35)
1480g4,g yo
(e1)9g,g yo
(86)87,5 %
(35)87,3 %(ss)
94,6 %o
(70)
AnnéeSepten Croix Faubourgs Firmin Foy Mathieu Paul
13 8084,8%(442)
62,9 yo
(1s7)
1404-1416
64,6 yo
(308)47,6 yo
Q06)44,9 yo
(1 1s)
AnnéeSepten
Croix Faubourgs Firmin Foy Mathieu Paul
1429-1435
79,7 yo
(231)82,3 yo
(107)68,9 yo
(t7s)66,5 yo
(137)69,4 yo
(161)
r446-1449
79,8%(1 38)
63,7 yo
(86)79,0 yo
(132)74,1 Yo
(103)86,4 oÂ
(318)74,6 Yo
(176)
1469-1470
69,9 yo
(te7)49,0 yo
(70)58,3 yo
(1 ss)67,9 Yo
(108)70,4yo(171)
148071,2yo(2se)
66,5 Yo
(232)69,7 yo
(140)68,7 yo
(184)74,9 yo
(2st)
Les compoix montpelliérains
L'accroissement des qualificatifs entre 1380 et 1450 peut s'expliquerpar l'intérêt et le soin grandissants portés aux documents officiels par leaonsulat, dans un but juridique et fiscal, ainsi que dans un souci de
transparence vis-à-vis des autorités royales et de la population. Ce nouvelesprit administratif a pu inaiter le personnel à être plus scrupulerx et àconsacrer plus de temps à l'inscription de chaque contribuable. La chute
démographique subie par la ville au tormant des XIV" et XV" siècles réduitpar ailleurs la longueur des registres, facilitant une démarche plusqualitative de la part des notaires. Le nombre de contribuables se réduit en
effet fortement dans les compoix entre 1380 et 1435, répondant à la fois à
la crise démographique qui affecte la ville et aux tentatives répétées pax leconsulat de faire baisser le nombre de feux taillables par le roi80.
En adoptant un regard geffé, l'on observe que la proportion de
femmes qualifiées est plus élevée que celle des hommes, à l'exception de
quelques registres. Par ailleurs, une analyse plus approfondie des résultats,montre une répartition très claire des qualificatifs. La mention du métier est
inférieure à l0 yo pour les femmes dans 22 registres sur 26, au maximum17 Yo, alors qu'elle est supérieure à 50 Yo dans 24 registres sur 26 pour les
'u La corespondance au sujet des fèux et de la taille est contenue dans le Grand Chartrier.AMM, Grand Chartrier. Amoire D. cassette 14. Louvet 1725 à1746. Voir aussi A. Couxou.« De I'impôt communal à l'impôt royal. Le cas de Montpellier ». dans D. MEN:or el a/il(dir.), L'intpôt dans les villes de I'Occidenl..., p. 291-304.
117
118 Memini. Travaux et documents
s,AMM, Joflre 249. Saint-Firmin. 1435, lo1.3l (deux manifestes), 62v.72,85v,97v, 104v.
105, 129v, 132v. En foliotation médiévale.
" AMM. Joff,re 2,11, Sainte-Croix, 1380, fol.4v, 5v. 50, 55v, 65v,82v, 85' 87.87v' 93v' 94'
95v, 96v, 98u I 09. 1 I 5v (deux maniflestes).
,r Sh. Fennrrn, Surviving Poÿer\) itt Medieval Paris. Gender, Ideobg'. antl the Dttily Lives ttJ
the Poor, Ithaca et Londres, Comell University Press. 2002, p l I 8'
'r C. Bounrrr, « L'anthroponymie à Paris à la fin du XIII' siècle d'après les rôles de la taille
clu règne de phitippe Lè gel ». dans M. BounrN et P Crrnru.t.s (éd.), Genèse médiévule de....
t. Il-2.1992. p.9'44.
hommes. Inversement, la mention du statut conjugal ou familial des
hommes est toujours inférieure à 9 yo, alors qu'elle est portée al]x
manifestes de plus de 50 Yo des femmes à l'exception de trois registres. Les
femmes sont donc plus souvent identifiées par leur pa.renté, consanguine ou
d'alliance, et les hommes par leur profession.
L'importance du métier dans la désignation des hommes est
particulièrement sensible dans le compoix de Saint-Firmin pour l'année
l+:S. À dix reprises, le notaire a indiqué « ajurat que non a ges lrien] de
moble mais a son bon mestié8', », la mention de la profession suit dans huit
cas. Aucun autre compoix ne contient de formule semblable, le notaire se
limitant la plupart du temps à « a jurat [parfois : per son sagramen] que non
a res de môble ». Dans ce registre, nulle femme n'est concemée par cette
expression. c,est par contre le veuvage féminin qui est invoqué de manière
,"-blubl", surtout dans le registre de Sainte-Croix pour l'année i380, où
l,on trouve 17 fois une expression variant autour de « paubra dona vezoa
[veuve], a jwat per son sagramen que non a res82 )). Dans les miracles de
Saint-iouis, Sharon Farmer observe un phénomène semblable :
Only when the witness was a women, however, did the
scribes record the identity of the witness's spouse : as an
aspect of the reproductive sphere, marital status was
essential to identify a woman but not a ma ' Work, by
contrast, was cln aspect of the productive, or masculine
sphere, and thus more central to men's identities ["']83
Les rôles de tailles de Parissa se révèlent aussi contrastés. En
revanche la mention du métier ne montre pas de différenciation genrée
majeure : les femmes sont en effet identifiées par leur profession dans plus
65-Yo des cas, taux certes inférieur à celui des hommes, mais très semblable
à la mention de leur situation familiale. L'importance de ces deux §pes de
Les compoix montpelliérains
85 lhid.. p.29.
"'C. Beerl'rr.:. « The Probler-n olwoman's work Identities in post Black Death England ». dansJ. BrrrHwr:rr-, J. Grrrnrng et M. ovno» (éd.). The prohlem ,f Lubour in FourteJnth-c)enntrvEngland. York, York Medievar press. 2000. p. I - I 9. pour rei statistiques voir r e tabreau p. 5.t' Sh. Fenr,,rrn. Suruiving pllystty it1 Medieval paris..., p. 39_40.
" « molher que fbnc de » ne peut se traduire que rnaladroitement par « épouse qui était celrede ». Pour alléger la lecture J'expression a èté tracruite par « de feu ». AMM. Joffre 239.Sairrr-Firrnirr. l,10zl, lol. I0ir.
8' AMM. Joflie 257, Saint-Marhieu. 1447, tbl. 192v.
"' AMM. Jofiie 240. SaintJacques, 13g0, fbl. 75.
"' AMM. Joffie 252, Sainrpaul, 1,135. fbl. 9v.
"r Fille ou tils - ici une firre - du premier rit de l'épouse, en occitan « firhastre ».ot AMM. Joffre 240, Saint-Jacques. 13g0. fbl. 73v.
119
désignation des femmes, de ces « modèles concurrentss5 )), pour reprendreles termes de caroline Bourlet, ne se retrouve pas à Montpelliei où lelglier _
xe permet pas d,identifier les femmes et où le systèmed'identification est donc fortement genré. L étude comparative de quatre.relevés d'impôts anglais par cordelia Beattie montrè aussi une nettedomination de la parenté consanguine et d'afliance pour res femmes, arxdépens du métier86.
Pour sharon Farmer, ces differences dans la désigrration deshommes et des femmes s'expliquent par re paradigme s-outenant laconstruction des représentations du genre au Moyèn Âge, paradigme fondésur le récit de la chute d'Adam et Ève. pour l'historieÀe, ce pasisage de la!enè1e ne renvoie pas tant à une distinction corps/esprit'marq:uant lafrontière féminirÿmasculin, qu'à une répartition des tacnes üant l,humanitéà la chair. Aux hommes la productivité, par le travail physique, al,, femmesla reproduction, par la douleur physique. « Indeed, tÀe identification ofmen with the productive labor and women with reproductive labor was so
{eep and widespread that it even affected public iecord keeping [...]rr».c'est peut-être naturellement que les notaires et greffiers du consulattendent à qualifier les femmes par leurs liens familiaux ou leur statutconjugal, et les hommes par leur profession. Dona Guilhelmeta, est épousede feu Johan Monierencss; Dona Dos4 sæur d,Urban Girartse; boruBlanqu4 mère de Pos Aufree.. D'autres ne sont pas nommées mais sontdésignées par des liens de parenté : la nièce de nidier Duran et de vidalBasseter, ou la fillâtree2 de Pons de cabanas, femme de Franses Martine3.De même, maître Johan de la Costa, alias de Bras est barbier de
120 Memini. Travaux et documents
Sainte-croixea, Esteve Barni est boucher de bæufls et pey.e cayrar estmarchande6' euant à pey'e et lo.ri, "sii*i, en 1404 à saint-Firmin, ilsn'ont que leur prénom
"i l"rr métiér , r"1o" est << re cultivateur » et Joni« le pâtissierei >>' La. fonction_pre.,à p*Ëoi, re dessus ,*'iJno.o, qrriapparût en information secondâire : «ïanifeste a, pJr"* iJ, îïqu,r",qui a pour nom Andrieu Goies », n **ir"u" du foumier du four duChâteau qui a pour nom Johan Marties ».
La hiérarchie entre chair et esprit se situe plutôt sur l,échellesociale, le peuple - hommes et femmes - est rié à sa corporalité, à l,inversede la noblesser.,. Les hisroriens ouruiii*t a*, 1", ilil'rJ#irË, ,or,des observations que.l,on {o,it ."pp-.h".;s propos de Sharon Farmer :devant les tribunaux, res nobres p;; il;onnêteté dans reur titre, reurreputation est a priori n9yitiv9. ï", g;;;, peuple doivent prouver leurbonne fama par leur métier, r"* irriirr-",î que l,on dit d,euxr,r. L,onremarque ainsi dans les compoix que les rât*r",
",irrr"rlr"riqrî.*"_*,la profession des hommes t C, to.t rrrer, "àn
u, de la population et duconsulat comme les deux yzam Teintn ri"., père et fils marchandsdrapiers, dont les notaires n" p.e"ir"nilîmetièr qu,une roirï ,"ptestimationsl.2. par ailleurs, res details [; ;]"r variés sont principarementapportés aux manifestes res plus faibreÂent a,ivres, uËi." "'*"Àpter.Comme si la mention « nichil, "" ,;tri;;it pas toujours, les notairestiennent à préciser, comme on
'a lu pour les veuves, un détail particulierjustifiant peut-être davutage'exemption ou *" réduction des charges.
L'on trouve ainsi des mentions de la faiblesse physique : l,âgecomme Remon Belluoc « m9u1 viel e paubre home,o, » ; la malaàie commeEsteve calvet, « se,ier, malade a" sâini-a"âine [mal des ardents] qui aq AMM, Joffre 251, Sainre-Croix, 1435, fol.44v.e' AMM, Joffre 255, Saint_paul, 1446, fol. 179v.% AMM, Joffre 250, Sainte-Anne, t435, fol. 27.e7 AMM, Joffre 239, SaintFirmin, 1404, fol. 96v et 123v.
:: AMM, Jotrre 243,Sainte_Croix, 1404, fot. 21.e' Ibid., fol.44.r00Sh.
Fanrræn, Smtiving poverÿ..., p. 39_43.r0rA' Ponrsau-Brrrrn, et A. Terazac-Launrur, << La renommée dans le droit pénal raique duXIrI" au XV" siècle », Médiévales,z1 tt,iiy, p.ïiiËi'C. Geuvano, « Honneur de femmeetfemmed,honneurenFranceàÉfinà;ttiyi""Âi""rl)rrrncia,28-1
(2001),p. 15g_1g1.r.2AMM' toffre241' Sainte-croix, 13g0, fol. 7 ; Joffre 243, sainte-cro ix, 1404,fo1. g, 107 et109 ; Joffre 251, Sainte_Croi x, :rlls,i.t. à, tisâ'isi-"'103AMM,
t offre 245, Faubourgs, 1 4 I 7, Saint_Firm in, fol. 27 v.
Les compoix montpelliérains
perdu une jambe dudit mal'04 >>, ou Sezelia et Peyre Morgolh, pauvres et
aveuglest0s. Notre échantillon contient 24 individus qualifrés par leurdécrépitude ou une quelconque faiblesse physique. La cécité et
f impotencel06, souvent associées à la vieillesse, sont largement
majoritaires avec neuf occumences chacune. Un homme est paralysélo7 et
d'autres sont malades, sans guère plus de précision. Parmi ces individus, lamoitié est « nichil », c'est-à-dire ne possède rien des biens estimés à moinsde 25 livres. Dans ces cas, l'ajout par le notaire de leur état physique
permet de justifier leur pauvreté. Ainsi, Esteve Calvet, qui a perdu sa
jambe, « fait publiquement l'aumône arx portes des églisesros », corlmePeye Morgolh, aveugleloe. Les 12 autres mentions de la conditionmédicale des contribuables servent à justifier un dégrèvement
exceptionnel, par exemple l'exemption des meubles. Ainsi les consuls
révisent pour la deuxième fois en 1420 l'estimation de Johan Dorlhac,orgier de Sainte-Croixlto. Déjà en 1412, l'on baissait son meuble, parce
qu'il ne pratiquait plus de métier et ne pouvait gagner sa vie. L'on sait
pourquoi cinq and plus tard, quand il est exempté du meuble restant. Johan
est malade depuis longtemps et il l'est encore le 26 féwier quand le notaire
inscrit la note. Il est marié, sa femme prend probablement soin de lui,comme le fait l'épouse d'Amaut Rendayre, foumier aveugle du même
quartier. Cette demière jure à sa place qu'il n'a aucun meuble à déclarer, en
raison de sa conditionlll.
Parmi ces malades, ces aveugles et ces personnes impotentes,
seulement quatre sont des femmes. En miroir, aucun homme ne déclare être
un pauvre veuf, alors que c'est le cas de nombreuses femmes. Dans le
dénuement, les hommes se situent par rapport aux standards positifs de
pauvreté masculinelr': pauvres honnêtes, handicapés ou travailleurs -comme ceux qui ont « leur bon métier » -, dignes de recevoir l'aumône
'o'AMM. lofTre 251, Sainte-Croix. 1435. fol. 62v.
r05AMM. Joffre 251, Sainte-Croix, 1435, lol.58v pour Sezelia. Joffre 257 bis, Saint-Firmin.
1448. fol. I94.r!6« impotent », « despoderat » ou « decrepitat ».
'n'AMM, Joffre 243. Sainte-Croix, 1404. fbl. 37.
"''AMM.Joffie 251. Sainte-Croix. 1435. fol. 62v.
ro"AMM, Joffre 257 bis. Saint-Firmin. 1448. lol. 194.
"iAMM Joffre 243. Sainte-Croix, 1404. fbl. 51. Il était estimé en 1404 pour 954 livres dont
800 de meubles.
Lrll est estimé pour 33 livres. AMM. Sainte-Croix, 1435. fol. 107v.
121
122Memini. Tiavaux et documents
pubrique' Ils sont dans I'incapacité de gagner leur pain quotidien en raisonde leur corps ori en aepild;ffi;;ff;É.Tl'r t"-,,o quant à erles menenren avant la rupture des.liens *rurg;*;; justifier de leur pauvreté. Lesaumônes sont en effe:.:dï]rnée, Ë;."d e;uvres femmes,r3, en particulierles pauvres veuves^ oui' comme t"u.,'o-àiàgues mascurins handicapés ouhonnêres appartiennànt * purr.", à"'èùi.r. Ce groupe aux contoursflouslra se distingue a*ri"ri"îpï",
"à;: par les exemptions donr ses,ïi3,:",'."rJî.,;,,ïIT:,",no,',Ë'r.ïirnr;n* jusrincarirsajoutéspar
marqués par 1es ,"r.1:-f^:,"'ent désignés par leur. pu'*",t,-lllàli ,urrl
m i,i ù * i î*ï J#:iiïiHii, :;,i.ffi iî"#i l :, aà, ig, J ", a *
*{.*
reputation ^g:l:1ériré {gs sourcgg fiscales médiévales estcertainemenr iniustifiée oanr t"
"u, àü. nîirré rée,e et proporrionnelre.une approche plus quaritative, ad;r;;; ;ï., objets historiographiquesa*uels' permet de révLrer.reur Ë"i*,'i"-rr,eioï-. nou, l,avons monré iciavec .histoire de la famille
",'r'rrirr"ir"-a""genre. Ainsi les dyramiquesfamitiales, absentes a, o"iàÀ""i';ffi#iie ces archives, se .evàtentregistre après reeistre et montrent [* .o.nplexité ainsi que ra nécessitéd'une étude miiutieuse. C;:; ü*piÏ#i*,rr"r. p-pr", a "r.,uqu.
notaire' les formules d'un systématir-" t o*p"* témoignent de ,a manièredonr le consulat t".rt" a'o.io*".*ü"'rï*"ilrrrriéraine. Ils permettentà l'historien d'accéder.à * ,Vrter" à"'r"r*r*orions spécifique de lasociété médiévale. Un dépo.uiIÉ;#.;ilü'0,.,
ou" fastidieux, s,avèrenécessaire pour saisir r, a;"...iiJ o.r"il"Ë.,res famiriares er l,efforrcroissanr dans ra quarificarion ;;; ffi#J,r]'r, ,,r." ainsi des résulrats;X."tr 1î::r1e1a
multiplicire 0". *uiir"ü; t,on peut mener grâce aux
'J%#,i:'rï"j:,;:::*": dtt Mrryen Àge, une étutte ,tociate,_paris, Ftachette. re78;Paris. Callimard. tqgz.
u lt piti': ' l'Etrrcp"t lts putrtte, au wot,n' ,11,1')')i,,, rn,,rr.' SUr les lentmes paurrc: \oir N. Gu\trJil R- Ll.rm,.t.r,:t D,
L:"1;,iff:fL'Jll;-?j :q' t,.,,"' È.,,,,.,.'.:.!fl:lhl",'rT;,):;!i,,,:J,l: 'i!,li:"
;,a,..,.n, a 'j.ï
,.ï,î:::;"I' ;i, ll " ",1::i:,lnes des bal.res a. i, É,i.,ii';:,e, igno,
T',' I :;; ctu xtt :ii' tt *, ,,trl,i )î *i":,!,';,1';:K";."f';;lï:,:?lfil';;*
;ïiJ::îf !1$,'ï iï'ï:1; f :::'ïâii:*i J,:':l. sous r e\ press ion généra,e de
diverse..,Danier Lr Br rvr ,.la rrnaïr"ài") :.,1,'r..,;: #:','rbres du Molen Ase c5r