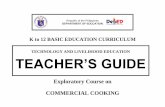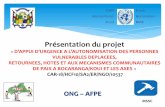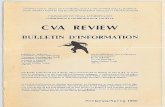Vestiges textiles et activités de filage sur le site néolithique d'Arbon-Bleiche 3 (TG, Suisse)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Vestiges textiles et activités de filage sur le site néolithique d'Arbon-Bleiche 3 (TG, Suisse)
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
Fabienne MÉDARD
Vestiges textiles et activités de filage sur le site néolithique d’Arbon-Bleiche 3 (TG, Suisse)
RésuméLocalisé au sud-est du lac de Constance (Suisse), le site d’Arbon-Bleiche 3 (TG) a livré, entre 1993 et 1995, un matériel riche, abondant et remar-quablement conservé. Associés à un niveau d’occupation unique, ces vestiges offrent l’opportunité d’étudier l’activité d’un village néolithique détruit en pleine expansion. Incendié au terme de 15 années d’occu-pation, le village a été définitivement abandonné en 3370 avant J.-C. Plusieurs artefacts et restes textiles ont été mis au jour, mais ce sont les fusaïoles qui retiennent l’attention. Admirablement préservées, elles constituent la plus importante série mise au jour pour cette période et permettent d’appréhender un aspect souvent négligé de l’activité textile : le filage.
AbstractBetween 1993 and 1995 the Arbon-Bleiche 3 (TG) site, located south-east of Lake Constance (Switzerland), yielded rich, abundant and remarkably preserved remains. Associated with a unique level of occupation, these remains provide an opportunity to study the activity of a neolithic village destroyed when still in full development. Burnt after 15 years of occupation, the village was definitively abandoned in 3370 BC. Many artefacts and textile remains have been discovered, however the spindle-whorls drew the most attention. Admirably preserved, they are the most important series discovered for this period and highlight an often neglected aspect of the textile industry: spinning.
Grâce à des conditions de conservation exceptionnelles, le site lacustre d’Arbon-Bleiche 3 (TG, Bodensee/lac de Constance) apporte une remarquable contribution à notre connaissance des activités textiles au Néolithique. Détruit en 3370 avant J.-C. dans un incendie, le vil-lage a très rapidement été enseveli sous les sédiments lacustres, préservant ses vestiges de toute dispersion ou dégradation. L’étude archéologique montre qu’au moment de sa destruction, le site était encore en acti-vité, ses structures d’habitation entretenues et le rythme de production constant. Les vestiges suscitent d’autant plus d’intérêt qu’aucun autre site lacustre contempo-rain n’a été découvert dans cette région. Enfin, le gi-sement ne comporte qu’un seul niveau d’occupation
que les datations dendrochronologiques permettent de caler avec précision entre 3384 et 3370 avant J.-C., soit 15 années d’existence “ quotidienne ” quasiment intactes, associées à la culture de Horgen.Parmi les nombreux vestiges archéologiques retrouvés à Arbon et en dehors des restes de vannerie (Leuzin-ger, 2002a, p. 126-133), nous disposons, pour abor-der les activités textiles, de 3 assemblages de côtes appointées1, 1 lame de tisserand dont seule subsiste la poignée, 74 fragments de fil, cordelettes et cordes, 5 fragments d’étoffes cordées, 3 fragments de tissus carbonisés, 1 fuseau garni de fil, 24 poids de tisserand et surtout un nombre considérable de fusaïoles : 409 exemplaires dispersés sur l’ensemble du site.
376 Fabienne MÉDARD
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
2002, inédit ; Leuzinger, 2002a, p. 120 ; Winiger, 1971, Tf. 69).Une étude méticuleuse des pieux de construction (ré-partition spatiale et dendrochronologie) a permis de
Remarquables par leur quantité, ces fusaïoles le sont encore davantage par leurs positions géographique et chronologique : elles constituent à ce jour les plus an-ciens modèles connus en Suisse orientale (Médard,
Fig. 1 (ci-dessus et ci-contre) – Arbon-Bleiche 3 (TG) : évolution du plan d’occupation du site (d’après Leuzinger, 2000, p. 160-161).
Vestiges textiles et activités de filage sur le site néolithique d’Arbon-Bleiche 3 (TG, Suisse) 377
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
reconstituer, année après année, le plan d’occupation du village, chaque bâtiment étant parfaitement indivi-dualisé (fig. 1). L’opportunité de confronter les vestiges avec l’évolution d’un site n’ayant quasiment souffert d’aucune perturbation post-dépositionnelle constitue un atout irremplaçable pour la compréhension des ac-tivités textiles au Néolithique.
PRÉSENTATION ET RÉPARTITION SPATIALE
Fusaïoles
Le nombre élevé de fusaïoles recueillies sur le site les place au cœur de cette étude, spécifiquement orientée vers l’analyse des activités de filage.
378 Fabienne MÉDARD
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
Un examen attentif permet d’observer quatre zones à forte densité de fusaïoles (bâtiments 3, 8, 20 et 21), alors que d’autres emplacements en sont totalement dépourvus. Le soin apporté à la reconstitution des structures d’habitat permet de préciser que 80 % des fusaïoles se situent dans les unités d’habitation, ou à si faible distance des parois, que leur présence à l’in-térieur des murs au moment de la destruction du site peut être considérée comme assurée (fig. 2) ; restent 20 % de pièces trop éloignées des bâtiments pour être assimilées à ce groupe. S’il ne suffit pas à démontrer que le filage avait lieu dans les habitats, cet indice suggère au moins que le matériel de filage y était en-treposé. On observe par ailleurs des concentrations de fusaïoles à proximité des aires de tissage ; les associa-tions fusaïoles-poids de tisserand laissent en effet peu de doute quant à la vocation, totale ou partielle, des structures qui les abritent (cf. infra).
D’autres bâtiments occupant à peu près la moitié de l’espace fouillé sont quasiment exempts de fusaïoles (l’absence de fusaïoles dans les bâtiments 12, 26, 27 pourrait être liée à l’érosion du site dans ce secteur) : avec toute la prudence qu’implique ce type d’argu-ment a silentio, on peut supposer, lorsque les sols ont été préservés de l’érosion, qu’ils répondaient à une fonction différente de celle de l’habitat (greniers, étables…) ou abritaient d’autres activités. La concen-tration de certains vestiges à l’intérieur des habitations met effectivement en évidence des aires de spécialisa-tion consacrées à la taille du silex (par exemple, dans le bâtiment 9), au broyage des céréales (bâtiments 1, 3, 4) ou au traitement des filets de pêche (bâtiments 2, 4, 13) (Leuzinger, 2000, p. 157), etc.Sans entrer dans le détail, l’évolution de l’habitat révélée par l’analyse des pieux de construction permet d’affirmer qu’à chaque nouvelle phase d’expansion du
Fig. 2 – Arbon-Bleiche 3 (TG) : répartition spatiale du matériel textile.
Vestiges textiles et activités de filage sur le site néolithique d’Arbon-Bleiche 3 (TG, Suisse) 379
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
village, près de la moitié des bâtiments abritaient des activités textiles. S’il ne fait aucun doute qu’elles ré-pondaient à un besoin de première nécessité, force est d’admettre que toutes les unités domestiques n’étaient pas liées au travail du fil. Faut-il envisager la spécia-lisation de certains membres de la communauté, voire l’existence d’espaces spécialisés ?
Pesons
Leur répartition spatiale les confine plutôt en limite intérieure des bâtiments, observation bien illustrée par un groupe de 8 pesons rassemblés dans la
construction 10, édifiée en 3381 avant J.-C. à l’ex-trémité nord du site (voir fig. 2). Bien qu’associés à plusieurs phases de construction, plus de 70 % des pesons sont liés aux premières phases d’occupation du village, entre 3384 et 3381 avant J.-C. Cette fourchette chronologique correspond à l’expansion maximale du site, sans doute marquée par une aug-mentation de la population allant de pair avec un accroissement du nombre de structures liées à la production textile. Cette observation, largement con-firmée par l’étude chronospatiale des fusaïoles (cf. supra), suggère de réels besoins dans ce domaine, plus qu’une activité occasionnelle.
Fig. 3 – Arbon-Bleiche 3 (TG) : nos 1, 2 et 3 : poids de tisserand ; n° 4 : reste d’une lame de tisserand.
0 5 cm
380 Fabienne MÉDARD
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
La répartition des pesons à l’intérieur des habitats évoque, quant à elle, la présence de métiers verticaux à poids, probablement adossés contre une paroi, ou dressés devant, afin de limiter l’encombrement. Il n’en subsiste néanmoins aucune trace archéologique. Dans la littérature, les pesons ne sont d’ailleurs pas tou-jours associés au tissage : plusieurs hypothèses ont déjà été proposées parmi lesquelles d’éventuelles uti-lisations comme calage de poteau ou comme support de fuseau (Ramseyer et Michel, 1990, p. 25 ; Wini-ger, 1995, p. 178 ; Schwab, 1999, p. 219-220 ; Médard, 2000, p. 37-40). La morphologie de certains d’entre eux n’exclut effectivement pas ces possibilités (fig. 3, nos 1 à 3). Parallèlement, les documents ethnologiques attestent l’existence de métiers horizontaux rudimen-taires n’utilisant aucun dispositif de tension verticale, ce qui pourrait constituer un autre argument dans ce sens. Les fils de chaîne peuvent être tendus quelques centimètres au dessus du sol à l’aide de pieux, ou encore fixés à un support vertical (arbre ou poutre), la tension étant assurée par la tisserande elle-même, reliée aux fils de chaîne par une ceinture (Hecht, 1989, p. 11 et 63). Dans le cas d’Arbon, on peut néanmoins supposer que les pesons servaient à tendre les fils de chaîne des métiers verticaux, comme le suggèrent leur répartition spatiale au sein de l’habitat et leur associa-tion avec de nombreuses fusaïoles. En effet, la dimen-sion des métiers horizontaux les destine plutôt à une utilisation en extérieur, appropriée aux régions chaudes et sèches. À l’inverse, les métiers verticaux sont adap-tés à des conditions climatiques plus capricieuses, car ils permettent de tisser à l’abri des intempéries. Pour des questions d’encombrement, la préférence donnée à un dispositif de filage peu volumineux s’impose avec évidence.En admettant que les quatre concentrations de pesons attestées sur le site révèlent chacune la présence d’un métier à tisser, le nombre moyen de poids de tisserand par métier s’élèverait à 6 exemplaires (24/4). Or, un tel nombre de pesons ne permet pas de tisser de grandes largeurs. Pour des pesons de 500 g environ – les exem-plaires d’Arbon pèsent entre 400 et 600 g – et compte tenu de la qualité des fils recueillis sur le site (cf. infra), on estime à 20 le nombre moyen de fils pouvant être accrochés à chaque peson. À l’aide de 6 pesons, on ne peut obtenir qu’un tissu d’environ 12 cm de large (in-formation Marie-Pierre Puybaret). Ce constat renforce l’hypothèse de J. Winiger, selon laquelle le Néolithique suisse n’aurait pas connu la fabrication de tissus en grandes largeurs, attestés seulement à partir de l’Âge du Bronze (Winiger, 1995, p. 143 et 184).Ces données ne reposent évidemment que sur une moyenne, car les pesons n’apparaissent pas en nombre équivalent d’une concentration à l’autre – respecti-vement 8 pesons associés au bâtiment 10 ; 4 pesons associés au bâtiment 20 ; 4 pesons associés au bâtiment 3 ; 3 pesons associés au bâtiment 14 ; 2 pesons asso-ciés au bâtiment 4 ; 1 peson associé au bâtiment 7 ; 1 peson associé au bâtiment 2 et 1 peson isolé –. Ces variations, propres à éclairer le faible nombre d’exem-plaires mis au jour, pourraient être expliquées par des problèmes liés à la conservation des objets. En effet,
les 24 exemplaires dont nous disposons présentent tous des traces de calcination. Vraisemblablement, ils se trouvaient à proximité des foyers les plus actifs de l’incendie. Si les pesons étaient en terre crue – ce que suggère l’extrême friabilité des exemplaires conser-vés –, on peut penser que les pièces moins directement exposées aux flammes ont rapidement disparu. En cela, les pesons d’Arbon ne seraient pas différents des pesons néolithiques, qui pour la plupart ont été cuits accidentellement (Altorfer et Médard, 2000, p. 45). Compte tenu du faible soin apporté à la production des céramiques domestiques sur l’ensemble du site (cf. infra), la présence de pesons en terre crue n’aurait rien de surprenant.Dès lors, il devient impossible d’évaluer l’importance comme la nature de la production textile sur le site. Les restes de tissus ne nous renseignent pas davantage à ce sujet. Le seul indice tient au nombre considé-rable des fusaïoles, qui laisse supposer une importante production de fil destinée, au moins partiellement, au tissage.
Assemblages de côtes appointées ou “ peignes à côtes ”
Trois artefacts constitués de plusieurs côtes, polies, appointées et maintenues ensembles par une ligature végétale, peuvent être associés aux activités textiles. Le site ayant livré de nombreuses côtes appointées, il est probable que ces objets étaient initialement mieux représentés.On leur attribue généralement la fonction de peigne à lin, même si aucun élément ne permet aujourd’hui de l’affirmer. Les documents ethnographiques n’offrent aucun parallèle avec ce type d’objets, jusqu’à pré-sent exclusivement liés à la sphère archéologique : on en a notamment recueilli sur les sites néolithiques de Meilen, Feldmeilen-Vorderfeld (ZH) et Montilier-Platzbünden (FR) (Winiger, 1981, p. 149 ; Ramseyer et Michel, 1990, p. 103). Pour l’avoir testé en expérimen-tation, J. Reinhard affirme que cet objet n’est d’aucun intérêt pour peigner la filasse, mais qu’il pourrait éven-tuellement avoir servi à l’égrenage du lin (information Jacques Reinhard). J. Winiger (1995, p. 162) l’asso-cie, quant à lui, à la découpe des lanières de liber2. Sans qu’il soit possible d’identifier avec précision la fonction des “ peignes à côtes ”, cet objet semble lié au domaine de la production textile.Sur le plan spatial, 2 “ peignes à côtes ” sont respecti-vement localisés à l’intérieur des bâtiments 5 et 6, le troisième se trouvant à l’extérieur, entre les construc-tions 4 et 7 (voir fig. 2). Nous ignorons si le lieu de découverte de ces outils renvoie ou non à leur lieu d’utilisation. D’expérience, nous savons qu’il est plus commode de préparer les fibres de lin ou de liber à l’extérieur, mais l’incertitude relative à la fonction réelle de ces ustensiles incite à la prudence.
Lame ou couteau de tisserand
Taillée dans un bois de frêne d’une remarquable qualité, la lame de tisserand recueillie à Arbon se distingue de
Vestiges textiles et activités de filage sur le site néolithique d’Arbon-Bleiche 3 (TG, Suisse) 381
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
la plupart des exemplaires connus, en bois d’if (fig. 3, n° 4). Aucune trace d’utilisation ne nous éclaire sur cet outil dont la fonction communément admise est de tasser les fils de trame (Winiger, 1995, p. 162 ; Rast-Eicher, 1995, p. 170). Certains auteurs inclinent da-vantage à penser qu’il s’agit de jouets ou d’imitations de poignards (Müller-Beck, 1991, p. 110-116). Quel qu’en soit le véritable usage, l’utilisation de cet objet comme lame de tisserand ne soulève aucune difficulté (Puybaret, 1989). Ce constat s’appuie en outre sur des parallèles ethnographiques, notamment sur la pratique du tissage dans les pays scandinaves (Hoffmann, 1964, p. 116, 117, 147 et 283).Cet objet est localisé dans l’enceinte du bâtiment 22, dont l’essentiel se situe hors des limites de fouille (voir fig. 2). Cette position excentrée et la rareté du matériel associé ne permettent d’apporter aucune précision sur son contexte fonctionnel.Les lames de tisserand sont particulièrement fréquentes dans les niveaux liés à la culture de Pfyn, notamment à Niederwil, Gachnang-Egelsee (TG), Meilen, Feldmei-len-Vorderfeld (ZH), Zürich, Kanalisationssanierung-Seefeld (ZH) ou encore Wetzikon-Robenhausen (ZH) (Müller-Beck, 1991, p. 110-111 ; Winiger, 1981, p. 60 ; Bleuer et al., 1993, Tf. 127 ; Altorfer et Médard, 2000, p. 69). Sa qualité de fossile directeur pour cette période nous amène à considérer l’exemplaire d’Arbon comme un représentant particulièrement tardif.
Vestiges textiles
La mise au jour de 74 fragments de fils, cordelettes et cordes, de 3 fragments de toiles tissées, de 5 frag-ments d’étoffes cordées et d’un ensemble fuseau-fu-saïole dont l’axe est encore garni de fil, enrichit con-sidérablement l’inventaire du matériel textile et permet de développer une approche plus complète des acti-vités textiles sur le site (voir fig. 2)3. Avant de pour-suivre nous tenons à préciser que les étoffes cordées peuvent être classés dans la catégorie des tissus : on parle parfois de tissu cordé. Dans ce cas, il est né-cessaire de faire une distinction avec les tissus tissés
car les techniques mises en œuvre pour les réaliser sont totalement différentes. Les étoffes cordées sont issues d’un système d’assemblage de fils, cordelettes ou cordes formant un tissu dont une partie des élé-ments constitutifs s’apparente à des montants fixes (éléments passifs) autour desquels est entrelacée l’autre partie des éléments constitutifs (éléments actifs) (fig. 4). Le tissu tissé correspond à un système d’entre-lacs dans lequel les fils de chaîne (éléments verticaux) sont pris puis laissés alternativement, un à un, deux à deux… par les fils de trame (éléments horizontaux) (fig. 4). Afin de ne pas les confondre, nous utilise-rons le terme d’étoffe cordée pour désigner les objets conçus à partir de la technique cordée et le terme de tissu, pour désigner ceux conçus à l’aide d’un métier à tisser.
Identification des fibresComme l’ensemble des vestiges textiles mis au jour sur les stations lacustres, les exemplaires recueillis sur le site d’Arbon sont constitués de fibres végétales. Les fibres d’origine animale n’ont effectivement pas été conservées dans ces contextes.Les analyses archéobotaniques effectuées sur les sites lacustres ont montré que la culture du lin (Linum usitatissimum L.) atteignait son apogée à la fin du IVe millénaire (Rast-Eicher, 1995, p. 169 ; Bromba-cher et Jacomet, 1997, p. 220-299). Les donnés re-cueillies à Arbon vont également dans ce sens. Des graines et capsules de lin ont effectivement été mises en évidence et l’examen macroscopique des vestiges a permis d’observer des copeaux d’écorce peut-être détachés de la tige lors du teillage (information Urs Leuzinger)4. On pourrait donc s’attendre à ce que la plupart des restes textiles soient en lin. Or, il n’en est rien. Les identifications de fibres mettent presque systématiquement en évidence l’utilisation du liber (principalement du liber de tilleul : Tilia sp.)5. L’in-tensification de la culture linière n’aurait-elle aucun lien avec la production textile ? Il semble en effet que le choix et l’utilisation des fibres textiles d’Arbon ren-voient au schéma commun à l’ensemble des sites la-custres néolithiques, à savoir des cordelettes et des cordes en liber, des fils fins en lin, des étoffes cordées en liber ou en liber et lin, et des tissus tissés en lin (Médard, 2002, inédit).Dans ce contexte, et parce que les fils les plus fins s’obtiennent généralement à l’aide d’un fuseau, il va presque de soi que les fils réalisés au fuseau sont en lin. Ils entrent par la suite dans la composition des tissus (Médard, 2002, inédit).Outre qu’il soit extrêmement rare, pour ne pas dire unique, de découvrir un dispositif de filage complet (fig. 5), l’analyse du fil enroulé autour de l’axe du fuseau a livré des conclusions inattendues. S’il est dif-ficile d’en préciser la nature exacte, ses caractéris-tiques permettent d’ores et déjà d’affirmer qu’il ne s’agit pas de lin, mais de liber. L’agglomération des éléments fibreux et leur forme aplatie ne laissent planer aucun doute sur l’identification (observation Christophe Moulhérat). À notre connaissance, cet ensemble consti-tue le premier témoignage archéologique tangible d’un Fig. 4 – Schéma de fabrication des étoffes cordées et des tissus.
382 Fabienne MÉDARD
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
fil de liber en cours de fabrication, utilisant la tech-nique de filage au fuseau : contre toute attente, les caractéristiques du fil analysé démontrent que le liber permet d’obtenir à l’aide d’une même méthode un pro-duit semblable à ceux qu’on obtient à partir de la filasse de lin.
Caractéristiques techniquesNous ne nous attarderons pas sur les nombreux frag-ments de fils, de cordelettes et de cordes formant un ensemble disparate qu’on suppose essentiellement constitué d’éléments de ligature. La plupart des objets appartenant à ce groupe présentent les caractéristiques des cordes : des diamètres principalement compris entre 4 et 12 mm et un retordage quasiment systéma-tique à partir de deux ou trois brins (Leuzinger, 2002a, p. 123-126).En liber de tilleul, les fragments d’étoffes cordées présentent les caractéristiques suivantes : conservé sur une importante surface (59 x 60 cm), l’un des frag-ments est constitué d’éléments passifs retordus en Z, mesurant 3 mm de diamètre et répartis en densité moyenne de 1,6 montants/cm. Les éléments actifs sont tordus en Z, mesurent 3 mm de diamètre et sont répar-tis à raison de 0,2 passages/cm. Une lisière (départ ou fin) partiellement préservée est encore visible. Comme on l’observe fréquemment sur les étoffes cordées, la lisière est conçue en repliant l’extrémité des “ fils ” passifs sur une corde, mesurant ici 3 mm de diamètre et présentant une torsion Z2s (la lettre majuscule in-dique le sens du retordage et la lettre minuscule le sens de torsion des fils simples). Le tout est maintenu par deux rangs de cordé en S.
Deux autres fragments mis au jour dans le même bâtiment pourraient appartenir à la même pièce : le premier consiste en une simple lisière. Les éléments passifs sont repliés sur une corde de 3 mm de diamètre, retordue en Z et l’ensemble est maintenu par deux rangs cordés éloignés de 2,3 cm. La partie passive est constituée d’éléments tordus en Z, mesurant 8 mm de diamètre et dont la densité atteint 1,2 montants/cm. La partie active est constituée d’éléments retordus en Z, mesurant 3 à 4 mm de diamètre. Le deuxième morceau est très endommagé mais présente, en partie passive comme en partie active, les mêmes caractéristiques de torsion, de diamètre et de densité.Enfin, deux fragments semblant provenir d’une même pièce ont été découverts à peu de distance l’un de l’autre et présentent les mêmes caractéristiques tech-niques : les éléments passifs sont retordus en Z (Z2s), mesurent 1,3 mm de diamètre et sont répartis à raison d’un montant tous les 2 mm environ. Les éléments actifs sont tordus en Z, mesurent 1,8 mm de diamètre et sont répartis à raison de 4 passages par cm. La den-sité et la qualité de cette étoffe rappellent celles des tissus.Les tissus mis au jour sont vraisemblablement en lin. Deux fragments tissés en armure toile (1/1), apparte-nant vraisemblablement à la même pièce, sont cons-titués de fils retors S2z mesurant environ 0,7 mm de diamètre. L’absence de lisière ne permet pas de distin-guer les fils de chaîne des fils de trame : on précisera simplement que la densité du tissu est de 10 fils/cm dans un sens et de 12 fils/cm dans l’autre. Le troisième fragment de tissu est également réalisé en armure toile. Il présente une lisière de départ et une lisière de côté mettant en évidence des fils de chaîne retors S2z, d’une épaisseur de 0,7 mm environ. Les fils de trame pos-sèdent les mêmes caractéristiques attestant la volonté d’obtenir une toile équilibrée. La densité du tissage est de 10 fils/cm dans les deux sens. Les densités de tissage observées à Arbon se situent dans la norme des tissus néolithiques. À propos des tissus recueillis lors des anciennes fouilles menées sur le site de Chalain (F-Jura), H. Masurel indiquait entre 6 et 17 fils/cm en chaîne et entre 12 et 24 fils/cm en trame (Masurel, 1985, p. 206).Le fil enroulé autour du fuseau est un fil simple tordu en Z, dont la section quelque peu aplatie a souffert des conditions d’enfouissement. On estime à 0,7 mm le diamètre du fil tel qu’il se présente aujourd’hui. On ne saurait dire s’il était ou non destiné à la fabrication des tissus. Ceux mis au jour sur le site ne semblent pas confectionnés à partir de cette qualité de fil : ils sont effectivement constitués de fils de lin qui, une fois retordus, ne mesurent que 0,7 mm de diamètre, soit l’épaisseur du fil simple en liber. Néanmoins, le site a livré peu de restes textiles : beaucoup ont sans doute disparu, nous empêchant d’en apprécier la diversité. D’autres sites néolithiques ont en revanche livré des tissus en liber : c’est le cas d’un fragment de toile découvert à Delley-Portalban II (FR), dans un niveau Horgen (Médard, 2000, p. 67 et 247). Il n’est donc pas exclu que le fil en liber mis au jour à Arbon ait été destiné à la confection d’un tissu.
Fig. 5 – Arbon-Bleiche 3 (TG) : dispositif de filage complet.
Vestiges textiles et activités de filage sur le site néolithique d’Arbon-Bleiche 3 (TG, Suisse) 383
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
MATÉRIEL DE FILAGE
Étude des fusaïoles
État de conservationOn dénombre 60 % de fusaïoles entières, 20 % dont la moitié, au moins, est conservée et 20 % de frag-ments plus petits. L’analyse spatiale ne laisse appa-raître aucune concentration propre à mettre en évi-dence des aires de rejet : la répartition des exemplaires fracturés s’apparente à la répartition spatiale générale. Si le nombre de fusaïoles brisées semble légèrement supérieur dans l’enceinte des bâtiments, le phénomène reste peu significatif. Par ailleurs, plus de la moitié des fusaïoles entières ont été retrouvées à l’extérieur des bâtiments (fig. 6).En stratigraphie, on observe cependant une propor-tion plus élevée de fusaïoles entières, dans la couche d’incendie. Correspondant à la dernière phase d’occu-pation du site, ce niveau réunit en toute logique les artefacts en bon état de fonctionnement. Les fusaïoles endommagées, situées dans la couche d’occupation, renverraient donc davantage à des objets abandonnés (Leuzinger, 2002a, p. 119).
ProductionMatière premièreToutes les fusaïoles recueillies sur le site sont en terre cuite, façonnées dans une argile lacustre locale. La plupart sont modelées dans une argile grise qui doit sa couleur à un enfouissement en terrain inondé, pauvre en oxygène. On trouve également quelques pièces en argile beige témoignant d’une meilleure oxygénation. Dans les deux cas, la matière première est extraite sur place : on peut supposer que l’argile grise était récoltée au bord du lac, contrairement à l’argile beige, située en amont. Le dégraissant est essentiellement consti-tué de minéraux concassés (granits, quartz ou feld-spaths), plus rarement de chamotte (céramique pilée). Bien qu’ils soient facilement accessibles, les sables calcaires recouvrant les rivages lacustres n’ont pas été utilisés car leur composition fait exploser les poteries
à la cuisson. Le dégraissant employé n’en reste pas moins grossier, notamment lorsqu’on le rapporte à la faible dimension d’une fusaïole. La déformation des surfaces qui en résulte nous oblige à convenir que les fusaïoles étaient soumises aux mêmes traitements que les autres productions céramiques. Il est d’ailleurs probable qu’elles étaient façonnées dans des restes de pâte, les besoins en matière première étant minimes comparés à ceux qu’implique la fabrication des grands vases de type Horgen.
FaçonnageDans l’ensemble, le modelage des fusaïoles n’est pas soigné. Les pièces dont les contours sont réguliers, les perforations nettes et les surfaces lisses représentent moins du quart de la production. Plusieurs éléments mettent en évidence le faible soin accordé au façon-nage : des fusaïoles présentent un bord aplati, d’autres ont une épaisseur irrégulière résultant de l’écrasement de l’argile encore souple entre les doigts du potier (fig. 7, nos 1 à 3). Les marques involontaires de végé-taux, de doigts ou de griffures, sont également fré-quentes. Une fusaïole a même été accidentellement amputée d’une partie de l’argile qui la constituait. Aucune amélioration n’a été apportée, si ce n’est pour la forme, au moins pour l’équilibrage de l’objet. Alors qu’il était encore possible de leur donner une forme régulière, la plupart des fusaïoles ont été cuites telles quelles après séchage. Des éléments (adhésif) attestant l’utilisation effective de pièces parmi les plus gros-sières, éliminent par ailleurs l’hypothèse d’un rejet des exemplaires “ défectueux ”. Ces observations, aux-quelles il faut ajouter l’irrégularité des perforations (voir ci-dessous), montrent que les fusaïoles d’Arbon étaient des objets purement utilitaires.
PerforationLa logique de fabrication, que ne dément pas l’analyse des perforations, veut que l’orifice soit aménagé dans une pièce en terre crue, avant séchage et avant cuisson. La présence d’un bourrelet de terre autour des perfo-rations (sur une ou deux faces) indique qu’un bâtonnet
Fig. 6 – Arbon-Bleiche 3 (TG) : répartition spatiale des fusaïoles en fonction de leur état de conservation.
384 Fabienne MÉDARD
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
Fig. 7 – Arbon-Bleiche 3 (TG) : caractéristiques de façonnage des fusaïoles. Nos 1, 2, 3 et 4 : contours irréguliers et perforations décentrées ; nos 5, 6 et 7 : perforations déformées ; nos 8 à 15 : fusaïoles décorées.
0 5 cm
Vestiges textiles et activités de filage sur le site néolithique d’Arbon-Bleiche 3 (TG, Suisse) 385
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
était inséré dans l’argile fraîche. Les rares exemplaires perforés à partir des deux faces, soit à peine 15 % de l’échantillon, n’ont aucune autre particularité. La per-foration est une étape du façonnage rapidement éva-cuée : bien que faciles à éviter, les bourrelets de terre et les éventuelles déformations causées par l’insertion du bâtonnet dans l’argile souple sont restés en l’état.D’autres éléments renforcent les observations qui précèdent : il arrive notamment que l’outil perforant soit incliné, créant ainsi une ouverture oblique. La fusaïole est cuite ainsi puis utilisée : en témoignent quelques fragments d’écorce conservés dans les per-forations. Il va de soi qu’un axe de fuseau oblique ne permet pas d’obtenir une rotation circulaire. Lors de l’insertion du fuseau, un rattrapage de l’aplomb peut être envisagé à l’aide d’un élément de calage ou grâce à un pâton d’adhésif.En tant que volant d’inertie, il est préférable que les fusaïoles aient une perforation centrée. À Arbon, une petite majorité de pièces (53 %) possède cette ca-ractéristique, les autres présentant des perforations approximativement ou totalement décentrées (respec-tivement 34 % et 13 %). Enfin, certaines fusaïoles présentent une perforation élargie, de forme ovale, ou obstruée par l’argile : ces déformations pourraient être dues aux circonstances de l’incendie et à l’ex-position prolongée à une forte chaleur (fig. 7, nos 5 à 7).
DécorsSeules quinze fusaïoles sont décorées, soit à peine 5 % de nombre total de pièces. Ce détail, qui n’influe en rien sur la fonctionnalité de l’objet, lui confère un ca-ractère d’exception.Onze fusaïoles sont décorées par incision sur une seule face et/ou sur la tranche : par application d’un ongle dans l’argile fraîche (décor en lunules) pour les tranches (fig. 7, n° 15), par des séries d’incisions con-centriques réalisées à l’aide de tiges végétales sur les surfaces planes (fig. 7, nos 8, 10 à 12 et 14). Dans un cas comme dans l’autre, l’organisation et la profondeur irrégulière des incisions témoignent d’une exécution rapide.Trois fusaïoles sont ornées par impression : la première porte une série de cupules, manifestement effectuées à l’aide de graines (céréales) (fig. 7, n° 13), la seconde est marquée par des empreintes provenant peut-être d’un os de batracien (fig. 7, n° 9), la troisième pré-sente des traces effectuées par un élément cylindrique, probablement une tige creuse. Une dernière pièce, de forme conique, comporte, dans sa partie supérieure, un décor modelé dans l’argile signalé par un bourrelet périphérique à peine visible.La qualité des décors tend à écarter toute fonction symbolique. Les fusaïoles ornées ne se distinguent de l’ensemble du matériel ni par la forme, ni par le façon-nage. L’analyse spatiale ne met en évidence aucune concentration. Cette spécificité ne semble répondre à aucune volonté de différenciation : rapide et machinal, le décor, effectué à l’aide d’outils puisés dans l’éven-tail des objets immédiatement disponibles, ne traduit aucun code ou préméditation (marques de propriété,
fonction ou système de comptage). Sans doute faut-il envisager des solutions plus simples, comme l’utilisa-tion ponctuelle, par l’artisan, d’objets gisant à proxi-mité pour tromper les temps d’attente ou diversifier sa production.La chaîne de production des fusaïoles peut donc être qualifiée, dans son ensemble, de grossière. En dépit de ses faibles dimensions, cet objet ne bénéficie pas d’une argile plus raffinée que celle des grandes poteries fa-briquées sur le site. Peu soignées, les opérations de modelage ou de perforation attestent de gestes rapides et machinaux. Fait rarissime, les traces d’adhésif, les restes d’écorce et les fragments de fuseaux liés à l’uti-lisation des fusaïoles démontrent que ces objets, aussi défectueux soient-ils, ont néanmoins servi à filer. Les quelques exemplaires décorés évoquent eux-mêmes un travail rapide et sans attention. Comparée aux pro-duits d’importation, numériquement très faibles mais remarquables par leur qualité d’exécution et le soin apporté au décor, la production locale est grossière et sans ornement.
TypologieRépartition des types morphologiquesL’ensemble des types morphologiques recensés sur les stations lacustres du Néolithique suisse est repré-senté à Arbon. Bien qu’en proportions inégales, les fusaïoles discoïdes, coniques, biconiques, hémisphé-riques et campaniformes sont présentes sur le site (fig. 8-1). Pour avoir eu l’occasion d’étudier d’impor-tantes séries de fusaïoles issues de nombreux gise-ments (Médard, 2002, inédit), il n’est pas fréquent de rencontrer une telle diversité sur un même site.La catégorie des fusaïoles de type discoïde est cons-tituée d’éléments au profil arrondi, droit ou effilé. Compte tenu des modalités de façonnage, il est pro-bable que ces légères différences ne sont pas signifi-catives. Les fusaïoles recensées dans ce groupe repré-sentent 79 % de l’échantillon.Tout comme la base (partie opposée à la pointe du cône) dont le profil peut être plat ou incurvé, la hau-teur des fusaïoles de type conique varie d’une pièce à l’autre. À cet égard, le bourrelet d’argile, si fréquent autour des perforations, confère parfois aux fusaïoles discoïdes un profil conique, voire biconique si la per-foration est effectuée à partir des deux faces. Les fu-saïoles coniques représentent 16 % de l’échantillon.Les fusaïoles biconiques sont peu nombreuses. Il est vraisemblable que la plupart ne résultent pas d’une véritable intention, mais de déformations liées au façonnage : déformation du volume et surplus d’argile autour de la perforation. Observé sur de nombreuses fusaïoles issues d’autres gisements, ce bourrelet d’ar-gile est caractéristique des fusaïoles du Horgen et tient lieu de marqueur culturel.Comme les exemplaires hémisphériques, les fusaïoles campaniformes sont rares. Ces dernières n’en restent pas moins remarquables, car leur rareté au Néoli-thique les rend exceptionnellement nombreuses sur le site d’Arbon. Ensembles, les fusaïoles biconiques, hémisphériques et campaniformes représentent 5 % de l’échantillon (fig. 8-2).
386 Fabienne MÉDARD
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
L’analyse spatiale des différents types morphologiques présents sur l’ensemble du site et dans chaque bâti-ment n’est pas probante. La diversité des fusaïoles re-cueillies dans les unités d’habitation renvoie à celle des fusaïoles mises au jour sur le gisement (fig. 8-3). Par conséquent, aucune distinction chronologique n’est envisageable.Si les variations typologiques ont influencé la qualité des fils réalisés, les répartitions spatiale et chronolo-gique témoignent de la diversité des productions à l’in-térieur des unités domestiques.
Évolution chronologique de la productionEn considérant les bâtiments où les fusaïoles sont nom-breuses, il apparaît que les structures 3, 4 et 14 ras-semblent les exemplaires dont les dimensions sont les plus éloignées des valeurs moyennes, situées entre 41 et 51 mm pour le diamètre et entre 15 et 40 g pour le poids. Ces trois bâtiments appartiennent aux premières phases d’occupation du village. Inversement, la plupart des fusaïoles (70 %) dont les dimensions se situent dans la moyenne ont été recueillies dans les bâtiments érigés lors des dernières phases de l’occupation. La présence de fusaïoles “ atypiques ” dans les premiers temps de l’occupation pourrait correspondre à la diversification des besoins, peut-être liés à l’installation sur le site.Cela dit, la plupart des fusaïoles se situent autour de 47 mm de diamètre (coefficient de variation = 18 %). Les variations de poids sont plus marquées : 24 g de valeur moyenne et coefficient de variation = 51 %. La constance des diamètres indique qu’ils sont adaptés
aux besoins et qu’il est préférable de modifier le poids des fusaïoles que leur diamètre.
Des usages différenciésD’une manière générale, le poids des fusaïoles varie peu en fonction de la forme ; tout au plus, pour des dimensions équivalentes, les fusaïoles coniques sont-elles légèrement plus lourdes que les autres. Par ailleurs, les propriétés d’inertie et de vitesse de rotation qui caractérisent le fonctionnement des fusaïoles, sont nettement plus sensibles aux variations de diamètre qu’aux variations de masse.Le moment d’inertie donne une indication sur la ca-pacité de la fusaïole à tourner sans être relancée : plus il est élevé, plus la fusaïole tourne longtemps et len-tement. Plus le diamètre de la fusaïole est faible, plus la vitesse de rotation est rapide : un diamètre réduit de moitié implique une vitesse de rotation deux fois supérieure. En résumé, plus la fusaïole est petite, plus elle tourne rapidement, plus il faut la relancer souvent ; plus le fil est tordu, plus il est fin et résistant (Médard, 2002, inédit).L’homogénéité des fusaïoles d’Arbon implique logi-quement une certaine homogénéité dans la production du fil. Dans ce cas, comment expliquer la présence de fusaïoles nettement plus lourdes et plus larges que la moyenne (fig. 9) ? Leur marginalité est si mani-feste qu’elle ne saurait être imputée à un façonnage approximatif. Seuls des axes de fuseaux excessive-ment longs permettraient de restituer, avec ces fu-saïoles, les mêmes conditions de filage qu’avec les
Fig. 8 – Arbon-Bleiche 3 (TG) : Typologie des fusaïoles. 1 : types morphologiques représentés au Néolithique ; 2 : répartition des fusaïoles, par types morphologiques ; 3 : répartition spatiale des fusaïoles, par types morphologiques.
➀ ➁
➂
Vestiges textiles et activités de filage sur le site néolithique d’Arbon-Bleiche 3 (TG, Suisse) 387
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
fusaïoles “ standard ”. Or, cette solution inconfortable n’est d’aucun intérêt. On peut en revanche supposer que les fusaïoles les plus imposantes servaient à pro-duire des fils différents, de faible torsion. Elles pour-raient éventuellement être associées à un travail de préfilage, destiné à organiser les fibres et à faciliter les opérations de filage ultérieures.Ces fusaïoles pourraient également être associées au filage de fibres résistantes, épaisses, voire rigides, né-cessitant d’être fortement tendues. Un travail de cor-derie à partir du liber n’est pas exclu.Le retordage constitue une autre possibilité. Pourtant, les fils retors qui ont servi à confectionner les tissus mis au jour sur le site présentent une torsion serrée, incompatible avec l’inertie des grandes fusaïoles. Il est vraisemblable que les fusaïoles utilisées pour le retordage étaient suffisamment lourdes pour assurer la tension des fils simples et de diamètre assez petit pour assurer une rotation rapide et donc une torsion serrée. Un grand nombre de fusaïoles coniques pourraient être associées à ce type de travail (fig. 9).
L’ensemble des observations effectuées permettent de proposer plusieurs hypothèses fonctionnelles pour l’en-semble des fusaïoles mises au jour sur le site :- des fusaïoles discoïdes, larges et lourdes, destinées
au préfilage des fibres ou à la corderie ;- de nombreuses fusaïoles discoïdes destinées au
filage des fils simples ;- des fusaïoles coniques et discoïdes (plus lourdes que
la moyenne), destinées à la production de fils retors.
Aucune concentration, propre à mettre en évidence des aires spécialisées, ne renforce ces hypothèses.
Les fuseaux
Pour traiter du dispositif de filage (fuseau et fusaïole), nous disposons d’un remarquable échantillon : 82 fusaïoles, soit plus du quart des exemplaires, dont
l’utilisation est signalée par la présence d’axes de fuseau plus ou moins longs et par des traces d’adhésif aux abords des perforations. Les fragments de fuseau sont de loin les plus nombreux : toutes dimensions con-fondues, on dénombre 60 fragments dont 9 adhéraient encore à la fusaïole grâce à un bourrelet de “ mastic ”. Dix fusaïoles, dont 2 portant des traces d’adhésif, n’ont conservé de l’axe initialement inséré dans la perforation que quelques fragments desséchés.Les conditions de destruction du site pourrait expli-quer l’absence de fuseaux associés aux autres fu-saïoles : selon leur degré d’exposition aux flammes, ils se seront consumés comme de simples brindilles. Par ailleurs, toutes les fusaïoles ne devaient pas être munies d’un axe au moment de l’incendie.
Matières premièresL’identification des bois a mis en évidence 4 fuseaux en bourdaine (Frangula alnus), 2 en chèvrefeuille (Lo-nicera sp.), 7 en cornouiller (Cornus sp.), 1 exemplaire en frêne (Fraxinus excelsior), 39 en noisetier (Corylus avellana), 1 en sapin blanc (Abies alba), 1 en viorne (Viburnum sp.) et 1 en saule (Salix sp.) ; l’essence de 4 fragments n’a pu être identifiée (Leuzinger, 2002b, p. 99)6. L’ensemble des espèces mentionnées pous-sent dans des conditions climatiques et pédologiques similaires : la bourdaine, le noisetier, le saule et la viorne prolifèrent en terrains humides et marécageux, le cornouiller, dans les sols calcaires (le sable lacustre contient une forte proportion de calcaire) et le chèvre-feuille, à l’ombre des sous-bois. Les bois utilisés pour la fabrication des fuseaux proviennent vraisemblable-ment d’espèces de proximité, choisies pour la qualité de leur branchage, le plus souvent glabre et rectiligne (noisetier, bourdaine, saule et cornouiller), exploitable en l’état.La morphologie, le poids ou le diamètre des fusaïoles n’a aucun lien avec le choix des espèces de bois. L’uti-lisation fréquente du noisetier est probablement due à son abondance aux abords du site.
Fig. 9 – Arbon-Bleiche 3 (TG) : répartition des fusaïoles en fonction de leur diamètre et de leur masse.
388 Fabienne MÉDARD
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
MorphologieMalgré les déformations consécutives à leur enfouisse-ment, les axes de fuseau se présentent comme des bâ-tonnets sommairement écorcés pour éviter que le fil ne s’accroche aux aspérités du bois. Ils semblent réduits à leur plus simple expression, à savoir un bâton droit et sans aucune spécificité morphologique. Les documents ethnologiques attestent en effet de nombreux axes ren-flés au centre ou à l’une des extrémités ; il arrive par-fois que ce renflement se substitue à la fusaïole (Vallin-heimo, 1956, p. 131 ; Zuccarelli, 1984, p. 22 ; Giese et al., 1991, p. 158). L’état de conservation des exemplaires ne permet pas d’apprécier les extrémités des fuseaux, parfois révélatrices des techniques de filage utilisées.Aucun exemplaire n’étant complet, on ne peut esti-mer la longueur initiale des axes. Le fragment le plus long mesure 275 mm ; un autre atteint 355 mm si l’on met bout à bout les 10 segments qui le constituent. La section des axes est déformée de sorte qu’il est également difficile d’apprécier leur diamètre originel. Les mieux conservés présentent une section d’envi-ron 6 mm, ce qui correspond approximativement au diamètre de perforation des fusaïoles.Compte tenu de leurs caractéristiques, il est probable que les axes de fuseaux n’influaient quasiment pas sur le poids du dispositif de filage.
Mode de fixation des fusaïoles à l’axe du fuseau
La présence d’adhésif autour de certaines perforations nous éclaire pour la première fois sur le mode de fixa-tion de la fusaïole à l’axe du fuseau. Vingt-sept fu-saïoles en portent les traces, dont 8 sur les deux côtés. Une fusaïole, dont l’axe de fuseau a été entièrement prélevé pour analyse, présente le long des parois de la perforation des traces d’adhésif sur environ 2 mm. Il semble que la substance collante était placée à l’em-bouchure de la perforation puis transpercée par l’axe du fuseau. Emboîtement et collage se faisaient donc simultanément.Ce mode de fixation ne peut être considéré comme l’unique alternative, car les exemplaires qui en attes-tent ne représentent que 8,5 % du matériel. Si l’in-cendie a pu faire disparaître toute trace d’adhésif sur certaines fusaïoles, il ne suffit pas à en expliquer l’ab-sence sur des dispositifs de filage épargnés par les flammes. Force est d’admettre que certaines fusaïoles étaient simplement bloquées sur l’axe. Par exemple, le recours à des cales végétales (bois, brindilles) ou à des fibres permet d’ajuster le diamètre de perforation des fusaïoles à celui des axes de fuseau.On peut donc envisager trois modes de fixation : soit la fusaïole est collée à l’axe du fuseau, soit elle est emboîtée, soit elle est emboîtée et calée. La méthode la plus simple, et probablement la plus fréquente, consiste à emboîter la fusaïole sur l’axe. On précisera enfin que l’utilisation d’un adhésif rendait définitivement soli-daires la fusaïole et l’axe du fuseau, détail important pour l’interprétation des vestiges.L’emplacement de la fusaïole sur l’axe constitue un élément capital pour appréhender les méthodes de filage. Cet aspect peut être abordé si les extrémités
des fuseaux sont conservées, ce qui n’est pas le cas à Arbon. Par conséquent, il est impossible de préciser le(s) mode(s) de filage employé(s) sur le site.
INTERPRÉTATION
Des fusaïoles par centaines…
Bien que nombreux, les bâtiments mis en évidence à Arbon ne représentent qu’une partie du village ; les constructions tronquées par les limites de fouille at-testent une occupation plus étendue. Ce site n’en a pas moins livré un matériel très abondant, en parti-culier un nombre considérable de fusaïoles, corres-pondant de surcroît à une durée d’occupation très brève (3384-3370 avant J.-C.) : 409 exemplaires pour quinze années d’installation, soit moins d’une généra-tion. Rapportées au nombre d’habitations et à la durée d’occupation du site, les fusaïoles peuvent finalement paraître peu nombreuses : divisé par le nombre d’an-nées et de bâtiments, on obtient une à deux fusaïoles par an et par habitat (Leuzinger, 2002a, p. 119). Le site d’Arbon reste toutefois celui qui a livré le plus grand nombre de fusaïoles recensées à ce jour sur un seul et même niveau d’installation.La longévité des fusaïoles en terre cuite ne justifie pas de renouveler le stock en permanence. Un remplace-ment fréquent des pièces défectueuses devrait logique-ment se traduire par une nette prédominance d’objets fracturés, alors que les fusaïoles entières représentent ici plus des deux tiers de l’effectif. On admettra qu’au jour de l’incendie, la plupart des fusaïoles étaient en usage ou en état de fonctionner.Si la ruine de certains palafittes résulte d’incendies volontaires (Pétrequin, 1997, p. 45), la présence d’ob-jets en cours de fabrication (tasses en bois, haches) suggère une destruction accidentelle pour le site d’Ar-bon. Les fusaïoles mises au jour correspondraient donc à la totalité des exemplaires liés au site car, d’après les observations précédemment effectuées, il est peu probable qu’on ait cherché à les emporter dans la hâte du départ.Le nombre des fusaïoles évoque une importante acti-vité de filage, peut-être liée à des besoins en fil particu-lièrement conséquents. Pourtant, il n’est pas indispen-sable qu’une fileuse dispose de nombreuses fusaïoles pour travailler.Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette situa-tion : la soudaineté de l’incendie, obligeant les ha-bitants à laisser sur place la majeure partie de leurs possessions ; une occupation particulièrement dense impliquant d’importantes activités de filage ; une spé-cialisation du village dans les travaux textiles. Ces hypothèses restent malheureusement invérifiables sur la base des vestiges archéologiques.
Des rythmes saisonniers
Dans la mesure où les matières d’origine animale n’ont pas été conservées sur les sites lacustres, il est impossible de déterminer si les populations concer-nées filaient ou non la laine. Les études de M.L. Ryder
Vestiges textiles et activités de filage sur le site néolithique d’Arbon-Bleiche 3 (TG, Suisse) 389
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
tendent à prouver que la toison des moutons néoli-thiques ne contenait pas de laine qui puisse être filée (Ryder, 1992, p. 132). Nous évoquerons donc les fibres végétales :- le lin (Linum usitatissimum L.), dont la culture est
attestée sur le site sous la forme de capsules et de graines cultivées, et dont l’usage textile est avéré par la présence de déchets de teillage et de fils utilisés pour le tissage ;
- le liber (en l’occurrence Tilia sp.), dont l’utilisation est mainte fois attestée pour la fabrication des cordes et des cordelettes ainsi que pour celle, plus inatten-due, du fil.
Implanté en zones sèches, le lin produit des graines riches en huile, tandis qu’en terrain humide, il déve-loppe de longues tiges droites qui influencent directe-ment la qualité des fibres. La récolte a lieu à la fin de l’été ou au début de l’automne, quand le sol est suffisamment sec pour faciliter l’arrachage. Commence alors le traitement des fibres qui seront normalement prêtes pour le filage à la fin de l’automne ou au début de l’hiver (Pline, Nat. Hist., XIX, 2 ; Endrei, 1968, p. 22 ; Ewers, 1989, p. 179). En admettant que les fibres ne soient pas stockées plusieurs années durant, un calendrier similaire peut être appliqué au travail du liber. L’arrachage des écorces à l’origine de l’obtention du liber s’effectue plus facilement au printemps qu’à toute autre saison. La durée du rouissage, opération indispensable à l’obtention d’une fibre fine qui puisse être utilisée dans le textile, dépend de nombreux élé-ments (choix de la méthode, qualité de l’eau, qualité de l’écorce…) ; il est néanmoins vraisemblable qu’elle pouvait être prête à la fin de l’automne.Jusqu’au XIXe siècle, les cycles naturels rythmaient le travail des hommes : ainsi, les opérations de filage et de tissage avaient généralement lieu en hiver, période où la terre se repose et où les paysans se livrent à des activités plus abritées (Reynier, s.d.). Une con-trainte apparemment confirmée par la répartition des fusaïoles sur le site, plus nombreuses dans l’enceinte des habitations, ou à proximité immédiate, qu’à l’ex-térieur.
Stockage
Le tissage est une opération rapide si on la compare à l’extraction de la fibre et au filage, qui représentaient au XIXe siècle plus de 75 % du temps consacré à la confection d’une étoffe. Cette proportion augmentait lorsque les fibres étaient mal dégrossies, car c’est alors au filage que se perdait le temps gagné au traitement des fibres.On sous-estime généralement la quantité de fil néces-saire à la production d’1 m2 de tissu. Par exemple, pour confectionner 1 m2 de tissu semblable à l’un de ceux recueillis à Arbon (inv. : 93 01 1764 1), il faut environ 2 000 m de fil retors, soit plus de 4 000 m de fil simple (densité de 10 fils/cm en chaîne et en trame). Comme le souligne H. Masurel, le tisserand devait sans cesse se prémunir contre le manque de fil. Il lui fallait par ailleurs disposer des fils appropriés à différents types
de réalisations. Autant de raisons suffisantes pour en-visager l’existence d’un “ stock-tampon ” assez impor-tant. À propos des pelotes de fil exhumées lors des anciennes fouilles de Chalain (F-Jura), H. Masurel (1985, p. 207) évoque la possibilité d’une forme de stockage des fils simples, attendant d’être retordus comme le sont tous les fils qui constituent les tissus néolithiques.L’absence de telles pelotes sur le site d’Arbon pourrait renvoyer à une autre forme de stockage, compatible avec le nombre élevé de fuseaux et de fusaïoles. Le fil pouvait être stocké à même le fuseau, évitant ainsi un transfert fastidieux du fil en pelotes : quand un fuseau était rempli de fil, il était mis de côté avec sa fusaïole. Un témoignage ethnologique apporte quelque crédit à cette hypothèse : L. Saudinos rapporte en effet qu’au début du siècle, les femmes du canton de Luchon (F-Haute-Garonne) stockaient le fil de lin à même les fuseaux, en les piquant sur une planchette prévue à cet effet (fig. 10). Quand une douzaine de fuseaux étaient remplis, elles mettaient le fil en écheveaux (Saudinos, 1942, p. 108).Plusieurs éléments vont dans ce sens parmi lesquels le mode de fixation des fusaïoles : une fusaïole collée, ou même calée, n’est pas destinée à changer d’axe en permanence. Le stockage du fil à même le fuseau implique des manipulations réduites et s’accorde en cela avec l’attitude minimaliste qui semble caractériser tout ce qui a trait aux activités de filage. Les fusaïoles, façonnées sans soin, et les fuseaux, rudimentaires, évo-quent une activité machinale, rapide, où la multiplica-tion des fuseaux et des fusaïoles constituait une solu-tion efficace pour stocker le fil sans effort. Dans la perspective d’une économie de gestes, on peut égale-ment imaginer que quelques fuseaux, notamment ceux utilisés pour le retordage, étaient délestés de leur fu-saïole et servaient directement de navette pour le tis-sage (Masurel, 1985, p. 208). Aussi fallait-il prévoir une réserve suffisante de fuseaux pour supporter un roulement à long terme, c’est-à-dire jusqu’au retor-dage, qui libère deux fuseaux à la fois, puis jusqu’au tissage, qui en libère un à la fois, mais plus rapide-ment7.
Fig. 10 – Planchette utilisée au XIXe siècle pour stocker les fuseaux remplis de fil. La planchette tenait également lieu de mesure, car elle contenait les douze fuseaux nécessaires à la fabrication d’un écheveau (d’après L. Saudinos, 1942, p. 108).
390 Fabienne MÉDARD
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
CONCLUSION
Sans insister sur la remarquable qualité des décou-vertes effectuées sur le site d’Arbon, la richesse du ma-tériel de filage est exceptionnelle en elle-même. L’un des aspects les plus spectaculaires tient au nombre de fusaïoles et de fuseaux mis au jour. La découverte d’un dispositif de filage complet, en excellent état, souligne encore la valeur de cet ensemble8. Le filage du liber, avéré grâce à cette dernière découverte, constitue un élément important pour la compréhension des activi-tés textiles au Néolithique. Il est de nature à modifier notre vision de l’économie des fibres textiles au Néoli-thique.L’emplacement et la datation du site sont également dignes d’intérêt. Sur les rives du lac de Constance, les gisements datés du Horgen sont, actuellement encore, très peu nombreux. Dans le nord-est de la Suisse, on dénombre en revanche plusieurs établissements liés à la civilisation de Horgen, parmi lesquels le site d’Ar-bon est l’un des représentants les plus anciens : situé à la charnière chronologique du Néolithique final, entre la fin du Pfyn et le début du Horgen, il constitue le plus oriental des gisements et celui qui a livré le matériel de filage le plus abondant. Si, non loin de là, des sites plus anciens ont livré de nombreux restes textiles – Meilen, Feldmeilen-Vorderfeld (ZH), Thayngen-Weier (SH), Niederwil, Gachnang-Egelsee (TG), Zürich-Mozart-strasse (ZH) (Winiger, 1981, p. 57-64 ; Winiger, 1971, Tf. 50-53 ; Waterbolk et Zeist, 1991, p. 251-258 ; Gross et al., 1992, Tf. 266-271) – aucun ne contenait un tel matériel lié à la transformation des fibres en fil. Il faut attendre une phase plus récente du Horgen pour qu’apparaissent des lots de fusaïoles sur d’autres sites : Zürich, Kleiner-Hafner (ZH), Meilen, Feldmeilen-Vor-derfeld (ZH), Zürich, Kanalisationssanierung-Seefeld (ZH) (Suter, 1987, p. 367 ; Winiger, 1981, p. 150-151 ; Gerber et al., 1994, p. 23)Sur la base des découvertes effectuées à Arbon, l’in-troduction du filage au fuseau en Suisse orientale, sous l’influence d’un courant venu de l’est, n’est pas à exclure. Bien que la plupart des productions céra-miques soient d’origine locale, quelques récipients, identifiables comme des produits d’importation, sont de facture notablement plus soignée : ils présentent les caractéristiques (pâte, formes et décors) des pro-ductions d’Europe centrale (civilisation de Baden-Bo-leraz). Ce contact culturel tangible permet d’effectuer un parallèle avec la pratique du filage.La localisation du site et les artefacts qu’il a livré le lient à une influence culturelle nord-orientale,
semble-t-il imperméable à celle, pourtant très proche, de Suisse occidentale. À la même période, les gise-ments du sud-ouest de la Suisse sont caractérisés par la culture dite de “ Horgen occidental ” ; dans cette région, les fusaïoles sont connues depuis plusieurs siècles, même si les découvertes sont peu abondantes. Les niveaux Cortaillod ancien, classique ou récent des stations d’Auvernier-Port (NE), Mur-Guévaux (VD), Chavannes-le-Chêne, le vallon des Vaux (VD), Egolzwil 4 (LU) (Schifferdecker, 1982, p. 107 ; Gallay, 1977, p. 282 ; Sauter et Gallay, 1966, p. 37 ; Sitterding, 1972, Tf. 55 ; Wyss, 1983, p. 209), ont tous livré des fusaïoles, attestant une apparition précoce du filage au fuseau, probablement véhiculé par un courant origi-naire du sud-ouest. La diffusion ne s’est apparemment pas poursuivie vers le nord-est du pays. P. Pétrequin remarquait, à propos de gisements situés dans l’Est de la France et en Suisse occidentale, “ l’étanchéité de certains filtres culturels entre des groupes proches et rigoureusement synchrones ” (Pétrequin, 1988, p. 47). En dépit de très faibles distances et à la lumière des découvertes archéologiques, il semble exister deux grandes entités culturelles entretenant peu de rapport entre elles. Sans doute la fusaïole était-elle connue en des lieux où elle n’était pas utilisée, sans doute aussi ne l’utilisait-on pas parce qu’elle ne répondait pas aux besoins locaux, ou n’offrait aucun avantage supplé-mentaire par rapport aux habitudes de production.
NOTES
(1) On parle aussi de “ peigne à côtes ”. À cette liste s’ajoutent trois éléments isolés qui présentent encore des restes de ligature ; Deschler-Erb et al., 2002, Abb. 509.5, 14, 15.(2) Le liber définit le tissu végétal cellulaire de la tige, de la racine ou de l’écorce d’une plante. Il désigne ici les fibres recueillies sur la partie interne des écorces.(3) Toiles tissées : 94 01 5029 1 et 94 01 5031 1 (même pièce), 93 01 1764 1. Étoffes cordées : 93 01 826 1 et 93 01 1582 (même pièce), 95 01 8565 1 et 95 01 8152 1 (même pièce), 95 01 10658 1. Fuseau-fusaïole-fil : 94 01 7453 1.(4) Le teillage est une opération de battage ou de broyage qui consiste à éliminer l’écorce de certaines plantes textiles, pour en extraire les fibres.(5) Identification des fibres textiles : Werner H. Schoch. Labor für Quartäre Hölzer, Unterrütistrasse 17, CH-8135 Langnau.(6) Identification des bois : A. Widmann et W.H. Schoch.(7) Le fil peut être stocké à deux moments de la chaîne opératoire de production des tissus : sous forme simple en attendant le retordage ou sous forme de produit fini en attendant le tissage. Dans les deux cas, rien ne s’oppose à ce que le fuseau serve de support. Le retordage de deux fils simples enroulés sur deux axes différents ne soulève aucune diffi-culté, le travail étant effectué par étapes : étirage des fils, retordage, enroulement, étirage, retordage, etc.(8) Lors de fouilles récentes effectuées sur le site de Chalain (F-Jura), un dispositif de filage a également été mis au jour (information Pierre Pétrequin).
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ALTORFER K., MÉDARD F. (2000) – Nouvelles découvertes textiles sur le site de Wetzikon-Robenhausen (Zürich, Suisse). Sondages 1999, Archéologie des textiles, Actes du colloque de Lattes, octobre 1999, collection Instrumentum, éditions Monique Mergoil, Montagnac, p. 35-75.
BLEUER E. et al. (1993) – Jungsteinzeitliche Ufersiedlungen im Zürcher Seefeld. Ausgrabungen Kanalisationssanierung 1986-1988 (Zürich
Kan.San), Band 2, Zürcher Denkmalpflege, Archäologie Monographien 18, Zürich.
BROMBACHER C., JACOMET S. (1997) – Ackerbau, Sammel-wirtschaft und Umwelt: Ergebnisse archäobotanischer Untersu-chungen, in J. Schibler, H. Huster-Plogmann, S. Jacomet, C. Brom-bacher, E. Gross-Klee et A. Rast-Eicher dir., Ökonomie und Ökologie neolithischer und bronzezeitlicher Ufersiedlungen am Zürichsee.
Vestiges textiles et activités de filage sur le site néolithique d’Arbon-Bleiche 3 (TG, Suisse) 391
Bulletin de la Société préhistorique française 2003, tome 100, no 2, p. 375-391
Ergebnisse der Ausgrabungen Mozartstrasse, Kanalisationssanierung Seefeld, AKAD/Pressehaus und Mythenschloss in Zürich, Mono-graphien der Kantonsarchäologie 20, Zürich, p. 220-299.
DESCHLER-ERB S. et al. (2002) – Die Knochen-, Zahn- und Geweih-artefakte, in A. de Capitani, S. Deschler-Erb, U. Leuzinger, E. Märti-Grädel et J. Schibler dir., Die jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon-Bleiche 3. Funde, Archäologie im Thurgau, Band 11, Frauenfeld, p. 277-366.
ENDREI W. (1968) – L’évolution des techniques du filage et du tissage du Moyen-Âge à la révolution industrielle, Mouton, Paris.
EWERS M. (1989) – Linum usitatissimum L. Le lin, une plante cultivée du Néolithique, Bulletin de la Société préhistorique luxembourgeoise, 11, Luxembourg, p. 169-192.
GALLAY A. (1977) – Le Néolithique moyen du Jura et des plaines de la Saône. Contribution à l’étude des relations Chassey-Cortaillod-Michelsberg, Antiqua 6, Basel.
GERBER Y. et al. (1994) – Jungsteinzeitliche Ufersiedlungen im Zürcher Seefeld. Ausgrabungen Kanalisationssanierung 1986-1988 (Zürich Kan.San), Band 1, Zürcher Denkmalpflege, Archäologie Mono-graphien 22, Zürich.
GIESE W. et al. (1991) – Le travail du chanvre, le filage et le tissage, Le monde alpin et rhodanien. Mots et choses en Haut-Dauphiné dans les années 30, t. 3-4, Centre alpin et rhodanien d’ethnographie, Grenoble, p. 157-160.
GROSS E. et al. (1992) – Zürich “ Mozartstrasse ”. Neolithische und bronzezeitliche Ufersiedlungen, Band 2, Zürcher Denkmalpflege, Monographien 17, Zürich.
HECHT A. (1989) – The Art of the Loom. Weaving, Spinning and Dyeing across the World, British Museum Publication, London.
HOFFMANN M. (1964) – The warp-weighted loom. Studies in the his-tory and technology of an ancient implement, Robin and Russ Handweavers, Oslo, 1974 (first printed in 1964 as n° 14 in the series Studia Norvegica).
LEUZINGER U. (2000) – Die jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon-Bleiche 3. Befunde, Archäologie im Thurgau, Band 9, Frauenfeld.
LEUZINGER U. (2002a) – Textilherstellung, in A. de Capitani, S. Deschler-Erb, U. Leuzinger, E. Märti-Grädel et J. Schibler dir., Die jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon-Bleiche 3. Funde, Archäo-logie im Thurgau, Band 11, Frauenfeld, p. 115-134.
LEUZINGER U. (2002b) – Holzartefakt, in A. de Capitani, S. Deschler-Erb, U. Leuzinger, E. Märti-Grädel et J. Schibler dir., Die jungstein-zeitliche Seeufersiedlung Arbon-Bleiche 3. Funde, Archäologie im Thurgau, Band 11, Frauenfeld, p. 76-114.
MASUREL H. (1985) – Vanneries, tissus, réserves de fil et liens trouvés à Chalain et conservés au musée de Lons-le-Saunier, Chalain - Clairvaux, fouilles anciennes. Présentation des collections du musée de Lons-le-Saunier, t. 1, Lons-le-Saunier, p. 201-210.
MÉDARD F. (2000) – L’artisanat textile au Néolithique. L’exemple de Delley-Portalban II (Suisse), 3272-2462 avant J.-C., collection Préhistoires 4, éditions Monique Mergoil, Montagnac.
MÉDARD F. (inédit) – Les activités de filage sur les sites néolithiques du plateau suisse. Système technique de production du fil dans son contexte économique et social, thèse de doctorat, Université de Paris X- Nanterre, 2002.
MÜLLER-BECK H. (1991) – Die Holzartefakte, in H.-T. Waterbolk et W. van Zeist dir., Niederwil, eine Siedlung der Pfyner Kultur, Band IV, Holzartefakte und Textilien, Academia Helvetica 1, Bern, p. 13-234.
PÉTREQUIN P. (1988) – Le passage Néolithique moyen II/Néolithique final dans le Jura méridional, Du Néolithique moyen II au Néolithique final au nord-ouest des Alpes, Actes du 12e colloque interrégional de Lons-le-Saunier, 11-13 octobre 1985, Lons-le-Saunier, p. 33-62.
PÉTREQUIN P. dir. (1997) – Les sites littoraux néolithiques de Clairvaux-les-Lacs et de Chalain (Jura) III. Chalain station 3,
3200-2900 avant J.-C., vol. 1 et 2, éditions de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH), Paris.
PLINE L’ANCIEN – Histoire Naturelle, VIII, XIX, Les Belles Lettres, Clermont-Ferrand, 1964.
PUYBARET M.-P. (1989) – Les gestes du tisserand de l’Âge du Fer, Antiquités nationales, nº 21, Saint-Germain-en-Laye, p. 23-28.
RAMSEYER D., MICHEL R. (1990) – Muntelier/Platzbünden. Gisement Horgen, 1. Rapport de fouille et céramique, Archéologie fribourgeoise 6, éditions Universitaires, Fribourg (Suisse).
RAST-EICHER A. (1995) – Tissus et vanneries, La Suisse du Paléolithique à l’aube du Moyen-Âge. Le Néolithique, SPM II, Basel, p. 169-173
REYNIER M. (s.d.) – Un métier disparu : les fileuses, Gloria.
RYDER M.L. (1992) – The interaction between biological and technolo-gical change during the development of different fleece types in sheep, Animals and their products in trade and exchange, Actes du 3e col-loque international de l’homme et l’animal, Oxford, 8-11 novembre 1990, Anthropozoologica 16, Paris, p. 131-140.
SAUDINOS L. (1942) – L’industrie familiale du lin et du chanvre, librai-rie Édouard Privat, Toulouse.
SAUTER M.-R., GALLAY A. (1966) – À quoi se rattache le Néolithique du vallon des Vaux (Chavannes-le-Chêne, Vaud) ?, Helvetia Antiqua, Zürich.
SCHIFFERDECKER F. (1982) – Auvernier 4. La céramique du Néolithique moyen d’Auvernier dans son cadre régional, Cahiers d’Archéologie romande, 24, Lausanne.
SCHWAB H. (1999) – Archéologie de la deuxième correction des eaux du Jura. 2 : Les premiers paysans sur la Broye et la Thielle, Archéologie fribourgeoise 14, éditions Universitaires, Fribourg (Suisse).
SITTERDING M. (1972) – Le vallon des Vaux. Rapports culturels et chronologiques. Les fouilles de 1964 à 1966, Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, Band 20, Basel.
SUTER P.J. (1987) – Zürich, “ Kleiner Hafner ”. Tauchgrabungen 1981-1984, Berichte der Zürcher Denkmalpflege, Monographien 3, Zürich.
VALLINHEIMO V. (1956) – Das Spinnen in Finnland. Unter besonde-rer Berücksichtigung Schwedischer Tradition, Kansatieteellinen Arkisto 11, Helsinki.
WATERBOLK H.T., ZEIST W. van (1991) – Niederwil, eine Siedlung der Pfyner Kultur, Band I-IV, Academia Helvetica 1, Bern.
WINIGER J. (1971) – Das Fundmaterial von Thayngen-Weier im Rahmen der Pfyner Kultur, Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz, Band 18, Basel.
WINIGER J. (1981) – Feldmeilen-Vorderfeld. Der Übergang von der Pfyner zur Horgener Kultur, Antiqua 8, Basel.
WINIGER J. (1995) – Die Bekleidung des Eismannes und die Anfänge der Weberei nördlich der Alpen, Der Mann im Eis. Neue Funde und Ergebnisse, Band 2, Wien, p. 119-187.
WYSS R. (1983) – Die jungsteinzeitlichen Bauerndörfer von Egolzwil 4 im Wauwilermoos. Die Funde, Band 2, Archaeologische Forschungen, Zürich.
ZUCARELLI M.-C. (1984) – La “ rocca ” ou quenouille corse, La navette. Revue d’art et d’information sur le tissage, la tapisserie, le filage et la teinture végétale, nº 27, Cordes (Vaucluse), p. 18-23.
Fabienne MÉDARDUMR 7055, Préhistoire et Technologie,
Maison de l’archéologie et de l’ethnologie21 allée de l’Université, 92023 Nanterre cedex