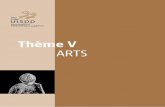Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux loups-garous
Transcript of Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux loups-garous
MÉMOIRESDE
L’ACADÉMIE DES SCIENCES
ARTS ET BELLES-LETTRES DE CAEN
Me ́moires 2015 de ́but.indd 1Me ́moires 2015 de ́but.indd 1 29/10/15 23:19:1129/10/15 23:19:11
PRINCIPALES DATES
DE L’HISTOIRE DE L’ACADÉMIE DE CAEN
Reconnue d’utilité publique par décret impérial du 10 août 1853
Des réunions littéraires, constituant le noyau de la future Académie, 1652 se tiennent autour de Moisant de Brieux à l’Hôtel du Grand-Cheval, place Saint-Pierre, à Caen. Ces réunions durent jusque vers 1701, sous la direction de Regnault de Segrais.
Premières réunions de l’Académie de Physique de Caen autour d’An-1662 dré Graindorge et Daniel Huet.
Des statuts sont accordés à l’Académie de Physique, qui se disperse 1667 pourtant vers 1676.
Lettres patentes de Louis XIV établissant offi ciellement l’Académie 1705 Royale des Belles-Lettres de Caen, qui retombe en sommeil vers 1714.
M1731 gr de Luynes devient Protecteur de l’Académie.
L’Académie reprend ses séances à l’Hôtel du Grand-Cheval (Hôtel 1753 d’Escoville), sous la direction de l’intendant Fontette.
Publication du tome I1754 er des Mémoires de l’Académie.
La Convention supprime les Académies.1793
Le Préfet Dugua ressuscite l’Académie sous le nom de Lycée.1800
1802 L’Académie prend son titre défi nitif d’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen. Elle n’a pas interrompu son activité depuis lors.
Reprise de la publication des 1811 Mémoires.
L’Académie est reconnue d’utilité publique par le décret impérial du 1853 10 août.
L’Académie tient une séance publique solennelle à l’occasion de la 1955 célébration du quatrième centenaire de Malherbe.
1970 L’Académie fi xe de nouveau son siège à l’Hôtel d’Escoville, acquis par son fondateur Moisant de Brieux.
2002 En juin, l’Académie célèbre ses 350 ans d’existence en présence de M. Pierre Messmer, chancelier de l’Institut de France, et de très nom-breux invités.
Me ́moires 2015 de ́but.indd 2Me ́moires 2015 de ́but.indd 2 29/10/15 23:19:1229/10/15 23:19:12
MÉMOIRESDE
L’ACADÉMIE DES SCIENCES
ARTS ET BELLES-LETTRES DE CAEN
Fondée en 1652. Lettres patentes 1705.Reconnue d’utilité publique (décret du 10 août 1853).
Avec le concours de la Ville de Caen,
du Département du Calvados,
du Conseil Régional de Basse-Normandie
et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
TOME LI2015
Siège : Hôtel d’Escoville, 12 place Saint-Pierre, 14000 CAENTél.\Fax. : 02 31 86 14 16
Courriel : [email protected] Internet : http :/www.academiecaen-scabl.com
Me ́moires 2015 de ́but.indd 3Me ́moires 2015 de ́but.indd 3 29/10/15 23:19:1229/10/15 23:19:12
VIE DE L’ACADÉMIE EN 2014
7 janvier Réunion de la Commission administrative
10 janvier Décès de M. François Solignac-Lecomte, membre associé correspondant, ancien adjoint au Maire de Caen
11 janvier Séance privée M. Pierre Ageron : Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux loups-garous.
Renouvellement du Bureau : ont été élus à l’unanimité pour un mandat de deux ans M. Jean Laspougeas, président, et M. Éric Eydoux vice-président.Élection de quatre membres titulaires : Mme Nicole Vray, MM. Éric Eydoux, Jean-François Robert et Jean-François Wantz.Élection de deux membres associés correspondants : M. Laurent Bellamy (parrains MM. Jacques Legendre et René Parisse), M. Geoffrey Mahy, résident à Guernesey (parrains MM. Jean- Jacques Bertaux et Claude Roche).
22 février Conférence publique M. Jean Laspougeas : Autour d’un centenaire : la guerre de 1914-1918, aspects et problèmes généraux
24 février Réunion de la Commission administrative
22 mars Séance privée M. Gérard Guy Mouchel : Le Latin en riant : la carte d’Astérix en Corse
31 mars Réunion de la Commission administrative
26 avril La conférence publique sur Le cheval est annulée faute de conférencier
12 mai Séance privée Mme Christine Baraduc-Fallot : Se soigner par l’hypnose, une thérapie du XXIe siècle Élection d’un membre titulaire : M. Jacques Adans.
3 juin M. Éric Eydoux représente notre compagnie à la réunion de la Conférence Nationale des Académies à Paris
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:5Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:5 29/10/15 23:19:1229/10/15 23:19:12
6
4 juin M. Jean Laspougeas a été reçu en audience, à Bayeux, par Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, membre d’honneur de l’Académie
14 juin Conférence publique M. Yves Lecouturier : Les préparatifs du débarquement
M. Jean Laspougeas, accompagné de M. Jacques Moulin, ancien président et de Madame, est à Angers où il représente l’Académie à la première réunion interrégionale des Académies du Grand-Ouest, organisée par l’Académie d’Angers. Il présente une communica-tion sur La bataille de Troarn dans la bataille de Normandie.
20 septembre décès de M. Charles Hargrove, ancien membre associé corres-pondant de l’Académie. L’inhumation a eu lieu à Asnelles le mercredi 24 septembre.
27 septembre Séance privée M. Jean-François Robert : Les mauvaises cartes de géographie, miroir de notre société
6 octobre Réunion de la Commission administrative
8-10 octobre Assemblée générale de la Conférence Nationale des Académies de province à Orléans. L’Académie a été représentée par M. Jean Laspougeas, M. et Madame Claude Roche, M. Baptiste Leseigneur et M. Jacques Moulin.
13 novembre Dîner annuel de l’Académie à l’hôtel restaurant Le Dau-phin Conférence de M. Jean Migrenne sur Dylan Thomas.
L’Académie a été honorée de la présence des cinq membres d’honneur : M. le Premier Président de la Cour d’Appel de Caen, Mme le Procureur général près la Cour d’Appel, M. le Recteur de l’Académie-Chancelier de l’Université, M. le Président de l’Université et M. le Maire de Caen. Étaient excusés : Mgr l’Évêque de Bayeux et Lisieux, M. le Président du Sénat, M. le Président du Conseil régional.
17 novembre Conférence publique M. Jean Lspougeas : Entre terrorisme et militarisme : les origines de la guerre de 1914 au Centre International Anne d’Ornano de Deauville.
13 décembre Remise du Prix littéraire annuel de l’Académie par M. Alain Goulet, président du Comité du Prix, à M. Philippe Torreton sur son livre : Mémé, Éditions l’Iconoclaste.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:6Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:6 29/10/15 23:19:1229/10/15 23:19:12
UN MANUSCRIT INÉDIT DE SAMUEL BOCHART
RELATIF AU CUTUBUTH
ET AUX LOUPS-GAROUS
Par M. Pierre AGERON
(Séance privée du 11 janvier 2014)
Pasteur de l’église réformée caennaise pendant plus de quarante ans, Samuel Bochart (1599-1667) fut aussi l’un des premiers membres de l’Académie de Caen et en demeure à jamais l’un des plus illustres. Il fi t parler de lui dans toute l’Europe savante par deux ouvrages monumentaux, ahurissants d’érudition : une Geographia sacra (Caen, 1646), étudiant les peuples de la Bible et les Phéniciens, et un traité de zoologie sacrée, son Hierozoicon (Londres, 1663). Dans l’un et l’autre, il mit à profi t une impressionnante quantité de sources latines, grecques, hébraïques, arabes, araméennes, syriaques, samaritaines, éthiopiennes1.
C’est une dissertation entièrement inédite de Samuel Bochart que j’exhume ici. Elle s’intitule : Réponse à la question d’un homme très savant demandant ce qu’est la mélancolie errabonde, dite en arabe cutubuth du nom d’un animal qui court continuellement et sans relâche à la surface des eaux stagnantes. Ce titre long et obscur, que j’ai ici traduit du latin, recouvre entre autres les deux questions suivantes : de quelle nature sont ceux qu’on appelle loups-ga-rous ? Un homme peut-il vraiment se transformer en animal ? Pour singulier qu’il puisse nous paraître, le sujet était de grande importance pour les hommes de son temps. Il avait déjà été abordé par maints érudits, au nombre desquels Johan Wier (1563), Jean Bodin (1580), Claude Prieur (1596), Jean Beauvois de Chauvaincourt (1599), Francesco Maria Guazzo (1608), Jean de Nynauld (1615) et Robert Burton (1621) : à l’exception notable de Bodin, la plupart des auteurs avaient jugé que la transmutation n’est pas réellement possible et que les cas constatés relèvent de l’illusion. Dans le cas de Bochart, ce type de préoc-cupation s’inscrivait naturellement dans le prolongement de ses vingt années de travail sur les animaux. Sa dissertation fait d’ailleurs plus d’une fois référence au Hierozoicon, avec des renvois précis aux numéros de colonnes. Elle est donc postérieure à l’impression de celui-ci en 1663, et fait partie des nombreux écrits que Bochart laissa manuscrits à sa mort, survenue soudainement en 1667.
1 Pour plus de détails sur Samuel Bochart, je renvoie à mon récent article : Pierre AGERON, « Dans le cabinet de travail du pasteur Samuel Bochart (1599-1667) : l’érudit et ses sources ara-bes », in Érudition et culture savante, de l’Antiquité à l'époque moderne, sous la direction de François BRIZAY et Véronique SARRAZIN, Rennes, P.U.R., 2015, p. 117-143.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:7Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:7 29/10/15 23:19:1229/10/15 23:19:12
8 Pierre AGERON
Les ouvrages inédits de Samuel Bochart
Le destin des manuscrits laissés par Samuel Bochart abonde en péripé-ties. Le petit-fi ls de l’érudit, Samuel Le Sueur, né en 1651 et très attaché à la mémoire de son grand-père maternel, annonça en 1682 être en train de « les ramasser pour en faire part au public dans un recueil » ; il priait « ceux qui pourroient en avoir de les lui communiquer »2. Dix ans plus tard, la troisième édition des Opera omnia de Samuel Bochart3 rendit publiques quarante-neuf lettres ou dissertations inédites. Les éditeurs Johannes Leusden et Pierre de Villemandy avaient bénéfi cié des conseils de deux pasteurs orientalistes nor-mands, passés en Hollande, qui avaient été très proches de Bochart : Étienne Lemoyne, décédé avant la parution, et Étienne Morin. Certains brouillons avaient été réordonnés, et bon nombre de textes rédigés en français avaient été traduits en latin. Mais pas un seul de ces inédits n’avait été fourni par Samuel Le Sueur, qui avait prétexté la disparition de tous les papiers de son grand-père lors d’une dragonnade à son domicile4. Les éditeurs précisaient qu’en dépit de leurs efforts, il en restait un nombre équivalent dont ils n’avaient pu obtenir que les titres, et que même s’ils leur paraissaient de moindre intérêt, ils ne dou-taient pas qu’on y trouvât l’érudition et le discernement habituels à Bochart et les publieraient très volontiers s’ils devaient un jour entrer en leur possession5. Tel ne fut pas le cas6. Au XVIIIe siècle, les volumineuses liasses de papier jalou-sement conservées par la famille quittèrent le logis caennais de la rue Neuve Saint-Jean, où Bochart avait vécu pendant vingt-sept ans, pour le château des Le Sueur à Saint-Aubin de Cretot – aujourd’hui en Seine-Maritime. Pendant la Révolution, les occupants du château furent contraints à l’émigration et les liasses vendues à vil prix avec le mobilier du château. C’est ainsi que les ma-nuscrits de Bochart servirent pendant vingt-cinq ans de papier d’emballage à
2 Journal des savants, 1er juin 1682, p. 112.3 Samuelis Bocharti Opera omnia, editio tertia, Leyde, 1692.4 Ce renseignement est donné dans une lettre de Madame de Tilly à Pierre Daniel Huet
daté du 19 juillet [1690] : « M. de Colleville, qui avait trente-cinq ou quarante dissertations, n’en fournit pas une seule ; il dit que tout a été perdu quand les dragons ont été chez lui. » (lettre publiée dans : Charles HENRY, Un érudit, homme du monde, homme d’Église, homme de cour. Lettres inédites (…) extraites de la correspondance de Huet, Paris, 1879, p. 35, voir aussi p. 124 ; repu-bliée dans : Jacques Alfred GALLAND, Essai sur l’histoire du protestantisme à Caen et en Basse-Normandie, de l’Édit de Nantes à la révolution (1598–1791), Paris, 1898, p. 485). Les réticences de Le Sueur sont confi rmées dans une lettre de Gilles Ménage à Johann Georg Grævius datée du 10 septembre 1691 : « N’aïant rien pu obtenir de Mr. Colleville touchant les écrits posthumes de Mr. Bochart, je me suis adressé à Mr. L’Evesque d’Avranches. » (lettre publiée dans : Richard G. MABER, Publishing in the Republic of Letters: The Ménage-Grævius-Wetstein correspondence 1679-1692, Amsterdam, 2005, p. 139).
5 Samuelis Bocharti Opera Omnia, op. cit., Præfatio : « Eaque de causa nihil non egimus, ut quæcunque audiveramus fuisse olim ab illo [Bocharto] meditata & elaborata, necdum tamen in lucem emissa, obtineremus, tertiæque huic Operum ejus Editioni adderemus. Omnia quidem non obtinuimus ; quæ tamen damus, hæc & numero, & dignitate talia sunt, ut Lectoris cupidi-tati queant utcunque satisfacere, donec cætera offeramus : quæ multitudine hisce forsan paria sunt, sed ex titulis & inscriptionibus de illis sit judicandum, pretio & utilitate inferiora videntur. Qualiacinque sint, cum nulli dubitemus, quin eadem cum cæteris eruditione sint locupletata, eo-dem perfecta judicio, eâdem elaborata industriâ, eam ob rem lubentissime edemus, si in nostram potestatem deveniant. »
6 Trois volumes de Sermons sur la Genèse en français furent aussi imprimés à Amsterdam en 1705, 1711 et 1712.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:8Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:8 29/10/15 23:19:1329/10/15 23:19:13
Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux lousps-garous 9
l’épicier du village ! D’après le récit du pasteur rouennais Paumier7, on s’en rendit compte en 1818, lors d’un dîner au château pendant lequel le curé en-voya un domestique acheter du tabac : une bonne partie des manuscrits put alors être récupérée. Ils furent d’abord dispersés entre plusieurs personnes, mais l’abbé Gervais de la Rue, érudit caennais bien connu, parvint à les ras-sembler ; il classa et numérota les diverses pièces et en constitua deux recueils qu’il déposa à la bibliothèque du roi en juin 1823. En préparant la première édition de la France protestante, parue en 1846, les frères Haag demandèrent à consulter ces recueils : ce fut en vain, sans doute parce qu’ils n’avaient pas en-core été cotés. Pour la seconde édition, parue en 1879, on demanda à Hermann Zotenberg, orientaliste attaché à la bibliothèque nationale, de reprendre la re-cherche. Il retrouva les deux recueils égarés, ce qui lui permit de compléter le long article consacré à Bochart par une description assez précise de leur riche contenu8. Ils n’ont quasiment pas été exploités depuis. Outre leur intérêt pro-pre, ils permettent d’appréhender les méthodes de travail de l’auteur.
Les manuscrits de la Réponse sur le cutubuth
La Réponse sur le cutubuth – ainsi abrégerai-je désormais le long titre cité plus haut – occupe les feuillets 198 à 218 dans l’un des deux recueils formés par l’abbé de la Rue, aujourd’hui le manuscrit 2488 des Nouvelles acquisitions françaises (NAF) à la Bibliothèque nationale de France. Celui-ci se présente comme un codex factice de 256 feuillets au format in-folio, relié dos cuir. Dans son descriptif pour la France protestante, Zotenberg signalait que les feuillets 198 à 218 contiennent « quatre copies » de cette dissertation « et le commen-cement d’une traduction française ». Un examen plus attentif montre que nous avons en réalité trois versions du texte, disons I, II et III, avec, pour chacune d’elles, l’original de la main de Samuel Bochart et une copie d’une autre main plus moderne. Les copies, exactes et soignées, à l’écriture très nette et à la mise en page aérée, avaient peut-être été entreprises en vue d’une impression, mais nous ne savons rien des circonstances qui ont pu y faire obstacle.
La version I, restée embryonnaire, est en français, après cependant un titre et un « faux départ » en latin. La version II est entièrement en latin. C’est aussi le cas de la version III, qui a été amplifi ée par rapport à la II et apparaît claire-ment comme la version fi nale. Comme dans toute l’œuvre de Bochart, les ci-tations en grec, en hébreu et en arabe abondent. S’ajoutent à ces trois versions une dizaine de lignes de notes de travail en latin, assez informes, mais qui ont elles aussi ont fait l’objet d’une copie soignée, toujours par la même main.
L’ordre dans lequel ces différents éléments sont intégrés dans le codex NAF 2488 est le suivant :
7 Louis Daniel PAUMIER, Éloge historique de Samuel Bochart, Rouen, 1840, p. 45-47. 8 La France protestante, sous la direction de Eugène and Émile HAAG, seconde édition,
Paris, 1879, t. II, col. 658-665.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:9Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:9 29/10/15 23:19:1329/10/15 23:19:13
10 Pierre AGERON
feuillets n° donné par contenu l’abbé de la Rue
f.198r – 207r 90 copie de la version IIIf. 207v – page blanchef. 208r – 211v 91 copie de la version IIf. 212r – 213r 92 copie de la version I et des notes informesf. 213v – page blanchef. 214r – 215v 92b autographe de la version III (la fi n manque)f. 216r – 217v 92c autographe de la version IIf. 218r 92d autographe de la version If. 218v – autographe des notes informes ; notes d’histoire romaine (tête-bêche)f. 219r – v – pages blanchesf. 220r et seq. 93 copie de Explication de ces mots de l’épître de Jérémie (Bar VI 42-43)
Le fait que l’abbé de la Rue ait attribué aux pièces écrites de la main de Samuel Bochart des rangs intercalaires (92b, 92c, 92d) suggère qu’elles n’étaient pas conservées avec les copies, et que c’est a posteriori qu’il les a in-sérées entre les pièces 92 et 93. Cette hypothèse est confi rmée par leur grande fraîcheur de conservation, contrastant nettement avec le papier taché et l’encre pâlie des pièces qui, dans le recueil, les précèdent et les suivent. Dans ces der-nières, on reconnaît volontiers « la triste empreinte des ravages du temps et de l’humidité » dont témoigna le pasteur Paumier au sujet des manuscrits qu’il vit à Saint-Aubin de Crétot : le texte y est parfois à la limite du lisible, notamment dans les bas de pages. Malgré ces dommages, la copie de la version III (pièce 90) s’avère d’un très grand prix : elle permet de rétablir dans son intégralité le texte de cette version, la plus complète, dont le manuscrit autographe (pièce 92b) se trouve mutilé de la fi n, suite à la disparition du dernier feuillet.
Cutubuth et lycanthropie, est-ce la même chose ?
Le texte qui nous occupe se présente comme une très longue réponse à une seule et unique question, posée dans le titre : « On demande ce qu’est la melancholia errabunda, dite en arabe cutubuth, du nom d’un animal qui erre continuellement et sans relâche à la surface des eaux stagnantes »9.
Beaucoup des dissertations érudites de Bochart ont adopté cette forme d’une responsio ad quæstionem. Les questions posées émanaient tant de noms glorieux de l’Europe savante que d’humbles ministres du culte de Basse-Normandie : la
9 La formulation exacte varie légèrement d’une version à l’autre : I. Quæstio quid sit me-lancolia errabunda Cutubuth dicta Arabibus, ab animali quodam in superfi cie aquarum stagnan-tium, perpetuo et indesinenter errante. Respons[io]. II. Quæritur quid sit melancholia errabunda Cutubuth dicta Arabice, ab animali quodam in superfi cie aquarum stagnantium, perpetuo et inde-sinenter errante. Resp[onsio]. III. Responsio ad Quæstionem viri doctissimi, quid sit melancholia errabunda Cutubuth Arabice dicta, ab animali quodam in superfi cie aquarum stagnantium, per-petuo et indesinenter currante.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:10Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:10 29/10/15 23:19:1329/10/15 23:19:13
Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux lousps-garous 11
BnF NAF 2488, fol. 214r.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:11Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:11 29/10/15 23:19:1329/10/15 23:19:13
12 Pierre AGERON
notoriété de Bochart était grande, et chacun voulait connaître son avis, le plus souvent sur tel passage obscur ou discuté des Écritures10. Cependant, dans le cas qui nous occupe, le texte commence et fi nit abruptement et ne présente pas l’aspect d’une lettre personnelle. L’auteur de la question reste anonyme : la ver-sion III, la plus travaillée, précise seulement qu’il s’agit d’un vir doctissimus, un « homme très savant ». La forme de réponse serait-elle donc ici de pure rhétori-que ? Je ne le crois pas, et j’avancerai même dans la suite un nom possible pour le questionneur. Il est possible que la matière de cette Réponse ait été intégrée à une lettre que nous n’avons pas, la forme dont nous disposons étant rédigée comme discours académique ou destinée à l’impression.
« On demande ce qu’est la melancholia errabunda, dite en arabe cutubuth… » Pour un honnête homme du XVIIe siècle, la réponse n’était pas bien diffi cile à trouver. Ces deux termes, melancholia errabunda et cutubuth, apparaissaient à l’époque dans la plupart des traités médicaux : ils y désignaient une maladie ca-ractérisée par un visage pâle et hébété, des yeux creux et sans larmes, une langue sèche, des jambes ulcérées, une humeur triste, taciturne et solitaire, une errance nocturne dans les cimetières. Mais à l’évidence, la question posée à Bochart lui venait d’un érudit averti et appelait bien autre chose que cette réponse de premier degré. Pour en comprendre l’enjeu, un retour en arrière s’impose.
Des synonymes melancholia errabunda et cutubuth, le second est le plus ancien. Il dérive du mot arabe qutrub par lequel Avicenne (980-1036) dénom-ma cette maladie dans son Canon de la médecine11. Gérard de Crémone, tra-duisant l’ouvrage dans la deuxième moitié du XIIe siècle, ne prit pas le risque de chercher un équivalent latin à ce mot qu’il ne connaissait pas : il se conten-ta, comme à son habitude, de le translittérer en caractères latins. C’est ainsi
10 Parmi les Normands, citons Jean Tapin du Manoir, ministre des Essarts dans le Bessin, auquel Bochart répondit, entre autres, au sujet de l’article du Credo « Il descendit aux enfers » et Louis Hérault, ministre d’Alençon, avec lequel il échangea, de manière plus polémique, sur la manière dont le Diable porta Jésus sur une montagne pour le tenter. Voir Samuelis Bocharti Opera omnia, op. cit.
11 Ibn Sînâ (Avicenne), Kitâb al-qanûn fî al-tibb, lib. III, fen. 1, tract. IV, cap. xxii, p. 315 : fasl fî al-qutrub. Les numéros de page sont donnés d’après l’édition arabe de la Typographia Medicea, Rome, 1593 – c’est celle que possédait Bochart.
BnF NAF 2488, fol. 217v - le passage crucial.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:12Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:12 29/10/15 23:19:1429/10/15 23:19:14
Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux lousps-garous 13
qu’apparut dans les manuscrits latins la forme cutrub. Au fi l des copies mé-diévales, ce mot ignoré des scribes subit une constante déformation. De sorte qu’au XVe siècle, dans les premières éditions imprimées d’Avicenne ou de ses commentaires, il se présentait sous la forme cutubut ou cutubuth, voire cu-cubuth ! Ce n’est qu’au XVIe siècle qu’on songea à lui forger un équivalent latin moins énigmatique : ainsi apparut la melancholia errabunda (mélancolie vaga-bonde) que l’on trouve en 1576 chez le médecin italien Domenico Leoni12.
Mais là n’est pas toute l’histoire. Depuis la publication, en 1549, de la com-pilation médicale d’Aèce d’Amide (VIe s. après J.-C.), les médecins savaient que Marcellus de Side avait décrit dès le IIe s. après J.-C. un couple de pathologies, dites lycanthropie et cynanthropie, aux symptômes très exactement semblables à ceux du cutubuth d’Avicenne, avec un de plus qui explique leurs dénominations : l’homme qui en est affecté imite en toute chose les loups (en cas de lycanthro-pie) ou les chiens (en cas de cynanthropie). Or Avicenne, s’il n’ignorait pas le symptôme consistant à imiter les chiens – il ne parle pas de loups –, ne l’avait pas inclus parmi ceux du qutrub, mais donné comme caractéristique d’une autre maladie, qu’il appelait « maladie du chien » ou en arabe dâ’ al-kalb. Il y avait donc pour lui deux maladies bien différentes, dâ’ al-kalb et qutrub, décrites dans son traité à quelques pages de distance. La première était une manie ou délire violent13, la seconde une maladie mélancolique – nous dirions aujourd’hui une dépression. En les distinguant, Avicenne se singularisait par rapport à ses prédé-cesseurs grecs, mais aussi arabes comme Ibn Mâsawayh, ‘Alî bin al-‘Abbâs al-Majûsî ou Abû al-Qâsim al-Zahrâwî. Il en résulta chez les médecins européens de la Renaissance une grande confusion : la lycanthropie/cynanthropie des Grecs correspondait-elle dans le Canon d’Avicenne au cutubuth ou bien à la « mala-die du chien » ? Était-elle, par conséquent, une mélancolie ou bien une manie ? Au début du XVIIe siècle, le Portugais Ambrosio Nunes estimait : « c’est à tort qu’Avicenne a séparé de ces sortes de maladies [les manies lycanthropique et cy-nanthropique] celle qu’il a appelée en arabe alchatrab ou chatrab »14. Mais l’Al-lemand Daniel Sennert jugeait quant à lui préférable de maintenir la distinction entre, d’une part, la « melancholia errabunda, dite par les Arabes kutubuth » et, d’autre part, la lycanthropie et la cynanthropie15.
En 1659, le Français Pierre Vattier donna au public une nouvelle traduction latine partielle du Canon d’Avicenne. Il fut le premier traducteur d’Avicenne à
12 Domenico LEONI, Ars medendi humanos, particularesque morbos a capite usque ad pedes, Bologne, 1576, sect. I, lib. II, cap. x : De Melancholia errabunda […] ab Avic[enna] cæterisq[ue] Arabibus cutubut dicitur.
13 Ibn Sînâ, op. cit., lib. III, fen. 1, tract. IV, cap. xvi, p. 312 : fasl fî al-mâniya wa-dâ’ al-kalb. Le chapitre commence par ces précisions : « la signifi cation de manie est folie de bête sauvage ; quant à la maladie du chien, elle en est une variété » (en arabe : tafsîr al-mâniya huwa al-junûn al-sab‘î ammâ dâ’ al-kalb fa-innahu nû‘ minhu). Gérard de Crémone avait interprété al-junûn al-sab‘î par dæmonium lupinum [démon lupin] ; en 1659, Pierre Vattier se montra plus exact en traduisant les mêmes mots par insania ferina [folie de bête sauvage].
14 Ambrosio NUNES, Enarrationum in priores tres libros Aphorismorum Hippochratis, Coimbra, 1603, t. I, lib. III, aphor. XX, p. 704 : « falso t[ame]n postea c. 21 ab his insaniæ specie-bus separavit illa[m], quam Arabice vocavit alchatrab seu chatrab ».
15 Daniel SENNERT, Medicina Practica, Lyon, 1629, lib. I, part. II, cap. xiv, p. 491-493 : De Melancholia Errabunda, Arabibus Kutubuth dicta.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:13Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:13 29/10/15 23:19:1429/10/15 23:19:14
14 Pierre AGERON
prendre le parti de rendre qutrub non point par cutubuth, par lui rangé au nom-bre de ces mots obscurs des anciennes traductions « qui ne peuvent être compris par la connaissance ni du latin, ni du grec, ni de l’arabe »16, et pas davantage par melancholia errabunda, mais par lycanthropia17. Quant à la « maladie du chien », dâ’ al-kalb, Vattier la latinisa en mania canina18. La question à laquelle Bochart répond dans le manuscrit que j’ai exhumé – rappelons qu’il est rédigé entre 1663 et 1667 – me semble devoir être placée dans le contexte de ces tergiversations, et très singulièrement du parti pris de Vattier dans sa récente traduction : a-t-il eu raison ou non d’identifi er le cutubuth à la lycanthropie ?
Pierre Vattier, un Normand traducteur des auteurs arabes
À ce point, il est important de dire un mot de ce Vattier et de noter l’exis-tence de relations étroites entre lui et le milieu érudit caennais, notamment Samuel Bochart, Pierre-Daniel Huet et Jacques Moisant de Brieux. Comme eux, Pierre Vattier (1623-1667) était un Normand : il était né et demeurait à Montreuil, aujourd’hui Montreuil l’Argillé, à trois lieues d’Orbec. Ayant étudié la médecine et l’histoire naturelle, il avait appris l’arabe dans le but de pouvoir lire Avicenne dans le texte. Il y avait si bien réussi qu’il fut nommé en 1658 sur une chaire d’arabe au Collège royal, et traduisit en latin l’intégralité du Canon. La traduction partielle dont nous venons de parler, imprimée à Paris en 1659, regroupe tout ce qui dans le Canon concerne les maladies mentales. Bochart en possédait un exemplaire, qui fi gure dans le catalogue de sa bibliothèque (Bibliotheca Bochartiana et Sudoriana) sous le numéro 2534. En 1660, Vattier publia une traduction d’un recueil de textes arabes19 édité par Golius trente ans plus tôt20 : il reprenait ainsi un projet qui fut celui de Bochart vers 164021. En 1661, à la demande de l’homme de lettres parisien Jean Chapelain, Bochart et Moisant de Brieux fi rent des démarches répétées auprès de leurs relations en Angleterre en vue d’une édition intégrale de sa traduction du Canon d’Avi-cenne : elles restèrent vaines et le manuscrit de Vattier est aujourd’hui perdu22.
16 Pierre VATTIER, Abugalii fi lii Sinæ, sive, ut vulgo dicitur, Avicennæ […] de Morbis mentis tractatus, Paris, 1659, p. 201 : « neque a Latinæ aut Græcæ, neque ab Arabicæ linguæ perito intelligi queant. »
17 Op. cit., p. 155. 18 Op. cit.., p. 109. 19 Pierre VATTIER, L’Élégie de Tograï, avec quelques sentences tirées des poètes arabes,
l’Hymne d’Avicenne et les Proverbes du chalife Gali, Paris, 1660.20 Jacob GOLIUS, Proverbia quaedam Alis, imperatoris Muslemici, et Carmen Togra’ï Poëtae
doctiss[imi], necnon Dissertatio quaedam Aben Sinæ, Leyde, 1629.21 L’exemplaire du recueil de Golius qui appartint à Bochart est interfolié avec une tra-
duction latine de sa main en regard du texte arabe imprimé ; il est coté comme ms. in-8°26 de la bibliothèque de Caen.
22 Voir notamment ces lettres de Chapelain : 1°) à Huet, 25 août 1661, in Léon PÉLISSIER, « Lettres inédites de Chapelain à P.-D. Huet », Mémoires de la société de l’histoire de Paris, t. XXI, 1894, p. 150 : « M. Vattier se viendra establir à la Saint-Martin icy et sera en lieu à pouvoir entretenir correspondance avec ses amis. Vous nous ferez savoir s'il y a quelque fondement d’es-pérer que les nouveaux offi ces de M. Bochart fassent résoudre les libraires anglois à entreprendre l’édition de son Avicenne » ; 2°) à Moisant de Brieux, 2 juin 1661, in Lettres de Jean Chapelain, publiées par Ph. TAMIZEY DE LARROQUE, t. II, 1883, p. 137 : « Il (Montauzier) m’ordonna d’engager Mr Bochart à sçavoir de ses amis d’Angleterre s’ils se voudroient charger d’une nouvelle édition latine d’Avicenne l’Arabe par Mr Vattier, médecin, le plus habile pour l’arabe qui soit peut estre
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:14Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:14 29/10/15 23:19:1429/10/15 23:19:14
Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux lousps-garous 15
Plus tard, Bochart formula sur Vattier ce jugement qui, quoique quelque peu hyperbolique23, montre qu’il avait une exacte connaissance de ses travaux :
« On peut dire de M. Vattier que viribus ingenii potest super astra volare. Il est Normand, d’aupres de Lizieux, fort attaché à l’estude ; il a fait des Notes sur le premier livre d’Hippocrate de diæta, & sur celuy de Veteri medicina, & fait des Abregez en Grec de plusieurs livres de Galien. Il a traduit en François la Logique d’Avicenne & l’Histoire de Tamerlan qui sont imprimées. Il a aussi fait une traduc-tion nouvelle de tout le canon d’Avicenne en latin fort élégant. »
La maladie dont Vattier souffrait depuis longtemps, et était sans doute la cause d’un absentéisme au Collège royal dont Chapelain lui fi t reproche, l’em-porta à l’âge de 45 ans. Cinq semaines plus tard, Bochart décédait à son tour.
Origine grecque du mot arabe qutrub
Dans l’inédit de Bochart que je présente ici, l’aspect que je trouve le plus remarquable concerne l’étymologie du nom de la maladie dite cutubuth, ou plutôt, en arabe, qutrub. Au début du texte, la Quæstio donne une explication de ce mot : il viendrait « du nom d’un certain animal qui court24 continuellement et sans relâche à la surface des eaux stagnantes ». Cette étymologie n’est autre celle qu’on lit dans le Canon d’Avicenne : le grand médecin arabe précisait que « le qutrub est une bestiole qui se forme à la surface de l’eau, a des mouvements variés et désordonnés, et toutes les heures plonge, disparaît puis réapparaît ». Appuyée sur l’autorité d’Avicenne, reprise par d’autres auteurs arabes, elle fut aussi admise dans de nombreux traités médicaux européens des XVIe et XVIIe siè-cles, comme ceux de Giovanni Arcolani, Michele Savonarola, Domenico Leoni et Daniel Sennert. Sa formulation précise varia légèrement d’un auteur à l’autre, mais je n’ai pu identifi er de texte où elle fi gure exactement dans les mêmes ter-mes que dans la Quæstio adressée au pasteur caennais25.
en Europe, au jugement mesme de Mr Gaumin, et qui a déjà donné des traductions françoises du Macine [al-Makîn] et du Tamerlan extrêmement approuvées... Si Mr Bochart faisant cet offi ce trouvoit ces Messieurs d’Outremer disposés à entreprendre cette édition, on leur laisseroit le choix de la faire ou seule ou avec le texte... » ; 3°) au même, 17 octobre 1661, ibid., p. 152 : « Nous vous sommes bien obligés, M. Vattier et moy aussi bien que M. Bochart, des soins que vous avés tous deux pris pour essayer de faire entreprendre aux Anglois l’impression de son Avicenne. Il faut se consoler du mauvais succès de la négociation... »
23 Lettre de Bochart à Colomiès, 20 février 1665, in Paul Colomiès, Gallia Orientalis, La Haye, 1665, p. 230.
24 Les versions I et II du texte donnent : « qui erre » (errante).25 À la description de l’animal telle qu’elle est formulée dans la question (animal in super-
fi cie aquarum stagnantium, perpetuo et indesinenter errante/currante), on peut comparer : 1°) la traduction d’Avicenne que propose plus loin Bochart : animalculum aqua superfi ciei innatans, cujus varii et inordinati sunt motus ; 2°) la traduction d’Avicenne par Gérard de Crémone revue par André Alpago : bestiola existens in superfi cie aquæ, quæ super eam movetur diversis motibus sine ordine ; 3°) la traduction d’Avicenne par Vattier, op. cit. : animalculum summæ aquæ innatans & variis illic motibus sese circummagens nullo ordine ; 4°) l’Ars medendi humanos de Dominico Leoni, op. cit. : parvum animal plurimum cursitans super aquas stagnantes ; 5°) la Medicina practica de Daniel Sennert, op. cit. : animal in superfi cie aquarum stagnantium, hic inde cursitat ; 6°) la Practica Maior de Michele Savonarola (Venise, 1547, tract. VI, cap. I, rubr. XIII) : animal quod invenitur in superfi cie aquarum stantium, & tamen ex omni re ei occurrente movetur, immo modico spatio stat, non moveatur, quasi est in continuo motu.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:15Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:15 29/10/15 23:19:1429/10/15 23:19:14
16 Pierre AGERON
Dans ce texte, nous voyons Bochart s’autoriser, non sans une étonnante audace, à contredire le grand Avicenne, et avec lui tous les savants et lexicogra-phes arabes, sur l’origine d’un mot de leur propre langue. L’explication selon laquelle la maladie dite qutrub tirerait son nom de la bestiole homonyme ne le convainc pas, parce que le rapport de sens ne lui semble pas établi : l’animal dé-crit par Avicenne, qui est l’araignée d’eau ou tipula, est en effet particulièrement grégaire, tandis que l’homme atteint de qutrub ne recherche que la solitude. Il est bien plus probable, soutient-il, que le mot arabe qutrub dérive du grec lycanthropia. La mutation s’expliquerait par un banal phénomène d’aphérèse, ou chute de la première syllabe, jointe à l’absence du phonème p en arabe. Il envisage aussi, sans la retenir, une variante de cette hypothèse, selon laquelle qutrub viendrait de cynanthropia, au prix cette fois d’une syncope. Remarquons que l’hypothèse de Bochart justifi e complètement le choix de traduction fait par Vattier. Car si, comme le pense Bochart, l’arabe qutrub dérive du grec ly-canthropia, alors la maladie décrite sous ce nom par Avicenne était bel et bien la lycanthropie des Grecs, et ceci même s’il en avait exclu le symptôme le plus caractéristique. Exeunt donc le cutubuth et la melancholia errabunda, réduits au rang d’artefacts créés par la transmission et la traduction des textes. Peut-être Vattier est-il directement à l’origine de la question posée à Bochart.
La dissertation de Bochart resta, comme on l’a vu, inédite et inconnue. Pour qu’une explication du mot arabe qutrub analogue à la sienne fût à nou-veau avancée, il fallut attendre, semble-t-il, la séance du 8 janvier 1892 de la Société asiatique26. L’orientaliste français Rubens Duval, qui travaillait à l’édi-tion du dictionnaire syriaque-arabe de Bar Bahloul (Xe siècle), indiqua qu’il y avait trouvé le nom commun qantropos, défi ni comme la mélancolie de celui qui habite les cimetières et imite les loups. Il en conclut que l’équivalent arabe qutrub dérivait du grec par un intermédiaire syriaque. Mais contrairement à Bochart, il jugea que le mot grec d’origine était cynanthropos plutôt que ly-canthropos, avec bien peu de vraisemblance puisque la défi nition du lexique de Bar Bahloul faisait mention de loups et non de chiens. Quoi qu’il en soit, et sans le savoir, Rubens Duval confi rmait, presque 230 ans après son devan-cier normand, l’essentiel de sa stupéfi ante étymologie. Plus largement, c’est la place non négligeable des racines non-sémitiques dans le lexique de la langue arabe qu’on commençait à percevoir.
De Nabuchodonosor au varou
La Réponse sur le cutubuth de Samuel Bochart contient encore bien d’autres choses curieuses, que le lecteur pourra découvrir dans la traduction intégrale que nous proposons ci-dessous. Bochart y discute, avec son érudition sans faille, des hypothétiques transformations d’hommes en loups chez les Arcadiens, chez les Neuriens, puis en Livonie, Lithuanie, Irlande et Rhénanie, pour conclure qu’il ne
26 Rubens DUVAL, « Origine grecque du mot arabe Kotrob », Journal asiatique, VIIIe sé-rie, XIX, 1892, p. 156-159. Voir aussi : Manfred ULLMANN, « Der Werwolf. Ein grieschisches Sagenmotiv in arabischer Verkleidung », Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, LXVIII, 1976, p. 171-184.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:16Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:16 29/10/15 23:19:1429/10/15 23:19:14
Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux lousps-garous 17
s’agit, dans tous ces cas, que de vues de l’esprit. Étudiant par le menu le chan-gement en bœuf du roi Nabuchodonosor que rapporte la Bible, il établit, s’ap-puyant tant sur les pères de l’Église que sur les rabbins médiévaux, qu’elle relève de l’aliénation et non de la métamorphose. Rien ne l’empêche alors de détecter les symptômes de la lycanthropie chez les démoniaques décrits par les Évangiles synoptiques. Il clôt sa dissertation par une discussion soigneuse de diverses hy-pothèses sur l’étymologie de l’intrigant mot français loup-garou. Sur ce point, le pasteur normand ne manque pas d’évoquer ces rustici nostrates, « paysans de chez nous », qui disent louvaroux au lieu de lougaroux. Cette forme typiquement normanno-picarde27 aurait pu lui permettre de percer le mystère du garou, s’il avait rapproché le normand varou de son synonyme allemand Werwolf : dans celui-ci, on reconnaît sans peine la racine Wer- qui est aussi celle du latin vir (homme) et le mot Wolf (loup), de sorte que loup-garou est un pléonasme qui signifi e loup-{homme-loup}. Malheureusement, sur la foi du Thesaurus geo-graphicus du savant néerlandais Abraham Ortelius, Bochart crut que la forme principale du mot allemand était Wederwolf et non Werwolf. Reprenant en la modifi ant une idée de son ami et coreligionnaire Claude Saumaise, il échafauda une autre hypothèse rapprochant le garou/varou, le verbe égarer et le toponyme normand Varaville : quoique ingénieuse, elle doit aujourd’hui être écartée.
Conclusion
Samuel Bochart est un des érudits les plus exceptionnels dont puissent s’enorgueillir la ville de Caen et son Académie. Par sa connaissance phéno-ménale des langues et des textes, par sa critique rigoureuse des sources et leur comparaison systématique, par sa lecture historique et philologique du corpus biblique, il a été l’un des savants les plus novateurs et les plus infl uents de la République des lettres en Europe. Il fut injustement raillé aux XVIIIe et XIXe siècles, notamment pour certaines hypothèses étymologiques apparues avec le recul comme fragiles, voire farfelues. De nombreux exemples, comme celui du qutrub que nous avons détaillé, démontrent cependant que Bochart était capable, dans ce domaine naissant de la science du langage, d’intuitions très fi nes et parfaitement argumentées.
Malgré un récent regain d’intérêt pour le personnage et ses ouvra-ges28, Samuel Bochart reste beaucoup plus mal connu que d’autres savants de
27 Elle résulte de l’évolution du [w] germanique en [v] et non en [g]. En Normandie, ce phénomène concerne la zone au nord de la ligne Granville – Vire – Falaise – Broglie – Saint André – les Andelys. Voir : René LEPELLEY, La Normandie dialectale, Caen, 1999, p. 61-62.
28 Parmi les publications récentes : Thierry BUQUET, « Pourquoi la Bible des Septante a-t-elle traduit le zemer du Deutéronome en kamelopardalis ? Réfl exions sur le statut symbolique et alimentaire de la girafe », Anthropozoologica, 41, 2006, p. 7-25 ; Pierre AGERON, « Les manus-crits arabes de la bibliothèque de Caen », Annales de Normandie, 2008, 1-2, p. 77-133 ; Thierry BUQUET, « La girafe, belle inconnue des bibles médiévales. Camelopardalis : un animal philologi-que », Anthropozoologica, 43, 2008, p. 47-68 ; Luc DAIREAUX, « Au service de l’érudition : Samuel Bochart (1599-1667) et les Provinces-Unies », in Entre calvinistes et catholiques. Les relations religieuses entre la France et les Pays-Bas du Nord (XVIe-XVIIe siècles), sous la direction de Yves KRUMENACKER et Olivier CHRISTIN, Rennes, PUR., 2010, p. 223-238 ; Zur SHALEV, Sacred Words and Worlds. Geography, Religion, and Scholarship, 1550-1700, Leyde, 2012, p. 141-203 et 271-
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:17Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:17 29/10/15 23:19:1429/10/15 23:19:14
18 Pierre AGERON
son temps. La tâche est à vrai dire immense : il faudrait recenser et examiner les vestiges, souvent annotés de sa main, rassembler et éditer sa correspon-dance dispersée, cataloguer, éditer, traduire et analyser ses manuscrits inédits, rédiger une biographie tenant compte des acquis récents de la recherche sur l’Europe savante et le protestantisme au XVIIe siècle. Ce travail ne peut être que collectif, car les compétences requises sont multiples, de l’histoire à la zoologie en passant par la linguistique et la théologie. Je souhaite vivement que l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen soit capable de re-connaître ce qu’elle doit à Samuel Bochart en prenant sa part de tels projets.
SAMUEL BOCHARTRÉPONSE À LA QUESTION
D’UN HOMME TRÈS SAVANT,QUI DEMANDE CE QU’EST LA
MELANCHOLIA ERRABUNDA,DITE EN ARABE
CUTUBUTHDU NOM D’UN ANIMAL QUI S’AGITE
CONTINUELLEMENT ET SANS RELÂCHEÀ LA SURFACE DES EAUX STAGNANTES
Avertissement. L’essai de traduction qui suit n’a pas de prétention scientifi que. Son but, modeste, est de permettre au lecteur une prise de contact rapide avec le contenu de la dissertation de Bochart. Je me suis appuyé sur la version III, la plus complète. Trahissant la méthode philologique de l’auteur, j’ai « aplati » le texte en ramenant au français les quatre langues utilisées : latin, grec, hébreu, arabe. Quelques mots grecs, hébreux ou arabes isolés ont néanmoins été transcrits en alphabet latin avant d’être traduits en français. Les notes appelées par un astérisque sont de Bochart lui-même. Le découpage en treize sections est une commodité ; je l’avais opéré avant d’entamer la traduction et l’ai conservé bien qu’il ne soit pas pleinement satisfaisant. Les lacunes dans la section 9 sont dues à l’impossibilité de lire quelques lignes : cette section est conservée seulement dans la copie de la version III, très endommagée par l’humidité. Je n’ai pas cherché à vérifi er systématiquement les références données par Bochart, sauf dans un très petit nombre de cas (notes infrapaginales nu-mérotées). J’espère donner un jour une édition critique de ce texte complexe, avec une traduction fi dèle à l’esprit de l’auteur et des notes en abondance. Je remercie Mme José Codréanu, professeur d’hébreu au Centre d’études théologiques de Caen, pour son aide précieuse.
1. Cutubuth n’est pas un vrai mot arabe, mais un mot corrompu de l’arabe par l’ignorance des scribes qui ont copié les livres de médecine des Arabes traduits en latin. Dans la version latine d’Avicenne, il est écrit tantôt cutubut, tantôt cucubut. Dans les Pandectes de médecine de Matthieu Sylvaticus, écrits vers l’an 1300, on le lit ou avec
278 ; Pierre AGERON, « Dans le cabinet de travail du pasteur Samuel Bochart (1599-1667) : l’érudit et ses sources arabes », in Érudition et culture savante, de l’Antiquité à l’époque moderne, sous la direction de François BRIZAY et Véronique SARRAZIN, Rennes, PUR, 2015, p. 117-143.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:18Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:18 29/10/15 23:19:1429/10/15 23:19:14
Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux lousps-garous 19
l’article : Alcurub et Alcutubut, ou sans l’article : curub et cutubuth ; il est expliqué par « espèce de mélancolie ». Mais le nom arabe est kutrub ou kotrob, mot qui a des sens variés. Ainsi, dans le dictionnaire Alkamus, kutrub est un brigand, une souris, un loup pelé, une furie mâle, un petit chien, un petit diable léger (diablotin, esprit follet), un oiseau, un petit animal qui ne se repose pas de tout le jour. On lit des choses très sem-blables dans le dictionnaire de Giauhari. À quoi Damir ajoute, dans son grand ouvrage sur les animaux29, que c’est une espèce de mélancolie, et que les médecins appellent d’alkutrub ceux qui en sont affl igés.
2. Quelle est cette espèce de mélancolie, je l’ai appris dans le texte arabe d’Avi-cenne (Canon, livre 3, p. 315) au chapitre intitulé Sur Alkotrob. N’y lit-on pas que c’est une espèce de mélancolie survenant en général au mois de shubât, c’est-à-dire février, que celui qui en est affecté fuit les vivants, se plaît à converser avec les morts dans les cimetières et est mal disposé envers ceux qui croisent son chemin ? Il sort la nuit et se cache le jour parce qu’il aime la solitude et l’éloignement des hommes. Il ne reste jamais une heure en un même lieu, mais erre çà et là, par divers chemins, sans savoir où il tend, se gardant toujours des hommes – ou s’il s’en garde moins, c’est qu’il les regarde avec négligence et sans prêter attention à ce qu’il voit. De plus, il est extrême-ment taciturne, d’humeur morne, dolente et triste, de couleur pâle, la langue sèche, avec des ulcères aux jambes qui ne guérissent jamais à cause de la corruption de l’humeur mélancolique et du mouvement perpétuel de ses pieds qui fait qu’aussitôt de nouvelles humeurs s’y écoulent, d’autant plus que qu’ils sont souvent heurtés, frappés ou mordus par des chiens. Ses yeux sont secs et ne donnent pas de larmes, ils sont vides et creux à cause de la sécheresse de son tempérament.
3. Cependant, à cette traduction défectueuse, il faut aussi relier les descriptions des maladies dites en grec cynanthropia ou lycanthropia, ainsi décrites par Aèce d’Amide (livre 10, chap. 10, que d’autres numérotent 11) : « Ceux qui sont affectés de lycanth-ropie ou de cynanthropie sortent la nuit au mois de février et imitent en toutes choses les loups ou les chiens ; ils fréquentent principalement les cimetières jusqu’au point du jour. Tu diagnostiqueras ceux qui en sont affectés à ces signes : ils sont d’apparence pâle, leur regard est vide, leurs yeux sont secs et ne pleurent pas. Tu verras qu’ils ont les yeux creux, la langue râpeuse et ne peuvent pas cracher complètement. Ils sont des-séchés, et ont aussi des ulcères aux jambes qui ne peuvent pas guérir en raison de fré-quents heurts et morsures de chiens ». De Paul d’Égine (livre 3, chap. 16) : « Ils sortent la nuit, jusqu’au jour. Ils errent principalement dans les cimetières, imitant les loups en toutes choses. Leurs yeux sont concaves et secs, ils semblent stupides et faibles d’es-prit, ils ont la langue très sèche, ont une grande soif et leur bouche manque de salive. Leurs jambes sont incurablement ulcérées en raison de chocs fréquents. » On dit qu’il y a aussi des choses similaires dans Alexandre de Tralles, que consulteront ceux qui ont son livre. De là vient ce que qu’écrit sur la lycanthropie Marcel Virgile dans ses notes sur Dioscoride (livre 3, au chapitre sur la pivoine30) : « les anciens médecins des Grecs ont mis au nombre des signes de ce mal la pâleur, la sécheresse des yeux, l’apparence faible d’esprit, l’absence de salive, la soif et les tibias ulcérés sans remède parce que cette partie est abondamment heurtée la nuit ».
29 Il s’agit de Hayât al-hayawân al-kubrâ [Grande vie des animaux] de Muhammad al-Da-mîri (1341-1405). Samuel Bochart tenait du cardinal Mazarin un manuscrit de cet ouvrage, copié à Tripoli en 1459 et aujourd’hui conservé à la bibliothèque de Caen (ms. in-4°3). Voir : Pierre AGERON, « Les manuscrits arabes de la bibliothèque de Caen », Annales de Normandie, 2008, 1-2, p. 77-133.
30 Pedacii Dioscoridæ Anazarbei de Materia medica libri sex, Interprete Marcello Virgilio Secretario Florentino. Cum ejusdem annotationibus, Florence, 1518, f. 215v.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:19Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:19 29/10/15 23:19:1429/10/15 23:19:14
20 Pierre AGERON
4. Cette même maladie est dite lycaon par les auteurs récents, et ceux qui en sont affectés des lycaons. Phavorinus écrit : « Lycaon – on appelle ainsi chez les auteurs récents la maladie de quelqu’un qui erre pendant la nuit et fréquente les cimetières ». Il ne faut peut-être pas imaginer d’autre raison que la transformation en loup du très ancien roi Lycaon d’Arcadie, parce que, saisi de ce mal, il errait dans les champs, et pour tout langage ne faisait sortir de sa bouche que des hurlements, comme s’il eût été un loup, ce à quoi fait allusion ce poète (Ovide, Métamorphoses, livre 1) : « Épouvanté lui-même, il fuit, / Ayant rencontré le silence de la campagne, il hurle, / En vain il en-treprend de parler », etc. On lit ainsi chez Hérodote (livre 4, chap. 105), s’il est permis de le croire : « une fois par an, chaque Neurien devient un loup pendant quelques jours, et inversement est rétabli dans son état premier ». Si contraire au sens commun que ce soit, non seulement ils le disent, mais ils l’allèguent sous serment, parce qu’un grand nombre d’entre eux étaient persuadés de la chose. Pareillement Mela (livre 2, chap. 1er) rapporte au sujet des mêmes : « Tous les Neuriens ont une période fi xe pendant laquelle, ils sont, s’ils le veulent, transformés en loup, et transformés une deuxième fois en ceux qu’ils étaient. » Et Solin, dans le chapitre sur l’Hypan et le Borysthène : « Les Neuriens, à ce que nous savons, étaient pendant les périodes estivales métamorpho-sés en loups ; ensuite, après l’exact laps de temps attribué à ce sort, ils retournaient à leur premier visage ». Mais Saumaise avertit très justement qu’à la place de « périodes estivales » (æstatis temporibus), il fallait lire « périodes fi xes » (statis temporibus). Les Neuriens sont des peuples Scythes dont le territoire n’est pas suffi samment bien déterminé. Suivant Pline (livre 4, chap. 12), Solin (ubi supra) et Ammien (livre 22), le Borysthène prend sa source chez eux ; suivant Pomponius (livre 2, chap. 1), c’est le Tyras ; suivant Philostorge (livre 11, chap. 18) et Nicéphore (livre 9, chap. 17), c’est le Tanais. Les sources de tous ces fl euves sont très éloignées les unes des autres, quoique toutes situées dans l’Europe sarmatique. Si l’on en croit Nicéphore (ubi supra), qui le tient de Philostorge (ubi supra), les Neuriens seraient les mêmes que les Huns.
5. Ce n’est pas seulement en Sarmatie, chez les Barbares, mais aussi en Grèce que l’on a cru que les hommes peuvent se transformer en loups. Ainsi au livre 8 de la République de Platon : « Autour du temple de Jupiter Lycéen en Arcadie, celui qui a goûté des entrailles humaines mêlées à celles d’autres victimes se voit contraint d’être changé en loup. » Ce passage de Pline (livre 8, chap. 22) fait référence à la même chose : « Parmi les auteurs grecs qui ne sont pas à dédaigner, Evanthes rapporte que les Arcadiens ont écrit, que de dans la descendance d’Antæus, quelqu’un était tiré au sort et conduit vers une mare de la région, qu’ayant accroché ses vêtements à un chêne, il la traversait à la nage, puis partait dans des lieux déserts, était métamorphosé en loup, et pendant neuf ans s’assemblait avec d’autres de la même espèce. Si pendant ce temps, il s’était abstenu de manger de l’homme, il revenait à la même mare, et l’ayant traversée à la nage, il recevait la fi gure qu’il avait précédemment, vieillie de neuf an-nées supplémentaires. » Et chez saint Augustin (La Cité de Dieu, livre 18) : « Varron évoque les Arcadiens, qui, conduits par le sort, traversaient une mare à la nage, puis là étaient transformés en loups, et vivaient avec des bêtes semblables dans les déserts de cette région. Au bout de neuf ans, si véritablement ils ne s’étaient pas nourris de chair humaine, alors, revenus à la nage à travers la même mare, ils étaient rendus à leur forme d’hommes. Finalement, il dépeint nommément un certain Demœnetus qui, ayant goûté à l’enfant immolé que les Arcadiens avaient coutume de sacrifi er à leur dieu Lycéen, fut changé en loup et, la dixième année, fut rendu à la fi gure qui était la sienne, puis s’exerça au pugilat et fut vainqueur d’une joute olympique ». Pausanias aussi dans les Arcadiens rapporte qu’en Arcadie, un enfant ayant été sacrifi é à l’autel de Jupiter Lycéen, le roi Lycaon d’Arcadie en personne versa le sang humain, et qu’il fut changé
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:20Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:20 29/10/15 23:19:1529/10/15 23:19:15
Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux lousps-garous 21
en loup entre ces cérémonies. Mais plus tard, dans les Éliaques, le même auteur appelle Demarchus au lieu de Demœnetus l’athlète parrhasien d’Arcadie, vainqueur aux Jeux olympiques dont on dit qu’il se transforma en loup lors des cérémonies pour Jupiter Lycéen et retrouva la dixième année sa fi gure humaine d’auparavant. Et il prouve que cette fable n’est pas venue des Arcadiens, car il n’en est fait aucune mention dans l’ins-cription de la statue de ce même Demarchus, qui indique ceci : « Demarchus, fi ls de Dynitta, Parrhasien d’Arcadie, a consacré cette statue ».
6. Que penser encore de ce que beaucoup racontent, à savoir qu’aujourd’hui, en Livonie et en Lithuanie, les métamorphoses de ce genre ne sont pas rares ? De fait, Olaus Magnus (livre 8, chap. 45) dit : « Pendant la nuit de Noël se rassemblent en un endroit déterminé convenu entre eux de très nombreux loups, issus de la transformation d’humains en divers lieux, qui, plus tard dans la nuit, s’acharnent avec fureur et férocité aussi bien sur le genre humain que sur les autres animaux qui n’ont pas la nature de bêtes sauvages, de sorte que les habitants de cette région en subissent un dommage plus important qu’ils n’en ont jamais subi de la part de loups véritables et naturels » ; voyez la suite dans son ouvrage. Et Camden, dans son chapitre sur l’Irlande, en décrivant le comté de Tipperary : « Certains Irlandais affi rment, et ils veulent qu’on les croit, que dans ce coin de terre, des hommes sont changés en loups ». Ortelius aussi, dans son dictionnaire géographique, dit en parlant des Neuriens : « Je sais que ces temps-ci, on a brûlé publiquement un criminel dans le duché de Clèves, à qui on avait fait la réputation infâme de pratiquer cet art ». Cependant, il s’y montre comme un Démocrite vis à vis de Pline et Pausanias. Camden tient pour affabulations ce que rapportent les Irlandais. Mais le même les soupçonne d’être saisis par la malignité d’un excès d’hu-meur atrabilaire, que les médecins nomment lycanthropique, excitant leur imagination de sorte qu’ils se croient transformés en loups. Il en est peut-être de même de Lycaon, des Neuriens, des Arcadiens, du peuple d’Antæus, de Demœnetus ou Demarchus, des Livoniens et Lithuaniens, et du magicien de Clèves. Alors, quelle que soit l’assurance avec laquelle ils annoncent ces prodiges, ils se trompent, ou bien ils sont trompés. Ils se trompent s’ils rapportent comme si elles s’étaient passées des choses qui n’ont même pas une ombre de vérité. Ils sont trompés, si abusés par l’habileté des démons, ils tiennent pour vraies des choses qui ni ne se sont produites, ni en vérité ne peuvent se produire d’aucune créature par les hommes. Car seul Dieu peut modifi er la nature des choses et transformer les hommes en bêtes brutes, ou bien faire revenir à leur état antérieur ceux qui ont été ainsi transformés. Par conséquent dans les lycanthropes, la nature n’est pas changée, mais l’imagination est touchée : des images s’y impriment qui ne sont rien d’autre que rêve d’une ombre31 et pure vue de l’esprit.
7. Soit par exemple le roi Nabuchodonosor de Babylone, dans lequel l’esprit hu-main s’était engourdi au point qu’il s’est pensé être une tête de bétail. Il en advint que celui qui avait été roi des rois et avait régné sur une partie non négligeable de la terre erra en plein air pendant sept ans et se contenta de se nourrir de foin avec les bœufs. Certains veulent que la forme de son corps aussi ait dégénéré en bête. Mais l’Écriture enseigne seulement que détourné des hommes, il brouta l’herbe comme les bœufs et qu’il lui vint des poils et des griffes comme à un aigle. De même chez Laèrce Héraclite : « déjà âgé, quand il se fut retiré en misanthrope, errant dans les montagnes, il se nourris-sait d’herbes et de plantes ». Cependant, rien n’était changé dans sa forme humaine. On objectera vainement, ce que, d’après les Grecs et la Vulgate, ce même Nabuchodonosor dit de lui au chapitre 4, verset 33 (qui pour d’autres est le verset 36) : « ma fi gure m’est revenue, comme elle était avant d’être changée ». Car dans le texte authentique, on n’a
31 Allusion à un vers de Pindare : « l’homme est le rêve d’une ombre ».
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:21Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:21 29/10/15 23:19:1529/10/15 23:19:15
22 Pierre AGERON
pas « ma fi gure », mais zini, c’est-à-dire « ma splendeur ». Dans Jachiades32, ces mots sont expliqués par « la splendeur et la lumière de mon visage ». C’est pourquoi les rabbins veulent que le mois qui est pour partie en avril, pour partie en mai s’appelle en hébreu zin (1er livre des Rois, chap. 6, verset 21) : « parce que les arbres resplendissent au cours de ce mois ». Et Fuller33, parce qu’on dit que la splendeur de la lumière du jour commence à être magnifi que et éclatante, le Soleil montant alors plus haut.
8. J’avoue que dans la Vie de Daniel, l’une des œuvres d’Épiphane, on a au sujet du roi Nabuchodonosor : « il est devenu animal et bête de somme ». Et aussi : « ses par-ties antérieures avec sa tête étaient comme celles d’un bœuf, ses pieds avec ses parties postérieures comme ceux d’un lion ». Le Synopse de Dorothée contient quelque chose qui n’est pas très différent : « Ses membres antérieurs avec sa tête étaient semblables à un bœuf, ses pieds avec ses membres postérieurs renvoyaient à un lion » – ce qui en soi est déjà prodigieux. Cependant, dans les Réponses aux orthodoxes du martyr Justin, en réponse à la question 44, on lit quelque chose de beaucoup plus extraordinaire : Nabuchodonosor ne s’est-il pas montré à Ézéchiel à travers un animal quadriforme, ayant des similarités avec un homme, un lion, un bœuf et un aigle et dans lequel ces quatre animaux étaient réunis ? Car le prophète Daniel a écrit là-dessus : « ses griffes avaient poussé comme celles d’un aigle, ses cheveux comme ceux d’un lion, il broutait du foin comme un veau et un cœur d’homme lui avait été donné ». Mais j’ai beaucoup d’éléments à rapporter, qui se cachent vainement, au premier abord, sous les grands noms d’Épiphane, de Dorothée et de Justin martyr, alors que personne n’a jamais rien lu de ce qu’on y cite de la part du vrai Épiphane, du vrai Dorothée et du vrai martyr Justin. En réalité, il est déjà bien connu que ces trois écrits sont faux, complètement hyperbo-liques, remplis de balivernes et d’inepties au nombre desquelles il est juste de censurer ce qu’ils rapportent sur Nabuchodonosor. Car quoi de plus inepte que de fabriquer un seul animal par assemblage d’un lion avec un bœuf, ou d’un homme et d’un aigle avec un bœuf et un lion ? Une fois ceci donné et concédé, pourquoi n’admettrions-nous pas aussi que les Centaures aient eu une double nature, que la chimère soit un monstre tri-forme, que l’hippotraguélaphe (cheval-bouc-cerf) et les hippalectryons (chevaux-coqs) aient vraiment existé, ainsi que les gryphes, au bec d’aigle, au corps d’homme et aux pieds de lion, et tout ce que dans l’histoire grecque, un menteur aura pu forger ? Mieux : au roi Hérilus, « sa mère Feronia avait donné, chose effroyable à dire, trois âmes »34. Ainsi, de là, il faut plusieurs âmes à des monstres de ce genre, s’il est vrai, comme les philosophes le soutiennent, que l’âme se fabrique un corps. Car si Nabuchodonosor n’avait ni l’âme d’un bœuf, ni l’âme d’un lion, a-t-il pu composer un corps à partir des deux ? Ou bien : si son corps était pléraprosope (à plusieurs personnes), comme se plaît à le dire le Pseudo-Justin, il est nécessaire que son âme aussi ait été pléramor-phe (à plusieurs formes) et ait eu de multiples asystata (incohérences), par exemple la douceur du bœuf avec la férocité du lion, et l’inclination et la propeteia (promptitude) des aigles à voler avec la nature marchante des animaux terrestres. Et ce n’est pas ce qui nous est appris par l’Écriture. Car j’ai enseigné dans mon ouvrage sur les Animaux (livre 3, chap. 6) qu’il faut entendre la vision d’Ezéchiel tout à fait autrement. Il est vrai que dans la version de Théodotion35, on lit en Daniel 4. 30, au sujet de Nabucadnetsar : « Ses cheveux poussèrent comme [la crinière] des lions ». Et il est vrai que beaucoup d’Anciens l’ont suivi. Cependant, dans le texte sacré, il y a « comme des aigles », et
32 Jachiades est un rabbin portugais (1494-1539). Son commentaire sur Daniel a été édité et traduit par Constantin l’Empereur : Paraphrasis Josephi Iachiadæ in Danielem, cum versione et annotationibus Constantini L’Empereur ab Oppyck, Amsterdam, 1633.
33 Nicolas Fuller (m. 1626), hébraïsant anglais.34 Selon Virgile, Énéide, livre 8.35 Traducteur de l’Ancien Testament en grec au IIe siècle après J.-C.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:22Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:22 29/10/15 23:19:1529/10/15 23:19:15
Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux lousps-garous 23
il n’est même pas question de lions. Il n’est pas douteux que Théodotion avait écrit « comme des aigles », mais cela a été transformé en « comme des lions » par des semi-savants, qui ont pensé qu’on ne pouvait pas accorder de cheveux à des aigles, ce que nous avons abondamment réfuté dans le traité sur les aigles36*. Bien plus, si ce mot avait signifi é lion, alors il n’y aurait pas eu d’aigles : car un même mot ne peut pas désigner l’un et l’autre animal. En outre, on ne trouve nulle part dans l’Écriture ce que rapporte le Pseudo-Justin, « un cœur d’homme lui a été donné », mais exactement le contraire : « son cœur humain sera échangé, et il lui sera donné un cœur de bête ». Pourquoi se-rait-il dit que Dieu lui a donné le cœur d’un homme, qu’il avait déjà par nature ? Et même si on considérait comme donné, sans que ce soit concédé, que cet auteur ait cité fi dèlement les paroles de l’Écriture, il ne s’ensuivrait pas que Nabuchodonosor ait été un animal quadriforme. Car si un homme broute de l’herbe comme un bœuf – ce qui est aussi raconté par Héraclite, comme nous l’avons observé plus haut –, s’il est velu comme les lions, ou s’il néglige de se couper les ongles de sorte qu’ils poussent comme les griffes d’un aigle, il ne s’ensuit pas qu’il ait été transformé en ces trois animaux, dont les fi gures sont inconsistantes, tant entre elles qu’avec la forme humaine.
9. Il est d’abord à noter qu’aucun historien n’a apporté son suffrage à cette fi ction37*. Borosus et, après lui, Alexandre Polyhistor, disent seulement que Nabuchodonosor est tombé « dans la maladie ». Et tant chez Mégasthène que dans Abydène l’Assyrien, on lit qu’après avoir prédit la ruine des Chaldéens, « aussitôt, il disparut de l’oracle » (de la vue des hommes). Joseph (Antiquités, livre 10, chap. 11) raconte son rêve, par lequel il lui a été signifi é que, privé de sa couronne, il passerait sept années parmi les bêtes, et que ce n’est qu’après en avoir terminé qu’il serait rétabli dans son pouvoir passé. C’est pourquoi il passa le temps prescrit dans la solitude, puis après son achèvement et Dieu s’étant laissé fl échir, il retrouva sa couronne. Ce qu’a suivi Sulpice Sévère dans le livre 2 de son Histoire sacrée, où il dit : « On rapporte qu’il accomplissait sa punition, ayant abandonné la puissance de sa couronne, étant éloigné de toute conversation humaine, ne se nourissant que d’herbes, mais son pouvoir lui étant maintenu par la volonté de Dieu, jusqu’à ce que le temps accompli, reconnu par Dieu, il soit rendu et à sa couronne et à son état antérieur ». Et il y a environ cinq cents ans, l’auteur de l’Historia scholas-tica, Pierre le Mangeur38, après avoir cité les paroles de Daniel, dit : « Il apparaît de ceci, comme en atteste Épiphane, qu’il a souffert non d’une mutation du corps, mais d’une aliénation de l’esprit, que l’usage de la langue pour parler lui a été ôté, et que l’herbe qui lui a été donnée est une nourriture d’une nature humaine ». Nous pourrions leur ajouter de vrais Pères de l’Église. Dans le Commentaire sur Daniel de Jérôme se trouvent ces paroles : « Lorsqu’il (Nabuchodonozor) a dit que sa faculté de penser lui était revenue, il a voulu dire qu’il n’avait pas perdu sa forme, mais son esprit ». Théodoret observe aussi, concernant la même histoire, qu’il a seulement été fait semblable à une bête en ce que Dieu lui a enlevé « la raison humaine ». Et Sedulius sur le même sujet, dans son Ouvrage pascal, livre 1, chap. 17 : « Il a vécu dans les forêts à la façon d’une bête sauvage, et, en compagnie des autres bêtes, a échangé les délices des repas de la cour pour une nourriture faite de foin et une boisson d’eau de rivière, lui qu’on a vu pendant sept ans parcourir en tous sens les forêts et les montagnes, hirsute et hideux à voir ». On ne trouverait pas dans ces mots ce que l’éditeur François Juret a ajouté en marge, à savoir que « le roi Nabuchodonosor a été changé en bœuf ». On ne le trouverait pas
36 * Livre des animaux [Hierozoicon], tome 2, livre 2, chap. 1, p. 166.37 * Voyez les Chroniques d’Eusèbe publiées en grec par Scaliger, p. 49, sa Préparation
évangélique, livre 10. p. 267 et 268, et Josèphe, Contre Apion, livre 1, p. 1045.38 Petrus Comestor (XIIe siècle). Son Historia scholastica est un abrégé commenté de la
Bible en latin.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:23Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:23 29/10/15 23:19:1529/10/15 23:19:15
24 Pierre AGERON
non plus dans la Récapitulation des miracles, chap. 19, où il y a seulement ceci : « dans des pâturages broussailleux, le roi vagabond a été fait le convive des bêtes sauvages et domestiques ». Ce qui est aussi écrit dans ce poème au livre 1 : per pascua Regem / Pavit ut hirsutam pecudem (tel un animal hirsute, le roi a brouté dans les pâturages). Qu’Augustin ait été du même sentiment apparaît clairement dans la Cité de Dieu (livre 18, chap. 16, 17 & 18), où il traite de la métamorphose d’hommes en d’autres animaux. Il n’omet pas les anciennes histoires ou même les fables : les oiseaux de Diomède, les compagnons d’Ulysse transformés par Circé en différentes bêtes sauvages, la biche d’Iphigénie, les Arcadiens changés en loups. Il en raconte aussi de nouvelles : l’âne d’Apulée, le père de Præstantius qui, changé en cheval, croyait porter sur son dos les provisions pour les soldats, et ces femmes aubergistes italiennes qui changeaient les voyageurs en chevaux après qu’ils aient mangé du fromage. Cependant, il n’est pas de métamorphose plus illustre que celle de Nabuchodonosor, non pas que [quelques mots illisibles] il se soit cru être un monstre biforme ou quadriforme [quelques mots illisibles]. Les Juifs aussi, par ailleurs très enclins aux fables, ne le comprennent pas différemment. Aben-Ezra écrit, au sujet de Daniel4 : « Ne laisse pas monter dans ton cœur que Nebucadnetsar ait été changé en bête, soit mâle, soit femelle, parce que la seule chose qui ait été écrite, c’est qu’il habiterait avec les bêtes et mangerait de l’herbe comme elles. [Illisible] cœur de bête veut dire que la faculté de penser se retirerait de lui, c’est-à-dire que, son esprit rationnel lui ayant été enlevé, son cœur changera et de-meurera celui d’une bête ». Et Saadia Gaon : « Ne dis pas qu’il a été changé en âne ou en onagre ; bien plutôt, il a été abruti et s’est engourdi comme une bête. Et à cause de sa crasse, de sa sueur et de ses excréments, ses poils ont poussé et des plumes d’aigle, et ses ongles sont devenus comme les griffes d’une orfraie ou d’un mélanète, oiseaux qui déchiquètent en piétinant avec leurs griffes ». Et Jachiades dans sa Paraphrase39 : « son intelligence humaine s’en est allée et est devenue comme celle d’un âne sauvage, il a désiré se nourrir comme les bêtes et cohabiter avec elles ». Il en résulte que le chan-gement s’est fait par mentalement et seulement dans son âme et non dans son corps. J’allais oublier ce que Aben-Ezra ajoute à ce que j’ai cité plus haut, et que lui a raconté un certain homme digne de confi ance : en Sardaigne, une vierge, ayant conçu le rêve délirant d’espérer fuir la maison paternelle, erra de nombreuses années à quatre pattes avec les biches, jusqu’à ce que tombée sur des chasseurs, reconnue par ses parents et appelée amicalement, elle ne comprit pas ce qu’on lui disait, ne répondit rien, et refusa tout à fait et avec répugnance de manger quelque chose et de boire du vin, brouta seule-ment de l’herbe ; elle s’évada au milieu de la nuit et se réfugia une nouvelle fois parmi les biches des campagnes. En voilà assez sur Nabuchodonosor.
10. Semblent aussi être affectés de lycanthropie ceux dont les Évangélistes parlent en disant qu’ils n’habitaient pas dans des maisons, mais dans des cimetières, et mani-festaient de l’hostilité à ceux qu’ils rencontraient (Matthieu 8. 28, Marc 5. 2, Luc 8. 26). De tels individus sont en effet des lycanthropes, ainsi que nous l’avons fait voir plus haut à partir des Grecs et d’Avicenne. C’est pourquoi les commentateurs, tant anciens que récents, se fatiguent en vain à rechercher les causes pour lequelles un démon les aurait entraînés ou retenus dans des cimetières. Car ce n’était pas tant l’effet d’un dé-mon que de la lycanthropie. Ainsi, parmi les démoniaques que Christ a libérés, certains étaient en outre lunatiques et épileptiques, comme celui dont le père dit à Christ, avant de se jeter à ses genoux : « Seigneur, aie pitié de mon fi ls, parce qu’il est lunatique et très atteint : parfois il tombe dans le feu, parfois dans l’eau ». Ce sont les symptômes
39 Paraphrasis Josephi Iachiadæ in Danielem, cum versione et annotationibus Constantini L’Empereur ab Oppyck, Amsterdam, 1633.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:24Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:24 29/10/15 23:19:1529/10/15 23:19:15
Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux lousps-garous 25
de l’épilepsie. Mais les versets suivants40 enseignent que le même homme était possédé par le Diable : « le démon sortit de lui » (verset 18) ; « on ne fait sortir cette espèce [de démons] que par la prière et par le jeûne » (verset 21). C’est pourquoi, de même que cet homme était à la fois démoniaque, lunatique et épileptique, de même ceux qui abandonnaient les maisons pour ne passer leur temps que dans les cimetières étaient non seulement démoniaques, mais aussi lycanthropes. En quoi ils étaient malades, de sorte qu’ils étaient plus exposés aux attaques des démons : l’acuité de leur esprit, par laquelle nous résistons au Diable, était émoussée et affaiblie. On pense ainsi que le roi Saül était fortement mélancolique, et avait par là laissé champ libre à l’esprit mauvais qui l’envahissait. David devait alors le ranimer et le détendre par le son de sa cithare, ce dont nous traitons davantage dans l’ouvrage sur les animaux (livre 2, chap. 44, voyez p. 461 etc.)
11. Il nous faut maintenant dire pourquoi les Arabes appellent ce genre de mélanco-lie alkutrub ou alkotrob. Avicenne répond en disant que celui qui souffre de cette ma-ladie se dérobe de manière désordonnée, marche de façon erratique, ne sait pas où ses pas le portent, etc. – à la manière de la bestiole appelée alkotrob qui naît à la surface de l’eau et dont les mouvements sont erratiques et désordonnés : en effet, tantôt elle plonge et se dérobe, tantôt elle émerge à nouveau. Il y a d’ailleurs un autre petit animal de ce nom qui ne trouve jamais le repos : le vampire (strige, lampie) mâle. C’est aussi le cas du loup pelé, mais les deux étymologies précédentes conviennent mieux à cet endroit. Voilà tout ce que dit Avicenne, qui avec les lexicographes, a fait de ce kutrub deux espè-ces parmi les petits animaux. Mais Damir, dans son livre sur les animaux n’en a reconnu qu’une, qu’il s’est contenté de nommer sans la décrire. Il l’a seulement placée dans le genre des oiseaux, mais par ce mot pris dans son sens arabe, on entend aussi les insectes volants. Et il affi rme qu’il erre çà et là toute la nuit, sans sommeil. Ses mots exacts sont : « alkotrob est un oiseau ou insecte volant qui erre toute la nuit et ne dort pas ». Parmi les expressions proverbiales des Arabes, il cite « plus vagabond qu’un kotrob » et de même « plus vigilant qu’un kotrob », et rappelle qu’on a gardé mémoire d’un homme appelé Alkotrob parce qu’il était très attentif. Le même est d’avis que Alkotrob appar-tient à l’espèce des démons étant donné qu’il est le mâle des sahali, c’est-à-dire des lamies ou des striges, ce qu’il tient de Ibno Saïda. Mais l’imam Mahomet Ben Daphar a écrit qu’en Thébaïde d’Égypte, l’alkotrob est un animal qui apparaît aux hommes lorsqu’ils sont seuls. Les plus hardis le repoussent. Il importune les autres, ne les quitte pas, jusqu’à ce qu’il les provoque au coït qui les conduit à la mort. Je passe sur d’autres choses qui sont magiques et choquantes. Là aussi, alkutrub est la souris, et le loup pelé, et une espèce de mélancolie, comme dans Avicenne.
12. Pour dire maintenant la chose comme elle est, ces étymologies ne me plaisent pas, parce que alkotrob est un animal grégaire, appelé en latin tipula ou tipulla (arai-gnée d’eau), alors que rien n’est plus caractéristique des lycanthropes ou cynanthropes que l’amour de la solitude. Ainsi ils passent leur temps dans les cimetières, et, comme l’a dit Avicenne, ils fuient les vivants et ne fréquentent que les morts. Mais kotrob se déduit de lycanthropia par aphérèse, ou de cynanthropia par syncope. De ces deux étymologies, la première me semble à coup sûr plus vraisemblable, parce que le mot lycanthropie est d’usage plus fréquent. Les exemples de semblables aphérèses ne man-quent pas. Ainsi les Grecs appellent le port limena, mais les Arabes seulement mina par aphérèse de la première syllabe. Le navire Liburna ou Liburnica est appelé en chaldéen burni. Le fait que le B fi nal de kotrob devienne dans lycanthrope un P, ou un en grec,
40 Ces versets sont tirés de Matthieu XVII. Le verset 21 est absent des éditions modernes, car il semble avoir été extrait de Marc IX.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:25Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:25 29/10/15 23:19:1529/10/15 23:19:15
26 Pierre AGERON
n’arrêtera personne. En effet, les Arabes ne rendent pas le grec autrement que par un B, ou par un φ, parce qu’il leur manque la lettre P. Par conséquent, Petrus (Pierre) est pour eux Betruso et Paulus (Paul) Bauluso.
13. J’ajoutera i en corollaire que les lycanthropes sont appelés en français louga-roux, ou louvaroux comme le disent les paysans de chez nous, en quelque sorte loups varous, c’est-à-dire diabatas ou « traverseurs ». C’est parce qu’on croit que ceux qui traversent les fl euves à la nage sont transformés en loups, ce qu’ont démontré Pline à partir d’Evanthes et Augustin à partir de Varron – voir plus haut. En effet varare veut dire traverser, et varatio une traversée. De là vient qu’à ceux qui vont de Caen à Rouen se présente après quatre lieues le village dit Varaville, venant de traversée, dans lequel les voyageurs doivent traverser les eaux de la Dive en bateau. En allemand, la traversée d’un fl euve se dit Faar ou Fahr, et en fl amand Waer. En français, s’égarer est à propre-ment parler « s’ex-varer » exvarari, c’est-à-dire s’écarter de l’endroit d’un fl euve qui est approprié à sa traversée ; de là, il a été transféré à n’importe quelle situation où l’on s’éloigne des chemins. Ceci a été vu en partie par le très savant Saumaise. Dans son Solin, p. 946 D41, celui-ci cite en effet plusieurs endroits d’auteurs de la périphérie de la latinité dans lesquels varare signifi e traverser un fl euve, varatio traversée d’un fl euve, et varæ des petits ponts faits de planches par lesquels on peut traverser les lits des riviè-res42. Mais par la suite, comme si sa vue se troublait, il se fourvoie : « Du verbe varare, dit-il, nous avons fait guarare, c’est-à-dire fuir, et, en fuyant, être sur ses gardes ; de là, nous appelons “évarés’’ ou “ex-garés’’ ceux qui se sont écartés du droit chemin, et les loups “guareurs’’ ou garous, ceux qui fuient la compagnie des autres loups et que les Grecs ont appelés chasseurs solitaires, animaux solitaires ou monolyces (loups solitai-res) ». Par ces paroles, il a commis plusieurs confusions. En effet, quand les hommes du peuple crient gâre, gâre, c’est le mot contracté de garde, garde, c’est-à-dire attention, attention – c’est pourquoi je l’expose en premier. Garde est formé à partir du germani-que warden : il n’a rien de commun avec la traversée des eaux, que traversent souvent ceux qui sont pourchassés et qui fuient. Inversement, s’égarer n’est pas se garder, mais se tromper de chemin, ce qui est complètement différent. Les loups garous ne sont pas non plus ceux qu’en grec, on appelle chasseurs ou loups solitaires parce qu’ils fuient la compagnie des autres loups. En effet, Evanthes cité par Pline enseigne qu’« ils s’assem-blaient avec d’autres de la même espèce ». Et Varron, cité par Augustin, qu’ils vivaient avec des bêtes semblables dans les déserts. Et Olaus Magnus : « à Noël ils se rassem-blent très nombreux en un endroit déterminé ». C’est pourquoi un nom dérivé de la solitude ne leur aurait pas convenu, et c’est parce qu’il n’aurait pas convenu qu’ils ont été appelés varous. Varou en effet ne signifi e pas solitaire, mais « traverseur ». D’autres veulent que le loup varou soit en quelque façon varié ou tacheté, pour une raison qui m’est tout à fait obscure. D’autres que garoux soit une contraction de garés voux ou gardez-vous, c’est-à-dire « prenez garde à vous », sous prétexte que c’est un animal terrible. D’autres qu’il vient du nom germanique de ce loup, Wederwolf, c’est-à-dire « loup renouvelé », parce que, disent-ils, c’est un loup par intervalles et afi n de le distin-guer du loup brut perpétuel. C’est le cas d’Ortelius dans son Thesaurus Geographicus, à l’article sur les Neuriens. Mais je pense que notre première explication est la vraie.
41 Claudii Salmasii Plinianæ exercitationes in Caii Julii Solini Polyhistora, Paris, 1629, vol. 2, p. 946 D.
42 Bochart écrit en note dans la version II : chez Vitruve.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:26Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:26 29/10/15 23:19:1529/10/15 23:19:15
CANDIDATURES À L’ACADÉMIE
Par M. Gérard-Guy MOUCHEL
(Séance privée du 11 janvier 2014)
Candidats à l’Académie (titulaires et correspondants)
La Commission administrative s’est réunie le 8 décembre 2013 et le 6 jan-vier 2014. Elle a examiné les candidatures que je présente aujourd’hui en les retenant à l’unanimité.
Elle vous propose de promouvoir les Membres correspondants associés en les titularisant comme Membres titulaires. Seuls les Membres titulaires ici pré-sents et ceux qui ont une procuration pourront ratifi er ces propositions :
- M. Eric Eydoux, domicilié à Caen ; élu en 2008 (candidature présentée par MM. Jean-Marie Lepargneur et Guy Pelletier).
- M. Jean–François Robert, domicilié à Paris ; élu en 2010 (candidature pré-sentée par MM. Jean-Marie Lepargneur et Claude Roche).
- Mme Nicole Vray ; domiciliée à Nantes ; élue en 2009 (candidature présentée par MM. Bernard Gourbin et Lucien Jerphagnon).
- M. Jean-François Wantz, domicilié à Basseneville , 14 ; élu en 2009 (candi-dature présentée par MM. Jean Laspougeas et Jean-Marie Leopargneur )
Élection comme Membres associés correspondants : M. Laurent Bellamy et M. Geoffrey Mahy.
Monsieur Laurent Bellamy
Ingénieur projets et formateurs dans l’espace européen. Né à Lisieux en 1953 ; demeurant à Caen (Calvados), (candidature présentée par MM. René Parisse et Jacques Legendre).
Bachelier scientifi que à Caen en 1971, M. Bellamy a suivi trois années pré-paratoires à Versailles avant d’obtenir un Master of Business administration en 1976 à l’EDHEC du Nord. Sa carrière professionnelle le fait, de 1978 à 1984 Responsable marketing à Europ Assistance (Europe et Amérique), puis Directeur commercial au Plan gestion de l’Epargne salariale, avant d’être Directeur régio-nal du groupe Ionis (Institutions de retraite, de prévoyance et société de gestion d’épargne salariale) en Île de France et dans le Pas-de-Calais de 1990 à 1997.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:27Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:27 29/10/15 23:19:1629/10/15 23:19:16
28
Il est ensuite Directeur Europe pour l’activité assurance-vie et fonds de pension à la Société générale où il crée la structure européenne. De 2005 à 2013, il est Ingénieur projets et formateur dans neuf écoles de management.
Son parcours scolaire et universitaire lui fait pratiquer le latin, le grec, l’al-lemand, le russe, l’italien, l’espagnol, l’arabe, le chinois, le japonais et l’hé-breu. À Caen, en 2010-2011 il obtient un diplôme en dialogue interreligieux au Centre d’Etudes théologiques. Actuellement il fait des travaux de recherche sur le fonds commun lexical des institutions indo-européennes et il est membre actif de l’Association caennaise pour la connaissance de l’Allemagne. Sa lettre de candidature évoque la politique, l’histoire des nombres, la philosophie anti-que, les racines indo-européennes, la programmation neuro-linguistique, avant qu’il offre ses services pour contribuer aux travaux de notre académie.
La Commission administrative du 2 décembre 2013 a retenu cette candida-ture à l’unanimité.
Monsieur Geoffrey Mahy
Assistant de droit à Guernesey. Né au Pays de Galles en 1944 (candidature présentée par MM. Jean-Jacques Bertaux et Claude Roche).
Revenu à Guernesey à la fi n de la seconde guerre mondiale, M. Mahy fi nit ses études en Grande Bretagne, avant de rejoindre, pendant ses études univer-sitaires, l’Ecole normale d’Auteuil et l’Institut britannique de Paris.
Se destinant à une carrière d’enseignant, il est assistant d’anglais à Saint-Nazaire, puis de 1966 à 1985 comme enseignant de français à Guernesey et en Angleterre. Il poursuit des stages en France, au lycée Louis Liard à Falaise, puis à Saint-Genix sur Guiers en Savoie. À Falaise ses enfants suivaient l’en-seignement traditionnel français.
Revenu à Guernesey, sa carrière s’est diversifi ée puisqu’il s’est tourné vers le droit, et il travaille actuellement dans des cabinets d’avocat où il intervient comme un notaire le fait en France.
Il a été élu en 1989 Président du Cercle français de Guernesey, poste qu’il occupe toujours. Cette association fait partie du réseau global d’alliances fran-çaises. Dans sa lettre de candidature, il rappelle avec plaisir qu’il a reçu pour des conférences universitaires les Académiciens Pierre Bouet, René Lepelley, Gérard Mouchel et François Neveux. Il a envoyé le programme de ses activités pour le dernier trimestre 2013.
En 1992, il est chevalier dans l’ordre des palmes académiques, et il parti-cipe aux assemblées générales de l’AMOPA à Londres.
La Commission administrative du 6 janvier 2014 a retenu cette candidature à l’unanimité, rappelant que les îles anglo-normandes ont souvent été repré-sentées chez nous, avec dernièrement feu M. Jacques Maingard.
Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:28Me ́moires 2015 de ́but.indd Sec1:28 29/10/15 23:19:1629/10/15 23:19:16




































![[Myth or reality? Man-eating wolves], « Mythe ou réalité ? Les loups mangeurs d’hommes », L’Histoire, 299, june 2005, p. 64-69.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633179aff0080405510402ae/myth-or-reality-man-eating-wolves-mythe-ou-realite-les-loups-mangeurs.jpg)