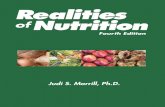[Real time epidemiological surveillance within the armed forces: concepts, realities and prospects...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of [Real time epidemiological surveillance within the armed forces: concepts, realities and prospects...
Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
e Publique 56 (2008) 11–20
Revue d’Epidemiologie et de SantArticle original
Surveillance epidemiologique en temps reel dans les armees ;
concepts, realites et perspectives en France
Real time epidemiological surveillance within the armed forces;
concepts, realities and prospects in France
J.-B. Meynard a,*, H. Chaudet b, G. Texier c, B. Queyriaux c, X. Deparis d, J.-P. Boutin c
a Unite d’epidemiologie, institut Pasteur de la Guyane, 23, avenue Pasteur, B.P. 6010, 97306 Cayenne, Guyaneb Laboratoire d’informatique fondamentale, universite de la Mediterranee, 13385 Marseille, France
c Departement d’epidemiologie et de sante publique, institut de medecine tropicale du service de sante des armees, 13998 Marseille, Franced Departement d’epidemiologie et de sante publique, ecole du Val-de-Grace, 75230 Paris, France
Recu le 31 juillet 2007 ; accepte le 20 novembre 2007
Disponible sur Internet le 20 fevrier 2008
Abstract
Background. – In 2002, the North Atlantic Treaty Organization took five initiatives in order to enhance the defence capacities against the
massive destruction weapons, one of them concerned the development of an interoperable surveillance system, giving in real time some
informations permitting early warning to the commanders. Thoughts in France to improve the military surveillance system, methodological
constraints and first results are shown.
Methods. – Medical, technological, human and organisational aspects had to be taken into account to develop real time surveillance within the
armed forces, and also specific military constraints. In order to evaluate the validity of its methodology, the ‘‘Institut de medecine tropicale du
service de sante des armees’’ developed a prototype, set up in French Guyana and which took part in a second time at a multinational exercise.
Results. – The ‘‘surveillance spatiale des epidemies au sein des forces armees de Guyane’’ has been set up in 2004, formed by both a recording
and an analysis networks. This system permits to provide in real time some dashboards directly operational for the commanders. The
exhaustiveness rate has been evaluated at 104%, compared to the traditional surveillance. It permitted three times to detect outbreaks several
weeks before the other systems. Some limits have been identified, as the use of personal digitalized assistants. The involvment in a multinational
exercise showed the system’s efficacy, by detecting two simulated outbreaks, but also its interoperability. In 2006, it has been decided to extend the
concept by deploying its second generation within the French armed forces in Djibouti. The ‘‘alerte et surveillance en temps reel’’ disposal
permitted to take into account multiple geographical localizations.
Conclusion. – A real time surveillance system is an essential alarm disposal, however it is only an information tool within the complex activity
of piloting the sanitary situation. It must be integrated within the whole situation expertise supports, represented also by medical intelligence,
epidemiological investigations and prediction of the epidemiological phenomenon evolution.
# 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits reserves.
Resume
Position du probleme. – En 2002, l’Organisation du Traite de l’Atlantique Nord a pris cinq initiatives pour renforcer les capacites de defense
contre les armes de destruction massive, dont l’une concernait le developpement d’un systeme de surveillance interoperable entre nations,
apportant au commandement des informations en temps reel permettant de declencher des alertes precoces. La reflexion faite en France pour
optimiser le systeme de surveillance militaire, les contraintes methodologiques ainsi que les premiers resultats sont presentes.
Methodes. – Developper la surveillance en temps reel au sein des armees necessitait de prendre en compte des aspects medicaux,
technologiques, humains et organisationnels, mais egalement des contraintes specifiquement militaires. Pour evaluer la validite de sa methode,
* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (J.B. Meynard).
0398-7620/$ – see front matter # 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits reserves.
doi:10.1016/j.respe.2007.11.003
J.-B. Meynard et al. / Revue d’Epidemiologie et de Sante Publique 56 (2008) 11–2012
le service de sante des armees a fait realiser un demonstrateur par l’Institut de medecine tropicale du service de sante des armees, mis en œuvre en
Guyane. Il a ensuite ete deploye lors d’un exercice multinational.
Resultats. – La « surveillance spatiale des epidemies au sein des forces armees de Guyane » a ete mise en place en 2004, constituee d’un reseau
de recueil et d’un reseau d’analyse. Ce systeme permet la production automatisee en temps reel de tableaux de bord directement operationnels pour
le commandement. Le taux d’exhaustivite par rapport a la surveillance traditionnelle a ete estime a 104 %. Il a permis a trois reprises d’identifier
des epidemies avec plusieurs semaines d’avance sur les autres systemes. Des limites ont ete identifiees, comme l’utilisation des assistants
personnels digitalises. La participation a un exercice multinational a montre l’efficacite du systeme en detectant deux epidemies simulees, mais
aussi son interoperabilite. Fin 2006, il a ete decide d’etendre le concept en deployant une seconde generation au sein des forces francaises a
Djibouti. La prise en compte multitheatres a ete effectuee grace au dispositif d’« alerte et surveillance en temps reel ».
Conclusion. – Un systeme de surveillance en temps reel est un systeme d’alerte essentiel, qui n’est cependant qu’un instrument d’information
dans l’activite complexe de pilotage de la situation sanitaire. Il doit entrer dans un ensemble de supports d’expertise de la situation, constitue
egalement par la veille sanitaire, l’investigation epidemiologique et la prevision de l’evolution des phenomenes epidemiologiques.
# 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits reserves.
Keywords: Real time surveillance; Early warning; Armed Forces; Interoperability
Mots cles : Surveillance en temps reel ; Alerte precoce ; Forces armees ; Interoperabilite
1. Introduction
Les Services de sante militaires doivent connaıtre en continu
la situation sanitaire de chaque combattant. C’est le principe de
la surveillance epidemiologique. Le Service de sante des
armees (SSA) francais realise depuis trois decennies une
surveillance selective sur les maladies (65 maladies surveillees)
mais exhaustive sur toutes ses formations sanitaires. Les
donnees collectees par les medecins a chaque consultation sont
transmises aux departements d’epidemiologie une fois par
semaine [1], l’exploitation en est manuelle, l’analyse partiel-
lement automatisee. Lorsque l’analyse revele une anomalie, il
s’est ecoule au moins deux semaines depuis l’apparition des
premiers signes. Ce delai est incompatible avec les besoins des
combattants et du commandement, les risques d’agressions
biologiques et la rapidite necessaire aux investigations. Pour
ces raisons, un nouveau systeme plus reactif est necessaire.
L’enchaınement des evenements qui diagnostiquent une
situation anormale est complexe et long. Entre l’instant ou un
sujet est expose a un pathogene et celui ou une intervention de
sante publique est lancee, huit etapes doivent etre franchies
(incubation, delai de consultation, temps d’examen, synthese
des donnees, declaration, analyse des donnees, production de
l’alerte, decision d’investigation). A chacune, des choix et des
besoins peuvent etre bloquant ou retardant [2]. Diminuer le
temps d’acces a l’information pendant les etapes precoces passe
par l’incitation a consulter tot et par la densification du reseau
medical. Diminuer ce temps d’acces entre l’examen clinique et
la declaration des donnees passe par l’enregistrement de
donnees cliniques plus simples (en particulier les symptomes)
ou de resultats de tests de diagnostic rapide effectues hors
laboratoires, ce qui represente les premieres etapes de la
surveillance syndromique. Il faut ensuite des reseaux de
telecommunications reliant tous les acteurs de sante des
theatres d’operations aux structures d’analyse des donnees. Ici
commence la surveillance en temps reel stricto sensu. Les
methodes d’analyses automatisees permettent alors d’accelerer
l’alerte. Cette alerte peut enfin engendrer des investigations
rapides, d’ou le besoin d’equipes prealertees.
La surveillance epidemiologique en temps reel consiste
donc en une strategie privilegiant la collecte de donnees
preliminaires (le plus souvent avant qu’un diagnostic formel
soit etabli), a les transferer immediatement, a les analyser
automatiquement et a fournir spontanement des tableaux de
bords sanitaires aux decideurs de tous niveaux. En 2002, les
dirigeants de l’OTAN ont pris cinq initiatives afin de renforcer
les capacites de defense contre les armes de destruction massive
[3]. L’une d’elle concernait le developpement d’un systeme de
surveillance interoperable entre nations et apportant au
commandement des informations en temps reel permettant
de declencher des alertes precoces. La reflexion faite en France,
les contraintes methodologiques ainsi que les premiers resultats
sont presentes.
2. Developpement du projet francais, reflexions et
contraintes methodologiques
La surveillance en temps reel ne vise qu’un des objectifs
traditionnels de la surveillance epidemiologique : alerter devant
une suspicion d’anomalie epidemiologique. Le concept de
surveillance syndromique est quant a lui restrictif et ambigu.
Restrictif, car la collecte d’un syndrome stricto sensu doit
reunir un ensemble d’informations deja elabore en amont du
diagnostic, faisant appel a un niveau de connaissance suppose
identique de tous les soignants sur le theatre et donc tardif dans
la chronologie de l’alerte [2], alors qu’il faut pouvoir collecter
de simples symptomes qui sont ensuite utilises pour construire
des syndromes connus ou construits de novo, generateurs
d’hypotheses. Restrictif encore, car il ne porte en lui aucune
notion de delai, de rapidite. Ambigu car sa definition n’est pas
fixe [3], certains auteurs preferant parler de systeme d’alerte
precoce, de surveillance des prodromes, de systeme de
detection des epidemies, de surveillance sentinelle, de
surveillance des indicateurs de sante, et plus justement de
surveillance des symptomes [4].
Globalement, il s’agit d’assurer une maıtrise de l’informa-
tion epidemiologique retrouvee dans le concept d’etat-major de
« commandement, conduite, communication, renseignement »
J.-B. Meynard et al. / Revue d’Epidemiologie et de Sante Publique 56 (2008) 11–20 13
(C3R) [5]. Cet objectif impose des contraintes inhabituelles
dans le domaine de la surveillance epidemiologique [6] parfois
specifiquement militaires. Ce sont ainsi :
� la
permanence operationnelle du dispositif de surveillance entout temps et tout lieu, l’ouverture sans delai de nouveaux
theatres d’operation ;
� la
precocite et la rapidite de l’acquisition, de la transmissionet du traitement de l’information ;
� la
double confidentialite (militaire et medicale) ;� la
capacite d’identifier les situations d’alerte ;� l’
exploitation de l’alerte ;� l’
information des destinataires ;� le
contexte interallie ;� l’
integration dans un systeme d’information medicale axe surle patient ;
� le
contexte d’une activite collaborative geographiquementdisseminee et multidisciplinaire.
Les solutions font appel aux technologies de l’information
et de la communication, a la sante publique, aux bioma-
thematiques, a la clinique, a la biologie et aux facteurs
humains.
La comparaison entre les systemes de surveillance
syndromique civils [7–10] et militaires [11] montre de
nombreuses differences fondamentales. La surveillance civile
est caracterisee par la participation de nombreuses institutions
medicales, qui utilisent differents systemes d’information et
couvrent des populations d’effectifs importants et assez stables.
Dans ce contexte, les « capteurs epidemiologiques » ont ete
etendus a la medecine liberale, aux services d’urgence, aux
hopitaux, aux laboratoires de biologie, qui ont leurs propres
systemes de recueil d’information. Cela conduit a utiliser pour
la surveillance epidemiologique des donnees deja recueillies
pour d’autres besoins, et engendre le risque d’utiliser de facon
erronee des donnees qui n’ont pas ete concues pour les besoins
de surveillance, pose le probleme des barrieres techniques,
organisationnelles et legales a la communication electronique
des informations dans un contexte de surveillance globale [12].
Ces barrieres expliquent le besoin de standards de description et
de construction des messages electroniques et necessite la mise
a disposition d’une infrastructure securisee de transmission
basee sur Internet [13,14].
Les armees allegent ces barrieres de transmissions car les
formations sanitaires appartiennent toutes a l’institution
militaire. Les principales difficultes de la surveillance militaire
resident dans les caracteristiques de la population surveillee :
� la
composition de la population est modifiee plusieurs fois paran, a chaque rotation de personnel en mission ;
� d
e nouveaux theatres d’operation peuvent etre ouverts, etceux existants peuvent etre modifies ;
� le
s partenaires de la surveillance sont dissemines dans lemonde entier et tres mobiles ;
� la
contrainte de permanence du service est plus forte ;� e
nfin la numerisation du champ de bataille a un impact sur laconception du traitement de l’information epidemiologique.
2.1. Aspects medicaux
La premiere contrainte est la precocite. L’analyse doit
concerner les premiers signaux, comme les symptomes
recueillis des que le combattant devient un patient, c’est-a-
dire des qu’il a un contact avec le Service de sante.
L’information n’est pas un diagnostic, mais un ensemble de
symptomes decrivant le tableau clinique initial. Cet ensemble
est rarement evocateur d’une seule maladie et plusieurs
alternatives doivent etre envisagees. Il s’agit donc de surveiller
des « evenements epidemiologiques », constitues d’un ou
plusieurs symptomes. La definition de ces evenements peut se
faire en utilisant la liste des definitions de syndromes publiee
par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [15]
ou sur la base des maladies d’interet militaire.
Ces evenements epidemiologiques sont analyses de facon
a donner une alarme. C’est un signal qui previent que les
parametres epidemiologiques de la population s’ecartent des
valeurs jugees normales. Elle previent de l’emergence d’une
symptomatologie dans une population, a un moment et dans
un lieu donnes. Elle doit ensuite faire l’objet d’un debat,
voire d’une enquete de pertinence afin de confirmer ou non
l’alerte. Cela pose les problemes de la validite du signal, de
son traitement et de la disponibilite prealable d’un signal
normal.
Trois situations d’alarme peuvent etre rencontrees. La
premiere signale des tableaux cliniques rencontres dans les
maladies rares, a haute letalite ou fort impact epidemiologique.
Ici, l’existence d’un seul cas doit etre a l’origine d’une alerte
(par exemple : la survenue d’un bubon febrile chez un
militaire). La seconde signale des syndromes attendus dans la
population dans un intervalle d’incidence habituel (par
exemple : icteres febriles). Cet intervalle est deduit des
donnees de reference, fonction du type de population, de la
saison et de la zone geographique. Deux difficultes sont
importantes : la construction des donnees de reference et
l’identification des anomalies du signal. La construction des
donnees de reference est relativement simple en population
civile, mais pas en milieu militaire du fait de la mobilite de la
population. Lors du deploiement sur un theatre nouveau pour
lequel les armees ne disposent pas de donnees epidemiologi-
ques militaires anterieures recentes, la difficulte est de
constituer un referentiel theorique pour chaque evenement.
Ce probleme est entierement nouveau. Il faut etablir une
methode specifique qui fera sans doute appel aux informations
provenant de la veille sanitaire [16]. La detection d’une
anomalie du signal epidemiologique revient a detecter une
« aberration spatiotemporelle ». Les travaux dans ce domaine
sont abondants. Il n’existe pas de specificite militaire sur ce
point. Les methodes basees sur l’analyse du signal se
repartissent en : analyse temporelle, regroupement spatial et
analyse spatiotemporelle [10,17]. La troisieme situation
d’alarme est celle de l’emergence d’une maladie qui par
definition n’est pas sous surveillance. Il s’agit alors d’avoir la
capacite d’analyser les donnees symptomatiques brutes, de
facon a identifier des regroupements spatiotemporels de
tableaux cliniques presentant des similitudes.
J.-B. Meynard et al. / Revue d’Epidemiologie et de Sante Publique 56 (2008) 11–2014
L’alarme lancee, il faut comprendre la situation epidemio-
logique, rattacher les syndromes aux maladies les plus
probables compte tenu des circonstances. Plusieurs alternatives
sont possibles et doivent etre traitees en concurrence. Suivant la
nature du risque et les conditions de survenue, l’investigation
peut s’appuyer sur des normes, comme l’ATP-45 de l’OTAN
[18]. Cette etape requiert des outils d’aide a la decision qui ne
sont pas encore disponibles et des capacites de representation
geographique [19,20].
2.2. Aspects technologiques
L’architecture de transmission et de traitement de l’informa-
tion doit permettre la flexibilite des capacites de traitement et la
continuite de service (redondance des capacites et possibilite de
proceder a des modifications de geometrie sans arreter le
systeme). L’integration dans un systeme C3R abandonne la
centralisation des systemes pour une architecture en reseau,
constituee d’elements de traitement et de sources de donnees
disperses mais relies par une infrastructure d’information. Cela
souleve des problemes d’integration de donnees heterogenes,
de la capacite des elements a dialoguer entre eux, de la
standardisation des donnees [21]. Dans ce cadre, l’acquisition
des donnees ne peut etre specifique a la seule surveillance. Elle
profite de l’existence de dossiers electroniques des patients
pour recuperer les informations pertinentes. Cela ne peut etre
fait qu’a condition d’inserer la fonction de surveillance
epidemiologique dans le cahier des charges du dossier
electronique afin d’etre sur que les items de surveillance sont
presents et de prevoir les standards de transmission des
informations.
Du point de vue de l’informatique, ces transmissions
d’informations sont considerees comme des messages, dont il
faut standardiser les differents constituants, ou couches. Par
analogie avec un resultat d’examen sanguin envoye par la poste,
ces standards de formats doivent etre definis pour l’enveloppe,
la lettre et la mesure biologique. C’est dire qu’il est necessaire
de definir l’enveloppe des messages (Simple Object Access
Protocol (SOAP) [22]), leur format [23,24], et leur contenu
[25]. Pour le format des messages, nous avons retenu le
standard ENV 13606 [26] pour des raisons de facilite de mise
en place.
Ces standards permettent la comprehension de la structure
d’un message, mais ils ne definissent pas l’interoperabilite de
son contenu, c’est-a-dire l’utilisation d’un langage commun
pour definir les termes medicaux qui sont transmis. Aucun
standard d’interoperabilite semantique n’a encore pu emerger
en medecine [13], ce qui explique leur diversite [27,28]. Notre
choix s’est porte sur l’utilisation d’une ontologie specifique-
ment concue pour representer les evenements epidemiologi-
ques [29], que nous avons completee [30].
Une telle structure permet de concevoir un systeme de
surveillance epidemiologique dans lequel chaque element du
reseau assure une fonction de traitement mise a disposition pour
les autres elements du reseau. Ainsi quatre types de services
informatiques sont necessaires pour ce genre de systeme de
surveillance :
� d
es capteurs epidemiologiques, qui mettent a disposition lesdonnees du dossier medical ;
� d
es dispositifs de traitement de l’information, qui assurent lestraitements statistiques, geographiques etc. necessaires pour
identifier l’alerte ;
� d
es clients utilisateurs qui permettent d’afficher les elementsde la surveillance et d’interagir avec le systeme ;
� d
es dispositifs d’integration qui mettent en commun lesdefinitions des standards utilisables par tous les composants
du reseau afin d’assurer l’interoperabilite de chacun.
En termes de debit de donnees, les besoins de la surveillance
en temps reel sont faibles car seules des donnees textuelles
transitent, et en faible quantite pour chaque cas declare. Il est
habituel en milieu civil de favoriser les infrastructures terrestres
de transmission (disponibilite, opportunite, faible cout). La
coexistence de ces moyens avec la necessite de confidentialite
est assuree par l’utilisation de moyens de securisation, tels que
le cryptage des donnees avec une cle de cryptage asymetrique
d’au moins 128 bits, l’authentification du correspondant et
l’echange des cles de cryptage par la norme X509, ou encore
l’utilisation d’un reseau virtuel prive (VPN). Dans le contexte
d’une operation exterieure et en l’absence d’une infrastructure
de transmission purement militaire, il est illusoire de compter
sur des moyens de transmission terrestres qui auront de grandes
chances d’etre indisponibles. La seule solution dans toutes les
conditions demeure la liaison par satellite, avec un debit
confortable pour la surveillance.
2.3. Aspects humains et organisationnels
La surveillance en temps reel applique le concept de
situation awareness (SA : savoir ce qui se passe pour savoir
quoi faire) [31]. L’ensemble des activites est partage entre
plusieurs collaborateurs, du medecin ou infirmier de l’avant,
jusqu’au responsable sante sur le theatre en passant par les
differents specialistes. La qualite de la SA est dependante des
facteurs humains, de l’infrastructure informatique et des
logiciels.
D’un point de vue organisationnel, la surveillance en temps
reel est un processus de pilotage d’un systeme dynamique [32].
Deux activites coexistent dans ce systeme global : une activite
autonome de prise en charge medicale des malades et une
activite de surveillance qui s’y greffe. Chacune est hautement
collaborative. Dans l’activite de soins, chacun renseigne le
dossier medical par les informations liees a sa pratique, et c’est
ce dossier qui est la source d’information pour la surveillance. Il
y a bien un reseau fonctionnel de circulation de l’information.
Le theatre d’operation est le cadre spatial de cette activite de
soins, justifiant un systeme d’information medicale du theatre.
La perception des modifications de la dynamique sanitaire
de la population est dependante de la qualite du couple
constitue du soignant (capteur) et du logiciel de saisie, posant le
probleme de l’ergonomie du dispositif d’acquisition. Comme
l’epidemiologie n’est pas un partenaire de la constitution du
dossier medical, ses capacites sont fortement dependantes de la
qualite des informations fournies dans les premiers instants de
J.-B. Meynard et al. / Revue d’Epidemiologie et de Sante Publique 56 (2008) 11–20 15
la prise en charge, en particulier des possibilites d’utilisation du
dossier medical dans le contexte operationnel et de son
ergonomie.
L’activite de surveillance est en aval du flux. La SA doit
percevoir les parametres epidemiologiques de la population
dans le volume de temps et d’espace correspondant a sa
capacite de pilotage. Le milieu militaire apporte une originalite
qui est la distribution de la population surveillee sur l’ensemble
des fuseaux horaires, induisant un etirement spatiotemporel
entre les capteurs et l’organe de surveillance metropolitaine.
Cette activite est aussi collaborative aux niveaux tactique,
operationnel et strategique. Ce sont des acteurs des niveaux
tactique et operationnel qui confirment ou non l’alerte. La
comprehension de l’alerte et son interpretation pour le futur
immediat sont un processus complexe, consistant en un
diagnostic de situation [33]. Celui-ci s’appuie sur un reseau
d’experts, et sur des sources complementaires comme la veille
sanitaire et environnementale [16]. D’un point de vue
organisationnel pour la « SA epidemiologique », cette
surveillance se structure donc comme un systeme d’informa-
tion epidemiologique qui sert a informer l’etat-major et aide au
choix des contre-mesures medicales.
Pour evaluer la validite de cette methode, le SSA a decide de
faire realiser un demonstrateur par l’institut de medecine
Fig. 1. Exemples de tableau de bord du reseau d’analyse du demonstra
tropicale du Service de sante des armees. Sa mise en œuvre a ete
realisee au sein des forces armees en Guyane (FAG). Le
demonstrateur a ensuite ete deploye lors d’un exercice de
l’OTAN (Munich, avril 2006).
3. Mise en œuvre sur le terrain, premiers
resultats et lecons
3.1. Architecture
La Surveillance spatiale des epidemies dans les forces
armees en Guyane (2SE FAG) a debute en octobre 2004. Le
systeme a ete deploye en deux reseaux, l’un consacre au recueil
des donnees et l’autre a leur analyse.
L’implantation du reseau de recueil en Guyane a necessite
une campagne d’equipement en materiel : assistants digitaux
personnels durcis (PDA), Global Positioning Systems (GPS),
terminaux Inmarsat (Mini-M1), serveurs informatiques et
ordinateurs de bureau. L’instabilite des liaisons telephoniques
civiles en zone equatoriale a necessite deux serveurs sur site
pour assurer la continuite de service. Le troisieme a ete installe
en metropole, pour accueillir une fonction de sauvegarde. Ces
trois serveurs ont ete parametres pour se synchroniser et mettre
a jour l’entrepot de donnees toutes les dix minutes en routine.
teur de surveillance en temps reel 2SE FAG (Guyane, 2004-2006).
J.-B. Meynard et al. / Revue d’Epidemiologie et de Sante Publique 56 (2008) 11–2016
Huit services medicaux d’unites militaires ont ete equipes. Les
transmissions civiles de type GSM et GPRS se sont averees
difficiles. La connexion des batiments de la Marine au reseau a
ete rendue delicate en raison du fonctionnement des
telecommunications du bord.
L’architecture du reseau d’analyse et les communications
des services ont ete baties sur des standards interoperables. Le
choix de solutions ouvertes et libres de droits (Opensource) a
ete fait (PHP, MySQL, R, etc.). Ce reseau assure l’interrogation
et le traitement automatise des donnees toutes les dix minutes.
Il permet de redefinir a tout moment les evenements
epidemiologiques sous surveillance, sous la forme d’une
requete adressee a l’entrepot de donnees et definissant les
caracteristiques cliniques de l’evenement.
Le resultat de ces requetes est ensuite traite pour analyse du
signal epidemiologique a l’aide de cartes de controle [34]
basees sur l’Exponentially Weighted Moving Average [35] et
sur le Current Past Experienced Graph [36]. Cette technique est
particulierement adaptee a la detection au fil du temps d’ecarts
statistiques par rapport a des valeurs de reference.
3.2. Production
Le systeme affiche differents tableaux de bord (Figs. 1 et 2)
avec un rafraıchissement automatique des ecrans. Un tableau
decrit les evenements par periode et pour tout ou partie des
unites (Fig. 1, cercle 1). Une fenetre fournit le suivi temporel
des cas sous la forme d’une courbe epidemique de l’evenement
surveille, accompagnee d’un diagramme de qualite, avec
indication du niveau d’anomalie du signal temporel en trois
niveaux d’alerte associes a des pictogrammes verts, jaune et
rouge (Fig. 2). Une cartographie des cas declares est disponible
(Fig. 1, cercle 2). La meteorologie en temps reel specifique
(Fig. 1, cercle 3) est integree. Il est possible enfin de
redescendre depuis ces tableaux de bord vers la fiche anonyme
Fig. 2. Courbes epidemiologiques simultanees du signal de l’evenement «fievres» a
Guyane, 19 novembre 2005).
(Fig. 1, cercle 4) de declaration du cas. Cette derniere
fonctionnalite a montre son utilite dans les investigations des
alarmes.
3.3. Fonctionnement
Tous les medecins et infirmiers militaires des FAG (50
personnes) ont ete formes a l’utilisation. Un ensemble de
manuels a ete redige. Le reseau etait conforme a l’attendu d’une
chaıne de soutien medical en operation a trois niveaux : le
niveau tactique des soins de l’avant, le niveau operationnel de
commandement medical local et le niveau strategique
metropolitain.
Les retours d’experience ont montre des limites. Les PDA se
sont averes inadequats. Le PDA durci et le terminal telephonique
satellitaire ne satisfaisaient pas aux missions en Guyane ; leur
poids global de 3,5 kg s’ajoutait aux 32 kg (en moyenne) du sac a
dos, plus le materiel medical emporte par le medecin et
l’infirmier au cours des missions en foret amazonienne de deux a
trois semaines. L’ecran du PDA etait trop petit, et le durcissement
a aggrave la perte ergonomique en diminuant la luminance et la
sensibilite de l’ecran tactile. Le couvert vegetal a rendu difficile
l’obtention des points GPS. L’autonomie des terminaux Mini-
M1 etait insuffisante et le couvert vegetal ne permettait pas
l’emploi de panneaux solaires.
L’utilisation des ecrans de questionnaires pour la declaration
n’a pas pose de probleme de comprehension, mais la lourdeur
de l’interface etait prejudiciable a la declaration. Des etudes
ergonomiques ont permis d’ameliorer partiellement
l’ensemble. Le principe de fonctionnement autonome des
postes de declaration (sans connexion synchrone avec les
serveurs) associe a l’expedition differee des donnees par le
mecanisme de replication est a conserver.
Apres deux ans de fonctionnement, la base contient plus de
500 dossiers de declaration de l’evenement « etat febrile ». Dans
nalysees en temps reel, avec depassement de seuil dans 1 regiment (2SE FAG -
J.-B. Meynard et al. / Revue d’Epidemiologie et de Sante Publique 56 (2008) 11–20 17
80 % des cas, la creation de la fiche de declaration et son envoi par
replication se faisaient au decours de la consultation. Apres un an
de fonctionnement, le taux d’exhaustivite des declarations etait
de 104 % par rapport a la surveillance epidemiologique
traditionnelle (message faxe hebdomadaire) [1].
Des ruptures de transmission ont ete penalisantes (effets de
la foudre et surtensions d’un reseau electrique urbain). Ces
problemes pointent la vulnerabilite face aux moyens civils de
communications terrestres hors de controle. Le service de
messagerie accompagnant le projet a permis de mettre en
reseau toutes les equipes, favorisant l’acceptabilite.
3.4. Efficacite
Nous avons pousse les possibilites du dispositif a ses limites
au cours d’exercices. Le temps entre l’envoi d’une declaration
et sa prise en compte dans les tableaux de bord a ete reduit a
1,5 minutes. Le dispositif 2SEFAG a deja permis de detecter
trois departs d’epidemies avec une anticipation allant d’une a
cinq semaines par rapport aux surveillances traditionnelles. La
premiere etait une epidemie de dengue, qui a ete detectee dans
le courant de l’ete 2005. Elle a aussi ete detectee en milieu civil
par le Centre national de reference (CNR) et par l’institut
Pasteur de la Guyane. La deuxieme etait une epidemie de
paludisme, pendant l’hiver 2005–2006, avec une semaine
d’avance sur la declaration militaire traditionnelle par message
epidemiologique hebdomadaire. La troisieme etait une
epidemie de dengue fin 2005, qui s’est propagee a toute la
Guyane. Une alarme a pu etre donnee au sein des armees avec
une avance de une a deux semaines sur la declaration militaire
traditionnelle. En l’absence d’analyse des tendances des
donnees declarees en milieu civil, cette alarme est survenue
plusieurs semaines avant l’alerte civile [37].
Ces alarmes montrent l’avantage d’une detection basee sur un
recueil de symptomes. Dans ces trois exemples, 2SEFAG a
detecte en fait un accroissement anormal des fievres, alors
qu’aucun critere biologique et epidemiologique ne permettait
encore la declaration de cas de dengue ou autre arbovirose, de
paludisme, etc. Trois explications sont possibles. La definition
des cas dans la surveillance epidemiologique traditionnelle [1]
demande pour la declaration de ces maladies un diagnostic
confirme retardateur. Cette explication est discutable puisque les
« fievres d’origine indeterminee » sont aussi incluses dans la
surveillance epidemiologique traditionnelle et leur definition ne
comporte pas de confirmation microbiologique. La deuxieme
explication concerne la procedure de declaration, des la fin de
l’acte medical, dans la surveillance en temps reel par opposition a
la declaration hebdomadaire. Le troisieme facteur est la
dispersion des patients au sein des unites militaires ; dispersion
infraepidemique pour chacune, alors que les seuils epidemiques
etaient depasses au niveau de la surveillance globale des forces en
Guyane. Ce dispositif a permis a l’autorite militaire de Guyane
d’etre alertee et de disposer d’informations sur des epidemies
debutantes, permettant d’adapter la reponse de sante publique, en
particulier en renforcant les mesures de lutte antivectorielle.
Afin d’evaluer la faisabilite d’un systeme multinational
integre de surveillance, l’OTAN a realise un audit des systemes
de surveillance des nations alliees et a organise en avril 2006 un
exercice de validation du concept (Disease Surveillance System
Experiment). Les services de sante francais, britannique
et allemand, le Global Public Health Intelligence Network
(GPHIN) canadien et la societe Applied Signal Technologies
(projet Integrated Bio-Surveillance – IBS, Etats-Unis) y
participaient. Le scenario simulait une epidemie naturelle de
dysenterie bacillaire et une agression par l’agent du charbon
humain dans une zone de deploiement. Des dossiers de patients
fictifs etaient distribues tout au long de l’exercice aux armees
francaises et britanniques. Les donnees etaient saisies et
analysees au niveau de ces deux nations. Chacune produisait ses
propres alarmes selon sa procedure de surveillance en temps
reel a partir de ses seuls patients. Les donnees saisies brutes
etaient simultanement transmises par chaque nation a une
agence de l’OTAN a destination du centre d’analyse a Munich.
Celui-ci analysait donc des donnees multinationales, avec
l’objectif d’etablir des alertes portant sur un effectif multi-
national de patients et de militaires exposes. Une comparaison
finale a ete faite entre les analyses nationales et l’analyse
centralisee.
La fusion des donnees britanniques et francaises a pose des
problemes semantiques. Les resultats de l’exercice ont montre
l’interoperabilite du demonstrateur francais avec les partenai-
res, ainsi que la capacite a transmettre de l’information
securisee (VPN, cryptage. . .) tout en respectant les lois et
reglements francais. Le systeme a montre son efficacite en
detectant en temps quasi-reel (deux heures entre l’apparition du
premier cas suspect de charbon dans une unite francaise et la
proposition de contre-mesures), les deux types d’epidemies
(naturelle et intentionnelle) a partir d’un simple recueil de
symptomes. Plusieurs recommandations ont ete formulees :
definir une liste des symptomes et syndromes communs a
recueillir, standardiser les donnees et les rapports, composer
une base historique commune des deploiements allies afin de
definir l’attendu en termes d’evenements epidemiologiques,
disposer d’equipes d’enqueteurs entraınees (Rapid Deployable
Outbreak Investigation Team – RDOIT), automatiser l’analyse
de donnees. Il a ete suggere que la solution d’interoperabilite
francaise basee sur les web-services serve de reference au
dispositif OTAN.
Fin 2006, il a ete decide d’etendre le concept a l’ensemble des
signes et symptomes constitutifs du risque biologique agressif
(fievres, affections respiratoires, diarrhees, eruptions, paralysies)
et pour cela de deployer une seconde generation de materiels au
sein des forces francaises a Djibouti. L’ouverture d’un second
theatre a surveiller en temps reel necessitait de concevoir un
nouveau « systeme de systemes » realisant un centre operationnel
de metropole d’ou l’ensemble des theatres actifs serait surveille.
Cette prise en compte multitheatres constitue le dispositif Alerte
et Surveillance en Temps Reel (ASTER).
4. Discussion
Face a l’abondance des solutions proposees pour la
surveillance epidemiologique en temps reel ou quasi-reel [7–
10], des doutes ont ete emis sur l’utilite de celle-ci pour la
J.-B. Meynard et al. / Revue d’Epidemiologie et de Sante Publique 56 (2008) 11–2018
detection et l’alerte rapide. Il faut en effet tenir compte du cout
de developpement et de fonctionnement. Il peut etre
inacceptable lorsqu’il faut investiguer des alarmes qui se
revelent etre de fausses alertes generant des delais prejudicia-
bles [38]. Pour discuter des perspectives de ce concept dans les
armees, nous avons utilise la grille d’evaluation des systemes de
surveillance syndromique des CDC [2] en trois parties :
architecture du systeme, capacite de detection des epidemies et
experience tiree de l’utilisation.
4.1. Architecture du systeme
Du point de vue des armees, la capacite a detecter une
agression biologique est une preoccupation recente, dans un
contexte de controverses liees aux consequences medicales des
deploiements [39,40]. Cela a souvent conduit les armees a
reagir en s’appuyant sur des recueils d’informations medicales
deja existants, contrairement au projet francais. Nous avons
montre [11] que quasiment toutes ces surveillances sont basees
sur la collecte de diagnostics et de l’activite des formations et
non sur celle des symptomes. Le systeme EpiNATO est le
modele d’une surveillance basee sur le recueil de 25 categories
regroupant les maladies par organes et les blessures par grandes
causes. L’armee canadienne a montre son absence d’efficacite
et de fiabilite [41]. Early Notification of Community-Based
Epidemics (ESSENCE) utilise les donnees de consultation de
plus de 300 formations de soins militaires aux Etats-Unis.
Recemment, il a ete etendu aux structures sanitaires civiles. Il
est capable de detecter un phenomene epidemiologique avec un
delai moyen d’un jour [42]. Mais il utilise des dossiers dont la
conception n’avait pas pris en compte le recueil des
symptomes, il procede donc a une reconstitution des syndromes
potentiels a partir des diagnostics codes par le medecin grace a
la classification internationale des maladies et des problemes de
sante connexes editee par l’OMS. Recemment, ESSENCE a ete
integre dans un dispositif de surveillance sanitaire des forces en
deploiement. D’autres systemes ont ete realises comme
Lightweight Epidemiological Advanced Detection and Emer-
gency Response System (LEADERS) [43], ou Early Warning
Outbreak and Response System (EWORS), deploye dans des
structures medicales civiles du Sud-Est asiatique [44]. Le
systeme britannique Prototype for Remote Illness and
Symptom Monitor/Realtime Medical Surveillance (PRISM/
RMS) repose sur le recueil par un auxiliaire de sante d’un
ensemble de 33 symptomes choisis essentiellement pour leurs
liens avec les risques biologiques ou chimiques. Ce recueil se
fait a l’aide d’un PDA. Les donnees sont expediees
quotidiennement par satellite a un centre d’analyse en
Grande-Bretagne. Le concept operationnel considere ici
l’homme comme detecteur epidemiologique et a fait le choix
d’etre plus sensible que specifique [45]. Aucun de ces systemes
n’a integre dans sa conception la notion d’interoperabilite entre
nations comme dans ASTER ni ne procede en routine a une
surveillance avec un temps de reponse de l’ordre de
dix minutes.
Du cote civil, il s’agit moins de gerer la mobilite des sujets
que la diversite d’origine des informations. Avant 2001, les
responsables de sante publique civils se preoccupaient deja de
la surveillance des populations pour la detection precoce
d’epidemies, des maladies emergentes [46,47] et des menaces
terroristes [48]. Toutefois, les evenements de septembre 2001 et
l’epidemie de SRAS ont brutalement developpe l’interet pour la
surveillance en temps reel dans les populations. Un des
problemes principaux de la surveillance civile est d’integrer de
nombreuses structures medicales utilisant des systemes
d’information differents. Cela a stimule le besoin de standards
de communication, de solutions d’interoperabilites, mais sans
toutefois subir la pression de la permanence de service qui nous
a fait opter pour une architecture tolerant la redondance et la
mise a l’echelle des ressources informatiques.
L’experience de 2SE FAG a montre les limites de
l’utilisation des PDA durcis. Ces derniers sont en effet trop
lourds pour etre emportes sur l’homme s’ils ne servent qu’a
declarer des cas dans un systeme de surveillance et leur ecran
est trop petit pour la gestion complete du dossier medical. Il faut
enfin, disposer a tout moment d’une alternative militaire dans
les domaines electriques et des communications.
4.2. Capacites de detection
La sensibilite et la specificite de la surveillance syndromique
sont des points critiques. Une sensibilite insuffisante ne permet
pas de detecter une agression, tandis qu’une faible specificite
multiplie a tort les investigations apres alarmes. Il faut
concevoir le dispositif comme un tout, associant le traitement
du signal qui alarme et l’expert humain qui interprete. C’est
pourquoi nous nous sommes orientes vers des traitements qui
permettent a l’homme d’interpreter plus facilement la situation.
Tout d’abord, en utilisant des controles de qualite qui etudient
l’evolution temporelle des cas par rapport a des normes. Les
anomalies apparentes sont comparees a l’evolution attendue de
l’incidence, plusieurs niveaux de seuils sont utilises. Des qu’un
seuil est franchi, ASTER permet de consulter immediatement
les dossiers medicaux des patients constitutifs du depassement
de seuil. Toutefois, rares sont les etudes analysant conjointe-
ment la sensibilite et la specificite de ces systemes de
surveillance [8], d’autant qu’il n’existe aucun standard de
reference dans ce domaine.
Pour l’instant, l’analyse spatiale des donnees est peu
contributive comme le soulignent Bravata et al. qui n’ont trouve
aucune etude montrant qu’une analyse spatiotemporelle
apportait plus d’information qu’une analyse temporelle [8].
Dans notre cas, cela est essentiellement du a la confusion entre
le lieu de consultation des cas et leur appartenance a une unite
militaire, le facteur geographique etant emboıte dans le facteur
population. Cette analyse pourrait toutefois montrer son interet
pour identifier des grappes dans une zone ou plusieurs unites
seraient deployees.
4.3. Experience tiree de l’utilisation
Un systeme de surveillance en temps reel est un systeme
d’alerte qui n’est qu’un instrument d’information dans une
activite complexe de pilotage de la situation sanitaire. Il ne peut
J.-B. Meynard et al. / Revue d’Epidemiologie et de Sante Publique 56 (2008) 11–20 19
etre seul le support de ce pilotage ; il doit entrer dans un
ensemble de supports d’expertise de la situation qui sont la
surveillance, la veille sanitaire, l’investigation epidemiologique
et la prevision de l’evolution du phenomene epidemiologique.
Les lecons les plus importantes de l’utilisation d’ASTER
sont tirees de l’exercice Disease Surveillance System Expe-
riment de l’OTAN et de l’epidemie de dengue de 2006 en
Guyane. L’exercice de l’OTAN a replace la surveillance parmi
les differentes sources d’information necessaires pour finaliser
le diagnostic de situation : evaluation du contexte sanitaire dans
lequel intervient l’evenement epidemiologique a l’aide des
resultats de la veille sanitaire et des donnees historique de
surveillance epidemiologique, elaboration d’hypotheses etio-
logiques en fonction de la clinique, des prophylaxies en cours et
des expositions connues. Cette demarche a permis d’identifier
rapidement les deux epidemies de shigellose et de charbon
humain programmees dans l’exercice. Lors de l’epidemie de
dengue en Guyane, la veille sanitaire a eu une forte influence
sur la qualite et la rapidite de la reponse. Elle nous avait fourni
au prealable des informations sur l’existence d’une epidemie de
dengue de serotype 2 en Amerique latine qui progressait vers la
Guyane. Les responsables de la surveillance etaient donc dans
une posture de prealerte. L’aide au diagnostic de situation est
alors difficilement transposable a une situation d’emergence
d’un pathogene nouveau.
Un autre aspect important est la souplesse d’adaptation a un
nouveau theatre qui repose sur trois piliers : adaptabilite du
materiel, analyse du signal et formation des utilisateurs. Apres
la Guyane, le deploiement du systeme sur le theatre de Djibouti
a permis de verifier ces aspects. Nous avons deploye sans
probleme notable un serveur mobile pour le theatre. Pour les
procedures d’analyse, les seules configurations necessaires ont
ete la creation des donnees de reference des syndromes pour ce
nouveau theatre et la representation cartographique des
donnees. Le point le plus delicat a ete la formation des
utilisateurs qui pose le probleme de l’integration de l’utilisation
du dossier medical electronique avec le principe de la
surveillance basee sur les symptomes. Sous cette condition
liee au facteur humain, il est possible de considerer le systeme
ASTER comme aisement transposable a tout nouveau theatre
d’operation. ASTER a fait l’objet d’un depot de demande de
brevet en France.
Remerciements
Les auteurs tiennent a remercier pour leur contribution tous
les acteurs des systemes militaires de surveillance en temps
reel, en particulier les personnels du service de sante des forces
armees de Guyane et des forces francaises de Djibouti. Sont
egalement remercies tous les partenaires francais et etrangers,
militaires et civils qui ont participe a ces travaux.
References
[1] Spiegel A, Haus R, Berger F, Meynard J, Richard V, Cavallo J, et al. La
surveillance epidemiologique des maladies transmissibles dans les
armees. Bull Soc Fr Microbiol 2004;19:156–62.
[2] Buehler J, Hopkins R, Overhage J, Sosin D, Tong V. Framework for
evaluating public health surveillance systems for early detection of out-
breaks: recommendations from the CDC Working Group. MMWR 2004;
53(RR-5):1–11.
[3] North Atlantic Treaty Organization. Prague summit declaration. Novem-
ber 2002 [cited; Available from: http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-
127e.htm.
[4] Henning KJ. What is syndromic surveillance? MMWR Morb Mortal Wkly
Rep 2004;53(Suppl):5–11.
[5] Gibernon J-L. Les evolutions du C3R. Revue scientifique et technique de
la defense 2004;64:5–17.
[6] Centers for Disease Control and Prevention. Annotated bibliography for
syndromic surveillance. January 13, 2006 [cited July 23, 2007]; Available
from: http://www.cdc.gov/EPO/DPHSI/syndromic/index.htm.
[7] Mandl K, Overhage J, Wagner M, Lober W, Sebastiani P, Mostashari F,
et al. Implementing syndromic surveillance: a practical guide informed by
the early experience. Am Med Inform Assoc 2004;11(2):141–50.
[8] Bravata DM, McDonald KM, Smith WM, Rydzak C, Szeto H, Buckeridge
DL, et al. Systematic review: surveillance systems for early detection of
bioterrorism-related diseases. Ann Intern Med 2004;140(11):910–22.
[9] Lober WB, Karras BT, Wagner MM, Overhage JM, Davidson AJ, Fraser
H, et al. Roundtable on bioterrorism detection: information system-based
surveillance. J Am Med Inform Assoc 2002;9(2):105–15.
[10] Yan P, Zeng D, Chen H. A review of public health syndromic surveillance
systems. In: Springer-Verlag, editor. IEEE International Conference on
Intelligence and Security Informatics; 2006 May 23–24, 2006; San Diego,
CA, USA: Lecture notes in Computer Sciences; 2006. p. 249–60.
[11] Meynard J-B, Texier G, Sbai Idrissi K, Ollivier L, Michel R, Gaudry M,
et al. La surveillance epidemiologique en temps reel pour les armees.
Medecine et armees 2004;32:360–5.
[12] Buehler JW, Berkelman RL, Hartley DM, Peters CJ. Syndromic surveil-
lance and bioterrorism-related epidemics. Emerg Infect Dis
2003;9(10):1197–204.
[13] McDonald CJ, Overhage JM, Dexter P, Takesue B, Suico JG. What is
done, what is needed and what is realistic to expect from medical
informatics standards. Int J Med Inform 1998;48(1–3):5–12.
[14] Brennan P. AMIA recommendations for national health threat surveillance
and response. J Am Med Inform Assoc 2002;9:204–6.
[15] Centers for Disease Control and Prevention. Syndromic definitions for
diseases associated with critical bioterrorism-associated agents. October
23, 2003 [cited; Available from: http://www.bt.cdc.gov/surveillance/syn-
dromedef/index.asp.
[16] Boutin J, Ribiere O, Van Cuyck H, Malosse D. Pour une veille sanitaire de
defense. Medecine et armees 2004;32:366–72.
[17] Moore A, Cooper G, Tsui F-C, Wagner M. Summary of Biosurveillance-
Relevant Statistical and Data Mining Technologies. RODS Laboratory
Technical Report 2003. 2003 [cited 20th February 2007]; Available from:
http://rods.health.pitt.edu/LIBRARY/2002.
[18] Organisation du Traite de l’Atlantique Nord. Stanag 2103 NBC (Edition 9)
– Compte rendu d’explosions nucleaires, d’attaques biologiques et chi-
miques, previsions des dangers et des zones dangereuses qui y sont
associees et diffusion de l’alerte (manuel operateur) – ATP-45(C). Brux-
elles, Belgique. Agence OTAN de normalisation. 2005.
[19] Clarke KC, McLafferty SL, Tempalski BJ. On epidemiology and geo-
graphic information systems: a review and discussion of future directions.
Emerg Infect Dis 1996;2(2):85–92.
[20] Scotch M, Parmanto B, Gadd CS, Sharma RK. Exploring the role of GIS
during community health assessment problem solving: experiences of
public health professionals. Int J Health Geogr 2006;5:39.
[21] Ceruti M. Data management challenges and development for military
information systems. IEEE T Knowl Data En 2003;15(5):1059–68.
[22] W3C. SOAP Version 1.2, partie 0: Preliminaire. Recommandation W3C
24 Juin 2003. [cited 20 fevrier 2007]; Available from: http://www.w3.org/
2002/07/soap-translation/soap12-part0.html.
[23] Health Level Seven. [cited 23rd October 2007]; Available from: http://
www.hl7.org/.
[24] openEHR RELEASE 1.0.1. 15 April 2007 [cited 23 October 2007];
Available from: http://www.openehr.org/.
J.-B. Meynard et al. / Revue d’Epidemiologie et de Sante Publique 56 (2008) 11–2020
[25] Forslund D, Joyce E, Burr T, Picard R, Wokoun D, Umland E, et al. Setting
standards for improved syndromic surveillance. IEEE Engin Med Biol
Magazine 2004;23(1):65–70.
[26] Electronic Healthcare Record Communications. [cited 23rd October
2007]; Available from: http://www.centc251.org/.
[27] Logical Observation Identifiers Names and Codes. [cited 23 October
2007]; Available from: http://www.regenstrief.org/medinformatics/loinc/.
[28] Smith B, Ceusters W. HL7 RIM: an incoherent standard. Stud Health
Technol Inform 2006;124:133–8.
[29] Chaudet H. Extending the event calculus for tracking epidemic spread.
Artif Intell Med 2006;38(2):137–56.
[30] Chaudet H, Pellegrin L, Meynard JB, Texier G, Tournebize O, Queyriaux
B, et al. Web services based syndromic surveillance for early warning
within French Forces. Stud Health Technol Inform 2006;124:666–71.
[31] Endsley M. Towards a theory of situation awareness in dynamic systems.
Hum Factors 1995;37:32–64.
[32] Hoc J-M, Amalberti R, Cellier J-M, Grosjean V. Adaptation et gestion des
risques en situation dynamique. In: Hoc J-M, editor. Psychologie ergo-
nomique: tendances actuelles. Paris, France: Presses Universitaires de
France; 2004. p. 15–48.
[33] Hoc J-M, Amalberti R. Diagnostic et prise de decision dans les situations
dynamiques. Psychologie francaise 1994;39(2):177–92.
[34] Hanslik T, Boelle PY, Flahault A. The control chart: an epidemiological
tool for public health monitoring. Public Health 2001;115(4):277–81.
[35] Roberts S. Control chart tests based on geometric moving averages.
Technometrics 1959;1:239–50.
[36] Stroup D, Wharton M, Kafadar K, Dean A. Evaluation of a method for
detecting aberrations in public health surveillance data. Am J Epidemiol
1993;137:373–80.
[37] Meynard J, Dussart P, Lamy M, Matheus S, Dupuy B, Daudens E, et al.
Interest of syndromic surveillance within the Armed Forces in French
Guiana for early warning. Advances in Disease Surveillance 2007;2:111.
[38] Reingold A. If syndromic surveillance is the answer, what is the question?
Biosecur Bioterror 2003;1(2):77–81.
[39] Engel CC, Hyams KC, Scott K. Managing future Gulf War Syndromes:
international lessons and new models of care. Philos Trans R Soc Lond B
Biol Sci 2006;361(1468):707–20.
[40] Gordin M. The anthrax solution: the Sverdlovsk incident and the
resolution of a biological weapons controversy. J Hist Biol 1997;30:
441–80.
[41] Wilson J, Carew M, Strauss B. Evaluation of EpiNATO Surveillance
System: Canadian Forces. Task Force Bosnia Herzegovina Theatre. In.
Budapest: Human Factors Medicine 108 Panel Symposium; 2004.
[42] Lombardo J, Burkom H, Pavlin J. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC). ESSENCE II and the framework for evaluating
syndromic surveillance systems. MMWR Morb Mortal Wkly Rep
2004;53(Suppl.):159–65.
[43] Department of the Air Force – Air Force Surgeon General. Presentation to
the Committee on Armed Services, subcommittee on military personnel,
United States House of Representatives. Fiscal year 2003 Department of
Defense Medical Programs 2002.
[44] Culpepper R, Kelley P. DoD-Global Emerging Infections Surveillance and
Response System. Navy Medicine 2002;95(5):10–4.
[45] MacDonald P, Green A, Cotrell T, Webber D, Burr P. Developments in
near real-time surveillance: the portable remote illness and symptom
monitor (PRISM). In: XXXV International Congress on Military Medi-
cine; 2004 Sept 12–17; Washington, DC; 2004. p. 51.
[46] Groce NE, Reeve ME. Traditional healers and global surveillance
strategies for emerging diseases. Emerg Infect Dis 1996;2(4):
351–3.
[47] Heymann DL, Rodier GR. Global surveillance of communicable diseases.
Emerg Infect Dis 1998;4(3):362–5.
[48] Special issue. National Symposium on Medical and Public Health
Response to Bioterrorism. Emerg Infect Dis 1999; 5(4).
![Page 1: [Real time epidemiological surveillance within the armed forces: concepts, realities and prospects in France]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051502/63448e85f474639c9b046d33/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: [Real time epidemiological surveillance within the armed forces: concepts, realities and prospects in France]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051502/63448e85f474639c9b046d33/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: [Real time epidemiological surveillance within the armed forces: concepts, realities and prospects in France]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051502/63448e85f474639c9b046d33/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: [Real time epidemiological surveillance within the armed forces: concepts, realities and prospects in France]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051502/63448e85f474639c9b046d33/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: [Real time epidemiological surveillance within the armed forces: concepts, realities and prospects in France]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051502/63448e85f474639c9b046d33/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: [Real time epidemiological surveillance within the armed forces: concepts, realities and prospects in France]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051502/63448e85f474639c9b046d33/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: [Real time epidemiological surveillance within the armed forces: concepts, realities and prospects in France]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051502/63448e85f474639c9b046d33/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: [Real time epidemiological surveillance within the armed forces: concepts, realities and prospects in France]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051502/63448e85f474639c9b046d33/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: [Real time epidemiological surveillance within the armed forces: concepts, realities and prospects in France]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051502/63448e85f474639c9b046d33/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: [Real time epidemiological surveillance within the armed forces: concepts, realities and prospects in France]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051502/63448e85f474639c9b046d33/html5/thumbnails/10.jpg)