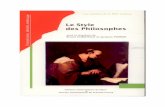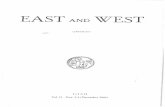Peut-on démocratiser l'expertise
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Peut-on démocratiser l'expertise
PEUT-ON DÉMOCRATISER L'EXPERTISE ? Renaud Dehousse et Notis Lebessis Presses de Sciences Po | Raisons politiques 2003/2 - no 10pages 107 à 123
ISSN 1291-1941
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2003-2-page-107.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dehousse Renaud et Lebessis Notis, « Peut-on démocratiser l'expertise ? »,
Raisons politiques, 2003/2 no 10, p. 107-123. DOI : 10.3917/rai.010.0107
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po.
© Presses de Sciences Po. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
Raisons politiques
, n° 10, mai 2003, p. 107-123.© 2003 Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
dos
sier
E
NTRETIEN
AVEC
R
ENAUD
D
EHOUSSEET
N
OTIS
L
EBESSIS
Peut-on démocratiser l’expertise ?
Raisons politiques
a rencontré deux personnalités qui ont eu, par leursfonctions, à réfléchir sur l’expertise européenne et ses processus dedémocratisation. Renaud Dehousse, professeur de droit européen etde science politique à l’Institut d’études politiques, mène uneréflexion institutionnelle originale sur l’Union européenne ; NotisLebessis, fonctionnaire de la Commission européenne depuis vingt-deux ans, a exercé pendant dix ans des fonctions au sein de la Cellulede prospective et dirigé, dans ce cadre, les travaux préparatoires auLivre blanc sur la gouvernance européenne.
Raisons politiques :
Il semble que le Livre blanc sur la gouver-nance constitue un effort, mis en œuvre par la Commission européenne,pour « démocratiser » l’exercice de l’expertise européenne, notammentpar une ouverture accrue au jugement public : transparence, accès de lasociété civile aux mécanismes décisionnels. Pourriez-vous revenir surl’histoire de ce Livre blanc et expliciter les principes de la gouvernance ?
Notis Lebessis
: Rappelez-vous… Au printemps 1999, pour lapremière fois dans l’histoire de la Communauté, la Commissioneuropéenne a dû démissionner. Installée fin 1999, la Commissionqui lui a succédé a fait figurer au premier rang des orientations stra-tégiques pour sa législature « la promotion de nouvelles formes degouvernance ». L’idée d’un Livre blanc
1
pour mettre en œuvre cette
1. Commission européenne,
Gouvernance européenne : Livre blanc,
Luxembourg, Office despublications officielles des communautés européennes, 2001. Voir également
Gouvernanceeuropéenne. Travaux préparatoires au Livre blanc,
Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2002.
RP10-107-124 Page 107 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
108 –
Entretien avec Renaud Dehousse et Notis Lebessis
orientation a émergé au sein même du Collège des commissaires.Son annonce devant le Parlement européen a été faite dans le dis-cours d’investiture prononcé par le président Prodi le 14 janvier2000. Dans les discours qui ont suivi, il précisait davantage ce qu’ilfallait en attendre : « le Livre blanc devrait poser les questions fonda-mentales sur les politiques et les institutions dont l’Europe avaitbesoin à l’aube du 21
e
siècle ». La conférence intergouvernementale(CIG) de Nice, chargée de la réforme des institutions laissée ina-chevée par la CIG d’Amsterdam, était certes toujours en cours etallait bientôt entrer dans sa phase conclusive. Cependant, à mesurequ’avançaient les négociations, il devenait improbable que Nice« accouche » vraiment des réformes nécessaires à une Europe élargie.Dans le climat de crise qui avait entouré la démission de la Commis-sion Santer, il était donc normal que la nouvelle Commission essayede prendre ainsi l’initiative d’une relance ; mais, en même temps, ilétait politiquement délicat de le faire. De fait, au-delà de l’idée ini-tiale imparfaitement claire qu’avaient les responsables de la Commis-sion du contenu futur du Livre blanc, l’ambition de départ a dû seréajuster au contact des réalités du bras de fer inter-institutionnel etdu calendrier politique. C’est devenu évident fin 2000, aprèsl’annonce à Nice par les chefs d’États et de gouvernement du lance-ment d’un grand débat sur l’avenir de l’Europe et d’une nouvelleconférence intergouvernementale en 2004. Peu après cette annonce,ceux qui avaient la charge de préparer les propositions du Livre blancde la Commission recevaient le mandat de les imaginer « à traitéconstant ». Pour les besoins de l’exercice, l’Europe du 21
e
siècle pou-vait s’accommoder du cadre institutionnel existant !
C’est là qu’est sans doute intervenu le rôle de la réflexion sur lagouvernance menée, au sein de la Commission, par la Cellule deprospective avant même l’arrivée de Romano Prodi.
R. P. :
Qu’est-ce que la Cellule de prospective ?
N. L.
: Elle a été créée en 1989 sur l’initiative de Jacques Delors.C’était un petit groupe de douze à seize personnes, directement placésous l’autorité du président de la Commission mais indépendant desservices et des directions générales en charge des politiques. À sacréation, elle a reçu pour mission de « suivre et d’évaluer l’intégrationeuropéenne ». Vaste mandat ! La Cellule devait éclairer les commis-saires sur des enjeux de la construction européenne, détecter des évo-lutions porteuses d’intégration ou, au contraire, susceptibles de la
RP10-107-124 Page 108 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
Peut-on démocratiser l’expertise ?
– 109
ralentir. En soi, la création de la Cellule de prospective n’a pas étéfacile à accepter au niveau de la Commission, parce que JacquesDelors, anticipant sur un pouvoir qui n’a été formellement reconnuaux présidents de la Commission que plus tard, était déjà un prési-dent extrêmement fort. Ses collègues n’ont pas vu ainsi d’un très bonœil la création d’un nouveau service sous son autorité. Ils l’ont fina-lement accepté mais avec de multiples contraintes. Cela explique enparticulier pourquoi ce groupe, chargé de réfléchir sur l’intégrationeuropéenne, s’est systématiquement vu refuser tout mandat deréflexion sur la dimension proprement politique et institutionnellede l’avenir de l’Europe. On n’a eu accès à ces dimensions-là que pardes biais spécifiques, par exemple, « l’identité européenne ». En1990 – et je pense que c’était le premier jalon d’une réflexion en rap-port avec la gouvernance –, la Cellule a organisé un colloque autourde la question de l’identité postnationale, auquel participaientJürgen Habermas, Ronald Dworkin, Charles Taylor, Jean-Marc Ferryet Luc Ferry… Il s’agissait de penser les conditions d’une démocratieplurinationale. Mais, comme vous le voyez, c’est le mot « identité »qu’on a mis en exergue. Et encore, cette opération a été menée enpartenariat avec l’université de Louvain et non comme une opéra-tion propre à la Cellule de prospective – d’ailleurs, on n’en aurait paseu les moyens
2
.Entre ce moment-là et l’arrivée de Jacques Santer en 1995, il y
a eu un relatif silence de la Cellule sur les questions politiques et ins-titutionnelles. Entre-temps, Maastricht a suscité un choc importanten matière d’intégration européenne. En effet, le « non » danois et le« oui, mais » français ont révélé la distance entre une forme d’expres-sion de la « volonté populaire » et ce que les élites lui proposaient.
Pour une Cellule de prospective en charge du suivi et de l’éva-luation de l’intégration européenne, c’était une interpellation extrê-mement forte. Comment interpréter cette distance et le fait que,quand on interroge les Européens sur l’Europe, il y ait tellement decontradictions ? L’idée européenne est perçue positivement, pourl’essentiel, mais pas toujours : certains aspects des affaires européennesgênent. Jacques Delors étant parti, c’est par ce biais-là que la Cellulede prospective a commencé une réflexion sur le renouvellement del’art de gouverner. Comment comprendre « la crise des institutions »et un certain malaise démocratique ? Comment interpréter les inno-
2. Il en est résulté un livre : Nicole Dewandre, Jacques Lenoble (dir.),
L’Europe au soir dusiècle : identité et démocratie
, Paris, Éditions Esprit, 1992.
RP10-107-124 Page 109 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
110 –
Entretien avec Renaud Dehousse et Notis Lebessis
vations en matière d’approfondissement démocratique ? Commentévoluent le rôle et les responsabilités des pouvoirs publics aujour-d’hui ? Toutes ces choses qui coexistent à la fois : « la crise » ou, entout cas, une certaine incomplétude et un essoufflement des formestraditionnelles de régulation et de légitimation démocratiques etl’invention de nouvelles formes. À la recherche d’un cadre interpré-tatif pour étayer sa réflexion, la Cellule s’est tournée vers ses parte-naires du Centre de philosophie du droit de Louvain avec qui elleavait déjà travaillé. Avec leur réseau en Europe, ils étudiaient préci-sément la question du renouvellement des formes de la régulationdémocratique. Ensemble, nous avons organisé un séminaire interne,associant les fonctionnaires de la Commission, à qui nous avons pro-posé de réfléchir sur l’évolution des politiques publiques euro-péennes et des façons de les construire, en d’autres mots, de réfléchirsur le renouvellement de notre métier d’agents publics européens. Ceséminaire s’est déroulé sur pratiquement deux ans, avec des apportsextérieurs, notamment de la part d’intellectuels travaillant sur l’inté-gration européenne, sur les systèmes politiques et sur les administra-tions, ce qui a permis d’apporter des éclairages complémentaires ànotre sujet. Le résultat paraît aujourd’hui avec pas mal d’années dedécalage
3
.
R. P. :
Qu’en est-il de la notion de gouvernance ?
N. L
. : Pour la Cellule, le mot de gouvernance était une invita-tion à renouveler le regard sur les réalités que la science politique al’habitude d’analyser. Renouvellement nécessaire non pas seulementparce que la science politique traditionnelle a forgé ses outils d’ana-lyse en référence aux réalités nationales. Mais aussi parce quelorsqu’elle décrit les mécanismes de coordination de l’action collec-tive et qu’elle traite la question de la validité et de la légitimité del’intervention publique, elle a tendance à indexer sa description surla prise de décision. De considérer aussi qu’une décision seraitvalable et valide parce que ceux qui l’ont prise ont été valablementdésignés.
L’idée de gouvernance renvoie quant à elle à l’expérience cons-tante de la vie des administrations où trop de choses apparaissent
3. L’un des
Cahiers de la Cellule de prospective
(Olivier de Schutter, Notis Lebessis, JohnPaterson (dir.)
La Gouvernance dans l’Union européenne
, Luxembourg, OPOCE, 2001)présente les principales contributions à ce séminaire.
RP10-107-124 Page 110 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
Peut-on démocratiser l’expertise ?
– 111
déjà déterminées au moment où ceux qui ont la charge formelle deprendre les décisions vont effectivement les prendre et qu’en réalitédes choix importants sont déjà faits. Ce n’est pas différent pour unParlement. Lorsqu’il délibère en vue d’une décision, en réalité, leschoix apparaissent déjà, et pour beaucoup, prédéterminés. Certainsdécrivent cela comme « l’étirement » de la phase législative en amontet en aval du travail parlementaire proprement dit. Comme l’actionpublique porte aujourd’hui sur des réalités très complexes, avec unedimension technologique forte, les conditions de l’élaboration desrègles diffèrent fondamentalement de ce qu’elles étaient à la fin du19
e
siècle ou au début du 20
e
. Les sujets sont devenus plus com-plexes, en relation avec l’accroissement de la complexité techniqued’abord, mais aussi en raison de la complexité organisationnelle, liéeà l’ouverture et à l’interdépendance du monde. Beaucoup de déci-sions sont déléguées aujourd’hui à l’exécutif et, notamment, à sabranche administrative et à ses multiples ramifications, avec une ina-daptation des mécanismes traditionnels de contrôle démocratique.
Au-delà donc de la dimension internationale, l’enjeu d’unapprofondissement démocratique européen selon la Cellule de pros-pective, et pour le formuler brièvement, c’est d’inventer des formesnouvelles de contrôle du pouvoir discrétionnaire des administra-tions. Et parmi les moyens expérimentés, certains ont pour but deremettre ceux que la science politique appelle les « principauxpolitiques » (ceux qui ont la charge formelle du contrôle de l’admi-nistration, comme le Parlement, par exemple) en situation d’exercerce contrôle. Parce qu’en réalité, ils ne l’ont souvent plus. La com-plexité des matières est telle qu’un Parlement, par exemple, sauf s’ils’en donne exceptionnellement les moyens, n’a pas la capacité réellede connaître et de contrôler ce que l’exécutif et son administrationfont, qui est hautement technique et a en même temps, assez sou-vent, une vraie dimension politique. Or, au moment où un choix quia une dimension politique est présenté juste comme choix tech-nique, la démocratie perd quelque chose. Par le biais de ce que lespolitistes appellent le « contrôle diffus » et, notamment, par plus detransparence du processus décisionnel, on espère ainsi donner lemoyen à des parties concernées d’alerter opportunément et d’aiderles principaux politiques à exercer leur rôle.
R. P. :
Pourriez-vous préciser les principes de la gouvernance et lecontenu du Livre blanc ?
RP10-107-124 Page 111 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
112 –
Entretien avec Renaud Dehousse et Notis Lebessis
N. L.
: Un axe majeur de nos propositions vise à assurer uneimplication mieux organisée et plus large de la société civile et d’unediversité d’acteurs dans l’action européenne et le processus d’élabo-ration des politiques. Le diagnostic implicite est que les États et laCommission n’ont plus la capacité d’élaborer des propositionssolides, robustes, sans s’appuyer sur un savoir beaucoup plus partagéet qui va très au-delà de leurs propres capacités d’expertise. Donc, letemps où l’expertise était concentrée dans les administrations et danstout ce qui dépendait de l’État est révolu. Quand il s’agit de régulerles produits chimiques, qui, mieux que l’industrie chimique, saitquelle est la dangerosité d’un produit ? Même chose lorsqu’il s’agitde réguler les nouveaux moyens de télécommunications. Commentl’État, avec sa seule expertise, suffirait-il à évaluer les enjeux ? Donc,il faut que les pouvoirs publics organisent un jeu collectif beaucoupplus ouvert et pluraliste. C’est pour cela aussi qu’on a parlé de gou-vernance plutôt que de gouvernement.
La Commission a montré une certaine réticence à l’égard desorientations de la Cellule de prospective, notamment celles visant àétablir une obligation de consultation de personnalités ou d’orga-nismes extérieurs dans le processus législatif, en raison de ce qu’ellesimpliqueraient en matière de ressources pour être valablement misesen œuvre, mais aussi en raison des risques d’utilisation stratégique etde blocage qu’elles pourraient engendrer. Malgré tout, une séried’engagements inspirés de ces orientations ont été pris dans ce Livreblanc. Certaines des 39 propositions qu’il contient incitent la Com-mission elle-même à prendre des décisions pour améliorer la gouver-nance européenne. D’autres intéressent les autres institutions, lesÉtats membres et les administration publiques. Sur la base des enga-gements du Livre blanc, la Commission a depuis formalisé davan-tage des propositions pour mieux fabriquer les règles européennesqui sont plus connues sous le vocable de
better regulation
. Il en vaainsi, par exemple, avec la proposition de systématiser les analysesd’impact. Ça a l’air technique, mais c’est extrêmement importantpour dépasser les cloisonnements dus à la sectorialisation des poli-tiques en prenant mieux en compte la diversité d’intérêts et d’enjeux,et en le faisant au moment le plus opportun : lors du cadrage des pro-blèmes et des options. Elle a aussi élaboré des normes minimales deconsultation. C’est vrai qu’on n’est pas allé jusqu’à la codificationjuridique de ce qu’est une bonne consultation et de la façon dont elledoit être faite, mais on a donné des orientations. Si nous sommes
RP10-107-124 Page 112 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
Peut-on démocratiser l’expertise ?
– 113
sérieux, nous devrons quand même suivre nos propres orientations !Et ça commence à produire des effets.
Renaud Dehousse
: Il me semble en effet que la Cour de justicen’aurait aucune difficulté à considérer qu’une communicationcomme celle qui a été faite en matière de principes de consultationengage la Commission du point de vue juridique.
N. L.
: Elle a aussi élaboré des orientations sur l’expertise :lorsque la Commission choisit et utilise des experts, dans quellesconditions le fait-elle ? Comment s’assure-t-elle de leur qualité et deleur indépendance ? Le mot d’indépendance doit d’ailleurs êtrenuancé. S’il est politiquement utile comme horizon, il prête souventà confusion. En réalité, c’est une pluralité d’expertise qu’il faut viser.Dans les conditions d’aujourd’hui, un expert vraiment « indépen-dant » serait un expert qui ne saurait rien !
R. P. :
À ce sujet justement…, seriez-vous d’accord pour qualifierl’Union européenne de gouvernement d’experts ?
R. D.
: Poser la question dans ces termes-là implique uneréponse assez tranchée. La question est de savoir si l’Union euro-péenne est, plus que les gouvernements nationaux, un système degouvernement ou de gouvernance d’experts. Je crois que c’est ça, laquestion la plus intéressante, parce que, comme Notis l’évoquaittout à l’heure, le fait est que nous vivons dans des sociétés complexes,qui ont à affronter des problèmes complexes pour lesquels le pointde vue des experts est incontournable. C’est un problème que ren-contrent aussi, ô combien, les démocraties nationales. Il n’est ni plusni moins prononcé au niveau européen. Simplement, le poids desexperts y est peut-être plus visible qu’au niveau national, ce qui estpeut-être une bonne chose pour la démocratie. Pourquoi cette visi-bilité accrue ? D’abord, parce qu’on est en présence d’un systèmepolitique dans lequel les logiques politiques traditionnelles et, enparticulier, les logiques partisanes passent au second plan. Lorsqu’unproblème est abordé par l’Union européenne, il y a rarement desmobilisations partisanes nettes. On assiste parfois à des mobilisa-tions en fonction de clivages idéologiques, comme l’ont montré lesdébats sur la gouvernance économique ou sur la nécessité de prendreen compte les questions sociales dans la Constitution, mais c’estplutôt une exception. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas, en fait, de
RP10-107-124 Page 113 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
114 –
Entretien avec Renaud Dehousse et Notis Lebessis
force politique véritablement constituée au niveau européen. Il y abien sûr des formations politiques transnationales, mais, dans leurfonctionnement, ce sont plutôt des confédérations que des acteursautonomes : ce qui est déterminant, c’est ce que pensent les partisnationaux. Je crois que c’est un aspect important, qui empêchel’émergence au niveau européen d’un débat politique semblable àcelui qui peut exister au niveau national.
R. P. :
C’est ce que vous appelez le gouvernement non majoritaire ?
R. D.
: Ça, c’est encore autre chose, c’est vraiment une questionde « mécano institutionnel ». En parlant de gouvernement nonmajoritaire, j’ai voulu suggérer qu’en raison de sa nature hétérogène,l’Europe était condamnée à la recherche du consensus, parce quel’alternative majoritaire risquait de conduire à une superposition declivages partisans aux clivages nationaux, superposition que j’estimedangereuse pour la stabilité du système politique européen. Ici, monpoint de vue est plus analytique : j’essaye simplement de regarder lamanière dont se constituent les débats de politique publique au seinde l’espace européen. Et l’on voit bien que la difficulté majeure est ceque j’appellerai un déficit politique, c’est-à-dire l’absence de tous cesacteurs dont les positions constituent autant de repères dans le débatpolitique national : partis politiques, partenaires sociaux, ONG…Au niveau européen, il n’y a pas de véritable équivalent. C’est ce quilaisse une place beaucoup plus grande aux experts.
N. L.
: Bien sûr, Renaud vient de caractériser la situation danslaquelle on se trouve et la nécessité de s’appuyer sur du savoir expert.Je dirais que les questions qui font débat public, et par rapport aux-quelles il y a une espèce de contestation du rôle de l’expert ou d’inter-rogation sur son rôle, ont été souvent des questions liées à la santépublique et à la sécurité, comme par exemple le nucléaire, à des sujetsdonc où la connaissance même apportée par les experts est contestée.Cela exige un renouvellement de la façon dont l’acteur public faitappel à l’expertise, l’Union européenne comme les États membresd’ailleurs.
Je dévie un peu de votre question, mais je pense que l’enjeu estd’éviter de rester prisonnier d’un seul type d’expertise. Notre inter-rogation a été : comment faire en sorte que notre appel à l’expertise,que l’organisation même de l’expertise, facilite le renouvellement desconnaissances et laisse le moins possible d’incertitudes dans
RP10-107-124 Page 114 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
Peut-on démocratiser l’expertise ?
– 115
l’obscurité ? Et un levier principal est celui de la pluralisation del’expertise.
R. P. :
La logique experte c’est très bien, mais elle est limitée, voirebornée. Et vous donnez vous-même la solution : c’est la pluralisation desexperts. Peut-on parler de contrepoids à l’expertise au sein de l’UE ?
R. D
. : La question, telle qu’elle est posée, est biaisée, parcequ’elle sous-entend qu’il y a une communauté des experts avec sesintérêts propres, mais surtout un point de vue univoque… Je ne suispas un spécialiste de la philosophie des sciences, mais on sait depuisKarl Popper que le propre du savoir scientifique, c’est le doute. Ilsuffit de se frotter aux experts pour s’apercevoir qu’il n’y a pasnécessairement un point de vue des experts, contrairement à ce quevous semblez dire. Il y a
des
points de vue d’experts, qui ne sont pasnécessairement concordants. Et, très souvent, le contrepoids à unexpert, c’est un autre expert. On le voit d’ailleurs même dans lesmachineries bureaucratiques. Quand le Congrès américain a voulufaire contrepoids à l’expertise des agences spécialisées, qu’a-t-il fait ?Il a créé ses propres structures d’expertise : des experts étiquetés« Congrès » qui allaient consulter les dossiers compilés par les expertsétiquetés « Agences administratives » pour passer au crible les opi-nions expertes contenues dans ces rapports et alimenter leurs man-dants, c’est-à-dire les parlementaires, rendre l’analyse critique desopinions des experts. Donc, la première des questions n’est pas detrouver un contrepoids aux experts, mais d’organiser au sein de lacommunauté scientifique, ou plutôt dans les rapports qu’on veutavoir avec la communauté scientifique, ce débat pluriel, cette plura-lité de voix.
R. P. :
Quand vous parlez de ces experts nombreux et variés, s’agit-il de scientifiques, de ceux qui sont associés aux comités de gestion, deceux qui sont consultés… ?
N. L.
: Il n’y a pas un type ou une configuration particulièred’expertise qui serait visé. Dans la nouvelle Agence de sécurité ali-mentaire, par exemple, subsistent les mêmes comités d’expertsqu’auparavant ; donc, il y a une structure de comités coordonnée parun comité scientifique directeur. Mais chaque réunion commencemaintenant par une déclaration sur les conflits d’intérêts que pour-raient avoir les experts. On essaie également d’assurer une transpa-
RP10-107-124 Page 115 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
116 –
Entretien avec Renaud Dehousse et Notis Lebessis
rence de leurs travaux. Je voulais illustrer les propos de Renaud sur lacontre-expertise. Plutôt que de demander à un expert : « Dites-moiquelle est la bonne solution », on peut aussi imaginer de lui poser laquestion, par exemple, face aux problèmes de la gestion des déchetsnucléaires : « Défendez l’option de l’enfouissement profond etmobilisez toutes vos connaissances scientifiques à l’appui de cetteoption ». Puis, demander à un autre groupe d’experts : « Vous, vousallez défendre l’option inverse… ». On placerait ainsi le scientifiqueen situation de se justifier dans un univers qui n’est pas uniquementscientifique, ce qu’il déteste, parce qu’en principe, si on lui demandeson avis, c’est au titre de la science… En réalité, étant donnée la com-plexité des sujets traités, le décideur n’est pas le mieux armé pouridentifier les zones d’ombre laissées par l’accumulation des argu-ments. C’est le rôle de la contre-expertise publique, surtout si elle estorganisée de cette façon-là.
In fine
, on sera plus conscient des fai-blesses et des incertitudes inhérentes à un sujet par rapport aux-quelles la science elle-même n’est pas en situation aujourd’hui de seprononcer. La décision que l’on prendra sera donc mieux informéeet plus responsable. Il ne faut pas faire reposer la responsabilité de ladécision sur l’expert. Ça, c’est un biais, et c’est ce que l’on sous-entend lorsqu’on parle de gouvernement des experts.
R. P. :
Donc il ne faut pas que ce soit l’expert qui décide. Mais,dans le fond, n’est-ce pas lui qui décide dans l’Union européenne ? Est-cequ’on ne décide pas sur des bases faussées ou unilatérales ? Cette confron-tation des points de vue existe-t-elle réellement et informe-t-elle la déci-sion publique d’une façon contradictoire ?
R. D.
: La différence qu’on peut faire entre le niveau européenet le niveau national tient moins au poids qu’aurait l’expertise à l’unou l’autre de ces niveaux qu’à la possibilité précisément de procé-dures faisant intervenir les citoyens. Là, oui, il y a des différences. Onpourrait dire que le poids des experts est plus ou moins identique,mais qu’au niveau national, il est plus facile aux personnes intéresséesde se mobiliser, d’utiliser les procédures existantes de façon plus oumoins efficace (parce que là aussi il y aurait des choses à dire), de fairepression sur les pouvoirs publics et de faire bouger les choses…
R. P. :
Pouvez-vous donner un exemple au niveau national ?
R. D.
: Un exemple de mobilisation sur un enjeu technique ?
RP10-107-124 Page 116 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
Peut-on démocratiser l’expertise ?
– 117
R. P. :
Oui, l’éthique ou la bioéthique peut-être ?
R. D.
: Oui, encore que je n’aie pas vu de manifestation demasse sur ce sujet. En revanche, il ne manque pas d’exemple demobilisations de catégories de la population – fonctionnaires, agri-culteurs – lorsqu’elles sentent leurs intérêts menacés. Et ces catégo-ries sont représentées de façon beaucoup plus directe au niveaunational qu’au niveau européen. Au fond, c’est le problème de la fai-blesse des contrepoids à l’expertise que soulève votre question. Dansune optique fédéraliste, on soutient que le citoyen est représentéaujourd’hui par le Parlement et demain par la Commission, lorsquecelle-ci sera élue d’une façon ou d’une autre. En fait, c’est une façonassez pauvre de concevoir la représentation, parce que les parlemen-taires européens ne sont pas très représentatifs. Ils sont souvent élussur les listes nationales, donc peu en prise avec leur électorat. Parailleurs, il faut voir comment fonctionne pratiquement le Parlementeuropéen, qui est la chose la plus proche, nous dit-on, d’un espacede délibération au niveau européen : c’est une assemblée énorme,entravée dans son bon fonctionnement par la multiplicité des lan-gages officiels et par le nombre de décisions qui doivent être prisesdans un espace de temps très limité. Je vous recommande à ce proposla lecture d’un article d’Alain Krivine paru dans
Le Monde
il y aquelques années
4
: il y dresse un tableau fascinant de son expériencede parlementaire européen. À quoi se résume l’espace de délibé-ration ? Une minute pour exprimer son opinion, deux minutes sivous êtes chef de groupe, je crois que c’est à peu près ça… Déjà, ladélibération en prend un coup. Et quand on a des votes, c’est plusieurscentaines de votes dans la même matinée, où il faut pousser sonbouton et où il faut faire gaffe, parce que si vous vous trompez detempo, vous croyez voter un subside pour l’aide alimentaire au Kosovoet patatras ! C’est au contraire une subvention pour la culture du tabacdans je ne sais quelle province lointaine de l’Union… Et ce serait ça,l’espace de délibération européen ? Le tableau n’est pas plus réjouissantsi l’on adopte
une lecture intergouvernementale. Tony Blair a beauaffirmer que les États sont démocratiques et qu’ils peuvent donclégitimement contrôler ce qui se fait au niveau européen ; ça aussi,c’est une vue de l’esprit. Dans le meilleur des cas, les élus nationauxpeuvent contrôler le comportement de leurs représentants au sein des
4. « Choses vues au Parlement européen »,
Le Monde
, 12 janvier 2000.
RP10-107-124 Page 117 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
118 –
Entretien avec Renaud Dehousse et Notis Lebessis
conseils européens, mais ils ne le font que rarement… C’est pourquoinous avons à inventer des contrepoids au pouvoir des experts et, defaçon plus générale, à la technocratie.
R. P. :
Comment la gouvernance, que la Cellule de prospective aintroduite dans l’intégration communautaire, peut-elle permettre defaire émerger ce contrepoids, et réapparaître la figure du citoyen ou del’opinion publique dans la décision publique, puisqu’eux seuls détiennentle jugement légitime en démocratie ?
N. L.
: Ce qu’on essaye de distinguer, ce sont ceux qui ont laresponsabilité formelle de décider, ceux-là, la gouvernance, commevous dites, ne les questionne pas. Elle « porte » son intérêt et sonregard sur tout ce qui précède le moment de la décision que conti-nueront de prendre ceux qui en ont la responsabilité formelle, à quia été délégué, par les mécanismes de démocratie, le pouvoir formelde décider. Ce que « dit » la gouvernance, c’est que la représentativitéet la délégation telles qu’elles sont organisées à l’heure actuelle, surdes bases professionnelles, sur des bases territoriales, sont parfois ina-daptées au regard des sujets qu’il s’agit de traiter. Elles sont parfoisdifficilement mobilisables tout au long du processus de formation etd’élaboration des politiques, surtout si on se réfère bien en amont.Les principes de la gouvernance essaient de promouvoir la reconnais-sance d’un enrichissement des canaux, des dispositifs de représenta-tion
ad hoc
sur les problématiques qui n’ont pas forcément toujoursbesoin de cadres permanents. On peut très bien imaginer un forumqui, pendant un temps, informe bien en amont un processusdécisionnel, étant entendu que la décision
in fine
sera toujours prisepar ceux qui ont la responsabilité formelle de la prendre. Pluralisonsdonc les canaux de la représentation, hybridons-les, pour que ce nesoient pas uniquement des professionnels de la décision qui partici-pent à cela ; croisons la dimension politique, la dimension del’expertise, la dimension de la partie directement concernée. Accep-tons même l’idée, et c’est quelque chose de différent, que la démo-cratie n’a pas comme seuls sujets des citoyens, mais aussi des acteurscollectifs. Là, c’est poser des critères de reconnaissance par la démo-cratie des acteurs collectifs.
R. P. :
Vous dites : « Pluralisons les types d’acteurs, croisons lesperspectives ». Très bien. Concrètement, qui sont les gens que l’on peutassocier aux processus de décision « en amont »… et jusqu’où en amont ?
RP10-107-124 Page 118 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
Peut-on démocratiser l’expertise ?
– 119
N. L.
: On se rapproche de cette pluralisation lorsque la Com-mission fait appel, dans l’élaboration de ses propositions, à d’autresacteurs que ceux qui ont traditionnellement la responsabilitéd’émettre une proposition. En matière de transport, par exemple, onconsulte aussi ceux qui s’occupent de l’environnement, de la cohé-sion et du développement des territoires. Lorsque je parlais de forumhybride, je faisais référence à des expériences qui, à l’heure actuelle,ne sont connues qu’au niveau national. Et là, effectivement, il y aune multitude d’inventions et d’innovations.
R. P. :
Par exemple ?
N. L.
: Eh bien, par exemple, la conférence des citoyens sur dessujets comme les choix technologiques qui ont une dimensiond’incertitude, une dimension éthique. Souvent, le politique cherchelui-même à s’appuyer sur des mécanismes qui ont une représentati-vité plus large, et où le citoyen se reconnaît, en fait, de manière unpeu plus symbolique. Parce que, dans ces forums de citoyens, onretrouvera la ménagère, l’épicier, l’employé de banque… Ce ne sontpas des réunions d’une demi-heure ou de deux heures : ce sont desprocessus longs, qui s’organisent sur six mois, où l’on se forme déjàen tant que citoyen. On ne va pas devenir un expert du nucléaire,mais on va quand même être en situation de poser des questions auxexperts du nucléaire, des questions qui, croyez-moi, déstabilisentl’expert du nucléaire, parce qu’elles le font sortir du cadre des ques-tions que, selon le protocole scientifique, il a tendance à privilégier.Or cela est nécessaire. Comment l’Europe – qui est interpellée par cetype de décision, parce que souvent les décisions en ces matières seprennent aussi au niveau européen, pour ne pas dire au niveauinternational –, comment la démocratie internationale traiteront-elles ce problème ?
R. P. :
Mais, quand même, les citoyens sont là, ils ont le droit deparler. Prend-on en compte leurs remarques, leurs suggestions ?
N. L.
: Les citoyens français ont été consultés sur les OGM dansle cadre du Parlement français. L’Office de l’évaluation des scienceset techniques du Parlement a institué une conférence des citoyenssur les OGM dans l’alimentation et ceux-ci ont rendu un avis…
R. P.
:
J’imagine que l’avis était attentiste ?
RP10-107-124 Page 119 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
120 –
Entretien avec Renaud Dehousse et Notis Lebessis
N. L.
: Non, pas du tout. On a tendance à s’extasier sur le faitque de simples citoyens en arrivent finalement à prendre des posi-tions qui sont tout à fait raisonnables. Par rapport aux OGM, ils ontémis un avis pour le progrès, en reconnaissant l’utilité des OGM,mais en faisant, en même temps, beaucoup de propositions pourencadrer l’expérimentation sur les sujets génétiquement modifiés, defaçon à ce qu’il y ait création de nouvelles connaissances sur les incer-titudes pour que, lorsqu’on décèle des risques, ils soient valablementtraités, pour qu’il y ait…
R. D.
: Pour qu’il y ait une politique un peu plus ouverte. Cequi est frappant, c’est de voir qu’au niveau gouvernemental, la posi-tion nationale française, comme celle de la plupart des Étatsmembres, est beaucoup plus conservatrice, au nom d’une peur del’opinion publique.
N. L.
: Mais le déficit de ces dispositifs, à l’heure actuelle, c’estjustement leur articulation avec les mécanismes du débat public.Comment, par exemple, un instrument comme la télévision pourra-t-il s’articuler avec ce genre de consultations citoyennes, plutôtexclusivement focalisées sur des minorités actives, et faire en sorteque l’opinion publique en prenne plus largement connaissance ?
R. P. :
Peut-on alors parler d’une « délibération experte » au seinde l’UE ? Autrement dit, y a-t-il une confrontation critique des différentspoints de vue, de telle sorte que se produise l’équivalent de ce queHabermas appelle une démocratie procédurale ?
R. D.
: J’ai des difficultés à répondre à une question posée endes termes aussi généraux, parce que ce serait donner un jugementd’ensemble sur un système, alors qu’au fond le système est, commetout système politique, plus peut-être que les systèmes nationaux,fragmenté, composite. La réponse, si on veut vraiment être honnête,ne peut être que « ça dépend des dossiers, des domaines ». Sansnécessairement prétendre donner une évaluation d’ensemble, je vou-drais mentionner qu’il y a des éléments dans le système communau-taire qui, à mon avis, rendent plus vraisemblable ce genre de logiqued’échange… Le premier, peut-être paradoxal, est la faiblesse despartis politiques. Je dis paradoxal parce que, dans la lecture classiquede la faiblesse de la démocratie européenne, dont je me suis faitl’écho précédemment, c’est un élément qui figure en bonne place.
RP10-107-124 Page 120 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
Peut-on démocratiser l’expertise ?
– 121
Or, dans les débats politiques nationaux par exemple, la délibérationest, dans une large mesure, polluée par les logiques partisanes. Sivous êtes dans l’opposition, ce que propose le gouvernement estmauvais et, si vous êtes dans la majorité, ce qu’il propose est bon.C’est un peu simpliste…
R. P. :
Il y aurait donc un meilleur esprit public au niveaueuropéen ?
R. D.
: En tout cas, il n’y a pas cette logique-là qui est unénorme frein au développement d’une véritable délibération. Ledeuxième élément, qui peut permettre le développement de cettelogique de délibération, est un autre paradoxe. Je disais tout à l’heureque ce qui complique la lecture des débats européens, c’est leur frag-mentation, or c’est parfois cette fragmentation qui va permettre laconstitution de mécanismes qui s’apparentent à la délibération. Jepense par exemple aux travaux de Christian Joerges et Jürgen Neyersur la comitologie, dans lesquels ils présentent le système européende « gouvernement par comités » comme un espace de délibérationhabermassien. Sans doute y a-t-il là une part d’idéalisme. Mais peuimporte. Il est clair que ce qui peut favoriser l’émergence d’unelogique de délibération c’est que les comités réunissent souvent despersonnes intéressées par les mêmes types d’enjeux, de questions, quipartagent des éléments d’un langage commun, des fragments d’unsavoir commun… Cela facilite évidemment le processus délibératif.Avec parfois des risques qui sont, comme le soulignait Notis, qu’onne va pas prendre en compte un point de vue, parce qu’il n’a pascours dans l’espace épistémique en question, parce qu’il n’a pasd’écho parmi les experts, alors qu’un avis de profane pourrait quandmême être intéressant. Prenez la question très concrète des hormonesdans la viande. Les experts vous disent (ce qui embarrasse beaucoupl’UE dans ses prises de position au sein de l’OMC), qu’il n’y a pas,en l’état actuel de nos connaissances, de démonstration scientifiquede la nocivité de la plupart des hormones utilisées par les Américains.Reste que l’opinion publique, nous dit-on, ne veut pas en entendreparler… Or l’opinion publique ce sont plutôt des profanes ; tous nesont pas des experts en biologie…
R. P. :
Sans doute, mais la crise de la vache folle a montré que lesexperts pouvaient expertiser dans une totale ignorance des conséquencesde leurs jugements
.
RP10-107-124 Page 121 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
122 –
Entretien avec Renaud Dehousse et Notis Lebessis
R. D.
: C’est une autre question. Ce que je voulais dire, c’estqu’il y a sur certaines questions un point de vue profane qui ne serapas pris en compte dans les réseaux d’experts européens. Restemalgré tout que la fragmentation dont je parlais tout à l’heure peutreprésenter un avantage, dans la mesure où elle permettra le dévelop-pement de logiques de délibération plus aisément qu’au seind’assemblées plus hétérogènes. On aura ainsi plus de délibération,mais peut-être par des acteurs qui sont moins représentatifs del’ensemble de la société. Difficile de dire si, au total, en termes delégitimité, on y gagne.
R. P. :
J’aimerais revenir à la Cellule de prospective et à sa réflexionsur la gouvernance. On a pu vous reprocher, dans une perspective socio-logique, de faire appel plus particulièrement à une sensibilité philoso-phique. Pensez-vous qu’au sein de la Cellule de prospective, il y avait,sans parler d’une théorie politique commune, des visions philosophiquesou des visions de la politique partagées, et pourriez-vous qualifier cesvisions ?
N. L.
: Non, je ne pense pas qu’il y ait eu consensus au sein dela Cellule sur quelque thème que ce soit. Sans doute, la culture com-mune était celle de l’ouverture, de l’acceptation de la confrontation,de l’échange des arguments. En revanche, il y avait des avis très con-trastés. Il y avait des économistes et, parmi eux, il y en avait qu’onpourrait qualifier de libéraux, d’autres de moins libéraux. Donc,non, je ne pense pas que se dégageait une…
R. P. :
Une vision commune.
N. L.
: Une vision commune sur les enjeux, sur les problèmes,sur leurs différentes dimensions, oui. C’était quand même le but denotre travail. Mais cette vision commune n’implique pas une unicitéd’approche. Au contraire, elle procède du croisement des approches.Et donc, c’est une approche de la « vérité » par ce biais-là.
R. P. :
Pourtant, vous avez précisé l’approche de la démocratie quise dégageait, pas seulement une démocratie non représentative, maisquelque chose qui pouvait suppléer aux défauts, aux lacunes de cettebureaucratie… Est-ce que les gens associés à cette entreprise de réflexionétaient conscients de la nécessité de redéfinir la démocratie à l’usage del’Union ?
RP10-107-124 Page 122 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po
Peut-on démocratiser l’expertise ?
– 123
N. L.
: Pour les académiques qui nous ont aidés à cadrer notreinterrogation, c’était clairement leur objet de recherche : le renouvel-lement de formes de régulation démocratiques. Pour ce qui nousconcerne, je pense que nous avons tous été impressionnés par la des-cription des enjeux qu’ils nous faisaient. C’est-à-dire qu’ils nousoffraient un cadre interprétatif qui nous semblait beaucoup plus par-lant que ceux qu’on connaissait auparavant.
R. P. :
La théorie politique serait venue, dans ce cas-là, à la res-cousse de l’action publique…
N. L.
: Oui, pour autant qu’il s’agisse vraiment de théorie poli-tique. Là, c’était un croisement de philosophie politique et de philo-sophie du droit.
�
Janvier 2003Entretien réalisé par Muriel Rouyer
RP10-107-124 Page 123 Mercredi, 26. octobre 2005 8:22 08
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 91
.182
.224
.147
- 0
7/11
/201
3 13
h05.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 91.182.224.147 - 07/11/2013 13h05. ©
Presses de S
ciences Po