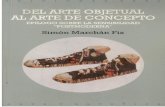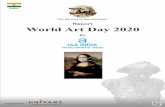Mer de Glace - Art et Science_L'empreinte des glaciations
-
Upload
univ-savoie -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Mer de Glace - Art et Science_L'empreinte des glaciations
CollectionEDYTEM MER
DE GLACE
art &
sci
ence
Mer de glace, art & science a été coordonné par : Samuel Nussbaumer, Philip Deline, Christian Vincent, Heinz J. Zumbühl
Il est le fruit des recherches menées, en France, au sein du Laboratoire EDYTEM (Environnements, dynamiques, territoires de montagne), du LEGOS (Laboratoire d’étude en géophysique et océanographie spatiales), du LGGE (Laboratoire de glaciologie et géophysique de l’environnement) et, en Suisse, à l’Université de Berne et à l’Université de Zurich.
Etienne Berthier, LEGOS, CNES - IRD Université Paul Sabatier - CNRS, Toulouse
Sylvain Coutterand, EDYTEM, Université de Savoie - CNRS, Le Bourget-du-Lac
Philip Deline, EDYTEM, Université de Savoie - CNRS, Le Bourget-du-Lac
Marie Gardent, EDYTEM, Université de Savoie - CNRS, Le Bourget-du-Lac
Emmanuel Le Meur, LGGE, Université Joseph Fourier - CNRS, Grenoble
Melaine Le Roy, EDYTEM, Université de Savoie - CNRS, Le Bourget-du-Lac
Benoît Martin*, Université de Savoie, Le Bourget-du-Lac
Luc Moreau, EDYTEM,Université de Savoie - CNRS, Le Bourget-du-Lac
Samuel Nussbaumer, Département de géographie, Université de Zürich, Zürich
Delphine Six, LGGE, Université Joseph FourierCNRS, Grenoble
Christian Vincent, LGGE, Université Joseph Fourier - CNRS, Grenoble
Heinz J. Zumbühl, Institut de géographie, Université de Berne, Berne
* Benoît est décédé en montagne le 15 juillet 2012
60
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
L’histoire des glaciers du massif du Mont-Blanc avant la période géologique du Quaternaire, ouverte il y a 2,6 millions d’années, s’éclaire peu à peu. On sait que les péjorations climatiques amorcées il y a 3,5 millions d’années, lors du Pliocène moyen, ont favorisé l’installation des glaciers. La Mer de Glace primitive s’est mise en place dans une vallée qui existait déjà, car d’origine tectonique et fluviatile. Pendant le Quaternaire, le climat a oscillé entre périodes glaciaires et interglaciaires. Ainsi, le climat d’il y a 130 000 ans était sensiblement plus chaud que celui d’aujourd’hui. Après cette période interglaciaire, le volume des glaciers alpins a augmenté assez régulièrement pour atteindre un premier maximum il y a environ 60 000 ans, puis un second il y a 25 000 ans. La déglaciation a ensuite commencée dans les Alpes il y a plus de 20 000 ans, pour s’achever il y a environ 11000 ans, avec une extension des glaciers proche de celle contemporaine.
Carte paléogéographique des Alpes nord-occidentales au dernier maximum glaciaire du Pléistocène récent.
La paLéogéographie et La dendrogLacioLogie aident
à reconstituer Le passé de La Mer de gLace
L’ empreinte des glaciations
sylvain coutterand, Melaine Le roy
ch
ap
it
re
3
63
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
62
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
reconstitution du Massif Lors du dernier MaxiMuM gLaciaire
Des travaux récents ont proposé une reconstitution cohérente de l’englacement du massif du Mont-Blanc et notamment celui du bassin de la Mer de Glace lors du maximum de la dernière glaciation, la glaciation würmienne, il y a 25 000 ans. Actuellement, le massif du Mont-Blanc présente une superficie d’environ 160 km2 de glaciers. Mais lors des périodes froides du Quaternaire, les glaciers occupaient toutes les vallées de la région et débordaient jusque sur les piémonts : pendant la dernière glaciation, ils avançaient ainsi jusqu’à Lagnieu, à 20 kilomètres de Lyon.
La principale méthode utilisée pour reconstituer les limites occupées par les glaciers durant les dernières périodes glaciaires est la reconnaissance géomorphologique et la cartographie des dépôts glaciaires, les moraines frontales indiquant les extensions maximales. Cependant, cette méthode ne renseigne pas sur l’épaisseur de glace dans les zones d’accumulation (partie centrale des Alpes), d’où la mise en œuvre d’une autre méthode basée sur l’interprétation des formes d’érosion glaciaire, appliquée avec succès dans les Alpes suisses et le massif du Mont-Blanc1. Ces morphologies d’érosion glaciaire sont bien caractéristiques et facilement interprétables. Suivant l’échelle considérée, on distinguera les micros-formes d’érosion : stries, cannelures…, et les mégas-formes d’érosion : vallées en auge, roches moutonnées et « trimlines ». Résistantes, les roches endogènes constituant le massif du Mont-Blanc (granites et gneiss) permettent la bonne préservation du modelé d’érosion glaciaire, en particulier des trimlines, qui marquent la limite supérieure des zones englacées.
La triMLine
L’action érosive d’un glacier tempéré (dont la glace basale est proche du point de fusion) imprime un modelé caractéristique, qui se différencie de celui des secteurs non recouverts par la glace. La surface maximale d’englacement correspond à la limite supérieure de ce modelé glaciaire. Cette limite, appelée trimline, est définie par Thorp (1981) comme la zone de transition entre la partie inférieure d’un versant affectée par les processus d’érosion glaciaire et sa partie supérieure présentant une forte rugosité (crêtes acérées, couloirs) car soumise à la cryoclastie et aux écroulements. Souvent visible dans le paysage (en particulier sur les granites du bassin de la Mer de Glace), la trimline se développe sur quelques dizaines de mètres de dénivelé.
Huit exemples de roches moutonnées striées. Résistantes, les roches du massif du Mont-Blanc ont bien préservé le modelé d’érosion glaciaire, facilitant la lecture du paysage.
1 penck et Brückner, 1909 ; florineth, 1998 ; coutterand et Buoncristiani, 2006.
65
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
64
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
2
1
2650 m
2450 m
Les vitesses d’altération du modelé d’origine glaciaire sont un paramètre majeur pour définir l’âge des trimlines. Une approche quantitative des processus d’altération du modelé glaciaire dans le massif du Mont-Blanc suggère une valeur minimale de 4 à 5 millimètres d’érosion par millénaire2. Mais l’altitude, l’orientation des versants et la couverture nivale sont des paramètres qui agissent sur cette valeur d’érosion, et certains auteurs proposent des valeurs moyennes de 10 millimètres par millénaire3. Avec cette dernière valeur, l’érosion moyenne du modelé glaciaire serait de 25 centimètres depuis le dernier maximum glaciaire (il y a environ 25 000 ans) et de 1,70 mètre depuis l’avant-dernière glaciation, il y a environ 170 000 ans. Cette relative rapidité d’altération du modelé d’origine glaciaire suggère que la formation des trimlines actuelles est bien contemporaine du dernier maximum glaciaire4.
La cartographie des trimlines aux confluences des glaciers issus du massif du Mont-Blanc avec le glacier principal de la vallée de l’Arve permet de définir les altitudes de sa surface. La diffluence des glaciers du Tour et d’Argentière par les Cols des Montets, des Posettes et de Balme, postulée par plusieurs auteurs5, est confirmée par la présence de stries au sommet de la montagne des Posettes6. Ces deux glaciers alimentaient donc celui du Rhône par les vallées de l’Eau Noire et du Trient dès que leur surface dépassait 1 600 m d’altitude. Cette interprétation a été reprise par De Martonne en 1931, qui, sans doute influencé par l’axe d’écoulement de la Mer de Glace, envisage également la diffluence d’une partie de ce vaste bassin glaciaire vers le glacier du Rhône.
La reconstitution met en évidence une surface glaciaire qui dépassait généralement l’altitude de 2400 m autour du massif du Mont-Blanc, avec six principales zones d’accumulation : la haute vallée de l’Arve (altitude 2 500 m), le haut Val Montjoie (2 400 m), le haut Val Ferret suisse (2 700 m), le haut Val Ferret italien (2 800 m) et le haut Val Veny (2 850 m) 7, et la haute Vallée des Glaciers (2 800 m). Dans le bassin de la Mer de Glace, la paléo-surface glaciaire est bien documentée par l’altitude des trimlines, à laquelle il faut ajouter une certaine épaisseur de glace et de névé d’environ 100 mètres. Par conséquent, la surface pléniglaciaire qui atteignait 3 000 m d’altitude au niveau des séracs du Géant s’abaissait à 2 750 m à la confluence avec le glacier de Leschaux, puis à 2 650-2 700 m au droit de la Tête de Trélaporte, pour terminer à 2 450 m au débouché dans la vallée de Chamonix8). La nappe de glace recouvrant la vallée de Chamonix débordait alors par le col du Brévent.
2 Coutterand et Buoncristiani, 2006.3 Bierman et al., 1995.4 Florineth, 1998 ; Coutterand et Buoncristiani, 2006.5 Corbin et Oulianoff, 1929.6 Coutterand et Buoncristiani, 2006.7 Porter et Orombelli, 1982.8 Coutterand, 2010.
La trimline est bien marquée à la base de l’aiguille de Trélaporte. Elle sépare deux types d’érosion : au dessus (1), les roches modelées par l’alternance gel-dégel (cryopastie) ont des formes anguleuses. En dessous (2), l’érosion glaciaire a façonné les formes arondies des fameuses roches moutonnées. De l’emplacement de la trimline, on peut déduire celui de la surface pléniglaciaire lors du dernier maximum glaciaire, il y a 25 000 ans: ici, elle s’abaissait d’environ 2650 m au droit de la Tête de Trélaporte à 2450 m au débouché dans la vallée de Chamonix. La reconstitution paysagère (à gauche) a été effectuée sur la base de ces données, à partir d’une vue aérienne de septembre 1997.© Alpes MAgAzine, s. CoutterAnd
Reconstitution paléogéographique de la région du massif du Mont-Blanc lors
du dernier maximum glaciaire, quand la Mer de Glace
n’était qu’un « petit » glacier alimentant l’immense glacier de l’Arve (équidistance des courbes
de niveau 100 m)CoutterAnd, 2010
2 coutterand et Buoncristiani, 2006.3 Bierman et al., 1995.4 florineth, 1998 ; coutterand et Buoncristiani, 2006.
5 corbin et oulianoff, 1929.6 coutterand et Buoncristiani, 2006.7 porter et orombelli, 1982.8 coutterand, 2010.
67
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
66
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
Il y a 14 500 ans, extension des glaciers du massif du Mont-Blanc, le glacier qui occupe encore la vallée de Chamonix est principalement alimenté par la Mer de Glace © s. CoutterAnd
Il y a 12500 ans, le net refroidissement du Dryas
récent permet l’avancée des langues glaciaires sur plusieurs kilomètres, dont témoignent les
vallums morainiques déposés dans toutes les hautes vallées à l’aval des moraines holocènes.
pAléogéogrAphie de l’extension des glACiers du MAssif du Mont-BlAnC Au dryAs réCent
CoutterAnd, 2005
69
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
68
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
1874. Glacier des Bois
et vallée de Chamonix, Aiguille-du-Dru, Aiguille-Verte
par Eugène Viollet-le-Duc Reconstruction artistique du stade
de Chamonix (dernière étape de la dernière glaciation) sur la base de
témoins morainiques latéraux identifiés sur les versants de la vallée
signé ; CrAyon, AquArelle, gouAChe ; 29,0 x 69,5 CM ; fonds Viollet-le-duC, n° 65-g ; MédiAthèque de
l’ArChiteCture et du pAtriMoine, pAris ; frey, 1988 : 63/146
évoLution de La Mer de gLace après Le dernier MaxiMuM gLaciaire
Après le dernier maximum glaciaire, la nappe glaciaire se fragmente avec l’individualisation des grands glaciers dans leurs vallées respectives. Le Tardiglaciaire (qui commence il y a 18 000 ans) couvre une période de fonte progressive entrecoupée de stades de progression et de stationnement des langues glaciaires. Le glacier de la vallée de l’Arve a laissé au cours de son retrait des vallums morainiques parfois volumineux, notamment près de la Roche-sur-Foron, au Fayet et à Chamonix.
Il y a 16 000 ans, le glacier de l’Arve stationnait au Fayet, avant de se retirer dans la vallée de Chamonix il y a environ 14 500 ans. Ce stade de retrait est attesté par la moraine du Clot (1120 m) en rive droite du verrou cristallin des Houches9. C’est la dernière période où le glacier de la vallée de Chamonix présente encore l’aspect d’un glacier de vallée, alimenté par ceux du massif du Mont-Blanc, et principalement par la Mer de Glace : l’analyse pétrographique de la moraine du Clot montre qu’elle est composée de granites du Mont-Blanc, sans matériel provenant des Aiguilles Rouges.
Il y a 14 500 ans, les interstades tempérés du Bølling et de l’Allerød portent un coup fatal aux derniers glaciers de vallée würmiens. Le net refroidissement du Dryas récent il y a 12 500 ans permet toutefois l’avancée des langues glaciaires sur plusieurs kilomètres, dont témoignent les vallums morainiques déposés dans toutes les hautes vallées à l’aval des moraines holocènes. La Mer de Glace, en particulier,
9 Dorthe-Monachon, 1986. 9 dorthe-Monachon, 1986.
71
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
70
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
Reconstitution paysagère (à partir de la photo ci-dessus)de l’englacement de la vallée de Chamonix pendant le Dryas récent, il y a 12 000 ans environ. On distingue au fond la Mer de Glace et le glacier d’Argentière jointifs, s’avançant dans un lac à l’emplacement actuel du centre ville ; au premier plan les glaciers de Taconnaz et des Bossons, réunis, scindent le lac en deux parties photo s. CoutterAnd, 2006 © Alpes MAgAzine
73
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
72
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
a construit lors de cette extension un complexe morainique bien étudié, défini comme stade de Chamonix par Mayr10. Les moraines frontales et latérales les plus remarquables de ce complexe sont la moraine du Casino au centre-ville de Chamonix, haute de 5 à 6 mètres sur son flanc interne ; celle du Lavancher, moraine latérale droite de la Mer de Glace immédiatement à l’amont de sa confluence avec le glacier d’Argentière ; et, en rive gauche au niveau du Biollay, trois moraines étagées à 1 091 m, 1 062 m et 1 057 m11. Dans la vallée occupée actuellement par la Mer de Glace, on peut observer une moraine au pied de l’escarpement de la Tête de Trélaporte (2 200 m), soulignée par le chemin du refuge d’Envers des Aiguilles. Plus à l’aval, le Grand hôtel du Montenvers est construit sur une moraine latérale à gros blocs erratiques de granite, prolongée vers 1 800 m d’altitude par deux cordons morainiques incurvés vers Chamonix.
Viollet-le-Duc a proposé une reconstitution très cohérente de la Mer de Glace débouchant dans la vallée de Chamonix au Dryas récent en s’appuyant sur son illustration de 1874. La représentation de la langue glaciaire est très réaliste, cependant l’extension des glaciers latéraux paraît disproportionnée. Nous proposons une reconstitution basée sur la géomorphologie. Cette récurrence de la Mer de Glace a eu lieu en contexte glacio-lacustre, le front du glacier atteignant le paléo-lac qui occupait le fond de la vallée. Un peu plus en aval, le complexe glaciaire des Bossons-Taconnaz scindait le paléo-lac en deux.
Les teMps post-gLaciaires
La période holocène, qui représente l’interglaciaire actuel, a débuté il y a 11 700 ans. Elle a été marquée par une variabilité climatique faible – l’amplitude thermique n’y aurait en effet pas dépassé 2°C. Suite à une déglaciation très rapide, les glaciers acquièrent une taille « moderne » dès le début de l’Holocène. Il y a environ 10 000 ans, les fronts des glaciers alpins avaient déjà reculé jusqu’à des positions proches de celles de la fin du xxe siècle.
Depuis quelques années, de nombreux bois subfossiles sont découverts aux fronts de glaciers des Alpes centrales et orientales actuellement en retrait. Ces fragments de troncs, conservés dans les sédiments (glaciaires, lacustres, tourbeux…) pendant plusieurs centaines voire milliers d’années, ont gardé toutes les caractéristiques du bois du fait de cet environnement anoxique. Ils prouvent que des arbres parfois centenaires avaient colonisé à cette époque des espaces qui ne sont à présent déglacés que depuis quelques années, voire encore sous la glace aujourd’hui. Ces retraits ont accusé un maximum lors de l’optimum climatique holocène, entre 7 500 et 6 500 ans avant aujourd’hui, qui
10 Mayr, 1969.11 Lucena, 1998.
10 Mayr, 1969.11 Lucena, 1998.
Cet arbre subfossile retrouvé dans la moraine latérale de la Mer de Glace, en face du
Montenvers, a permis d’identifier une avancée glaciaire datant de la fin de l’époque romaine (ses racines plongent toujours dans le paléosol,
montrant qu’il n’a pas été déplacé). La datation au carbone 14 a révélé qu’il était
mort lors d’une avancée glaciaire entre 130 et 430.
photo W. Wetter
Sol fossile dans la moraine latérale droite de la Mer de Glace. Cet arbre couché, en contact avec le sol a permis de dater (au carbone 14) l’avancée glaciaire qui l’a tué, et donc le début du Petit âge glaciaire : entre 1165 et 1400.photo W. Wetter
75
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
74
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
a été la période la plus chaude de ces 10 000 dernières années et qui a connu un englacement plus réduit qu’à l’heure actuelle12.
Dans la seconde moitié de l’Holocène, en réponse notamment au changement du forçage orbital (baisse de l’insolation estivale dans l’hémisphère nord), les épisodes climatiques froids se sont multipliés et les fronts des glaciers ont réavancé. Cette période dite Néoglaciaire commence dans les Alpes il y a 3 000 à 4 000 ans13 et comprend plusieurs épisodes froids, dont le plus récent est le Petit âge glaciaire entre 1300 et 1850. Chacun de ces épisodes froids a été marqué par plusieurs crues glaciaires.
Mise en œuvre récente de La dendrogLacioLogie
L’étude des fluctuations glaciaires pendant la période holocène a fait de grandes avancées ces dernières années grâce à l’amélioration des méthodes de datation. La méthode la plus anciennement utilisée est la datation au carbone 14, qui permet de dater des restes de matière organique (sol, bois, tourbe) enfouis sous des sédiments lors d’une avancée glaciaire. Sa précision (+/- 100 ans) est cependant trop faible pour établir des chronologies à haute résolution.
Depuis une trentaine d’années, la dendrochronologie, méthode de datation qui repose sur l’analyse des cernes de croissance des végétaux, a été appliquée à l’étude des fluctuations glaciaires, les précisant grandement14. Les pionniers en « dendroglaciologie » sont des chercheurs suisses, autrichiens et canadiens qui ont établi des chronologies glaciaires très précises basées sur des datations dendrochronologiques de bois subfossiles15. Les résultats les plus précis proviennent de la datation de bois subfossiles in situ (c’est à dire toujours en place dans leur position de croissance) dans la marge proglaciaire, l’espace au sein duquel le glacier a fluctué. Ils permettent de reconstituer la position du glacier dans l’espace et dans le temps, à l’année près si l’écorce est conservée. L’interprétation des bois détritiques retrouvés dans la marge proglaciaire est plus problématique ; ils n’apportent pas d’information spatiale, car ils peuvent provenir d’arbres installés sur les versants, transportés par une avalanche, un glissement, etc.
Les secteurs les plus propices à l’étude des fluctuations glaciaires holocènes sont les moraines latérales qui flanquent la plupart des glaciers tempérés dans le monde ; bâties lors d’avancées glaciaires successives, elles peuvent atteindre 150 à 200 mètres de haut. Elles permettent d’étudier la période antérieure au Petit âge glaciaire : alors que les moraines frontales des avancées antérieures ont le plus souvent été recouvertes par les dépôts du Petit âge glaciaire, la mise au
12 Nicolussi et Patzelt, 2000 ; Nicolussi et Patzelt, 2001 ; Hor-mes et al, 2001 ; Joerin et al, 2008.13 Ivy-Ochs et al, 2009.14 Holzhauser, 1984 ; Luckman, 1998 ; Le Roy et al, 2009.15 Holzhauser et al, 2005.
12 nicolussi et patzelt, 2000 ; nicolussi et patzelt, 2001 ; hormes et al, 2001 ; Joerin et al, 2008.13 ivy-ochs et al, 2009.14 holzhauser, 1984 ; Luckman, 1998 ; Le roy et al, 2009.15 holzhauser et al, 2005.
Ce pin cembro parfaitement conservé (l’écorce est présente) a été retrouvé
une trentaine de mètres sous la crête de la moraine latérale droite
de la Mer de Glace. La dendrochronologie
(l’étude de ses cernes de croissance) a permis de dater la crue
glaciaire qui l’a tué: vers 1120.photo M. le roy
Des restes d’écorce sur ce tronc (le plus grand à avoir été échantillonné) ont permis d’en dater la mort à l’an 777 avant Jésus-Christ. D’abord repéré dans la moraine, sa chute sur le tablier d’éboulis en a facilité l’échantillonnage. photo M. le roy
76
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
jour du flanc interne des moraines latérales lors des retraits glaciaires révèle des strates qui contiennent des débris organiques. Cela est dû à leur mode de construction par superposition – le dépôt d’une avancée glaciaire recouvrant celui de l’avancée précédente. Ces strates organiques résultent de la colonisation végétale de la crête de la moraine lors des phases de retrait glaciaire, avec formation d’un sol, combinée à l’accumulation d’arbres morts provenant des versants boisés et qui peuvent se conserver plusieurs siècles avant de se décomposer. La datation des troncs conservés dans ces horizons organiques renseigne donc sur la durée des phases de retrait. De plus, ceux qui ont gardé leur écorce et qui sont en contact avec un paléosol (ou sol fossile) donnent un âge maximum proche pour l’avancée glaciaire qui les a enfouis. Enfin, les arbres in situ dont les racines sont en contact avec le paléosol
datent exactement l’avancée glaciaire qui les a tués.
reconstituer Les fLuctuations de La Mer de gLace avant 1500
Les fluctuations de la Mer de Glace ont pu être reconstituées de manière précise pour la période historique récente mais celles antérieures à 1500 ne sont pas encore bien connues malgré le travail pionnier du Zurichois Wolfgang Wetter dans les années 198016. Une étude dendroglaciologique menée au laboratoire edytem a pour but de préciser cette chronologie. Elle est basée sur l’échantillonnage exhaustif des bois subfossiles présents dans la moraine latérale droite de la Mer de Glace et dans le tablier d’éboulis à sa base. Les bois récoltés, presque exclusivement des pins cembro, vont de simples fragments à des troncs de plusieurs mètres de long. Ils présentent parfois un état de surface altéré (abrasion, déformation des derniers cernes, incrustation de graviers) qui peut indiquer leur transport avant dépôt.
La datation dendrochronologique des bois subfossiles est réalisée grâce à la synchronisation des séries de largeurs de cernes avec une courbe de référence établie dans les Alpes autrichiennes qui couvre les 9 000 dernières années17. Cette synchronisation est possible malgré l’éloignement des sites (environ 400 km) car il s’agit d’arbres qui ont poussé en altitude, proches de la limite supérieure de la forêt. Ce facteur limitant entraîne une réponse des arbres au climat – retranscrite dans la largeur des cernes – relativement similaire à l’échelle régionale.
Les bois les plus anciens retrouvés à la Mer de Glace sont morts il y a plus de 3 600 ans. La première avancée glaciaire dont on trouve la trace dans la moraine latérale droite s’est produite il y a environ 3 580 ans. Neuf avancées glaciaires majeures antérieures aux maxima historiques
17 Nicolussi et al., 2009.
1352+
1280+
465+ 1180+
970+ av.JC
1581 av.JC
~700 av.JC422+
620+ av.JC
PAG
1995
1559-1851+ AD
1234-1352+ AD
11 m
1559-1851+ AD
1234-1352+ AD
11 m
Synthèse des datations effectuées sur les bois subfossiles de la moraine latérale droite
de la Mer de Glace, en face du Montenvers. Les lignes en tiretés rouges indiquent l’altitude
minimale atteinte par la surface du glacier lors des phases d’avancées.
Les dates indiquées sont des âges maxima pour la position du glacier à l’altitude des
arbres, étant donné que ceux-ci ne sont souvent pas in situ.
La ligne en tiretés épais indique l’extension maximale du PAG ; celle en tiretés fins indique la position du glacier en 1995,
lors de sa dernière avancée.
Aperçu du site qui a permis de dater l’avancée majeure de la Mer de Glace au xive siècle. Celle-ci marque le premier maximum du
glacier pendant le Petit âge glaciaire. Les deux bois dont les datations sont présentées
ici encadrent le dépôt de la partie sommitale de la moraine qui a donc eu lieu après 1352,
mais avant 1559 (date de germination de la souche).
Ce site est indiqué par une étoile sur la photo du bas.
(Le signe + après une date dendrochronologique indique qu’il s’agit d’un âge minimum pour la date de mort
de l’arbre car les cernes externes ne sont plus présents du fait de l’abrasion du tronc).
photo M. le roy
1. après une période chaude pendant laquelle la crête de la moraine a été soumise à la recolonisation végétale, à la pédogénèse (formation d’un sol), et à l’accumulation d’arbres tombés du versant ; le glacier entame une phase de crue.
2. La première phase de crue a exhaussé la crête de la moraine. après un retrait, le glacier entame une nouvelle crue plus importante que la précédente qui entraîne la fossilisation d’une nouvelle strate de débris organiques.
3. Le glacier en décrue libère la moraine latérale, sur laquelle des troncs se déposent à nouveau.
4. La décrue continue, la moraine est érodée et sa base est recouverte d’un tablier d’éboulis qui contient des bois subfossiles. dans le même temps des bois et sols fossiles sont mis au jour à plusieurs niveaux de la moraine en place.
Origine des bois subfossiles présents dans les morainesLes moraines se construisentpar superposition – le dépôt d’une avancée glaciaire recouvrant celui de l’avancée précédente.
16 Wetter, 1987.17 nicolussi et al., 2009. 77
L’e
mpr
eint
e de
s gl
acia
tions
79
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
78
L’em
prei
nte
des
glac
iatio
ns
du Petit âge glaciaire ont pu être identifiées sur les 4 000 dernières années à partir de la datation d’une soixantaine de troncs18. Elles sont suivies par les trois maxima historiques de la seconde moitié du Petit âge glaciaire : en 1644, 1821 et 1852. La dendrochronologie a ainsi fourni une date plus précise que le radiocarbone pour la première avancée maximale du Petit âge glaciaire. Un fragment de bois (auquel il manque quelques cernes périphériques et qui n’était pas in situ) échantillonné dans un lit tourbeux, 11 mètres sous la crête de la moraine latérale droite, a donné un âge maximum de 1352 + pour l’avancée qui a enfoui le tronc. Cette première avancée de la Mer de Glace au Petit âge glaciaire a donc eu lieu dans la seconde moitié du xive siècle. A quelques mètres de cet échantillon, la datation d’une souche in situ en bordure de la crête morainique montre qu’un arbre a vécu à cet endroit entre le milieu du xvie siècle et celui du xixe siècle. D’après ces datations, le scénario suivant peut-être avancé : pendant la première partie du Petit âge glaciaire la crue glaciaire a exhaussé la crête de la moraine d’une dizaine de mètres avant qu’elle ne soit colonisée par la végétation, dont ce pin cembro qui a vécu trois cents ans à cet endroit. La croissance de cet arbre à partir du xvie siècle suggère que le glacier n’a plus ré-atteint sur ce site son ampleur du xive siècle. Le premier maximum du Petit âge glaciaire dans la seconde moitié du xive siècle a donc été pour la Mer de Glace l’un des principaux maxima du Petit âge glaciaire et de l’Holocène, équivalent à celui de 1644 considéré jusqu’alors comme son maximum maximorum.
Ces résultats sont concordants avec les chronologies glaciaires établies dans le reste des Alpes pour la seconde moitié de l’Holocène, à savoir des épisodes glaciaires d’amplitude et de fréquence croissantes qui culminent lors de trois avancées paroxysmales durant le Petit âge glaciaire 19. La base de la moraine latérale, quant à elle, a été construite lors d’avancées plus vieilles que 3 600 ans : peut-être lors d’une des premières avancées du Néoglaciaire, ou au tout début de l’Holocène, période qui a connu quelques crues relativement importantes selon les travaux menés dans les Alpes centrales et orientales.
18 Les quatre premières avant notre ère, vers –1580, après –970, vers -777 et vers -600, les cinq suivantes après 290, après 525, vers 1180, vers 1295, et après 1352.19 Nicolussi et Patzelt, 2001 ; Holzhauser et al, 2005.
La dendrochronoLogie
sous un climat tempéré où les saisons imposent aux arbres une alternance entre période d’activité végétative et période de repos, ceux-ci produisent un cerne de croissance annuel composé de bois de printemps, clair, et d’été, sombre. La largeur de ce cerne varie en fonction du climat pendant la saison végétative : plus la température est élevée, plus la saison végétative est longue et plus le cerne est large.sous un même climat tous les arbres d’une même essence réagissent de façon similaire (guibal, 1998). de ce fait, des séquences de cernes similaires (alternance de cernes fins et larges) communes à plusieurs arbres constituent des repères chronologiques utilisables pour synchroniser (interdater, dans le langage dendrochronologique) des séries de cernes (schweingruber, 1988 ; guibal, 1998). cette interdatation s’effectue grâce à des tests statistiques confirmés par un examen visuel.Identifier les cernes ou les séquences caractéristiques et attribuer à chaque cerne l’année exacte de sa formation est à la base de la construction des chronologies dendrochronologiques de référence. celles-ci sont construites à partir d’arbres vivants dont l’année du dernier cerne sous l’écorce est connue puis en remontant le temps avec des bois provenant de différentes sources. L’interdatation permet ensuite d’attribuer une date absolue à des séries de cernes individuelles non datées (comme les bois subfossiles de la moraine de la Mer de glace) en les comparant avec la chronologie de référence.L’intérêt majeur de la dendrochronologie est sa résolution annuelle voire saisonnière. Mais dans le cas de bois subfossiles, cette résolution est conditionnée par le degré de conservation de l’échantillon (présence ou non de l’écorce ou de l’aubier) et l’absence éventuelle de cernes périphériques due à l’érosion du tronc dont le nombre est difficile à déterminer.
pin cembro âgé de plus de 750 ans en bordure du glacier des Bossons.
tourbière en limite supérieure de la forêt, qui peut renfermer des troncs subfossiles.
pièce de charpente d’un chalet d’altitude.
tronc subfossile en position stratigraphique dans une moraine latérale.
18 Les quatre premières avant notre ère, vers –1580, après –970, vers –777 et vers –600, les cinq suivantes après 290, après 525, vers 1180, vers 1295, et après 1352.19 nicolussi et patzelt, 2001 ; holzhauser et al, 2005.