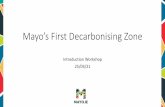Les Cardioceratinae (Ammonitina) de la Sous-zone à Cordatum (Zone à Cordatum, Oxfordien...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les Cardioceratinae (Ammonitina) de la Sous-zone à Cordatum (Zone à Cordatum, Oxfordien...
Cardioceratinae (Ammonitina) from the Cordatum Subzone (Cordatum Zone, Lower Oxfordian) at Villers-le-Tourneur–Neuvizy area (Ardennes,France). - Abstract: Temporary outcrops at Villers-le-Tourneur–Neuvizy area enabled the observation and biostratigraphical dating of the ‘Ooliteferrugineuse de Villers-le-Tourneur–Neuvizy’. This quite thick, marly unit has yielded silicified fossils that have been renowned since the 19th century. Indetail, the formation records the succession of several faunal associations, characterizing the main subzones of the Cordatum Zone (late Lower Oxfordian)and the Plicatilis Zone (early Middle Oxfordian). These early Oxfordian associations are widely dominated by the family Cardioceratidae, such a structurebeing related to the ‘subboreal associations’ typically represented in Great Britain. Amongst many other species, Cardioceras cordatum (SOWERBY 1813)corresponds to a rare taxon or morphotype that occurs in the basal part of the formation. Then, the ultimate Lower Oxfordian faunal association isdominated by ammonites related to C. persecans. Other main taxa are rare ‘Goliathiceras’, various and quite common ‘Pachycardioceras’, several rare buttypical ‘Vertebriceras’, ‘Sagitticeras’, ‘Plasmatoceras’, and poorly documented ammonites which probably belong to primitive ‘Scoticardioceras’ and‘Subvertebriceras’.
Keywords: Ammonites, Cardioceratidae, Lower Oxfordian, Upper Jurassic, morphology, Subboreal Realm.
63
Géographie - Paléogéographie
Au Jurassique, autour de la limite Dogger-Malm, la partiesud de l’actuel Massif ardennais est localisée sur la marge nordde plates-formes marines au nord-est du Bassin anglo-parisien,immédiatement au sud des zones émergées constitutives dumassif Londres-Brabant (fig. 1-A). Conséquemment, les faunesd’ammonites sont parfaitement représentatives des associationssubboréales (Cariou & Hantzpergue, 1997), alors largement
dominées par la famille des Cardioceratidae, et régulièrementassociés à des Aspidoceratidae (Arkell, 1939-48 ; Marchand,1986 ; Page et al., 2009).
Les faunes oxfordiennes de Neuvizy près de Charleville-Mézières (fig. 1-B) sont connues depuis les grandesmonographies de la “Paléontologie Française” du 19e siècle(Bayle, 1879 ; d’Orbigny, 1842-1850 ; Cotteau, 1885 ; deLoriol, 1889...). La conservation originale des invertébrés sousla forme de moulage silicifiés roux et légers les rend trèsfacilement repérables dans les collections. En outre, les
Philippe COURVILLE (1) & Alain BONNOT (2)
(1) Université de Rennes-1/UMR CNRS 6118 Géosciences Rennes, Campus Beaulieu, F-35042 Rennes Cedex - [email protected]
(1) Centre des Sciences de la Terre et Laboratoire de Paléontologie analytique et Géologie sédimentaire associé au C.N.R.S, UMR 5561, 6 boulevard Gabriel, F-21000 Dijon
Fossiles, hors-série II
Les Cardioceratinae (Ammonitina) de la Sous-zone à Cordatum (Zone à Cordatum, Oxfordien inférieur)
Neuvizy – Villers-le-Tourneur (Ardennes, France)
Fig. 1 - Localisations paléogéographique (A, modifié d’après Waterlot et al., 1973) et géographique (B, modifié d’après Lorin et al. 2004) de l’affleurement de Villers-le-Tourneur (Ardennes, France). C, Cardioceras cordatum, espèce-indice de la Zone à Cordatum.
FHS2-08-Ardennes:FHS2-08-Ardennes 13/02/12 18:52 Page63
couches oxfordiennes de Neuvizy ont la réputation derenfermer Cardioceras cordatum (SOWERBY 1813), l’une desespèces les plus classiques du Jurassique supérieur (fig. 1-C).
C’est très anciennement qu’Alcide d’Orbigny (1852) avaitutilisé C. cordatum comme indice d’une zone de l’étageOxfordien ; ensuite, il a fallu attendre les travaux d’Arkell(1936, 1941), pour que l’unité biostratigraphique et son calageà la fin de l’Oxfordien inférieur acquièrent leur sens “moderne”(Cariou & Hantzpergue, 1997). A cette occasion, Arkell définitégalement les trois sous unités qui en sont constitutives, dont laSous-zone à Cordatum est la plus récente.
Historiquement, les ammonites et autres invertébrés deNeuvizy étaient surtout récoltés dans les formationssuperficielles (“ocres, minerai de fer”), souvent riches enconcentrations d’ooïdes ferrugineux ou de fer, et résultats del’altération des formations sous-jacentes (Bonte & Hatrival,1966 ; Waterlot et al., 1973). Quelques petites exploitationsrésiduelles subsistaient encore lors de la réalisation de nosobservations, et il est toujours possible de récolter denombreux fossiles à l’emplacement des anciens lavoirs àminerai de fer.
Par contre, il semble que les observations détaillées dans lesformations oxfordiennes elles-mêmes aient été très rares. Entre1997 et 2002, des conditions exceptionnelles d’affleurement àVillers-le-Tourneur près de Neuvizy (fig. 1-B), liées aux travauxautoroutiers de l’A 34, ont permis d’observer une grande partiede la série callovo-oxfordienne sur plus de 40 m d’épaisseur. De
nombreuses données faciologiques, paléontologiques etstratigraphiques ont pu être obtenues dans des conditionsprobablement jamais égalées depuis le 19e siècle, et ont étéprésentées dans un travail récent (Courville et al., 2011). Ce quisuit le complète et le prolonge ; il a pour objet la présentationdétaillée des Cardioceratinae rencontrés et récoltés en place dansles sédiments à oolites ferrugineuses datés de la Sous-zone àCordatum, et dans les unités les encadrant.
[Récoltes : G. Cuif, J.-C. Dudicourt, P. Courville; coll. : PC-Rennes ; photos : A. Bonnot (échantillons blanchis) et P. Lebrun(échantillons en couleur naturelle)].
Les Cardioceratinae de la Sous-zone à Cordatum
Cardioceras cordatum (SOWERBY 1813)
Aspects historiques : Cardioceras cordatum a sans douteété l’une des espèces du Jurassique supérieur les plus citéesdepuis sa création par Sowerby au début du 19e siècle (1813 :51, pl. 17:4) : on pourra se référer, par exemple, aux travaux deBoursault (1977), Buckman (1920), Callomon (1985), Cariou& Hantzpergue (1997), Collin & Courville (2000), Gygi &Marchand (1982), d’Orbigny (1849)... Les révisions les plusimportantes de l’espèce et des formes affines de la sous-zonequ’elle caractérise ont été celles d’Arkell (1936, 1946) et deMarchand (1986).
Après avoir été interprétée morphologiquement de façon
64Fossiles, hors-série II
Lithologiquement, l’Oolithe ferrugineuse de Villers-le-Tourneur correspondà une série d’environ 5 m, de teinte blanchâtre, rouille ou jaunâtre, où
alternent des marnes peu indurées irrégulièrement litées, et des bancs pluscalcaires, l’ensemble étant très riche en ooïdes ferrugineux.
Par rapport à ce qui est connu à des niveaux stratigraphiques comparablesailleurs en France ou en Europe (Callomon, 1985 ; Collin & Courville, 2000 ;Courville & Bonnot, 1998 ; Courville & Collin, 2002 ; Gygi & Marchand,1982 ; Jeannet, 1951 ; Marchand & Gygi, 1977 ; Marchand & Tarkowski,1992 ; Tarkowski & Marchand, 2004), cette formation à “ooïdes” ferrugineux
est remarquable par son épaisseur importante (moins “condensée”), ainsi quepar la relative “rareté” de sa faune ammonitique (plus “diluée” = moins“concentrée” ; Courville & Collin, 2002). En outre, sur tout le secteurd’observation, elle est recouverte par un mètre au minimum (jusqu’à 4 m aumoins à l’est de l’affleurement), d’argile ocre compacte ou très plastique, avecconcentrations d’ooïdes, de fossiles siliceux souvent partiels, et même de blocsde calcaire à ooïdes ferrugineux. Il ne fait aucun doute que ce faciès résulte del’altération de l’Oolite ferrugineuse (“minerai de fer”, Bonte & Hatrival, 1966).
Succession et repères lithostratigraphiques intra-Oolite ferrugineuse.
Cette série (unités VII et VIII) est assez homogène enapparence, mais on peut distinguer :
• à 0,2 m de la base, existe un niveau rouge (banc “R” =base 53), riche en gros “corps ferrugineux” et en galetsroulés centimétriques à décimétriques, laminés, parfoissphériques, englobant souvent des fossiles nettementperforés et encroûtés par de petites huîtres et, surtout, desserpules ; la partie supérieure de ces “intraclastes” estrecouverte d’un liant et d’un enduit ferrugineux luisants ; ilstémoignent d’une période de vacuité sédimentaire propiceau remaniement, d’une durée brève, à l’intérieur de la Zoneà Cordatum. Les rares ammonites récoltées sont des formeshabituelles dans la Sous-zone à Costicardia (Courville et al.,2011).
Sur 1,5 m environ, se développent ensuite les marnes de laSous-zone à Cordatum.
• à 0,7 m de la base de 53, un lit avec nombreuxEuaspidoceras ; beaucoup de Cardioceratinae ont étérécoltés dans les 0,2 m au-dessous et dans les 0,2 m au-dessus de ce lit (unité VIII, banc 53) ;
• à 1,5 m de la base (unité VIII, jonction 53/54), niveauinduré de 10 cm, très plan et constant, où abonde ungastéropode (Pseudomelania sp.). Dans les 0,3 m sous-incombants, existe une véritable communauté à échinides(Nucleolites scutatus (LAMARCK 1816), associé à unHyboclypus voisin de H. gibberulus (AGASSIZ 1839)). Detelles faunes sont déjà connues à un niveau plus récent(Laurin & Marchand, 1978) ;
• la série de la Sous-zone à Cordatum se termine au milieudu banc 54, sous un joint argileux centimétrique verdâtreassez constant (V). L’ensemble est caractérisé par desniveaux argileux peu indurés, moins fossilifères et souventblanchâtres sur 1 m.
Les marnes postérieures à ce niveau V, mal litées sur 1 m(unité VIII, fin du banc 54 et bancs 55-56) montrent souventdes inclusions ou des “galets” d’argile verdâtre ; ellesrenferment une faune typique mais très ancienne del’Oxfordien moyen, étudiée en partie et discutée dans letravail de 2011.
Succession lithologique (numérotation des bancs conservée d’après Courville et al., 2011)
Fig. A - Succession lithologique dans l’Ooliteferrugineuse de Villers-le-Tourneur (modifié d’après undétail de la coupe publiée in Courville et al., 2011).Prélèvements : numérotation d’après Cuif (2000), utiliséepour la localisation verticale des ammonites figurées.
FHS2-08-Ardennes:FHS2-08-Ardennes 13/02/12 18:52 Page64
65 Fossiles, hors-série II
1a, 1b : individu proche du lectotype, mais tendant vers la forme costicordatum ARKELL 1945 par sa densité costale finale ; [M ou m ?], Dmax = 57 mm ;phragmocône adulte sans chambre d’habitation. + 50/70 cm, niveau à Euaspidoceras.
2 : individu le plus proche du lectotype figuré par Arkell (1945 : 68-1) ; [m] probable, Dmax = 55 mm ; phragmocône adulte avec le début de la chambre d’habitation.+ 30/40 cm. 2b : silhouette en vue ventrale.
3 : individu évolute et très épineux, à tubercule latéral décalé vers le haut du tour (morphologie “percoelatum PAVLOW 1914” ; [m] , Dmax = 50 mm ; phragmocôneadulte complet. + 20/25 cm. 3b : silhouette en vue ventrale.
4a, 4b : individu typique de la forme angusticordatum ARKELL 1945 ; [m] probable, Dmax = 62 mm ; phragmocône adulte complet. + 30/50 cm.5a, 5b : individu très voisin de C. angusticordatum ARKELL 1945, à costulation plus dense et persistante ; [M] probable, Dmax = 80 mm ; phragmocône adulte
complet. + 10/20 cm.6 : individu à costulation peu marquée et lâche ; [M], Dmax = 90 mm ; phragmocône adulte complet. + 0/30 cm.7 : individu à costulation dense et très peu persistante ; [m], Dmax = 52 mm ; phragmocône adulte complet. + 20/50 cm.8a, 8b : individu à costulation dense, marquée et persistante, très proche de la forme costicordatum ARKELL 1945 ; [M ?], Dmax = 57 mm ; phragmocône juvénile
complet. + 0/20 cm.
Fig. 2 - Cardioceras cordatum (SOWERBY 1813) - Oxfordien inférieur, Zone à Cordatum, Sous-zone à Cordatum. m : début de la chambre d’habitation.
FHS2-08-Ardennes:FHS2-08-Ardennes 13/02/12 18:52 Page65
variée et souvent confuse pendant un siècle et demi, C. cordatum a été remarquablement réétudiée par Arkell enplusieurs étapes : discussion et désignation d’un lectotype(1936), puis refiguration et discussion de son originestratigraphique et géographique, ainsi que des espèces affines,dans une monographie richement illustrée éditée en 1946.
L’espèce restreinte au sens morphologique d’Arkell (1946)et la cohorte d’ “espèces” ou de formes affines qui lui sontassociées dans les “Lower Calcareous Grits” du Wiltshire(Angleterre) sont strictement confinées à l’intérieur de la sous-zone nominale. Les ammonites évoquées et illustrées ci-aprèscorrespondent à des formes qui n’ont été que très rarement etincomplètement figurées en Europe occidentale postérieurementà Arkell (cf., par exemple, Boursault, 1977 [pars.] ; Gygi &Marchand, 1982 [pars.] ; Marchand, 1986 [pars.]).
Pourtant, restreinte au sens (morphologie et âge) donné parArkell (1946), C. cordatum paraît rare en Europe. Parmi lesammonites rapportées à l’espèce par d’Orbigny (1849), seulecelle illustrée planche 194, figure 4, est considérée commeproche de C. cordatum par Arkell [1946 : 312] ; il compare lesautres formes (fig. 1 à 3) à Vertebriceras quadrarium BUCKMAN1926. Les ammonites illustrées par d’Orbigny provenaientd’ailleurs du minerai de fer de Neuvizy (Ardennes). Les travauxde la fin du 20e siècle suggèrent que seules quelques formes deSuisse (Gygi & Marchand, 1982) ou de Pologne (Marchand &Tarkowski, 1992 ; Matyja & Tarkowski, 1981), peuvent êtreattribuées au même morphotype de façon convaincante. Acelles-ci s’ajoutent évidemment les nombreuses formes figuréespar Marchand (1986) : la plupart de ses ammonites rapportées àCardioceras cordatum (espèce que l’auteur conçoit dans unsens extrêmement large), provient de Neuvizy.
“Pattern” ornemental général des Cardioceratinae de laSous-zone à Cordatum : par définition (Buckman, 1920 : 15), C. cordatum est l’espèce-type du genre Cardioceras str. s.(= sous-genre Cardioceras sensu Arkell, 1941 : 24). Pourl’essentiel, ces ammonites sont caractéristiques de la sous-zonenominale (ibidem).
Selon Arkell (ibidem, repris par Arkell in Arkell et al.,1957), Cardioceras str. s. (c’est-à-dire le style ornemental desCardioceratinae de la Sous-zone à Cordatum) est caractérisé :
(1) par une taille moyenne à grande ; [50-200 mm ?] ;(2) par des tours internes et moyens fortement costulés, et
des tours externes et chambres lisses, au moins sur les plusgrandes coquilles ;
(3) par des côtes clairement différenciées en primairesfortes et secondaires plus nombreuses et moins marquées, cesdernières brutalement flexueuses vers l’avant (proverses) ;[individualisation fréquente de tertiaires vers le ventre, nonévoquée par Arkell] ;
(4) par une section cordiforme ;(5) par une carène très surélevée et très dentelée, les
denticulations était clairement reliées aux secondaires de partet d’autre de la région ventrale.
Dans sa description, Arkell n’insiste pas sur l’effacement (oul’affaissement ?) caractéristique des côtes (sans disparition) à lajointure primaires-secondaires ; corrélativement, dessecondaires courtes en résultent. Egalement, les secondaires sontcourbes et inclinées vers l’avant sur tout leur parcours ; lefléchissement anguleux des côtes au voisinage de l’épaulementlatéro-ventral caractérisera les formes de l’Oxfordien moyen,d’ailleurs souvent associé à des primaires et secondaires plusrectiradiées.
Ces caractères, assez largement identifiés par Marchand(1986), sont plus ou moins nettement exprimés en fonction destypes morphologiques, comme nous le verrons plus loin : [M]ou [m], variants plus ou moins épais, ornementation plus oumoins vigoureuse et dense...
Caractéristiques morphologiques de C. cordatum str. s. : lelectotype désigné par Arkell (1936) est une ammonite de 55 mm totalement cloisonnée et il n’y a pas de renseignementsur l’approximation des cloisons, donc pas d’évaluation de sonstatut sexuel ; notons que Marchand (in Gygi & Marchand,1982) le considère comme un macroconque. Coquille
moyennement épaisse (E/D = 0,41), plutôt évolute (O/D = 0,33) ; ornementation assez lâche et vigoureuse : 14-15 primaires seulement, flexueuses ; primaires abaisséesentre un tubercule ombilical et un tubercule latéral (plus élevé) ;tubercule latéral épineux, au-dessus du mi-flanc ; 2 secondaires et intercalaires très régulièrement espacées ;effacement caractéristique (sans disparition) à la séparationprimaires-secondaires ; corrélativement, secondaires courtes,courbes et inclinées vers l’avant sur tout leur parcours (unelivrée commune à tous les Cardioceratinae de la sous-zone) ;tertiaires nombreuses et grossières, sculptant grossièrement lacarène qui est très élevée.
Comme Arkell (1946) l’a remarqué, le lectotype réalise untype morphologique rare : il associe une section moyennementdéprimée à carène haute et une ornementation lâche etgrossière. Ses variétés costicordatum (plus mince, ombiliclarge et densément costulé), et surtout angusticordatum (plusmince et ombilic plus étroit), semblent nettement mieuxreprésentées en Angleterre.
A Villers-le-Tourneur, un unique individu remarqua-blement semblable au lectotype anglais a été récolté parmi 250Cardioceratinae, dans le niveau riche en Euaspidoceras (fig. A).Plusieurs autres exemplaires sont très proches, tous issus de labase du banc 53. Cet exemplaire sans chambre d’habitationatteint 55 mm et montre des cloisons rapprochées.Manifestement adulte, il pourrait s’agir d’un microconqued’assez grande taille (ombilic ouvert, ornementationpersistante…), dont la taille finale atteindrait 75 à 80 mm.Remarquons que le lectotype anglais est très comparable(niveau d’évolution de la coquille, taille finale observée de lacoquille ; Arkell, 1946, pl. 68:1), ce qui pourrait suggérer qu’ils’agit également d’un [m] ; la même remarque s’applique ausecond individu (topotype, Arkell, 1946, pl. 68:2).
A Villers-le-Tourneur comme en Angleterre, les formesprédominantes affines avec C. cordatum str. s. sont plus minces,plus involutes et plus graciles que le lectotype, et donc prochesde la variété angusticordatum. Là encore, cette ammonitepourrait correspondre à un grand [m], mais ce typemorphologique caractérise également les tours internes degrandes coquilles dépassant 200 mm, indéniablement [M].L’autre variété d’Arkell (costicordatum : plus mince et ombiliclarge, densément costulée), semble bien moins fréquente àVillers-le-Tourneur. Parmi les variants sans doute [m], existentquelques formes non mentionnées par Arkell : coquillesmoyennement épaisses, à carène élevée, ornementation lâchemais vigoureuse, avec tubercule latéral très déporté côté latéro-ventral ; ces formes évoquent C. percoelatum (PAVLOW 1914) deRussie, notamment celles figurées par Kniazev (1975) (fig. 2:3).
Les variants de C. cordatum sont abondants (surtout C.angusticordatum) entre le niveau R et le banc à Pseudomelania,et ils persistent, rares, au début du banc 54. C. cordatum str. s. etles variants voisins sont surtout illustrés fig. 2.
Morphotypes, formes ou espèces de Cardioceratinaestrictement associés à C. cordatum
Plusieurs groupes morphologiques accompagnent plus oumoins rarement C. cordatum str. s. dans le banc 53. Les formesrécoltées en place (PC, G. Cuif & J.-C. Dudicourt) sontfigurées de façon exhaustive figures 3 à 6.
Les macroconques : les [M] atteignant de grandes tailles(cloisonnés au-delà de 150 mm) sont rares ou rarementrécoltés, très fragmentaires ; les coquilles moyennementépaisses dominent, possédant une ornementation visible bienqu’atténuée jusque vers 80-90 mm. Typiquement, les toursinternes sont de type cordatum str. s. ou var., sur une coquille àombilic plus réduit au même diamètre. Celles-ci peuventobjectivement être baptisées C. cordatum également. Notonsque C. galeiferum BUCKMAN 1926, du même niveaustratigraphique en Angleterre, est également une forme degrande taille, épaissie près de l’ombilic, restant très involute, àcarène très élevée ; si le niveau est bien le même, ce nompourrait être synonyme et servir pour décrire certains [M] ;pour l’instant, son utilisation reste discutable, dans la mesureoù ses tours internes ne sont pas connus.
66Fossiles, hors-série II
FHS2-08-Ardennes:FHS2-08-Ardennes 13/02/12 18:52 Page66
67 Fossiles, hors-série II
1a, 1b : C. cordatum f. angusticordatum ARKELL 1945 ; petit [M], Dmax = 77 mm ; adulte à chambre incomplète ; individu très comprimé à côtes nombreuses,graciles et persistantes. 54/0 cm.
2a, 2b : C. aff. persecans BUCKMAN 1923 ; [m] probable, Dmax = 47 mm ; phragmocône évolute complet. 20/30 cm.3 : C. persecans BUCKMAN 1923 ; [M], Dmax = 115 mm ; individu presque complet. 20/30 cm.4a, 4b : C. persecans BUCKMAN 1923 ; [M] probable, Dmax = 66 mm ; tour interne. 10/20 cm.5a, 5b : C. cf. persecans BUCKMAN 1923 ; [M] probable, Dmax = 60 mm ; tour interne relativement épais, notamment à la fin du tour externe. 10/20 cm.6a, 6b : C. ashtonense ARKELL 1945 ; [m], Dmax = 35 mm ; adulte évolute presque complet. 50/70 cm.7a, 7b : C. ashtonense ARKELL 1945 ; [m] probable, Dmax = 38 mm ; phragmocône adulte complet. 50/70 cm.8a, 8b : C. ashtonense ARKELL 1945 ; [m], Dmax = 31 mm ; adulte avec début de la chambre d’habitation. 30/40 cm.9a, 9b : C. cf. tenuicostatum (NIKITIN 1878) [Plasmatoceras] ; [m] ?, Dmax = 21 mm ; phragmocône subadulte. 20/30 cm.10a, 10b : C. aff. ashtonense ARKELL 1945 ; [m]?, Dmax = 21 mm ; tour interne dont l’ornementation est à peine plus épineuse et presque aussi gracile que chez
certains Plasmatoceras. 0/50 cm.
Fig. 3 - Cardioceratinae - Oxfordien inférieur, Zone à Cordatum, Sous-zone à Cordatum.
FHS2-08-Ardennes:FHS2-08-Ardennes 13/02/12 18:52 Page67
68Fossiles, hors-série II
1a, 1b : tour interne rapportable à C. cordatum (SOWERBY 1813) str. s. ; Dmax = 33 mm. + 0/40 cm.2a, 2b : tour interne rapportable à C. c. f. costicordatum ARKELL 1945 probable ; Dmax = 32 mm. + 30/40 cm.3 : phragmocône complet d’un juvénile rapportable à C. c. f. angusticordatum ARKELL 1945 probable ; Dmax = 30 mm. + 20/25 cm.4 : C. cyclops ARKELL 1947 [Goliathiceras] ; [m] ou [M] ; Dmax = 30 mm ; tour interne. + 0/40 cm.5 : C. og ARKELL 1947 [Goliathiceras] ; [M] ; Dmax = 100 mm ; tour interne. + 0/120 cm.6 : C. nitidum ARKELL 1947 [Pachycardioceras] ; [M] ; Dmax = 67 mm ; tour interne. + 0/20 cm.7 : C. repletum MAIRE 1938 f. compressum ARKELL 1947 [Pachycardioceras] ; [M] probable ; Dmax = 68 mm ; tour interne. + 0/20 cm.8 : C. cf. nitidum ARKELL 1947 [Pachycardioceras] ; [M] probable de petite taille ; Dmax = 68 mm ; adulte incomplet dont l’ornementation disparaît précocement.
+ 0/20 cm.9 : C. aff. stella ARKELL 1947 [Scoticardioceras ?] ; [M] très probable ; Dmax = 90 mm ; adulte sans chambre d’habitation. + 0/20 cm.
Fig. 4 - Cardioceratinae - Oxfordien inférieur, Zone à Cordatum, Sous-zone à Cordatum.
FHS2-08-Ardennes:FHS2-08-Ardennes 13/02/12 18:52 Page68
69 Fossiles, hors-série II
1a, 1b : C. cf. excavatum (SOWERBY 1815) sensu Marchand (in Gygi & Marchand, 1982) [Scoticardioceras] ; grand [M], Dmax env. 150 mm ; tour interne ;ornementation très fine et peu persistante, carène très haute. 30/40cm.
2a, 2b : C. sp. gr. excavatum (SOWERBY 1815) [Scoticardioceras] ; Dmax = 44 mm ; tour interne. 20/30 cm.3 : C. cordatum (SOWERBY 1813) subsp. indet. ; [M ou m], Dmax = 32 mm ; tour interne à section très quadratique. 0/40 cm.4a, 4b : C. quadrarium BUCKMAN 1926 [Vertebriceras] ; [m], Dmax = 68 mm ; grande chambre d’habitation. 0/20 cm.5a, 5b : C. cf. quadrarium BUCKMAN 1926 [Vertebriceras] ; proche de la f. biplicatum ARKELL 1946 ; [m], Lmax = 36 mm ; fin de phragmocône adulte. Niveau non
précisé (coll. Jaffré / A.G.A.).6a, 6b : C. altumeratum ARKELL 1946 [Vertebriceras] ; [m], Dmax = 33 mm ; tour interne. Niveau non précisé, coll. Jaffré (A.G.A.).7a, 7b : C. gr. quadrarium BUCKMAN 1926 [Vertebriceras] ; [m], Dmax = 43 mm ; tour interne. Primaires denses et rétroverses, caractère proche de la f. baylei MAIRE
1932. Niveau non précisé (coll. Jaffré / A.G.A.).8a, 8b : C. sp. [Sagitticeras] ; [m] , Dmax = 31 mm ; juvénile avec début de la chambre d’habitation. 50/70 cm.9a, 9b : C. sp irrég. ; [m], Dmax = 40 mm ; proche de certains Subvertebriceras plus récents ; phragmocône adulte complet ; ornementation originale variocostée.
0/20 cm.10a, 10b : C. cf. tenuicostatum (NIKITIN 1878) et ashtonense ARKELL 1946 [Plasmatoceras] ; [m], Dmax = 35 mm ; phragmocône subadulte ; épaisseur et
ornementation du phragmocône de type Plasmatoceras, passant brusquement à un type ashtonense. 20/30 cm.11a, 11b : C. aff. tenuicostatum (NIKITIN 1878) [Plasmatoceras] ; [m], Dmax = 22 mm ; phragmocône subadulte . 0/40 cm.12a, 12b : C. tenuistriatum BORISSJAK 1908 [Plasmatoceras] ; [m], Dmax = 33 mm ; adulte presque complet. 20/25 cm.
Fig. 5 - Cardioceratinae - Oxfordien inférieur, Zone à Cordatum, Sous-zone à Cordatum.
FHS2-08-Ardennes:FHS2-08-Ardennes 13/02/12 18:52 Page69
D’autres Cardioceratinae [M] sont plus petits, minces,possédant des flancs plans et en grande partie parallèles ; lebord latéro-ventral est anguleux et la carène très élevée ;l’ornementation, relativement persistante bien qu’effacée dès 75 mm, est constituée par des primaires plutôt larges et espacéesdans les tours internes au moins ; ce type morphologique (ou
espèce) est compatible avec la définition qu’Arkell (1948) donnede C. persecans BUCKMAN 1923 (fig. 3).
D’autres enfin, comprimées et très involutes, à carène pincéeet tours internes graciles bien ornés, ont une morphologie quin’est pas sans évoquer les Scoticardioceras, plus récents, ou ensont des “précurseurs” ; de telles formes, dont les tours internes
1 : fragment remanié de surface à encrôutement de serpules ferruginisée ; dimmax = 160 mm. Tr, trigonie (Myophorella sp.) ; EF, encroûtement ferrugineux ; Sr, serpules ; Hu, huîtresencroûtantes.
2 : intraclaste (“galet”) arrondi ferruginisé et encroûté par de petites huîtres ; dimmax = 78 mm.EF, encroûtement ferrugineux ; Sr, serpules ; Hu, huîtres encroûtantes.
3a, 3b : Cardioceras costellatum BUCKMAN 1925 ; [m] adulte avec phragmocône partiellementpréservé. Chambre en calcaire argileux oolitique ; phragmocône siliceux.
4a, 4b : Cardioceras aff. anacanthum ARKELL 1943 ; [m ?] adulte avec chambre d’habitationbrisée. Cette ammonite, incluse dans un galet, est partiellement ferruginisée (partie de lachambre) ; le dernier demi-tour de phragmocône est calcaire ; la partie interne est silicifiée.
Les deux ammonites ont un mode de fossilisation identique à celles des unités postérieures(Sous-zone à Cordatum).
Fig. B - Galets et faune de l’“Oolite ferrugineuse”, unité VII, banc “R”; Oxfordien inférieur, Zone à Cordatum, Sous-zone à Costicardia ; ammonites figurées à la même échelle, taille réelle.
Apremière vue, les ammonites légères et marron récoltées à Neuvizy au 19e siècle et celles provenant de la coupe de Villers-le-Tourneur paraissent
très différentes (fig. B et C).Les fossiles “frais” sont préservés de façon comparable dans toute la
formation, des bancs 53 à 56 : ils sont souvent assez fragiles et les tests sontfragmentés dans la roche, fréquemment partiellement dissous, bien que mieuxconservés dans les bancs calcaires sommitaux. En fait, ils sont siliceux, ainsique systématiquement, les remplissages des phragmocônes d’ammonites detaille inférieure à 50 mm. A l’intérieur des grandes ammonites qui ne sont pasrares, mais très fragiles dans la roche fraîche très tendre, on peut même souventobserver des quartz automorphes tapissant les loges. Généralement, seules depetites portions du phragmocône des plus grandes ammonites sont trèspartiellement silicifiées ; de même, les chambres d’habitation sont souventprésentes, mais leur remplissage est constitué par la gangue environnante trèsaltérable, voire meuble. Ceci explique l’absence généralisée dans lescollections, des chambres ou partie externes des grandes coquilles, trèsdifficiles à récupérer. Fraîches, les parties siliceuses sont recouvertes d’unenduit compact, qui leur confère une patine blanchâtre : l’aspect des fossilesparaît donc très différent de ce qui est connu dans les collections anciennes deNeuvizy.
Néanmoins, leur dégagement par l’érosion et leur incorporation à lacouverture superficielle conduisent à la préservation classique de Neuvizy.Vidés de leur remplissage argilo-calcaire par dissolution, les fossiles s’allègent,en même temps que seules les parties les mieux silicifiées résistent ; ils
s’imprègnent également du fer concentré dans les argiles environnantes, etacquièrent la teinte rouille caractéristique. Plusieurs ammonites récoltées dansl’argile d’altération sur le chantier d’autoroute et dans une petite carrièreproche rendent parfaitement crédible cette hypothèse.
Il est normal que les coquilles de taille supérieure à 70 mm, fragmentéesdans le sédiment et très partiellement silicifiées, soient si rares dans lacouverture superficielle, comme d’ailleurs dans les collections anciennes : il nefait aucun doute que les faunes ayant fait la réputation du site de Neuvizy, dontles Cardioceratinae figurés par d’Orbigny (1849) ou Marchand (1986),proviennent des argiles d’altération.
On peut ajouter que, immanquablement, une concentration des faunes dontl’âge est étalé entre la Sous-zone à Costicardia et la Sous-zone à Vertebrale,s’est réalisée dans les argiles d’altération superficielles. Toutes ont la mêmepréservation siliceuse, notamment des tours très internes, mais dans certainscas, il demeure possible de repérer les morphotypes ou espèces appartenant àdes horizons stratigraphiques différents ; cela est par contre presque impossiblepour des coquilles dont la taille est minuscule, et qui ne possèdent plus lachambre d’habitation.
Enfin, en l’absence d’argile d’altération au-dessus, il est probable que lalithologie compacte des bancs coquilliers 55-56 soit plus favorable à lapréservation des seules ammonites de l’Oxfordien moyen dans les champs, parexemple à Sy, d’où proviennent la plupart des ammonites non silicifiées bienconnues des amateurs (Ardaens et al., 1977 ; Marchand, 1986), ou mêmelocalement, à Villers-le-Tourneur.
Préservation des macrofossiles
Fossiles, hors-série II 70
FHS2-08-Ardennes:FHS2-08-Ardennes 13/02/12 18:52 Page70
Sous-zone à Cordatum, début du banc 53 - 1a, 1b : Cardioceras cf. ashtonense ARKELL 1946 ; [m], adulte sans chambre d’habitation. Argiles d’altération, Sous-zone à Cordatum. 2a-c : Cardioceras cf. cordatum variant angusticordatum ARKELL 1946 ; [M], tour interne ; 3a-3b : C. ashtonense
ARKELL 1946 ; [m] ?, tour interne.Argiles d’altération, Sous-zone à Costicardia. 4a-4b : C. cf. costellatum variant vulgare ARKELL 1946 ; [m] ?, tour interne.Lavoirs à minerai de fer de Neuvizy ; ammonites de la Sous-zone à Cordatum, autres fossiles sans origine biostratigraphique précise. 5a-5b : C. cf. cordatum str.
s. (SOWERBY 1813) ; tour interne ; 6a-6b : C. cf. persecans BUCKMAN 1923 ; [M] ?, tour interne ; 7a-7b : C. sp. ; [m = Sagitticeras] ?, tour interne ; 8a-8b : C. cf. persecans BUCKMAN 1923 ; tour interne ; 9 : Pictavia sp. ; 10 : Plicatula tubifera (LAMARCK 1801) ; 11 : Millericrinus horridus (D’ORBIGNY
1841) ; 12 : polypier.Tous les fossiles sont à l’échelle 1 (coll./récolte/préparation : PC – photos : P. Lebrun).
Fig. C - Préservation des fossiles de la région de Neuvizy – Villers-le-Tourneur (Ardennes). A – 1a,b : fossilisation ordinaire d’une ammonite récoltée in situ dans le faciès à oolites ferrugineuses de Villers-le Tourneur ; chambre d’habitation (non récupérée) et deux ultimes loges du phragmocône en calcaire
argileux oolitique (cof), phragmocône silicifié (ph Si). B – Préservation des ammonites récoltées in situ dans la couverture d’altération, directement àl’aplomb des couches à oolites ferrugineuses ; B1 : ammonites de la Sous-zone à Cordatum ; 2c : qtza = quartz automorphes dans la dernière loge visible
d’un phragmocône partiel ; B2 : ammonite présentant la même préservation, remaniée de la Sous-zone à Costicardia. C – Fossiles récoltés dans les lavoirs àminerai de fer de Neuvizy ; la préservation sous forme de moulages siliceux évidés et légers est parfaitement comparable à celle des fossiles collectés dans les
argiles d’altération du chantier de Villers-le-Tourneur ; C1 : ammonites ; C2 : quelques autres organismes classiques de l’Oxfordien ardennais.
Fossiles, hors-série II71
et secondaires longues, ne tendant pas à être saillantes, souventdélicatement flexueuses et proverses, ce qui les distingue desformes de l’Oxfordien moyen. Par rapport aux représentantsplus anciens, la jonction primaires-secondaires est déprimée,voire soulignée par une bande presque lisse.
Les principales “morpho-espèces” rencontrées sont : (1) les grands et sphérocônes C. og ARKELL 1947 ; (2) les formes à ornementation dense, plutôt rectiradiée,
persistante et peu atténuée à la jonction primaire-secondaire,
sont relativement atypiques (comparer fig. 5:1-2 et 6:1-2), sontcomparables à celles décrites et figurées par Marchand (in Gygi& Marchand, 1982), de la même sous-zone.
Sans être fréquents, les [M] “plutôt épais” ou moyens (fig. 4), à ombilic étroit sont assez bien représentés ; ilsconstituent les représentants de Pachycardioceras et Goliathi-ceras. Dans la Sous-zone à Cordatum, leur ornementation estatténuée dans les tours internes par rapport aux formes de typecordatum et affines (fig. 4:1-3 vs. 4) : primaires peu épineuses
FHS2-08-Ardennes:FHS2-08-Ardennes 13/02/12 18:52 Page71
72Fossiles, hors-série II
1a, 1b : C. serrigerum BUCKMAN 1926 in Arkell (1946, pl. 50:2) [Scoticardioceras] ; petit [M], Dmax = 93 mm ; phragmocone adulte complet ; individu trèscomprimé à côtes nombreuses, graciles et persistantes ; TI = agrandissement du tour interne. 54/0 cm.
2a, 2b : C. sp. [Scoticardioceras] ; [m ou M], Dmax = 29 mm ; tour interne équivalent à 1, de type serrigerum sensu Arkell (1941) = excavatum sensu Boden (1911).54 =.
3a, 3b : C. cf. excavatum (SOWERBY 1815) [Scoticardioceras] ; [M], Dmax = 96 mm ; phragmocône adulte partiel d’une forme très comprimée, bien ornée dans lestours internes. 54 <.
4a, 4b : C. sp. [Scoticardioceras] ; [m ou M], Dmax = 33 mm ; tour interne équivalent à 3, de type excavatum str. s. 54 = >.5a, 5b : C. cf. scoticum BUCKMAN 1926 [Scoticardioceras] ; [m ou M], Dmax = 26 mm ; tour interne très involute relativement épais, à ornementation aussi fine que
les Plasmatoceras. 54 > /55.6a, 6b : C. expositum BUCKMAN 1926 [Scoticardioceras] ; [M], Dmax = 108 mm ; phragmocône adulte complet ; TI = agrandissement du tour interne. 54 >.7a, 7b : C. sp. [Scoticardioceras] ; [m ou M], Dmax= 22 mm ; tour interne équivalent à 6, de type C. expositum BUCKMAN 1926, in Arkell (1945). 54 = >.8a, 8b : C. cf. cordatiforme BUCKMAN 1923 [Cardioceras] ; [m], Dmax = 54 mm ; adulte avec début de la chambre d’habitation. 54 >.9a, 9b : C. aff. cordatiforme BUCKMAN 1923 [Cardioceras] ; petit [m], Dmax= 33 mm ; individu subadulte avec début de la chambre d’habitation. 54 = >.
Fig. 6 - Cardioceratinae - Oxfordien inférieur (fin de la Zone à Cordatum) et Oxfordien moyen (début de la Sous-zone à Vertebrale).
FHS2-08-Ardennes:FHS2-08-Ardennes 13/02/12 18:52 Page72
73 Fossiles, hors-série II
Fig. 7 - Cardioceratinae - Oxfordien moyen.
1a, 1b : C. cordatiforme BUCKMAN 1923 [Cardioceras] ; [m], Dmax = 60 mm ; individu adulte avec début de la chambre d’habitation. 54 >.2a, 2b : C. cf. zenaidae ILOVAISKY 1904 sensu Arkell (1941) ; [m] adulte incomplet ; Zone à Plicatilis, Sous-zone à Vertebrale ; 54, env. 0,5 m < 553 : C. sp. [Pachycardioceras] ; [m ou M], Dmax = 41 mm ; tour interne ; de telles formes sont en principe rares ou absentes à ce niveau ; Zone à Plicatilis, Sous-zone
à Vertebrale ; 54 >.4a, 4b : C. sp. [Cardioceras str. s. ?] ; Dmax = 39,5 mm ; tour interne très évolute, [m] probable. Niveau non précisé, 56 supposé ou équivalent (coll. Jaffré / A.G.A.).5a, 5b : C. cf. excavatum (SOWERBY 1815) [Scoticardioceras] ; [m], Dmax = 50 mm, adulte presque complet, à secondaires évoquant C. bullingdonense ARKELL 1941.
Zone à Plicatilis, Sous-zone à Vertebrale ; banc 55. 6a, 6b : C. serrigerum BUCKMAN 1926 str. s. [Scoticardioceras] ; [m], Dmax = 51 mm, adulte presque complet. Zone à Plicatilis, Sous-zone à Vertebrale ; banc 55. 7a, 7b : C. sp. [Sagitticeras ou Goliathiceras] ; [m ou M], Dmax = 45 mm, individu juvénile avec début de la chambre d’habitation ; morphologie de type C. gorgon
ARKELL 1943. Zone à Plicatilis, Sous-zone à Vertebrale ; 56.8a, 8b : C. cf. densiplicatum BODEN 1911 [Scoticardioceras] ; grand [m], Dmax = 75 mm ; adulte complet très proche de la fig. d’Arkell (1942, pl. 53:1), mais
l’absence de tertiaires sur la chambre le rapproche d’un Vertebriceras de type C. cowleyense ARKELL 1942. Zone à Plicatilis, Sous-zone à Vertebrale ; banc 56. 9a, 9b : C. zenaidae ILOVAISKY 1904 ; [m], Dmax = 34 mm ; adulte incomplet, forme typique. Zone à Plicatilis, Sous-zone à Vertebrale ; banc 55. 10a, 10b : C. cf. sowerbyi ARKELL 1936 ; [m], Dmax = 32 mm ; adulte sans chambre d’habitation. Zone à Plicatilis, Sous-zone à Vertebrale ; banc 55.
FHS2-08-Ardennes:FHS2-08-Ardennes 13/02/12 18:52 Page73
dont les représentants principaux sont plus anciens (= C.repletum MAIRE 1938, présent par sa forme comprimée) ;
(3) les très graciles, involutes et oxycônes épais C. nitidumARKELL 1947, qui montrent pratiquement une bande lisselatérale ;
(4) les trapus et très épaulés C. cyclops ARKELL 1947,possédant une ornementation falciforme forte malgré leurépaisseur ;
(5) enfin les très rares et involutes C. gr. stella ARKELL1947, dont l’ornementation vigoureuse, marquée, rectiradiée àprimaires longues, peu dense et irrégulière, évoque aussi biendes formes plus anciennes, que certains Scoticardioceras plusrécents (classement choisi par Arkell).
Les microconques – (1) Parmi les ammonites les pluscommunes dans le banc 53 (illustrations surtout fig. 3), onrencontre des coquilles de petite taille, comprimées et évolutes,adultes vers 45 à 60 mm, indéniablement [m]. Plutôt densémentet vigoureusement ornées, elles sont cependant assez variables(densité) d’un individu à l’autre ; les coquilles les pluscommunes correspondant bien à C. ashtonense ARKELL 1946.Beaucoup de coquilles sont identiques à celles de Suissedéterminées par Marchand (in Gygi & Marchand, 1982).
Remarques : parmi les formes attribuées à ce groupe, ladensité costale varie considérablement au cours del’ontogenèse sur une même coquille ; à l’extrême, les toursinternes sont très densément costulés et graciles, demorphologie Plasmatoceras (fig. 5:10) ; la chambre développealors brutalement une ornementation plus “normale” ; de tellesformes sont extrêmement rares, mais apparemment connuesailleurs (Marchand, comm. orale. 2012) ; elles sont pourl’instant laissées en nomenclature ouverte (C. tenuistriatum /ashtonense).
D’autres coquilles (fig. 5:9), laissées en nomenclatureouverte, sont des [m] très rares, très évolutes ; elles ont un styleornemental évoquant les Subvertebriceras plus récents, etpossèdent une costulation variocostée.
(2) Très rares petites formes minces adultes vers 40-50 mm,à ombilic bien ouvert, avec rostre ventral, indiscutablement [m](fig. 5:11-12). Très finement et densément ornées, ellescorrespondent au sous-genre Plasmatoceras et se rapprochentclairement de C. tenuiscostatum (NIKITIN 1878) in Marchand(1986) ; les formes plus graciles, sans tubercules, àornementation flexueuse, correspondent bien à C. tenuistriatum
BORISSJAK 1908. Des ammonites identiques ou très voisinesabonderont surtout à divers niveaux au début de l’Oxfordienmoyen (Sous-zone à Vertebrale ; Sykes & Callomon, 1979).
(3) Apparemment non trouvés dans la Sous-zone àCordatum en Angleterre à l’époque d’Arkell, mais clairementévoqués, les Vertebriceras présents potentiellement sontassimilés par lui à des formes de la Sous-zone à Costicardia,plus ancienne. Très rares mais caractéristiques, ces coquillesépaisses sont très diversifiées ; celles que nous avons récoltées(ou qui ont été clichées par R. Jaffré, A.G.A. Troyes)appartiennent à plusieurs types (fig. 5) :
- le grand et classique, moyennement épais et plutôtinvolute, C. quadrarium BUCKMAN 1926, et la variété trapue àprimaires saillantes et régulièrement divisées en deuxsecondaires C. biplicatum ARKELL 1946 ;
- des formes évolutes, très épaissies, à ornementationrestant peu saillante, bien flexueuse, à carène peu individualisée,de type Sagitticeras ;
- des ammonites plus évolutes, à ornementation très forte ettours plutôt hexagonaux, tubercules latéraux épineux, carènegrossière au milieu de sillons marqués. En outre, ces coquillesont une ornementation irrégulière ; elles ont été baptisées parArkell (1946) C. altumeratum ; une de leur particularité (pourun Vertebriceras…) est de posséder des côtes tertiaires, parfoisnombreuses (f. filatum ARKELL 1946). Dans ce groupe, de rarescoquilles sont involutes (tours internes de [M] ?), plusdensément costulées, à section très “Subvertebriceras” ; rarestertiaires et primaires nettement rétroverses, ce derniercaractère étant propre à la forme C. baylei décrite par Maire(1938).
Les Cardioceratinae de l’Oxfordien moyen (Sous-zone à Vertebrale)
Les ammonites de la fin du banc argileux 54 et des bancscalcaires 55-56 (fig. A) ont été évoquées dans un travail récent(Courville et al., 2011). Si besoin, nous reviendrons sur ladescription brève de leurs caractéristiques essentielles dans lapartie qui suit, consacrée aux formes de l’Oxfordien moyen.Particulièrement, les Cardioceratinae de la fin du banc 54constituent probablement l’association la plus ancienne connuedans l’Oxfordien moyen de l’Est de la France. LesCardioceratinae de l’Oxfordien moyen basal de Villers-le-Tourneur sont illustrées figures 6 et 7. ■
74Fossiles, hors-série II
Ardaens, R., Laurin, B. & Marchand, D., 1977 - L’Oxfordien moyen de la région de Sy(Ardennes). Précisions stratigraphiques, paléontologiques et paléobiogéographiques. C. R.Acad. Sci. Paris, 285 : 299-302.
Arkell, W. J., 1936 - The Ammonite Zones of the Upper Oxfordian of Oxford, and the Horizonsof Sowerby’s and Buckman’s Types. Quarter. J. Geol. Soc., 92 :146-187.
Arkell, W. J., 1939-1948 - A monograph on the Ammonites of the English Corallian Beds.Palaeontogr. Soc., London, Part 1-14 : 1-420.
Arkell, W. J., Kummel, B. & Wright, C. W., 1957 - Mesozoïc ammonoidea. In Mollusca 4,Moore, R. C., (ed.), Treatise on Invertebrate Paleontology. New York, p. 490.
Bayle, E., 1879 - Fossiles principaux des terrains. Explication carte géol. France, 4 : 158 pl.Boden, K., 1911 - Die Fauna des unteren Oxford von Popilany in Lituauen. Geol. Pal. Abh.
Koken, 10 (2) : 125-199.Bonte, A. & Hatrival, J.-N., 1966 - Notice explicative de la feuille Rethel à 1/50 000. Carte
géologique de la France, B.R.G.M. Orléans, 29 : 1-12.Boursault, J.-P., 1977 - L’Oxfordien moyen à nodules des “Terres noires” de Beauvoisin
(Drôme). Ammonitina de la Zone à Plicatilis, paléontologie et biostratigraphie, milieu desédimentation et genèse des nodules carbonatés. Nlles Arch. Mus. Hist. Nat. Lyon 15 : 1-116.
Buckman, S. S., 1909-1930 - Yorkshire Type Ammonites. London 1-5 :1-116.Callomon, J. H., 1985 - The evolution of the Jurassic ammonite family Cardioceratidae. Sp.
Papers Palaeont., 73 : 49-90.Cariou, E. & Hantzpergue, P., (eds), 1997 - Biostratigraphie du Jurassique ouest-européen et
méditerranéen. Zonations parallèles et distribution des invertébrés et microfossiles. Bull.Centre Rech. Elf-Aquitaine Explo.-Prod., Mem., 17 : 79-86.
Collin, P.-Y. & Courville, P., 2000 - Paléoenvironnements et Biostratigraphie d’une sérieoxfordienne non condensée de référence (Saint-Blin-Sémilly, Haute-Marne). Géol. France 1 :59-63.
Cotteau, G, 1885 - Paléontologie Française. Terrains jurassiques, Echinides réguliers. Masson,10, 1-960.
Courville, P. & Bonnot, A., 1998 - Faunes ammonitiques et biochronologie de la zone à Athletaet de la base de la zone à Lamberti (Callovien supérieur) de la Côte de Meuse (France).Intérêts des faunes nouvelles d’Aspidoceratidae. Rev. Paléobiologie, 17 : 307-346.
Courville, P. & Collin, P.-Y., 2002 - Taphonomic sequences - A new tool for sequencestratigraphy. Geology, 30 : 511-514.
Courville, P., Bonnot, A., Dudicourt, J.-C. & Cuif., G., 2011 - L’assemblage à Cardioceras(Cardioceras) cordatum (J. SOWERBY, 1812) et sa place au sein de la succession ammonitiquede l’Oxfordien Inférieur (Jurassique Supérieur). Apport des données ardennaises (ProvinceSubboréale). Annales Paléont., 97 : 9-33.
Gygi, R.-A. & Marchand, D., 1982 - Les faunes de Cardioceratinae (Ammonoidea) duCallovien terminal et de l’Oxfordien inférieur et moyen (Jurassique) de la Suisse
septentrionale : stratigraphie, paléoécologie, taxonomie préliminaire. Géobios, 15 : 517-571.Jeannet, A., 1951 - Stratigraphie und Palaeontologie des oolitischen Eisenerzlagers von
Herznach und seiner Umgebung. Beitr. Geol. Schweiz, 13 : 1-240.Kniazev, V.-G., 1975 - Ammonites and zonal stratigraphy of the Lower Oxfordian of North
Siberia. Trudy Academy of Sciences, Siberi branch, 275 : 1-139.Laurin, B. & Marchand, D., 1978 - Variations architecturales et morphologiques chez
Nucleolites scutatus LAMARCK (Echinoidea – Cassiduloidea) de l’Oxfordien moyen desArdennes. Bull. Soc. Géol. France, 20 : 895-906.
Lorin, S., Courville, P., Collin, P.-Y., Thierry, J. & Tort, A., 2004 - Modalités de réinstallationd’une plate-forme carbonatée après une crise sédimentaire : interprétationspaléoenvironnementales et paléoclimatiques. Exemple de la limite Jurassique moyen -Jurassique supérieur dans le Sud-Est du bassin de Paris. Bull. Soc. géol. France, 3 : 289-302.
Loriol, P., 1889. Paléontologie française, Terrain jurassique, Crinoïdes. Masson, 11 : 1-580.Maire, V., 1938 - Contribution à la connaissance des Cardioceratidés. Mém. Soc. géol. France,
Paris, 34 : 1-134Marchand, D., 1986 - L’évolution des Cardioceratinae d’Europe occidentale dans leur contexte
paléobiogéographique (Callovien supérieur-Oxfordien moyen). Thèse de doctorat del’université de Dijon, 1-630.
Marchand, D. & Gygi, R.-A., 1977 - L’Oxfordien inférieur d’Herznach (Canton d’Argovie,Suisse). Précisions paléontologiques et stratigraphiques. C. R. Acad. Sci. Paris, 285 : 853-856.
Marchand, D. & Tarkowski, R.-A., 1992 - Les ammonites du niveau vert de Zalas (Oxfordieninférieur, Pologne du Sud), condensation ou concentration de faunes ? Bull. Polish Acad. Sci.,40 : 55-65.
Matyja, B.-A. & Tarkowski, R.-A., 1981 - Lower and Middle Oxfordian ammonitebiostratigraphy at Zalas in the Cracow Upland. Acta Geol. Pol., 31 : 1-14.
Orbigny, A. d’, 1842-1852 - Paléontologie Française. Description géologique et zoologique detous les animaux mollusques et rayonnés fossiles de France. Terrains oolithiques oujurassiques. Masson, 1 : 1-642.
Page, K. N., Melendez, G. & Wright, J., 2009 - The ammonite faunas of the Callovian-Oxfordian boundary interval in Europe and their relevance to the establishment of anOxfordian GSSP. Volumina Jurassica, 7 : 89-99.
Sowerby, J., 1812-1822 - The Mineral Conchology of Great Britain. London 2.Sykes, R. & Callomon, J., 1979 - The Amoeboceras zonation of the boreal Upper Oxfordian.
Palaeontology, 22 : 839-903.Tarkowski, R.-A. & Marchand, D., 2004 - Le dimorphisme chez Perisphinctes
(Properisphinctes) cf. bernensis DE LORIOL (Oxfordien inférieur, région de Cracovie,Pologne). C. R. Palévol, 3 : 191-198.
Waterlot, G., Beugnies, A., Bintz, J., 1973 - Guides géologiques Régionaux : Ardennes-Luxembourg. Masson, 132-134.
Références bibliographiques
FHS2-08-Ardennes:FHS2-08-Ardennes 13/02/12 18:52 Page74