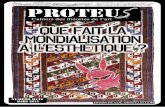L'entreprise fait-elle partie de la structure de base rawlsienne ? (RPE 2014)
Transcript of L'entreprise fait-elle partie de la structure de base rawlsienne ? (RPE 2014)
L’ENTREPRISE FAIT-ELLE PARTIE DE LA STRUCTURE DE BASE
RAWLSIENNE ?
Sandrine Blanc1
(Article publié disponible sur : http://www.greqam.fr/en/publications/revue-philo)
Résumé :
Cet article clarifie le statut de l’entreprise par rapport à la structure de base rawlsienne. Ce statut est ambigu, du fait d’incertitudes liées à la conception rawlsienne de l’entreprise ainsi qu’à sa définition de la structure de base. L’article identifie deux représentations principales de l’entreprise chez Rawls : l’une inclusiviste, qui définit l’entreprise comme une entité ontologiquement distincte de la structure de base ; l’autre constitutiviste, qui l’appréhende comme une institution susceptible d’appartenir à la structure de base. L’article recense ensuite différentes interprétations de la structure de base avant d’en proposer une plus large, y intégrant notamment certaines structures informelles. Articulée à la conception institutionnaliste de l’entreprise, cette définition large de la structure de base débouche sur une représentation constitutiviste étendue de l’entreprise, permettant ainsi au libéralisme égalitaire de la considérer d’un œil plus critique.
Abstract :
This paper clarifies the status of the firm vis-à-vis the Rawlsian basic structure of society. This status is ambiguous due to uncertainties in Rawls’s conception of the firm and his definition of the basic structure. The paper identifies two perspectives regarding the firm in Rawls: an inclusivist perspective defines a firm as an entity ontologically distinct from the basic structure; a constitutivist perspective views the firm as an institution that possibly forms part of the basic structure. The paper then reviews several interpretations of the basic structure before offering a more inclusive version, which notably includes some informal structures. Articulated in relation to the institutionalist conception of the firm, this expanded definition of the basic structure results in an extended constitutivist perspective regarding the firm. It thus provides liberal egalitarianism with firmer ground for critically assessing businesses.
Mots-clés : entreprise, institution, justice, Rawls, structure de base.
Key words: firm, corporation, institution, justice, Rawls, basic structure
JEL: D3, D63, G38, J31, K22, P12, P14, P16
1Enseignante-chercheuse Inseec Business School 27 avenue Claude Vellefaux 75010 Paris [email protected] Une première version de cet article a été rédigée lors d’une recherche postdoctorale au Center for Capitalism, Globalization and Governance de l’Essec. Je remercie Marie-Laure Djelic de l’avoir rendue possible. Cet article a bénéficié des réflexions du programme « L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales » du Collège des Bernardins, ce dont je remercie Olivier Favereau et Baudoin Roger. Il a également bénéficié du séjour de recherche effectué en 2013 à la Chaire Hoover et de l’appui du Projet Bernheim « Social Responsibility in Economic Life ». Je remercie tout particulièrement Axel Gosseries et deux rapporteurs anonymes pour leurs commentaires judicieux. Les erreurs restantes sont les miennes.
2
INTRODUCTION - L’ENTREPRISE FACE AU LIBERALISME EGALITAIRE
L’entreprise2 est omniprésente dans le monde contemporain et pourtant, Rawls ne l’évoque
guère, si ce n’est sous la forme d’une réflexion sur la propriété des moyens de production.
Récemment, un certain nombre de travaux d’inspiration rawlsienne se sont intéressés à ce
point aveugle du libéralisme égalitaire, envisageant les éventuelles implications des principes
de justice3 sur les niveaux de salaire4, l’impôt sur les sociétés (O’Neill 2009), les formes de
gouvernance etc. (Hussain 2009 ; O’Neill 2008).
Une réflexion sur l’entreprise à partir des principes de la justice « domestique », c’est-à-
dire des principes qui régissent la structure de base de la société, n’est cependant pas
exclusive d’une réflexion à partir de principes de justice « locale », c’est-à-dire des
« principes de justice qui doivent être appliqués directement par les associations et les
institutions » (Rawls 2003 [2001], p. 30). Rawls suggère en effet que les exigences de justice
pertinentes pour l’ensemble du système socio-économique peuvent se combiner à celles d’une
justice organisationnelle5. Les entreprises seraient donc soumises à un double régime
pratique : aux principes de la justice sociale domestique et à ceux d’une justice
organisationnelle locale restant à élaborer. Ce qui importe alors pour une réflexion sur
l’entreprise, c’est de déterminer auquel de ces ordres normatifs se référer à propos d’une
question particulière et notamment, dans la perspective de cet article, quand mobiliser
légitimement les principes de la justice domestique.
Claire en principe, la distinction entre les ordres normatifs domestique et organisationnel
est délicate à mettre en œuvre à propos des questions liées à l’entreprise, par exemple son
statut juridique, les modalités de répartition du pouvoir, d’organisation du travail, etc. Dans
2Il serait nécessaire, en toute rigueur, de distinguer entre « société » et « entreprise » : la première fait référence à la forme juridique de l’unité productive, sa personnalité morale, quand la seconde désigne sa réalité économique et organisationnelle. Les limites de l’entité juridique ne se superposent pas nécessairement à celles de l’entité économique. Voir à ce sujet la mise au point de Robé (2011, p. 3). En tant que caractéristique de la structure légale de l’entreprise, la gouvernance au sens du droit se déploie donc, stricto sensu, dans le cadre des sociétés. Dans la suite de cet article, nous ne distinguons l’entreprise de la société que lorsque l’objet de la discussion rend la précision nécessaire. 3Le principe des libertés de base égales pour tous, le principe d’égalité équitable des chances et le principe de différence. Voir Rawls (2003, p. 69). Nous les désignons aussi dans la suite de l’article comme les principes de justice sociale ou, suivant l’usage établi dans La justice comme équité, de justice domestique. 4Au détour de sa critique du libéralisme rawlsien, Martha Nussbaum (1990) remarque qu’il doit quand même permettre de limiter les écarts de salaire. 5Au total, Rawls définit trois niveaux de justice, domestique, globale et locale : « Nous avons donc au total trois niveaux de justice : d’abord, la justice locale (dont les principes s’appliquent directement aux institutions et aux associations) ; ensuite, la justice domestique (dont les principes s’appliquent à la structure de base de la société) ; et enfin la justice globale (dont les principes s’appliquent au droit international) » (2003, p. 30).
3
les faits, l’entreprise renvoie en effet à une série de pratiques et de règles qui les orientent,
certaines qui lui sont propres (par exemple les procédures, règles ou codes d’entreprise
élaborés en interne, certaines modalités d’organisation du travail), d’autres plus générales
(telles que les règles du droit des sociétés ou du droit du travail), en passant par des étages
normatifs intermédiaires tels que les codes de gouvernance ou de déontologie développés sur
une base volontaire par des entreprises d’un même secteur ou d’une même zone
géographique, à l’échelle infra ou supranationale. Dès lors, quelles sont celles de ces pratiques
et de ces règles qui ressortent légitimement de la justice sociale ? A quel point et sur quelles
questions la justice sociale doit-elle céder le pas à une réflexion guidée par des principes
éthiques ou ceux d’une justice organisationnelle ?
Les indications de Rawls ne permettent pas de répondre d’emblée à cette interrogation.
Sans doute établit-il clairement que la justice domestique prend pour objet la structure de base
de la société. C’est donc bien le statut de l’entreprise, de ses pratiques et des règles qui les
orientent dans la structure de base de la société qui doit permettre de préciser les implications
des exigences de la justice domestique pour les entreprises. Mais, il reconnaît aussi
« l’imprécision du concept de structure de base » (1987 [1971], p. 35). De plus, sa
représentation de l’entreprise est ambiguë, empruntant notamment à deux conceptions
différentes de l’entreprise et de son rapport à la structure socio-économique de base :
l’entreprise comme unité organisationnelle pensée par analogie avec l’individualité autonome
et l’entreprise comme unité-type d’un régime économique à considérer dans son ensemble,
telle la brique faisant partie intégrante du mur auquel elle appartient. D’un côté, donc, la
représentation que nous qualifierons d’« inclusiviste » de l’entreprise comme unité évoluant
dans la structure de base de la société et, de l’autre, une représentation que nous qualifierons
de « constitutiviste », et qui appréhende l’entreprise comme constitutive, avec d’autres unités
économiques identiques, de la structure de base de la société. Or, les exigences de la justice
sociale pour l’entreprise varient en fonction de la représentation de l’entreprise adoptée.
La réception des travaux de Rawls reflète cette ambivalence. Certains auteurs conçoivent
l’entreprise comme distincte de la structure de base et accordent effectivement que « la
plupart des questions auxquelles s’intéressent les éthiciens des affaires tombent hors du
champ des principes de justice de Rawls, ou ne leur sont reliées que de façon indirecte » (de
façon critique, Heath et al. 2010, p. 431)6. D’autres auteurs considèrent au contraire
l’appartenance de l’entreprise à la structure de base de la société comme une évidence (Taylor
6Les auteurs présentent la perspective dominant le champ de l’éthique des affaires et que leur article discute. Les traductions de cet article sont les nôtres.
4
2004 ; O’Neill 2009 ; Heath et al. 2010). Mais les raisons à l’appui de cette affirmation
restent souvent implicites. Et elles varient significativement quand elles sont énoncées de
façon explicite : pour certains, ce serait l’importance du travail dans la vie des individus qui
justifie l’appartenance des entreprises à la structure de base (Heath et al. 2010, par référence à
Taylor 2004) ; pour d’autres, le fait qu’elles constituent une source de revenu essentielle
(Taylor 2004), ou encore leur caractère de conventions légales aux effets « profonds » sur la
distribution des biens premiers (O’Neill 2009, p. 175).
Or on constate que ces critères n’évaluent pas tous de la même façon la place des
organisations économiques dans la structure de base. Ils diffèrent tout d’abord sur le type
d’organisations économiques qui relèvent de la structure de base. Le cas de l’université par
exemple fait débat : Taylor l’intègre dans la structure, contre les suggestions de Rawls et
Freeman (2007). Le statut de la petite entreprise semble aussi problématique : élément
possible de la structure de base pour Taylor (2004), son statut n’est pas tranché par Heath,
Moriarty et Norman qui limitent en première approche la structure de base aux « sociétés
cotées » (Heath et al. 2010, p. 432). On pourra donc s’interroger sur ce qu’impliquent les
différents critères pour des entreprises de taille différente. De plus, on note un flottement dans
les formulations, qui évoquent tantôt l’appartenance de « l’entreprise » à la structure de base
de façon globale, tantôt l’appartenance de certaines des règles et conventions qui la
structurent. Ainsi, à quelles dimensions les critères d’appartenance de l’entreprise à la
structure de base renvoient-t-ils ? De plus, s’appliquent-ils aux décisions qui relèvent
purement de son activité ou de sa stratégie comme à celles qui définissent ses modalités
d’organisation ou sa structure juridique ? Ainsi, quelles sont, des différentes entreprises, des
pratiques et des normes qui les orientent, celles qui relèvent de la structure de base et doivent
effectivement être soumises à la considération critique du libéralisme égalitaire ?
Afin de répondre à ces interrogations, la suite de cet article est consacrée à la clarification
du statut de l’entreprise dans la structure de base rawlsienne. Nous engageons notre propos
par un état des lieux de la représentation de l’entreprise chez Rawls et la mise en évidence de
ses enjeux pour une société juste (Partie I). Nous commençons par un bref rappel de la
distinction rawlsienne entre structure de base et actions individuelles. Nous mettons ensuite
en évidence la présence, à des degrés divers, de trois représentations de l’entreprise chez
Rawls, exclusiviste, où l’entreprise est appréhendée comme un réseau de contrats entre
individus, mais surtout inclusiviste, où l’entreprise est appréhendée comme une entité
autonome évoluant dans la structure de base de la société, et constitutiviste, où l’entreprise
apparaît constitutive de la structure sociale de base. La perspective constitutiviste est celle qui
5
offre le potentiel critique le plus important et elle sous-tend de façon implicite certains des
récents travaux rawlsiens sur l’entreprise. Mais on constate des divergences sur la
délimitation de la structure de base et par conséquent sur ce qui, des entreprises et de ses
règles, la constituent. La deuxième partie est donc consacrée à la clarification d’un critère
d’appartenance d’une institution à la structure de base et de ses implications pour l’approche
constitutiviste de l’entreprise (Partie II). Nous y passons en revue différents critères présents
dans la littérature avant d’argumenter en faveur d’une proposition alternative : des institutions
ou des pratiques font partie de la structure de base si et seulement si elles ont un effet sur les
perspectives de biens premiers d’au moins une position sociale pertinente. Nous illustrons
enfin sa portée pour la réflexion sur l’entreprise dans une société juste.
L’ENTREPRISE DANS LE MODELE INSTITUTIONNEL RAWLSIEN
La distinction rawlsienne entre structure de base et actions individuelles et les principes qui
les régissent est bien connue. Elle procède de l’expression différenciée de l’exigence
d’autonomie des citoyens dans des circonstances distinctes : vie au sein d’une société
politique d’une part et participation à diverses formes d’unions sociales d’autre part. Rawls a
fait l’hypothèse de sociétés dans lesquelles les individus entrent à la naissance et sortent à la
mort (Rawls 2003, p. 85). L’autonomie du citoyen vis-à-vis de la structure sociale – comme
structure à laquelle il ne peut se soustraire – requiert donc qu’il puisse la penser comme
structurée d’après des principes « résultant de la pensée réfléchie et du jugement raisonné »
(Rawls 1995 [1993], p. 270), c’est-à-dire des principes qu’il peut raisonnablement faire siens7.
Il s’agit des principes de justice qui ne visent à gouverner, par définition, que la structure
sociale de base. Les citoyens exercent plus directement leur autonomie vis-à-vis des
institutions particulières en rejoignant celles qui servent leurs intérêts et en décidant de ne pas
interagir avec celles dont ils ne partagent pas les principes d’organisation ou les objectifs.
Dans le cadre de la division du travail moral établie par Rawls, il est donc essentiel de pouvoir
distinguer entre ces deux niveaux de réalité sociale, structure sociale de base et « les
institutions, les associations, et les pratiques sociales en général » (Rawls 2003, p. 29) et, pour
ce qui concerne l’objet de cet article, d’y localiser l’entreprise. Mais en pratique, cette
évaluation s’avère délicate.
7Voir sur ce point l’utile mise au point de Bertrand Guillarme (1999, p. 197).
6
La structure de base
La difficulté à positionner l’entreprise dans l’architectonique rawlsienne s’explique tout
d’abord par la généralité et les ambiguïtés de la définition de la structure de base. En effet,
celle-ci n’est définie que de façon très générale, comme la structure politique et socio-
économique qui associe les perspectives de biens et devoirs fondamentaux aux positions
sociales8, le « système unique »9 de coopération sociale qui détermine, en fonction des
positions sociales dans lesquelles les hommes naissent, les perspectives de vie qui s’ouvrent à
eux, avec leurs droits, leurs devoirs et leurs avantages.
Au-delà de cette définition, Rawls ne brosse qu’à grands traits la physionomie de cette
structure. Elle comprend les « institutions sociales les plus importantes » (Rawls 1987, p. 33)
et se divise en deux parties, dédiée chacune à la mise en œuvre de l’un des deux principes de
justice10. La constitution politique (Rawls 1987, p. 33) forme la première partie de la structure
de base et vise à garantir les exigences du premier principe, c’est-à-dire des libertés de base
égales pour tous. La deuxième partie de la structure de base cherche à mettre en œuvre les
exigences du deuxième principe, c’est-à-dire une répartition des avantages socio-économiques
conforme à une juste égalité des chances et au principe de différence (Rawls 1987, p. 235).
Elle correspond aux « principales structures socio-économiques » (Rawls 1987, p. 33), par
exemple les « marchés concurrentiels, la propriété privée des moyens de production et la
famille monogamique » (Rawls 1987, p. 33 ; voir aussi Freeman 2007, p. 101), tels qu’ils sont
façonnés et orientés par le législateur (Rawls 1987, p. 235). Ce dernier tient compte, pour ce
faire, à la fois du deuxième principe et des « faits généraux économiques et sociaux » (Rawls
1987, p. 235) de la société concernée. Dans ce tableau d’ensemble, la structure de base est
donc considérée à la fois sous l’angle de la réalité des mécanismes sociaux et politiques qui la
constituent et des lois qui la réglementent.
8« Pour nous, l’objet premier de la justice, c’est la structure de base de la société ou, plus exactement, la façon dont les institutions sociales les plus importantes répartissent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent la répartition des avantages tirés de la coopération sociale » (Rawls 1987, p. 33). Voir aussi La justice comme équité (Rawls 2003, p. 28). 9Rawls évoque un « système unique » (1987, p. 33 ; 2003, p. 28) ou encore un « système unifié de coopération sociale entre une génération et la suivante » (Rawls 1995, p. 36). 10« […] la constitution établit un statut commun qui garantit l’égalité des citoyens entre eux et réalise la justice sur le plan politique. Le second principe intervient dans l’étape du corps législatif. Il exige que le but de la politique sociale et économique soit la maximisation des attentes à long terme des plus désavantagés […] La seconde partie de la structure de base comporte les distinctions et les hiérarchies des formes politiques, économiques et sociales qui sont nécessaires à une coopération sociale efficace et mutuellement avantageuse » (Rawls 1987, p. 235). Sur les deux rôles de la structure de base, voir aussi Rawls (1995, p. 278), ainsi que Rawls (2003, p. 76).
7
Mais alors que la Théorie de la justice affirme que la structure de base ne comprend que
deux parties, la constitution et le corps législatif régulant les institutions socio-économiques,
Libéralisme politique en identifie une troisième :
Cette structure [de base] applique également, à travers le système des lois, un autre ensemble de règles qui gouvernent les transactions et les accords entre individus et entre associations (la législation des contrats, etc.). Les règles relatives à la fraude, à la violence, etc., font partie de ces règles […]. Elles sont formées pour laisser les individus et les associations libres d’agir efficacement pour réaliser leurs buts et sans contrainte excessive. (Rawls 1995, p. 321, nos italiques)
Par conséquent, ce troisième élément de la structure de base ne relève ni de la constitution
pour la garantie du premier principe, ni des lois qui régulent la distribution des avantages
socio-économiques en accord avec le deuxième principe. Il s’agit du droit privé, notamment
du droit des contrats dont les règles paraissent en première approche spécifier les exigences
du premier principe pour les formes d’interactions sociales entre individus et organisations.
Au final, la structure de base comprend donc la constitution conforme au premier principe,
les institutions socio-économiques organisées pour la réalisation du deuxième principe, et le
droit privé qui applique les exigences du premier principe aux interactions entre individus et
entre organisations.
Actions personnelles et organisations
Rawls distingue ensuite une deuxième catégorie d’interactions sociales : les actions
personnelles11 et interactions intra-organisationnelles. Par différence avec la structure de
base, les actions personnelles des individus ou des collectifs d’individus ne sont pas soumises
directement aux principes de justice : « les principes qui sont satisfaisants pour la structure de
base […] peuvent fort bien ne pas s’appliquer aux règles et aux pratiques d’associations
privées ou de groupes sociaux plus restreints » (Rawls 1987, p. 34). Le principe de différence
n’a pas de légitimité pour contraindre directement les actions des individus, par exemple en
11Nous suivons ici l’interprétation de Kok-Chor Tan (2004) qui distingue, au sein des actions individuelles entre actions individuelles personnelles et les actions individuelles non personnelles. Les premières sont directement et principalement orientées par les fins particulières de l’individu ou de l’organisation dans laquelle il choisit d’intervenir et indirectement par les contraintes de la structure de base. Les secondes sont celles qui ont un effet sur les institutions. Nous proposons, à la différence de Tan, de distinguer deux types d’actions individuelles non personnelles : les actions individuelles non personnelles publiques et les actions individuelles non personnelles citoyennes. Les actions individuelles non personnelles publiques, sont principalement orientées par la contrainte indirecte de la structure de base, comme par exemple le fait de payer ses impôts ; elles sont réalisées en conformité avec la loi, que ce soit par désir citoyen de contribuer à une société juste ou par soumission hétéronome à la force de la loi. Les actions individuelles non personnelles citoyennes correspondent à l’activité du législateur qui légifère et à celle du citoyen quand il vote – ou quand il décide ou non d’émigrer (ce qu’on a appelé « le vote avec les pieds ») : ces actions visent à établir une structure de base conforme aux principes de justice et sont uniquement guidées par le sens de la justice des individus sans médiation institutionnelle.
8
leur demandant de chercher à anticiper les effets de leur action individuelle sur le plus
défavorisé de la société et d’agir en conséquence. Il ne sert pas non plus à déterminer les
règles de fonctionnement d’une organisation donnée ; il n’exigerait pas, par exemple, que le
salaire le plus bas d’une société commerciale soit le plus élevé possible12.
Comme le note justement Freeman (2007, p. 99), cela ne signifie pas que les actions
personnelles ou les pratiques et règles organisationnelles sont libres de contraintes liées aux
principes de justice, mais plutôt que ces dernières sont médiatisées par la structure de base13.
Les actions personnelles et les interactions organisationnelles devront respecter le droit
constitutionnel, le droit privé, ainsi que les exigences pertinentes relevant deuxième principe,
par exemple au travers du paiement d’un impôt sur le revenu.
Positionner l’entreprise : exclusivisme, inclusivisme ou constitutivisme ?
Ceci précisé, comment positionner l’entreprise, ses pratiques et les actions de ses membres
dans cette stratification institutionnelle et morale allant de la justice de la structure de base à
l’éthique des actions personnelles ? Sous son apparente simplicité, la distinction rawlsienne
entre les « principaux éléments du système socio-économique » d’une part et les « règles et
[les] pratiques d’associations privées » de l’autre (Rawls 1987, p. 34) est délicate à
interpréter. Quand quitte-t-on la structure sociale de base et son exigence de justice pour
entrer dans l’espace de l’institution secondaire, de la décision d’un individu ou d’un groupe
d’individus et de leurs normes éthiques ? De fait, Rawls reconnaît « volontiers l’imprécision
du concept de structure de base. On ne voit pas toujours clairement quelles institutions,
quelles fonctions doivent en faire partie » (Rawls 1987, p. 35). De même note-t-il dans La
justice comme équité que la « caractérisation de la structure de base ne procure pas une
définition, ou un critère, à partir duquel nous pourrions décider quels arrangement sociaux, ou
quels aspects de ceux-ci, en font partie » (Rawls 2003, p. 30).
12« […] les principes de justice, en particulier le principe de différence, s’appliquent aux principes publics essentiels et aux politiques qui régulent les inégalités économiques et sociales. […] Le principe de différence vaut, par exemple, pour la taxation de la propriété et du revenu, pour la politique économique et fiscale. Il s’applique au système connu du droit et des règlements publics, mais ni aux transactions ou aux répartitions particulières ni aux décisions des individus et des associations, mais plutôt au contexte institutionnel dans lequel elles ont lieu » (Rawls 1995, p. 337). 13« En général, les principes de la structure de base posent des contraintes (ou limites), mais ils ne déterminent pas à eux seuls les principes appropriés à la justice locale » (Rawls 2003, p. 30). « Puisque la justice comme équité commence par le cas spécifique de la structure de base, ses principes régissent cette structure, et ne s’appliquent pas directement aux institutions et associations de la société, pas plus qu’ils ne régissent leur organisation interne. Les entreprises et les syndicats, les Eglises, les universités, et la famille sont contraintes par des limites qui découlent des principes de justice, mais ces limites proviennent indirectement du contexte institutionnel juste au sein duquel les associations et les groupes existent, et au moyen duquel la conduite de leurs membres est restreinte » (Rawls 2003, p. 29).
9
Mais l’entreprise n’est pas difficile à positionner dans l’édifice institutionnel rawlsien
seulement à cause du flou de la définition de la structure de base ; c’est aussi parce que
l’entreprise ne fait pas l’objet d’analyses spécifiques et que les indications glanées ici et là
n’en donnent pas de vision cohérente. Les rares formules sur « les entreprises commerciales »
(Rawls 2003, p. 224) ne permettent pas de déterminer s’il s’agit d’un élément de la structure
de base, ni d’identifier de théorie économique ou juridique de référence. De fait, trois
perspectives distinctes sur l’articulation de l’entreprise à la structure de base affleurent,
exclusiviste, où l’entreprise est représentée comme un réseau de contrats au sein de la
structure de base, inclusiviste, où elle est assimilée à un agent autonome évoluant dans la
structure, et constitutiviste, où elle apparaît comme une institution constitutive de la structure
de base14. Nous les examinons tour à tour.
Pour les perspectives exclusiviste et inclusiviste, l’entreprise est ontologiquement distincte
de la structure de base et évolue dans la structure. Ces perspectives conceptualisent
l’entreprise à partir de la catégorie de l’individu et de ses droits, l’exclusivisme renvoyant à la
théorie de la société commerciale comme nœud de contrats entre des personnes réelles15,
l’inclusivisme à la théorie néoclassique plus ancienne de l’entreprise comme une entité
autonome porteuse de droits. Ces perspectives s’accordent notamment avec l’identification de
la troisième dimension de la structure de base, celle du droit des contrats, dont on a noté qu’il
se limitait apparemment à appliquer les exigences du premier principe aux interactions entre
individus et entre associations.
Dans certains contextes, la désignation de l’entreprise comme une association volontaire
(Rawls 2003, p. 29) dont l’objet est d’« [aider] à la réalisation des fins essentielles de la vie
humaine » (Rawls 1995, p. 358) semble mettre l’accent sur les personnes et les interactions à
l’arrière-plan de la société commerciale. Rawls évoque aussi des « organisations ou de[s]
procédures décidées librement et en coopération, afin d’aboutir à des accords contractuels »
(Rawls 1987, p. 34). Cette approche réduit, en dernière instance, la société aux individus
contractants et à leur liberté contractuelle et leur liberté d’association qui leur permettent de
s’associer pour la réalisation de leurs intérêts. Cette esquisse de l’entreprise est compatible
avec le renouvellement de la théorie néoclassique de la firme à partir des années 70, dite
14Nous utilisons les termes d’exclusivisme, inclusivisme et constitutivisme pour identifier les ontologies de l’entreprise repérables chez Rawls et leur articulation à la structure de base. 15Pour une présentation synthétique de l’évolution de la théorie économique de la firme, voir l’ouvrage de François Eymard-Duvernay Economie politique de l’entreprise (2004). Pour une introduction pédagogique à ces théories, voir aussi Weinstein (2008).
10
théorie de la firme comme « nœud de contrats »16. Contrastant avec une conception
monadique de l’entreprise, cette théorie la représente comme un réseau d’accords contractuels
déterminant la contribution et la rétribution des différents contractants (Fama 1980, p. 290).
Quoique cette lecture de la représentation rawlsienne de l’entreprise soit compatible avec la
quasi absence d’indications sur l’entreprise dans la présentation de la démocratie de
propriétaires, contrastant avec la description détaillée de mesures visant les individus
(éducation, impôt sur le revenu, mesures de dispersion du capital etc.), elle reste hypothétique
au regard de la rareté des indications textuelles qui la supportent.
D’autres passages du texte rawlsien dessinent en creux l’entreprise comme une unité
autonome comparable à un agent individuel doté de fins propres. C’est l’image que renvoient
l’identification des « actions des individus et des associations » (Rawls 1995, p. 319) et la
considération que « des associations tout comme des personnes physiques peuvent être libres
ou non libres » (Rawls 1987, p. 238, nos italiques). Cette évocation rawlsienne de l’entreprise
est compatible avec l’approche de l’économie néoclassique jusque dans les années 70 :
l’entreprise y est décrite sur le modèle de l’agent individuel, boîte noire autonome et opaque
agissant sur les marchés à la poursuite de ses fins propres, essentiellement la recherche du
profit. Cette représentation de l’entreprise fait aussi écho à celle du droit des sociétés, qui
définit la société commerciale comme une personne morale dotée de la personnalité juridique
et jouissant de prérogatives semblables à celles des personnes physiques : par exemple la
capacité à être propriétaire, à être endettée etc. (Robé 2011, p. 9). Malgré les indications
textuelles qui la supportent plus nettement, la lecture inclusiviste de la représentation
rawlsienne de l’entreprise sur le modèle de l’agent individuel n’est pas totalement
satisfaisante.
Nous relevons en effet une autre série d’indications qui suggèrent plutôt que l’entreprise
serait l’une des institutions constitutives de la structure de base de la société. L’évocation
rawlsienne de l’entreprise emprunte en effet aussi au registre du régime économique. Rawls
mentionne par exemple « un système de production […] en grande partie défini par la manière
dont ses règles publiques organisent l’activité productive, spécifient la division du travail,
assignent des rôles variés à ceux qui y sont engagés, et ainsi de suite » (Rawls 2003, p. 95). Il
suggère par ailleurs que la propriété des moyens de production relève de la structure de base
et permet de distinguer un régime socialiste libéral (propriété publique des moyens de
16Fama et Jensen (1983) cité par Robé (2011, p. 6). Pour une présentation des transformations de la conceptualisation de la firme au sein de l’économie néoclassique, on consultera avec profit Favereau et Picard (1996).
11
production) d’une démocratie de propriétaires (propriété privée des moyens de production)17.
Rawls laisse encore entendre qu’il pourrait en être de même d’autres aspects de l’entreprise,
telle sa gouvernance (2003, p. 242-243). Ces aspects de l’entreprise apparaissent donc comme
les éléments structurants d’un régime économique à appréhender dans sa globalité.
Enjeux pour l’entreprise face à justice libérale égalitaire
L’adoption d’une ontologie particulière de l’entreprise (nœud de contrats, agent ou institution)
conditionne son articulation à la structure de base (exclusivisme, inclusivisme ou
constitutivisme) et par suite la façon dont les exigences de justice s’y appliquent (voir
fig. 1)18. Il s’agit donc d’une question importante pour le libéralisme égalitaire.
Ainsi, on constate que l’ontologie qui sous-tend l’inclusivisme (entreprise-agent) a pour
conséquence de soustraire nombre d’aspects de l’entreprise à l’analyse libérale égalitaire. La
description de l’entreprise comme une boîte noire autonome agissant sur des marchés opacifie
ses mécanismes de coordination et d’organisation internes. Bien sûr, il reste possible dans ce
cadre de soumettre certains fonctionnements et produits « externes » de l’entreprise aux
exigences de la justice sociale, par exemple au travers de l’impôt sur les sociétés19. Mais les
pratiques, codes, règles et autres modes de fonctionnement internes de l’entreprise échappent
en première analyse au regard de la justice domestique.
La représentation exclusiviste de l’entreprise (entreprise-nœud de contrats) radicalise ce
résultat, quoique de façon opposée. Elle ne soustrait pas les processus et mécanismes internes
de l’entreprise au regard libéral égalitaire mais elle les rapporte à l’autonomie des individus
contractants et à leurs droits. Elle exclut ainsi l’entreprise et ses mécanismes d’organisation et
de régulation de l’objet de la justice sociale (fig. 1), qui ne peut plus, dès lors, qu’agir sur les
individus physiques, soit en amont, au travers du droit des contrats, de politiques éducatives et
de dispersion du capital, soit en aval, au travers d’un impôt sur le revenu ou l’héritage et des
politiques redistributives de l’Etat-providence. L’individualisme méthodologique qui sous-
tend cette approche positionne au premier abord l’entreprise et ses règles hors de la structure
de base et les soustrait au regard de la justice égalitaire.
A contrario, l’ontologie institutionnaliste de l’entreprise qui sous-tend le constitutivisme
(entreprise-institution) permet de considérer d’emblée l’entreprise, les règles et pratiques
17Remarquons qu’il s’agit ici de régimes économiques idéaux et pas nécessairement de régimes existants ou ayant existé. Sur le modèle de la démocratie de propriétaires en particulier, voir l’ouvrage édité par Martin O’Neill et Thad Williamson, Property-Owning Democracy : Rawls and Beyond (2012). 18Nous remercions un rapporteur anonyme pour nous avoir encouragée à préciser ce point. 19Pour un argument selon lequel l’impôt sur les sociétés tel qu’il est conçu de nos jours procède d’une analogie entre entreprise et personne privée, voir O’Neill (2009, p. 190).
12
qu’elle suit, comme des institutions, des règles d’actions implicites ou explicites dont la
légitimité est susceptible d’être évaluée à l’aune des objectifs de la justice sociale.
Nous pouvons discerner à présent les implications de chacune de ces représentations de
l’entreprise pour une question particulière, par exemple la question des rémunérations20. Les
accords contractuels sur les salaires apparaîtront comme une question privée hors du champ
de la justice pour l’exclusivisme, la répartition des revenus faisant alors plutôt l’objet d’une
fiscalité sur les revenus individuels et de politiques de redistribution. C’est aussi une question
privée pour l’approche inclusiviste de l’entreprise, mais cette dernière pourra songer en outre
à soumettre les sociétés commerciales à l’impôt pour rectifier la répartition des revenus. Les
politiques de rémunérations seront susceptibles de constituer un sujet légitime pour la justice
sociale dans le cadre d’une conception constitutiviste de l’entreprise (fig. 1), mais il convient
de préciser dans quel contexte et à quelles conditions.
Implications de la représentation de l’entreprise pour le libéralisme égalitaire (fig. 1)
Positionnement de l’entreprise dans la structure de base
Exclusivisme Inclusivisme Constitutivisme
Ontologie de l’entreprise Nœud de contrats
Agent Institution
Articulation de l’entreprise à la structure de base
Exclue Incluse Constitutive
Implications possibles de la justice sociale pour l’entreprise
- Impôt sur le profit des sociétés (IS)
Structure de gouvernancePolitique de rémunérationForme de la fiscalité de
l’entreprise Structure des comités de
rémunération
A la recherche d’un critère de constitutivité de la structure de base
Latente chez Rawls, l’ontologie institutionnaliste de l’entreprise semble sous-tendre
implicitement certains des travaux qui étendent la réflexion rawlsienne à l’entreprise.
Toutefois, une conception institutionnaliste de l’entreprise ne suffit pas à la soumettre aux
exigences de la justice libérale égalitaire. Encore faut-il démontrer qu’il s’agit de l’une des
institutions constitutives de la structure de base et préciser quels aspects de l’entreprise sont
concernés. Or, le critère d’appartenance d’une institution à la structure de base n’est pas
20Nous pouvons songer à d’autres exemples. Ainsi, dans l’article qu’il consacre à l’impôt sur les sociétés, O’Neill avance que le passage de la représentation de l’entreprise-agent à l’entreprise-institution (« conventionnaliste » dans les termes de O’Neill) permet de repenser les modalités de cet impôt, initialement conçu sur le modèle de l’impôt sur le revenu individuel. Selon lui, une fiscalité d’entreprise plus judicieuse chercherait par exemple à imposer les externalités économiques et sociales (2009, p. 190).
13
nettement défini dans le texte rawlsien, pas plus qu’il ne l’est chez ses commentateurs. Nous
avons signalé que Rawls posait plus qu’il ne la démontrait l’appartenance de la propriété des
facteurs de production à la structure sociale de base. Et, quand il l’esquisse, ce critère reste
imprécis : par exemple, il ne s’agirait pas tant considérer le nombre de personnes impliquées -
« une démocratie constitutionnelle est plus qu’une grande famille » - que « la structure et le
rôle social des institutions » concernées (Rawls 1995, p. 314).
Les auteurs d’inspiration rawlsienne ne proposent pas non plus de définition unanime du
critère permettant de justifier l’appartenance de l’entreprise et de ses règles à la structure de
base, souvent présentée comme une évidence. Il en va ainsi de la gouvernance de l’entreprise
(notamment chez Freeman 2007 ; Hussain 2009 ; O’Neill 2008) mais aussi, plus
généralement, de « l’entreprise » comme telle. Par exemple, pour O’Neill « il ne fait aucun
doute que les entreprises sont des éléments significatifs de la structure socio-économique de
base des sociétés libérales modernes » (O’Neill 2009, p. 175). De même, pour Heath,
Moriarty et Norman, « ce n’est pas un saut important de penser, que, au minimum, les
entreprises cotées en bourse devraient être considérées comme une partie de la structure de
base » (2010, p. 432).
Mais derrière l’évidence affichée, les raisons à l’appui de ces affirmations sont souvent
implicites. Et elles varient significativement quand elles sont énoncées explicitement,
aboutissant à des conclusions différentes à propos de différentes organisations économiques.
Ainsi, quand ils évoquent « l’entreprise » tous ne portent pas un jugement identique sur la
petite PME, la société cotée, les entreprises publiques, les ONG, l’université ou encore les
associations sportives ou culturelles. De plus, l’affirmation selon laquelle « l’entreprise »
appartient à la structure de base laisse ouverte la question des éléments précis qu’il faut
soumettre à la considération critique du libéralisme égalitaire. Convient-il par exemple de
traiter à l’identique les décisions stratégiques, celles liées aux politiques de ressources
humaines ou aux questions de gouvernance ? Un critère satisfaisant d’appartenance d’une
institution à la structure de base devrait permettre de clarifier ces différents points. Examinons
à présent les critères de constitutivité de la structure sociale de base mis en avant dans la
littérature et leurs implications pour le statut de l’entreprise et de ses pratiques.
14
CRITERES DE CONSTITUTIVITE DE LA STRUCTURE DE BASE ET STATUT DE
L’ENTREPRISE
Face aux incertitudes du texte rawlsien, plusieurs critères de délimitation de la structure de
base ont été avancés. Ils conduisent à intégrer différents aspects de l’entreprise à la structure
de base. Nous les examinons tour à tour21, avant de proposer un critère alternatif et d’en tirer
les implications pour le statut de l’entreprise d’une société juste.
Des unions sociales centrales dans la vie des gens - Taylor
Dans un article consacré à la justification de la priorité lexicale du principe de l’égalité
équitable des chances sur le principe de différence, Taylor (2004) propose qu’une union
sociale « fait partie » de la structure de base si elle est centrale dans la vie des gens et qu’elle
représente leur source de revenu essentielle (cf. fig 2) :
Qu’est-ce qui distingue alors ces unions sociales qui font partie de la structure de base … des unions sociales en général ? Ce qui les distingue (entre autres) c’est que les fonctions et les positions qui leur sont associées demandent un engagement important et en général prépondérant en temps et en énergie et sont les premières sources de subsistance [primary sources of livelihood] de ceux qui les occupent. (2004, p. 341, nos italiques)22
Les organisations professionnelles font partie de la structure de base parce qu’elles sont un
élément « central » (2004, p. 341) et nécessaire de la vie des gens qui occupent les postes et
fonctions qu’elles proposent. Central, parce qu’elles leur demandent un investissement
notable en temps et en énergie, et nécessaire, parce qu’elles sont leur première source de
revenu23. Elles jouent donc un rôle essentiel dans la réalisation d’intérêts importants de la vie
humaine : elles constituent le lieu incontournable de la réalisation de soi et elles répondent à
l’intérêt des citoyens pour les revenus et la richesse.
C’est la raison pour laquelle, les « gouvernements, entreprises publiques et privées,
universités, ONG » (Taylor 2004, p. 341) relèvent de la structure de base, à la différence des
associations sportives, culturelles ou religieuses. On notera qu’en renvoyant à la présence
d’un personnel rémunéré, le critère de Taylor intègre dans la structure de base des
organisations écartées par d’autres auteurs, par exemple la petite entreprise, l’université ou les
21Il s’agit de reconstructions élaborées à partir d’indications tirées d’articles qui n’abordent pas nécessairement la question du statut de l’entreprise frontalement. Elles présentent par conséquent un caractère spéculatif. 22Toutes les traductions de cet article de Taylor sont les nôtres. 23C’est aussi l’une des raisons avancées par Hussain pour justifier la mise en place de structures de démocratie participative au niveau des branches d’activité : c’est parce que le travail est central dans la vie des individus que la participation à l’activité économique apparaît la plus pertinente pour développer et affermir leur sens de la justice.
15
ONG. Heath, Moriarty et Norman hésitent ainsi pour leur part à associer la petite entreprise à
la structure de base (Heath et al. 2010, p. 432) et Rawls suivi par Freeman en excluent pour ce
qui les concerne l’université.
La réflexion de Taylor, qui poursuivait d’autres objectifs, laisse certaines questions en
suspens. Par exemple, pourquoi intégrer dans la structure de base les organisations qui ont un
effet sur le revenu de subsistance plutôt que sur les revenus et richesses de façon générale24 ?
Plus fondamentalement, Taylor mentionne les effets des entreprises sur le revenu et la
réalisation de soi sans évoquer d’autres biens premiers tels que le pouvoir et les prérogatives.
Cela tient certainement au fait qu’il ne s’intéresse au statut des unions sociales qu’à la faveur
de sa justification de la priorité lexicale de l’égalité des chances sur le principe de différence
et qu’il lui suffit pour cela de constater la priorité de l’intérêt pour la réalisation de soi sur
l’intérêt pour la consommation. On pourrait sans doute extrapoler de la caractéristique de
centralité des unions sociales dans la vie des gens l’idée d’un effet sur la distribution du
pouvoir et des prérogatives, mais cette articulation possible reste implicite.
De plus, en évoquant en termes généraux l’appartenance de l’union sociale à la structure de
base, ce critère laisse ouverte la question des pratiques qu’il convient de considérer plus
précisément. Notamment, Taylor affirme-t-il que les entreprises « font partie » de la structure
de base sur un mode inclusiviste ou constitutiviste ? Les indices qui témoigneraient d’une
ontologie spécifique de l’entreprise sont rares, si bien qu’une réponse à cette question revêt un
caractère conjectural. Le vocabulaire de l’appartenance (« part of ») et la distinction établie
entre deux catégories d’unions sociales, les associations et les entreprises, tendrait à asseoir
une représentation constitutiviste de l’entreprise comme institution de base. Mais on
s’étonnera alors que Taylor ne fasse référence qu’aux institutions rawlsiennes classiques pour
la garantie de l’« intérêt pour la réalisation de soi par le travail » (Taylor 2004, p. 345), à
savoir la liberté formelle d’accès aux postes et responsabilités et une éducation publique. Le
manque d’attention portée à des politiques d’entreprise (notamment la participation,
l’enrichissement des tâches etc.) pourrait refléter la pente inclusiviste rawlsienne, alors qu’un
positionnement constitutiviste les aurait peut-être envisagées comme leviers possibles de la
réalisation de soi25. Mais comme chez Rawls, il reste difficile, au final, de trancher le
positionnement d’une réflexion qui n’aborde le statut de l’entreprise que de façon indirecte.
24L’interprétation pertinente des biens premiers, et notamment du revenu et de la richesse, a fait l’objet de débats. Sur ce point, voir par exemple Chauvier (2004). 25Freeman évoque pour sa part la possibilité que la juste égalité des chances requière une forme de contrôle de la part des salariés (2007, p. 135).
16
Des conventions légales aux effets profonds – O’Neill
Dans un article consacré à la fiscalité de l’entreprise (2009) O’Neill formule de façon plus
systématique une condition d’appartenance de l’entreprise à la structure de base. Nous
pouvons restituer sa position de la façon suivante : une union sociale est constitutive de la
structure de base de la société si les conventions qui la structurent ont des effets profonds sur
la distribution des biens premiers et ont un caractère légal, comme produit de l’activité du
législateur (condition suffisante). C’est ce qui justifie pour O’Neill que la justice libérale
égalitaire s’intéresse aux entreprises, qui présentent ces deux caractéristiques.
Les institutions de la structure de base sont tout d’abord celles qui ont un effet profond sur
la distribution des biens premiers, incluant explicitement les chances de succès, le pouvoir et
les prérogatives, le revenu et les richesses ainsi que les bases sociales du respect de soi.
O’Neill affirme que les entreprises appartiennent à la structure de base de la société parce
qu’« [elles] ont certainement un effet profond sur la distribution des biens premiers
rawlsiens » (2009, p. 175, nos italiques)26. Cette formule fait écho à celle de Rawls selon
laquelle la structure de base est l’objet de la justice « parce que ses effets sont très profonds et
se font sentir dès le début » (1987, p. 33, nos italiques).
Mais O’Neill ne suggère pas d’intégrer l’entreprise à la structure de base seulement en
raison de la profondeur de ses effets sur la distribution des biens premiers. C’est aussi parce
qu’il s’agit d’une structure « conventionnelle » instituée par le droit : « la forme de
l’entreprise n’existe que grâce à une structure juridique et institutionnelle d’arrière-plan »
(O’Neill 2009, p. 177), « les entreprises existent au titre de conséquence conventionnelle de
décisions politiques » (O’Neill 2009, p. 177), « [elles] tirent leur identité d’un ensemble
particulier de règles juridiques » (O’Neill 2009, p. 179). O’Neill conclut qu’en tant qu’entités
artificielles, les entreprises doivent voir les normes qui les structurent et les droits qui leur
sont concédés évalués du point de vue de la justice libérale égalitaire27. Les conventions
constitutives des entreprises devraient donc être modifiées quand elles sont susceptibles de
« mieux servir les intérêts des états démocratiques qui leur donnent l’existence » (O’Neill
2009, p. 177).
26Les italiques sont les nôtres. Waheed Hussain défend également le modèle idéal de ce qu’il décrit comme un corporatisme démocratique en insistant sur la plus grande justice de ses effets distributifs : « il y a aussi des preuves empiriques que les sociétés qui adoptent les éléments du corporatisme démocratique tendent à distribuer les ressources économiques de façon plus juste » (Hussain 2009, p. 428, notre traduction). 27« Loin d’être une unité “naturelle” de la vie économique, la forme juridique de l’entreprise est le produit d’un moment historique particulier. En tant que telle, elle devrait être soumise à une reconfiguration et une restructuration substantielles au sein des sociétés démocratiques, si cela permet de servir des objectifs politiques importants » (O’Neill 2009, p. 177).
17
Ce critère apporte notamment deux précisions par rapport à l’approche de Taylor. Il étend
tout d’abord explicitement l’observation des effets de l’entreprise à l’ensemble des biens
premiers, au-delà du revenu et de la réalisation de soi. Il explicite et circonscrit en outre le
sens de la formule selon laquelle « l’entreprise » appartient à la structure de base de la
société : il s’agit plus précisément d’observer les effets des conventions légales structurant
son activité, par exemple sa forme de gouvernance (O’Neill 2008). C’est donc une
représentation constitutiviste de l’entreprise comme institution.
Mais ce critère demande aussi à être affiné. Il conviendrait tout d’abord de préciser les
modalités d’évaluation de la profondeur des effets d’une institution sur la distribution de biens
premiers. Différentes options restent ouvertes : on pourrait par exemple juger suffisant le fait
qu’une pratique conventionnelle affecte profondément la vie d’une seule personne pour que
ses effets soit qualifiés de profonds ; ou bien affirmer au contraire que celle-ci n’a d’effets
profonds que lorsqu’elle affecte plusieurs individus. Et il faudrait encore, dans ce cas,
proposer une définition du groupe pertinent. On pourra également s’interroger sur le
périmètre des conventions pertinentes pour la justice égalitaire. O’Neill intègre en effet à la
structure de base les conventions inscrites dans la loi, mais son analyse laisse en suspens la
façon dont la justice libérale égalitaire devrait considérer les pratiques ou conventions
informelles d’entreprise qui auraient aussi un effet important sur la distribution des biens
premiers.
Des institutions fonctionnellement nécessaires – Freeman
Dans l’ouvrage que Freeman consacre à Rawls (2007), il ressort une définition quelque peu
différente de la structure de base : une institution est constitutive de la structure de base de la
société si et seulement si elle est nécessaire à une coopération sociale productive.
Tout d’abord, pour Freeman comme pour O’Neill, le critère de la profondeur des effets
apparaît comme une caractéristique nécessaire mais non suffisante de la structure de base :
Ces institutions [de la structure de base] ont une influence profonde sur la vie quotidienne des individus, leurs caractères, leurs désirs, leurs ambitions, ainsi que sur leurs perspectives futures […]. [Mais] la caractéristique distinctive de chacune de ces institutions, ce qui fait d’elles une partie de la structure de base de la société, ce n’est pas simplement qu’elles ont une influence aussi profonde sur la vie des individus et leurs perspectives futures. On pourrait dire la même chose d’autres institutions dans la société, telles que ses institutions religieuses, ses universités, ou ses réseaux de communication de masse. (Freeman 2007, p. 101, nos italiques)28
28Cette traduction et toutes les suivantes de cet ouvrage de Freeman sont les nôtres.
18
Mais pour distinguer, parmi les institutions aux effets profonds dans la vie des individus,
celles qui relèvent de la structure de base, Freeman retient un critère distinct de celui de
O’Neill. Pour Freeman, ce n’est pas le caractère légal, ou plutôt, dans ses propres termes, le
fait de la contrainte légale, qui constitue le critère complémentaire pertinent. Contingente à la
faiblesse morale caractéristique d’un peuple de démons, la contrainte légale est nécessaire
pour garantir le respect des règles, mais elle ne distingue en rien les règles que le droit doit
rendre obligatoires de celles qui peuvent être abandonnées à la bonne volonté des individus :
La caractéristique distinctive de ces institutions, ce n’est pas non plus qu’elles impliquent toutes d’une façon ou d’une autre une mise en œuvre politique coercitive de leurs règles, contrairement aux règles des associations volontaires […]. Après tout, si tout le monde acceptait l’application des règles tout le temps, la coercition pourrait ne jamais être nécessaire. (Freeman 2007, p. 101-102)
Ce n’est donc pas le fait de la contrainte qui désigne les institutions de la structure de base
mais au contraire l’identification préalable de la structure de base qui permet de dessiner
l’espace où la contrainte s’exerce de façon légitime. Quel est alors le fondement du droit de
contrainte, et donc du critère d’appartenance d’une institution à la structure de base ? Ce
fondement, c’est le caractère de nécessité fonctionnelle de l’institution concernée pour la
coopération sociale. C’est précisément parce que des institutions sont indispensables à la
coopération sociale qu’il faut s’assurer que chacun les respecte :
La caractéristique distinctive des institutions sociales de base qui constituent la structure de base, c’est qu’elles sont, sous une forme ou une autre, nécessaires à une coopération sociale productive, et partant, pour la continuation de l’existence de toute société, en particulier de toute société relativement moderne. (Freeman 2007, p. 102)
Cette indication fait écho au passage de La justice comme équité où Rawls avance avec netteté
un critère fonctionnaliste pour juger de l’appartenance de la famille à la structure de base :
« la famille fait partie de la structure de base, car l’un de ses rôles essentiels est d’instituer la
production et la reproduction ordonnée de la société […]. Le travail reproductif est un travail
socialement nécessaire » (Rawls 2003, p. 222, nos italiques). Ainsi, pour Freeman,
l’institution de base est une composante nécessaire et inamovible du système social. Elle a
bien évidemment un effet profond sur les perspectives de vie, puisque sans elle, il n’y aurait
ni société ni biens premiers. Mais la réciproque n’est pas vraie : toute institution qui a des
effets profonds sur la société n’est pas fonctionnellement nécessaire et ne fait donc pas partie
de la structure de base.
19
Freeman n’indique pas les raisons que le conduisent à limiter la structure de base aux
institutions fonctionnellement nécessaires et à en écarter, par exemple, les institutions
religieuses ou les universités. On peut toutefois supposer que les institutions
fonctionnellement nécessaires sont celles auxquelles l’individu est soumis malgré lui, ce qui
justifie leur soumission à la rationalité des principes de justice. A contrario, les institutions
non nécessaires sont des règles ou des associations volontaires dont les buts privés sont
choisis et partagés par leurs membres. De fait, rien ne s’oppose à ce que des individus
éprouvent les effets profonds de règles locales auxquelles ils adhèrent. Un rawlsien orthodoxe
n’objecterait pas à ce que les membres d’une institution religieuse respectent un vœu de
pauvreté qu’ils auraient choisis. Et on pourrait imaginer, à l’extrême, que tous les citoyens
d’une société se soumettent volontairement à une même règle particulière. C’est la raison
pour laquelle le critère de profondeur des effets constitue une condition nécessaire mais non
suffisante d’appartenance d’une institution à la structure de base.
On pourra cependant s’interroger sur la légitimité de la limitation de la structure de base
aux institutions qui répondent au critère de la profondeur des effets associé à celui de
nécessité fonctionnelle. En effet, ce critère omettra d’intégrer à la structure de base une
association importante qui modifierait la distribution d’ensemble des biens premiers, dans
l’hypothèse où cette association ne serait pas fonctionnellement nécessaire à la coopération
sociale, comme ce pourrait être le cas d’une institution religieuse très présente dans la société.
Ce critère omettra également d’intégrer une pratique génératrice d’inégalités pour les moins
favorisés, si celle-ci n’apparaît pas nécessaire à la perpétuation de la coopération productive,
par exemple, une pratique discriminatoire fondée sur le genre.
Or, bien que le libéralisme égalitaire n’ait rien à redire, en première analyse, au fait que
tous les membres de la société partagent les principes d’une association ou d’une pratique
sociale, il exige néanmoins que tous disposent des moyens de vivre comme des citoyens
coopérant sur un pied d’égalité et soient capables de poursuivre la conception du bien qui est
la leur, en particulier si elle diffère de celle de l’association dominante. Les individus
appartenant aux nouvelles générations doivent ainsi avoir la possibilité d’adopter une
conception du bien différente de celle à laquelle tous adhèrent déjà. Et chacun doit conserver
au cours de sa vie la possibilité de réviser sa conception du bien. Au regard de cet impératif,
une contradiction apparaît entre l’exigence libérale de respect des associations et des pratiques
privées et l’influence possible d’une association ou d’une pratique dominante sur la
répartition des biens premiers : leurs effets distributifs potentiellement injustes déstabilisent
les conditions de perpétuation d’une coopération équitable.
20
Nous pouvons préciser à présent les implications du critère fonctionnaliste de délimitation
de la structure de base pour le statut des entreprises : il autorise une forme minimaliste de
constitutivisme. Il exclut de la structure de base des organisations ou des règles, formelles ou
informelles, qui ne relèveraient pas d’une modalité nécessaire du fonctionnement de la
société, par exemple ses « institutions religieuses, ses universités, ou ses réseaux de
communication de masse » (Freeman 2007, p. 101) ou encore une entreprise particulière,
quand bien même celles-ci auraient des effets profonds sur la distribution des biens premiers.
La représentation de ces organisations ou de ces règles communes d’action apparaît alors
plutôt inclusiviste, renvoyant à des entités indépendantes de la structure de base et relevant de
finalités privées. Cependant, les organisations économiques, conventions et règles
d’entreprise fonctionnellement essentielles à la société sont constitutives de la structure de
base. Cela justifie pour Freeman l’intégration à la structure de base de « la structure et [des]
normes du système économique de production, de transfert et de distribution des biens et des
ressources entre individus » (Freeman 2007, p. 101) et notamment de la gouvernance
d’entreprise (Freeman 2007, p. 136). Freeman « entre » pour ainsi dire dans l’entreprise pour
identifier les modalités de répartition du pouvoir compatibles avec la juste égalité des
chances. De ce point de vue, son approche de l’entreprise apparaît constitutiviste, même si la
contrainte de la nécessité fonctionnelle limite le nombre des institutions éligibles.
Des structures formelles et informelles aux effets profonds - G. A. Cohen
Le cas des règles informelles, en suspens chez O’Neill et guère abordé par Freeman, a
provoqué une objection radicale à la conception institutionnelle de la justice proposée par
Rawls : il s’agit de l’objection de G.A. Cohen, qui conteste la restriction de la justice à la
structure de base précisément au motif que cette conception de la justice ne parviendrait pas à
traiter de façon cohérente le cas des conventions ou règles informelles susceptibles d’avoir
des effets profonds sur la distribution des biens premiers. Cette objection remet en question
l’intérêt même du projet de localisation de l’entreprise dans la structure sociale de base.
Les règles informelles sont des règles non coercitives au sens du droit positif, telles que les
règles coutumières (Cohen 1997 ; 2008), les conventions ou autres pratiques courantes
informelles. Bien qu’elles ne soient pas inscrites dans la loi, Cohen souligne que les individus
les acceptent, s’y conforment et, de ce fait, les perpétuent. Ce processus produit et reproduit
ainsi les structures sociales informelles. La structure familiale inégalitaire, par exemple, est le
produit de la multitude d’actions individuelles d’hommes et de femmes qui pratiquent le
principe d’une répartition inégalitaire des tâches au sein du foyer (Cohen 2008, p. 137). De
21
plus, à l’instar des lois positives, les règles coutumières peuvent avoir des effets profonds sur
les perspectives des individus. Pour Cohen, ces règles mettent l’institutionnalisme rawlsien
face à un dilemme insurmontable.
Ou bien on s’en tient à l’affirmation de Rawls selon laquelle la structure de base est
constituée des institutions qui ont un effet profond sur les perspectives des individus, et il faut
alors intégrer les structures informelles à la structure de base de la société, au vu de
l’importance de leurs effets sur la vie des gens. Pour Cohen, ce serait l’interprétation la plus
plausible du texte de Rawls. Mais elle implique aussi, selon lui, d’évaluer la justice des
actions quotidiennes à l’origine de ces règles à l’aune des mêmes principes que ceux qui
servent à évaluer la justice du droit positif29, précisément parce que la justice a trait à tout ce
qui a une influence profonde sur les biens premiers (Cohen 2008, p. 135) :
Ce que je dis, ce n’est pas que le comportement quotidien […] fait partie de la structure de base, mais qu’il est si étroitement lié à ce qui, sous peine d’arbitraire, doit être inclus dans la structure de base, à savoir la structure informelle qu’exige la justice, que cela aussi, c’est-à-dire le comportement quotidien, ressort des mêmes principes de justice que ceux qui jugent des propriétés structurelles de la société. (Cohen 2008, p. 150)
La société juste exigerait donc que les principes de justice ne se limitent pas à inspirer la
forme de la structure de base de la société mais animent aussi l’« ethos » (2008, p. 132) des
individus et des associations. Une telle lecture fait cependant problème parce qu’elle
contrevient à la séparation stricte que Rawls avait voulu établir entre le domaine d’application
de la justice (qui concerne les décisions du législateur) et le domaine d’application de
l’éthique (qui concerne les décisions privées des individus et des groupes d’individus).
Ou bien on évite cette difficulté en limitant le champ d’application des principes de justice
aux lois positives existantes et en excluant de la structure sociale de base les institutions
informelles qui ont un effet profond sur la vie des gens. Mais Cohen souligne que cette option
entre en contradiction avec l’argument de Rawls selon lequel la structure de base fait l’objet
de la justice précisément « parce que ses effets sont très profonds et se font sentir dès le
début » (Rawls 1987, p. 33, cité par Cohen 2008, p. 136). Pour Cohen, cette dernière
caractérisation de la structure de base n’est pas « optionnelle » (2000, p. 138 ; 2008, p. 136)
mais fondamentale : il lui apparaît donc parfaitement arbitraire d’exclure les structures
informelles de la structure de base.
29« De même que vous pouvez demander si le législateur agit justement quand il crée une certaine structure coercitive, de même pouvez-vous évaluer pour leur justice les actes quotidiens délibérés par lesquels les participants à une structure informelle la perpétuent » (Cohen 2008, p.135). Toutes les traductions de cet ouvrage de Cohen sont les nôtres.
22
Cohen de conclure que l’institutionnalisme rawlsien se retrouve dans une situation
inextricable, l’incohérence tenant au fond à l’affirmation simultanée de deux exigences
incompatibles : une première exigence qui veut que la justice n’ait pas à constituer le mobile
d’actions individuelles et se limite à organiser la structure formelle de la société et une
deuxième exigence selon laquelle la justice doit prendre pour objet toutes les institutions qui
ont un effet important dans la vie des gens, dont les structures informelles et les intentions à
leur origine.
Face à cette alternative, Cohen penche pour la deuxième option. Ainsi, pour Cohen, une
institution formelle ou informelle appartient à la structure de base de la société si et
seulement si elle a un effet profond sur la vie des gens (Cohen 2000, p. 146). Par conséquent,
toutes les structures légales ou coutumières de l’entreprise dont les effets sont profonds
apparaîtront bien constitutives de la structure de base. Mais le rejet de la division du travail
moral entre structure de base et actions individuelles30 relativise fortement l’enjeu soulevé par
la nature de l’entreprise et la question de son positionnement dans la structure de base : en
effet, toutes les décisions au sein de l’entreprise, individuelles et collectives, toutes ses
pratiques et toutes les règles formelles et informelles qu’elle suit devront être guidées par un
même ethos de justice.
Des institutions affectant les perspectives d’une position sociale pertinente
Deux options principales ressortent de ce tour d’horizon des critères de délimitation de la
structure de base et de leurs implications pour l’entreprise. La première option retient une
conception institutionnaliste de la justice et cherche à définir, dans les pas de Rawls, un
critère d’appartenance d’une institution à la structure de base ; mais ses deux variantes,
conventionnelle-légale et fonctionnaliste ignorent ou se privent de la capacité d’encadrer les
institutions informelles ou non fonctionnellement nécessaires qui ont un effet profond sur la
distribution des biens premiers, fragilisant ainsi les conditions de perpétuation d’une société
juste. Le coût de la première option serait celui d’une conception trop restrictive de la
structure de base et donc insuffisamment exigeante vis-à-vis de l’entreprise (constitutivisme
limité ou minimaliste, cf. fig. 2 ci-après).
Une conception non institutionnaliste de la justice définit en réponse la structure de base
comme l’ensemble des structures formelles et informelles qui ont un effet profond sur la
distribution des biens premiers mais appelle simultanément à étendre l’exigence de justice à la
30Selon un argument notoire de Cohen, un ethos de justice devrait orienter toutes les actions individuelles, car il serait incohérent, pour un citoyen égalitariste qui souscrit aux principes de justice de les ignorer dans le cadre privé de sa vie familiale ou professionnelle (Cohen 1997, p. 8-9).
23
sphère personnelle. Le coût de cette deuxième option, c’est la limitation des prérogatives de
l’agent de poursuivre ses fins propres, de l’agent individuel (Tan 2004, p. 347) mais aussi de
l’entreprise comme agent collectif.
Face à cette alternative, nous proposons un critère large d’appartenance à la structure de
base qui puisse tenir compte des effets de pratiques émergentes ainsi que des structures
informelles, sans partager toutefois les implications qu’en tire Cohen, à savoir, l’application
d’un ethos de justice à toutes les actions individuelles. Cette conception de la structure de
base, conjuguée à celle de l’entreprise comme institution, implique une représentation
constitutiviste étendue de l’entreprise (cf. fig. 2 ci-après). Nous présentons ce critère de
délimitation de la structure de base et ses implications pour la représentation de l’entreprise
avant de souligner ce qui le distingue des propositions précédemment évoquées puis de
l’illustrer à partir d’un exemple concret.
Nous proposons un critère distributif structurel d’appartenance d’une institution à la
structure de base, qui définit cette dernière à partir de ses effets sur la distribution des biens
premiers. Une institution ou une pratique fait partie de la structure de base de la société si et
seulement si elle a un effet structurel sur la distribution des biens premiers, c’est-à-dire si et
seulement si, considérée indépendamment ou de façon agrégée avec des institutions ou
pratiques similaires, elle affecte, dans son fonctionnement avec les autres institutions de la
société, les perspectives de biens premiers d’au moins une position sociale pertinente. L’idée
d’un effet structurel sur la distribution des biens premiers désigne ainsi un effet qui porte sur
une position sociale pertinente par différence avec des institutions ou pratiques affectant
seulement un ou plusieurs individus.
Par ailleurs, le terme d’institution désigne une convention ou une règle, inscrite ou non
dans la loi. Le terme de pratique renvoie à la similarité d’un ensemble d’actions qui ne
suivent pas nécessairement de codification explicite mais plutôt implicite. La distinction entre
pratique et institution peut être ténue, dans la mesure où une pratique peut se généraliser
jusqu’à devenir une forme institutionnelle. Mais il est clair que ce critère ne s’applique pas
seulement à des lois positives existantes, par exemple au droit des sociétés, ni à l’entreprise
envisagée comme une unité indivisible. Il permet ainsi de considérer, à côté des lois positives,
des codes ou des règles volontaires (soft law) ainsi que des pratiques qui ne seraient pas
encore codifiées, voire identifiées. Il permet donc d’ouvrir la boîte noire de l’entreprise en
invitant à se la représenter comme une superposition de pratiques et de règles locales plus ou
moins intégrées aux strates de pratiques et de règles partagées à l’échelon supérieur, par
exemple au niveau d’un secteur d’activité ou au niveau d’ensemble de la société. Il sera ainsi
24
possible d’observer l’effet des codes et pratiques internes à l’entreprise, tels que leur
gouvernance, leurs politiques de rémunération, la formation des salariés etc. L’observateur
choisira alors le niveau d’agrégation de son observation, local, sectoriel ou national. On
cherchera par exemple à observer les éventuels effets d’un système31 de pratiques locales
répandues mais non réglementées ou les effets de pratiques émergentes. Cette approche
impose donc à l’observateur libéral égalitaire de définir précisément ce qu’il observe et
évalue.
Rawls corrobore cette proposition quand il souligne que des actions justes au sens où elles
sont menées dans le cadre d’une société bien ordonnée peuvent déstabiliser le contexte
d’équité de la société et requérir des ajustements de la structure de base : « même si tout le
monde agit équitablement […] le résultat de nombreuses transactions séparées peut affaiblir la
justice du contexte social. […] Par conséquent, même dans une société bien ordonnée, des
ajustements dans la structure de base sont toujours nécessaires » (Rawls 1995, p. 339). Rawls
envisage bien ici de considérer comme sujet de la justice sociale des pratiques ou institutions
que l’on aurait jugées jusque-là non significatives mais dont on constaterait progressivement
l’influence croissante sur la répartition d’ensemble des biens premiers et qu’il conviendrait,
par conséquent, d’encadrer. Leur régulation peut intervenir ex-post par le biais de la fiscalité,
mais aussi ex-ante, en autorisant, interdisant ou orientant les pratiques qui ne relèvent pas de
droits et de libertés fondamentales.
Par ailleurs, l’évaluation de l’institution ou de la pratique considérée doit être faite dans son
environnement économique. De fait, une institution peut avoir un effet direct sur une position
sociale pertinente, mais aussi un effet indirect via son influence sur d’autres institutions qui
affectent également la position considérée. Nous pouvons penser par exemple aux éventuels
effets désincitatifs sur le travail d’un revenu inconditionnel de base : il importe donc, pour
évaluer ce dernier, de considérer ses effets indirects sur le revenu du travail32. Juger de l’effet
d’une institution donnée implique ainsi de tenir compte des autres institutions avec lesquelles
elle interagit (Tan 2004, p. 337-338). Par ailleurs, il s’agit d’évaluer les effets des institutions
considérées sur les perspectives de vie des citoyens « durant leur vie complète » (Rawls 2003,
p. 85) par différence avec la distribution des biens premiers à un instant donné33.
31Nous employons ce terme par référence à la discussion de Rawls par Susan Moller Okin. Cette dernière a mis en évidence l’incidence d’un « système du genre » sur la distribution des libertés politiques, des ressources, des « responsabilités et [des] privilèges » (Okin 2008, p. 224). Rawls utilise également ce terme dans l’esquisse de réponse qu’il fait à Susan Moller Okin (Rawls 2003, p. 228). 32Sur ce point voir par exemple la discussion menée par Van Parijs (2003, p. 218 sqq.). 33Sur l’importance et les implications de cette distinction, voir Van Parijs (2003, p. 211 sqq.).
25
L’élément le plus délicat à définir reste cependant celui de position sociale pertinente du
point de vue de la justice comme équité. Les positions sociales pertinentes sont celles qui
permettent de juger de la bonne application des principes de justice dans une société : « on
adopte la position de certains individus représentatifs et on considère le système social tel
qu’eux le voient » (Rawls 1987, p. 125). Ce critère implique de ne pas évaluer les effets d’une
institution sur un individu, mais sur une position sociale susceptible d’être occupée par des
personnes différentes dans les différents scénarii envisagés. Mais la véritable difficulté
concerne le degré de précision attaché à la description d’une position sociale pertinente, qui
déterminera aussi le niveau de granularité des institutions relevant de la structure de base. A
notre difficulté initiale de spécification d’une institution de la structure de base s’est donc
substituée celle de la caractérisation d’une position sociale pertinente. Hélas, les indications
de Rawls à ce sujet varient et renvoient à deux approches, distinctes en première analyse.
Une première suggestion, particulièrement appuyée dans la Théorie de la justice, définit les
positions sociales pertinentes comme les positions sociales de naissance caractérisées par des
dotations naturelles et sociales (Rawls 1987, p. 126). Le milieu social d’origine et les qualités
naturelles constituent les caractéristiques descriptives pertinentes de ces positions sociales car
elles « ne peuvent être modifiées » (Rawls 1987, p. 129) et que, additionnées d’un facteur
chance, elles influencent profondément les perspectives de vie des individus. La position du
plus défavorisé rassemble ainsi ceux qui sont les plus désavantagés du point de vue des trois
contingences, conjuguant un milieu social d’origine défavorisé, peu de talents naturels
actualisés et qui n’ont pas été favorisés par les hasards de la vie (Van Parijs 2003, p. 214).
Cependant, une deuxième suggestion présente plutôt la position pertinente comme une
position socio-professionnelle et/ou socio-économique de la société considérée à un moment
donné. Mais il ne s’agit pas simplement d’une position sociale ou d’un métier particuliers :
« toutes les positions sociales n’ont pas la même pertinence […] il existe des fermiers, mais
aussi des fermiers spécialisés dans les produits laitiers, dans les céréales […] et ainsi de suite
pour d’autres métiers et d’autres groupes à l’infini » (Rawls 1987, p. 126). En se démultipliant
à l’infini, ces catégories apparaissent trop précises pour définir les positions à prendre en
compte du point de vue de la justice comme équité. Rawls propose alors deux critères pour
définir les positions pertinentes et notamment celle du groupe le plus défavorisé. Le premier
critère associe une profession définie en termes de compétences et une catégorie sociale qui
lui est apparentée par son niveau de revenu. Pour identifier le groupe le plus défavorisé, il
s’agit ainsi de choisir « une position sociale particulière, celle de l’ouvrier non qualifié par
exemple, et ensuite de considérer comme groupe le plus défavorisé tous ceux qui ont
26
approximativement les mêmes revenus et la même richesse, ou moins » (Rawls 1987, p. 128).
Le deuxième critère fait l’économie de la référence à la catégorie socio-professionnelle pour
tenir compte directement du niveau de revenu : il « ferait jouer les niveaux relatifs de revenus
et de fortune, mais sans référence à la position sociale » (Rawls 1987, p. 128). Rawls fait par
ailleurs l’hypothèse que le plus défavorisé du point de vue du revenu le sera également du
point de vue des autres biens premiers (Rawls 1987, p. 127). Suggérée dans la Théorie de la
justice, cette approche est confirmée dans La justice comme équité : « les plus défavorisés
sont ceux qui appartiennent à la classe de revenu dont les attentes sont les plus faibles »
(Rawls 2003 p. 90-91).
Nous sommes bien ici en présence de deux caractérisations distinctes des positions sociales
pertinentes – à partir des dotations initiales ou à partir des perspectives de biens premiers –
mais nous pouvons tenter d’en proposer une interprétation synthétique. Cette double
perspective manifeste l’idée d’une correspondance entre dotations initiales et perspectives de
biens premiers, entre positions sociales de départ et positions sociales ultérieures d’une
société : « l’un et l’autre critère [profession et revenu] s’appliquent bien à ceux qui sont les
moins bien lotis par les diverses contingences » (Rawls 1987, p. 129, nos italiques). Et c’est
précisément en raison de cette connexion et du rôle fondamental qu’y joue la structure de base
que se pose la question de la société juste. Par conséquent, la position sociale pertinente n’est
ni un groupe caractérisé par des dotations de départ, ni un groupe de situations socio-
économiques ou professionnelles caractérisées par des perspectives de biens premiers : il
s’agit des deux à la fois. Une position sociale pertinente du point de vue de la définition de la
structure de base sera ainsi l’ensemble des positions sociales (au sens de professions ou de
catégories sociales définies par un revenu donné) accessibles à partir d’un lot de dotations
(milieu social d’origine, talents naturels actualisés et hasards de la vie) et caractérisées par des
perspectives de biens premiers au cours d’une vie. On peut donc aussi considérer que les
positions sociales pertinentes sont celles auxquelles les individus n’accèdent pas
volontairement ; ou, plus précisément, qu’elles constituent la part non volontaire et donc, non
imputable à l’individu, de positions sociales plus finement identifiées. C’est la raison pour
laquelle, « puisque je fais l’hypothèse qu’en général on accède volontairement aux autres
positions, nous n’avons pas besoin de prendre en considération le point de vue des gens
occupant ces autres positions pour évaluer la structure de base » (Rawls 1987, p. 126-127).
Réciproquement, si d’autres caractéristiques que les talents et le milieu social devenaient
discriminantes dans l’accès aux positions sociales, par exemple certains traits naturels, ces
caractéristiques définiraient alors aussi des positions pertinentes (Rawls 2003, p. 98). Au
27
final, et malgré les hésitations de Rawls sur ce point34, les positions sociales pertinentes pour
la structure de base sont les positions sociales de départ qui ouvrent sur des parcours sociaux
associés aux dotations initiales.
Nous pouvons maintenant préciser la façon dont ce critère de délimitation de la structure de
base répond au souci qui avait poussé Rawls à distinguer entre les principes organisateurs de
la structure de base et ceux valables pour des institutions particulières ou des actions
individuelles. Cette distinction procédait du constat que les citoyens sont nécessairement
soumis aux institutions de la structure de base alors qu’ils ont une issue possible face à une
organisation donnée. Le critère distributif structurel permet d’affiner ce qu’il faut entendre par
là. L’individu est « soumis » à une institution, qu’il s’agisse d’une organisation ou d’une
pratique, si celle-ci influence les perspectives de biens premiers de la position sociale
pertinente dont il relève.
La délimitation proposée de la structure de base comme institution qui affecte les
perspectives de bien premiers d’une position sociale pertinente est moins restrictive que celles
de Taylor, O’Neill ou Freeman, en invitant explicitement à intégrer plus de formes
institutionnelles à la structure de base. Conjuguée à une conception de l’entreprise comme
institution, elle débouche sur une représentation constitutiviste étendue de l’entreprise sous
laquelle les propositions précédentes peuvent être subsumées. Cette proposition permet tout
d’abord d’inclure l’idée de Taylor selon laquelle une union sociale qui affecte le revenu de
subsistance et l’égalité des chances appartient à la structure de base. Mais nous suggérons
qu’il conviendrait de désigner dans ce cas la politique des salaires (ou de recrutement) plutôt
que « l’union sociale » comme l’institution constitutive de la structure de base. C’est la raison
pour laquelle il est pertinent de réfléchir à des mesures libérales égalitaires portant sur les
salaires, qu’elles soient financées et mises en œuvre par l’entreprise ou par l’Etat35.
34Dans une longue note de La justice comme équité par exemple, Rawls modère cette interprétation : « Même si l’on suppose qu’il s’avère, comme la sociologie politique du sens commun porte à le croire, que les plus défavorisés, identifiés par leur revenu et leur richesse, incluent de nombreux individus nés dans la classe sociale d’origine la moins favorisée, et beaucoup de ceux qui sont le moins (naturellement) doués et qui ont subi le plus de malchance et d’infortune (section 16), il reste que ces attributs ne définissent pas les plus défavorisés. C’est plutôt qu’il peut exister une tendance à ce que ces traits caractérisent nombre de ceux qui appartiennent à ce groupe » (Rawls 2003, p. 91, note 26). 35Dans cet esprit, Van Parijs examine les mérites comparés pour les plus défavorisés d’une subvention publique sur les bas salaires (mécanisme de crédit d’impôt) et d’une allocation universelle inconditionnelle (Van Parijs 2003, p. 216 sqq.). Mais on pourrait aussi considérer l’effet de mesures mises en œuvre par les entreprises elles-mêmes, telles que le versement d’un salaire minimum ou encore la modification de la structure de gouvernance des comités de rémunération.
28
Ce critère permet en outre de considérer comme constitutives de la structure de base les
conventions légales et les institutions fonctionnellement essentielles à la coopération sociale
qui affectent profondément la distribution des biens premiers. Mais il permet aussi d’intégrer
explicitement des conventions qui ne seraient pas inscrites dans la loi ainsi que des pratiques
institutionnalisées, établies ou émergentes, en un mot, une structure informelle, ce en quoi il
va au-delà d’une définition seulement conventionnelle-légale de la structure de base. Il
apparaît aussi moins restrictif que le critère fonctionnel de Freeman en permettant d’évaluer et
d’inclure dans la structure de base les organisations ou les pratiques informelles
d’organisations qui ne seraient pas fonctionnellement nécessaires à la coopération sociale
mais auraient des effets importants sur la distribution des biens premiers.
La définition de la structure de base ainsi proposée peut apparaître proche de celle de
Cohen mais elle n’en partage pas les conclusions. Elle suggère que la mise en évidence des
effets structurels d’une règle coutumière n’invalide pas nécessairement la division du travail
moral entre structure de base et actions personnelles. Il s’agit plutôt de reconnaître que le
législateur doit encadrer les comportements coutumiers dont on constaterait les effets
structurellement défavorables sur la distribution des biens premiers. Ce faisant, le législateur
ne légifère pas sur les mobiles ou les attitudes des individus, autrement dit, sur l’ethos qui doit
les animer au quotidien, mais il encadre juridiquement des actions individuelles qui ont des
effets agrégés tangibles sur la distribution de biens premiers36. Il ne demande pas aux
individus d’agir par justice mais conformément à la justice. Et des limites s’imposent bien
évidemment à lui, par exemple celles du respect des libertés fondamentales et de l’égalité des
chances quand il intervient au nom du principe de différence37.
Au final, le critère proposé de la structure de base invite à une représentation constitutiviste
étendue de l’entreprise (cf. fig. 2 ci-après) intégrant à la structure de base : les dimensions de
l’entreprise fonctionnellement essentielles à la société considérée, les conventions légales aux
effets profonds qui la structurent, mais aussi toutes les autres pratiques ou politiques
d’entreprise susceptibles d’affecter les perspectives de biens premiers d’une position
pertinente.
36Nous partageons sur ce point l’excellente analyse de Kok-Chor Tan (2004, p. 366 sqq). 37Par exemple, si l’on constate les effets négatifs du divorce sur la situation financière des femmes divorcées les moins favorisées, la réaction pertinente du législateur ne consistera pas à interdire le divorce ou encourager un ethos égalitaire dans la répartition des travaux domestiques mais à mettre en place une compensation financière qui tienne compte de la valeur du travail domestique. C’est le résultat de la réflexion rawlsienne sur la famille patriarcale : « Une proposition aujourd’hui commune est que la loi, en tant que norme ou orientation, considère le travail d’une femme relatif aux enfants […] comme un titre lui donnant droit à une part égale du revenu que son mari gagne pendant la durée de leur mariage. Si un divorce survenait, elle devrait recevoir une part égale de la valeur qu’ont acquis les biens de la famille durant cette période » (Rawls 2003, p. 227-228).
29
Critères de délimitation de la structure de base et constitutivisme(s) d’entreprise (fig. 2)
Source Taylor O’Neill Freeman Cohen Proposition
Objet considéré
Unions sociales Union sociale* Institution Loi, pratique sociale
Institution, pratique sociale
Articulation à la structure de base
« font partie » de la structure de
base si
est constitutive de la structure
de base si
est constitutive de la structure de
base si et seulement si
est constitutive de la structure
de base si et seulement
si
est constitutive de la structure
de base si et seulement
si Source de l’effet
Unions sociales Conventions légales qui la
structurent
Institution Loi, pratique sociale
Institution, pratique sociale
Modalité de l’effet
Effet important Effet profond Nécessité fonctionnelle
Effet profond Effet
Type d’effet Temps et revenu Distribution des biens premiers
- Distribution des charges et des
avantages
Distribution des biens premiers
Affectés par l’effet
Salariés des unions sociales*
La société* Coopération sociale productive
Individus* Une position sociale
représentative Ontologie de l’entreprise
Non précisée Institution Institution (?)
Non précisée Institution
Représentation de l’entreprise
Constitutivisme (?)
Constitutivisme (limité)
Constitutivisme (minimaliste)
Distinction moralement non
pertinente
Constitutivisme (étendu)
*Hypothèse formulée à partir des indications partielles des textes retenus.
Nous pouvons évaluer pour finir la portée pratique de ce critère et la réponse qu’il permet
d’apporter à une question concrète portant sur l’entreprise. Quoiqu’il invite à adopter une
perspective constitutiviste sur l’entreprise, il est clair que ce critère ne peut permettre
d’identifier a priori toutes les dimensions de l’entreprise constitutives de la structure de base.
Il s’agit d’une question empirique qui demande de tenir compte des conditions particulières
d’une société donnée. Considérons par exemple la politique de rémunération d’une entreprise
de nettoyage industriel, dont les salaires des postes les moins qualifiés seraient parmi les
moins bien rémunérés d’une société donnée. S’agit-il d’une politique constitutive de la
structure de base ? La réponse doit être construite en cherchant à évaluer ses effets sur les
positions sociales pertinentes, en l’occurrence celle du plus désavantagé.
Si l’on considère la politique de rémunération de cette entreprise isolément, il est douteux
qu’elle ait, à elle seule, un effet sur la position sociale la plus défavorisée de la société dans
son ensemble. Cette politique de rémunération ne relève donc pas isolément de la structure de
30
base de la société mais de considérations de justice organisationnelle. Une analyse exhaustive
devra cependant examiner cette même question à un niveau d’agrégation plus élevé, par
exemple au niveau de la branche du nettoyage industriel.
Supposons à présent qu’une politique de relèvement des salaires dans le secteur du
nettoyage industriel puisse être réalisée. Nous faisons par exemple l’hypothèse que cette
activité locale ne souffrira pas de la concurrence internationale et que le surcoût salarial sera
supporté par le consommateur. On cherchera à déterminer le positionnement de cette politique
dans la structure de base en évaluant ses effets sur la position sociale la plus défavorisée de la
société. Imaginons pour simplifier que cette dernière corresponde à deux types de postes, ces
postes non qualifiés du secteur du nettoyage industriel et des postes d’opérateurs non qualifiés
sur des lignes de production d’entreprises industrielles. L’impact global d’un accord salarial
dans le secteur du nettoyage industriel dépendra vraisemblablement de la taille respective des
secteurs.
Si la taille du secteur du nettoyage industriel est suffisante pour affecter l’équilibre de
marché global et se répercuter sur les rémunérations des postes de qualification équivalente de
l’autre secteur industriel, il faut considérer qu’il s’agit d’une mesure structurelle, car elle
affecte une position pertinente. Cette évaluation demandera bien sûr d’intégrer au calcul toute
une série de facteurs tels le risque de fuite de capitaux, le risque associé sur l’emploi etc.38
Mais si l’on constate, tous comptes faits, une répercussion positive sur les perspectives de la
position sociale la plus défavorisée, alors cette mesure sectorielle relève bien de la justice de
la société considérée et peut être légitimement imposée par le législateur.
Mais si la taille du secteur du nettoyage est suffisamment réduite pour que les effets
distributifs de cette mesure se limitent aux salariés du secteur sans influencer l’équilibre de
marché, alors la mesure ne relève pas de la structure de base et correspond, du point de vue
des individus concernés, à un avantage particulier qui n’est pas soumis aux exigences de la
justice sociale. La poursuite de l’analyse demandera de reproduire la même réflexion au
niveau d’agrégation supérieur, par exemple, au niveau de la politique des salaires des deux
secteurs considérés, nettoyage et production industrielle. Mais si aucune politique globale
portant sur le niveau des rémunérations ne permet d’améliorer le sort des plus désavantagés,
la justice sociale pourra encore s’intéresser à d’autres politiques d’entreprise, telles que, par
exemple la gouvernance des comités de rémunération, ou bien alors considérer les
38Pour une réflexion économique de ce type, voir par exemple Witztum (2008).
31
instruments étatiques traditionnels de l’état-providence, comme la sécurité sociale, les
allocations chômage ou encore la fiscalité.
Soulignons pour finir la complexité des évaluations économiques en jeu et de l’ingénierie
socio-économique associée. Dès lors, quoiqu’une institution ou une mesure aux effets
structurels réels mais ténus ou difficiles à mesurer fasse partie de la structure de base, peut-
être la pratique politique préfèrera-t-elle considérer des institutions dont on puisse évaluer et
anticiper les effets avec plus de certitude ou aux effets plus importants. Et peut-être le
législateur jugera-t-il alors préférable de limiter ses décisions et la dimension formelle de la
structure de base à des mesures simples telles que l’impôt sur les sociétés ou l’impôt
progressif sur le revenu des particuliers, plutôt que de chercher à prendre des mesures
complexes portant sur la multiplicité des conventions et pratiques de l’entreprise39. Ce type de
limitations épistémiques pourra donc venir moduler la mise en œuvre politique du critère,
mais il n’affecte pas la légitimité de la régulation, du point de vue de la justice sociale, des
institutions et pratiques qu’il désigne à l’attention du législateur.
CONCLUSION
Reprenons à présent notre question inaugurale : l’entreprise fait-elle partie de la structure de
base de la société ? Nous avons montré que les ambiguïtés de la représentation rawlsienne de
l’entreprise ne permettent pas de répondre immédiatement à cette question. En effet, deux
représentations principales de l’entreprise affleurent dans le texte rawlsien, inclusiviste et
constitutiviste. L’approche inclusiviste représente l’entreprise comme une entité
ontologiquement distincte de la structure sociale de base et évoluant au sein de cette structure.
Les objectifs de l’entreprise-agent ainsi définie sont assimilables à des finalités individuelles
et son rapport à la structure de base se pense sur le modèle de la relation de l’individu à la
structure de base. Il s’agit de maximiser la liberté d’action de l’entreprise, sans pour autant
exclure la possibilité de mesures portant sur les sociétés, par exemple fiscales, pour la garantie
du deuxième principe. Mais cette approche soustrait certains faits internes de l’entreprise au
regard libéral égalitaire. L’approche constitutiviste insiste plutôt sur le caractère institutionnel
de l’entreprise et sa possible appartenance à la structure de base. C’est l’approche qui permet
d’exercer le regard le plus critique sur l’entreprise d’un point de vue libéral égalitaire ; elle
39Hypothèse qui serait étayée dans La justice comme équité par la suggestion de Rawls de limiter à quelques instruments de politique publique la réalisation du principe de différence, par exemple à l’impôt sur le revenu (Rawls 2003, p. 221 ; voir aussi Rawls 1995, p. 337), alors que la Théorie de la justice suggérait plutôt la prise en compte des exigences du principe de différence dans chaque acte législatif (Rawls 1987, p. 234). Sur ce point, voir également le commentaire de Freeman (2007, p. 232-234).
32
est, de fait, implicitement présente chez des auteurs qui étendent la réflexion rawlsienne à
l’entreprise. Toutefois, pour déterminer les dimensions de l’entreprise-institution soumises à
la justice égalitaire, il est nécessaire de préciser les contours de la structure de base.
Or, nous avons relevé dans la littérature des conceptions plus ou moins restrictives de la
structure de base, conduisant à des représentations constitutivistes de l’entreprise plus ou
moins étendues. Nous avons notamment identifié une approche de la structure de base en
termes légaux, pour laquelle les entreprises font partie de la structure de base parce qu’elles
sont structurées par des conventions légales à l’influence profonde sur la distribution des
biens premiers ; nous en avons identifié une deuxième, en termes fonctionnels, pour laquelle
les institutions de la structure de base sont uniquement celles qui sont nécessaires à une
coopération sociale productive. Ces approches ont en commun de proposer un constitutivisme
d’entreprise limité par leur indifférence aux pratiques émergentes qui ne seraient pas encore
identifiées en droit ou non fonctionnellement nécessaires à la société considérée. Cohen
propose par différence d’inclure dans la structure de base toutes les structures formelles et
informelles qui ont un effet profond sur la distribution des biens premiers. Mais en refusant de
réduire l’application de la justice à la structure ainsi définie, il disqualifie l’intérêt d’une
interrogation sur la place de l’entreprise dans la structure de base.
Nous avons argumenté pour une conception de la structure de base proche de celle de
Cohen, tout en maintenant une conception institutionnaliste de la justice sociale. Nous avons
proposé qu’une institution ou une pratique fait partie de la structure de base de la société si et
seulement si elle a un effet structurel sur la distribution des biens premiers, c’est-à-dire si et
seulement si, considérée indépendamment ou de façon agrégée avec des institutions ou
pratiques similaires, elle affecte, dans son fonctionnement avec les autres institutions de la
société, les perspectives de biens premiers d’au moins une position sociale représentative. La
structure de base de la société ainsi définie renvoie donc tant à la réalité des mécanismes
socio-économiques qui la constituent qu’aux lois qui les orientent. Elle se distingue des
critères définis en termes juridiques ou fonctionnalistes par sa plus grande sensibilité à
l’émergence de formes institutionnelles susceptibles d’avoir une influence sur la distribution
des biens premiers. Mais elle reste institutionnaliste au sens où elle affirme que la justice
s’applique à la structure de base de la société et non pas aux décisions individuelles,
ménageant ainsi un espace à des actions collectives dont les finalités ne se réduiraient pas
nécessairement aux objectifs de la justice sociale.
Articulée à une conception de l’entreprise comme institution, cette définition de la structure
de base débouche sur une représentation constitutiviste de l’entreprise plus étendue que les
33
approches évoquées précédemment. En pratique, la perspective proposée invite à entrer dans
l’entreprise pour identifier celles qui, de ses conventions et pratiques, caractérisées ou non en
droit, ont un effet direct ou systémique sur les perspectives de biens premiers d’une position
pertinente. Quant aux autres institutions et pratiques d’entreprise, celles-ci relèvent de
finalités privées. Cette approche suggère donc de distinguer, au sein de l’entreprise, entre des
dimensions constitutives de la structure de base et des dimensions qui relèvent des finalités de
l’organisation ou de ses membres. Elle positionne ainsi l’entreprise entre un pôle inclusiviste
pour lequel aucune dimension interne de l’entreprise ne relèverait de la justice sociale et un
pôle constitutiviste maximaliste qui affirmerait sans nuance que les entreprises sont
constitutives dans leur globalité de la structure de base. Dans cette perspective, on concevra
aisément qu’une petite entreprise ou qu’une décision isolée, sans influence sur les
perspectives de biens premiers d’une position pertinente, n’appartiennent pas comme telles à
la structure de base de la société. Mais une pratique particulière transversale aux petites
entreprises, celle d’une grande entreprise influente (e.g. monopole), une forme
organisationnelle partagée, une pratique émergente, une disposition du droit des sociétés ou
d’autres formes de régulation (soft law), si elles affectent une position sociale représentative,
relèvent de la structure de base et devront être régulées au bénéfice de la position sociale la
plus défavorisée.
34
Références
CHAUVIER, Stéphane. 2004. « Biens premiers et besoins fondamentaux ». Dans Rawls. Politique et métaphysique, éd. Catherine Audard, 63-94. Paris : Presses Universitaires de France. COHEN, Gerald A. 1997. « Where the Action is : On the Site of Distributive Justice ». Philosophy and Public Affairs, 26(1) : 3-30. COHEN, Gerald A. 2000. If You’re are an Egalitarian, How Come You’re So Rich? London, Cambridge (Mass.) : Harvard University Press. COHEN, Gerald A. 2008. Rescuing Justice and Equality. London, Cambridge (Mass.) : Harvard University Press. EYMARD-DUVERNAY, Francois. 2004. Economie politique de l’entreprise. Paris : Editions La Découverte. FAMA, Eugene F. 1980. « Agency Problems and the Theory of the Firm ». Journal of Political Economy, (88)2 : 288-307. FAMA, Eugene F. et Michael C. JENSEN. 1983. « Separation of Ownership and Control ». Journal of Law and Economics, 26(2) : 301-325. FAVEREAU, Olivier et Pierre PICARD. 1996. « L’approche économique des contrats : unité ou diversité ? ». Sociologie du travail, (38)4 : 441-464. FREEMAN, Samuel. 2007. Rawls. Milton Park, New York : Routledge. GUILLARME, Bertrand. 1999. Rawls et l’égalité démocratique. Paris : Presses Universitaires de France. HEATH, Joseph, MORIARTY, Jeffrey et Wayne NORMAN. 2010. « Business Ethics and (or as) Political Philosophy ». Business Ethics Quarterly, 20(3) : 427-452. HUSSAIN, Waheed. 2009. « The Most Stable Just Regime ». Journal of Social Philosophy, 40(3) : 412-433. NUSSBAUM, Martha C. 1990. « Aristotelian Social Democracy ». Dans Liberalism and the Good, éd. R. Bruce Douglass, Gerald M. Mara et Henry S. Richardson, 203-252. New York, London : Routledge. O’NEILL, Martin. 2008. « Three Rawlsian Routes towards Economic Democracy ». Revue de Philosophie économique, 9(1) : 29-55. O’NEILL, Martin. 2009. « Entreprises et conventionnalisme : régulation, impôt et justice sociale ». Raison publique, 10 : 171-200. O’NEILL, Martin et Thad WILLIAMSON (éds). 2012. Property-Owning Democracy : Rawls and Beyond. Malden (MA), Oxford : Wiley-Blackwell. OKIN, Susan Moller. 2008 [1989]. Justice, genre et famille, trad. Ludivine Thiaw-Po-Une. Paris : Flammarion. RAWLS, John. 1987 [1971]. Théorie de la justice, trad. Catherine Audard. Paris : Editions du Seuil. RAWLS, John. 1995 [1993]. Libéralisme politique, trad. Catherine Audard. Paris : Presses Universitaires de France. RAWLS, John. 2003 [2001]. La justice comme équité : une reformulation de théorie de la justice, trad. Bertrand Guillarme. Paris : Editions La Découverte. ROBÉ, Jean-Philippe. 2011. « The Legal Structure of the Firm ». Accounting, Economics and Law, 1(1) : Article 5. TAN, Kok-Chor. 2004. « Justice and Personal Pursuits ». The Journal of Philosophy, 101(7) : 331-362. TAYLOR, Robert S. 2004. « Self-Realization and the Priority of Fair Equality of Opportunity ». Journal of Moral Philosophy, 1(3): 333-347.
35
VAN PARIJS, Philippe. 2003. « Difference Principle ». Dans The Cambridge Companion to Rawls, éd. Samuel Freeman, 200-240. Cambridge : Cambridge University Press. WEINSTEIN, Olivier. 2008. « Quelques controverses théoriques. L’entreprise dans la théorie économique ». Cahiers Français, 345 : 91-96. WITZTUM, Amos. 2008. « Corporate Rules, Distributive Justice and Efficiency ». Business Ethics Quarterly, 18(1) : 85-116.