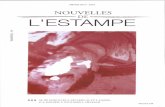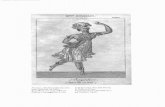Théâtre / Musique / Humour / Danse / Rencontres / Découvertes
La danse de la prophétesse Miryam (Exode 15, 20-21)
Transcript of La danse de la prophétesse Miryam (Exode 15, 20-21)
Présence de la danse dans l’Antiquité – Présence de l’Antiquité dans la danse,
Caesarodunum, XLII-XLIII bis, Clermont-Ferrand, 2013, ISBN : 978-2-900479-17-9
15
LA DANSE DE LA PROPHÉTESSE MIRYAM (Exode 15, 20-21)
par Josselin ROUX (LUNAM Université,
Université Catholique de l’Ouest, UMR 8167) La sortie d’Égypte des fils d’Israël à la suite de Moïse demeure un
épisode célèbre de la littérature biblique. Au cœur du livre de l’Exode, le double miracle de l’ouverture de la mer Rouge (appelée la « mer des Roseaux » dans le texte lui-même) et de l’engloutissement des armées égyptiennes reste facilement dans les mémoires. En particulier, sa représentation grandiose dans le péplum de Cecil B. De Mille « Les dix commandements » (1956) a marqué les imaginations.
14, 27 Moïse étend sa main sur la mer la mer s’en retourne dès l’aube à son emplacement tandis que fuyaient à son approche les Égyptiens YHWH1 bouscule les Égyptiens au milieu de la mer
La danse de la prophétesse Miryam et de toutes les femmes à sa suite
est par contre assez peu connue, alors même que les versets qui décrivent leur action (Ex. 15, 20-21) viennent justement clore l’ensemble de ce récit de la sortie d’Égypte (1, 1-15, 21)2. Il est vrai qu’à la lecture, cette danse peut facilement passer inaperçue. Premièrement, sa description se résume à deux versets seulement : Ex. 15, 20-21. Deuxièmement, cette danse semble a priori assez secondaire au regard de l’ordre d’exposition des épisodes et de leur degré d’importance. La narration de la danse de Miryam succède non seulement au récit de la traversée miraculeuse de la mer des Roseaux (Ex. 13, 21-14, 31), mais elle s’inscrit également dans le prolongement d’un long psaume de reconnaissance chanté en l’honneur de YHWH par Moïse et tous les fils d’Israël à sa suite (Ex. 15, 1-18). De ce point de vue, la danse des femmes semble assez redondante. Chanté par Miryam, le refrain qui accompagne leur danse (« Magnifié qu’il est magnifié || le cheval et son cavalier | il les a jetés dans la mer » 15, 21b) était déjà inclus dans le psaume (15, 1 // 15, 21b). Enfin, il semble que la version grecque de la Septante ait durablement influencé la lecture, les traductions et les interprétations de ces deux versets de la danse de
Josselin Roux
16
Miryam. Le mot hébreu meHölöT qui désigne cette danse a été traduit par
le grec corov". Ce corov" est lui-même le plus souvent identifié avec un « chœur de danse »3, ou encore plus précisément, avec une « danse dans une ronde »4. La traduction de la Bible de Jérusalem va par exemple dans ce sens : « Miryam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins, formant des chœurs de danse »5 (15, 20). Autrement dit, après la traversée de la mer des Roseaux et après le cantique chanté par les fils d’Israël, entre elles, les femmes semblent prolonger les festivités de la libération du peuple dans une danse collective. Leur danse demeure dès lors assez anecdotique et pour le moins redondante.
Cependant, si l’attention de la recherche se porte non plus sur la Septante, mais bien sur le texte hébreu lui-même, en l’occurrence le Texte Massorétique6, alors la danse des femmes à la suite de Miryam prend un tout autre aspect et offre un nouvel éclairage sur l’ensemble du récit de la sortie d’Égypte.
I- La performance de la victoire
Dans le Texte Massorétique, le substantif meHölöT semble toujours
renvoyer à une danse des femmes7. En Ex. 15, 20, ce substantif s’inscrit dans une formule idiomatique qui sert à désigner les performances musicales et gestuelles8. Le verbe indique l’action principale de la performance, en l’occurrence il s’agit ici du verbe yäcä’ « sortir », et une succession de compléments, introduits par la préposition « b », précisent les modalités de sa mise en œuvre : 15, 20 Miryam la prophétesse sœur d’Aaron prend le tambour9 dans sa main Toutes les femmes sortent [yäcä’] à sa suite au son du tambour et avec les mouvements de la danse [me
HölöT] Par ailleurs, cette expression yäcä’ B
eTuPPîm
ûBimHölöT « sortir au son
du tambour et avec les mouvements de la danse [meHölöT] » est répétée
quasiment à l’identique en Juges 11, 34 et en 1 Samuel 18, 610. Cette formule stéréotypée est précisément l’expression clé d’une scène type11, celle de la « performance de la victoire » dont l’argument peut être résumé ainsi : un guerrier et ses troupes victorieuses sont accueillis par un groupe de femmes qui sort à leur rencontre en jouant du tambour et avec les mouvements de la danse me
HölöT (Jg. 11, 29-40 // 1 S. 18, 6-7). En Jg. 11 (v. 29-40), tandis que Jephté revient victorieux de la guerre contre les Ammonites, sa fille sort de sa maison à sa rencontre en pratiquant la danse m
eHölöT. De même, en 1 S. 18 (v. 6-7), à leur retour après la
La danse de la prophétesse Miryam
17
victoire contre Goliath (le géant des Philistins), le roi Saül et David sont accueillis par les femmes qui sortent « de toutes les villes d’Israël ».
De prime abord, la danse de Miryam semble n’avoir aucun rapport avec ces retrouvailles festives entre femmes et guerriers victorieux. Cependant, à plusieurs reprises, alors qu’ils partent de l’Égypte, les « fils d’Israël » ont été décrits comme des guerriers : « rangés en ordre de bataille » (13, 18), ils constituent les « armées » [ce
BäôT] de YHWH (cf. 6, 26 ; 7, 4 ; 12, 17.41.51). Par ailleurs, dans ces chapitres 14 et 15, l’ordre de la narration diffère de la chronologie des événements racontés. Le psaume chanté par les fils d’Israël intervient juste après l’engloutissement de Pharaon et de ses armées comme l’indiquent les versets 14, 28-29 qui font office d’en-tête : 14, 28 Les eaux se tournent et recouvrent les chars et les cavaliers pour toute la force armée de Pharaon qui venait à leur suite dans la mer Il n’y avait pas de survivants parmi eux pas un seul
29 Mais les fils d’Israël ont marché sur la terre ferme au milieu de la mer Mais pour eux les eaux étaient un rempart à leur droite et à leur gauche
Or, cet en-tête se retrouve quasiment à l’identique un peu plus loin
dans le récit, après le psaume, en Ex. 15,19, où il sert cette fois-ci à introduire l’action de Miryam. 15, 19 Tandis que le cheval de Pharaon était arrivé avec son char et ses [cavaliers dans la mer YHWH fait que se retournent contre eux les eaux de la mer Mais les fils d’Israël ont marché sur la terre ferme au milieu de la mer
Le narrateur use ici de l’analepse. Dans l’histoire racontée, la danse de
Miryam a précisément lieu, comme le psaume, juste après l’engloutissement de Pharaon et de ses armées.
A. Engloutissement de Pharaon, mais les fils d’Israël ont pu traverser (14, 28-29)
B. Constat : YHWH a sauvé Israël, et le « peuple » croit en lui (14, 30-31)
C. Performance des fils d’Israël (15, 1-18) A’. Engloutissement de Pharaon, mais les fils d’Israël ont pu traverser (15, 19)
C’. Performance des femmes (15, 20-21)
Josselin Roux
18
Autrement dit, la performance musicale et chorégraphique des femmes est parfaitement synchronisée avec le psaume chanté par Moïse et les fils d’Israël. Nous retrouvons donc, avec son expression clé, les éléments caractéristiques de la « scène type de la performance de la victoire » : tandis que les fils d’Israël, les « armées » de YHWH, viennent de traverser victorieux la mer des Roseaux, toutes les femmes à la suite de Miryam sortent pour les accueillir au son du tambour et avec les mouvements de la danse me
HölöT. Au cœur de cette performance de la victoire, les hiérarchies se
trouvent dès lors bouleversées. Le refrain de Miryam qui semblait redondant devient au contraire le signe manifeste de son autorité de « prophétesse ». En effet, une fois que le lecteur a pris en compte la synchronie entre le chant des hommes et la danse des femmes, il est en mesure de découvrir que le psaume qui est traditionnellement appelé le « cantique de Moïse » est plus exactement le « cantique de Miryam ». C’est elle qui fait office de psalmiste en sollicitant le chant des fils d’Israël : 15, 21 Pour eux Miryam entonne : « Chantez pour YHWH : “Magnifié qu’il est magnifié le cheval et son cavalier il les a jetés dans la mer” »
À cette invitation de la prophétesse, Moïse, ainsi que chaque fils
d’Israël à sa suite, répond :
15, 1b « Je chante pour YHWH : “Magnifié qu’il est magnifié le cheval et son cavalier il les a jetés dans la mer” .../...»
De l’autre côté de la mer des Roseaux, Miryam se révèle être la
meneuse de l’ensemble de la performance musicale et chorégraphique de la victoire. Bien plus, au regard de l’historiographie biblique, Miryam est l’initiatrice du tout premier psaume et de la toute première danse accomplis par Israël pour YHWH son Dieu.
II- Une danse de « travail » L’examen des variantes de la scène type de la « performance de la
victoire » permet d’en connaître un peu plus sur la nature de cette danse des femmes. En effet, dans le cas de Jg. 11 (v. 29-40), la danse me
HölöT se présente comme une activité individuelle : la fille de Jephté est seule à sortir de la maison en accomplissant cette danse pour accueillir son père victorieux.
La danse de la prophétesse Miryam
19
Avant de partir au combat contre les fils d’Ammon, Jephté prend une initiative qui s’avérera malheureuse : 11, 30 Jephté fait cette promesse pour YHWH il dit : « Si vraiment tu remets les fils d’Ammon entre mes mains 31 Il sera celui qui sortira sortant par les portes de ma maison à ma rencontre lorsque je reviendrai en paix de chez les fils d’Ammon Il sera pour YHWH je le ferai monter en holocauste »
À son retour, la performance de la victoire prend une tournure
tragique : 11, 34 Jephté arrive à Miçpé vers sa maison voici sa fille qui sort à sa rencontre au son du tambour et avec les mouvements de la danse [me
HölöT] Et seulement elle l’unique il n’a à cause de lui ni fils ni fille12
La narration s’emploie à construire la rencontre entre Jephté et sa fille
comme un face à face, excluant la participation de toute autre personne. Au regard de l’intrigue, il importe que la fille de Jephté soit la victime désignée, sans équivoque possible. Ce qui suggère qu’elle est non seulement seule à sortir, mais aussi seule à jouer du tambour en accomplissant les mouvements de la danse me
HölöT. La figure qui semble ici s’imposer est celle d’une danseuse qui avance – puisqu’elle sort – tout en jouant du tambour portatif TöP.
La prise en compte du caractère individuel des mouvements de cette danse renforce l’hypothèse selon laquelle le substantif me
HölöT serait un dérivé du verbe Hûl. Ce verbe signifie de manière technique « être dans l’agitation de l’enfantement »13. Or, en accord avec les conclusions sociohistoriques concernant l’enfantement dans le Proche-Orient ancien, les textes de la Bible hébraïque témoignent d’une parturition accomplie en position verticale (la parturiente étant accroupie, semi-assise ou même debout)14. C’est d’ailleurs pourquoi, à deux reprises dans le texte biblique, l’agitation de l’enfantement Hûl peut s’inscrire comme motif chorégraphique dans une performance festive. En Michée 4, le prophète voit dans la parturition de la fille-Sion avec ses piétinements inévitables, la préfiguration d’un foulage festif par lequel elle détruira ses ennemis. À l’invitation « Sois dans l’agitation du travail et répands-toi [Hûlî wäGöHî] | fille-Sion comme la femme qui enfante ! » (4, 10), succède une autre sollicitation, elle aussi construite sur le modèle des appels à une
Josselin Roux
20
performance musicale et gestuelle15 : « Lève-toi et piétine [qûmi wäDôšî] fille-Sion || car ta corne je la ferai en fer | et tes sabots | je les ferai de bronze || tu vas broyer de nombreux peuples » (4, 13).
Dans le Psaume 114, la sortie d’Israël hors d’Égypte (cf. Ps. 114, 1) est présentée comme s’il s’agissait d’un enfantement accompli par la terre : Ps. 114, 1 Quand Israël est sorti loin de l’Égypte La maison de Jacob loin d’un peuple incompréhensible 2 Juda est vraiment devenu son sanctifié Israël ses domaines 3 La mer a vu alors elle déguerpit Le Jourdain se détourne 4 Les montagnes cavalent comme des béliers Les collines comme les fils du troupeau 5 Qu’as-tu la mer tu déguerpis Jourdain tu te détournes 6 Les montagnes vous cavalez comme des béliers Les collines comme les fils du troupeau
7 En face du Seigneur terre sois dans l’agitation de l’enfantement [Hûl] En face du Dieu de Jacob 8 « Lui qui me change de ce rocher en un bassin des eaux D’une pierre en son jaillissement des eaux »16
L’invitation « En face du Seigneur | terre sois dans l’agitation de
l’enfantement » s’adresse à la fois à la terre personnifiée, mais également, par métonymie, à tout auditeur du psaume susceptible de s’impliquer gestuellement dans la célébration en l’honneur de YHWH.
La proximité à la fois morphologique et sémantique entre le verbe Hûl « être dans l’agitation de l’enfantement » et le substantif me
HölöT suggère que cette danse des femmes est précisément une danse de « travail » dans
La danse de la prophétesse Miryam
21
le sens le plus littéral et le plus féminin du terme. Dans le Ps. 114, la sortie d’Égypte est assimilée à une naissance : le peuple d’Israël est le fruit d’une danse-parturition (Hûl) de la terre. De manière similaire, dans le livre de l’Exode, la bénédiction liée à l’enfantement est un élément essentiel de l’intrigue du récit. En effet, la sortie des Hébreux hors d’Égypte était légitimée par l’oppression qu’ils subissaient de la part de Pharaon. Leur détresse atteignait son paroxysme avec la mise à mort de leurs enfants mâles par les Égyptiens, et cela dès la naissance (cf. Ex. 1, 22). En Égypte, les fils mouraient dès leur traversée des eaux, et les femmes subissaient les douleurs de l’enfantement sans connaître la bénédiction de recevoir un fils nouveau-né. De l’autre côté de la mer des Roseaux, le retournement de situation est complet. Chacun est sauvé par YHWH selon son genre, à la mesure de sa détresse en Égypte. D’une part, dans une nouvelle naissance, au terme de leur traversée des eaux, les fils d’Israël ne sont plus menacés : l’Égypte est « morte sur le rivage de la mer » (Ex. 14, 30). D’autre part, à la faveur d’une parturition non douloureuse, à savoir la danse m
eHölöT, les femmes peuvent à présent
accueillir une multitude de fils. III- La voie de la danse
Inscrite dans la performance de la victoire, la danse de l’enfantement fonctionne à la manière d’une clé : elle permet une relecture inattendue de l’ensemble du récit de la sortie d’Égypte. En effet, dans cette performance de la victoire, « toutes les femmes » [Kol-hannäšîm 15, 20] sont placées en vis-à-vis du groupe des « fils d’Israël » [Be
nê yiSrä’ël 15, 1]. Ainsi donc, dans toute cette séquence (Ex. 14, 28-15, 21), l’expression « fils d’Israël » désigne précisément les hommes [’ánäšîm] d’Israël17. De même, dès le tout premier verset du livre de l’Exode, le titre « fils d’Israël » désignait exclusivement les hommes d’Israël, en l’occurrence les fils de Jacob. Ex. 1, 1 Voici les noms des fils d’Israël arrivés en Égypte Avec Jacob chaque homme [’iš] ainsi que sa maison ils sont arrivés 2 Ruben Siméon Lévi et Juda 3 Issakar Zabulon et Benjamin 4 Dan et Neftali Gad et Asher
Josselin Roux
22
Dès lors, il n’y a pas lieu de supposer que l’expression « fils d’Israël » désigne autre chose que les hommes d’Israël dans l’ensemble du récit de la sortie d’Égypte. Or, aussi étonnant que cela puisse paraître, aucun verset ne dit explicitement que les « femmes » [näšîm] sont au départ de l’Égypte avec ces « fils d’Israël », les hommes donc, à la suite de Moïse.
YHWH s’est manifesté à Moïse à travers le buisson ardent et lui a
confié sa mission (3, 10). Comme en témoigne sa réponse, Moïse a compris qu’il doit faire sortir « les fils d’Israël », les hommes donc (3, 11). 3, 11 Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je moi que j’aille vers Pharaon ? Et que je fasse sortir les fils d’Israël hors d’Égypte ? »
Un peu plus loin dans le récit, YHWH lui-même demande à Aaron et
à Moïse : « faites sortir les fils d’Israël selon leurs armées » [`al-
ciB´öTäm] (6, 26). Dans les diverses rencontres entre Moïse et YHWH, s’il est question des « femmes » [näšîm], c’est seulement pour les associer aux préparatifs du départ : 3, 22 Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui réside dans [sa maison des objets d’argent des objets d’or et des vêtements Vous les mettrez sur vos fils et sur vos filles vous en libérerez l’Égypte18
Ici comme dans tout le récit de la sortie d’Égypte, quand ils sont
associés dans une même expression, « fils » [Bänîm] et « filles » [BänôT] désignent précisément les enfants et les jeunes gens qui ne sont pas encore des « hommes » [’ánäšîm] et des « femmes » [näšîm]19. Curieusement, le butin pris aux Égyptiennes ne revient pas aux femmes comme le lecteur pourrait s’y attendre, mais parures et vêtements féminins sont mis sur les enfants, aussi bien sur les garçons que sur les filles.
Le départ des femmes n’est pas non plus envisagé lors des pourparlers de Moïse et Aaron avec Pharaon. Effrayés par le fléau des criquets, les serviteurs de Pharaon lui demandent de laisser partir « ces hommes » [hä`ánäšîm 10,7]. La précision de leur requête sème le doute chez Pharaon : « Qui mais qui sont ceux qui partent ? » (10, 8).
La danse de la prophétesse Miryam
23
10, 9 Moïse répond : « Avec nos garçons et nos anciens nous partons Avec nos fils et nos filles avec le petit et le gros bétail nous partons car c’est pour nous une fête de YHWH »
Cette énumération de ceux qui partent donne l’impression que tous
sont au départ avec les fils d’Israël. Or, il n’en est rien. Tous les hommes, tous les enfants (« fils » et « filles ») et tous les troupeaux suivront, mais il manque les « femmes » [näšîm] ! Les groupes qui sont censés partir avec Moïse sont associés dans des couples construits selon des principes logiques. Ils appartiennent à un même ensemble, mais un trait caractéristique les oppose. Les bêtes des troupeaux sont rassemblées, mais elles se distinguent selon leur type en « petit bétail » [cö`n] et « gros bétail » [Bäqär]. Les enfants sont réunis, mais ils sont distingués selon leur sexe : les « fils » [Bänîm] et les « filles » [BänôT]. Les personnes de sexe masculin qui ne sont pas en mesure de combattre sont différenciées selon leur âge : les « garçons » [ne
`ärîm ; trop jeunes pour combattre], les « anciens » [ze
qënîm ; trop vieux pour se battre]. Mais avec qui les « hommes » [’ánäšîm] qui sont en âge de combattre, à savoir les « fils d’Israël », sont-ils associés ? Dans cette énumération qui prétend à l’exhaustivité (10, 9), il manque un autre couple évident et pourtant le lecteur ne perçoit pas d’emblée son absence. Les « hommes » [’ánäšîm] sont privés de leur vis-à-vis logique, à savoir les « femmes » [näšîm]20.
les « garçons » [ne
`ärîm] partent les « anciens » [zeqënîm] (des fils
d’Israël) partent les « fils » [Bänîm] partent les « filles » [BänôT] partent le « petit bétail » [cö`n] part le « gros bétail » [Bäqär] part les « hommes » [’ánäšîm] partent
(cf. 10, 7 ; « nous partons » 10, 9) (et les « femmes » [näšîm] ?)
Pharaon lui-même ratifie cette absence des femmes au départ avec
Moïse : il a bien compris que les hommes veulent partir avec les « enfants » [†aP ; 10, 10]21 :
10, 10 Il [= Pharaon] leur dit : « Que YHWH soit donc avec vous si jamais je vous envoie vous et vos enfants Voyez comme sont mauvaises vos intentions »
Il n’est pas question du départ des femmes. Si on s’en tient aux mots
de cet échange entre Moïse et Pharaon, la réponse à la question de
Josselin Roux
24
Pharaon « Qui mais qui sont ceux qui partent ? » (10, 8) est tout à fait claire : ceux qui sont censés partir d’Égypte avec Moïse sont les « fils d’Israël » (hommes en âge de combattre et anciens), leurs « enfants » [†aP] et leurs troupeaux (10, 9).
Dans la suite du récit (10, 9 sq.), cette composition du groupe qui doit partir d’Égypte avec Moïse (les fils d’Israël, les enfants, les troupeaux) ne sera pas remise en cause. Elle ne cessera au contraire d’être confirmée. Pharaon refuse d’abord de laisser partir les fils d’Israël s’ils sont accompagnés de leurs « enfants » [†aP] et de leurs troupeaux (10, 10-11). Face à un nouveau fléau (les « ténèbres » 10, 21-26), Pharaon est finalement prêt à faire une concession concernant le départ des « enfants » (cf. 10, 24). Dès lors, les pourparlers se concentrent sur le départ des troupeaux (10, 24 sq.). Mais le départ des « femmes » n’est même pas envisagé…
Après la mort des premiers-nés de l’Égypte, Pharaon ordonne à Moïse et Aaron de partir « avec les fils d’Israël » (12, 31). Conformément à ce qui était prévu, ceux-ci partent avec les « enfants » : 12, 37 Les fils d’Israël se mettent en route de Ramsès vers Soukhot Environ six cent mille guerriers qui vont à pied sans compter les enfants
Il n’y a pas lieu de compter les femmes, ni même de dire qu’elles ne
sont pas comptées, si, tout simplement, elles ne sont pas de ce départ. Les traductions de ce verset 12, 37 sont particulièrement intéressantes à examiner. En effet, de nombreux traducteurs glosent : d’une manière ou d’une autre, ils prennent en compte les « femmes » alors que le mot hébreu [näšîm] qui les désigne est absent de ce verset. C’est par exemple le cas pour la traduction de la Bible Jérusalem : « Les Israélites [Be
nê
yiSrä’ël ; les « fils d’Israël »] partirent de Ramsès en direction de Sukkot au nombre de près de six cent mille hommes de pied – rien que les hommes, sans compter leur famille » 22. Or, c’est encore le mot †aP qui est utilisé ici, lequel désigne de manière technique les enfants et les jeunes gens, filles et garçons qui ne sont pas en âge de se marier, qui ne sont justement pas encore des « hommes » [’ánäšîm] et des « femmes » [näšîm].
En plus des enfants, conformément à ce que Moïse et Aaron avaient demandé, les hommes partent avec le petit et le gros bétail (12, 31-32// 12, 38) : 12, 38 Et aussi un grand groupe disparate [`ëreB] est monté avec eux Et le petit et le gros bétail un troupeau très imposant
La danse de la prophétesse Miryam
25
Le mot `ëreB désigne de manière assez imprécise « un groupe disparate »23. En partant de cette signification, de nombreux commentateurs considèrent que ce « groupe disparate » renvoie à des personnes étrangères qui accompagnent les fils d’Israël aux côtés des « enfants » et des troupeaux24. Cependant, à aucun moment, le départ d’un groupe étranger aux côtés des fils d’Israël n’a été annoncé ni par YHWH, ni lors des pourparlers de Moïse avec Pharaon. Dans ce contexte (12, 38), le « grand groupe disparate » [`ëreB raB] renvoie plutôt à la multitude des troupeaux « mélangés » les uns avec les autres (cf. « le petit et le gros bétail ») comme l’indique le parallélisme des hémistiches du verset : « un grand groupe disparate » (12, 38a) // « un troupeau très imposant » (12, 38b). Le verset 12, 38 est l’exposition du départ des troupeaux annoncé lors des rencontres avec Pharaon (10, 9 ; 10, 24 sq. ; en particulier 12, 32). La formule évasive « un grand groupe disparate » fait partie du « tour d’illusionniste » que propose le narrateur. Elle donne l’impression que le compte y est, alors que « toutes les femmes » (cf. 15, 20), ni plus ni moins, manquent25.
Successivement dans ces versets 12, 37-38, le départ de chacun est exposé. Le départ des « fils d’Israël » est explicitement raconté (12, 37a), puis celui des « enfants », mais sous le mode de la prétérition (cf. « sans compter les enfants » 12, 37b), et enfin, le départ des troupeaux est lui aussi exposé (12, 38), mais cette fois-ci, dans le registre hyperbolique. En revanche, il n’y a pas de verset pour exposer ce qui serait le départ des femmes à la suite de Moïse. Le récit est au contraire toujours plus clair sur l’identité de ceux qui partent : 12, 50 Tous les fils d’Israël agissent Conformément à ce que YHWH a commandé à Moïse et Aaron [ainsi ils ont agi 12, 51 Alors précisément en ce jour-là YHWH a fait sortir les fils d’Israël du pays d’Égypte selon [leurs armées
Comme convenu, ce sont les fils d’Israël, les hommes donc, avec leurs
enfants (filles et garçons) et leurs troupeaux, qui sortent d’Égypte à la suite de Moïse. Par contraste avec ces versets relatifs au départ de Ramsès à la suite de Moïse (Ex. 10, 9 ; 12, 37-38.51), les « femmes » [näšîm] n’étaient évidemment pas oubliées dans l’énumération de ceux qui arrivaient en Égypte avec Jacob (Gn. 45, 19 // Gn. 46, 5) :
Josselin Roux
26
Gn 46, 5 Jacob se lève de Béer-Shéva Les fils d’Israël amènent leur père Jacob leurs enfants [†aP] et leurs femmes [näšîm] sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour l’amener
Rétrospectivement, le lecteur peut être enclin à penser qu’il faut
inclure les femmes dans le « peuple » [`am] Israël mentionné en Ex. 14, 30-31 :
30 YHWH a sauvé en ce jour-là Israël de la main de l’Égypte Israël a vu l’Égypte morte sur le rivage de la mer 31 Israël a vu avec quelle main puissante YHWH avait agi contre l’Égypte le peuple a eu de la crainte envers YHWH Ils ont eu foi en YHWH et en Moïse son serviteur
L’observation vient au contraire conforter notre hypothèse de lecture
sur l’absence des femmes dans le groupe qui sort d’Égypte à la suite de Moïse. En effet, dès le début du récit, le narrateur a laissé entendre que le « peuple » se limitait aux seuls fils d’Israël. Devant l’accroissement du nombre des « fils d’Israël » dans le pays d’Égypte (Ex. 1, 7), Pharaon s’inquiète de ce que « le peuple | les fils d’Israël » [`am B
enê yiSrä’ël]
soit devenu si nombreux (1, 9). Cette expression « le peuple | les fils d’Israël » employée par Pharaon s’avère être suffisamment ambiguë pour orienter la lecture dans deux sens diamétralement opposés. Est-il question du « peuple dont les fils d’Israël »26, ou du « peuple des fils d’Israël »27 ? Dans ce dernier cas, le « peuple » [`am] désignerait les seuls hommes (le « peuple des fils d’Israël » = « le peuple des hommes d’Israël »). Une réponse est esquissée au verset suivant (1, 10). Pour Pharaon, « le peuple | les fils d’Israël » est, du moins potentiellement, un groupe de guerriers ennemis. Dans le même temps, c’est son propre « peuple » [`am] (1, 9) dont il projette l’existence en tant que groupe de guerriers. Son « nous » est en effet celui d’un chef qui s’adresse à ses troupes (cf. Ex. 1, 10). Face à la menace guerrière qu’il se représente, Pharaon prend donc logiquement des mesures contre les « fils d’Israël », hommes et guerriers potentiels, en les soumettant aux corvées (1, 12-14). Dans ce contexte, le narrateur semble lui-même ratifier ce point de vue de Pharaon : « Israël » est identifié au groupe des « fils d’Israël » soumis aux corvées (cf. 1, 11 // 1, 13-14). Qui plus est, YHWH utilise la même formule ambiguë que Pharaon. YHWH demande à Moïse : « fais sortir | mon peuple les fils d’Israël hors d’Égypte » (3, 10 // 1, 9). Utilise-t-il cette formule (« mon
La danse de la prophétesse Miryam
27
peuple les fils d’Israël ») dans le même sens que Pharaon ? Son « peuple » serait alors le « peuple des fils d’Israël »… La réponse de Moïse à cet envoi en mission suggère que c’est effectivement le cas : il a compris qu’il doit faire sortir « les fils d’Israël » (3, 11). Autrement dit, Pharaon et YHWH vont s’affronter chacun avec son « peuple » de guerriers, « l’Égypte » faisant face à « Israël ». Au terme de la traversée de la mer des Roseaux (14, 30-31), à l’issue du combat, de même que « l’Égypte » morte sur le rivage (14, 30) désigne uniquement les guerriers de Pharaon, le peuple « Israël » qui leur fait face regroupe alors, précisément, les braves qui forment les « armées » de YHWH.
Au regard des thèmes et enjeux de la narration, la présence des femmes aux côtés de Moïse et des fils d’Israël lors de leur sortie d’Égypte n’est pas requise, bien au contraire. Premièrement, les fils d’Israël en marche à la suite de Moïse forment les armées de YHWH. Si les enfants, « filles » et « fils », accompagnent les hommes, c’est qu’ils font office de pages portant le butin pris à l’Égypte (cf. 3, 21-22 // 11, 2-3 // 12, 35-36). Les femmes n’ont, quant à elles, pas plus à participer à cette campagne guerrière qu’à une autre. Leur présence est en revanche requise à la fin, pour la mise en œuvre de la performance de la victoire : quand elles accueillent en femmes et en mères les guerriers victorieux. Deuxièmement, devant Pharaon, Moïse légitime son départ avec les fils d’Israël par un sacrifice qui doit avoir lieu après trois jours de marche dans le désert (3, 18 // 5, 3 // 8, 23). Dès lors, les troupeaux doivent partir avec eux, car Moïse pense que c’est parmi le bétail que seront prélevées les victimes. Mais de ce point de vue également, le départ des femmes aux côtés des fils d’Israël ne se justifie pas. Ce sacrifice pour YHWH doit normalement rester une affaire d’hommes comme l’indiquent les propos de Pharaon : « partez donc vous les guerriers [haGG
eBärîm] | et servez
YHWH || car c’est cela que vous cherchez » (10, 11). Troisièmement, le salut de YHWH se présente comme une nouvelle naissance avons-nous dit. Chacun est délivré à la mesure de sa détresse en Égypte : de l’autre côté de la mer des Roseaux les fils ne risquent plus d’être mis à mort par les Égyptiens, et les femmes n’entrent plus dans l’agitation de l’enfantement pour rien. Or, lors d’une naissance, mères et fils ne passent évidemment pas par la même voie.
Deux parcours de lecture de ce récit de la sortie d’Égypte s’avèrent donc possibles. Soit le lecteur suppose que même si elles ne sont pas expressément mentionnées, les femmes sont malgré tout aux côtés des fils d’Israël lorsqu’ils partent de l’Égypte à la suite de Moïse. Ou bien le lecteur se refuse à de telles suppositions, et dès lors, lus au plus près, en rigueur de termes, mot pour mot, les deux versets de la danse de Miryam constituent le récit explicite de la sortie des femmes :
Josselin Roux
28
15, 20 Miryam la prophétesse sœur d’Aaron prend le tambour dans sa main Toutes les femmes sortent à sa suite au son du tambour et avec les mouvements de la danse de l’enfantement 21 Pour eux Miryam entonne :
« Chantez pour YHWH : “Magnifié qu’il est magnifié le cheval et son cavalier il les a jetés dans la mer” »
Ainsi, les fils d’Israël accompagnés des troupeaux et des enfants sont
partis en marchant à la suite de Moïse, mais les femmes sont sorties à la suite de la prophétesse Miryam dans la danse. Contrairement à ce que le narrateur avait jusqu’ici laissé entendre, les femmes ne sont donc pas exclues du peuple appelé à être libéré d’Égypte pour célébrer la « fête de YHWH » (cf. 10, 9). Avec Miryam, elles sont tout simplement sorties autrement, dans la danse.
Ce deuxième parcours de lecture a le considérable avantage de rejoindre le témoignage du livre de Michée concernant le rôle de Miryam. En effet, par la voix du prophète Michée, YHWH lui-même déclare : Mi. 6, 3 Mon peuple que t’ai-je fait est-ce que je t’ai épuisé ? Réponds-moi 4 Quand je t’ai fait monter hors du pays d’Égypte loin de la maison des servitudes je t’ai délivré J’ai envoyé devant toi Moïse Aaron et Miryam
Le récit de la sortie des fils d’Israël hors d’Égypte à la suite de Moïse
a un versant féminin que peut révéler la danse de la prophétesse Miryam. Dans cette perspective de lecture, le récit de la sortie d’Égypte ne saurait être réduit à un récit historiographique qui évoquerait de manière anecdotique une danse des femmes. Mais lu depuis sa fin, par bien des aspects, ce récit s’apparente plutôt à une instruction théologique et mystique (une « torah ») sous forme d’historiographie. Et dans cette instruction, la danse pour YHWH occupe une place centrale. Le récit désigne en effet la danse de l’enfantement accomplie pour YHWH comme une voie possible de sortie, de libération, loin des détresses et des servitudes caractéristiques de l’Égypte de Pharaon.
La danse de la prophétesse Miryam
29
NOTES
1 Translittération du tétragramme, le nom divin à quatre lettres qu’Israël s’interdit de prononcer. 2 Au verset suivant (15, 22), le cheminement du peuple dans le désert commence : « Moïse fait partir Israël | de la mer des Roseaux || ils sortent vers le désert de Shour ». 3 Cf. « a chorus, a choir » (II) The Abridged Liddell-Scott Greek-English Lexicon, éd. Simon Wallenberg Press, 2007 ; « chœur », « chœur de danse » Anatole BAILLY, Abrégé du dictionnaire grec-français, Paris, éd. Hachette, 1901. La Bible d’Alexandrie (traduction française de la Septante) traduit corov~ par « danse » en Ex. 15, 20 et 32, 19, mais par « chœur » ou « chœur de danse » dans les autres cas (Jg. 11, 34 ; 21, 21 ; 1 S. 29, 5) cf. La Bible d’Alexandrie, Paris, éd. Cerf, 1986-2009. 4 Cf. « round dance » (I) The Abridged Liddell-Scott Greek-English Lexicon. L’hypothèse selon laquelle me
HölöT désigne spécifiquement une danse dans une ronde sur le modèle du corov~ semble a priori rejoindre les conclusions étymologiques. En effet, de nombreux philologues et exégètes ont estimé que le substantif me
HölöT dériverait du verbe Hûl, et que ce dernier renverrait en son sens premier à l’action de « tourner ». Dans cette perspective, m
eHölöT désignerait soit une danse « tournoyante » (« perform a whirling
dance » Mayer I. GRUBER, « Ten Dance-derived expressions in the Hebrew Bible », The motherhood of God and other studies, coll. South Florida Studies in the History of Judaism n° 57, Atlanta, éd. Scholars Press, 1992, p. 167), soit une « danse en rond »/ une « ronde » (« a round-dance » Victor H. MATTHEWS, « Music in the Bible », dans David Noel FREEDMAN, The Anchor Bible Dictionary, New York, Doubleday, 1997 ; John H. EATON, « Dancing in the Old Testament », Expository Times, vol. 86, 1975, p. 136 ; « Reigentanz » Heinz Joseph FABRY, « Der Tanz im alttestamentlichen Judentum », Choreae, Zeitschrift für Tanz, Bewegung und Leiblichkeit in Liturgie und Spiritualität, n° 3, 1996, Choros-Verl, p. 38). Cependant, si les analyses contextuelles effectuées dans la Bible hébraïque semblent corroborer l’hypothèse d’une dérivation de me
HölöT à partir du verbe Hûl, elles viennent contredire les conclusions concernant le sens à donner à ce même verbe (c.-à-d. « tourner »). Voir infra. 5 La Bible de Jérusalem, Paris, éd. Cerf, 1981. 6 Karl ELLIGER, Wilhelm RUDOLPH éd., Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart, éd. Deutsche Bibelgesellschaft, 1983. 7 Les personnages qui la mettent en œuvre sont « toutes les femmes » (Ex. 15, 20), la « fille de Jephté » (Jg. 11, 34), « les filles de Silo » (Jg. 21, 21), « les femmes de toutes les villes d’Israël » (1 S. 18, 6 ; 21, 12 ; 29, 5). En revanche en Ex. 32, 19, les acteurs ne sont pas désignés de manière explicite : « [Moïse] voit le veau et les danses ». 8 Pour les détails concernant ces formules de performance, voir Josselin ROUX, La danse de Miryam, une approche littéraire et anthropologique d’Exode 1-15,21, Thèse de doctorat, Université Marc Bloch (Strasbourg II), janvier 2007 (à paraître aux éditions du Cerf), p. 152-161. 9 Le mot TöP désigne un tambour portatif qui de manière privilégiée est joué par les femmes. Comme l’atteste l’iconographie, il s’agit d’un tambour à cadre (et non à caisse) de forme circulaire assez comparable au Bodhran irlandais. Il est porté à hauteur de la poitrine dans une main tandis que l’autre main vient frapper la peau et éventuellement le cadre. La traduction par « tambourin » (Traduction œcuménique de la Bible, Paris, éd. Cerf/ Les Bergers et les Mages, 1988 ; Bible de Jérusalem ; Traduction de la Bible de Louis Segond, éd. Bible Society, 1991) prête à confusions. En effet, l’instrument TöP ne correspond ni au « tambourin » de l’organologie, lequel est un instrument à caisse soit membranophone (tambourin provençal) soit cordophone (tambourin de Béarn), ni au « tambourin » du langage courant, à savoir le « tambour de basque ». Ce dernier possède
Josselin Roux
30
le plus souvent des pièces métalliques sonores (grelots ou cymbales miniatures) sur le pourtour de son cadre. Or, l’existence de telles pièces métalliques sur le cadre du tambour TöP n’est pas attestée. Voir Joachim BRAUN, Music in Ancient Israël / Palestine, Archaeological, written, and comparative sources, Grand Rapids (Michigan) / Cambridge, coll. The Bible in Its World, éd. William B. EERDMANS Publishing Company, 2002, p. 29-31. 10 waTT
ece ´nä Kol-hannäšîm ´aHárêhä B
eTuPPîm ûBimHölöT (Ex. 15, 20)
// yöcë´T liqrä´Tô BeTuPPîm ûBimHölôT. (Jg. 11, 34)
// waTTëce ´näh hannäšîm miKKol-`ärê yiSrä´ël läšôr wehamm
eHölôT liqra´T šä´ûl
hammeleK BeTuPPîm. (1 S. 18, 6)
11 Diverses scènes de la narration biblique apparaissent comme autant de variantes d’une même scène appelée « scène type ». La reprise d’un ou plusieurs motifs, et la présence d’expressions stéréotypées qui fonctionnent comme des mots-clés permettent de reconnaître et d’associer ces variantes. Voir Robert ALTER, L’Art du récit biblique, trad. Paul LEBEAU & Jean-Pierre SONNET, Bruxelles, coll. Le Livre et le Rouleau 4, éd. Lessius, 1999, p. 73-89. 12 Pour la traduction et l’analyse détaillée de ces versets voir Josselin ROUX, « La danse de la fille de Jephté (Jg 11, 29-40) ou L’enfantement de la vengeance », Semitica et Classica, vol. V, 2012, p. 29-42. 13 Pour le détail des analyses contextuelles des verbes Hûl, Hyl et de leurs substantifs dérivés, voir Josselin ROUX, La danse de Myriam, op. cit., p. 161-210. 14 Dans les sociétés antiques, comme c’est encore le cas dans la plupart des sociétés proto-scientifiques, les femmes accouchent le plus souvent en position verticale : debout, semi-assises, accroupies ou à genoux (cf. Fernand LEROY, Histoire de naître, De l’enfantement primitif à l’accouchement médicalisé, Paris, éd. De Boeck et Larcier, 2002, p. 24 sq.). Il est très peu probable que Ex. 1, 16 soit la première allusion écrite concernant l’usage de la chaise obstétricale ou même d’un quelconque instrument assurant le bon positionnement de la parturiente. Par exemple, Didier Luciani identifie les deux « pierres » / « cailloux » dont il est question dans ce verset avec les éléments constitutifs d’un « tabouret obstétrical », ou d’un « agenouilloir » (Didier LUCIANI, « Concevoir un enfant. Que dit la Bible ? », Bible et médecine, le corps et l’esprit, Michel HERMANS et Pierre SAUVAGE éd., Bruxelles, coll. Le livre et le rouleau n° 20, éd. Lessius, 2004, p. 27 n. 46). En effet, étant donné le contexte, à savoir l’élimination des enfants mâles dès leur naissance, l’enjeu est ici de déterminer le sexe des nouveau-nés. Les « deux cailloux » désignent plus probablement les « testicules » que les éléments d’un siège ou d’un tabouret : « vous regarderez au sujet des deux cailloux » ûr
e´îTen `al-hä´oBnäyim =
« vous examinerez au niveau des testicules » (en accord avec la Traduction œcuménique de la Bible : « Quand vous accouchez les femmes des Hébreux, regardez le sexe de l’enfant. Si c’est un garçon, faites-le mourir. Si c’est une fille, qu’elle vive. »). Il est en revanche bien attesté que les Égyptiennes enfantaient généralement « en position accroupie sur quatre briques [pour que la femme soit surélevée], de façon à permettre l’accès à la tête fœtale en voie de dégagement » (Fernand LEROY, op. cit., p. 45). Dans le Proche-Orient ancien, l’usage de la chaise obstétricale s’est répandu à partir du Ier siècle de notre ère dans le contexte de l’expansion de la civilisation romaine (ibid., p. 60 sq.). Dans le contexte de l’ancien Israël, si nous nous référons à 1 S. 4, 19-22, il peut sembler que la parturiente se tenait habituellement à genoux ou accroupie (cf. Kära`
« s’agenouiller » / « s’accroupir » 4, 19). Cependant, nous n’avons aucune garantie qu’il s’agit là de la technique normale, car la parturition a lieu dans un contexte troublé (une défaite et la perte de l’arche d’alliance). La mère ne se réjouit même pas de la naissance de son garçon comme cela devrait être le cas (cf. 4, 20). Il semble que sa position soit elle aussi anormale : elle manifeste concrètement qu’il n’y a plus d’hommes pour être à ses
La danse de la prophétesse Miryam
31
côtés (son « mari » et son « beau-père » viennent d’être tués, cf. 4, 19), et peut-être, pour la maintenir en position habituelle de parturition, à savoir semi-assise ou debout. On peut noter en effet que ce verset 4, 19 ne mentionne pas la mort des fils (cf. 4, 17), probablement parce qu’à la différence du père et du beau-père, ils n’avaient normalement pas de rôle à jouer dans ce contexte de parturition (sur la présence du « soutien » masculin, principalement du géniteur, lors de la parturition, voir Josselin ROUX, La danse de Myriam, op. cit., p. 340-342). 15 Lorsqu’ils se succèdent à l’impératif, les verbes d’action impliquant des manifestations corporelles entrent régulièrement dans la formulation d’un ordre (cf. par ex. Mi. 2, 10 ; 6, 1 ; 1 R. 14, 2 ; 2 R. 8, 1), mais ils renvoient également au langage de la mobilisation : le locuteur sollicite des protagonistes afin qu’ils se mobilisent pour la guerre (Jr. 4, 5-6 ; 6, 1 ; 50, 14-15 ; 51, 12.27-28), ou pour accomplir une performance de lamentation (Mi. 1, 16 ; Jr. 4, 8 ; 49, 3 ; Lm. 2, 19), ou au contraire une performance festive (par ex. Jr. 31, 7 ; et plus particulièrement, dans les Psaumes : Ps. 32, 11 ; 33, 2 ; 47, 2 ; 81, 3 etc.). 16 Sur les problèmes de traduction et d’interprétation que posent ces versets, voir Josselin ROUX, La danse de Myriam, op. cit., p. 187-199 et p. 346-350. 17 William Propp reconnaît l’évidence : les « fils d’Israël » en Ex. 15, 1 désignent précisément les « hommes d’Israël » distingués du groupe de « toutes les femmes » (William H. C. PROPP, Exodus 1-18, a new translation with introduction and commentary, New York - London - Toronto, coll. The Anchor Bible, éd. Doubleday, 1999, p. 508). Cependant, il n’en tire pas toutes les conséquences. 18 // Ex. 11, 2-3 // 12, 35-36. 19 Hormis lorsqu’il s’agit de désigner sous la forme d’un titre les hommes d’un groupe (cf. « fils d’Israël » [Be
nê yiSrä’ël] 1, 1.7.9.12.13 etc. // « fils d’étranger » [Ben-nëKär] 12, 43), d’expliciter une relation généalogique (cf. 1, 1 ; 6, 14-25 ; 10, 2.2.2) ou d’indiquer un âge (cf. 7, 7.7 litt. « Alors Moïse | était un fils de quatre-vingts ans » ; 12, 5), le « fils » [Bën] est un personnage masculin qui est encore trop jeune pour appartenir au groupe des hommes [’ánäšîm]. C’est particulièrement flagrant dans le cas de Ex. 1, 16.22 ; 2, 2.22, puisque le mot Bën désigne un nouveau-né de sexe masculin (voir aussi : 2, 10 ; 4, 20.25 ; 10, 9). Dans le contexte rituel, une fois devenu un « fils d’Israël » qui a une « maison », le sujet masculin passera du statut de celui qui interroge (« fils ») à celui qui est interrogé (« père ») et donne le sens du rituel (cf. 12, 23-27 ; 13, 1-16). Dès lors, le titre de « fils premier né » de YHWH donné à Israël (cf. Be
nî BeKörî yiSrä´ël « mon fils
mon premier-né c’est Israël » 4, 22-23) peut être entendu en deux sens. Selon une relation de type généalogique, Israël est désigné comme étant de la lignée de YHWH. Relativement à un état, ce titre témoigne du fait qu’Israël n’a pas encore acquis sa pleine stature, sa maturité. Le mot BänôT [/BaT] désigne les petites filles et les jeunes filles qui ne sont pas encore des « femmes » [näšîm]. Cela apparaît clairement en Ex. 1, 16.22 où il est question des nouveau-nés de sexe féminin. Mais c’est encore le cas lorsqu’il est question de la « fille de Lévi » (2, 1), de la « fille de Pharaon » (2, 5.7.8.9.10), ou des « filles » (2, 16.20.21) du prêtre de Madiân. La dénomination « fille de Lévi » [BaT-lëwî 2, 1] est comparable au titre « fils d’Israël » par le fait qu’elle indique une relation généalogique : le personnage en question est une descendante de Lévi. Cependant, « fille de Lévi » souligne aussi un état, celui d’un sujet féminin qui n’a pas encore quitté la maison paternelle pour s’unir à un homme et enfanter. C’est d’ailleurs pourquoi, dès le verset suivant, quand il est question de sa grossesse et qu’elle devient mère, ce personnage n’est plus appelé « fille de Lévi », mais « femme » [’iššäh 2, 2 // 2, 7.9]. De même, outre le lien de parenté qu’il indique, le titre « fille de Pharaon » (2, 5.7.8.9.10) renvoie à un statut social. Comme c’est par exemple le cas pour la « fille de Jephté » [BaT-yiPTäH ; Jg. 11, 40], la « fille de
Josselin Roux
32
Pharaon » [BaT-Par`öh] reste sous la tutelle de son père et dès lors, elle n’est même pas désignée par son nom propre. De même que la « fille de Jephté » est une jeune fille vierge (cf. Jg. 11, 37-40), la « fille de Pharaon » semble être encore une jeune fille à l’image des « jeunes filles de sa suite » [na`áröTêhäh Ex. 2, 5]. Toujours selon les mêmes principes, les personnages féminins de la maison du prêtre de Madiân sont ses sept « filles » (2, 16.20.21), soit autant de jeunes filles qu’il lui reste à marier. Une fois qu’elle a été accordée à Moïse, et qu’elle lui a enfanté un fils, Tsippora n’est plus désignée comme « fille » du prêtre de Madiân (2, 21), mais comme « femme de Moïse » [´ëšeT möšeh] 18, 2 //18, 5.6]. Dans le contexte de l’exposé généalogique d’Ex. 6, 14-25, de manière similaire, Élishéba est désignée comme « fille d’Amminadab » [BaT-`ammînäDäB] justement quand il s’agit de dire qu’elle est devenue la « femme » [´iššäh] d’Aaron (6, 23), idem dans le cas des « filles de Putiel » [Be
nôT Pû†î´ël], mentionnées parce que l’une d’elles deviendra la « femme » [´iššäh] d’Éléazar (6, 25). 20 Sur l’importance de la complémentarité du masculin et du féminin dans la Torah cf. Gn. 1, 27 ; 2, 23-25. 21 Le mot †aP désigne très clairement les « enfants », les « jeunes gens » de sexe masculin et féminin (cf. R. Laird HARRIS, Gleason L. ARCHER, Bruce K. WALTKE, The Theological Wordbook of the Old Testament, éd. Moody Press of Chicago, 1980 ; Theological Dictionary of the Old Testament, J., BOTTERWECK & H., RINGGREN (dir.), éd. Grands Rapids, 1977). À en croire Nb. 14, 29-31, l’âge limite pour appartenir à ce groupe semble être de 20 ans (voir Theological Dictionary of the Old Testament). En particulier, les jeunes filles sont assimilées au groupe des « enfants » †aP tant qu’elles sont vierges (cf. Nb. 31, 18). La traduction de la Bible de Jérusalem en ce verset d’Ex. 10, 10 relève donc de la glose : « je vais vous laisser partir, vous, vos femmes et vos enfants » (10, 10 // 10, 24). En effet, il n’est question des « femmes » [näšîm] ni dans le Texte Massorétique, ni même dans la Septante. Il en va de même pour la Bible en français courant (éd. Société biblique française, 1997) qui traduit ici †aP par « famille », ce qui correspond plutôt à l’hébreu BayiT (« maison » / « maisonnée »). Philippe REYMOND voit dans le collectif †aP le groupe le « plus fragile » dans la société, à savoir les enfants, les femmes, mais aussi les « vieux » (Dictionnaire d’Hébreu et d’Araméen Bibliques, Paris, éd. Le Cerf-Société Biblique Française, 1999). Cette position paraît tout simplement indéfendable. En effet, le mot †aP est justement utilisé pour différencier ces groupes (cf. Est. 3, 13 et Ez. 9, 6). Dans de nombreuses occurrences, le groupe des « enfants » †aP et celui des « femmes » [näšîm] sont ainsi très clairement distingués : cf. par ex. Gn. 34, 29 ; 45, 19 ; 46, 5 ; Nb. 14, 3 ; 16, 27 ; 31, 9.17 ; 32, 26 ; Dt. 2, 34 ; 3, 6.19 ; 20, 14 ; 29, 10 ; 31, 12 ; Jo. 1, 14 ; 8, 35 ; Jg. 21, 10 ; Jr. 40, 7 ; 41, 16 ; 43, 6 ; 2 Ch. 20, 13 ; 31, 18 ; Est. 8, 11. 22 Dans le même ordre d’idées, la Bible en français courant propose : « Ensuite, de la ville de Ramsès, les Israélites se mirent en route pour Soukoth ; ils étaient environ six cent mille hommes, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards ». Le même genre de glose se retrouve dans les traductions anglophones cf. The New International Version (éd. International Bible Society, 1984) : “The Israelites journeyed from Rameses to Succoth. There were about six hundred thousand men on foot, besides women and children” (idem pour The English Standard Version, éd. Crossway Bibles, London, 2001). 23 « Motley group » John I. DURHAM, Exodus, coll. Word Biblical Commentary, vol. 3, éd. Word Books, Waco, 1987, p. 172 ; « un mélange » Franck MICHAELI, Le Livre de l’Exode, Paris, coll. Commentaire de l’Ancien Testament, éd. Delachaux et Niestlé, 1974, p. 101 n. 10 ; « mixed multitude » Martin NOTH, Exodus, A commentary, éd. The Westminster Press, Philadelphia, 1962, p. 99 ; Brevard S. CHILDS, The book of Exodus,
La danse de la prophétesse Miryam
33
A critical, Theological Commentary, Philadelphia, éd. The Westminster Press, 1974, p. 180. 24 « the foreigners » cf. William PROPP, op. cit., p. 357 ; « la foule de gens divers » cf. Franck MICHAELI, op. cit., p. 115 ; voir John I. DURHAM, op. cit., p. 172 ; de manière similaire, voir la Bible de Jérusalem, Traduction œcuménique de la Bible, Bible en français courant. 25 Nous retrouvons le même type de procédé de détournement de l’attention qui était utilisé précédemment en Ex. 10, 9. 26 `am (« le peuple ») n’est pas nécessairement un état construit (cf. par ex. Gn. 11, 6 ; voir The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Francis BROWN, S. R. Driver, Charles A. BRIGGS éd., Boston, Hendrickson, 2000). Le Texte Massorétique ménage une pause entre « le peuple » et « les fils d’Israël », ce qui suggère au contraire que le mot est à l’état absolu. L’expression peut donc relever de la focalisation : il est d’abord question du « peuple » dans son ensemble, puis, en particulier, parmi ce « peuple », du groupe des hommes : « les fils d’Israël ». 27 C’est généralement la traduction qui est choisie (ex. Bible en français courant ; Traduction œcuménique de la Bible), `am étant considéré comme un état construit. Par ailleurs, le verbe « être »/ « devenir » est potentiellement sous-entendu : « les fils d’Israël sont devenus un peuple » (cf. William PROPP, op. cit., p. 130). Dans le même ordre d’idée, John I. DURHAM interprète ici l’expression « fils d’Israël » comme étant le nom du peuple des Hébreux pour Pharaon : « le peuple, “Fils d’Israël” » (cf. John I. DURHAM, op. cit., p. 6).