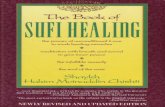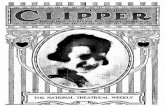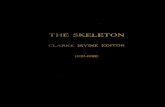Hârûn wuld ash-Shaykh Sidiyya (1919-1977)
-
Upload
univ-lorraine -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Hârûn wuld ash-Shaykh Sidiyya (1919-1977)
1
Muslim societies under French colonial rule Aix-en-Provence, 1-3 Septembre 1994
Hârûn Wuld al-Shaikh Sidiya (1919-1977). La personnalité que je me propose ici d'évoquer, Hârûn Wuld al- Shaikh Sidiya, n'a
pas joué un rôle politique majeur sous la colonisation française malgré son appartenance à une famille très fortement impliquée dans les affaires publiques mauritaniennes de cette époque. C'est plutôt en tant que chroniqueur et historiographe de sa parentèle qu'il s'est fait connaître d'un cercle de spécialistes intéressés par l'ampleur de ses travaux voués avant tout à la célébration du mérite religieux et à l'influence politique de ses ascendants.
Je donnerai d'abord un aperçu de ce milieu familial dont il s'attache à retracer l'histoire avant d'aborder la vie et l'oeuvre de Hârûn.
I - Le milieu familial. Hârûn est l'arrière-petil fils d'al- Shaikh Sidiya al-Kabîr, figure bien connue de la
qâdiriyya ouest africaine (Stewart 1972, Ould Cheikh 1985 et 1991). Rappelons brièvement, pour situer le capital culturel et charismatique dont Hârûn est l'héritier, les étapes essentielles de la carrière de Sh. Sidiyya.
Il appartient à la fraction Awlâd Nta shâyit de la tribu ( qabîla ) "maraboutique" des
Awlâd Abyairi. Abyairi, l'ancêtre éponyme de cette qabîla , serait lui-même issu de Hassân, l'aïeul putatif de la majeure partie des tribus "guerrières" maures, rattaché à son tour par les généalogistes locaux à une ascendance quraishite1..
Sh. Sidiya serait né vers 1190 / 1776. Après avoir récité le Qur'ân auprès de son
oncle maternel, Sidiya W. Atfa gha 'Ubaid et d'al-Tâlib al -Amîn W. al-Tâlib al- Mu khtâr (des Tîmriggîwin), il se rendit auprès du grand savant de la tribu des Idawa'li, Hurma W. 'Abd al-Jalîl (m. 1243 / 1827) pour étudier les sciences linguistiques (grammaire, philologie, littérature, rhétorique, métrique…), la théologie et la logique. Il fréquenta sa mahadra durant treize années, dans une région située entre les agglommérations actuelles de Boutilimit et de Méderdra (Tinbuya'li, al-Jarrâriyya…).
Il poursuivit sa formation auprès des maîtres de la tribu Idaidba qu'étaient Habîb
Alla W. al-Qâdi (m. 1240 / 1824) et son fils Muhammad Mahmûd (m. 1277 / 1860), particulièrement réputés pour leur compétence dans le domaine du fiqh.
Après avoir séjourné chez les Idaidba durant quatre ans, Sh. Sidiya résolut de
rejoindre la zâwiya de Sh. Sid al-Mukhtâr al-Kuntî, établie dans l'Azawâd. En chemin, il s'arrêtera à Tishît et Walâta, deux des plus importants centres "universitaires" de l'Ouest saharien à l'époque. Il se fixera durant seize années dans l'établissement
1Le système des statuts au sein de la société maure distingue trois types de tribus, liées entre elles par un réseau complexe et enchevêtré de relations : les "guerriers" (hassân ), les "marabouts" (tulba ) et les "tributaires"( aznâga ). Les recherches d'alliance, l'interprétation de solidarités traditionnelles existantes entre tribus maraboutiques et guerrières se font, dans bien des cas, du côté des liens généalogiques.
2
confrérique kunta dont quinze mois du vivant de Sh. Sid al-Mukhtâr (m. 1811), et le reste en compagnie de son fils et successeur, Sh. Sidi Muhammad (m. 1826).
A son retour dans sa région natale du sud ouest de la Mauritanie actuelle en 1827, Sh. Sidiyya, qui avait épousé la fille de l'un des principaux notables de sa tribu2, s'imposera comme une autorité religieuse, morale et politique non seulement à sa communauté tribale d'origine, mais également à une vaste clientèle (tlâmîd ) s'étendant des confins septentrionaux du Mali actuel à la région de al-Sâgia al- Hamra (Sahara Occdental ex-espagnol).
Lorsqu'il meurt en 1869, il laisse derrière lui un capital de relations et de prestige
considérable à l'échelle de la région. Il avait eu le temps de se constituer une des plus importantes bibliothèques de manuscrits de cette zone du Sahara comme il avait su gérer avec habileté le patrimoine économique que son éminente position confrérique lui avait permis d'acquérir.
C'est son fils unique, Sh. Sidi Muhammad, surnommé Sîdna, qui hérite de l'ensemble
de l'édifice construit par Sh. Sidiyya mais il ne lui survivra que l'espace de quelques mois. Son action politico-religieuse s'est donc pratiquement déroulée toute entière à l'ombre de son père. Sa notoriété personnelle, Sîdna la devra surtout à sa production littéraire. Il est en effet considéré par les lettrés et les annalistes comme un des plus grands poètes en arabe classique du pays maure3
Sîdna avait pris pour épouse Mariam Taqla (dite Yayya) Mint 'Abd al-Wadûd W.
Arabîh, de la fraction des Ahl Muhammad W. A'dajja W. Mrâbit Makka des Awlâd Abyairi.
Sîdna == Mariam Taqla. Sh. Sidiyya (Bâba) Sîdi 'Ali Sîd al-Mukhtâr Fatimatu az-Zahrâ
Sh. Sidiyya, surnommé Bâba, l'aîné des enfants de Sîdna, bien que très jeune à la
mort de son père (il avait moins de dix ans…) en assumera la succession spirituelle et politique à la tête des Awlâd Abyairi.
Quoi qu'il n'ait pas suivi un cursus connu, balisé par ces ijâzât que les lettrés zawâyâ
aimaient à collectionner, Bâba était, à ce que rapportent tous les témoignages, un homme d'une vaste culture traditionnelle4.On le disait même "abonné" à quelques
2am-Mâmma, fille de 'Ali W. 'Abdi, une des personnalités les plus en vue de la principale fraction des Awlâd Abyairi (Ahl Mahand Nalla). 3Voir notamment ce qu'en dit l'anthologiste Ahmad b. al-Amîn al-Shinqîtî dans son ouvrage, al-Wasît fî tarâjim udabâ' Shinqî†, al-Khanji, Le Caire, 1989 (1ère éd. 1911), pp.243-276. 4On lui doit diverses oeuvres dont notamment un opuscule sur l'histoire des Idaw§îsh et Mashzûf qui atteste d'une lucidité, d'une indépendance de jugement et d'un esprit critique peu communs parmi les auteurs maures qui se sont intéressés aux questions
3
publications venant du Maghreb et du Moyen Orient, et très au courant de la conjoncture politique mondiale.
Il a grandi et commencé à s'occuper des affaires publiques, c'est-à-dire avant tout
celles de sa tribu, dans une conjoncture régionale marquée par un développement sensible de l'insécurité. Les tribus "maraboutiques", en particulier, souffraient des razzias incessantes et de l'état de guerre généralisé qui semblait dominer le Sahara Occidental à la veille de l'occupation française.
Bâba mettra en avant les avantages d'une paix civile qui ne menacerait pas le libre
exercice des pratiques religieuses musulmanes pour accorder son soutien à l'occupation de ce qui allait devenir la Mauritanie par les troupes françaises à partir de 1902.
Il sera de ce fait un interlocuteur privilégié et honoré des Français jusqu'à sa mort en
1924. A Boutilimit, qui n'était jadis qu'un puits foré par son grand-père, Bâba cédera la
maison bâtie par Sh. Sidiya al-Kabîr pour entreposer ses livres et d'autres impedimenta aux représentants de l'autorité française qui en renouvelleront la construction. C'est cette maison qui abrite aujourd'hui la bilbliothèque de Hârûn…
Bâba épousera successivement Vâtma Mbârka (dite an-Nâha) Mint al-Mukhtâr W.
'Abd al-Fattâh, de la fraction des Ahl Ahmad Wuld al-Vâlli, puis Ramla Mint al-Hasan W. Sîd Ahmad, de la fraction des Awlâd Khâddîl5.
De ces deux épouses, il eut la descencance suivante : Bâba == an-Nâha Muhammad Ahmad 'Abd Allâh Brâhîm Smâ'îl Shâq Mariam Mahjûba Fatimatu al-Batûl Maimuna Zainabu Sârra Khadijatu Hafsatu ("Baddi") Bâba == Ramla Ya'qûb Um Kalthûm 'Aishatu Yûsuf Mûsâ Hârûn Sawdatu Sulaimân A l'arrivée des Français, Bâba, qui devait son autorité sur sa tribu, à la fois à
l'héritage légué par son grand-père et à une bai'a présentée par la jamâ'a des Awlâd Abyairi, décide de confier les "affaires temporelles" de sa communauté à son frère Sîd al-Mukhtâr. Il déléguait ainsi à ce dernier la portion "administrative" de la "chefferie générale" instituée par les Français au lendemain de leur installation et qui devait naturellement lui échoir.
historiques. Notre copie du manuscrit. Traduction anglaise dans H. T. Norris, Saharan Myth and Saga, Clarendon Press, Oxford, 1972, pp.160-213. 5La mère de Ramla, Maimûna Mint Akhyâr Antâju, appartient à la fraction Awlâd Abyairi des Idammîjin.
4
L'autorité de Sîd al-Mukhtâr ayant, à ce qu'il semble, suscité quelques réticences parmi ses "administrés", Bâba la reprend officiellement, mais il en confie en fait l'essentiel à son fils 'Abd Allâh.
En 1924, Sh. Sidiya Bâba décède. L'aîné de ses enfants, Muhammad, est investi de
la bai'a tribale, mais il meurt à son tour deux ans plus tard. C'est au suivant en âge, Ahmad, que revient la succession spirituelle de Muhammad, 'Abd Allâh conservant toutefois la haute main sur les affaires politico-administratives des Awlâd Abyairi.
Plus tard, lorsqu'à partir de 1946, les affaires publiques mauritaniennes
commenceront à prendre un tour plus ou moins électoral (désignation des conseillers territoriaux de l'AOF, d'un député…), c'est le benjamin de la famille, Sulaimân, le seul des descendants de Bâba à avoir eu un contact avec l'école coloniale, qui apparaîtra comme le principal représentant de la famille des Ahl Sh. Sidiyya dans l'arène politique.
Et Hârûn dans tout cela ? Je n'ai fait ce bref rappel politico-généalogique que pour
situer le contexte social, l'horizon familial dans lequel il a eu à évoluer. Les trois éléments-clefs de ce contexte me semblent être : le poids de l'héritage culturel, charismatique et économique issu de Sh. Sidiya al-Kabîr; le rôle de la tribu, de ses liens et de ses subdivisions généalogiques, l'influence exercée par la colonisation française.
II - L'homme. Hârûn appartient donc à la seconde génération des enfants de Bâba W. Sh. Sidiya. Je
n'ai pas développé toutes les connexions parentales, toutes les alliances matrimoniales qui lient depuis Sh. Sidiya al-Kabîr les membres de sa famille aux principaux lignages de sa tribu. Un examen détaillé de ces liens -auquel Hârûn lui-même s'est livré- ferait apparaître, mieux que bien des développements, les bases généalogiques de l'intérêt de notre personnage pour des réseaux de parenté qui ne cessent de déborder le "lien religieux", qu'il souhaitait poser, dira-t-il dans son Kitâb al-akhbâr, comme fil conducteur de sa recherche sur ses ancêtres…
Quoi qu'il en soit, Hârûn naquit vers 1919, sans doute dans les environs de
Boutilimit, la bourgade fondée par son arrière-grand-père, à une époque où, à la fois pour des raisons de sécurité (razzias des tribus hostiles…) et de mode de vie, le campement de Sh. Sidiya avait cessé de pratiquer des déplacements de quelque amplitude6.
Comme tous les enfants zawâyâ de son âge, Hârûn commence son apprentissage
scolaire par la récitation du Qur'ân sous la direction du maître appointé par son père, Muhammad Mahmûd W. Krâma, d'une famille originaire de la tribu des Midlish, tlâmîd de Sh. Sidiya. Dès cette première phase de sa vie scolaire, il fait preuve d'une intelligence et d'une mémoire peu communes. La tradition familiale attribue d'ailleurs aux effets de la jalousie et du "mauvais oeil" ('ain ) la perte précoce de l'un de ses 6Les habitants de ce campement qui vivaient, pour bon nombre d'entre eux dans des cases en paille um rukba (Panicum turgidum), entourées d'enclos (ahwâsh ) en branches d'épineux s'appelaient eux-mêmes ahl lahwâsh (litt. : "ceux des enclos"), d'un nom significatif de l'affaiblissement de leur mode de vie nomade.
5
yeux… Ce handicap ne l'a cependant pas empêché de poursuivre avec énergie et succès ses études.
Il obtint ainsi une ijâza dans le domaine coranique auprès de 'Abd al-Wadûd W.
Hammêh, maître originaire de la fraction Awlâd Abyairi des Idaghbsrîn, fameux pour sa maîtrise du texte sacré.
L'essentiel de sa formation se passe ensuite auprès de son cousin Sîdi Muhammad,
surnommé ar-Râjil, W. Dâddâh W. al-Mu khtâr W. al-Haiba7, une des figures intellectuelles les plus éminentes des Awlâd Abyairi. Hârûn s'attachera surtout à développer auprès de ce nouveau maître, ses connaissances dans le domaine des sciences de la langue arabe (grammaire, métrique, rhétorique, histoire littéraire…).
Il parachèvera sa formation traditionnelle, notamment l'étude du bréviaire des
juristes locaux, le Mukhtasar de Khalîl b. Ishâq, auprès de Muhammad 'Âli W. 'Addûd 8, son futur collègue à l'Institut Supérieur d'Etudes Islamiques de Boutilimit.
En 1941-42, il entreprend un périple au Sahara Occidental, sur les traces de la
fructueuse rihla accomplie jadis par son arrière-grand-père, Sh. Sidiya al-Kabîr dont il était notamment revenu chargé de manuscrits. Ce départ exprimait-il un mécontentement vis-à-vis de l'administration française ou des membres de sa famille qui en étaient les plus proches ? Hârûn aurait-il eu à ce moment-là des ambitions politiques qui n'avaient pu trouver le chemin de leur réalisation ? A-t-il eu l'intention d'envoyer un message de "dissidence" aux autorités ? Souhaitait-il simplement se rendre à la Mecque en faisant au préalable une tournée de ziyâra parmi les tlâmîd Awlâd Tîdrârîn de son aieul ?
Quoi qu'il en soit du but de ce voyage, il fut perçu avec quelque suspicion par
l'administration française qui, en cette période de guerre en Europe, appréciait modérément le passage des figures marquantes des tribus qu'elle contrôle derrière les frontières avec l'Espagne, dans un territoire qu'elle identifie traditionnellement à un refuge de dissidents.et où, de surcroit, on lui signalait la présence d'officiers allemands travaillant à miner le contrôle de la France sur ses administrés…
Hârûn aurait en tout cas été bien accueilli par les autorités espagnoles ainsi que dans
les tribus avec lesquelles il prit contact, tout spécialement les Awlâd Tîdrârîn. A son retour, les autorités de la colonie française à Boutilimit lui imposèrent une
sorte de statut de résidant surveillé, obligé de rendre compte de ses déplacements, et astreint en fait à un séjour quasi-permanent à Boutilimit, à une époque où il était pratiquement le seul membre de la famille Sh. Sidiya à y habiter.
C'est de ce temps que date, selon toute vraisemblance, sa prise de possession de
l'ancienne maison de Sh. Sidiya, restaurée par les Français, et où était entreposée une bonne partie des ouvrages de la bibliothèque familiale. Plus tard, il se fera officiellement octroyer cette maison par son frère 'Abd Allâh, devenu l'administrateur principal des affaires de la famille.
7ar-Râjil est mort en 1360/1942, à l'âge de 90 ans.cf al-Mukhtær W. Îæmidun, Hayât Mûritânyâ, al-Dâr al-Ma ghribiyya li-l-Kitâb, Tunis, 1990, Vol. II, p. 350. 8Eminent lettré de la tribu des Ahl al-Mubârik, décédé en 1401/1981.
6
La sédentarité forcée au milieu de tous ces ouvrages est venue renforcer les penchants "d'homme des livres" de Hârûn qui apparaîtra de plus en plus comme "l'archiviste" de sa parentèle.
C'est également de ce séjour que date son recrutement comme enseignant d'arabe à
l'école primaire de Boutilimit. Ce sera le début d'une longue carrière administrative dont nous évoquerons plus loin les principales étapes.
Si Hârûn n'assure pas en tant que "maître" un enseignement de mahadra
traditionnelle, il n'est pas rare qu'il commente des textes ou donne des éclaircissements sur les questions intéressant ses jeunes parents que la présence de l'école amène à séjourner à Boutilimit.
Hârûn fait dater de 1945 le début véritable de sa quête "d'archiviste". C'est lors d'une
visite à son grand frère Ahmad, dépositaire de l'autorité spirituelle de leurs aïeux, qu'il prit conscience, sur recommandation de ce dernier, de la nécessité d'entreprendre des biographies de Sh. Sidiya al-Kabîr, de ses fils et petit-fils, Sîdna et Bâba. J'évoquerai plus loin ce travail, Kitâb al-a khbâr, qui sera véritablement le grand oeuvre de la vie de Hârûn.
Il ne semble pas que durant ces années où la colonie de Mauritanie connaît un début
de vie politique pluraliste lié à "la loi Deferre" (participation aux législatives françaises de 1946 et 1951…), Hârûn ait pris une part active à l'agitation dont elle s'est accompagnée. Certes, on le voit, dans son Kitâb al-a khbâr, évoquer, avec une pointe d'agacement, l'intrusion de la siyyâsa (politique) dans le cours ordinaire des choses, comme s'il voulait désigner par ce vocable l'ensemble des idées et des personnes qui s'efforçaient de remettre en cause la statut quo politico-religieux où la famille des Ahl Sh. Sidiya occupait une position hégémonique…
Il est probable que ce ne soit pas vraiment par indifférence que Hârûn n'a pas pris
une part très active au bouillonnement politique de la fin des années quarante. D'autant que depuis son retour du Sahara Occidental, et son retour en grâce auprès de l'administration coloniale, il s'est vu octroyer la direction d'un groupe traditionnel ("le groupe Hârûn"), la chefferie d'un sous-ensemble de sa tribu, sous l'autorité du "chef général" des Awlâd Abyairi qu'était son frère 'Abd Allâh 9.
Il s'agissait, à la vérité, d'un ensemble assez modeste, regroupant essentiellement des
ressortissants de la fraction Idawbrim, des tlâmîd issus des Awlâd Tîdrârîn, quelques autres familles isolées…
Mais cette position, qui permettait au "chef de groupe" de prélever une fraction de
l'impôt "zakât" collecté sur ses administrés, avait surtout l'intérêt de lui ouvrir l'accès à "l'assemblée annuelle des chefs et notables", instance consultative où se retrouvaient, en principe, toutes les personnes de quelque poids dans la circonscription10.
9Les frères de Hârûn, Smâ'îl, Shâq et 'Abd Allâh avaient chacun leur "groupe", ce dernier cumulativement avec sa fonction de "chef général". 10Un des rôles essentiels de ces assemblées était de se prononcer sur les budgets des "Sociétés Indigènes de Prévoyance" (appelées $l-bikniyya en hassâniyya, parce que leurs ressources proviennent du "dixième additionnel" -bikni- ajouté à l'impôt zakât ), créées en 1946, en principe pour parer aux difficultés d'approvisionnement qui se sont
7
Hârûn était donc bel et bien associé à la gestion des "affaires de la cité". Mais sans
doute avec prudence et circonspection. Même les gens qui étaient les ennemis déclarés de sa tribu et de sa famille, il les évoque dans ce qu'il écrit avec respect, sinon avec bienveillance, en tout cas toujours sans acrimonie…
En fait,la politique n'occupait à l'évidence qu'une place seconde dans les
préoccupations de Hârûn, désireux avant tout de mener à bien le seul vrai grand projet de son existence, son ouvrage sur la vie de ses ancêtres, dont il commence la rédaction au début des années cinquante.
Son affectation à l'Institut Supérieur d'Etudes Islamiques de Boutilimit, créé par son
frère 'Abd Allâh au début des années cinquante, lui a peut -être procuré plus de temps libre que celui dont il disposait à l'école primaire…
Lorsqu'il signale des interruptions dans sa rédaction, ce ne sont d'ailleurs pas des
raisons de temps disponible qu'il met en avant, mais le souci de ne pas écrire sous l'emprise des manifestations de la siyyâsa, pour garder la tête froide et préserver son autonomie de jugement.
En 1960 en tout cas, la rédaction a bien avancé, et Hârûn, qui se présente avec
succès au concours de formation des quddât (sg. qâdi ), peut aller passer une année scolaire en Tunisie.
Je ne sais pas exactement en quoi consiste son statut administratif au lendemain de
sa formation… Une chose en tout cas semble acquise. Son projet d'ouvrage commence à être connu dans les sphères de décision de l'administration mauritanienne.
Il reçoit les visites de divers responsables du secteur de la Culture, y compris des
Ministres, qui doivent sans doute tous avoir été frappés par son érudition mais également par l'étendue de la documentation manuscrite qu'il a rassemblée au fil de ses nombreux déplacements. Le fruit de la collecte obstinée qu'il avait entamée depuis plusieurs années venait en fait s'ajouter à l'essentiel de la bibliothèque léguée par Sh. Sidiya dont il avait hérité11…
Il a une entrevue avec le Président Mokhtar Ould Daddah qui lui prodigue ses
encouragements. Bientôt il sera déchargé de toutes ses fonctions administratives et libéré pour poursuivre ses recherches, tout en gardant son traitement.
Il bénéficie de quelque soutien pour entreprendre des voyages de recherche à
Tîmbuktu et dans l'Azawâd, au Niger, où il découvre, dans la bibliothèque de Boubou Hama, divers documents intéressant son projet, notamment la version la plus longue du livre d'Sh. Sidi Muhammad W. Sh. Sid al-Mukhtâr al-Kuntî consacré à ses parents, al-Tarâ'if wa--l-talâ'id fî karâmât al-shaikhain al-wâlida wa-l-wâlid,12 dont l'influence n'est pas absente de sa propre démarche.
révélées particulièrement lourdes de conséquences lors de la crise climatique et économique de 1942-43. 11Charles Stewart (1970) a établi une liste des ouvrages rapportés par Sh. Sidiya de sa riÌla marocaine des années 1830. Réf. … 12L'auteur d'al-Tarâ'if annonce dans son plan sept chapitres en plus de l'introduction et de la conclusion. Hârûn n'avait trouvé, avant la version nigérienne qui s'étend jusqu'au
8
Ses soutiens officiels veulent absolument qu'il rédige quelque chose en vue d'une
édition, qu'une partie de son ouvrage soit mise à la disposition du public. Bien qu'il ne se sente pas vraiment prêt à livrer un document qui lui paraisse entièrement satisfaisant, il doit, à contre coeur -car c'est un perfectionniste- répondre à cette exigence. Il décide donc de bâtir un ouvrage sur des réponses données à une autre requête. Ahmad W. Hbayyib, des Idâtfagha (Tâshumsha), attelé à la rédaction d'une sorte d'encyclopédie borgesienne, Le livre des nombres13, lui avait en effet envoyé dix questions relatives à Sh. Sidiya al-Kabîr auxquelles Hârûn s'était efforcé de répondre. Il partira du canevas fourni par ces réponses pour rédiger son livre, Kitâb al-akhbâr.
Il n'avait pas encore achevé sa rédaction, quand survint son décés le 10 Mars 1977. Hârûn a eu plusieurs épouses avec lesquelles il a eu des enfants : 1 Hârûn == Maimûna Mint al-Khirshi W. Bâbbâh W. Sîd Ahmad (Awlâd
Khâddîl) 2 Hârûn == Zainabu Mint Taffâ W. Muhamd al-Kawri W. 'Ali W. 'Abdi
(Ahl Mahand Nalla) Muhammad Fatimatu 'Aishatu 3 Hârûn == Mahjûba (al-Badr) Mint MuÌamd as-Sâlim W. al-Hâfiz W. Khâddîl
(Awlâd Khâddîl) Mariam Bâba Khadijatu Sawdatu Mûh Maimûna 4 Hârûn == Îanna (une jâriyya ) 'Abd Allâh Ya'qûb Yûsuf Ahmad Um Kalthûm 5 Hârûn == Kuhaila Mint Labâi 'Abd al-Rahmân III L'oeuvre. Je l'ai déjà noté, la grande affaire de la vie de Hârûn, cela a été son livre, Kitâb al-
akhbâr, initialement conçu comme une biographie de son arrière-grand-père, et de ses fils et petit-fils, Sîdna et Bâba.
milieu du chapitre V, que les versions courantes qui ne vont pas au-delà de quelques développements du chapitre IV. 13Ahmad b. Muhammad b. Muhummadhin b. Ahmad b. Hbayyib al-Bahnæwî al-Yadmusî al-Alfaghî al-Shamshawî, Sullam al--'ilm wa-l-adab wa mi'râj al-hikma wa fasl al-khitâb / Kitâb al-A'dâd. Cf U. Rebstock, Sammlung arabischer Handscriften aus Mauretanien, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1989, p. 13.
9
Dans l'état où il l'a laissé, il s'agit d'un document qui fait plus de 6000 pages de cahiers scolaire d'une érudition généalogique, historique et littéraire exceptionnelle, où Hârûn a rassemblé, avec une grande probité, les témoignages écrits et oraux ayant trait principalement aux relations de son arrière-grand père, Sh. Sidiyâ al-Kabîr avec l'univers social environnant.
Pour échapper aux contraintes d'un plan trop rigoureux et aux requisits d'une
démarche d'historien professionnel, pour intégrer toutes les données au fil même de leur cueillette, Hârûn choisit la liberté du genre akhbâr.
Akhbâr, dit Lisân al-'Arab, est le pluriel de khabar qui désigne "les informations
(mâ atâk min naba' ) que l'on reçoit d'un locuteur-émetteur ('amman tastakhbir ). On trouve à la même entrée, dans l'Arabic-English Dictionary de Hans Wehr :"khabar, pl. akhbâr : news, information, intelligence, report, communication, message, notification, rumor, story, matter, affair.".
Le Kitâb al-akhbâr de Hârûn est en effet tout cela à la fois. Une sorte de fourre-tout
anecdotique, généalogique, littéraire et doxographique. Al-akhbâr a pourtant sa noblesse. "Si les savants, écrit l'auteur se reférant à Abu-l-
Hasan 'Ali b. al-Husain, ne s'étaient pas préoccupés de noter leurs impressions (khawâtir ) au moyen d'al-akhbâr et des traditions (âthâr ), la science aurait définitivement disparu. Car al-akhbâr est la source de toute science et de toute sagesse. On lui emprunte des citations et on y apprend la langue pure. Elle fournit des instruments pour toutes les analogies et toutes les argumentations. Elle apprend à connaître les hommes, et on y trouve les propos des sages. Elle enseigne les valeurs morales élevées, la prudence et la rectitude dans la conduite du pouvoir politique. Elle rend familières toutes choses étranges et merveilleuses. C'est un savoir qui intéresse autant le spécialiste que le dilettante, l'homme de raison que l'individu de peu de jugement. Elles suscite de l'attrait autant parmi les Arabes que parmi les Barbares (a'jâm ). Elle aide à embellir tout propos et toute démonstration. Sa supériorité sur toutes les autres formes de connaissance est patente et sa noblesse n'est pas à prouver. Seul l'homme qui se consacre entièrement à la science ('ilm ), celui qui a assimilé son sens et goûté son fruit, qui a perçu sa force et connu les joies qu'elle procure, peut s'adonner durablement à al-akhbâr ." (pp. 3-4 de l'introduction).
III -1 Pourquoi écrire ? Comment écrire ? Dans l'introduction du Kitâb, Hârûn explique les raisons qui l'ont poussé à écrire et
délivre le fil conducteur de sa démarche. C'est, nous dit-il, en 1945 que, passant dans le campement de son frère Ahmad à al-
Maimûn at-Talli, il s'est fait confier par ce dernier la tâche d'établir une biographie de leurs ascendants : Bâba, Sîdna et al-Shaikh Sidiya al-Kabîr. "Il m'a conseillé (amara-nî ) de m'informer auprès de personnes âgées qu'il m'a indiquées parmi les Awlâd Ntashâyit. Il m'a suggéré d'écrire tout ce que l'on m'aura rapporté tel quel sans correction ni ajout, quitte à y revenir plus tard. L'idée de réaliser un tel travail ne cessa depuis lors de murir dans mon esprit. Cependant divers obstacles empêchèrent sa mise en oeuvre, au nombre desquels l'apparition de la politique (zuhûr al-siyyâsa ) en Mauritanie à partir du 10 Novembre 1946" (pp. 4-5 de l'introduction).
10
Cette date marque en effet "l'irruption de la politique" dans la vie mauritanienne. Sur le fond des rivalités partisanes de la métropole coloniale et de ses représentants locaux, tiraillés entre l'héritage vichyste et les orientations inspirées par les bénéficiaires de la Libération en France, la Mauritanie connaît ses premières élections en Novembre 1946. Le candidat soutenu par les Ahl al-Shaikh Sidiya est battu par Hurma Wuld Babâna, de la tribu des Idawa'li qui s'était présenté sous l'étiquette socialiste (SFIO). Une campagne très "chaude" opposera encore Hurma, en 1951, à Sid al-Mukhtâr Ndiaye, parrainé par les Ahl al-Shaikh Sidiya, et qui sortira vainqueur du scrutin.
Hârûn, sans doute impliqué à quelque degrè dans ces évènements, mais proclamant
aussi sa volonte de ne pas se laisser influencer par des positions partisanes, de se donner tout le temps nécessaire à une réflexion sereine, attendra le début de l'année 1952 pour commencer sa rédaction.
Au moment d'entamer l'oeuvre que lui a demandée son frère Ahmad, il réalise qu'il
ne peut rédiger une biographie de leurs ancêtres sans faire connaître "leurs parents" (dhawi arhâmi-him ), "tous ceux qui ont avec eux un lien de proximité généalogique" (sâ'iri qurabâ'i-him ), l'ensemble de leur tribu (qabîla ). "Il fallait ensuite, poursuit-il, envisager l'étude de toutes les tribus mauritaniennes et d'autres encore afin de parvenir à savoir quels sont les membres de ces collectivités qui se sont attachés par un lien religieux à l'un quelconque de nos personnages, car ce lien est le plus solide de tous. Je devais aussi m'intéresser à toutes les autres espèces de lien qui ont pu engendrer des relations fermes et durables entre nos ancêtres et les hommes de leur temps." (p. 5).
Dans cette recherche, nourrie par une ambitieuse volonté d'exhaustivité, aucun détail
ayant trait à la vie et aux relations des personnages étudiés ne sera négligé. La tradition orale sous toutes ses formes (généalogies, récits, contes, poésie, anecdotes…) aussi bien que les témoignages écrits seront tour à tour interrogés. L'importante correspondance de Sh. Sidiya al-Kabîr notamment, dont près de trois cents lettres ont été conservées, est reprise quasi-in extenso. Hârûn propose également, dans l'introduction de son Kitâb, une bibliographie commentée des principales sources locales en arabe, constituées en majorité de manuscrits inédits, de l'histoire des tribus maures.
L'exposé, la mise en forme et en ordre des matériaux rassemblés suivra le fil
conducteur fourni à la fois par la généalogie et le "lien religieux". "Pour moi, écrit-il, le lien religieux (al-irtibât al-dînî ) est au principe (asl ) des relations que j'étudie, tout le reste en découle (yatlû-h tâbi'un la-h)" (p. 6).
61 cahiers scolaires d'une centaine de page chacun seront ainsi rédigés par Hârûn
entre le début de l'année 1952 et son décès survenu en 1977. Il définit lui-même ainsi le contenu de ces cahiers : "(j'y) mentionne le nom de l'ancêtre de la tribu (jadd al-qabîla ), ses fils et les ramifications de leur descendance jusqu'à la date de la rédaction, sur le modèle ('alâ namat ) des Ansâb Quraish (Généalogies des Quraish) de Mus'ab al-Zubairî qui s'arrêta (iqtasara ) en la matière aux mêmes limites que celles que j'ai adoptées. Al-Zubairî rappelle parfois, en évoquant un personnage, un épisode qui l'a rendu célébre, un évènement auquel il a pris part, ou sur lequel il a témoigné. Je procédais moi aussi de même, n'évoquant que les faits les plus notoires (shahîr ) que l'on ne peut passer sous silence, pour éviter de trop longs développements." (p. 7). Fort heureusement pour les amateurs d'archives, Hârûn donnera plus souvent libre cours à son érudition qu'il n'observera la règle de concision qu'il vient d'énoncer…
11
"J'ai commencé, éctit-il, l'étude des tribus par celle des hommes objets de ma recherche, la tribu des Awlad Abyairi, suivant l'ordre de fractionnement donné par le document relatif à leur généalogie daté de 1131 (1719) de l'Hégire. On ne trouve aujourd'hui aux mains d'aucune des tribus zawâyâ de la Gibla (Sud Ouest mauritanien) des données historiques sur la généalogie plus anciennes que cette date. J'évoque par exemple Abyairi, ses fils, ses petits-fils et ainsi de suite jusqu'aux personnes vivantes à l'heure où j'écris. J'évoque ensuite ses frères dans l'ordre proposé par le document plus haut cité jusqu'à leur descendance actuelle . J'aborde après cela, dans leur ordre de succession, les oncles paternels (a'mâm ) ainsi que la descendance de chacun d'entre eux jusqu'aux contemporains. Dans le document auquel je me réfère, les oncles sont cités avant les frères. Je procède à l'inverse de cet ordre, étant donné que les frères sont plus proches entre eux qu'avec leurs oncles. Je me suis ensuite intéressé aux tribus directement liées aux Awlâd Abyairi par une forme quelconque de lien existant à cette époque, et auquel, en cas de nécessité, on ne pouvait manquer de recourir. J'évoque ensuite, dans la partie de l'ouvrage spécifiquement consacrée à al-Shaikh Sidiya, à ses fils et petit-fils, les tribus autres que les Awlâd Abyairi."
Hârûn ne dissimule pas, on le voit, sa fierté d'appartenir à une tribu pour laquelle il
revendique un statut de supériorité "archivistique" sans équivalent dans sa région, parmi les groupes "lettrés", même si le document généalogique auquel il fait référence est d'une authenticité controversée14. L'orientation "globalement positive" qui commande l'ensemble de sa démarche, qui ne veut enregistrer des processus historiques que leurs aspects sinon exemplaires, du moins les plus nobles et les plus "présentables", il l'applique bien sûr en premier lieu aux siens. Il dira clairement que c'est à une célébration des mérites des hommes de sa tribu qu'il souhaite, par son travail, contribuer. "Mon objectif premier, en entreprenant ce travail était, écrit-il, de saisir l'ensemble des relations dans lesquelles étaient engagés les personnages dont j'ai voulu rapporter la biographie. Puis, quand je pris connaissance de ce que les Mauritaniens avaient écrit en matière d'histoire, de généalogies et de littérature; et ce que d'autres qu'eux parmi leurs voisins ont écrit, et que je n'y trouvais rien de bien important concernant la tribu des Awlâd Abyairi, de décidais d'établir son histoire et sa généalogie, d'évoquer ses savants, ses saints, ses hommes de mérite, ses poètes, ses vaillants guerriers (shuj'ânihâ ), ses hommes prodigues (kuramâ'ihâ ), et tout ce qui la rend supérieure et la distingue des autres tribus." (p. 8).
Tels étaient les objectifs affichés par Hârûn et la manière dont il en rend compte
dans l'introduction de son Kitâb. Sa tribu, Awlâd Abyairi, occupera finalement vingt des cahiers que compte l'ouvrage, le reste de la rédaction traite des relations des aïeux de l'auteur avec tous ceux qui ne relèvent pas de son groupe tribal.
III - 2 Un monument fragmenté Deux "prinicipes de désordre" semblent commander la structure éclatée du Kitâb al-
akhbâr. Formulés dans les termes employés par Hârûn, ils s'énoncent à peu près comme suit : "la conversation est vagabonde" (al-Ìadîth shujûn ); "il y a de la continuité dans l'histoire" (al-târîkh yartabitu ba'duh-u bi-ba'd). Le premier justifie les déplacements d'un sujet à un autre, le second autorise le retour au sujet au double sens de thème principal de la narration et de subjectivité individuelle cheminant dans l'histoire. Celle du héros dont Hârûn a entrepris de nous raconter la vie. La dynamique arborescente du récit, le foisonnement des généalogies et des anecdotes, comme une multitude de 14Voir l'article de Stewart (1970) cité dans la bibliographie.
12
ruisseaux au cours incertain, est ainsi constamment ramené vers, capté par un cour central, la vie édifiante de Sh. Sidiya.
Mais le travail accompli par Hârûn ne se limite pas, nous l'avons dit, à une
biographie hagiographique de son arrière-grand père. Le Kitâb al-akhbâr. , en conformité avec l'exigence de liberté inscrite dans le sens du mot qui lui donne son titre, emprunte une multitude de chemins qui en font une véritable somme. Oeuvre d'édification et d'auto-célébration, immense "who's who" tribal, fichier d'état-civil, chronique politico-militaire, anthologie littéraire et "exo-biographie" au jour le jour de Hârûn lui-même, on y trouve tout cela à la fois et bien d'autres choses encore…
Il s'agissait avant tout pour Hârûn d'immortaliser les qualités intellectuelles, les
hautes vertus morales, la grande influence politico-religieuse d'al-Shaikh Sidiya dans l'ensemble du Sahara occidental du XIXé s. Tout le parcours qu'il effectue de la société maure est ordonné autour de cet effort de canonisation posthume. Il s'étend longuement sur sa formation, sur l'étendue de ses connaissances, ses productions littéraires et juridiques en prose et en poésie. Parlant, par exemple, d'un de ses très nombreux poèmes invocatoires pour faire advenir la pluie (istisqâ' ), Hârûn insiste sur l'inspiration intarissable de son héros, sa parfaite maîtrise des règles de la prosodie arabe, son incomparable familiarité avec le corpus lexicographique de cette langue, lui qui, nous dit-il, composait des rimes "aussi naturellement qu'il respirait".
Ailleurs, Hârûn, qui s'est longuement étendu sur l'estime dans laquelle ses maîtres
Kunta tenaient al-Shaikh Sidiya, évoque les services pédagogiques et religieux qu'ils se sont mutuellement rendus. Il cite les nombreux échanges épistolaires en vers et en prose avec al-Shaikh Sidi Muhammad, avec ses fils Sid al-Mukhtâr al-Saghîr (dit Bâdi) et al-Bakkâi à la formation duquel Sh Sidiya a contribué, les ijâzât délivrées de part et d'autre (Cahiers I et II). Hârûn attribue à son aieul un rôle appréciable dans la dévolution de la succession d'al-Shaikh Sidi MuÌammad à la tête de la zâwiya qâdiriya, convoitée par ses différents descendants et ses collatéraux. Et quand Bâdi a été choisi grâce à un mystérieux procédé mis au point par al-Shaikh Sidiya, et qu'il se plaignit à ce dernier de ne pas savoir tout ce que savaient ses père et grand père, "il le prit à un moment particulier et lui transmit tout ce qu'il savait d'une manière surnaturelle ('alâ hâla khâriqa li-al-'âda ), comme cela était de notoriété publique à l'époque."
L'influence religieuse et politique d'al-Shaikh Sidiya à partir de son retour dans sa
région d'origine, après un périple "de formation" qu'il a poursuivi jusqu'à sa cinquante et unième année, n'a cessé, rapporte le Kitâb al-akhbâr, de s'étendre. Il a pris le contrôle de sa propre tribu, recruté des disciples dans la quasi-totalité des tribus maures du Sahara occidental et noué des liens de patronage religieux avec la plupart des chefs guerriers influents dont bon nombre avaient, à en juger par les multiples correspondances rapportées par Hârûn, institué des dons réguliers en sa faveur. On recherchait sa baraka à des fins propitiatoires ou de protection. Son campement allait progressivement acquérir un statut de sanctuaire où les persécutés, les auteurs de règlements de compte redoutant des représailles, venaient se réfugier. Il développa dès le début de son installation dans la Gibla une activité "diplomatique" et de médiation au profit de toute sorte de protagonistes proches ou lointains, individus ou communautés que sa ténacité et sa parfaite connaissance des hommes de son temps lui permettaient bien souvent de conduire à des dénouements heureux. Ses services de médiateur et d'intercesseur allaient être de plus en plus recherchés au fur et à mesure de l'extension de son réseau de talâmîdh et des succès obtenus que la vox populi a vite fait d'attribuer à des pouvoirs surnaturels.
13
Voici, à titre d'exemple, comment Hârûn évoque la manière dont il est entré en
contact avec A'mar Wuld al-Mu khtâr, l'ancêtre de la seconde "dynastie" des émirs des Trârza.
"Al-Shaikh Sidiya entama ses contacts extérieurs, en s'adressant à l'amîr des Trârza
de son temps, A'mar b. al-Mukhtâr Bu-Ka'ba b. al -Sharqî b. A'li Shanzûra b. Haddi b. Ahmad b. Damân, le premier des amîr de la seconde branche, et le douzième dans l'ordre. Il le reçut avec magnificence ('azzama-hu ), lui donna des présents (ahdâ la-hu ) et s'imposa à lui-même et à tous ses successeurs à la tête de l'émirat un versement précis en sa faveur comme il lui établit une redevance (kharâj ) annuelle sur l'ensemble des tribus Trârza. J'évoquerai plus loin ces taxes dont la plupart ont, grâce à Dieu, survécu jusqu'à notre époque. Certaines sont mentionnées dans nos sources écrites. (…) A'mar b. al-Mukhtâr s'attacha à al-Shaikh Sidiya et lui dit : je m'engage (u'âhidu-k ) avec toi sur trois voeux. Si Dieu le Très Haut les exauce, moi et mes descendants après moi seront tes esclaves ('abîdu-k ) jusqu'a la fin des temps. Ces trois voeux sont : la mort de Muhammad b. A'li al-Kawrî b. A'mar b. al-Mukhtâr -qui n'a pas occupé la fonctions d'amîr mais exerçait une pression permanente contre l'autorité d' A'mar avec le soutien des Français- que le bateau (porteur de présents) pour l'amîr que les Français faisaient accoster de temps en temps reprenne ses visites interrompues depuis longtemps, que l'autorité d'amîr reste définitivement dans ma descendance à l'exclusion de celles de mes cousins (dûn furû' abnâ' 'ammî ). Dieu combla ses attentes sur l'ensemble de ces points."
Grande ou petite, les personnalités et les tribus citées dans le Kitâb al-akhbâr le sont
essentiellement pour souligner une intervention d'al-Shaikh Sidiya, sa noblesse de caractère, son humanité, sa générosité, sa sagesse, son pouvoir miraculeux. La volumineuse correspondance rapportée par Hârûn témoigne d'une activité inlassable en faveur de la justice (notamment la restitution des biens razziés…) et de la concorde entre musulmans. C'est quasiment l'ensemble de l'ouvrage qu'il faudrait citer pour illustrer cet aspect des choses.
L'évocation des individus qui entrent à quelque titre dans le récit de Hârûn donne
presque toujours lieu à des développements généalogiques plus ou moins sophistiqués. Identifier les individus pour l'auteur du Kitâb, c'est d'abord et avant tout les (re)placer dans des chaînes généalogiques, les rattacher à des réseaux d'ancêtres, de collatéraux, de descendants dont l'énumération peut s'étendre jusqu'à (ou remonter à partir de) la période actuelle. C'est le côté "fichier d'etat-civil" arabo-islamique du Kitâb.
La recherche de connexions généalogiques, appelée, en principe, dans le projet de
départ de Hârûn par le souci de situer "socialement" l'allégeance confrérique, le "lien religieux" comme il dit, ne cesse de déborder cette dernière au point de paraître quelques fois la justifier. On se prend alors à se demander si le nasab ne pèse pas finalement d'un poids plus grand que le lien de talmadha, supposé commander l'ensemble de l'édifice Hârûnien. A propos d'une lettre adressée à Sh. Sidiya par Mahand Bâba b. A'baid, célèbre juriste, grammairien et logicien de la tribu des Awlâd Daimân, sans doute considéré par Hârûn comme un pair de Sh. Sidiya, on voit l'auteur du Kitâb chercher dans la parentèle du prestigieux lettré daimânî des connexions généalogiques avec la tribu de son aïeul, pas tant pour expliquer une allégeance confrérique que pour tirer parti d'un nasab qui a lui-même d'excellentes lettres de noblesse "maraboutiques".
14
Auteur notamment d'un prestigieux commentaire du Mukhtasar de Khalîl b. Ishâq, Mahand Bâba (m. 1860) est également l'aieul d'un éminent collègue et ami de Hârûn, al-Mukhtâr Wuld Hâmidun (m. 1993), qui a engagé une entreprise de recherche dans le domaine historiographique et généalogique encore plus vaste que le travail entamé par Hârûn.
L'exercice entrepris par celui-ci autour des liens entre Sh. Sidiya et Mahand Bâba b.
A'baid le conduit à dégager plusieurs passerelles entre ses aieux, sa parentèle tribale, et divers réseaux de parenté centrés sur Mahand Bâba. Des liens à la fois culturels et religieux, mais aussi généalogiques. Un des fils de Mahand Bâba a célébré dans des vers connus la mémoire de Sh. Sidiya et de son fils Sîdna, son grand-père maternel a rendu un jugement favorable à leur tribu dans un conflit qui l'opposa à une autre tribu à la fin du 18e s., la mère du grand père maternel de Mahand Bâba -al-Mukhtâr b. at-Tâlib Ajwad- est la fille d'A'dajja b. Mrâbit Makka, aieul de Sh. Sidiya, etc…
Dans cette page du Kitâb qui fait apparaître l'imbrication du "lien religieux" et des
préoccupations généalogiques de Hârûn, page qui fournit en quelque sorte une réplique en miniature de son projet biographique sur son aïeul appliqué à Mahand Bâba, on voit apparaître le souci de précision chronologique qui constitue un autre élément majeur de l'apport documentaire proposé par l'ouvrage de Hârûn. En bien des endroits en effet, Kitâb al-akhbâr prend l'allure d'une chronique politico-militaire, d'une chronologie.
Par exemple,lorsque Hârûn, après avoir longuement évoqué le périple scolaire et
religieux de Sh. Sidiya al-Kabîr, entreprend de citer toutes les dates précises qu'il a pu recueillir relativement à ce périple. Cela commence ainsi :
"La première date sûre (târîkh muhaqqaq ) que nous avons rencontrée concernant
Sh. Sidiya al-Kabîr après le commencement de ses études est celle qui marque l'achèvement de la copie qu'il réalisa du Musâ'id d'Ibn 'Aqîl, commentaire de Tashîl al-fawâ'id d'Ibn Mâlik, le samedi 17 shawwâl 1219 / 19 Janvier 1805, la seconde est celle de la fin de la copie qu'il réalisa du commentaire de al-Maqsûr wa al-mamdûd d'Ibn Mâlik l'après midi du samedi 2 rabî' II 1220 / 30 Juin 1805…"
Cette énumération se poursuit sur plusieurs pages, évoquant en marge des dates de
réalisation des copies ou de transcription des correspondances, les événements auxquels ils se rattachent, des éléments de biographie des copistes, des considérations historico-généalogiques sur leur tribu…
Pour bon nombre des tribus évoquées -et il y en a pas mal !- Hârûn donne l'ordre de
succession dans les familles de chefferie, en mentionnant bien entendu les noms des chefs eux-mêmes. Les principaux événements qui ont trait à l'histoire polico-militaire de ces groupements sont également abordés de manière plus ou moins succincte. Les émirats (Trârza, Brâkna, Âdrâr, Tagânit…) font l'objet d'un "résumé" suivi d'une évocation plus dispersée, ajustée aux branches généalogiques et aux individus, sous l'angle de leurs rapports avec Sh. Sidiya. On trouve dans ces brèves chroniques des émirats un rappel précis et clair de leur histoire politique, une approche simplifiée et fort utile des liens généalogiques enchevêtrés qui existent entre les émirs successifs.
L'importance en nombre de ces balises généalogiques ou chronologiques n'enlève
rien au caractère essentiellement "généraliste" et éclaté de l'ouvrage de Hârûn. Il a beau fournir une quantité prodigieuse d'informations extrêmement précises, pour lesquelles l'auteur cherche -et trouve- toutes sortes de moyens de "validation" (archives écrites,
15
chaînes de témoins fiables, "traces" de relations anciennes dans celles d'aujourd'hui…), il ne peut s'empêcher de développer un réseau de bifurcations défiant toute cartographie.
Car l'ouvrage est aussi une sorte de chantier en cours que le lecteur est parfois invité
à visiter, pour lui faire voir, au fil des travaux, comment l'immense mausolée à la mémoire de Sh. Sidiya se construit. Il y a parfois des personnages insolites qui le parcourent comme cet "architecte" américain qui avait déjà sa petite idée sur les contours du monument et qui s'est trouvé projeté, en quelque sorte à son insu, et comme par une divine et étrange nécessité, à l'intérieur même de l'édifice qu'il se croyait en tain de construire. Voici le récit de sa merveilleuse aventure.
"Une chose des plus étonnantes (al-'ajâ'ib ) qui me soit arrivées au cour de ma
recherche est la suivante. Alors que je poursuivais la rédaction de ce que j'avais pu rassembler de l'histoire d'al-Shaikh Sidiya que je suis présentement en train d'écrire, je reçus, à Butilimît, le jeudi 4 Avril 1968, la visite d'un jeune homme de nationalité américaine, s'exprimant en anglais (inglîzî al-lugha ), Charles Stewart, porteur d'une lettre officielle de la Direction des Affaires Culturelles n°……, datée du 30 Mars 1968. Dans cette correspondance, le Directeur des Affaires culturelles informe que le porteur est officiellement autorisé à effectuer une recherche en vue d'une thèse de doctorat à l'Université d'Oxford, qui est une faculté (kulliya ) de haut niveau ('âliya ), du pays des Anglais, située dans les environs de Londres. L'intitulé de la thèse est le suivant : La vie d'al-Shaikh Sidiya al-Kabîr, son rôle de médiateur (islâhâtu-hu ), son rayonnement religieux (sîtu-hu al-dînî ) en Mauritanie, au Sénégal et au Mali. Le Directeur précité invite à l'aider autant que faire se peut.
Depuis que le jeune homme en question est arrivé, je lui ai passé un écrit que j'avais
rédigé et où j'avais colligé les titres des oeuvres d'al-Shaikh Sidiya et recensé ses ijâzât et ses lettres sur lesquelles j'avais pu mettre la main. Il n'a cessé de travailler avec acharnement (inkabba haqîqat al-inkibâb ) à acquérir ('alâ tahsîl ) ce qu'il pouvait acquérir sur tous ces sujets et à transcrire les noms des disciples connus (al-talâmîdh al-mashâhîr ), en les regroupant (murattiban lahum ) en fonction de leur appartenance tribale. Il se rendit à Tindawja pour voir la tombe d'al-Shaikh Sidiya qu'il prit en photographie, comme il photographia les tombes des personnes enterrées auprès de lui. Il interrogea à propos de tout ce qu'il était possible de connaître."
Je terminerai la présentation du Kitâb al-akhbâr sur cet épisode qui nous ramène,
par un jeu de miroir plus étrange peut-être que Hârûn ne l'imagine entre le "thésard" et son objet, vers la dimension anecdotique si essentielle à al-akhbâr.
Je ne vais pas pour autant lâcher le malheureux Stewart que je suis fortement tenté
d'enrôler pour essayer de conclure ma propre akhbâr. Dans une communication présentée en Mai 1991 à un colloque de la Canadian
African Studies Association, sous le titre "Notions of Self and Group Identity in a southern Saharan Biography : Hârûn b. Sidiya Bâba's Kitâb al-akhbâr", Charles Stewart souligne l'importance du facteur démographique dans l'amorce d'une auto-suffisance matrimoniale des Ahl al-Shaikh Sidiya qui ne serait pas étrangère à l'émergence d'une conscience identitaire propre à ce lignage. L'ouvrage de Hârûn dont le début de rédaction coïncide à peu près avec le moment où la majorité des descendants d'al-Shaikh Sidiya al-Kabîr commence à prendre un conjoint dans leur groupe, exprimerait une manière de prise de conscience, une affirmation d'une identité
16
propre à ce groupe. Charles Stewart ajoute également, entre autres observations intéressant mon propos, le souci chez l'auteur du Kitâb al-akhbâr, de (re)mettre les choses et les gens à leur place, dans un contexte politique où la famille Sh. Sidiya avait perdu, au profit d'un cousin au pedigree moins prestigieux (Mokhtar ould Daddah), sa prééminence.
Même si la première remarque ne s'applique guère à la génération de Hârûn, ni
surtout à Hârûn lui-même dont toutes les épouses sont extérieures à la descendance de Sh. Sidiya, elle me semble indiquer une direction de réflexion intéressante. L'accroissement démographique du groupe issu de Sh. Sidiya -il commençait à frôler le millier d'individus en 198315…- peut certainement avoir contribué à renforcer la conscience identitaire de se groupe. Je crois qu'il est aussi porteur d'une menace, celle de la dissolution ou de la perte de l'héritage charismatique, d'une "laicisation par pression démographique", pour employer la terminologie gellnerienne. Eriger un énorme monument hagiographique à la mémoire du père fondateur de leur capital charismatique pouvait sembler une manière de parer à l'érosion politico-démographique qui était en train de l'entamer. A cela s'ajoute que l'année 1946, que Hârûn situe au point de départ de son travail, est celle qui voit l'élection du premier député mauritanien à l'Assemblée Nationale française. Il s'agit de Hurma wuld Babâna, des Idawa'li, rival des Ahl Sh. Sidiyya. C'est aussi l'époque des premiers frémissements anti-coloniaux et des signes avant coureurs de la naissance du parti Nahda hostile à la présence française en Mauritanie, parti dont Hurma sera un des ténors après son échec électoral de 1951 face à une coalition animée par les Ahl al-Shaikh Sidiyya. Il n'était certainement pas inopportun de rappeler, dans un tel contexte, le rôle anté et anti-colonial de l'ancêtre de leur lignage, et d'insister sur la très large étendue de son influence à une époque très antérieure à l'occupation française de la Mauritanie. Je me demande aussi s'il n'y a pas eu, dans la nombreuse descendance de Bâba Wuld Shaikh, une sorte de partage des tâches (et de l'héritage paternel…) entre les "religieux traditionnels" (Ahmad, Ishâq…), les "politiques" ('Abd Allâh, Sulaimân…), les porteurs de baraka (Ya'qûb…) et les "lettrés" (Ismâ'îl, Hârûn…) où les spécialisations se seraient dessinées en fonction des tempéraments, des formations, des places disponibles dans ces différents champs…
Je crois enfin que dans l'entreprise de Hârûn, il y avait aussi un enjeu littéraire. C'est
le côté "bel esprit" du personnage, émule du Sh. Sidi MuÌammad des Tarâ'if et des grands compilateurs de la littérature arabe tels que l'auteur d'al-Aghâni.
15 Dʼaprès un relevé généalogique effectué par mes propres soins à cette date.
17
Références bibliographiques Abdel Wedoud Ould Cheikh, 1985 Nomadisme, islam et pouvoir politique dans la société maure
précoloniale, thèse pour le Doctorat, Univ. Paris V. Abdel Wedoud Ould Cheikh, 1991 "La tribu comme volonté et comme représentation", in P. Bonte, E. Conte, C. Hamès, A. W. Ould Cheikh, Al-Ansâb. La quête des
origines. Anthropologie historique de la tribu arabe. MSH, Paris Al-Mukhtâr W. Hâmidun, 1990 Îayât Muritânyâ, al-Dâr al-Maghribiya li-al-Kitâb, Tunis. Harry T. Norris, 1972 Saharan Myth and Saga, Clarendon Press, Oxford. Hârûn Wuld Sh. Sidiyya Kitâb al-akhbâr, manuscrit. Ulrich Rebstock, 1989 Sammlung arabischer Handscriften aus Mauretanien, Otto Harrassowitz,
Wiesbaden. Sid Ahmad b. al-Amîn al-Shinqîtî, 1989 Al-Wasît fî tarâjim udabâ' Shiqît, al-Khanji, Le Caire. Charles Stewart, 1969 "A New Document Concerning the Origins of the Awlad Ibiri and the
N'tishait", Bull. IFAN, Série B, XXXI (1969), pp. 309-19. Charles Stewart, 1970 "A New Source on the Book Market in Morocco and Islamic Scholarship
in West Africa", Hesperis-Tamuda, XI (1970), pp. 209-50 Charles Stewart, 1972 Islam and social order in Mauritania, OUP, London. Charles Stewart, 1991
18
Notions of Self and Group Identity in a southern Saharan Biography : Hârûn b. Sidiya Bâba's Kitâb al-akhbâr", ronéoté.
19
Références bibliographiques Abdel Wedoud OULD CHEIKH, 1985 Nomadisme, islam et pouvoir politique dans la société maure
précoloniale, thèse pour le Doctorat, Univ. Paris V. Abdel Wedoud OULD CHEIKH, 1991 "La tribu comme volonté et comme représentation", in P. Bonte, E. Conte, C. Hamès, A. W. Ould Cheikh, Al-Ansâb. La quête des
origines. Anthropologie historique de la tribu arabe. MSH, Paris Hârûn Wuld Sh. Sidiyya Kitâb al-akhbâr, manuscrit. Charles Stewart, 1972 Islam and social order in Mauritania, OUP, London. Abdel Wedoud Ould Cheikh .
20
Sommaire de 14 cahiers du Kitâb al-akhbâr De Hârûn Wuld ash-Shaikh Sidiyya CAHIER N° 1 Page @ Présentation de al-Shaikh Sidiyyâ al-Kabîr 1 @ Ses études 5 @ Les ijâzât (habilitations) qu'il a délivrées 5 @ Date de sa mort 7 @ Ses traits de caractére 7 @ Méthodologie de l'auteur 17 @ Présentation d'al-Mukhtâr Wuld al-Haiba 19 @ al-Shaikh Sidiyya avant son périple d'étude 22 @ Conseils que lui a donnés MuÌammad Mukhtâr 23 @ Comportement de Sh. Sidiyya chez son maître Îurma W. 'Abd al-Jalîl 24 @ Son comportement chez Ah$l Îabîb Allâh W. al-Qâ∂i 28 @ Son départ à Tishît 28 @ Histoire de Tishît 28 @ Son périple dans l'Azawâd 33 @ Divers poèmes qu'il a composés et dédiés à Ah$l al-Shaikh Sîd al-Mukhtâr 37 @ Présentation de Lâlla 'Â'isha mint Sîd al-Mukhtâr W. al-Amîn al-AÂrag 53 @ Présentation sommaire de al-Shaikh Sîd al-Mukhtâr 55 @ Les maîtres d'al-Shaikh Sîd al-Mukhtâr 57 @ Divers poémes dédiés à Ah$l al-Shaikh Sîd al-Mukhtâr 61 @ Les fils d'al-Shaikh Sîd al-Mukhtâr 73 @ Liens entre al-Shaikh Sidiyyâ et al-Shaikh Sîdi MuÌammad W.al-Shaikh Sîd al-Mukhtâr 82 @ Poémes dédiés aux Ah$l al-Shaikh Sîd al-Mukhtâr 83 @ Demande d'autorisation de rentrer dans son pays présentée par al-Shaikh Sidiyyâ à al-Shaikh Sîdi MuÌammad 89 @ Réponse de al-Shaikh Sîdi MuÌammad par son traité intitulé : Junnat al-murîd dûn al-marîd 92 @ Poèmes dédiés (suite) 99
21
CAHIER N°2. Page @ Education d'al-Bakkâi W. al-Shaikh Sîdi MuÌammad par Sh. Sidiyya 116 @ Poémes dédiés (suite) 116 @ Poéme dédié par al-Bakkâi à son père et faisant référence à Sh. Sidiyya 117 @ Poème-réponse de al-Shaikh Sîdi MuÌammad à son fils 117 @ Correspondances adressées par al-Bakkâi à Sh. Sidiyya 118 @ Poème adressé par al-Bakkâi à Sh. Sidiyya 119 @ Correspondances adressées par les talâmîdh de al-Shaikh Sîdi MuÌammad à Sh. Sidiyya 121 @ Poèmes dédiés par Sh. Sidiyya aux Ah$l al-Shaikh Sîd al-Mukhtâr 126 @ Présentation sommaire d'al-Shaikh Sîdi MuÌammad 138 @ Poème dédié par Sh. Sidiyya à la famille des Dan Fodio @ Présentation de cette famille 157 @ Correspondances adressées à cette famille par al-Shaikh Sîdi MuÌammad 165 @ Poèmes dédiés par Sh. Sidiyya aux Ah$l al-Shaikh Sîd al-Mukhtâr 166 @ Mort d'al-Shaikh Sîdi MuÌammad 196 @ Poème dédié par Sh. Sidiyya à la famille du défunt 201
22
CAHIER N°3. Page @ Quelques dates cernées du périple d'étude de Sh. Sidiyya 202 @ Présentation sommaire des Brâbish 207 @ Signification de l'impôt ghafr 207 @ Sh. Sidiyya après son retour dans son pays et sa tribu 218 @ Les compagnons revenus avec Sh. Sidiyya de l'Azawâd 220 @ Premiers contacts entre Sh. Sidiyya et les Awlâd Abyairi 4 @ Installation de Sh. Sidiyya 21 @ Ses premiers contacts extérieurs : @ Avec l'amîr des Trârza, A'mar W. al-Mukhtâr 26 @ Deux poèmes d'invocation de la pluie composés par Sh. Sidiyya @ Médiations intérieures aux Awlâd Abyairi entreprises par Sh. Sidiyya 46 @ Affaire des Idâbhum et correspondances à cet effet 47 @ Quelques éclairages sur le document connu sous le nom de : Wathîqat al-tafâsukh 51 @ A propos du document : généalogie des Awlâd Abyairi 52 @ Présentation de ∑âliÌ W. 'Abd al-Wahhâb 54 @ Nominations de représentants ayant pour mission de reprimer les injustices et les exactions 55 @ Codification des infractions pénales au sein de la tribu 56 @ Ce qu'il a écrit à propos d'al-mudârât (taxes…) 57 @ Correspondances adressées aux Awlâd Ntashây$t 57 @ Correspondances adressées à Sîd AÌmad W. MaÌÌam 64 @ Correspondances adressées aux Ah$l AÌmal-$l-√⬬i
23
CAHIER N°4. Page @ A propos des redevances (maghram ) supportées par les faibles 73 @ Correspondances relatives à Ah$l MaÌand Na¬¬a 75 @ Dont lettre de MaÌan∂ Bâba 78 @ Présentation de MaÌan∂ Bâba 79 @ Correspondances relatives à Ah$l MuÌammad @ Correspondances relatives à Idâdhas, Idâbhum et Ah$l Budda du Tagant 83 @ Lettre de Zaidân W. Abû Bakrin W. Îâmidtu au sujet de sa femme 85 @ Présentation des Ah$l MaÌam Tanâl (al-Wagfa) 93 @ Présentation des I©ai©ba 94 @ Lettre d'al-Ìisba (risâlat al-Ìisba ) 106 @ L'affaire des Tabait 108 @ Présentation des trois émirats du Brakna 117 @ Présentation des Awlâd ManÒûr 122 @ Présentation des Awlâd AÌmad 123 @ Présentation de l'émirat des Idaw'îsh 124 @ Affaire des Tabait (suite) 126 @ A propos de l'affaire de ar-Ragba (où les Français avaient attaqué un campement des Awlâd AÌmad où se trouvait Sh. Sidiyya) 141 @ Correspondances relatives à l'affaire de Tabait
24
CAHIER N°5. Page @ Correspondances de l'affaire Tabait (suite) @ Relations entre Sh. Sidiyya et les différentes composantes du Brakna : 174 @ - Avec Awlâd Nughmâsh 175 @ - Avec Awlâd AÌmad 180 @ - Avec al-MaÌÒar al-Shargî (correspondaces au sujet des noirs) 187 @ Généalogie de MuÌummadh$n ash-Shwâil 192 @ Poèmes de Sh. Sidiyya en invocation de la pluie 193 @ Quelques rachats de Ìurma effectués par Sh. Sidiyya 229 @ - Fa∂l A¬¬a 229 @ - AÌmad W. Abn$k 232 @ - MuÌammad W. al-Gâdûm 234 @ - al-Mukhtâr al-Îâk$m W. Naiffâ' @ - Ah$l 'Umar. @ Fatwâ de Sh. Sidiyya au sujet des affranchis et commentaire sur l'affranchissement 235 @ Fatwâ de Sh. Sidiyya au sujet du rachat des Îurma @ L'émirat des Awlâd AÌmad M$n Damân 245 @ Les Awlâd Damân 256 @ Correspondances adressées par Sh. Sidiyya aux Trârza 260
25
CAHIER N°6. Page @ Correspondances adressées aux Trârza (suite) @ Descendance de Sîdi W. MuÌamd L$Ìbîb 293 @ Relations entre Sh. Sidiyya et les Awlâd YaÌya b$n 'Uthmân 301 @ Affaire des Awlâd Abyairi avec Khâlid W. Îabîb A¬¬a W. Av$lwât W. Mawlûd W. Bârika¬¬a 311 @ Présentation sommaire des Ah$l Bârika¬¬a 322 @ Présentation sommaire des Ah$l al-Mubârak 331 @ Signification du nom des Tâshumsha 338 @ Présentation des composantes des Tâshumsha 338 @ - IdâÚfagha 338 @ - Awlâd Daiµân 341 @ - Sh. AÌmadu 347 @ - Poèmes que a lui dédiés Sh. Sidiyya 350 @ - MuÌummadh$n √âl W. Slaimân 363
26
CAHIER N°7. Page @ Awlâd Daiµân (suite) @ Extrait du poème de MuÌ. W. AÌmald W. Qutrub : Shâfiyyat aÒ-Òudûr 367 @ AÌmad W. al-'Âqil 371 @ Poèmes de condoléances que lui a adressés Sh. Sidiyya Bâba après le décés simultané de ses deux fils MuÌ. √âl et 'Abd Allah 373 @ Sh. AÌmal-$l-√⬬i 376 @ Poèmes que lui a adressés Sh. Sidiyya al-Kabîr 378 @ Les tribus ayant participé à Shurbubba 389 @ Poème de Sh Sâl$m W. Âbbûda dédié à Sh. Sidiyya al-Kabîr 390 @ Présentation des Ah$l Bû-l-Ghâli 395 @ Présentation des Idagbahanni 399 @ Présentation des Idawdâi 401 @ Présentation des Idaiqub 403 @ Présentation de Sh. MuÌammad √âl W. al-Khu 407 @ Présentation des Awlâd AÚfagha Îaiba¬¬a 409 @ 'Abd al-Wadûd W. N©ubnân et son poème dédié à Sh. Sidiyya 409 @ Présentation des Idawd$nyuqb 414 @ Sh. al-Amîn W. Îabîb A¬¬a 414 @ Sh. MuÌammad W. Abnu 'Umar 416 @ Présentation des I©akkû©i 418 @ al-Shaikh W. 'Aµµi 419 @ Sîdi W. AÌmad Mawlûd W. 'Ammi 419 @ Affaire de l'esclave des Tâggât @ Talâmîdh de Sh. Sidiyya issus des Tâggât 422 @ Lettre importante adressée par Sh. Sidiyya aux Tâggât 424 @ Fatwâ de Sh. Sidiyya au sujet de 'ilm al-hai'a 431 @ Correspondance adressée par Sh. Sidiyya aux Ah$l ∫âbiyya 433 @ Sh. AÌmad W. al-Mukhtâr W. Zwayyin 441 @ Ses poèmes adressés à Sh. Sidiyya 453
27
CAHIER N°8. Page @ Sh. AÌmad W. al-Mukhtâr W. Zwayyin (suite) @ Sh. al-Musta'în 465 @ Poème dédié par Sh. Sidiyya à AÌmad W. al-Mukhtâr W. Zwayyin 468 @ al-Amîn √âl W. al-Mukhtâr W. Zwayyin 469 @ Les Ah$l ∫âbiyya 476 @ MuÌamd Mbâr$k W. AÌmad Îabîb A¬¬a al-Lamtûnî, disciple de Sh. Sidiyya 477 @ Son ijâza et sa waÒiyya 487 @ Correspondances adressées par Sh. Sidiyya aux Tajakân$t au sujet de leur différent avec ar-Rgaibât à Tîndûf. @ Les Tajakân$t 501 @ al-Mukhtâr W. Bûna 501 @ Lettre de Sh. Sidiyya au sujet du différent entre Tajakân$t, Kunta et Idaw'îsh 512 @ Relations des Kunta avec Sh. Sidiyya 517 @ Complément de présentation des Ah$l Sh. Sîd al-Mukhtâr 519 @ Correspondances échangées entre Sh. Sidiyya al-Kabîr et les descendants de Sh. Sîd al-Mukhtâr al-Kuntî.
28
CAHIER N°9. Page @ Correspondance avec les descendants de Sh. Sîd al-Mukhtâr (suite) @ Fatwâ de Sh. Sidiyya al-Kabîr au sujet des chameaux des Ah$l Sh. Sîd al-Mukhtâr razziés par aÒ-∑kârna 563 @ Lettre de Sh. Sidiyya au chef des T$kna au sujet de ces chameaux 564 @ Présentation des descendants de Sh. Sîdi MuÌammad W. Sh. Sîd al-Mukhtâr (suite) @ Les Awlâd al-Wâfî (Kunta) 567 @ al-Óâµi W. MÌammad W. A'mar W. Bnayya (des Ah$l al-AÂrag) 571 @ Bunanna W. Sîd AÌmad W. √âl W. Gûya 589 @ Lettre que lui a adressée Sh. Sidiyya intitulée : KhalaÒ al-nafs min al-Ìabs 593 @ MuÌammad al-Amîn dit Sîdi Khûya (des Awlâd Sîdi Bubakkar) 596 @ MuÌammad W.AÌmad W. Nbusaif 602 @ Ses poèmes dédiés à Sh. Sidiyya al-Kabîr 602 @ Histoire des Ah$l Aidiâh 613 @ 'Abd al-Qâdir dit Âdubba 622 @ MuÌammad W. $©-¢a 636 @ al-Shaikh W. al-Amîn 637 @ MuÌammad W. al-Amîn W. at-™âlib A'mar 642 @ MÌammad W. AÌmad aÒ-∑aghîr 644
29
CAHIER N°10. Page @ MÌammad W. AÌmad aÒ-∑aghîr (suite) @ AÌmad W. al-Shaikh W. Jiddu 4 @ Stewart 31 @ Sîd al-Amîn W. ™wair al-Janna 33 @ Les IdawalÌâj 39 @ Îamdi W. Blûl 44 @ Voyage de Sh. Sidiyya al-Kabîr au Maroc 50 @ Les Awlâd Tîdrârîn 51 @ Présentation de la dynastie 'Alawite du Maroc 74
30
CAHIER N°11. Page @ Présentation de la dynastie 'Alawite du Maroc (suite). @ Liste des livres ramenés par Sh. Sidiyya al-Kabîr du Maroc 93 @ Le sharîf Sîd A'li W. Sîdi YaÌya 116 @ Son frère Sîdi L$Ìsan 123 @ L'histoire de Haµµad √âl W. MuÌummadh$n Bawbba avec la maladie de Sh. Sidiyya al-Kabîr lors de leur retour 124 @ Le sharîf Mawlâi Brâhîm W. Sîdi MuÌammad 125 @ Le sharîf de la Mecque 133 @ Le sharîf de at-™â'if 136 @ at-™âl$b AÌmad W. 'Abd al-Wahhâb (de al-Grainât) 137 @ Le sharîf al-Bashîr W. al-Îusain 160 @ Le sharîf al-Mu'taÒim 162 @ Le sharîf 'Abd al-Wahhâb 163 @ Le sharîf al-Fâ∂il 164 @ La sharîfa Lâlla bint Mawlâi b. MÌammad (dont le père enseigna le Coran à Sh. Sidiyya Bâba) 164 @ MuÌ. al-Îasan W. Sîdi 'Abd A¬¬a W. Sîdi al-Sayyid 166
31
CAHIER N°12. Page @ Commentaire du poème dédié par Sh. Sidi MuÌammad W.Sh. Sidiyya à MuÌamd al-Îasan W. 'Abd A¬¬a W. Sîdi as-Sayyid (suite) @ 'Abd Allâh W. AÌmad (des Ah$l Sîdi MuÌamd at-Tishîtî) 189 @ Le sharîf Bismillâh 194 @ Mawlâi MuÌammad W. Sîdi Brâhîm 195 @ Sîdi MuÌammad W. MuÌammad √âl W. Shrîvanna (des Ah$l 'Abd al-Mûmin) 199 @ Ses poèmes dédiés à Sh. Sidiyya @ Correspondances diverses dont les auteurs ne sont pas identifiés @ Poèmes adressés à Sh. Sidiyya par des auteurs non identifiés 248 @ Fatwâ de Sh. Sidiyya al-Kabîr au sujet de l'allaitement (ri∂â' ) 258 @ Fatwâ au sujet du mariage 268
32
CAHIER N°13. Page @ Fatwâ au sujet du mariage @ Fatwâ sur des sujets divers 278 @ Poèmes divers 282 @ Requêtes et réponses au sujet de charges tribales 290 @ Poèmes de Sh. Sidiyya 292 @ Au sujet de al-mudârât 292 @ al-Mukhtâr W. MuÌammad W. L$mÂaid$f 296 @ Poèmes de Sh. Sidiyya 300 @ al-Mukhtâr W. Îabîb A¬¬a 307 @ Poèmes que lui a dédiés Sh. Sidiyya 309 @ Lettre traitant de taÒawwuf 311 @ Sîdi MuÌammad al-Kuntî 317 @ A propos de Tinwâk 1 317 @ A propos de Tinwâk 2 317 @ MuÌammad W. al-'Izza 318 @ MuÌammad W. al-Muslim 319 @ A propos du wird 321 @ al-wird wa-l-talqîn wa -l-bai'a 322 @ al-istikhâra 331 @ Ce qu'a écrit Sh. Sîd al-Mukhtâr à propos de @ al-isnâd wa-l-bai'a wa-l-mashâikh wa anwâ'ihim 331 @ maqÒid al-Ìasbala 334 @ fî maqÒid al-istighfâr 334 @ fî maqÒid al-hailala 335 @ La notion de wird 338 @ Deux lettres de taÒawwuf dont une adressée à Îabîb A¬¬a W. Ntâr 340 @ 'Abd al-RaÌmân W. AÌmad al-∑aghîr 343 @ Lettre des Ah$l Sh. Sîd al-Mukhtâr adressée à Sh. Sidiyya @ Idabbnazâr 346 @ Lettre à 'Uthmân W. MuÌammad W. Brâhîm (au sujet du respect des ascendants) 347 @ Lettre à AÌmad W. Manni W. Brâhîm W. Abûbak (même sujet) 348 @ Lettre traitant de taÒawwuf 350 @ Lettre à at-™âlib AÌmad W. 'Abd al-Wahhâb 355 @ Lettre traitant de taÒawwuf 356 @ Lettre à ∫ayyâh (respect des ascendants) @ Lettres au sujet d'un différent entre époux 364 367 @ mâ yata'allaq bi-l-wird wa-l-Ìaqîqa wa-l-talqîn 371
33
CAHIER N°14. Page @ Lettre traitant de taÒawwuf 373 al-Ìa∂∂ 'alâ al-taqwâ wa-l-tawÌîd. @ A propos du Prophète (fatwâ ) 375 @. Fatwâ sur l'apostasie (al-ridda ) 388 @ Fatwâ en droit commercial sur la zakât 388 @ Différence entre al-faqîr wa-l-miskîn 420 @ Fatwâ sur la zakât du waqf 420 @ Fatwâ sur le jeûne (al-Òawm ) @ Fatwâ sur la prière et les ablutions (al-tahâra ) 421 @ Fatwâ sur al-Ìubs 428 @ Fatwâ sur le régime juridique des dons 447 @ Fatwâ sur le régime juridique de al-hadiyya @ A propos de nâzilat Ah$l ∑$llâÌi @ ∑$llâÌi et sa descendance 456 @ MuÌammad √âl W. Âbanna 464 @ Sh. 'Abd Allâh W. Îabba¬¬a W. MuÌummadh$n W. AÚfagha Awbak 464 @ Retour de Stewart 466