F. de Callataÿ, La date des premiers tétradrachmes de poids attique émis par Alexandre III le...
Transcript of F. de Callataÿ, La date des premiers tétradrachmes de poids attique émis par Alexandre III le...
UNIVERSITE CATHOLlQUE DE LOUVAINFACUL TE DE PHILOSOPHIE ET LETTRES
Institut Superieur d' Archeoloqie et d'Histoire de I'Art
NUMISMATIQUE D'ALEXANDRE IIILE GRAND
DEUX QUESTIONS
(Promoteur: T. Hackens) Memoire presents en vuede I'obtention du grade
de licencie en Archeoloqieet Histoire de I'Art (Antiquite)
par Francois de Callatay
Ctest un devoir et un plaisir dtex-primer notre reconnaissanc~ a notrepromoteur, Monsi~ur le ProfessEurHackens, dont les conseils et la dis-ponibilit~ jamais d~mentie ont pcrmisi ce m~moir0 de voir le jour.
Nous tenons ~galement a remercicrtous les Professeurs dont nous avonseu la chance de suivre les leyons.
TABLE DES MATIERES.
~E~~~~E~_E~E!~~:~~_~~!~_~~~_EE~~~~E~_!~!E~~E~~£~~~~~_E~~~~_~!!~S~~_~~~~_E~E_~~~~~~~E~III le Grand (p •.6-84).
1.Histoire d'une question.
2.Iconographie.
A.Le type du droit: Heracles.B.Le Type du revers: Zeus aetophore.
1.Phidias.2.Arcadie.3.Mazaios.
C.Debat entre ~W.Zervos et Price.1.Presentation.2.Commentaires.
D.Modeles adoptes.1.Mazaios.2.Arcadie.
a)Iconographie.b)Finalite.
E.Tetradrachmes de Tarse et d'Amphipolis.F.Destinataires potentiels.
3.Metrologie.
A.L'etalon attique.B.Le changement metrologique.
1.Position du probleme.2.Evolution metrologique au IVe~es.J.Motifs necessitant le changement.4.But vise par le changement.
C.La serie a l'aigle.
p.6-ll.
p.12-J5.
p.12.P .12.p.lJ.p.14.p.15.p.20.p.20.p.22.p.26.p.26.p.27.p.27.p.29.p.JO.p.3J.
p.36-44.
p.J6.p.J7.p.J7.p.38.p.39.p.40.p.4J.
4.Monnaies frappees entre JJ6 et JJJ av.J.C. p.45-70.
2.Calcul des coins de droit.a)Systeme E.T.Newell/
G.Le Rider.b)Systeme E.T.Newell/
G.Le Rider/M.J.Price.c)Proposition de solution.
C.La serie a l'aigle.D.Autres monnayages.
p.45.p.45.p.45.p.47.p.48.
A.Introduction.B.Les philippes II posthumes.
I.Etude de M.Le Rider.
p .51.
Annexes.
p.54.p.61.p. 62.p.66.
5.Sources ecrites. p.71-74•
A.Les sources epigraphiques.B.Les sources litteraires.
p.71.p , 72.
6.Circulation. p.75-81.
A.Tresors contenant des alexandres.B.Tresors ne contenant pas d'alexandre.
p.75.p.79.
7.Contexte historique. p , 82.
8.Conclusion de la premiere partie. p.8J-84.
(p.85-IJI).
1.Tresors d'alexandres. p.85-89.
C.Commentaires.
p.85.p.86.p.87.
A.Introduction.B.Recensement.
2.Tresors d~nt la repartition est connue.
A.Recensement.B.Comrnentaires.
J.L'argent.
A.Les tetradrachmes.1.Recensement.2.Cas speciaux.J.Commentaires.
a)Production.b)Dif'f'usion.c)Les ateliers.
4.Le tresor de Demanhur.a)Historique.b)Importance.c)Commentaire numismatique.
B.Les drachmes.1.Introduction.2.Recensement.J.Commentaires.4.Probleme.
a)Enonce.b)Hypothese de resolution.
C.L'argent: deux problemes.1.Les mines d'argent.2.L'importance des ateliers.
4.~.A.Recensement.B.Commentaires.
5.Conclusions de la seconde partie.
Conclusion.
p ,90-92.
p.90.p.90.
p.9J-12J.
p.93.p.93.p.93.p.95.p.96.
p.lOl.p.lOJ.p.l07.p.l07.p.l08.p.l08.p.113.p.113.p.113.p.llS.p.116.p.116.p.119.p.121.p.121.p.122.
p.124-129.
p.124.p.124.
p.130-131.
p.132-133.
Introduction.
"One fact that does emerge however,is that Alexander studies arebuilt on shifting sand, and nothingshould be taken at face value wi-thout careful checking and rechec-king of all relevant evidence"(l).
Le prestige exceptionnel qui entoure le person-nage d'Alexandre le Grand a, en numismatique commedans les autres disciplines, retenu tres tot l'at-tention des specialistes. Des le milieu du sieclepasse, les etudes consacrees A son monnayage se s~ntmul tipliees. L .:'-Iuller,J.P.Six, E.Babelon, F.Imhoof-Blumer, G.F.Hill, B.V.Head, E.T.Newell, S.P.Noe,A.R.Bellinger et H.Seyrig s~nt autant de grands nomsqui jalonnent l'historique des recherches.
Les savants, qui ont repris le flambeau, s~nteux-aussi d'importance: en font partie H.Thompson,G.K.Jenkins, G.Le Rider, }1.J.Price, N.~.Waggoner etO.H.Zervos.
Le nombre d'etudes et la qualite des savants mon-trent A la fois l'importance du sujet en m~me tempsque sa difficulte. 11 tient, pour l'ensemble de lanumismatique grecque, le role capital de point de re-pere autour duquel s'articulent bien d'autres mon-nayages. Les pieces frappees au nom d'Alexandre 111le Grand (voir planche 11) appartiennent aux quel-ques rares monnaies de cette epoque, d~nt l'anneed'emission peut etre dans certains cas determineeavec exactitude.
11 faut toutefois preciser que la plupart destresors contenant des pieces d'Alexandre s~nt large-ment posthumes. Seule une infime minorite re1eve duvivant du conquerant (336-323 av.J.C).
(1) N.J.Price,On Attributing A1exanders- Some Cautiona-ry Tales, (GNA),1'ietteren,1979, P .246.
-1-
Il s'est, dans un premier temps, agi d'attribuerune date et un lieu de frappe a ces pieces qui e-taient decouvertes en quantite enorme de l'Espagneau Pakistan (2).
Des 1855, L.r.:ulleravait dr-e sse un catalogue detoutes les varietes connues (3). Dans cet ouvrage,qui reste une reference necessaire, le numismate da-nois a tente d'attribuer chaque variete a un atelierdetermine. Sa methode, qui se fiait trop exclusive-ment aux symboles et monogrammes des revers, a de-puis fait faillite. On a pu montrer de maniere irre-futable que des pieces, ayant des droits identiques,differaient parfois par les revers.
Le reamenagement des emissions que cette constata-tion entrainait a ete surtout l'oeuvre d'un homme:E.T.New eLl, ; Nous lui devons une sor-Le de monogra-phies d'ateliers (Salamine, Citium, Faphos, Amathon-te, Sidon, Ake, Tarse, Hyriandros, Tyr et "Sicyone")ainsi que l'etude de certains tresors d~nt celui -primordial- de Demanhur. Ses travaux, pris dans leurensemble, forment de nos jours l'essentiel de nosconnaissances sur le sujet.
Sa generosite a aussi permis a l'American Numis-matic Society de posseder a l'heure actuelle plus de10.000 pieces ou moulages de pieces d'Alexandre leGrand, faisant de cette institution le lieu de tra-vail presqu'oblige de toute etude de detail.
C'est, de fait, l'ecole americaine -et ~;.Thompsonen particulier- qui a poursuivi l'oeuvre inacheveelaissee par E.T.Newell.
Associee a A.R.Bellinger, H.Thompson a publie unimportant memoire sur les drachmes (4) avant de con-
(2) Voir IGCH,no2J19 et 2J20 pour l'Espagne; n018]1pour le Pakistan. Rien clue 1 'lQ.Q1:! recense 379 tre-sors contenant des pieces au nom d'Alexandre,c'est-a-dire plus que n'importe quel monnayage decite (Athenes: 270 tresors) et, a fortiori, de roi(Lysimaque: 156 tresors/ Philippe II: 143 tresors).
-2-
fier a ses etudiants le soin d'examiner certains a-teliers d'Alexandre III le Grand, comme Babylone ouAlexandrie, qui n'avaient pas encore fait l'objetd'une etude specifique.
Malgre certaines lacunes (5), un premier objec-tif parait donc aujourd'hui en passe d'etre atteint:attribuer un lieu et une date d'emission a chaque
Travailler dans cette optique revenait a etablirles sequences de coins pour un atelier precis. Il nenous etait pas possible, dans le cadre d'un memoire,d'atteindre a l'exhaustivite requise pour une telleentreprise.
En r-e v ari c-re , l'interpretation des do n n e e s numis-matiques a souvent ete negligee. Il n'existe qu'unseul ouvrage -capital, il est vrai- qui ait tente deles inserer dans une vision plus large: l'etude deA.R.Bellinger (Essays on the Coinage of Alexanderthe Great,(li§ ,11h1963).
M.Price a ecrit il y a quelques annees: "Thereis much to be done in detail which will turn thecoins from being numismatic catalopue numbers intodocuments of economic, h i st or-d.c and artistic impor-tance"(6).
(3) L.Mfiller,Numismatique d'Alexandre le Grand (suivied'un appendice contenant les monnaies de FhilippeII et III),Copenhague,1855.
(4) ?·,.Thompsonet A.~.Bellinger,A I10ard of AlexanderDrachms,dans .I£.§.,XIV,1955,p.3-45.
(5) L'atelier de Damas, par exemple, n'a jamais 6te etu-die en detail.
( 6 ) ~,.J.Price,In Search of Alexander the Great,dans, ~N~o~joJ._'_<1'~~~~_'_'_K_.lX...;..~_o_V_\_~_.I. , n ? 5 - 6 , 1978 , p •34 •
-3-
Nos recherches, menees au debut dans diverses di-rections (I'."etrologie,importance des sources, •••), ses~nt centrees autour de deux problemes susceptiblesde recevoir un developpement original: la date despremiers tetradrachmes de poids attique emis par A-lexandre le Grand et la circulation monetaire auIVe~esiec1e d'apres les tresors.
Le memoire est consacre a ces deux questions. Uncaractere commun les unit: la nouveaute du point devue.
La difference tient en ce que la premiere partieest une prise de position -peut-etre originale- dansun debat recemment reactive alors que la seconde ap-parait cornreune premiere etape dans la connaissanced'un domaine jusqu'ici inexplore.
Le probleme traite dans la premiere partie est deceux qui s'irposent: quand Alexandre le Grand a-t-ilcommence a emettre ses monnaies d'argent? Questionfondamenta1e aui, curieusement, n'avait jamais etevraiment debattue (7). I1 se fait que, parallelementa nos recherches, deux numismates -E" .Zervos et Pri-ce- ont tout recemment tente d'y repondre (8). Lesarguments'u'ils utilisent recoupent en partie ceuxque nous avions developpeSlors d'une communicationa la Societe Royale de Numismatiaue de Bel~ique (Se-ance du 18 decembre 1982). La pertinence de notreargumentation s'est donc trouvee renforcee dans lememe temps que s'evanouissait pour une part sa pri-maute.
Certains elements, toutefois, n'ont pas ete utili-ses par :-:H.Zervoset Price. Ils cornpLe t ent et justi-fient le traitement d'un probleme plus que jamaisd'actualite.
Les explications, donnees a ce sujet par E.T.Newell,res tent tres somraires (Reattribution,p.118-121).
(8 ) The Earliest Coins of Alexander the Great,dans NC,
142,1982 (O.H.Zervos,l.Notes on a Book by GerhardK1einer,p.166-179,pl.4J-4S et N.J.Price,2.Alexander'sReform of the ~'~acedonianRegal Coinage, p .180-190,pL,
h6-47 -4-
La seconde partie est toute autre. Personne ne s'e-tait jamais penche sur la circulation monetaire des
, , f ou i IVemealexandres attestee par les tresors en OU1S au -siecle. Notre travail entend faire l'examen statis-tique de ces donnees, telles que nous les trouvonsdans l'Inventory of Greek Coin Hoards ou les CoinHoards (9) qui lui font suite.
Les deux parties de notre menoire ont procede demanieres differentes.
La premiere a ete un cheminement visant, au de-part d'une argumentation assez large, a etablir lebien-fonde d'une hypothese unique. C'est un parcoursqui va du particulier au general, ou les acauis ob-tenus en cours de route sont reunis en faisceau con-vergent.
La seconde est con~ue de maniere inverse. Noussommes partis d'un probleme general: la circulationdes pieces frappees sous Alexandre. Le developpe-ment de celui-ci nous a amenea delimiter nos sour-ces d'abord, avant de faire des constatations, deformuler des hypotheses, aui sont autant de poin~dedepart pour des recherches futures.
(9) L'etude reprend les Coin Hoards I,II,III,IV,V et VI.
-5-
1. Histoire d'une question.
Nous nous proposons de traiter dans cette pre-miere partie un point tres discute de la numisma-tique d'Alexandre le Grand: la date de ses premie-res emissions de tetradrachmes de poids attique.
Cette date fait effectivement probleme: pourcertains, il faut faire debuter la frappe des nou-veaux tetradrachmes apres le passage d'Alexandreen Asie, c'est-a-dire au plus tot en 334 av.J.C.;pour d'autres (ils s~nt aujourd'hui majoritaires),Alexandre a du battre monnaie des 336 a ses pro-pres types. Le plus souvent m~me le proble~e aete passe sous silence.
Tout recemment, le debat a ete reouvert dansle Numismatic Chronicle de 1982. O.B.Zervos a vou-lu montrer, par des arguments plus rigoureux queceux que l'on pretendait tirer de la psychologiedu conquerant, que les premiers tetradrac~mes depoids attique avaient ete frappes a Tarse en 333av.J.C.(l). Dans sa reponse a M.Zervos, ~.Pricecontinue d'~tre partisan de la datation haute (2).
La question est entree dans sa phase critique.Le probleme semble mur, m~me si nous ne posse-dons toujours pas de monographies pour les ate-liers macedoniens (3).
(1) O.H.Zervos,Notes on a Book by Gerhard Kleiner.
(2) M.J.Price,Alexander's Reform of the ~'acedonian Re-gal Coinage.
(3) M.Thompson a distribue ces derniers temps a ses etu-diants une serie d'ateliers d'Alexandre pour etude(N.~.•Waggoner: Babylone/ O.E.Zervos: Alexandrie).M.Hackens nous a signale qu'une autre elbve de l'!-merican Numismatic Society a entrepris une monogra-phie sur Amphipolis.
-6-
Sans entrer dans les details, nous donnons iciun bref historique de l'evolution des opinions.
En 1831, E.M.Cousinery s'expri~ait dans ces ter-mes: "Nous ne pouvons nous refuser a croire qu'enentrant dans l'Asie, il(Alexandre) se soit bornea mettre en emission la mannaie de son pere dansles trois metaux"(4). M~me si L.MGller rejetacette vision, lui preferant la date de 336 ay.J.C.(S), il semble bien qu'au debut de ce siecle,les numismates aient prefere la premiere rryp othsse .
G.F.Hill ecrit en 1906: "It is generally sup-posed that the huge currency most commonly associa-ted with the name of Alexander the Great was notissued until his invasion of Asia"(6). Et B.V.Head de rencherir: "It was doubtless after hisinvasion of Asia that Alexander instituted hisvast international currency"(7).
Il aura fallu l'intervention de E.T.Newell pourfaire basculer la presomption en vigueur. Des sapremiere grande etude (8), il envisage le proble-me des premiers alexandres et combat la visionselon laquelle Alexandre le Grand aurait ete tropfaible en 336 av.J.C. pour pouvoir imposer sonnouveau monnayage. Il met en lumi~re la similitudede symboles entre les derniers philippes et lespremiers alexandres (Planche XVII,1-2), ce qui te-moigne a l'evidence d'une continuite. Il justifie
(4) E.M.Cousinery,Voyages dans la hacedoine,Paris,1831,p.230-23l.
(S) L.HGller,Numismatique d'.:\.lexandrele Grand (suivied'un appenrlice contenant les monnaies de PhilippeII et III),Copenhague,18SS.
(6) G.F.Hill,Historical Greek COins,Londres,1906,p.l04.
(7) B.V.Head,Historia Numorum (A f.'Ianualof Greek Numds-.matics),2e~eed.,Oxford,19ll,p.22S.
(8) E.T.Newell,Reattribution,p.118-l21.
-7-
le changement ponderal (Thraco-macedonienjatti-que) en pretendant qu'il s'agit la de l'accomplis-sement d'un plan dont Philippe 11 avait deja eul'idee. 11 conclut par cette phrase: "Of all thisthere is natural Iv no actual proof; as outlined,it is merely a suggestion to explain certain facts,and is only intended as such"(9).
Cinq ans plus tard, E.T.Newell ecrit: "Even so,it seems but natural that he would issue coinsbearing his own name and types to take the place,as soon as possible, of a coinage belonging to afast vanishing dynasty and empire"(lO).
Quoique n'ayant jamais justifie cette intuitionde maniere detaillee, le savant americain jouis-sait d'un credit tel que tout le monde, ~ sa sui-te, reprit son opinion.
Se demarquant resolument de l'orthodoxie nou-velle fixee par E.T.Newell, G.Kleiner entreprit,en 1947, de reconsiderer tout le probleme (11).Sa these principale etait qu'Alexandre le Granda inaugure le monnayage a ses types lors des fetesde Tyr en 331 av.J.C.(12). G.Eleiner, qui envisa-geait aussi bien l'or que l'argent, developpa uneargumentation tres riche d~nt les elements -belas-etaient loin d'avoir tous la meme force.
Sa theorie, quoiqu'ingenieuse, ne fut pas sui-
(9) Idem,p.12l.
(10) E.T.Newell,The Dated Alexander Coinage of Sidon and~,(Yale Oriental Studies: Researches 11),1916,p.22.
(11) G.Kleiner,Alexanders Reichsmfinzen,(Abhandlungender Deutschen Akari~mie der Wissenscnaft zu Berlin,phil.-hist.Klasse,1947,noS),Berlin,lg49.
(12) 0.P.Zervos,2.E,.ill,.,p.166.
-8-
vie. On lui reprocha surtout certains details re-latifs aux stateres d'or (13).
Nous reviendrons plus loin sur les argumentset les sources utilises par G.Kleiner; il est in-teressant d'observer des maintenant que ses ad-versaires ont trouve un appui tres important dansun ~: il s'agit de deux tetradrachmes de Pto-l' 'Ier ( , I I 'emee Soter Alexandre coiffe dune peau d e-lephant/Athena Alkider.los)port ant les inscriptionsL I et X, soi tIes ini tiales de Sidon et la datede l'ere locale (X= an 22)(Voir planche III,2).L'histoire nous apprend que Ptolemee tint la villea trois reprises: entre 320 et 319 av.J.C., aumilieu de 315 et quelques mois en 312 av.J.C. Sion resume les analyses de I.L.i"erker (14) et O.l-.
Zervos (15), on s'aper<;:oitque le seul monent pos-sible correspond a 312 av.J.C., ce qui rejette,selon I.L.Merker, l'an 1 de l'ere sidonienne en333-JJ2 av.J.C.(Voir planche III,I).
Voila donc fixes les deux termini de notre re-cherche. Postquem: l'accession d'Alexandre au tra-ne en JJ6 et antec,uem: l'an I a Sidon, c'est-a-dire JJJ/2 av.J.C.
La theorie de GQKleiner ecartee, fallait-ilne cessairemen t en revenir a E.T.Nevr eLk , co.zrn e lefait G.Le Rider (16)?
(13) Voir, par exemple, Ch.Seltman (Alexander Coins:Gerhard Kleiner,Alexanders Reichsmunzen,dans CR,64,n02,septembre 1950,p.66-67) ou G.Le Rider (.\nnuaire1968/69 (Extraits des rapports sur les conferences.Numismatique grecaue),dans AEPHE,1969,p.173-176).
(14) I.L.~·.erker,Noteson AbdalonYlTIOSand the Dated Alex-ander Coinage of Sidon and Ake,dans ANS~N,11,1964,p.lJ-20.
(15) O.I~.Zervos,Tl"'eearly Tetradrach.~s of TtolePlY I,c~ansANS:·:·,13,lS67,p.I-16.
-9-
Il semble que non. S.Hurter datait, en 1978,les premieres emissions de stateres d'Alexandre de333 a Tarse (17). Elle n'a cependant pas donne lesraisons Qui lui permirent de le penser.
Un historien a meme recemment anticipe les re-cherches actuelles en soutenant qu'Alexandre leGrand n'avait pas frappe ses tetradrachmes avantl'hiver 333/2 (18).
Nous nous sommes interesse au probleme pour no-tre part depuis les premiers mois de l'annee 1982.Ebauchees des Paques, nos recherches donnerentlieu, le 18 decembre 1982, a une communication luedevant la Societe Royale de Numismatique de Bel-gique (19).
Le hasard a voulu qu'au cours de cette meme an-nee deux numismates aient egalement diriges leursefforts en ce sens.
Le ~ruit de leurs travaux a ete publie dans larevue Numismatic Chronicle (1982), sous for~e dedebate
O.H.Zervos, reexLumant la theorie de G.Kleiner,
(16) Voir toute son oeuvre et, par exemple: La date despremieres monnaies d'Alexandre,dans ~,vol.8,no4,1971,p.65-66.
(17) S.Purter,Alexander the Great. A l-umismatic Itinera-ry,dans N()tA'(/"j..4_~lk$ )(pOlllw...f. ,no5-6,1978,p.35.
(18) "But the great change came about after the victoryat Issus. Then, in the winter of 333-332 B.C., heobtained a hu~e amount of Persian bullion and bothgold ans silver coin in Cilicia and at Damascus •••He began now to make coinage in his own name".(N.G.L.Hammond,Alexander the Great, Kin~, Commander andStatesman, Park Ridge ,1980,p.156).
(19) Nous i~norions alors que deux articles etaient enpreparation sur le sujet. Le texte de cette commu-nication forme toujours la base de notre etude maisil a ete totalement remanie a la lumiere de cesnouvelles donnees.
-10-
propose, avec des arguments icono~raphiques sur-tout, d'abaisser la date des premiers tetradra-chmes a JJJ av.J.C., soit Lrnme dLat erne nt apr-e s lavictoire d'1ssos (20).
Quant a H.J.Price, son propos est de montrerque les arguments avances par O.E.Zervos ne s~ntpas definitivement probants: dans ces conditions,il demande de ne pas abandonner l'hypothese deE.T.Ne'.•..ell (21).
Toutefois, i>l.J.Price ecri t lui-meme: " •••1write thi~ 'reply' not in order to defend the sta-tus quo as a matter of principle, hut wit~ a con-viction that open discussion of differing viewsmay ultimately lead to a solution"(22).
11 faut donc envisager cette premiere partiecomme un bilan des arguments souhaites par les au-teurs du d~bat. Ce bilan est fonde sur un examendes differents aspects du probleme, traitant suc-cessivement l'iconographie, la metrologie, lesmonnaies frappees entre JJ6 et JJJ av.J.C., lessources ecrites et la circulation telle que nousla trouvons dans les tresors pour terminer par lecontexte historique de ces premieres annees.
(20) O.H.Zervos,Notes on a Book by Gerhard Kleiner.
(21) j\I.J •Pri ce ,.£E. cit.
(22) 1dem,p.180,note 1.
-11-
2. Iconographie.
Les types figurant sur les tetradrachmes d'A-lexandre III le Grand s~nt, au droit, la tete d'He-racles coiffeede la peau du lion et, au revers,Zeus assis sur un trane tenant un sceptre dans lamain gauche et un aigle dans la main droite (Plan-che IV,4).
A.Le type du droit: Heracles.
La tete d'Heracles coiffee de la peau de lionest un type m o n e t a i r-e courant en i-ra c e do Ln e • .2lleapparait, avant Alexandre Ill, sur les piecesd'Archelaos Ier (41J-J99 av.J.C.), Amyntas III(J89-J8J et J8l-J69/Planche IV,l), Perdiccas III(J64-JS9/Planche IV,2) et Philippe 11 (359-3J6/Planche IV,J)(l).
Cette iconographie est ne reference directe~ la legende nui fait descendre la ~aison mace-donienne d'Heracles lui-meme par la filiation deTemenos d'Argos. Nous verrons comment, par lasuite, cette representation du droit doit inter-venir dans la question debattue.
B.Le type du revers: Zeus aetophore.
Le type du revers, en revanche, fait probleme.11 s'agit d'une repr~sentation neuve en hacedoi-ne. On a des lors cherche le modele qui l'auraitinspiree. 11 n'y a, semble-t-il, que trois possi-bilites: la statue de rhidias ~ Olympie, le mon-nayage de la Li,o~uearcadienne au Ve~e si.ecle oucelui du satrape Mazaios ~ Tarse (2).
(1) Voir A.R.Bellinger,Essays on the Coinage of Alexan-der tr.eGreat,(~ ,1~,196J,p.1J-14.
(2) On a pu parler aussi de ~eus de Bottiaea. E.T.Ne-
-12-
Dans un premier temps, la statue chrysele-phantine de Phidias a ete retenue comme la sour-ce la plus probable (Planche V,l). P.Gardner,Ch.Seltrnan et m~me E.T.Newell ont tous identi-fie Zeus Olympien (3).
A.B.Cook, le pr8mier, mit en evidence lesdifferences essentielles entre ce que nous sa-vons du Zeus de Phidias et celui aui est repre-sente sur les nouveaux tetradrachmes (4): lastatue d'Olympie tient une Nike dans la maindroite, la main gauche est posee bas sur lesceptre, la jambe gaucre est avancee par rap-port ~ la droite, le trane a un dossier et l'hi-mation remonte assez haut. Sur les monnaies enargent d'Alexandre,rien de tout cela: la maindroite porte un aigle, la main gauche est poseehaut sur le sceptre, c'est la jambe droite quiest en avant, le trane n'a -au debut du moins-
well lui-meme a repris au debut cette appellation(Reattribution,p.119) se fiant a J.Eckhel (DoctrinaNumorun Veterum,Partie I,vol.II,Vienne,18J9,p.100).Cette vue est aujourd'hui abandonnee. Ch.Seltmana suggere, pour sa part, de chercher le prototypea Praisos en Crete (Alexander Coins: Gerhard Kleiner,Alexanders Reichsmunzen,dans CR,64,no2,septembre1950,p.66-67). Cet atelier a effectivement frappedes pibces representant un Zeus tres proche de ce-lui des tetradrachmes d'Alexandre (Planche XI,l). Cerapprochement n'a plus jamais ete evoque depuis queles pieces de Praisos s~nt reputees dater dlapres325 av.J.C.
(3) P.Gardner,A Historv of \.ncientCoinae;e.700-300 BC.,Oxford,19l8,p.426.Cb ,Seltman, Greel: Coins, Londres, 1936, p .205.E.T.Newell,Roval Greek Portrait Coins,~ew York,1937,p.13.
(L~) A. B.Co ok,Zeus, Cambridge, vol. II, 19l4-1S'40,p .187.
-13-
pas de dossier et l'himation s'arr~te ~ la tail-le.
Depuis A.B.Cook, on ne pense plus qu'Alexan-dre ait repris le type de Phidias m~me si celui-ci se serait insere harmonieusement dans la vi-see panhellenique qulon prete au conquerant. P.Gardner, entre autres, a tempere son affirmation:1IThe Zeus of Alexander's coins is certainly notan imitation in any close sense of the greatOlympian statue of Pheidias, but the type isprobably introduced in honor of the God represen-ted by that statue"(S). G.Le Rider ecrit: "Enrevanche, Athena et Zeus aetophore s~nt des ty-pes nouveaux en ~acedoine: il est visible qu'~-lexandre a voulu placer sur son monnayage d'oret d'argent des divinites panhelleniques, E~ra-cles etant lui aussi honors dans tout le mondegrec" (6)•
11 faut cependant preciser que le style d'A-lexandrie (Jambes croisses: planche V111,4) serev~le beaucoup plus proche du mod~le de Phi-dias que le premier style (Planche V11I,6), ap-peLe souvent "cilicien" (Jar-tbespar-aLl.e Le s J ;
2)A.rcadie.
~ontrastant avec les differences enum~reesci-dessus, le vieux monnayage de la Li~ue arca-dienne (Planche v,2-6) offre un type de Zeusdans une attitude tr~s semblable ~ celle duZeus des monnaies d'Alexandre (Tout~s celles e-noncees plus haut, excepte la position des jam-bes la plupart du temps)(7).
(S) P.Gardner,The Types of Greek COins,Cambridge,1883,p.186.
(6) G.Le Rider,Annuaire 1968/69 (Extraits des rapportssur les conferences. Numisma tiQue ("j-recque),dansAEPHE,196g,p.17J.
(7) R.T.\Villiams,The Confederate Coinage 01 t:reArca-dians in the Fifth Centur r B.C., (~ ,nOlss),196S,p.1-141,pl.1-XV. -14-
Seul parallele evident sur le territoiregrec, A.B.Cook proposa de le retenir comme ori-gine la plus vraisemblable au nouveau type d'A-lexandre (S). Toutefois, il jeta l'embarras enposant une question a laquelle il ne repond pas:"1vhydid he (Alexandre) select for his world-wide coinage the old-bearer of Arkadia ratherthan the newer and nobler creation of Pheidias"(9)? C'est la grande faiblesse du modele arca-dien: l'absence de motifs serieux pour le choixopere par Alexandre.
Nonobstant cette remarque, A·R.Bellinger, re-prenant A.B.Cook, parle de Zeus Lykaios (c'est-a-dire du type arcadien)(lO) et S.Ferlman, deuxans plus t ar-d, declare: "The figure of Zeus, ••.,is clearly identical w i,th the figure of Zeusappearing on .ir-cad i.a.n s coins" (11) •
T'o u t recemment, R.R.IIollo\-lays 'est propose dereprendre le parallele arcadien en vue de l'in-terpreter (12): "I believe that Alexander hadlittle reason to evo~e the Arkadian League. Buthis artists, w i 'th Thermopylae and Plataea inmind, did have a reason to recall an image ofearly fifth-century type"(13). Il s'agirnit doncde rappeler par une representation archaigueles victoires acquises naguere sur les Perses.
Il existe un troisieme modele bien connu detous: le monnayag-e du satrape Hazaios a Tarse
(S) A.B.Cook,.2.l?.ill..,p.760-762.
(9) Ibidem.
(10) A.R.Bellineer,.2.l?.£i!.,p.22-23.
(11) S.Perlman,The Coinages of Philipp II and Alexanderthe Great and their Panhellenic Propaganda,dans ~,
erne 96- 637 - ser.,vol.5,1 ),p. •
(12) R.R.Ho110way,A1exander the Great's Choice of CoinTypes,dans AIIN,27-2S,19S1,p.57-60.
-15-
(Planche VI). Aucune etude serieuse de la nu-mismatique d'Alexandre le Grand ne peut en fai-re l'economie depuis que J.P.Six a fait remar-quer, au si~cle passe dej~, une ressemblance tr~sfrappante: "Les premi~res monnaies d'.Alexandrefrappees en Asie font immediatement suites ~celles de r.lazaios"(14)et "l~ donc ou finis-sent les emissions de r<azaios c ommencent cellesd'Alexandre~ Il.n'y a pas de lacune apparente"(15).
E.T.Newell a repris ~ son compte cette ideeen precisant les similitudes: "Here it will besufficient to state that in every det~il, suchfor instance as the throne, t}e footstool, therobes of the seated God,etc •••,the Alexander is-sues are the direct copies of the coins of Se-ries VI, tr.elast of Hazaios'Tarsian coinages"(16), avant de renforcer la comparaison en ecri-vant: "He evidently continued to employ the die-cutters and other personnel of the old esta-blishment"(17). E.T.Newell resume ailleurs lasituation par ces deux phrases: "It is interes-ting to note in how many instances th~ customsand peculiarities of a local coinage will reap-pear on the succeeding issues of Alexander forthe same district. This shows clearly how thepersonnel, appliances and traditions of a mintwere all retained for the production of the newcoin"(18).
(lJ)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Idem,p.S8-59.
J P S· L ~ t ., vc J~me, 1 4•• lX, e ~a rape. azalos,aans L-' - ser.,vo • ,l884,p.lCl.
Idem,p.lC2.
E.T.Newell,:yriandros,p.15.
Idem,p.29.
E.T.Newell,Tarsos,p.8J.
-16-
Tout se passe comme si, apres avoir fournitaus les ~l~ments, E.T.Newell h~sitait ~ en ti-rer les conclusions, ~ franchir le pas d~cisif.
Jusqu'il y a peu, la question ne fut plus ja-mais pos~e de maniere aussi claire et A.R.Bel-linger se contente de noter avec prudence: "Indiscussing the Alexander coinage of Tarsus and:'yriandrus Newell shows how directly it w as ba-sed on the coinage of the Persian satrap :a-zaeus which preceded it"(19).
Le m~me A.R.Bellinger ~touffe en fait le pro-bleme en le confinant au bas d'une page, en note92 de son ~tude: "Seltman had sugzested to himthat tre model mi.c;"tbe the Baal of Tarsos andits selection an instance of Alexander's inter-nationalism. But, as Cook recognizes (20), trisconflicts with the dating of the first: acedo-nian issues, a ouestion that has already beendiscussed"(21).
Voil~ enfin l'essentiel: reconnaitre qu'Alex-andre ait repris son type ~ I,azaios, c'est ad-mettre virtuellement que les nouveaux t~tra-drachmes ne furent pas frapp~s avant 3JJ av.J.C.(22), ce qui semble hautement improbable auxyeux des "panhellenistes". M.Le Rider reprend lavision de ces derniers Cjuand il ecrit: "11 estcertes possible au'Alexandre ait attendu quel-oues temps avant de battre monnaie, mais, sil'on tient compte de son temperament et du rolenon seulement economioue, mais aussi politioue(prestiee et propaeande) de la monnaie, on necroira pas que ce delai ait pu ~tre hien long.
(19) A.R.Bellinger,QE.~it.,p.lO.
(20) A.B.Cook,22.cit,p.762,no2.
(21) A.R.Bellinger,QE.£i!.,p.lO.
(22) h.Zervos comme ~,;.Pricel'ont reconnu: "Ne Lt her- I
par Zervos would consider it possible that ~lexan-
-17-
Le caract~re panhell~nique des types slexpliquepar le fait 0.u'Alexandre s'est consid~r~ d~s led~but comme le g~neral des Grecs c~ntre les Per-ses, fonctio~ dans laquelle il fut confirm~ parle synedr-a on de Corint.he des la fin de 336" (23).
Cette argumentation est fondee sur des mobi-les psychologiques et politiques possibles ouvraisemblables, non sur des faits rapportes parles sources.
Il faut tout d t abor-d souligner que ).•:,.Bel-linger abuse le lecteur quand il parle de "ques-tion deja d~battue"(24). Il n'existe aucun deve-loppement de ce point dans son ~tude.
De plus, A.~.Bellinger semble i~norer plu-sieurs s~ries de monnaies ~uand il pretend quedes differences importantes de dessin existententre les pieces de :.azaios et celles d I Alexan-dre (25). Pour lui, les doubles stateres d'ar-gent de r.:azaiosr-e pr-e sent ent Baal de Tarse te-nant devant lui son sceptre surmont~ d'un ai-gle alors que, sur les t~tradrachmes d'Alexandre,Zeus tient son sceptre derri~re lui et l'ai~leest pose sur la main. En fait, A.R.Bellin~er neconsidere ainsi que la Serie VI (La derniered'apr~s E.T.~ewell) sans relever ~ue les cinqpremieres s~ries repondent sur ces points precisexactement au futur type d'Alexandre (rlanc~e VI) ..
Il existe un element nouveau beaucoup plus io-portant. Dans un article capital, :,.Zervos s'est
der's choice of Zeus in 336 BC may have been in-fluenced by a knowledge of t e Baal type of Tarsus"(Y.J .Price,Alexander' s Reform of the :'_acedonianRe-gal Coinage,p.182).
(23) G.Le Rider,£E.cit.,p.176.
(24) A.R.Bellinger,£E •..£.i:.!.,p.lO.
(25) Ibidem.
-18
attache a definir les caracteres orientaux destetradrachmes d'Alexandre (26). Il y demontre demaniere convaincante l'origine perse du troneQui supporte Zeus. Ce genre de trane avec lesbarres horizontales et les pieds decores d'e-lements globulaires (parfois a godrons) est ty-pique de la Perse et semble n'avoir aucun paral-lele en Grece (27) ou les tranes ont les piedsdroits et souvent des barres intermediaires croi-sees. Le monnayage de la Ligue arcadienne n'e-chappe pas a cette distinction geograpbique.
li.Eyrieleis trouve pour les tetradrachces deTarse -et davantage encore pour ceux d'Alexan-drie- des paralleles avec les trones re~resen-tes a Persepolis (Planche VIII,1-3)(28). ~.~er-vos reprend a son compte ces remarques et sou-tient que le trone du ~eus aetop~ore n'est pasgrec. _·~ieuxmeme t tous les autres ateliers ori-entaux se seraient individualises dans le sche-ma etabli a Tarse.
Dans cet article toutefois, :.•Zervos n ' +vai. tpas encore re~arque le point decisif: ,le surles premiers tetrartrac~mes d'Anphipolis (29) e-
(26) O.H.Zervos,Near Eastern ~lements in the Tetradrac~~sof _\.lex2.ndert>e Great,(G=~_'c),-:etteren,l~7~.,p.:~~~-305.
(27) Idem,p.:299.
(28) H.Kyrieleis,Tbrone und Klinen,Studien zur Formge-schichte altorientalischer unci griechischer Sitz-und Liegemobel vorhellenistiscI1er ~eit,dans JDAI,
Suppl.24,Berlin,1969,p.l51.
(29) En parlant dlAmphipolis, nous reprenons par commodi-te l'appellation de B.T.Newell telle Qulil l'avaitpense dans Demanhur (p.67). b:.Price a montre recem-ment ~ulil est, en fait, plus prudent de parler duplus grand atelier macedoni en (Coins of the = :acedo-
-19-
galement le trone est perse.Trois ans plus tard, en 1982, ~.Zervos, pous-a...
sant jusqulau bout son etude (30), en tireYcon-sequence logique a laquelle nous etions sembla-blement arrive de netre cote: la Macedoine s'estinspiree du modele tarsiote et non le contraire.Corollaire immediat de cette affir~ation: les te-tradrachmes d'Alexandre n'ont pas ete frappesavant 333 av.J.C. Pour la premiere fois, le pro-bleme est pose avec nettete. Et ~;.Price de repon-dre, dans le meme volume, en defendant la datede 336 av.J.C.(31).
C.Debat entre ;·:if.Zervoset Price.
l)Presentation.
Nous examinons dans ce paragrapr.e les argu-ments iconographiques invoques par ~;:.Zervoset Price.
Pour ~·.Zervos, cinq details du Zeus aeto-phore sont d'origine orientale (Planche XII,lB et C):
1- Les jambes paralleles et ri~ides.
2- La main oui porte l'aigle est vue deface.
3- La torsion anti-naturelle du corps (Letorse est de f~ce mais les jambes sontde profil).
4- Le vetement qui forme un anneau circu-laire autour de la taille.
nians,Londres,1974,p.25 /T~e Coinage of Philip 11,dans ~,7e~eser.,VOl.19,1979,p.230-241'Pl.34).
(30) O.H.Zervos,Notes on a Dook by Gerhard Kleiner.
(31) !vI. J •Pri ce,Alexander I s Reform of the :-acedonian Re-
gal COinage.
-20-
5- Le trane typiquement oriental avec ses e-lements globulaires sur les montants.
Tous ces caracteres se retrouvent en effeta Tarse, mais aussi a Amphipolis (32).
Pour ~;.Zervos, la sequence qui s'impose estdes lors la suivante (Planche XII,l):
A) Baal de Tarse.
B) Zeus de Tarse.
C) Ze u s de Lacedoine.
Si la transition AlE est depuis longtempsacceptee (voir supra,p.15-17) et semble pres-qu'inattaquable (33), le passage B/c attendaitd'etre demontre.
Pour ce faire, il suffit de prouver qu'un61ement important au moins des tetradrachmesde i-:acedoine cen ses avoir ete frappes avant333 est strictement perse d'origine. ~.Zervos,dans une etude tres fouillee du sujet, croitpouvoir en discerner cinq. Il les donne dans u~ordre indetermine, sans appare~ment en privi-legier un en particulier.
Peut-etre eut-il mieux valu hierarchiserl'importance de ces cinq elenents, quitte sansdoute ~ nlen defendre vraiment qulun seul.
~.Price, en tous cas, ne slest pas faitfaute de mettre en lumi~re lline~alite de cesarguments et, par la, d'affaiblir l~ demonstra-tion de :'.Zervos.
~.Price montre que, dans c~acue cas, il ex-iste des modeles grecs qui ne doivent rien al'Orient:
1- On trouve des jambes paralleles sur lesmonnaies figurant des r-;ikesde Terina(Planche IX,1-3) mais tres rarernent surles Donnaies de la Ligue arcadienne.
(32) O.H.Zervos,£Q.cit.,pl.44,nol et 3.
(33) M.J.Price,£Q.cit.,pl.46,no2,L~ et 6.
-21-
2- La main vue de face est presente, entreautres, sur les monnaies de la Liguearcadienne du Ve~esiecle (Planche v,4-5).
3- La torsion lorcee du corps existe en Ar-di \. Veme t IVeme ., 1 'ca le. iu - e - slec es, on n a-
vait pas encore resolu le probleme duraccourci en Grece pour les figurationstres reduites.
4- La Nike de Terina, les pieces avec>I' O\k\~~~S de Tarente et les monnaies
de la Ligue arcadienne montrent toutesun vetement circulaire formant un an-neau autour de la taille (Planche v,4-6et IX,3-S).
5- "The stool, as opposed to a throne, isnot an orientalization, as the figureof Zeus in Arcadia and the Oikist at Ta-rentum clearly show"(34). l'!.Price,en-suite, insiste sur l'exag~ration co~misepar ~1.Zervos quand il rapproche les tra-nes de Tarse et ceux de hacedoine (Lespremiers s~nt tres semblables entre eux;les seconds incluent de nombreuses va-riantes).
Et M.Price conclut en notant qu'il n'y apas un seul element dans l'iconographie duZeus aetophore qui necessite de penser que laGrece l'ait emprunte.
Qu'en penser? D'abord que O.E.Zervos elabo-re une theorie d~nt toutes les references ren-voient ~ un modele unique (Les doubles statb-res de Hazaios ~ Tarse) alors que i;. J •Price
(34) Idem,p.184-l8S.
-22-
s'en refere tantat et le plus souvent au mon-nayage de la Ligue arcadienne, mais tantataussi ~ Terina ou Tarente. M.Zervos a l'avan-tage sur ~!.Price d'~tre plus coherent dansson argumentation.
Dans quatre cas sur cinq cependant, , D .J.J..Lrlce
a raison de rejeter l'origine exclusivementorient ale des details de composition avancespar ~i.Zervos. Ceux-ci peuvent, en effet, avoirete elabores sur le territoire grec.
S'il avait eu raison dans les cinq cas, M.Price n'aurait de toute fa~on pas pu imposerdefinitivement sa vision, mais il aurait emp~-cbe .i.Zervos d'affirmer la sienne cor.Ee etantla seule valable, en montrant 0.u'~ aucun pointde vue le type du Zeus aetophore n'est obli-gatoirement oriental.
~ous pensons cependant Gue ~:.Frice est dansl'erreur dans le cas precis du trane. Si cer-tains tetradracrmes parmi les tous pre~iersfrappes en ~acedoine portent un trone qui nepeut ~tre que perse, nous sommes en droit d'e-crire que la :-:acedoinesuit le model.e de Tar-se et que la frappe des tetradrac}'r.esd ' Alex-andre n'a pas pu debuter avant la fin de 333av.J.C.
Or M.Price a tente d'esauiver le problemepar deux fois.
La premiere fais en operant une distinc-tion factice entre trone et siege (35). ~-:on-trer que les Grecs ant represente avant Alex-andre le Grand des sieges sur leurs monnaiesn'apporte rien ~ partir du rnooent oG les a-lexandres de :'acedoine figurent un trane. Cequ'il faut prouver, pour ~1.Price, c'est quetous les tranes sur taus les pre~iers tetra-drachmes de Macedoine ont une origine grecque.Il ne I'a pas fait.
(35) Ibidem.
-23-
Pour N.Zervos, et ceux qui le suivront, latache est plus simple: il leur faut prouverqu'un trone au moins parmi les premi~res ~mis-sions de Mac~doine ne peut @tre que perse.
Dans ces conditions, mettre en ~vidence,comme le fai t "i':. Price, les differences ("uiexistent entre les trones de Tarse et la plu-part des trones mac~doniens, apparait commeune entreprise un peu gratuite. Cela pour deuxraisons: d'abord parce oue n'~tant pas exhaus-tif pour la :ac~doine, il ne prouve rien. Zn-suite parce qu'il est clair ,ue les tronesde I'acedoine ne different pas autant par rap-port aux trones figures par les autres ate-liers qu'entre eux. Pour s'en convaincre, ilsuffi t de regarder la pre.·ier.~pLancc e du livred'E.T.Xewell (Reattrihution)(Planche XII,2de notre travail) et plus particulierement lestetradrachmes I-I et II-2 li~s par les droits,de meme que I-J et III-4. II est un fait queles tranes repr-e sent es en ~··.ac6doinef or-rue nt un:7roupe beaucoup moins ri omog ene que ceux desateliers orientnux.
~outefois, presque tous les tranes mace ,0-
niens ont non seulement des el~~ents ~lobulai-res sur les pieds mais possedent en outre desbarres horizontales et perlees (Planche XII,J).Il slagit la de caracteristi~ues orientaleset non grecques. Les rapprochenents oper~s pari'I. Price avec les monnaies de la Ldrrue arcadien-ne et de Tarente (Planche Ix,4-S) sont a ce su-jet tres faibles: les si~~es sont tout-n-faitdifferents sans parler de l'invraise~blanceO~ 'Alexandre ait repris un type de Tarente,colonie spartiate, pour illustrer son rnonnayagequand on connait la situation historique del'epoque (J6).
(J6) Tarente n'en finit plus de de~ander des secaurs aSparte pour se defendre contre les barbares (Expedi-
Perse sans doute aussi, selon nous, est lefait de grossir les derniers elements despieds du trane (Planche XII,2(VI-9) et'3)(37).Ceux-ci sont souvent gOdronnes.
Pour etre plus rigoureux, il nous sembleque ces caracteres (Elements globulaires surles montants, barres transversales perlees(38), dernier element globulaire plus impor-tant) trouvent leurs paralleles en Orient, sansqulon ne connaisse de cas dans le monde grecqui les reunisse taus les trois. Leurs origi-nes orientales ne peuvent etre etablies de ~a-niere absolue. Il nlempeche que leur combinai-son existe dans le monde perse et n'existe pasen Grece. C'est suffisant pour en faire uncritere differentiel valable et ecrire, a bandroit, ~ue les tr8nes des preniers tetradra-chmes macedoniens sont du type de ceux 1uelIon trouve exclusivement en Orient (39).
Si, comme nous le pensons, ce+te propositio-est exacte, la demonstration stricto sensu es~terminee.
tions dlArchidamos entre 344 et 338 av.J.C., puisd'Akrotatos en 315 av.J.C.).
(37) Voir O.H.Zervos,Near Eastern 21ereents in t~e Tetra-drachms of Alexander the Great, (GNA),Wetteren,1979,pl.37,no6-8.
(38) Ce style perl6 est fondamental. II n'y a pas, seD-ble-t-il, de modele valable ~ui y recoure dans lemonde grec.
(39) Quand N.J.Price declare: "I have seen no exampleon which the bells are unnuestionnably present, andthere is no sLrm of a development t owar-d s a lessornate stool. T'h er-e is no attempt to render thebulbous legs of t1'>eTarsus stools"(.£E•.s.i.i.,p.185,note 12), il force la realite a propos des elements
-25-
En outre, un autre ~l~ment nous se~ble d'o-rigine orientale: le sceptre perl~. 11 est in-connu dans le monde grec avant Alexandre leGrand. Le seul antec~dent numisnatiaue quenODS ayons d~couvert provient de Nagidos enCilicie, de la m~me r~Rion donc que Tarse. Cestatore represente au revers Dionysos tenantun sceptre dans la main gauche. 11 a et~ frap-p~ entre 356 et 333 av.J.C.(Plancbe XI,3).
Tout ce qui suit revient des lors a fairela preuve par l'absurde de la coherence de no-tre position.
D.i';odelesa.dopt ea ,
La question du modele adopte par Alexandrepour le Zeus a~top~ore rloit nous re~enir main-tenant.
Ceux qui d~fendent le m~ne point de v'e ~ue.Zervos prennent le Baal de Tarse sur les
doubles st at or-e s de :'.azaioscornm e modeLe unLc ue ,ICOnOfF,rapj1i(luer~ent,cela ne pose pas de pro-bleme. Historiquement, non plus: apr~s sa vic-toire a Issos, Alexandre le Grand se retrou-Ye, fin 333 av.J.C., a la t~te cl'un empirecompose de deux parties differentes: la Greceet la Perse. 11 decide alors de frapper desmonnaies a son nom. Pour ce faire, il reprendau revers de ses tetradrac~mes le type ~tran-ger du Eaal de Tarse, non par man r-ti e de n.o dcLe
grec adequat, rais parce q~e le Baal de Tar-
globulaires (!ui s~nt bel et bien presents (VoirE.T.Newell,Reattribution,pl.I,nol,4,5 et g)(Plan-che XII,3) ~ais, surtout, il refuse de consiri6rertous les crit~res. Les barres hori70ntales perleesse retrouvent sur toutes les clix premi~res emis-sions. De cela, aucun modele n'existe sur le terri-toire grec.
-26-
se hellenise qui est reproduit sur ses mon-naies est un symbole nouveau de la conquetemacedonienne sur la Perse (Une divinite assisesur le trone oriental)(40).
Quel est le modele invoque par H.Price? Iln'est pas permis de le savoir. Dans son etude,essentiellement negative, il recourt surtoutau modele arcadien. A moins d'envisager uneinspiration variee fondee sur une multitudede mod~les (41), les numisnates s~nt forces dese rabattre sur ce monnayage tres ancien de laLigue arcadienne.
Nous avons plus haut (p.14-1S) mentionne lemodele arcadien de mani~re tr~s generale. Ilnous faut n"aintenant l'envisager sous un anglebeaucoup plus precis: celui delimite par ledeb~t entre ~~_.Zervos et Price.
Il pose, en effet, deux types de problemes:probleme dficonoBraphie dfabord, probl~nle definalite ensuite.
A.Iconographie: Sur les cinq ~le~ents pr~ten-dus orientaux par ~.•Zervos,les monnaies de la Li~ue arca-
dienne en poss~rlent trois, voire quatre: mainvue de face, torsion du corps non naturelleet v@tement circulaire autour de la taille(Planche v,2-6). Mais elles diff~rent pardeux aspects: la plupart des pieces arcadien-nes n'ont pas la jambe droite en avant etparallele par rapport a la gauche; le siege
(l~O) O.H.Zervos,Notes on a Book by Gerhard Kleiner,p.174.
(41) Non seulement la Ligue arcadienne, mais encore Teri-na (Plancr.e IX,l-J), Tarente (PlancLe IX,4-S), Rhe-gion (Planche x,4), ~ryx (Flancr.eX,2-J) et Aitna(Planche X,l) pour ne citer que queloues ateliers
-27-
n'est pas un trane perse. R.T.Williams, quia etudie le monnayage de la Ligue arcadien-
Veme ., 1 ·11 t t r-av ai 1ne au - S2ec e, 2 us re son rava2 parquinze planches (42). Il sly avere que lesZeus d'~rcadie peuvent ~tre assis sur troistypes de sieges differents.
A
nAucun n'est perse. Les types D et C,
proches l'un de l'autre, n'ont manifestementrien de commun avec les tranes repr~sentessur les tetradr2chmes d'Amphipolis. Le typeA, plus semblable, ne peut toutefois ~treconfondu: il s'en distingue par l'absenced'entretoises et d'elements globulaires surles pieds. Pas une seule fois, non plus, ilest fait usage de grenetis comre sur les te-tradrac~es d'Alexandre le Grand.
Il faut souligner aussi d'autres diffe-rences fondamentales, d~nt ::.Price ne parlepas (Planche V,2-6):
1- Sur les pieces arcadiennes, l'aigleest represente les ailes deployees surl'avant-bras et non immobile sur lamain (Comme pour les tetradrac~mesd'Alexandre).
ayant repr6sente des fi res assises sur des sie-ges. Cette these, pour ~tre soutenue valablement,necessite des arguments d'autant plus solides queles modeles consideres s~nt nombreux.
-28-
2- Les plis du vetement s~nt beau coupmoins raides que sur les pieces d'A-lexandre et de i'lazaios.
3- Le sceptre n'est jamais perle sur lesmonnaies de la Ligue arcadienne.
B.Finalite: Si le parallele arcadien est ico-nographiquement contestable, ilrecele en lui-meme une faiblesse
plus grande encore: la raison de son choix.Le seul qui ait vraiment tente de l'expli-ouer est, nous l'avons dit, R.R.Followay.
Pourquoi, en fait, avoir choisi l'Arca-die? Pour R.R.I'ollo\vay,Alexandre a voulurappeler le temps des guerres mediques enchoisissant une representation de cette e-poque (43). Dans cette opti0ue, le lieu d'e-mission et la communaute emettrice impor-tent peu; ce aui compte, c'est la periode e-voquee.
Personne ne pourra jamais demontrer lebien-fonde de cette theorie. Elle supposed'abord que les sujets d'Alexandre se rap-pellent en J36 av.J.C. le vieux monnayageemis en ~rcadie 150 ans plus t5t (Ce qui estfort peu probable) et qu'ils fassent ensuitele rapport avec les guerres mediques. C'estpar trop chercher la difficulte. Ilousnepouvons que douter du resultat obtenu.
Le modele arcadien apparait donc com~ehautement aleatoire: justifie ni par lesfaits, ni par le motif. ~.Price l'a biensenti en ne faisant que le sous-entendre s&ns
(42) R.T.Williams,The Confederate Coina~e of t~e Arca-dians in the Fifth Century B.C.,(NN~: ,nOlss),196s,p .1-lLJ.l, pL; I-XV.
(43) R.R.Hollo\vaY,2,£.cit.
-29-
jamais l'imposer.Tant que les d~fenseurs de E.T.Newell et
de .I.Price n'auront pas propose un modele plussolide pour l'iconographie des tetradracrmesd'Alexandre, ils en seront reduits ~ se te-nir sur la defensive.
Si nous resumons la situation, deux sche-mas d'evolution s~nt en concurrence:
1) Baal de Tarse A Zeus de Tarse ~ Zeus de ~acedoine •
2) (Arcadie)? ~ Zeus de I'lacedoineB Zeus de Ta rse ,
Nous venons d'etudier la premiere tran-sition (A) en montrant que, si lA est toutnaturel, 2A est par c~ntre extremement dif-ficile ~ etablir.
Le deuxieme ?oint (B) ne fait plus inter-venir Que les rnonnaies d'Alexandre. Tout estici fonde sur les differences constateesentre les t~tradrachmes de Tarse et ceuxd'Ampripolis.
2.Tetradrachmes de Tarse et d'Amphipolis.
~I.Price a raison d'insister sur les diffe-rences. Il y a, entre Tarse et Amptipolis,d'incontestables variantes qui s~nt davantageque le resultat d'une copie inintelligente oula reaction a des orientalismes (44). Il s'a-F,itde les expliquer.
La premiere difference concerne le droitdes tetradrachmes. E. T.Newe Ld, a tres tot (45)souliene la continuite entre la tete d'r-era-cles sur les derniers didrachmes de PhilippeII (46) et celle rencontree sur les premiers
(44) 0.B.Zervos,2E.cit.,p.169.
(45) E.T.Newell,Reattribution,p.44-4S et 113-114.
-30-
t~tradrachmes d'Alexandre le Grand (Planche XIII,5). Cette continuit~ a servi d'argument majeur~ E.T.Newell et Ch.Seltman, entre autres, pourfaire debu t er- la frappe des tetradrachmes en ~_a-c~doine (47).
"The explanation, ~crit O.B.Zervos, is, Ithink, tJat the Heracles head was adopted inde-pendently by Tarsus and Amphipolis. It was firstadopted at Tarsus as a companion type to trenewly designed 'seated Zeus', and later, when itwas taken up at Amphipolis, was modelled not onthe Tarsiote rendition but, naturally enough, onthe local examples"(48).
On peut meme retourner l'ar~r.ent. 11 es~ a~fait compr~hensible qu'apr~s avoir re9u un exer-pIe provenant de Tarse de ce qu'il devait faireet avoir constat~ qu'un des deux types lui ~taitparfaitement connu, l'artiste macedonien aitpr~fere reprendre le modele local pour la teted ' He r a c Le s •
En revanche, on ne voit pas pourquoi le oules ,s-raveurstarsiotes auraient cla ngc en JJ3une iconographie pour laqlelle ils n'avaient pasd'ant~c~dents chcz eux (49). Pourquoi se seraient-ils corpliques la t~che en ne recopiant pas leprototype mac~donien?
11 faut dire aussi aue ce nui apparaissaiten ~ac~doine comme une continuite jusqu'il y apeu , a de bonnes chances , depuis l'etude de ;.;.Le Rider, de n'etre plus qu'une contemporaneite(50). Les didrachmes en question rie P~ilippe IJs~nt probablement post~umes. Les sy~boles (rrouepoupe et f oud r-e ) sont en effet les met'les=ue surles premiers t~tradrachmes "ampr-ipolitains" d'.\.-
( L~6) V0 ir O.1-• Zerv 0 s ,.£.l2.•.£i.!.,pL, 45,n 0 7 et pL, 4 4 ,n r; 1 •
(47) Ch.Seltman,.£.l2..cit.,p.67.
(48) 0.P.Zervos,.£.l2.•.£i.!.,p.170.
-31-
lexandre (51).
Au revers ~galement, des diff~rences inter-viennent entre les t~tradrac~nes de Tarse etceux de ~·;acedoine.N.J.Price mentionne ainsi pourla Mac~doine l'absence de Tabouret, de sceptrefleuri et d 'une cve v e Lu r-e e n r-o u Le e a partir dela n1..1nue.11 est vrai qu'a Tarse ces trois ~l~-ments s~nt toujours presents (Planc~e XIII,l).
Le tabouret manque a Amphipolis mais il man-que aussi a Salamine et Citium, de m&me que surla plupart des emissions d'Arados et de Byblos(Planche XIII,4).
En revanche, certains t6tradrachrnes par-m i,
les premiers frapp~s en :ac~doine (Planc~e XIII,2) semblent figurer malgr~ tout un sceptre fle1..1-ri (Les deux premi~res 6~issions: Proue et pou-pe )(52 )•
~.Price a egalement tort de pr~tendre ~ue lac reveLu r-e e n r o u Le e n'est ja!"cd.spresents en ~.a-cedoine. Trois emissions au ~oins (fIance XIII,3) y ont recours: les et:1issionsXXXV, X~~XVI etXXXVIII (53).
Si, comme le dit .'·[.frice,on a a.i o te a Tar-se les "attributes -the footstool, the tIrane,
and t~'e sceptre- t 'at a conqueror parades as asymbol of his victory" (54), c omre nt se fai t-il
(49) Les differences de dessin entre les tetes d'Eera-c Le s ;\Tarse et en !'iacedoineont ete trai tees parO.H.Zervos (Near Eastern Elements in t~e Tetra-drachms of Alexander the Great, (Qg), Ivetteren,1979,p.297) •
(50) G.Le Rider,Le monnavage d'argent et d'or de F~i-lippe 11 (frapp~ en ~ac~doine de 359 a 254),Paris,1977.
(51) Proue, poupe et foudre correspondent aux emissionsI,ll et V selon B.T. ewell.
-32-
qu'il n'y ait la plupart du temps ni tabonret,ni sceptre fleuri ~ Arados? Les Zeus d'Aradosn'ont pas non plus de c~evelure comme ~ Tarse.
En realite, nous constatons entre c::aque ate-lier ouelques differences d~nt la rationnalitenous echappe parfois. Comme nous ec~appe lepourquoi des differences importantes que l'onrencontre dans un meme atelier (55).
Si deux pieces du meme atelier sont aussidifferentes entre elles que deux pi~ces d'ate-liers differents, la valeur accordee ~ ces dif-ferences s'estonpe un peu.
Le grand merite de ~.Frice est d'avoir mon-tre cue la t r-a.nsation Zeus de Tarse /Zeus de [-'<1.-
cedoine (lB) n'a pas ete sans ~uelcues retouchesqui font probl~me. La situation est plus coc-plexe ou e ce =u i, ressort 2..la Le c t u re rie l',.• Zer-vos.
Un dernier element, oui rlerite d'etre note,est l'absence de symboles ou lettres sur lestous pre~iers t~tradrach~es frappes 2..Tarse(IerGroupe,Officine n). Ce p~6nom~ne ne se re-trouve ni a Anrph i poL'i e , ni nulle part ailleurs.Il est davantage le fait d'un debut qu'un ac-cident de parcours survenu au milieu d'une evc-lution (Planche XIII,6).
F.Destinataires potentiels.
Pour terminer cette etude iconographioue,nous souhaitons lutter c~ntre une idee re~uequi alimente parfois la litterature scientifi-~ue et selon la,uelle Alexandre le Grand auraitchoisi ses types monetaires d~s 3J6 av.J.C. enfonction des peuples qu'il n'avait pas encoreconouLs ; Ch ,Seltman ecri t par exemple: "T'h ough
(52) Le sceptre fleuri n'est pas propre a l'Asie. Letres celebre bas-relief d'Eleusis repr6sentant De-meter, T'r-Lp t oLerne et Per-seph one le reprodui t (?>;useeNational d'Athenes: vers 450 av.J.C.).
-33-
introduced in 336 B.C., these types were desti-ned to appeal equally to Greeks and Orientalsubjects of Alexander as yet unconquered; forthe Phoenician was to see in the obverse typehis own god Melqart, the Cilician was to regardthe seated deity as the great Ba'al of Tarsus,and the Babylonian, thoug.hhe might not be ableto read the Greek name of Alexander, was tolook on pictures that might recall his own Gil-gamesh, the lion-slayer, and tr.e figure of Bel-l'1arduk,god of Babylon" (S6) •
Quant a N.Davis et C.i·i.Kraay,ils ecriventavec amb i.rrui.te: "The e n t h r-o n e d Zeus l-o Ld i.ng ea-gle a~d sceptre perhaps expresses the sameclaim to t~e hegemony of Greece as had been ex-pressed by the ,ead of Zeus on tre coinage ofAlexander's father, Philip II; but in the con-text of'Alexander's empire the figure could al-so be interpreted as tre Baal worshipped by ma-ny of Alexander's subjects in the Persian empi-re"(S7).
Si les considerations panhelleniaues nousse~blent justifiees dans le cadre d'une optiquedefinie, il ne nous parait pas vraisemblablequ'Alexandre ait ete certain de ses succes aupoint de les anticiper sur ses monnaies (58~
(S3) E.T.Newell,2E.cit.,pl.6,noll et pl.9,nol et 3.(S4) t-l.J. Price ,Alexander's Reform of t::ei-:acedonianRe-
gal Coinage, p .18S •
(ss) E.T.Ne"ell,.2..E..cit.,pl.I,noI-let 1I-2 lies par lescoins de droit.
(So"') Cb S It G 1'" L 1 2cne'd 19-- ?c-L. e man, ree"'\:'-,Olns,onares, - e., ,:::>,:::>,p._.:::>.
(S7) N.Davis et C.:.•Kraay,Tle Hellenistic Kin~doms,Portrait Coins and IJistorv,Londres,1976,p.J4.
(S8) Voir S.Perlrr:an(.2..E..cit.,p.67:"It is very dOllbt-ful whether Alexander froD the beginnine plannedhis campai~n in Asia Ninor in the way it was fi-
-34-
ni au point de connaitre des 336 l'interet duparallele Gilgamesh-Heracles, Gue ses futurs su-jets, trois ans plus tard, pourraient percevoirsi notre ~ypothese est correcte.
Cette pluralite de destinataires potentiels,si elle n'est pas fortuite, ne serait-elle pasplutBt le signe ~ue les monn~ies d'argent depoids attigue datent au mieux de novenbre 333av.J.C., au lendemain de la victoire rer.porteea Issos?
-35-
nally conducted. It is even more doubtful whet~erAlexander issued his silver coina~e because of thefuture acceptabili ty of its symb oLs to or-d ent aLpeoples").
3. i'ietrologie.
Alexandre 111 le Grand a change d'etalon pourson rnonnayage d'argent. Philippe 11 se servait del'etalon thraco-macedonien (!14,70g. pour un te-tradrachme). Alexandre passe ~ l'etalon attique(!17,20g.). Cela suscite deux questions: Pour-quoi a-t-il choisi l'etalon attique et, plus fon-darnentalement, pourquoi y a-t-il eu changement?
A.L'etalon attique.
Change ant le poids de ses monnaies en argent,il est normal qu'Alexandre le Grand ait choisil'etalon ayant la diffusion la plus large: l'eta-Ion attique.
Les chouettes atheniennes (Planche XIV,l) e-taient a l'epoque de tres loin le rnonnayage leplus repandu (et reconnu) tant en Gr~ce que danstout le bassin mediterraneen. On les trouve, ellesou leurs imitations, en Eeypte (Planche XIV,2), ~Gaza (Planche XIV,3), en Dabylonie et dans la pe-ninsule 2rabinue.
Le poids attique ~our l'argent est le plus aptea ~tre utilise dans le futur e~pire. D.Sc~lumber-ger defend cette position (1), qui est cornhattuepar A.R.Bellinger (2).
(1) D.Schlurnberger,L'argent grec dans l'ecpire ac~emeni-~,(Tresors monetaires d'Afghanistan),Paris,1953,p.27.
(2) A.R.Bellineer,Essays on the Coinage of Alexander theGreat, (NS ,11),196J,p.30: "This largeness of va ew ,however, would only have been possible at a timewhen he could foresee the eastern extension of hisempire. It therefore fits Schlumberger's idea thatthe imperial currency does not beein with tle begin-
-36-
B.Le c~angement m~trologigue.
l)~~~~!~~~_~~_E~~~!~~~'La n~c~ssit~ d'un chan~ement m~trologique et
la date ~ laquelle il faut le placer s~nt plusd~licates a expliquer.
Deux th~ories s'affrontent: pour les uns (3),un r~ajustement mon~taire (Bim~tallique) s'im-posait en 336 av.J.C., vu l'abondance d'or ex-traite du hont Pang~e depuis quelques temps, co~-me s'imposait pour Alexandre la cr~ation d'unemonnaie qui lui soit propre d~s son avbne~ent.
Pour les autres (4), c'est l'afflux d'or sui-te a1'Xbutins pri s sur les Ferses qui a :fait cbu=ter le rap ort or/areent et c'est la volont~ decr~er un monnayage utilisable tant par l'Occi-dent ~ue par l'Crient ~ui est ~ l'origine ducnangement de poids.
Voil~ r~su~~es succinte~ent les deux posi-tions. Celles-ci s~nt exemplairas dans la mesu-re o~ elles mettent en ~vidence les fondementsdes interpr~tations ~istoriques de leurs d~fen-seurs.
D'un c6t~, on insiste sur le role de propa-gande tenu par la monnaie, sur le R~nie d'Alex-andre et sa vivacit~ de r~action. C'est un ~-lexandre agissant souverainement Gu'on nous pr~-sente.
De l'autre, l'accent est mis sur les circon-stances histori0ues. Alexandre subit alors cequ'il a d~clench~. Il est forc~ d'a~ir sur une
nin~ of t~e reign". Une nouvelle fois, A.R.Uellir-ger conclut abusivement: "Dut Hitl- the difficultiescaused by this tleory we aye already dealt"(Ibidem).Ce n'est vrai qulen partie dans la Mesure o~ r~futerG.~leiner ne rtsoud pas la ~uestion.
(3) Soit E.T.?<:e,,,ell,h.Le Rider, :'_.Price,
(4) Soit a.IT.Zervos, N.G.L.Eammond, •••
-37-
situation qulil ne domine pas entierement. Cenlest plus un dieu qui peut tout prevoir, il re-devien t uryll.ommec:ui SIadapte •
Peut-etre avons-nous la, en filigrane, un desproblemes majeurs de la philosophie de Ilhistoi-re: Est-ce les hommes qui font llhistoire ouIlhistoire qui fait les hommes (5)?
Pretendre qulAlexandre le Grand a attendutrois ans pour frapper son propre monnayage re-vient certainement a saper son presti~e a labase. Clest traiter cette figure de proue deIlhistoire mondiale comme si elle slinserait dansun enchainement lOc;ique de faits et non commeun surhomme prevoyant en toute mati~re llunicitegrandiose de son SUCC8S imminent.
Av ari t dletudier la question de la elate de cechangement metrologi0ue, nous voulons montrerllevolution generale du rapport or/ar~ent au
.-J IVEl11e., 1cours uU - S18C e.Philippe 11 avait adopte l'etalon de la Li-
:",'UechaLc i.d i.e rm e , soit le ra~port 135/1. ~<ais,d 1 d ·t·' d IVeme ., 1 '1 tans a secon e mOl le.u - SlBC e, 1 escertain que ce rapport avait crute a 12/1 ou11/1 (6). Alexandre, en optant pour lletalon at-tique, le fait passer Et. 10/1. l':.I::elville-Jones
1a montre que celui-ci allait tomber ~ 9~/1 ena;
329/8 av.J.C. a Athenes (7).Resituee ainsi dans un large contexte, la
decision dlAlexandre de chanper dletalon ne doitpas nous surprendre. Le besoin de reforr'e a puexdst o des 336 av.J.C. Eri ce sens, ;,.J.Frice araison dlecrire: It ••• it is not necessary to be-
(5) Aucun ouvrage de r6flexion sur l'histoire ne peut pas-ser cette question sous silence. 11 faut noter, ~ cesujet, qu'Alexandre le Grand est pres~ue toujours ci-te ' chaque fois qulun historien aborde le problemedu personnage historique et du r51e qulil joue (Voir
-38-
lieve that he could have conceived the idea ofan Attic weight imperial coinage only after thebattle of Issusll(S).
Ce chapitre metrologique ne peut d'ailleursdeboucher sur aucune certitude chronologinue. Ilne fait qu'analyser des schemas d'explication. Anous de voir lequel detient la plus grande pro-babilite de se reveler exact.
J)~~~_~~~~!~_9~~_~~~_~~~~~~~~~_~~_~~~~~~~~~~'Il est entendu que le rapport 10/1 s'inscrit
dans une evolution qui peut se passer de l'erdes Perses pour ~tre expliquee. Mais la verita-ble auestion est de connaitre le motif nui apousse Alexandre le Grand a changer d'etalon.
Deux types de reponse ent, nous l'avons dit,jusqu'ici ete propose: le Mont Pangee (PlancheXVII,2-J) ou les butins perses.
M.Price comDence par mettre le change3ent depoids au service des vues de ;:.Zervos, mention-nant la portee Gu'il faut accorder a l'etude del' .Le Rider sur les stateres de Frilippe II (9):"l-'.ol.;ever,Dr G.Le Rider has recently sbown tbatthe stri~ing of gold coins started relativelylate in the reign of P~ilip II; and in te lightof Le Rider's study it may well be cuestionned
par exemple: P.Harsin,Comment on ecrit l'histoire,eme,. )2 - ed.,Parls,19J5,p.lJ7 •
(E?) Voir Lysias, De Bonis Aris tophanis, J9-1,0 ou "PIaton",Hipparchus,231D. Y.Le Rider en parle egale~ent dans:Le monnavaRe d'argent et d'or de Philippe II (frappeen Mac6doine de J59 ~ 254),Paris,1977,p.4J9-441.
(7) J.R.Yelville-Jones,ctans American Journal of AncientHistory,J.2.,1978,p.lS4-lS7.
(S) ~I.J.Price,Alexander's Reform of the :acedonian RegalCoinage,p.lSl.
(9) G.Le Rider,££.cit.
-39-
whether the output of gold was sufficiently ad-vanced to have so affected the ratio by 336 BC.On the other hand, with the additional circula-tion into Greece of gold captured from the Per-sians in Asia ?:inor, a cause for the lowering ofthe ratio c.JJ3 BC. is perfectly clear"(lO).
Na i s l'attitude de ~\l.:rriceest paradoxale. 11conclut son raisonnernent m~trologique par cestermes: "It is important to recognize at the out-set that the need for reform existed in ?"acedo-nia in 336 ac .vt i i }. En verit~, };.Price, r u i, n'ad-met pas le classernent de M.Le Rider (12), estoblige de d~fendre pour les besoins de sa theseun argument Gu'il sait faible.
De ces deux interpretations, quelle est laplus fondee? 11 est difficile d'y r~pondre. Au-cune des deux n'est ni plus, ni moins prouv~eque l'autre. La conau~te de l'Asie apparait end ef Lri L tive c ornme un phenomene h Ls t or-d.cu ernent
plus e t abLa. que l'irnportance de la mise en ex-ploitation du Mont Pangee (peu evaluable) dontles cons~quences ne peuvent ~tre fixees avecprecision, sinon de maniere arbitraire (131•
Apres les facteurs contrai7nants Qui antpouss~ Alexandre ~ agir de la sorte, i1 ~a~t con-sid~rer aussi l'id6e poursuivie par l1..1ia tra-vers cet acte. Soit une affirnation de sa souve-rainet~, soit la volont~ de cr~er un ~onnayage u-
(10) H.J.Price,.£.E,•.ill.,p.180-181.
(11) Idem,p.181.
(12) Voir infra,p.51-S4.
(lJ) D.Tzavellas, l<ount Pan,c;aeus.Stru,::;glesaround Goldfiines in Antiqui ty,dans Aurifex, V( Gold Jewelrv j ,
198J,p.163-169.
-40-
tilis8ble tant a l'Ouest ~u'~ l'Est.Com~ent admettre sans aucune r~ticence au'A-
lexandre ait boulevers~ l'ann~e m~me o~ il acc~-de an pouvoir I' etalo.n rionct ai.r-e en vigueur?Pour fier ~u'il soit, il est aussi realiste.Dans une ~tude p6netrante, A.D.West s'est atta-cbe a demontrer le caract~re pragmati~ue de Phi-lippe 11, guide par le profit immediat et davan-tage encore par les inter~ts commerciaux assu-res (14). Ensuite viennent les vis~es imp~riali-stes. ~~me si ce qui est vrai pour le p~re,l'est peut-~tre moins pour le fils, il reste cer-tain qu'un chan~ement monetaire ne peut se re-duire a un acte diplomatique de rapproc~ement(avec ~th~nes en particulier). 11 ioplioue avanttout une rencontre eCOnOmi0Ue avec les interetsvitaux du ~ays. Toutes les motivations propa-gandistes ou pan~ellenirues icaginces a poste-riori passent apr~s cette connee fondamentale (15).
Or, rien ri ' indique cu 'en 336 av ,J . C. la 2~ace-doine change de zone d'influence cOillmerci8.1e.Dans ces conditions, adopter l'etalon attique,c'est se mettre a dos certains de ses principauxpartenaires economiaues: les villes de la cotethrace et tout l'horizon tumu1tueux du Kord (16).
D'un autre cote, au debut de son r~~ne, i1n'est pas question pour Alexandre de faire des.concessions aux confederations grecques avec les-quelles les relations sont tr~s tendues (17), etencore moins de donner l'impression d'intervenir
(14) A.B.;vest,The ",arly DiploMacy of Fbilipp 11 of _ace-don illustr?ted bv his Coins,dans j\;C,5~~eser.,v01.J,1923,p.16~-2l0.
(15) Un rapnrochement diploillatiquepeut tres bien se con-tenter de l'icono~raphie. 11 n'y a pas de raison d'enplus changer le poids.
(16) Ainsi que le montrent les tr~sors dans ces re~ions,on continue d'utiliser les monnaies de Ihilippe 11bien apras S8.Dort.
-41-
dans leurs affaires. La diploQatie macedoniennes'occupe activement ~ masquer autant que fairese peut la mainQise de fait qulelle impose auxGrecs (18).
Les tresors indiquent ou'Alexandre s'est bienga:i-~rlede sup prLme r- les rtorrnayages au t onc.jes descites qui restent le plus souvent les seuls ~circuler (19), et cela sans doute meme en Thes-salie (20). Comme pour les villes d I Asie :.ineure,il a Lr.po se ses types progressi verne nt , une foissa conquete assuree (Voir la seconde partie). Onne voit pas en fait a qui profiterait l'adop-tion de l'etalon attique avant son passace en A-sie.
B.V.--ead note par contre «u t aL etnit deverrunecessaire de remplacer l'ancien etalon (duode-cimal) par un syst~me monetaire deciDal capablede satisfaire tant l'~st -ue l'Ouest (~l).
G.~·acdonaLd parle de 't r-adi, t aon bi-,otal.:L:"::Jteen Ferse: ":.aving aourrda.nt; supplies, he did nothesi tate to f oLLo w the example of tl-'e:-'ersian~_onilrc~-,sarid make ~~is currency biLlet"'11ic"(~2).
~leme si A.R.Dellinger ne croit pas que laPerse ait pratioue une politioue monetaire bi-
(17) Voir S.Perlman,The Coinages of PhilipD II and Alex-ander the Great and their Pan~ellenic Pro~aganda,,d ,,-."7ene, 1 ~ 106 - ,,- ("r", 1 t'ans~, - ser.,vo .~, J J,p.o~ l~e re a lonsbetween Alexander and Athens were certainly not cor-dial, and Atlens was obviously an uneasy ally") onA.-~.Pickard-Cambridge,Demosthenes and t~e lastDays of ~reek Freedom (3B4-322 B.C.),New York,1979,p.407-416.
(18) 1v.S.Ferguson,Eellenistic Atltens,Ne,.rYor~,,1969,p.ll:
"The great problem was to conciliate civic freedo:r.and autonomy with t~e dominating and controllingposition of Alexander".
(19) Voir lQfE,no78,B6,B7,88,89,107,lOB,109,110,112 et113.
-4.::-
m~tallioue (23), l'explication reste de m~meordre: ce serait pour mieux r~pondre a la r~ali-t~ mon~taire de son nouvel empire et non par d~-valuation relative qu'Alexandre aurait changed'~talon.
E.T.Newell se r~f~re lui aussi a B.V.Pead etcela d'une manigre assez subtile (24). Pour lui,Alexandre n'avait pas besoin de franchir l'Yel-lespont pour pens er a l'Asie. Son pere, Philip-pe 11, en avait d~ja forme le projet en tentantde s'emparer de l'Asie ~ineure. Le changementde poids pour les monnaies en argent aur~it ~te,en fait, une mesure deja programrree par Fhilippe11 (25).
C.La s~rie a l'aiRle.
11 existe enfin une serie de t6tradracrmes ex-ceptionnels ~mis par Alexandre III le Grand: cesont les fameux "t~tradrachmes 2.. I' aLv Le " (PlancheXIX,l)(Tite de Zeus/Aigle sur foudre) sur laauel1enous reviendrons en d~tail (Voir infra,p.~r,J etd~nt ~.Pegan a virtuellement ~tabli l'origine ma-c~donienne (26).
Selon lui -i1 est raisonnab1e de le suivre mal-~r~ certaines diffic Ites de d~tails- la serie est
(20) Th.R.hartin,The ~nd of Thessalian Civic ~oinage inSilver: r.lacedonianPolicy or Economic ?ea1i ty, (Pro-ceedings of the Nint~ International Numismatic Con-gress. Bern 10-15 September 1979),Berne,1982,p.l09-117.
(21) B.V.Head,Historia Numorum,2e:::eed.,Cxford,1911,P.22S.
(22) G.f.Iacdona1d,CoinTypes, their Ori "in and Develop-~ , G1a s [","0 iv , 1905 , p •IS5 •
(23) A.R.Dellinger,£2.cit.,p.41.
(24) E.T.Newell,Reattribution,p.120-121.
-43-
a placer au debut du re~ne d'Alexandre.Cette serie, comme les philippes II posthu~es,
est de poids thraco-reacedonien. En admettant unefrappe de tetradrachmes de poids attique d~s 336av.J.C., Alexandre le Grand aurait alors utilisedeux etalons distincts a la m~me epoque. Ceux-ci de-vraient correspondre a deux finalites differentesque rien, dans les faits, ne per~et de supposer.
La vision qui cree, a partir de 336, deux zonesmonetaires (Phili~pes II au Nord/Alexandres en Gre-ce) est dementie par les tresors. Les p~ilippespost l-un es s ont loin d !etre absents en Grece.l'IGCH recense pour la Grece quinze tresors d'alex-
d ~ IVeme ., 1 dan res enIouis au - slec e, ont douze contien-nent egalerent des p'1ilippes II (80-;), soituneproportion plus i:::portantequ I en = .acedoi ne merr.e(61" 11 t ' ? 3 f'ou i IVeme., 1 )>: "+ resors sur ~ en OUJ_S all - s aec e •
Il existe rneme un tresor ne contenant que desphilippes II, d~nt certains s~nt posttumes, sansaucun alexandre (IGCE,no75: Pyrgos en ~lide).
Les pieces a l'aiRle s~nt rarissi-es. Il s'agitplus que vraisernblablement d'une frappe de trbscourte duree. Nous pourrions proposer, sans quepour ce point nous n'ayons de preuve, de placer cet-te serie non pas en 336 mais plutot vers 334 ay.J.C., peu avant le passage d'Alexandre en Asie.
Le caractere ephemere serait explir'u6 puisquele bouleversement politique qui suivit contraiznitAlexandre a interrompre ce monnayage desorrais in-adapte. Cette datation expliquerait aussi l'etalonmon6taire -ui irplique une destination plutot ma-cedonienne et limitee pour ce numeraire.
(25) Pourquoi, dans ces conditions, P~ilippe II ne l'a-t-il pas executee ~lus tot? ~ourquoi avoir atten-du 3J6 av"J.C.?
(26) E.Pegan, Die frul1esten TetradraclcE!enAlexanrJers desGrossen mit dem Adler, i~re Eerk~nft und Entste-hunp;szeit,dans JNG,18,1968,p.9S-111.
-44-
4. honnaies frappees entre JJ6 et 333 av.J.C.
A.lntroduction.
Une des questions najeures a laquelle dut re-pondre G.Kleiner est celle des monnaies qu'auraitemployees Alexandre le Grand de JJ6 a 3Jl av.J.C.
En plus des monnayages inteeres dans son sys-t~me economique tels que ehouettes atheniennes(Planele XIV,l), dariques perses (Planehe Xlv,4-G)ou shekels pben i ci ens (F1anere XV,+-5), i1 aurait,suivant le numismate al1emand, frappe deux mon-naies dLf f er-e nt es e les philippes 11 post I-urres et
(Plancl-;.eXIX).la serie ,I' aig'leEl.
er, , l'epoqueEt
ge, on ne faisaito ft G.Xleiner pub1ia son ouvr-a«encore Gu'entrevoir la possibi-
lite d'un monnayage post~ume pour F~ilip~e I1 (1)et la s~rie a l'ai~le etait censee avoir "t6 ~riseen Bactriane (2). La criti~ue ne ~an~ua do~c pasd'insister sur ee ou i, apparaissai t en 194~ c on.medes points faibles dans le raisonrenent (3\•
.\11jourd'}-:ui,la situation est t.o t aLene nt d i.f f'c>-
rente.
B.Les philippes II post~umes.
l)Etude de tl.Le Rider.
Les prilippes II d'abnrd, qui forment l'es-sentiel de la demonstration.
M.Le Rider a permis de mieux co~prendre com-ment s'articulaient les no~breuses erissions du
p~re d'Alexandre (4). Apras une etude trns soi-gnee, il propose une frappe posthvrne de ptilippes
(1) Dans le prolongement de E.T.Newell (Reattribution,p.113-1l41, on n'admit d'abord qu'lne frappe tres li-mitee de transition en 336 av.J.C.; puis on insistasur une frappe de philippes apr~s 323, avant de re-conna!tre tout reeelnrnentl'existence de p~ilippesposthumes jusqu'en 329/8 AV.J.C.
-45-
11 jusqu1en 329/8 av.J.C.(S). 11 se fonde surune similitude, not~e depuis longtenps (6), demarques de mon~taires (T~te janiforne, proue,poupe et -peut-~tre- gouvernail) entre les te-tradrachmes de P~ilippe 11 et ceux d'Alexandre(Planche XVIII,2-3).
h.Le Rider date son groupe lIB d'Amphipolisentre 342/1 et 329/8 av.J.S. 11 s'agit -et deloin- du groupe le plus Ln.p o r-t ari t (7). Cetteperiode correspond aussi, ~.ais ~ Amp~ipolis seu-lement, ~ un changement dans l'organis~tion del'atelier oui voit quatre ~onetaires (T&te jani-forme, proue, poupe et o~p>alos) -un moment super-vises par un cinquieme (Abeille)- -F'raT'persil:1ul-t arierne nt (8).
(2) Voir, par exer.ip Le , H..B.~ibitehead,T'-eE",_sternSatr8.pSophytes,clans NC,6e~eser.,vol.J,194J,p.60-72,pl.III.
(3) G.Le Rider,AnnuBire 1968/69 (Extraits des rapportssur les conferences. _Tumis"'1tique~rec-'le),clansAEPE8,196g,p.17J-176.
(4) G.Le Rider,Le ~onnavage d'ar~enr et d'er de F-i-lippe 11 (fraI)1)Cen ;_ac~doinc de J5~ ::,_?9~), faris,1977.
(5) G.Le Rider etablit d'abord sa c~ronologie pour l'oret a Lasm e ensui te I' argent sur celle-ci. (.2.£ •.£i.!.,p , 390: ":-~aisune autre chronologie, qui est sugG"e-ree par l'etude des Monnaies d'or 2e paratt possi-ble. Comme je le r ontr-er-ai plus loin, il semble quela frappe des stat~res d'or de Plilippe 11 et releurs divisions, inau~uree dans la deuxi\ne partiedu rerne, se soit prolonRee sous Alexandre jusqu'en328 environ, ait 6t6 interrOMpue vers cette ~ateet ait repris c.J2J/2. Je suis enclin a penserou'i1 en a ete de n~~e pour les t6tradrac~~es d'ar-,c;entet '--'u'econsequence le groupe lIB peut etredate des a.n noes Jh,'2/1-329/8environ").
(6) E.T.Newell,H.eattribution,p.llJ-114.
-46-
De tou te f acon , le 't ervp s n I est plus 0·'1 onpensait que les Philippes II posthumes avaient~t~ ~mis exclusivement apr~s 323 av.J.C.(9). A-pres l'etude de l;.Le Rider, il est clair que lesproductions combin6es des deux ateliers cacedo-niens en philippes posthumes pour la p~riode336-329/8 av.J.C. furent tres i~portantes puis-qu'elles approchent, semble-t-il, la rasse colos-sale des t~tradrachmes d'Alexandre qulAmphipolisest suppos6e avoir ~mis dur~nt la m&me periode.
Nous nous proposons rnaintenant de traiter unas eet pa r-t i cuLie r- de la n ~r.ismatiCJl]eancienne:celui ui pretend recalculer les Doyenres annu-ellas de nouveaux coins (10).
Comrne .-\..~-::'.l:3ellin:-'-erant rof ori s pour le c aLc uL
~es revenue et depenses d'Alexandre (11) ou 2.u.P.Raven pour les monnaies a~p~ictioniqLes (12),il faudra ~ani~uler des cl iffres qui ne s~nt ~a-
r.a as '-'1]e des a.ppr-o xLma t dons ,::-r01. s ne le f aLs ons pas avec la conviction ,'e
detenir un ~tout decisif mais pour tenter declarifier une sit at i on <Jue les cLa sseruent s e-labor~s ont quelque pen e~brouill~e. Deaucoupd 'effort en def Lri i. tive pour nn resnl tat 'Te l'onsait d'av~nce contin~ent.
(7) Cela ne pr-ouve rien dans la mesure ou le d~ coupa xechronologique est peut-&tre arbitraire. ~~.Le Rider atres bien fourni cette periode IIB (342/1-329/8).
(8) G.Le Rider,2E.£i1.,p.389-391.
(9) G.Le Rider le pensait encore en 1968 (Voir Annuaire1968/69 (Extraits des rapports sur les conf~rences.
Numisoatigue grecque),dans A.2PF:2,196g,p.17S).
(10) Nous supposons, pour ces 6missions "regulieres",qu'il n'y a pas eu d'interruption au cours des ans.Ce n'est pas certain mais c'est un postulat oblige
Par postulat, nous entendons considerer pri-mo les seuls tetradrachmes , ~ l'exclusion detoute autre valeur, et secundo les droits de cesderniers pour etablir nos statistinues (13).
A-~r~!~~~_~~I~~~~~!!L~~~~_~~~~~:Quels s~nt leschiffres pourles philippes
II? Pour ~l.Le Rider, le groupe lIB comprend121 droits en 14 ans a ArnphLp oLd s (342/1-329/8) et 43 droits en 8 ~ns a Pella (336/5-329/8).Cela nous fait au total plus ou moins 112droits pour la periode 336/5-329/8 av.J.8.(14),soit une moyenne de 14 droits annuals, si noussuivons E.Le Rider.
La periode precedente avait vu une frappesuperieure de t6tradrac.'mes de Philippe 11
puisque, toujours selon M.Le Rider, le groupeIIA2 de Pella (342/1-337/6) comptabiliserait63 droi ts et la pr-e r.i er-e partie du Toupe lIBd'Amphipolis une cinauuntaine de droits (~ peupr~s 52) pour le rn~me laps de temps. Cela don-ne 115 draits en 6 ans (Jh2/1-337/6), c'est-~-dire une moyenne de 19,17 par an.
Pour les alexandres ~acedonicns, tout lemonde fait confiance a E.T.Kewell (IS), On
si nous voulons interpreter les chiflres. Une etudeirnportante des possibilites offertes par ce type derec~erche ainsi que des ~et~odes statisti~ues a em-player va prochainement sortir dans Pact V.
(11) A.R.Bellinger,Essays on the Coina~e of Alexanderthe Great,(NS ,1~,1963,p.35-37 et 73-75.
(12) E.J.r.Raven,T~e Amphictionic Coinage of DelD~i(316-334 D.C.),dans ~,6e~eser.,val.lo,1950'P.1-22.
(13) S'il nous r-a nque bon nombre de revers, nous pou-vons considerer ~ue les tresors nous o~t transmis laplupart des droits.
(14) Soit 43 drai ts pour Pella et 69 pour Ar=p hi poLd s(121:14= 69,1:8)
-48-
trouvera d !ailleurs, ~ la fin de ce c La p i, tre,des annexes avec ses diff~rents classeDents pourI' atelier principal de j':ac~doinc(16).
B.T.Newell a divis~ les cueloue soixante ~-missions recens~es dans le tr~sor de Deman-
hur (lQ£.!:I,no1664:enfoui en 318 av.J.C.) enplusieurs groupes auxquels il a donn~ des va-leurs c~ronologiques (Voir annexe I). Seulsles quatre premiers sont repr6sent~s dans letresor de Kyparissia CIQfl!,no76), c ensa avoir
E.T.Newell,Reattribution et Deman~ur. L'~tude dutr~sor de Deman"ur est plus f ou i L'Lo e rue la prGc~-dente. 211e tient co pte de 1582 pi~ces pour leseul atelier d ',\.r"pl-irolis(903 s euLe ment d ons Reat-tribution). Dans Deman~ur, E.T.Xewell donne le nom-bre total de drcits pour 7 ateliers (Voir annexeIII). Avec ses 705 droits, Ampr Lp oLa s est de trssloin I' atelier le plus Lmport ant , ~.ai:=i le n --,isr-a-te am~ricain ne livre pas la r~partjtion de ces 7C3droits par ~mission, co me il l'avait fait douzeans plus tat dans Reattribution pour les 521 droitsalors recenscs. ~ous basons donc nos calculs surles r~sultats de la premi~re ~tude tout en sachantque des ajouts sont nec~ssaires (Deman~Lr,p.66:"Since the publication of tl:at study, a great manyadditional cases of such use in co~non of obversedies between the cosponent me~bers of a sin~legroup, as well as between group and Group, have tur-ned up. T~ese facts, taken togetLer, prove beyond adoubt that these coins are all t~e issues of a sin-gle mint"). Quand il s'agit de calculer le nombrede droits par periode, nous avons effectue une r~-gle de trois qui tient co~pte des ac'uis du tr~sorde Demanhur. (Exemple: Groupe A= 58 droits sur 521dans Reattribution/ 78,5 droits sur 705 dans DeP1an-~ 78 - 58 x 705)~ car ,J= 521 •
(16) Pour les tetradrac:~r:esattiques d'Alexanrlre, il n t y
a au d~but ~u'un seul ~rand atelier. ~.T.Newell pen-
-49-
ete enfoui en 328/7 av.J.C.(17). Ces quatre pre-miers groupes couvrent la periode 336-329, soit8 ans. On d~nombre au moins 200 ~roits, soit 25par an (18). Par la suite, ce nombre va encoreaugmenter, senble-t-il, puisque de 328 ~ 319(Groupes E ~ J), on a grave quelgues SOS droitssuppl~mentaires (Moyenne annuelle: SO,S droits).
Si nous combinons les c La ssement s de l'I.LeRider avec ceux de E.T.Newell, nous obtenons,pour les trois periodes que nous avons indi~u6es,les resultats suiv~nts:
1- (342-337 ) =6 ans 19,17 droits/qn.
11- (336-J29) =8 ans 39 droits/an.
III- (328-319 ) =10 p.ns 50,S c'roits/an.
11 y a dej~ l~ ouelque chose d'~tran~e: latr~s forte expansion entre les deux pre~i~resperLo dea , ~.ais le c ar-act er-e histori-:1.:er.;entali1-bi"" de la deuxierne periodc (336-]29), ot':lesres sources disponibles ne s~nt pas les m~mes audebut qu'h la fin, tend ~ masquer la port~e deces resultats.
Durant trois annees, de 336 ~ 3~4 av.J.C.,les ressources en ;->rg-entd ' i\lexandre le Gr-a nddurent rester ce ru'elles etaient ax temps deson pere (19).
sait ::;u'ils t agissaat d t Amp+d poLa s (Demanhur,I1.67),mais la qu est Lo n n I est pas claire. 11 se:i;bleq ive
"Pella" ait co~mence beaucoup plus tarde
(17) E.T.Ne,vell, '.lexander Hoards I.Introduction an:::1I:v-
pariss;a "·oard,(Nm.; ,3),1921,p.1-21,pl.I-II.
(181 200 (Zn f~it lS9,5) :8 = 25 droits rar an.
(19) No u s ne pensons pas qn e le butin fai t en Tl~race etles 4~0 talents d1argent r6coltes ~ T~~bes aient
-50-
Les product~ons conjug~es des ph~l~ppes pos-thumes (tels que tra~t~s par ~.Le Rider) etdes prem~ers alexandres (selon E.T.Newell) cor-respondent ~ un accro~ssement ~ncompr~~ens~-ble. Une v~s~on globale qu~ adnettrait : lafois les conclusions de T- .• Le Rider sans reniercelles de E.T.Newell, creerait une surproduc-tion pour les prer:ieres annees du regne duconqu~rant (40,17 droits par an entre 336 et334 av.J.C.)(20).
Si nous admettons les conclusions de ~.LeRider pour les philippes I1 post.l-umes , nous de-vons en tirer les consequences. V.}olloi-iRYatres justement insiste sur les r6percussionsqu'avait l'citude du monn2ya~e de Ftili~~e IIsur celui de son fi1s. I'.aisil soutient que:" •••it does not f oLl.ow tt'at t ue b eg i, nr; in."':ofc oLriage in Alex?nder' s n ar.ieHas delayed" (:21)•Pour toute d6~onstrati0n, i1 renvoie ~ l'opi-nion de ~·'.LeRider 1ui-n!eme, c ornr-e i1 l'avaitforru16e pr~s de dix ans plus tat : une ~po-que 01~l il ne croyai t pas en t.i ne f r-a ppe ii"Tor-tante de philippes posthurnes ( ~) ') \'-.- .
rappe-ler :::ue
l'-l.Fricerefuse les cbrono J..o.:-iesde :.•L8 Riderpour les phi1ippes II et en particn1ier le t'3r-minus arbitraire (23) de 329/8 comme fin dugroupe IIB.
modifi6 la situation (Voir infra,p.74). I1 y a peude chances pour que cet arffent ait et~ (re)frappeen Lacedoine.
(20) Groupe A des a Lex rnd r-es Rl'lp':ipo1itains: 7R, 5 droi tsen J ans, soit 26,17 en vn ani Phi1ippes 11 pos-tlumes: 14 droits grav6s par an entre 3J6 et 334.
(21) R.R.Eo11oway,Alexander tJ·e (~rePtt'sC:~oice or CoinTvpes, dans A11N, 27-;28,1921,p , 57.
-51-
Il ecrit a ce sujet: "Le Rider would datethe end of period II to 329/8 BC, making thegroup exactly contemporary with the gold. How-ever, the close interlinking and t~e parallelwith the Alexanders woul~ suggest rat~er thatthis mint of Philips ended at, or very soon a-fter, the accession of Alexander. It is unrea-listic to suppose that the coins in the name ofPhilip with these symbols continued long afterthose of Alexander had ceased, and it is mostunlikely that this group of Alexanders conti-nued mucb after 335 BC"(24).
Les liens ~troits de syrnboles ~u~ existententre les derniers philippes II et les pre-miers alexandres (Voir annexe IV et planc>eXVIII,2-3) donnent raison ~t ~".l-rice,qui areaffirme recemr.:entsa position (25).
D~s lors, ce n'est plus entre 342/1 et329/8 ~ue les ~raveurs a~-phi~olitains ant pro-duit 121 droits mais bien entre 342/1 et 3]6/5,ce qui donne une moyenne de 17,29 par an pourle seul atelier d'Arr.phipolis.Ajoute aces 17,29 droits les 9 autres fabri-ues cha-ue ann~ea Pella (IIA2: 63 droits) et nous obteno~spour la :'iacedoineune production de 26,3 droi.tsannuellenent. Voila qui regarnit une preDi~reperiode qui paraissait bien peu i'ournie.
(22) G.Le Rider,Annu8ire 1968/69 (Extraits des rapportssur les conferences. Nl1mismatique grecgue),dansAEPI':=,1969,p.175-176.
(23) 329/8 est une datation inspiree d'abord par les sta-teres du tr-esor de Corinthe (IGCT,n °77). J.R. Ellis(Philipp II and :'\acedonianIl::perialism,Londres ,1976,p.238-239) tente de l'expliquer d'un point de vuehistorioue: en 329/8 av.J.C., Darius est mort, Bes-sos est neutralise. Desormais, Alexandre, seul pre-tendant de fait, peut se passer de la reference ason pere • Il aurai t donc ordorm e El la Lacedoine dene plus frapper de philippes II post.ufles.
-52-
:':aisle pr-ob Lem e n I es t que dopLa ce , car des-ormais la d eux Lei-;e per-dod e (336-329) se retrou-ve avec ses 25 droits annuals de tetradrach-mes dlAlexandre auxquels nous ne pouvons sansdoute pas ajouter les 43 droits de Philippe 11frappes a Pella (Groupe lIB: 43 droits entre336/5 et 329/8). H.Price nlen parle pas, maisslil refute les philippes 11 posthumes (ulte-rieurs ~ 336) ~ Amp~ipolis, il nla pas de rai-son pour les admettre ~; Pella.
11 y a donc de fortes chances pour qulilfaille renvoyer le groupe lIB de Fella egale-ment ~ notre premi~re periode.
La vision selon ~.Frice cree alors llevo-lution suivante pour les droits:
1- (342-336) =7 ans 32,43 droits/an.
11- (336-329) =8 ans ')- droits/an."-J
111- (328-319) =10 ans 50,5 c1roits (,'_n.
Ce s ys t erne , qui est u n o oicb i.no des vues d eE.T.New-ell, ~';.LeRider et t.Price n t est ::=,c.s
(24) !'.• J.Price,The Coinage of Pllilip II,dans NC,lJ9,197S',1") .238.
(25) 1>1.J •FriQe, Alexander IS Refor", of tl-e ~_acedoniE,n Re-
gal Coinage,p.187: "The conclusion is inescapable:the final issues of Philip 11 are contemporary wit~the first issues of Alexander. It is not reasona-ble to suppose that the issues of Ptilip 11 conti-nued to he struck ,,,,it>these same symbols at tb sa-me time as later tetradrac~ms of Alexander usin~ot'cer s ymb oLs in a regnlarly cranging sequence. Theclose die-linking proves tl,e contemporanei ty of t l.e
last issues of P;'ilip 11 and the first issues ofAlexander. There is no Group of issues of Philip 11
-53-
acceptable tel quel. Il suppose qu'Alexandreait, durant les Duit premieres annees de sonregne, frappe beaucoup moins de tetradrachmesque son pere, Philippe II. C'est inexpliqua-ble et meme tres peu credible.
Nous avons donc obtenu, dans un pr-eir Le r-temps, un scr.ema d'evolution (Systeme E.T.Ne-well/G.Le Rider) plausible ~ condition de s'entenir aux seuls resultats. Mais M.Price a rnon-tre ~ue la c~ronologie de M.Le Rider faussaitles calculs a la base.
Nous avons alors etabli un second sc:6oa in-tegrant les corrections de ;1, .Frice. Ce faisant,l'iopasse a laquelle nous avons abouti noussuggere de crer-cl-er-a resoudre le probLe re au-trement.
C-~E~E~~~!~~~_~~_~~!~!~~~:Le nornbre de droits,rru f, c or+p os e c v aq u e
groupe, ne doit pasetre tenu pour le responsable principal de cesresul tats surprenants. l:eme si les :-asards dela conservation ne nous permettent pas de pos-seder- im exemplaire au rnoi ns de tous les droi tsproduits, la plupart d'entre eux s~nt entrenos mains (26).
Les cr.ronologies proposees, par contre,peuvent preter a discussion. Il n'y a qu'uneseule date qui apparaisse corme certaine a lareflexion: 318 av.J.C., date d'enfouissernent dv
tresor de Deman~ur (27'.
whic~ may be placed later than the first issues ofAlexander •••".
(26) E.T.Newell avait trouve 77 droits ~ifferents pourla deuxie' e Serie a Babylone. Son analyse portaitaLors sur 769 tetradrachr;les differents. {\.= • \htG{;o-ner, apr~s avoir collect~ 250 nouveaux tetradrac~-mes de cette S~rie, n'a trouve 0ue 4 nouveauxdroi ts (N .r: .;'fagGoner,Tetradracl~ms fro!:'lJabvlon,(GNA \,11ettere n ,1979 , p .270 , not e 3). Ces ca1cu1s de
-54-
342 av.J.C. est une datation retenue par N.Le Rider que nous ne sommes pas en resure depouvoir discuter (28). La date de 329 est due~ une erreur, suivant h.Price, qui a ~t~ com-mise en voulant aligner l'argent sur l'or.Quant a 336 av.J.C., il est evident ru'elle n~-cessite une prise de position a priori dans ledebat qui nous occupe.
Notre position est toute tracee d'apres lesfaits et vraisernblances acquis dans les pagesprecedentes. Nous reprenons pour extr~mes lesdeux dates de 342 et 318 av.J.C. Nous nous a-lignons sur };.Frice en refutant 329, 'mais n01Spr-ef'o r-ons re tenir la cat <2 de 332 co-:"e le rle-but en ~ac~doine des nouveaux tetradrac ~esatti-::;,ues.
Cn ~ dbs lors grave 7C3 ~roits ~irfArentsd'alexandres a~p~ipolitains entre 332 et 319,ce qui fait, en royenne, 5C,36 ~ar an, tandisqu'entre 342 et 332 av.J.C., 227 droits de p>i-lippes II ont ~te realises, soit une moyenne d~20,6.
Ce sch~ma a l'inconvenient d'~tre ~oins d~-taille ~ue les deux precec.ents (Il n'y a plusgue deux pcriodes) pais l'avantage d'~tre ac-ceptable: il ne semble fautif ni au d~part(Systbme E.T.lewell/G.Le Rider), ni a l'a~rivee(Systeme E.T.Newell/G.Le Rider/i:.J.Frice).
Nous alterons peu les classell'entsde E.T.New eLf, si ce n 'est en comprimant les 70S
droits sur 14 ans (332-319) et non plus sur 18(336-319) .
coins ce droit seront ~ revoir a la lU!1iere de facty.
(27' Cette d?te d'enfouissement du tresor de De~anhur sefonde sur les eres ,.h~niciennes de Sidon et Ake ,Dans les deux cas, la derniere annee representee cor-respon~ ~ l'annee 319/8 av.J.C. (Voir Flanche III,l:
/ erne, ,' )Sidon: lettre ° Ake: 29 - annGe de 1 ~re locale.
-55-
E.T.Newell avoue d'ailleurs avoir r~partises groupes A ~ J entre 336 et 319 de ~ani~rearbitraire et dans une certaine mesure appro-ximative. 11 ecrit: "Between these 1ir'its t.I: ematerial has been divided in such a way that,up to the two or t'-:reeyears ir',r'1ediate1ypre-ceding the actual burial, the avera~e annualproduction, in both quanti ty of coins and rrurn=
ber of dies is reasonably distributed"(29) ouencore: "T'b e elates here assigned to t'--evari-ous groups of Ampripo1is coinage are perhapsto a certain extent approxi;;1ate"(JO).
Rien ne nous ernpecbe de r-edLs t r-dbu er' les705 c'roits au t r-emo nt Et l' interiellr des 1i"'itesque -po ,nous avons ~lxees.T .New e11 , que de s sous c gr-orp es existent ...-0
forI>lentdes enser .b Le s delimi t os ( I" v , VI a.'(11,XIIa a XVII, ••• ) (Voir annexe IV). Nou spreferons toutefois ne pas les dater ~ l'an-nee pres , La rerartition de E.T.Newelln'estd'ailleurs pas "raisonnablement '~istril)lH~e".Le schema suivant le montre:
.-
•• + r-t ~ ~ :' 0-0 r t" ~r _._.
-_ ...•.-. ---
f---.- '""
---==--
-=..•....• t,,1 -I, .
; '~1 'I"
- -,._ ......•. -. .
.11 •• ':_1 •• _.__
.. - ..,., .
-- -- or< .("f". rr r:
-56-
Nous avons retenu la date de 332 plutot quecelle, plus large de 333/2 av.J.C. Si, commeH.Zervos (31) et nous-meme le pensons, Alex-andre le Grand a mis en route son mon~ayagede tetradracr:mes attiques immediatement apresIssos (novembre 333 av.J.C.), Amphipolis nlamateriellement pas pu commencer de les produi-re avant 3J2 av.J.C. Les tresors montrent dlau-tre part que la Lacedoine nla pas du attendrelongtemps avant de faire debuter la frappe(voir surtout le tresor de Kyparissia).
Abaisser ~ JJ2 la frappe des preniers te-tradrac~mes attiques, clest aussi permettre au~227 droits du groupe IIE de Philippe de se re-partir sur 10 ans au lieu de 7.
:;:':.Price,qui a souLe ve la cifficnlte ca.useepar la c.ronologie de L.Le Rider, ecrit:the reform of the coinage took place while the
"
officials responsible for the ST~bols jani-form head, prow, stern, and rudder were stri-king. Whether this took place in JJ6 or JJJremains to be seen"(J2).
Nons pensons avoir montre qulen tirant lesconsequences des remarques de ~.Price lui-meme, il est preferable de situer en 332 ledebut des emissions de poids attique pour laEacedoine.
No t r-e schema peut surprendre du fai t qu I ilprovoque une cassure chronologi0ue au momentmeme (3jj/2) ou philippes II et alexandress~nt unis par les memes symboles (proue, poupe,foudre, gouvernail). Nous evons detailler cet-te periode-cle qui fait la transition entreles deux monnayages.
Pour celd, il faut partir des emissions etdes liaisons de monetaires qui les unissent.Nous avons repris le tableau de N.Price (33),
(28) G.Le Rider,Le monnayage dlargent et dlor de Philip-pe II (frappe en ~acedoine de 359 ~ 294),Paris,1977r
-57-
complete au besoin (voir annexe IV).Un simple coup d'oeil suffit pour se con-
vaincre que, dans les deux cas (p~ilippes etalexandres), nous avons affaire a des groupesextremement solidaires (tres nombreuses simili-tudes de droits). Cela semble indiquer unecont ernp or-aneL't e assez grande (34). r.:aislenombre de droits impliques dans ce probleme(78,5 pour le groupe A de E.T.Newell et 121pour le groupe lIB de h.Le Rider) exclut quecelle-ci soit totale.
Nous savons par Diodore de Sicile (35) quele Mont Pangee pouvait fournir 1.000 talentspar an (36)(Planche XVII,2-3). Si on a ccept equ'un coin de droit servait a frapper entre6.000 et 10.000 pieces (37), il suffisait de150 a 250 droits pour obtenir 1.000 talentsd'argent monnaye sous for~e de tetradrac·~es.199,5 droits representent donc virtuellerert1.000 talents ou encore 1.500.000 tetradracr-mes, c'est-a-dire la capacite de productiontotale du ~ont Pang'e pour un an.
Il est entendu aue les 1.000 talents duPangee furent loin d'etre taus convertis en
p.392: "Je suggererais, non sans hesitation, deplacer le ~roupe IL\2 entre c.3~;~/1 et c.337/G".
(29) E.T.Newell,DeDanbur,p.68.
(30) Ibidem.
(31) O.H.Zervos,Notes on a Book bv Gerhard Kleiner,p.166-178.
(32) ~-;.J.Price,.£.E.cit.,p.187.
(33) 1<.J.Price a note (The Coinage of Philip II,dans i:C,l39,p.230-24l) les liaisons de droits mises en evi-dence par E. T.Ne w eL'L dans la prer-d.e r-epartie de Re-attribution (nol,January 1911,p.l-lO). Les supple-ments faits a celle-ci dans les parties suivantesont ete ajoutes.
(34) Pour les philippes II en argent, seul le groupe lIB,
-58-
tetradracLmes. Une bonne partie a du memen 'etre jamais morm ay ee du tout. La l':acedoinepossedait des orfevres raffines: le cratere deDerveni ou les tombes de Vergina en s~nt lesexemples les plus fameux. Une bonne partie desressources du Mont Pangee a du servir ~ frap-per les stateres d'or (38). Avec ce qui res-tait, il a fallu, en plus des tetradrachmes,emettre toutes les autres unites en argent.Peut-etre meme des regions voisines, comme laTr.essalie, ont-elles battu monnaie avec l'ar-gent du Mont Pangee.
Toutes ces raisons font, selon nOlls, que40 nouveaux droits par an constituent une moy-enne raisonnable pour les tetradrachnes. Ilsrepresentent, suivant le taux adopte, de 160 a264 talents, chiffres qui ne doivent pas etretres loin de la rcalite.
200 droits ne peuvent certainement pas a-voir eta graves au cours de la meme annee.Bien au contraire, un etalement sur 5 ans ap-parait necessaire.
Sur ces 200 droits, 121 datent, selon no-tre schema de pendant ou d'avant 332 et 78,5de pendant ou ~pres cette date •. ous proposons
qui nous interesse, est tres lie par les droits(cfr E.J.Price,.2l?..£!1.,Table A,p.232-233).
(35) Diodore de Sicile,Bibliothegue Historique,XVI,8,6:
(36) Il devait y avoir d'autres districts miniers (voirPlanche XVII,l), mais d~nt l'ir.1portancedevait etrenettement moindre.
(37) Voir, Et ce propos, N.~ .\{age:oner,.2l?..£i!.,p.272,note 8.
(38) En fait, le Hont Pangee est surtout conrru r'01.'=- sor;or. C'est lui qui a perr.1isa ftilippe d'emettre un
-59-
donc de placer les 121 droits de p~ilippesgrav~s ~ Amphipolis entre le milieu 3J6 et 332av.J.C., soit une periode de quatre ans et de-mi pendant laquelle les Foraveurs auraient pro-duit plus ou moins 45 droits par an (44,4).
Le fai t remarquable dans cette rypotj'eseest que 336 correspondrait alors ~ un c~ange-ment dans l'organisation de l'atelier. Alexan-dre le Grand aurait nomrne quatre monetaires en336 av.J.C. pour qu'ils continuent a frappersimultanement les tetradrachmes de son pere.
Ces ouatre monetaires auraient continu~leur activite meme apres l'adoption de la nou-velle monnaie. Les 78,5 droits d'alexandres re-pr~sentent a ce point de vue pr~s de deux ans.
L'>ypotl-}eseque nons deveLo ppons place legroupe A de B.T.Newell (Emissions I a v) en332 et 331 av.J.C.
Sous certains aspects, elle provoque plusde problbmes ~u'elle n'en resoud (en co~pri-mant le groupe lIB d'Amp~ipolis sur la perio-de 336-332 av.J.C., nous creons Ln vide a laperiode precedente (342-337 av.J.:.) cue nousne pouvons combler qu'en "aspirant" tous leseroupes anterieurs vers cette derniere).
Parfois aussi, notre ~ypot~ese perrnet d'reu-reuses coincidences. En voici un exemple: si.nous tenons pour acquis cue la productivitedlAmphipolis n'a pas varie au cours des an-nees ,ui separent J32 de 319 av.J.C., no~s at-tribuons par la 50,4 nouveaux droits par an al'atelier (705: 14= 50,4). 1-0llSsavons d'au-tre part que le titre EA.t: If\. E:J1.S: n I apparai t
I' 1 37eL1e,.. 1 ..,~I emed .t ("9)qu a a - emlSSlon sur e J~~ - rOl J •Si nous calculons la date dlapparition de
ce titre d'apres les ratios adoptes, cela nous
monnayage regulier de stateres. Diodore, 0uoiquen'etant en general pas suivi sur ce point (~.R.Bel-linger,2E.£i!.,p.35,note 3), specifie nu'il s'agitde 1.000 talents d'or.
-60-
donne le milieu de la dixieme annee, c'est-a-dire juillet 323 av.J.C., moins d'un ~ois a-pres la mort d'Alexandre le Grand (13 juin323)(40). Il n'est donc pas certain que l'appa-rition de ce 3A.~II\E'~n'ait aucune si:<;ni-fication particuliere a Amphipolis (41).
Voila developpe ce moment-charniere (336-331 av.J.C.) dans le cadre de notre interpre-tation. Ceci termine notre analyse des philip-pes II posthumes.
C.La serie a l'aigle.
La serie a l'aigle est desormais classee de ma-niere convaincante. Halgre le type du Zeus laure etle poids thraco-macedonien repris a Philippe II,ces tetradrac'~lYesfurent longtemps places par cer-tains numismates en Bactriane (42). Cela pour deuxraisons: la provenance (un exemplaire est cense ve-nir de Raw aLpLrid L] et l'iconog-raphie (une des mar-ques de monetaires, apres avoir ete prise pour uneproue, a ete identifiee a un bonnet satrapal encuir)(Planche XIX,l).
E.Pegan resolut le different (43). "Il s'est a-per9u, en effet, qu'une monnaie de Fatraos, roides reoniens de 335 a 315 environ, etait surfrappeesur l'un d'entre euxll(44). Des lors, l'origine ma-c edonaenrie devenai t e)tremement probable (Planc'-eXIX,2-4). 1-:.Pricea meme propose d'attribuer la se-rie a l'aigle a l'atelier d'~egae (45). E.Pegan sou-ligne que la tete de Zeus au droit des tetradrac~-
(39) E.T.Newell,Reattribution,p.197-lg8.
(40) 14: 521= (),48: 35L~.
(41) A.R.Bellinger ecrit (2l?,.cit.,p.l,note1): " •.•andit evidently has no constitutional significance,for sometimes an issue with the title will be suc-ceeded by one without". Dans son etude de l'atelierde Babylone, N.1-i.Waggonerplace cependant aussi l'ap-
-61-
mes a l'aigle se rapproche le plus de celle qui fi-gure sur les philippes d~nt le symbole est le can-thare (46). M.Le Rider classe ses philippes au can-thare au tout debut du groupe IIB de Pella (en 336av.J.C.). E.Pegan place la serie juste apres 336.Nous aurions tendance a la placer immediatement a-vant 334 av.J.C.(47).
De toute manlere, il s'agit d'un monnayage detres faible inportance (2 emissions, 3 droits et5 revers connus) d~nt l'existence marginale est sur-tout l'indication qu'Alexandre ne s'est pas seule-ment contenter de perpetuer les monnaies de sonpere. Le role economiQue de cette serie semble, enrevanche, negligeable pour autant que nous puis-sions juger.
D.Autres monnayages.
De tout ce Qui precede, il ressort que deux desremaraues adressees a G.Kleiner s~nt totalement de-pourvues de fondement et que, jusqu'en 33J av.J.C.,Alexandre le Grand peut fort bien se passer re sestetradracrQes sans que le systeme soit lacunaire.
Nous n'avons aborde jusqu'ici que les t~tradracr-mes, qu'ils soient au non de Philippe ou a celuid'Alexandre, de poids thraco-macedonien ou attique.
Pour etre complete, cette etude devrait envisa-ger le cas de toutes les petites unites d'or ou
parition du a~~IA~_<1.~ en 323 av.J.C'(.£E.cit.,p.276:Serie VI: 324/3-323/2). Les deux plus grands ateliersde l'empire auraient donc, selon ces classements, a-joute le titre juste apres la mort d'Alexandre leGrand.
(42) R.B. "lvhitehead ,.£E,cit.
(43) E.Pe~an,Die frilhesten Tetradrac~men ~lexanders desGros sen mi t dem Adler t il1re ITerkunft und .2ntste1'ungs-~,dans ~,18,1968,p.99-111.(p.I03: "Vor eini&enJahren tauchte im lViener i'ilinzhandeleine Hilnze auf,
-62-
d'argent. Nous manquons cruellement d'etudes pources petites divisions. Il y a la, selon nous, toutun champ de travail qui attend les numismates. Enrestant superficiel, on peut dire que deux types demonnaies semblent a priori riches en enseignements:les monnaies de Philippe II ayant au droit une teted'Heracles (48) et les monnaies d'Alexandre ayantau revers un ou deux aigles ~ur un foudre.
Alexandre n'a pas utilise que les pieces a sonnom: il a du se servir des avant la capture desbutins perses de chouettes atheniennes, shekelspheniciens ou dariques perses.
Il existe aussi deux monnayages en Grece qui antete emis pendant les premieres annees du regne d'~-lexandre le Grand mais qui ne sont pas a son nom:le monnayage amphictioniaue de Delphes et les drach-mes dites d'Aleuas de Larissa en Thessalie.
Les monnaies amphictioniaues semblent etre uneemission d'urgence limitee dans le temps (336-334),l'espace (environs de Delphes) et le volume (pasplus de 200 talents) pour permettre de rebatir letemple d'Apollon (Planche XVI,1-2). Les sources e-pigraphiques permettent pour une fois de fixer avec
die starke Uberpragungsspuren auf'w i es , Das Stuck istein Stater des Patraos, angeblich auf eine Tetra-drachme Alexanders III. vom sog.Adlertypus uberpragt.Die unansehnliche Mfinze ist unscharf und teilweiseauch unklar. Sie ist stark beschnitten, und wiegtheute 12,49g").
(44) G.Le Rider,£E.cit.,p.39J.
(45) H.J.Price,,2J2•.£i!.,p.238-239.
(46) E.Pe ean ,£E •.£i!•.'p •106 •
(47) Voir supra,p.44.
(48) Ces dernieres sont tres souvent associees avec dessymboles qui se retrouvent sur les premiers tetradracl:-mes de r·:acedoine.
-63-
surete ces pieces dans le temps (49): elles ont eteernises entre le printernps et l'automne 336 av.J.C.(50). En verite, il n'y a sans doute pas lieu de lesintegrer dans la politique monetaire de PhilippeII ou d'Alexandre (51).
Les drachmes d'Aleuas, frappees a Larissa, ontvraisemblablement ete emises a la meme epoque(Planche XVI,3): elles representent d'un coteAleuas, le heros legendaire de la Thessalie, etde l'autre un aigle sur un foudre, du type de ceuxqu'on trouve parfois sur les petites divisions enargent au nom d'Alexandre III le Grand. Cet aiglethessalien a ete pris par p:.Sordi comme le proto-type de la serie a l'aigle frappee par Alexandre(52). En realite, nous trouvons dans les monnaya-ges des rois de ~;acedoine un antecedent plus si-gnificatif: les trioboles d'Amyntas III (389-383 et381-369 av.J.C.), de telle sorte que la Thessalien'a pas inspire mais a plutot repris un type a A-
lexandre.
Celui-ci a du se fonder egalement sur une eco-nomie nredatoire o~ butins et contributions four-nissent souvent ce que les ateliers monetairesn'ont pas permis d'acquerir.
Quand A.R.Bellinger ecrit: "None the less, wehave sufficient reason for believing that in theperiod suceeding the battle of Issus Alexander didnot intend to continue the local coinages of t~e
(49) E.Bourguet,Fouilles de Delphes. Tome III:EpiF-ra-prie. Fasc.V:Les c00ptes du IVe~eSieCle,Paris,1932,Inscription 48.
(50) E.J.P.Raven,.2l?•.£i1.,p.J: "Consequently w e can nowsay that they were first minted between spring andautumn 336".
(51) S.Perlman,.2l?•.£i1.,p.59.
(52) ~;.Sordi,La drac~a di Aleuas e l'origine di un ti-po :nonetario di Alessandro !':arrno,dans~,J,1956,p.9-22.
-64-
district but to replace them with his own, "(53), c'est admettre en quelque sorte implicite-ment qu'avant la bataille d'Issos il n'a pas deraison suffisante pour le penser.
(53) A.R.Bellinger,£Q.£ii.,p.55.
-65-
andres d'Arnphipo1is (Les resu1tats de Reat-------------------- ----
Demanhur).
tribution ont ete completes par ceux de
(!§§~)5519411135
I
IIIIIIVV
ProueFoudreTete janiformeGouvernai1Poupe
VI ArnphoreVIa Sty1isVII CanthareVIII Guir1andeIX Casque attiqueX Feui11e de cheneXI Grappe de raisinsXII Caducee
XIIa Caducee + bandeauXIII CarquoisXIV TridentXV Protome de PegaseXVI Epi de bleXVII Arc
XVIII Tete d'aig1eXIX t-lassueet.i0-ou.rv::LXX Cadu cee et .fiLoumXXI Bouc1ierXXII f.';assueXXIII Etoi1eXXIV Tete de cheva1XXV DauphinXXVI Acrosto1ion
r< + Caducee
151020
713
121
4
4
314
6
J
56
1
91
1
7141014
2
48
4
2
291023
614
20
1
4
64
1613
2
4
51
94
5
1120
1014
2
L~
752
(35 )(12)(25)
(5 )(15)
(21)(1)( 6 )
(7 )(2 )
(22)
(1~~)
(4)
( ~ ):;,
(7 )(2 )
(11)( 4 )(9 )
(12)(34 )
( 9 )
(19)(3)(5 )(9 )(3 )(3)
363
1211
4
3631
7
8
155
21101f
22
451827
4
8
1156
1
-66-
XXVII Rose 1 1 (1) 1XXVIII Coq 43 53 (69) 103XXIX Croissant 13 14 (16) 35xxx Bermes 33 36 (47) 76XXXI ~ ou.::.J- 23 26 (36) 50XXXII Caducee 18 24 (25) 42XXXIII Bucrane 25 31 (34) 60XXXIV Penta1pha 3 4 (4) 8XXXV Coqui11age 1 1 (1)
XXXVI Etoi1e dans cerc1e 7 6 (7 ) 14XXXVII Corne d'abondance 20 26 (34) 58XXA'VIII Pa11as promachos 15 22 (26) 47XXXIX Arc et carquois 14 17 (19) 29
XXXVIIa Corne d'abondance 22 2J (30) 57XXXVIIIa Pa11as promachos 20 27 (31) 68XXXIX a Arc et carquois 20 21 (22 ) 42
XL Dauphin 2 3 (4)XLI Bois de cerf 18 20 (21) 41XLII Casque macedonien 24 40 (55) 93XLIII Bonnet phrygien 43 53 (66) 112XLIV Trident 2 2 (2 ) 2
XLV Trepied 8 8 (7 ) 13
XLVI M 9 9 (7 ) 17XLVII ~ 9 11 (7 ) 24XLVIII ~ 14 16 (11) 26
XLIX Rameau de 1aurier 1 1 (2 ) 1XLIXa " " " +F' 7 8 (6) 18L Epi de grain 3La " " " +r 4 5 (2) 10LIa Croissant +r 9 8 (7 ) 12
E +/\ 1
-67-
Remarque: (1664)= nombres de specimens contenus dansDemanhur pour chaque emission.
Annexe II:
Remarque: Ces c1assements s~nt ceux donnes dans Reat-tribution en 1911. Nous avons a chaque foisajoute le nombre de specimens trouve dansle tresor de Demanhur en 1923. Entre cesdeux publications, E.T.Newe11 a change l'or-dre de certaines emissions a l'interieurd'un meme groupe mais ces derniers n'ontpas varie.
Droits
Specimensdans letresor deDemanhur.
Groupe A I a v 336-334 58
Groupe B VI a XII 333-332 28 140.
Groupe C XIIa a XVII 331 15
Groupe D XVIII a XXVI 330-329
Groupe E XXVII a XXXV 328-327 157
Groupe F XXXVI a XXXIX 326 48
Groupe G XXXVIIa a XXXIXa 325 51
Groupe H XL a XLV 324-323 75
Groupe I XLVI a XLVIII322-321 26
Groupe J XLIX a LIa 320-319 16
521
375.
148.
261.
1581.
71.
44.
-68-
~~~_~~~~_~~_~E~~~E_~~_~~~~~~~E_E~~E_~~E~ateliers d'A1exandre (voir E.T.Newe11,
Demanhur,p.151).
Nombre de Nombre de Nombre dedroits. revers. specimens.
Ampbipo1is 705 1281 1582
Baby10ne 172 498 630
Tarse 69 306 462
}!yriandros 25 122 178
Sidon 24 60 113
Ake 25 130 207
Alexandrie 43 150 217
-69-
Annexe IV: Liaisons de monetaires entre les derniers
PHILIPPE 11.
Raisin[ Lien( tete de face)
[Tete janiforme (entre jbes)Preue (")P.upe (")Omphalos(")Tete janiforme(seus chevalPreu (")Poupe (rt)
Omphalos(n)Poupe, (n)Abeille,tete janifermeAbeille ,proueAbeille ,poupeAbeille,amphalesAbeille,g~uvernail
Les derniers philippes II ontcomme symboles la tete janiforme, la proue, la poupe et legouvernail. Ces symboles se retrouvent sur les premiers a-lexandres. Pour ces derniers,il a ete tenu compte des mo-difications apportees par B.T.Newell dans son etude du tre-sor de Demanhur.
VI.Amphere JXI.Grappe de raisins~-;-·-,~,_
VII.Canthare ,-I..Feuille de lierre _ ] -,-
AIEXANDRE Ill.
I.PreueV.Pcupe
III.Tete jamiformeII.FQudreIV.G0uvernail
VIII .Gui rlandeVla.Stylis
IX.Casque attiqueXII..Caducee
XIII.CarqueisXVI .Epi de bleXIV.Trident
Xlla.Caducee + bandeauis .Pr.tome de pegase]
XVII.Arc
-70-
-
-1-
-=
]
I,--'
5. Sources ecrites.
La politique monetaire d'Alexandre le Grand n'aete mentionnee explicitement par aucun auteur an-cien, par aucune inscription. Toutefois les sour-ces ecrites, epigraphiques ou litteraires,meri-tent d'etre interrogees meme s'il ne faut pas es-perer y trouver la cle de notre probleme.
A.Les sources epigraphiques.
Il existe deux documents epigraphiques qui,sans etre decasaf s , sont d 'une r-e eLt e Lr-p or-t ance ,Il s'agit de deux inscriptions "delphiques datantdu printemps JJ5 av.J.C.(archontat de Dion).
La premiere dit: "Aux naopes pour des achatsde cypres: 150 philippes d'or"(l) et la secondeprecise ou'un philippe d'or correspond a 7 state-res d'argent (2).
Plutot que de nous perdre en explications bi-metalliques, c'est l'absence de reference au mon-nayage d'Alexandre qui nous frappe. Pourquoi n'enest-il pas question sur ces inscriptions a carac-tere officiel? Faut-il supposer simplement que lesphilippes II etaient encore majoritaires a l'epo-que ou bien sommeS-TIOUS en droit d'aller plusloin? Car c'est precisement en JJ5 av.J.C. qulileut ete necessaire d'afficher les equivalences dela nouvelle monnaie.
Il s'agit naturellement ici d'un argument ~silentio d~nt la valeur est faible par lui-meme.
(1) E.Bourguet,Fouilles de Delphes. Tome III:Epigraphie.Fasc.V:Les comptes du IVe~esiecle,Paris,19J2,p.199,50,col.II,9-10.
Idem,col.II,lO-ll.[
,-. ) I~- iS' iO'<:,J "v'JOTTLO,]OiS €!S i-;u~~? /.,6juO-'; C(ll :1;::[ID.)5
/ • ,;../ ~... 1' ••.• r- \
io XfLv]V-03[<;J t[kdTOI n<]v!i",r'tovti.;..J.C[:'J.j r-J./ f"v FL-rti:"," /"':',
d. aT..i.L"iJ~e[GiJ 1""00"';'00 ;~~[vf_T.::> (\~ .if '\...)t"-.)-.) iTJ.. <-<10 ••..'
-71-
B.Les sources litteraires.
La situation est analogue pour les sourceslitteraires quand Horace ecrit: "Il plut au roiAlexandre le Grand, ce Cherilus qui, en paiement devers mal tournes, veritables avortons, regut tantde philippes, monnaie royale"(J). Ici encore, ilest question de philippes sous Alexandre. Jamais,en revancne, l'existence d'alexandres n'est expli-citement rapportee pour les premieres annees deson regne.
Quant a connaitre l'evolution des finances d'A-lexandre le Grand, le probleme est delicat. A.R.Bellinger a rassemble les materiaux.
A la mort de Philippe II, les caisses du royau-me etaient vides. SeIon Quinte-Curce, Alexandreherita de son pere de 60 talents a l'actif et d'u-ne dette de 500 au passif (4). Arrien rapporte quePhilippe II legua a son fils moins de 60 talentsainsi que quelques coupes d'or et d'argent (5).
Plus grave: Alexandre, selon Arrien, accrut ra-pidement la dette laissee par son pere, la faisantpasser de 500 a 1.JOO talents (6). A.R.Bellingernote tres justement a ce sujet: "It must be obser-ved that he did not say he was without funds when
(J) Horace,Epistolae,livre II,epistol~l:ad Augustum,2J2-2J4.
"Gratus Alexandro regi ~agno fuit illeChoerilus, incultis qui versibus et male natisRetulit acceptos, regale nomisma, Philippos".
(4) Quinte-Curce,Histoires,X,ll.
(5) Arrien,L'Anabase d'Alexandre,VII,9,6:LI . 0. \. ,- \. ; \ \ J
OS nc.i.e--..L~o..~.K.\)\1 i1~rd. 'T~u TT•••."TpOSXt'vc...:. 0l'V ~J.i J.r~·J'(v..J" o : / / . ,.) " ,-.. I ;(niiv.>F'T":" 0). '{$J.. » 1..()..u-VT.l Sc- ov~<:. t.~~p,~OV1~ cv TO,Sn - -- <'",.) . t' - '\ ~,. ~
Or-/OJ0?O·S", t'f-uV ..)[" O~C\"\:>~~\lJ. vITO ..::RI iTi~:;)iJ c"-srr~v T.A I<cxn.l T~~.j.vTu..J"
(6) Ibidem.
-72-
he landed in Asia; being in debt is a differentthing" (7) •
Pour son passage en Asie (printemps 334 av.J.C.).,Plutarque, reprenant Aristobule, cite le chiffrede 70 talents (8). Douris parle de provisionspour 30 jours. Onesicrite va plus loin encore:Alexandre etait a ce moment en dette de 200 ta-lents. La petitesse des moyens dont il dispose estmanifeste. Ch.Seltrnan a eu, a ce propos, des paro-les tres etonnantes. Apres une introduction dithy-rambique sur Alexandre, il declare: "It is wiserto discard the story that Alexander was heavily indebt when he started for Asia, especially as t~emost trustworthy authority, Arrian, does not allu-de to this. It added a romantic flavour to the ta-le that Alexander enterin~ Asia should appear likethe poor boy entering the great unfriendly cityw i t h half a dollar in his pocket"(9). Il est clairque tous les auteurs sont unanirnes sur la precari-te des ressources d'Alexandre au debut 334.
La situation ne s'ameliore guere en cours d'an-nee: Alexandre manque toujours de disponibilitesa i':ileten aodt 334 av.J.C.(lO).
H.Price fait cependant remarquer que "It wouldbe ,,,rongto suggest that Alexander must have beenin financial troubles in 335 merely because in334 he crossed to Asia with only 70 talents, debtsof 200 talents, and provisions for only 30 days"(11) •
(7) A.R.Bellinger,Essays on the Coinage of Alexander theGreat,(~ ,1~,1963,p.37,note 6.
(8) Plutarque,~: Alexandre,XV,2:;,C ' cS'" ~, I. ~.A.c ,l.-~o~.o·J [. 10.f['<::> SOl.) nA":'0\/ e\-'00tJ-~,~')v'T';' I,.,L <J..J'f'.XJ'J
>, ~ \)A ,. Cl' '- ,. ,\ - ,"-X£'\v J.0'T01I tl(J'TO\:>O'.JAO::, iQ~O~n:'I>w.o..)?\':) Se:- T~")IJKO\/T~
, c... ,. S "':> " \UO''/O,,' r--u.(.awv ~J.TPO'Dv-\l, OVy-.OIK.",,:o< SE: ~,..J..'. ~;...A.r.;xj\J.,t- - . ~ I"" c \, ..,.-- t .I t \ _""")
I \ rTJ--t\J-Vf ••••.TiE'OG'O?t:I ), ~ Iv
(9) Ch.Seltman,Greek Coins,2e~eed.,Londres,1955,p.207.
-73-
Il se peut, en effet, qu'on ait frappe de tresnombreux philippes et alexandres en 336 et 335 maisque ceux-ci aient ete entierement utilises dansles preparatifs de l'expedition.
Il est aussi exact qu'Alexandre a fait du bu-tin en Thrace (12) ou en vendant les Thebains com-me esclaves (440 talents d'argent)(13).
Tout cela n'explique pas pourquoi dans le clas-sement E.T.Newell/G.Le Rider on passe de 19,16 a39,16 droits par an entre les periodes 342-337 et336-334, c'est-a-dire entre deux periodes ou lesressources en argent d'Alexandre le Grand n'ontpas dfi fort varier (~oir supra,p.50).
(10) Arrien,L'Anabase d'Alexandre,I,20,1:;, / -. - -' ~, " .A >. E'~ tl.vS~o<:, s~ i'\d.Tu..AuGd-1 f:if v:s: 70 V';'0Tl KOJ et"; ~w..,)v
) "'.> j ~ :...
'IT. t» <i';.p "foIE.: c!'IT0\?1..l i-<J.l <A.r,).. 0...):< .J ~lO rtcJ.X:0J O:2I.).J',1
\ '-.--.-Vcl."t7iKDV T~ \ \fo()\\"(;:D
\
(11) M.J.Price,Alexander's Reform of the ~:acedonian ne-gal Coinage,p.189.
(12) Arrien,L'Anabase d'Alexandre,I,2,1 et 4,5.
(13) Diodore de Sicile,Bibliotheoue Historigue,XVII,14,4:'To:"S .) J.~",~J..),,:~70"t;A<.Lc?v 20-;\U) I'/)-J.S ~:eeo.(f'r:vj / ,4\ "....,.dt' ~:)l'ID) 1d..,\;(,A\J'r VI. n'1 pJ... KO~', <.J.,. Kc..L\ -rt:~-Cu?ti.'"'J'..!T•..•..
-74-
6. Circulation.
Nous avons montre, jusqu'a present, que rienn'obligeait a placer les premiers tetradrachmesde poids attique d'Alexandre en 336 av.J.C. Nonseulement cette date de 336 ne peut etre etabliepar une preuve determinante, mais elle pose en ou-tre de serieux problemes touchant a des faits plusverifiables que les mobiles psychologiques suppo-ses du conquerant.
Il nous faut confronter maintenant notre pre-somption a la realite de la circulation.
A.Tresors contenant des alexandres.
Qui consulte l'Inventory of Greek Coin Eoards(1) est frappe par le nombre de tresors contenantdes alexandres (voir supra,p.2,note 2). Si nousne retenons que les tresors censes avoir ete en-fouis au IVe~esiecle, 184 d'entre eux en s~nt com-poses. La repartition par atelier est connue pour81 de ceux-ci. Parmi ces 81 tresors d'alexandresventiles, 53 s~nt des tresors de tetradractmes.Sur ces 53 tresors, 14 seulement s~nt reputes a-voir ete enfouis en 320 av.J.C. Oll avant. 14 tre-sors donc, d~nt 7, au maximum, re~event du vivantd'Alexandre (2).
Voici la liste de ces tresors:
1330-325 Tars~: 1. __ .1
j30-320 Babylone:l.327 Amphipolis:15.
Tarse:4.
IGCH 74IGCH 1663IGCH 76
HageiraTel el AthribKyparissia
Ake:l.IGCH 1506CH II 52IGCH 1436
Qasr Naba 329-320 Babylone:l.Thessalie 1323 Babylone:l.Asie Eineure 19-6-6132~Amphipolis :11.
/ Tarse: 7., •••(46 alex.).
1-------+---:--:---- .~- - I-IGCH 79 Nemee /325-320 Amphipolis:l.
-75-
La datation des tresors de Tel el Athrib (lQ£li,n01663) et de Qasr Naba (lQ£B,no1506) fait l'ob-jet d'une discussion dans la seconde partie de cetravail (3). Ces deux tresors, comme d'ailleursceux qui datent de 323 av.J.C. (~ II,no50 et lQ£[,1436), ne nous interessent pas ici au premier chef.Le tresor de Nemee n 'est pas assez COUHU po u r: et ...tpleinemen~ u~lllsable (4). On conviendra que ~enombre de tresors susceptibles de nous eclairerest tres limite.
Cela doit etre un enseignement important: iln'y a pas de tresors d'Alexandre d~nt la date d'en-fouissement est anterieure a J30 av.J.C.
Le premier tresor a contenir un nouveau tetra-d r-a chr ;e attique es t sans d o te celui de i'.ageiraC!Qf.!i,no74).O.H.Zervos comme L.J.Price en parlent(5): O.H.Zervos pour faire remarquer que le se~l te-tradrachme d'Alexandre a ete frappe tres tot a Tar-se (entre 333 et 327 selon E.T.Newell: droit nOll/28me, .. d 1 .' ,.. l'O+'f"- emlSSlon e a preclere serle cans ~ lClneA); .1.J.Price pour insister sur son degr-e d t usur-e ,
qui rend improbable une dataiion aussi r.aute queJ32 av.J.C. (cfr 0.E.Zervos,.2.l2.cit.,p.171:"Tb ehoard seems to have been secreted some years beforethat of Kyparissia, at a time when tlleAmphipolismint eitller had not yet produced any Alexandercoins or Dad tl>ereto struck only fe,,,").
Plutot que de souligner la part obligee de sub-jectivite qui entre dans l'appreciation de l'usureou d1essayer d'expliquer cette presence unique enGrece d'un tetradrachme frappe en Cilicie (6), nous
(1) N.Thompson,O.Mork:holm et C.I<.Kraay,An Inventory ofGreek Coin Hoards, New Yo r-l ", 1973.
(2) M. J •Price (Alexander's Reform of .:acedonian RegalCoinage,p.188) mentionne un nouveau tresor trouve ent-1acedoine.Enfoui vers 325 av.J.C., il contiendraitpas moins de 860 pieces.
(3) Voir infra,p.93~94.
-76-
preferons soulever un autre paradoxe.Si, cornme M.Price le souhaite, on ne re~onte
pas de quelques annees la date d'enfouissement dutresor de ~:ageira, on cr-e e par la meme une perioded'au moins 6 ans (336-330) d~nt aucun tetradracr.-me ne nous est parvenu (7). Admettre cela, c'ests'empecher, sous peine d'incoherence, d'utiliserun des meilleurs arguments en faveur de d.J.Priceet E.T.Newell: l'absence presque totale de philip-pes II en Asie Mineure (8). Pourquoi, en effet,trouverait-on des philippes II en Asie qui n'au-raient du circuler que durant 4 ans (336-333 ay.J.C.)(9), si on ne trouve d'alexandres nulle partdurant au moins 6 ans (336-331 ? Les comoentairesde t-;.J.Price nous semblent done dangereux pourla these qu'il defend.
(4) Il n'a jamais fait l'objet d'une oonograp~ie (cfrIGCE,no79,p.13).
(5) Voir TIce Earliest Coins of Alexander the Great, dans~,142,1982,p.171 et 186.
(6) t-1.J.Price(,2J2 •.£i!.,p.186) lie ce tetradrachr.lede
Tarse et ceux du tresor de Kyparissia a la missionde Cleandre qui, parti de Tarse, revint dans le Pe-loponnese avec de l'argent pour lever des renforts(Quinte-Curce,Histoires,III,l: "Inter haec Alexander,ad conducendum ex Peloponneso militem Cleandro cumpecunia misso, Lyciae Pamp~yliaeque rebus co~positisad urbem Celaenas exerciturn adrnovit").
(7) Cette periode creuse peut avoir dure 11 ans, si onplace le tresor de Nageira en 325 av.J.C.seulement.
(8) Cette absence n'est pas totale: le tresor de Prinkipoen Bythinie (1.Q.£.!i,no1239)contient au moins 27 phi-lippes d'or. Il faut aussi noter que le rnusee d'Adanapossede 8 bronzes de Philippe II qui furent tres pro-bablement recoltes par r·:deHetty Goldman, en 1935,dans les environs de Tarse (D.F.Cox,A Tarsus Coin
-77-
Le deuxieme tresor est celui de Kyparissia (.!Q.Q.E,n076). Il comprend 4 philippes II dont.3 posthu-mes et 20 alexandres dont 15 d'Amphipolis pour 4de Tarse (10). Voici le detail des tetradrachnesd'Amphipolis:
Groupe A 336-334 10 (Proue:4/Poupe:2/Tetejaniforme:3/Gouver-nail:l).
Groupe B 333-332 2 (Amphore:l/Feuille delierre:l).
-Groupe C 331 1 (Carquois:l).
Groupe D 330-329 2 (Hassue etlU-:l/Dau-phin:l).
Ce tresor, cense avoir ete enfoui en 327, nlestpas tres eclairant puisque, comme le dit h.Zervos(11), le lieu de decouverte est situe beaucoupplus pres de l'atelier macedonien et que ce derniera eu tout de suite (soit des 332, selon nous) uneproductivite nettement plus grande que Tarse. Trou-ver dans le tresor de Kyparissia comme dans celui
Collection in the Adana l'.useum,(l..l.l ,92),1941,p.2:"The owrrer- told me that he had bought the coins lo-cally, that is, in Tarsus or Mersina. The provenanceis of some importance but one can never be sure whe-ther a coin of Ilium or racedonia was brought to theshores of Cilicia by a sailor in the first or in thetwentieth century").
(9) Parmenion part, selon toute vraiserr.blance,pour llA_sie Hineure en mars 336 av.J.C. Philippe II est as-sassine en juillet de la meme annee et Alexandre ar-rive a Tarse a l'automne 333 av.J.C.(cfr J.R.Ellis,Philipp II and rlacedonian Imperialism,Londres,1976,p.220) •
-78-
d'Asie Nineure (1.Q£.!i,no1436)plus de pieces mace-doniennes n'a rien d'etonnant.
~~I.Zervos et Price traitent egalement du tresorde Demanhur quoique celui-ci soit plus tardif. Lespoints de vue des deux auteurs s'affrontent a pro-pos de l'usure des pieces, critere qui ne nous pa-raft pas tres significatif (12). M.J.Price, entous cas, a montre que l'interpretation de O.H.Zervos n'etait pas la seule valable (13).
B.Tresors ne contenant pas d'alexandre.
Un autre volet de la circulation merite sansnul doute d'etre aborde: il concerne tous les tre-sors sans tetradrachmes d'Alexandre III mais quipeuvent cependant avoir ete enfouis apres 336 ay.J •C.
Nous faisons n5tre ici une idee que Th.R.~ar-tin a recemment defendue dans le cadre precis dela T~essalie: "As a final point, it is not t~e ca-se, I suggest that Thessalian coins are wissingfrom hoards of the first decade of Alexander'sreign but rather that, as they are now dated, thehoards of this period can be overlooked when Thes-salian hoards lacking coins of Philip or Alexan-der are always presumed to be perhaps as early asCA.350 BC. Ilow e v e r , since Macedonians coins appearin Thessaly only late in the century, there is agood chance that some of the Thessalian oards li-ke IGCH 58,61 and 71 are considerably later thantheir earliest assiEned burial dates, of CA.350BC, despite their lack of Macedonian coinage"(14).
(10) E.T.Newell,Alexander Hoards I.Introduction and Kv-parissia Hoard,(~ ,~,1921,p.1-21,pl.I-II.
(11) O.H.Zervos,Notes on a Book by Gerhard Kleiner,p.170.
(12) Voir The Earliest Coins of Alexander the Great,dansBf,142,1982,p.170-171 et 185-186.
(13) H.J.Price,.2.l2.sU,.,p.185-186•
-79-
11 est vraiserrblable, en effet, qu'il failleabaisser les dates d'enfouissement de bon nombrede tresors: c'est vrai pour la Thessalie, ce l'estsans doute aussi pour le reste de l'empire.
Les crit~res qui permettraient de realiser cereamenagement s~nt helas assez subjectifs. Nousn'en voyons guere qu'un de plus objectif: les te-tradrachmes posthumes de Philippe 11.
r<aintenant que H.Le Rider a permis d 'y voirplus clair (15), il serait utile de faire les veri-fications necessaires, notamment pour certainstresors macedoniens, grecs ou egyptiens (16).
Cela amenerait probable~ent ~ fournir davantageen tresors une periode qui est relatiye~ent demu-nie pour le mo~ent.
Si nous cocrtabilisons pour la p6riode 340-330av.J.C. unieuement les tresors repris dans l'IGCH:20 contiennent des prilippes 11, aucun des alexan-dres (17). Pour la p6riode suivante (3JO-J20):25 contiennent des p"ilippes rneis 35 des alexan-dres.
Pour~uoi y a-t-il donc si peu de tresors d'a-lexandres durant les pre~ieres ann~es? 11 est dif-ficile d'invoquer la lente~r de diffusion. Tousles tresors nous montrent oue tetradracl;r:.esetstat~res d'Alexandre ont circule tr~s vite et tr~sloin. En un an, bien souvent, les errissions mace-doniennes se retrouvent en Asie ou en ~r;ypte. 11serait paradoxal, dans ces conditions, de pr5nerpour les pieces d'Alexandre tanttt une lenteur a-normale de circulation et tant8t une rapidite ex-treme. Co~e la grande rapidite est bien attesteepar les tresors, c'est sur elle que nous devons
(14) Th.R .!>_artin,The End of TLessalian civie Coinage inSilver: ~·.acedonianPolicy or economic Reali ty, (!:E..£-ceeding~ of the Ninth International Numismatic Con-gress,Bern.lO-15 September 1979)?Berne,1982,p.llO.
(15) G.Le Rider,Le monnayage d'argent et d'or de Phi-lippe 11 (frappe en Macedoine de 359 ~ 294),Paris,1977.
-80-
nous aligner et, des lors, nous demander pourquoiles premiers tetradrachmes de poids attique frap-pes a Amphipolis n'ont pas circule. L'absence detresors a ce sujet releve-t-elle de la simple vi-cissitude des decouvertes ou y a-t-il aussi une er-reur dans nos postulats chronologiques?
(16) Voir lQ£li,no60,65,70,75,385,386,387,388,389,390,402,403,1654,1656. Le tresor de Pyrgos (lQ£li,no75), nousl'avons deja ecrit (supra,p.44), contient 4 pbilippesposthumes sans aucun alexandre.
(17) L'IGCH date le tresor de Qasr Nab~ (no1506) de 3J2av.J.C. Il s t agLt d t une erreur (voir infra,p.~'1-~.Letetradrac~me d'Alexandre ~ ete frapp6 a Babylone etappartient 8 la periode 329-325 av.J.C.
-81-
7. Contexte historique.
Abaisser de trois ans la frappe des premiers te-tradrachmes de poids attique s'inscrit dans le cli-mat "historico-psycbologique" de l'epoque.
"L'avenement d'Alexandre, ecrit 1- .Le Rider (1),avait ete difficile: comme l'a bien montre J.R.El-lis (2), le jeune souverain dut dejouer une conspi-ration ourdie c~ntre lui par Amyntas et eut besoinassez longtemps du soutien des puissants compagnonsde Philippe II. Il lui fallut certainement mon-trer une fidelite particuliere a l'egard de la me-moire de son pere, et la continuation de la frap-pe de philippes d'or, d'argent et de bronze putconstituer une des manifestations de cette piete,outre qu'elle presentait en merne temps, selon tou-te vraisemblance, les avantages d'ordre economiqueevoaues plus haut".
E.Price a decrit de la meme fa~on le contextedu debut du regne d'Alexandre (3).
Nous n'avons toutefois pas traite cet aspect enprofondeur. Il constitue, en nuelque sorte, la toi-le de fond sur laouelle se dessinent les actionsdes premieres annees qui suivirent 336 av.J.C. Ilreleve cependant trop du domaine subjectif pour a-voir valeur, sinon de preuve, du moins d'argumentserieux au service de la vision que nous defendons.
(1) G.Le Rider,Le monnayage d'or et d'argent de Philip-pe II (frappe en Macedoine de 159 a 294),Paris,1977,p.437.
(2) J.R.Ellis,Amyntas Perdikka. Philip II and Alexanderthe Great: a Study in Conspiracy,dans JPS,91,1971,p.lS-24.
(3) H.J.Price,In Search of Alexander the Great,dans NOl!=,r" X ./JJ:d..~It<.J pavl t<.l ,noS-6,1978,p.32:
-82-
8. Conclusion de la premiere partie.
L'examen des sources nous a amene a prendre po-sition dans l'etude d'un probleme particulier: A-
lexandre III le Grand n'a pas frappe ses monnaiesen argent de poids attique avant d'etre a Tarse,contrairement a la these admise le plus generale-ment qui place cet evenement des 336 av.J.C.
II existe un faisceau d'arguments allant a l'en-contre de cette derniere. Tous ont leur part de ve-rite. Seul l'ensemble, en definitive, est signi-fiant.
La partie iconographique constitue le point dedepart ~u raisonnement. crest la qu'il faut cher-cher les arguments les plus convaincants en faveurde la these soutenue. Rappelons l'irnitation appa-rente d'un modele de Tarse ainsi que la presenced'un trane perse sur les premieres monnaies d'Am-
phipolis. Ceux qui datent les premiers tetradrac~-mes attiques de 336 av.J.C.devront, avant toutecrose, repondre a cette objection.
Pour la metrologie, citons l'interet economi-cue d'un changement d'etalon monetaire et quand ilfaut le situer, de meme que l'existence d' Ine pe-tite serie de poids thraco-macedonien.
Pour les monnaies qu'aurait employees Alexandrele Grand, il faut insister sur les reconsiderationseffectuees apropos tant des philippes II postrumesque des pieces a l'aigle. De plus, nous avons mon-tre ce que la convergence des vues actuelles a d'in-vraisemblable pour ce qui est des productions desateliers macedoniens.
Les sources ecrites, pour leur part, nous par-lent explicitement des philippes sans jamais men-tionner les alexandres.
La circulation, si elle n'apporte pas la preuvedefinitive, se garde bien toutefois de ruiner notrehypothese.
-83-
Tous ces aspects particuliers s'inscrivent enoutre dans un contexte historique susceptible de re-cevoir une interpretation favorable a notre pointde vue.
-84-
r;-. ----{~.-:.;"Ibdll ~o -. 2- ,"e,. .
r-
ME (RC h 0
Se H EIS PARTHI[
E N-----.-
efJC"'61
K A R
A AN
RE
[r/i/I/lerllf.l.f:_ lllg AleXBflders.
••.••...• ZuidesKralerosu.18hrt des N~arch. ~p rp%"~\.
-QER-~'i::J
100 sa {, H1u soo JjJiJC.-L_ I. -_J_- 2~ .,011 coo cno roo
l=_",,_:.;,..::L * x- ".:.;:;::-=iJiU/Jkm
~
IHI
'U•....III~oP'<D
H
0III11c+CD
c+ 'dt"' f-Jo IIICD 11 11f-J. CD, 0'd CD 0N Cf-J. 0. 11
01:J CD C.••.... c:::\0 .W ::::•.... f-J.•....
0~CD~.•;t>•....CD><III~0.CD11 •....
CD0.CD Q11 Ii
III~0.
Monna;es au nom d'Alexandre 111 le Grand.Planche 11: .J-
(Reproductions tirees de A.R.Bellinger,Es-says on the Coinage of Alexander theGreat,(~ ,1~,196J,pl.l).
E··,- t.-". ,-1J
" ,
er::·-,»'-J'e·. ~ .... -:...•. ,,-.-- --.
e""'" ,",.,-. -.:1.-
-11-
Planche II: Monnaies au nom d'Alexandre III le Grand.
1- Distatere, (Amphipolis).2- Statere (Amphipolis).3- Hemi-statere.4- Quart de statere.5- Quart de statere (Arc et Massue au revers).6- Huitieme de statere (Foudre au revers).
-ARGENT.
7- Decadrachme (Babylone).8- Decadrachme (Porus: Babylonie).9- Tetradrachme (Amphipolis).
10- Tetradrachme (~ l'aigl~).11- Didrachme.12- Drachme.13- Hemi-drachme.14- Obole.15- Hemi-obole.16- Drachme (Aigle sur foudre: Amphipolis).17- Drachme (Aigle sur foudre).18- Drachme (Aigle sur foudre).19- Tetrobole (Aigle sur foudre).20- Herni-drachme (Aigle sur foudre).21- Hemi-drachrne (Aigle sur foudre).22- Diobole (Deux aigles sur foudre).23- Obole (Foudre).24- Hemi-obole (Arc, massue et carquois).25- Quart d'obole (Arc, massue et carquois).
-BRONZE.
26- Unite (Arc, massue et carquois).27- Demi (Foudre).
-III-
Planche Ill: L'ere sidonienne.
-Le tableau est issu de I.L.Mer~er,Noteson Abdalonymos and the Dated AlexanderCoinage of Sidon and Ake,dans ANSMN,ll,1964,p.17.
-La reproduction de la piece provient deA.R.Bellinger,An Alexander Hoard fromByblos,dans Berytus,X,1950-51,pl.VI,n0140.
1)
Year su». Ake (I = 347/6)
~ @ (I)
332/r 9 (2)
33r/o (3)2)330/29 (4)
329/8 (5)328/7 (6) = (20)
327/6 N (7) 1= (21)
326/5 ~ (8) 11= (22)325/4 e, (9) III = (23)324/3 ~K (10) 1111= (24) Tetradrachme323/2 (r r) 11111= (25) de Ptolernee322/1 M (12) 111111= (26) er321/0 N (13) 1111111= (27)
I Soter,
320/r9 I (14) aD: (28)frappe a Si-
~ (S) (IS)Philip III 11 (29) don (~I et X) .
318/7 n (16) = (3°)317/6 p (17) 1= (31)316/5 :L (18) 11:: (32) [I]
315/4 T (19) III =:(33) [2J314/3 y (20) 1111:: (34) [3]
313/2 <l> (21) 11111;;; (35) [4]312/1 0 (22) 111111:: (36) [5]
3II/0 't' (23) 1111111== (37) [6]
3IO/09 " (24) 11111111= (38) [7]309/8 M (25) 111111111:: (39) 1111111 (8)
A308/7 M (26) 111111111 (9)
B307/6 M (27) - (10)
r3061.5 M (28) 1- (II)
t::.
-IV-
Planche IV: La tete d'Heracles revetue de la peau de
lion: antecedents iconographiques sur les
monnaies royales de 1-iacedoine.
1) Tetradrachme d'Amyntas III(389-383 et 381-369 av.J.C.)ou d'Amyntas IV (359-357 ay.J •C. )
~~
3) Hemi-statere dePhilippe II frappeentre + 345 et+ 329 av.J.C.
2) Tetradrachme dePerdiccas III(365-359 av.J.C.)
4) Tetradrachme d'Alex-andre III, frappe aAlexandrie en 324 ay.J.C.
-V-
Planche V: Le Zeus de Phidias a Olympie et les mon-
naies de la Ligue arcadienne.
1) Le Zeus de Phidias aOlympie (restitutionpar Adler).
2) r-~onnaiede la Liguearcadienne (represen-tant Zeus Likaios,vers 480-465 av.J.C.)
J) Honnaie de la Liguearcadienne (480-465 av.J.C.).I
J
111~~~1I111
o I I10 •••
4) Monnaie de laligue arcadien-ne (!470 av.J.C.).
6) Idem(!460).
-VI-
Planche VI: Les monnaies de Na zai.o s d !apr-e s les clas-
sements de E.T.Newell (Myriandros).
Serie I. Serie IV.Groupe A.
'.;j,~SI,'_:nfl f:' .".~.ft:jll :-r51 4- ,__ ""'-"__ . 4;:.
Groupe. ,B.~~~
Serie II. Serie V.
Groupe A.
Groupe B. Serie VI.
Serie III. Groupe B.Groupe A.
-VII-
Planche VIII: Les tranes representes sur les tetradra-
chrnes d !Alexandre le Grand et a PersepoLd s ;',
1) Relief de Per-sepolis.(Dessin).
2) Relief de Perse-polis (Photo).
... .:. :...•.~.
4) Tetradrachme d'Alex-andre 111 frappe aAlexandrie en + 325av.J.C.(AII). D'apresO.H.Zervos, ce seraitici une copie directe.
-.....••~1.,'L.~t•, J) Trane per-
se (Dessin) 0
Fig. 1 - THE Krxc s' "FIELD CHAIR"
(Relief in Apadana, Persepolis)
5) Statere d'argentde r.'azaios(Serie IV).
6) Tetradracr~e d'Alex-andre 111 frappe aT (Iere,.arse - serle,ler groupe,Officine A) .
-IX-
P1anche IX: Contre-exemp1es propos~s par N.J.Price:
Terina et Tarente.
1) Terina (Bruttium12eme "t"' d Veme/,- mOl le u ~ ~1e~emoiti~ du IVe~
2) Statere d'argent deTerina.
J) Terina: statered'argent.
4) Tarente: monnaie frapp~eentre 485 et 472 av.J.C.
5) Tarente: didrach~esd'argent frapp~ entre460 et 420 av.J.C.
-x-
Planche x: Autres exemples de sieges sur les monnaies:
Aetna, Eryx, Rhegion.
1) Revers du tetradrachmed'Aitna de Bruxelles(de Hirsch,no269), frap-pe vers 470 av.J.C.
~.~~::-r .
Rhe-
2) Tetradrachmed'Eryx (vers420 av.J.C.).
3) Tetradrachme d'Eryx(vers 420 av.J.C.).
5) Tetradrachme frappea Rhegion (430 av.J.C.)?
Planche XI: Praisos et Nagidos.
1) Piece de Praisos(Crete).
2) Piece de Praisos(Crete).
3) Statere d'argent frappe aNagidos (Cilicie) entre356 et 333 av.J.C. Le scep-tre de Dionysos est perle.
-XII-
Planche XII: Tetradrachmes d'Alexandre III frappes a
Tarse et Amphipolis.
A
Baal de Tarse.
B c
Zeus de Tarse. Zeus d'Amphipolis.
2) !~!~~~~~S~~~~_~~~~E~~E~~~~_~~~~_E~~_~~~_S~~~~_~~_~~~~!~~!_E~~~~~!~~!_~~~_!~~~~~_~~!!~~~~!~'
•
.• .t .... ~.\, .-
~~11I-8 VI-9
3) Tetradrachmes d'Amphipolis (le~eemission: proue)figurant un trone oriental.
-XIII-
Planche XIII: Details iconographiques du Zeus aeto-
phore a Tarse, Amphipolis et dans quel-
ques autres ateliers.
1) !~!~~~~~~~~_~~_!~~~~(lergroupe,Officine A).
A-Tabouret.B-Sceptre fleuri.C-Chevelure enroulee.
J) !~!~~~~~~~~~~_~~~~-E~~E~!~~(avec che-velure enroulee).
5) Style "sec" de la teted'Heracles. SimilitudesPhilippe II/Alexandre III.
Didrachme dePhilippe II(Foudre).
2) Tetradrachmes d'Am-E~~E~~~~(avec scep-tre fleuri).
(Ashmolean 2527).
tabouret.4) Tetradracv~es sans
6) Tetradrachme de Tar-se (lergroupe,Offi-cine B): aucune mar-que.Tetradrachme
d'Alexandre III(Foudre: II).
-XIV-
P1anche XIV: Monnaies uti1is~es par A1exandre III le
Grand entre JJ6 et JJJ av.J.C.: chouet-
tes et dariques.
1) T~tradrachme attique frapp~a Athenes entre J9J et JOOav.J.C.
J) Imitation d'unechouette ath~niennefrapp~e a Gaza(400-350 av.J.C.).
5) Darique d'or (frapp~eapres JJJ av.J.C.)
2) Imitation ~gyp-tienne d'unechouette atb~-nienne (avec lenom d'Artaxerxesen d~motique).
4) Darique persefrapp~e a Sardesavant A1exandre.
6) Sic1e d1argentfrapp~ apres A1ex-andre III (J31-JOO av.J.C.).
-"XV-
Planche XV: Honria Les u t d Ld sees par Alexandre III le
Grand entre 336 et 333 av.J.C.: shekels.
1) Tetrashe~el deSidon frappe vers425 av.J.C.
4) Tetrashekel deSidon frappe audebut du IVe!:!!e(384-370 av.J.C.).
3) Double shekel de Tyr(400-360 av.J.C.).
5) Double shekel de Byblos aunom d'Adramelek frappe vers350 av.J.C.
-XVI-
P1anche XVI: Les monnaies amphictioniques de De1phes
et 1es dracl1mes d'A1euas de Larissa.
1) Les monnaies amphictioniques de De1phesemises .entre 336 et 334 av.J.C.
3) Drachme d'A1euasde la Thessalie)Au revers: aigle
(Peros legendairefrappee a Larissa.sur foudre.
-XVII-
Planche XVII: Le Mon t Pan ge e et les ressources en
metal precieux de la Macedoine.
1) Les ressources de la r-iacedoine.
2) Le Mont Pangee.
Apprr»clmote scote: Kllomareso I ~ J
Based on compass bear.~verooot mtzervot 600 Feel;
ro TIAfrAloNOPO~
~ Producinq Areas• ,~/ne5
15o~01600"•• Q ••• .., •'d' ~...~
•. P . cl>
IN THE
rEGEAl"'l AREA
J) Les environs du Non t Pa.nsree •
Mount Pangaeus
• Philippoi (Crenides)Angitis Asyla '
Apollonia
Gaiepsos
-XVIII-
Planche XVIII: Les philippes II du vivant du roi ou
posthumes (parallel€$avec les premiers
alexandres d'Amphipolis.
2) Tetradrachmes posthumesde Philippe II (Proue,poupe,tete janiforme).
4)
J) Premiers tetradracrmesd'Alexandre III a Am-phipolis (Proue,poupe,tete janiforme).
5) Tetradrachmede PhilippeII postlul7le(Tete jani-forme).
-XIX-
Planche XIX: La serie a l'aigle et le monnayage de
Patraos, roi des peoniens.
1) Les deux varietes dela serie a l'aig1e.
A)
2) Tetradrachmea l'aiglefrappe vers336-333 av.J.C.
J) Nonnaie de Patraossurfrappee sur untetradrachme a l'ai-gle d'Alexandre III.
4) Tetradra-cbme de Pa-traos, roides Peo-niens (340/3J5-315).
-XX-























































































































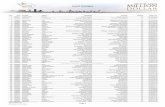
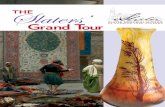





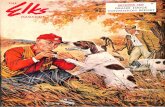




![Synthesis of Dibenz[ b,f ]oxepins via Manganese(III)Based Oxidative 1,2Radical Rearrangement](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63155ae15cba183dbf07f301/synthesis-of-dibenz-bf-oxepins-via-manganeseiiibased-oxidative-12radical-rearrangement.jpg)


