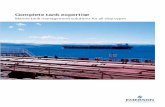Identifying Teacher Expertise: An Examination of Researchers' Decision Making
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Expertise de l’épave deDouglastown (DeDc-6), Gaspé
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
Rapport finalOctobre 2011
Couvert_05-21762_111012.indd 1 2011-10-17 09:14:24
Aménagement, Environnement et Ressources
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec Direction de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
© AECOM Tous droits réservés.
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final
05-21762
Octobre 2011
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
ii Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
Signatures Rapport préparé par : Le 21 octobre 2011
Érik Phaneuf, M. Sc. Archéologue/Anthropologue Études économiques et sociales
Rapport vérifié par : Le 21octobre 2011
Guylaine Lavallée Directrice de projet Études économiques et sociales
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 iii
Table des matières
1 Introduction .................................................................................................................. 1
2 Portrait régional ........................................................................................................... 5
2.1 Navigation à l’intérieur de la Baie ............................................................................................ 5
2.2 Bois ............................................................................................................................................. 5
2.3 Construction navale en Gaspésie ........................................................................................... 6
2.4 Histoire du cuivre dans la construction navale ..................................................................... 7
2.5 Douglastown .............................................................................................................................. 7
3 L’épave de Douglastown ........................................................................................... 11
3.1 Terminologie et analyse architecturale ................................................................................. 16
3.1.1 Quille ....................................................................................................................................................... 16
3.1.2 Carlingue ................................................................................................................................................ 17
3.1.3 Membrure ................................................................................................................................................ 17
3.1.4 Bordé ...................................................................................................................................................... 19
3.1.5 Vaigrage .................................................................................................................................................. 25
3.1.6 Marsouin arrière ..................................................................................................................................... 26
3.1.7 Étambrai.................................................................................................................................................. 27
3.2 Éléments présents à l’intérieur du navire ............................................................................. 28
3.2.1 Caisson de bois recouvert de briques ................................................................................................. 28
3.2.2 Artéfacts divers ...................................................................................................................................... 29
3.2.3 Bouilloire ................................................................................................................................................ 29
4 Interprétation sommaire des données et recommandations ................................. 31
4.1 Épaves de la Baie de Gaspé ................................................................................................... 31
4.2 Recommandations .................................................................................................................. 32
5 Bibliographie .............................................................................................................. 33
Liste des cartes
Carte 1 : Carte de situation ............................................................................................................................. 3
Carte 2 : Cartes de Douglastown de 1831 et 1861 ......................................................................................... 8
Carte 3 : Cartes de Douglastown de 1928 et 1954 où il est possible de voir le quai toujours en place ............................................................................................................................................ 9
Carte 4 : Positionnement de l'épave ............................................................................................................. 11
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
iv Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
Table des matières (suite)
Liste des figures
Figure 1 : Croquis des vestiges ...................................................................................................................... 14
Figure 2 : Illustration de profil de la carène du navire ..................................................................................... 16
Figure 3 : Dessin à l’échelle du bordage P1 ................................................................................................... 24
Figure 4 : Dessin à l’échelle du bordage P2 ................................................................................................... 24
Figure 5 : Dessin technique et photo d’une pièce du massif d’étambot ......................................................... 26
Figure 6 : Petite bouilloire tel qu’illustré dans le dictionnaire de marine de Paasch de 1885 ........................ 30
Liste des photos
Photo 1 : Douglastown en 1937 ....................................................................................................................... 8
Photo 2 : Section bâbord s'élevant au-dessus du niveau de la plage ........................................................... 12
Photo 3 : Épave à marée haute et à marée basse ........................................................................................ 13
Photo 4 : Photomosaïque de la section bâbord de l'épave ........................................................................... 15
Photo 5 : Photo de l'about de la carlingue ..................................................................................................... 17
Photo 6 : Chevilles de cuivre transversales aux membrures 62 et 64 ........................................................... 19
Photo 7 : Détail de clou du bordé et du trou de gournable du bordage 12 .................................................... 19
Photo 8 : Photomosaïque de la section tribord des vestiges architecturaux ................................................. 21
Photo 9 : Bordage P1 avec bordage P2 au-dessus ....................................................................................... 23
Photo 10 : Vue du bordage P2 face extérieure (en haut) et face intérieure (en bas) ...................................... 24
Photo 11 : Extrémité perdue de la vaigre 1 en bas à droite ............................................................................. 26
Photo 12 : Étambrai visible en décembre 2010 et lors de la visite de nuit en juin 2011 ................................. 27
Photo 13 : Ferrure d'étambrai .......................................................................................................................... 27
Photo 14 : Vue du caisson à l'intérieur de la carène ........................................................................................ 28
Photo 15 : Artéfacts divers et volant de vanne ................................................................................................ 29
Photo 16 : Bouilloire ......................................................................................................................................... 29
Liste des tableaux
Tableau 1 : Dimension des membrures, section bâbord ................................................................................... 18
Tableau 2 : Dimension des membrures, section tribord .................................................................................... 20
Tableau 3 : Dimension des bordages de la section bâbord .............................................................................. 23
Tableau 4 : Dimension des vaigres de la section bâbord .................................................................................. 25
Tableau 5 : Liste des navires potentiels pouvant constituer l'épave de Douglastown ...................................... 31
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 1
1 Introduction
À l’été 2010, M. Gabriel Blais-Morin, résidant de Douglastown sur la péninsule gaspésienne, fait la découverte, sur la plage de l’endroit, de quelques éléments en bois pouvant appartenir à une épave. Lors de la tempête qui balaya les rivages gaspésiens et nord-côtiers le 6 décembre 2010, les vestiges de l’épave furent dégagés. Maintenant certain d’avoir affaire à une coque de navire, M. Blais-Morin signale alors la présence de l’épave à M. Samuel Côté1, chercheur gaspésien de l’histoire maritime. Celui-ci communique l’information au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF), ainsi qu’à Parcs Canada. Par la suite, M. Yoann Pépin, stagiaire en archéologie du Département du patrimoine et de la muséologie au MCCCF produira un rapport d’expertise localisant l’épave et décrivant le contexte de sa découverte.
Au printemps 2011, M. Clément Deschênes du MCCCF contacte la firme AECOM afin de caractériser l’épave dans son milieu et d’en faire l’enregistrement. La caractérisation de l’épave a débuté par une recherche archivistique sur Internet et auprès des associations historiques régionales, ainsi que par des entrevues auprès de résidants reconnus pour leurs connaissances sur l’histoire locale. Ces activités n’auront révélé aucun indice probant sur l’épave. Par la suite, une visite de l’épave in situ a été réalisée afin de relever un plan d’ensemble des éléments architecturaux visibles et de faire une description détaillée des éléments architecturaux. Ainsi, il sera possible de procéder à l’analyse des données afin de proposer une datation relative du navire et, si possible, son lieu d’origine. Enfin, des mesures de protection à long terme qui promeut la sauvegarde des vestiges et des connaissances qu’elle recèle seront proposées.
L’expertise de l’épave a été réalisée dans la journée du 21 juin 2011 et au cours de la nuit du 21 au 22 juin, profitant ainsi du très court laps de temps durant lequel la marée basse exonde la majorité des vestiges architecturaux. La position des vestiges situés dans la zone de marnage ne permet d’observer l’épave dans sa presque totalité que pendant 2 ou 3 heures par jour, selon l’horaire des marées. En fait, malgré une marée basse à 0,5 m (1,6 pi), la partie basse des vestiges, soit la carlingue et la quille, n’a pu être observée directement, car elle est demeurée sous l’eau au plus bas de la marée.
Cette courte période aura toutefois permis de réaliser un plan d’ensemble des vestiges, une observation directe de la majorité des membrures, une couverture photographique de l’épave et le prélèvement de quelques échantillons de bois sur différents éléments architecturaux. Plus important encore, il a été possible de constater une dégradation importante de la coque au cours des six derniers mois. Également, le désensablement de l’intérieur du navire a mis au jour de nombreux vestiges mobiliers maintenant en voie de disparition par l’effet des marées et par les visites fréquentes des curieux. À ce titre, il faut mentionner que les tiges de cuivre photographiées en décembre ne sont plus présentes; elles ont été brisées et retirées possiblement en guise de souvenirs ou pour leur valeur monétaire. De surcroît, les artéfacts situés sur l’étrave et photographiés par M. Gabriel Blais-Morin en décembre 2010 ne sont plus présents sur l’épave. Il en est de même avec une partie de l’architecture. Ainsi, le massif d’étambot (qui comprenait les éléments de la courbe d’étambot ou du marsouin arrière), quelques bordés extérieurs et plus de quatre varangues (squelette interne du navire) sont maintenant disparus. Avec la disparition du massif d’étambot, pièce unique et particulièrement éloquente dans la construction du navire, a été perdu un témoin important de sa construction ainsi que du savoir technique des charpentiers de l’époque.
Le rapport d’expertise de l’épave présente une évaluation du site archéologique. Afin de mettre en contexte spatio-temporel les vestiges, est présenté un portrait régional du 19e siècle particularisant l’économie locale en étroite relation tant avec la navigation qu’avec la construction navale. Ensuite, sont présentés les résultats de la visite au terrain et les observations détaillées de l’architecture de l’épave. Une interprétation sommaire et des recommandations pour la préservation des vestiges viennent clore ce rapport. Notons que les résultats de l’analyse d’identification des essences de bois réalisée par le Groupe de recherche en dendrochronologie historique de l’Université de Montréal (Loewen, 2011) sont publiés à l’annexe A. Un compte rendu de la visite de l’épave envoyé à MM. Clément Deschênes et Pierre Desrosiers est également présenté à l’annexe B.
1. http://www.lecimetieredusaint-laurent.com/
DeDc-6
SEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVESEAL COVE
DOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWNDOUGLASTOWN
HALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EASTHALDIMAND EAST
HALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WESTHALDIMAND WEST
SANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACHSANDY BEACH
M iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM iM i
aux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Osaux Os
CapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapCapHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimand
Barre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deBarre deSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy BeachSandy Beach
PlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlagePlageHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimandHaldimand
BigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigBigHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHeadHead
ZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzagZigzag
Baie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de GaspéBaie de Gaspé
Octobre 2011 Carte 1
Échelle 1 : 50 000MTM, fuseau 5, NAD83
Source :CanVec, 1 : 50 000, RNCan, 2011
Cartographie : AECOMFichier : 0521762_tet_c1_110920.wor
Carte de situation
Site à l'étude (DeDc-6)
0 0,5 1,0 1,5 km
Intervention archéologiquede l'épave de la plage
de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
132
132
132
64°24'45'' 64°22'45''
64°20'45''64°22'45''
48°4
4'27
''48
°46'
27''
48°4
8'27
''48
°46'
27''
Ville deGaspé
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 5
2 Portrait régional
Dans ce portrait régional est présenté un sommaire historique de la navigation à l’intérieur de la baie de Gaspé à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, ainsi que de l’économie locale intimement liée à la construction navale. Cette période correspond approximativement à la date où devait naviguer le navire qui gît maintenant enfoui sur la plage de Douglastown.
2.1 Navigation à l’intérieur de la Baie
La navigation de la baie de Gaspé est étroitement liée à la pêche à la morue et ce, depuis le régime français. Suite à la conquête, la Gaspésie devient un territoire propice à l’investissement de nombreux marchands provenant des îles Jersey et Guernesey. Les mérites des pêcheries gaspésiennes, et surtout sa morue séchée déjà connue en Europe sous le nom de « Gaspé cure », attisaient les intérêts britanniques qui favorisèrent l’extension des activités marchandes déjà engagées dans le commerce atlantique. Les Anglais allaient non seulement ouvrir de nouveaux marchés, mais allaient aussi restructurer la manière dont la ressource était exploitée (Samson, 1981). De 1760 à la fin du 19e siècle, le développement des pêcheries gaspésiennes à grande échelle engendrera une navigation accrue en plus d’être le moteur d’une tradition de construction navale locale (Mimeault, 2002). La navigation devint plus facile après 1788 lorsque le gouvernement britannique autorisa l’établissement de pêcheries et le départ des navires ailleurs que d’un port d’appartenance britannique (Samson, 1981). Entre 1790 et 1810, on compte plus de 650 goélettes provenant des États-Unis qui naviguent entre la Baie-des-Chaleurs et le Labrador. En 1850, plus de 1 000 navires américains exploitent les eaux du Saint-Laurent et ce, illégalement (Mimeault, 1995). À cela, il faut ajouter les navires qui ont droit de pêche. Toute cette navigation ne tient qu’à un seul élément : le navire. La construction navale, tant locale, provinciale, qu’internationale, nécessitait une grande quantité de bois. Comme chaque élément de l’architecture du navire joue un rôle particulier, certaines essences de bois était préférées à d’autres pour la réalisation de certaines pièces.
2.2 Bois
Comme le chêne, bois utilisé en Europe pour la construction navale, fait défaut dans la région, les charpentiers gaspésiens le remplacèrent par des espèces indigènes (Mimeault, 1995). Ainsi, le premier usage industriel de la forêt gaspésienne fut pour la construction navale. Une première exploitation consistait en une coupe d’écrémage sélectionnant les meilleures tiges de pin blanc servant à la construction des mâts et espars de bateaux. Par la suite, la construction navale devenant une véritable industrie, de nombreuses espèces furent exploitées. Malgré tout, le chêne demeurait l’essence noble, et les charpentiers avaient de la difficulté à accepter de nouvelles essences dans la construction de leur navire. C’est après 1815 qu’un changement survint et que l’on vit apparaître des constructions utilisant des essences mixtes (Marcil, 2007). Ainsi, pour la construction de navires, on utilisait entre autres le pin blanc et l’épinette blanche, le frêne noir, l’orme d’Amérique et les érables. Certaines essences étaient préférées pour la construction d’éléments architecturaux; le pin blanc et l’épinette blanche servaient à la construction des mâts, le bouleau jaune pour la quille et le cèdre pour le bordage. Pour sa part, la tonnellerie utilisait le frêne noir et le thuya, et enfin le sapin servait à la fabrication de vigneaux (Pinna et al., 2009). Au chantier de Québec, en 1834, l’utilisation du chêne blanc et de l’orme liège pour une construction de qualité au prix de 12 à 14 £ la tonne était plus fréquente. Des navires de moindre prix, soit 9 £ la tonne, étaient aussi offerts et possiblement construits en bois de moindre qualité (Rankin, 1921). En 1840, un voilier construit à Québec avait une quille en orme, des allonges en mélèze, le bordage soit en orme liège, en pin rouge ou en mélèze, et un pont fait de pin jaune. Le chêne ne fut pas pour autant abandonné puisque sa force était toujours requise pour l’étrave, l’étambot et la carlingue (Marcil, 2007).
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
6 Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
2.3 Construction navale en Gaspésie
La construction navale au Québec revêt une importance capitale en tant qu’industrie. Pendant plus de 200 ans, ce fut, après l’agriculture, la plus importante industrie du Canada. Uniquement dans les chantiers navals de Québec et des environs, il y aurait eu la construction de 3 627 navires entre 1788 et 1872. (Dufour, 1981). Pour la baie de Gaspé, il est fort probable que la construction navale débuta au cours du régime français; toutefois, aucune documentation n’existe à ce sujet. Suite à la conquête, nous savons qu’entre 1761 et 1763, il fut construit presque autant de goélettes dans la Baie-des-Chaleurs qu’à Québec (Dufour, 1983). Entre 1760 et 1800, plus d’une cinquantaine de localités produisent des navires. En 1825, on en compte une quarantaine de plus. Dans l’ensemble, 60 % des navires produits sont de moins de 100 tonneaux (Dufour, 1981).
Ainsi, c’est à la fin du 18e siècle que l’on a vu apparaître de nombreux chantiers de construction navale sur les côtes de la Gaspésie. Une des premières constructions d’importance sortira du chantier de Bonaventure en 1771 avec la production d’un vaisseau à traits carrés de 250 tonneaux (Desjardins et al., 1999). La construction navale prendra réellement son essor avec l’arrivée des grandes entreprises d’exploitation halieutique dans la dernière décennie du 18e siècle.
Un des plus importants chantiers est celui de Paspébiac, qui appartient à la Charles Robin and Company, la première et la plus puissante des compagnies jersiaires à s’établir au Québec (Mimeault, 1995). Cette compagnie, en plus d’avoir son chantier naval, avait aussi sa propre forge, fabriquait les voiles, leurs poulies et les gréements. Le premier bateau à y être construit est le Fiott lancé en 1792. Ce chantier construira par la suite des goélettes, des barques, des bricks et des brigantins pour une moyenne d’un navire tous les deux ans entre 1791 et 1830 (Mimeault, 2002). En 1828, elle avait déjà mis en chantier plus d’une vingtaine de goélettes à traits carrés. En 1856, un 45e navire est lancé, et en 1857, on peut y observer un brick de 280 tonneaux mesurant 34 m de quille, 7,2 m de bau et 4,1 m de cale (Desjardins et al., 1999). En 1827, le chantier construisait une barque de 261 tonneaux (Marcil, 2007) qui naviguait toujours 45 ans après sa mise à l’eau. Sa longévité était attribuée à la qualité du bois de construction régionale et au soin apporté à sa fabrication (Desjardins et al., 1999). Un fait intéressant pour le chantier de M. Robin était sa propension au conservatisme. Tous ces navires devaient se terminer en cul-de-poule. Un charpentier fabriqua un brick avec une poupe carrée afin de maximiser l’usage du bois disponible. Il fut obligé de défaire sa construction pour rebâtir son navire avec une poupe allongée (Faucher de Saint-Maurice, 1877).
En 1830, on compte huit chantiers navals de grande envergure sur la péninsule gaspésienne, soit quatre dans le comté de Gaspé et quatre autres dans le comté de Bonaventure (Desjardins et al.,1999). Les plus importants se trouvaient à Bonaventure et Paspébiac, mais la péninsule comprenait aussi de nombreux chantiers de plus petite taille à Sainte-Anne-des-Monts, Cap-Chat, Saint-Georges, New Carlisle, New Richmond, Carleton, Péninsule, Gaspé, Douglastown, Pointe Saint-Pierre, Petit-Gaspé, Sydenham, Sandy Beach, Haldimand et Seal Cove (Pinna et al., 2009). En 1850, on estime à cinq le nombre de chantiers capables de produire des vaisseaux de haut et moyen tonnages, et à une quinzaine le nombre de chantiers de plus petite taille (Desjardins et al., 1999).
Pour les chantiers situés dans la baie de Gaspé, la plus ancienne construction connue est une goélette de 45 tonneaux baptisée le Trial qui fut construite et lancée par M. William Annett à Penouille en 1805. La majorité des navires construits dans la baie était destinée au cabotage le long de la côte avec un tonnage variant autour de 60 à 70 tonneaux. Les goélettes qui y sont construites sont majoritairement utilisées pour la pêche de la morue sur les bancs ou la pêche à la baleine (Mimeault, 2002). La goélette est le navire par excellence. Construction typique des chantiers du Saint-Laurent, la goélette est d’une longueur moyenne de 60 pi, mais peut varier de 31 à 125 pi. Elle avait un tonnage moyen d'environ 50 tonneaux (Franck, 1987). Le plus gros navire à avoir été construit dans la baie en est un de 375 tonneaux (Mimeault, 2002). Pour la Gaspésie, c’est à New Richmond que les deux plus gros navires ont été fabriqués, soit le Lahore de 787 tonneaux en 1846 et le Cuthbert de 914 tonneaux en 1848 (Desjardins et al., 1999).
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 7
La construction navale en Gaspésie atteint son apogée entre 1830 et 1840, mais l’économie s’essouffle. À partir de 1860, seulement les compagnies Charles Robin and Company et J. and E. Collas Company de Pointe Saint-Pierre construisent des navires. L’effervescence des pêches tombera après la crise économique de 1873. Les deux compagnies devront fusionner suite à la faillite de la Charles Robin and Company dans les années 1880 (McDougall, 2009).
Voilà qu’un aperçu très succinct de la riche histoire de la construction navale en Gaspésie, surtout en considérant qu’entre la conquête et la fin du 19e siècle plus de 550 navires de tout genre y ont été construits. De ce nombre, la majorité appartenait aux compagnies commerciales jersiaises (Mimeault, 2002).
2.4 Histoire du cuivre dans la construction navale
Comme l’épave possède au moins deux tiges de cuivre dans son mode de liaison et que l’utilisation du cuivre en construction navale offre un indice temporel de sa réalisation, un sommaire de l’utilisation du cuivre en construction navale est présenté ci-dessous.
Depuis l’utilisation du bois pour la fabrication d’embarcations maritimes, les tarets (teredo navalis), petits bivalves marins que l’on peut considérer comme le termite de la mer, attaquent et détruisent les éléments de charpente des navires. Depuis l’antiquité, les constructeurs ont tenté de contrer leurs effets. Ils ont doublé, voire triplé, l’épaisseur des planches formant la coque. Ils ont également utilisé de nombreux produits pour recouvrir l’extérieur des navires et recouvert la coque de feuilles de plomb et enfin de cuivre.
Des nombreuses méthodes utilisées, le recouvrement de la coque par des plaques de cuivre fut celle la plus utilisée avant l’avènement de la construction des coques de navire en fer. L’invention du recouvrement de la coque par le cuivre serait attribuée à MM. Robinson et Hanksbee en 1728. Une fois partiellement carbonisée et recouverte d’huile, la coque pouvait être recouverte de feuilles de cuivre, de laiton et d’étain. Il faudra attendre en 1761 avant que la marine britannique utilise le procédé sur la frégate HMS Alarm (New York Time, 1884).
Un effet secondaire au recouvrement des coques de navires par des feuilles de cuivre est l’altération rapide des fixations en fer utilisées dans la construction du navire. Le cuivre et l’eau salée créerait un milieu propice à la migration des ions de fer, résultant en la dégradation des tiges et boulons et, par conséquent, à la déstructuration du navire. Afin de contrer cet effet, les charpentiers ont commencé à utiliser des tiges en cuivre dans la construction des navires. De nombreuses expériences ont eu lieu avec différentes proportions de cuivre, zinc et fer. En 1779, le « cuivre chinois » était testé avec un fort pourcentage de zinc. Enfin, en 1783, étaient brevetés différents modes de fabrication de tiges en cuivre qui deviennent rapidement la norme. À partir de cette date, la marine anglaise utilisa ce mode de fixation pour tous ses nouveaux navires de moins de 44 canons (McCarthy, 2005). De ce fait, la présence de tiges filetées en cuivre dans le mode de fixation des membrures de l’épave de Douglastown propose une datation relative qui offre un terminus post-quem de 1783. Le cuivre demeure en utilisation jusqu’à l’apparition de la coque de navire en fer.
2.5 Douglastown
L’histoire de Douglastown commence avec la cession des terres à d’anciens loyalistes à la fin du 18e siècle. D’une population d’une personne avant 1780, on compte 10 habitants entre 1780 et 1790 et 27 personnes en 1830 (Samson, 1981). De tous ces nouveaux habitants, M. Daniel McPherson se démarque. Arrivé en 1785, il aura sa propre flotte de navires de pêche et deviendra propriétaire d’une grande partie de la Pointe Saint-Pierre. Marchand prospère, il avait à son solde de nombreux employés qui exploitaient les ressources forestières à des fins commerciales et pour la construction de navires. En 1800, il achète l’Isle-aux-Grues et y déménage peu après (White, 2000). Il est possible que l’épave soit un vestige de sa flotte de pêche, voire même un exemple de son chantier naval.
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
8 Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
Au milieu du 19e siècle, le terrain où l’on retrouve aujourd’hui l’épave appartient au Lieutenant-gouverneur de Gaspé, le Major Nicolas Cox, qui gouverna de 1775 à 1794. Sur une carte datant de 1831, le terrain appartient toujours à la famille Cox, ce qui n’est plus le cas sur une carte de M. Eugène-Étienne Taché de 1861 (BAnQ, 1861). Ainsi, l’épave, un navire qui semble avoir été abandonné au cours de la première moitié du 19e siècle, aurait été laissée sur place et, une fois ensevelie, aurait rapidement été oubliée puisqu’à cette époque Douglastown comptait moins de 50 habitants.
Source : BAnQ : (G/3450/1831a/B68 CAR pl) et (G/3452/G3751/1861/T333 CAR)
Carte 2 : Cartes de Douglastown de 1831 et 1861
Dans son rapport d’expertise remis au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, M. Pépin mentionne la présence d’un quai à proximité de l’épave. Les vestiges de ce quai aujourd’hui disparu sont encore visibles à marée basse, devant l’accès à la plage au début de la rue Matte. Sur une photo d’archive de 1937, il est possible de voir le quai ainsi que la plage sans vestige de navire.
Source : BAnQ (E21, S110, SS1, SSS1, PK 25-50)
Photo 1 : Douglastown en 1937
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 9
Source : BAnQ : Levé aérien 1930 (321699_01v) et péninsule de Gaspé (G 3450 s190 C37 7-A 1954 CAR)
Carte 3 : Cartes de Douglastown de 1928 et 1954 où il est possible de voir le quai toujours en place
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 11
3 L’épave de Douglastown
Source : Google Map, 2011
Carte 4 : Positionnement de l'épave
Les vestiges de l’épave ne présentent qu’une petite partie du navire sur un peu plus de 16 m de longueur. Deux sections de part et d’autre de la quille sur ce qui est possiblement la partie arrière, soit l’étambot du navire, viennent poindre hors de la plage en direction de la baie de Gaspé. La section bâbord visible présente une partie de carène s’élevant au-dessus du sol et uniquement retenue par la membrure du navire. Cette section est celle qui risque le plus de souffrir lors d’une future tempête.
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
12 Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
Photo 2 : Section bâbord s'élevant au-dessus du niveau de la plage
La section tribord, presque entièrement ensevelie, présente uniquement le sommet de plus de 70 membrures s’élevant verticalement à moins de 50 cm au-dessus du niveau de la plage. Au niveau du sol, il est possible d’observer, de part et d’autre de ces membrures, la partie supérieure d’une virure de bordé et une série de vaigres. La partie intérieure du navire, soit la plus affectée par l’action récurrente des vagues, révèle de nombreux artéfacts métalliques sous forme de plaquettes, de tiges, de ferrures indéterminées et de fers à cheval. Quelques fragments de verres à bouteilles se trouvent sertis dans des concrétions métalliques et au moins deux volants de vannes, possiblement de machine à vapeur, y ont été observés. De nombreuses briques rouges, dont certaines toujours en place dans une structure indéterminée au fond de la carène, s’exhibent graduellement à chaque marée. Enfin, un fragment de l’étambrai est toujours visible malgré le retrait de sa ferrure, de même qu’une pièce architecturale possiblement associée à l’emplanture d’un espar. Notons que cette dernière pièce était totalement ensevelie lors de la visite de M. Blais-Morin en décembre 2010. Enfin, à une dizaine de mètres de l’épave, les restes de ce qui semble être une petite chaudière associée à une machinerie à vapeur reposent dans l’eau et sont, en partie, visibles uniquement à marée basse.
La perte d’éléments architecturaux d’importance depuis la découverte de l’épave, soit des pièces maîtresses de sa conception et sa construction, rend l’interprétation plus difficile. Ce que nous croyons être la quille et la carlingue semblent toujours en place, mais entièrement ensevelies, à l’exception d’une infime partie qui demeure immergée lors d’une marée basse à 0,5 m (1,6 pi). De ce fait, ni la carlingue et ni la quille n’ont pu être mesurées ni observées directement.
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 13
Photo 3 : Épave à marée haute et à marée basse
Malgré tout, les deux sections observables apportent de nombreux indices sur la conception du navire et les artéfacts associés permettent une datation relative des vestiges. Ces éléments sont tous des témoins qui permettent une interprétation très sommaire sur le type de navire et la date possible de l’abandon du navire.
Durant les quelques heures où l’épave se trouvait hors de l’eau lors de la visite in situ, il a été possible de réaliser un croquis terrain de l’ensemble des vestiges (voir figure 1), un inventaire photographique permettant la réalisation d’une photomosaïque qui offre un vue d’ensemble assez réaliste des deux sections tel qu’observé en juin 2011 (photo 4 et photo 8). De l’ensemble des informations recueillies, il sera possible de faire un suivi diachronique de la détérioration des vestiges.
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
14 Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
Figure 1 : Croquis des vestiges
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 15
Photo 4 : Photomosaïque de la section bâbord de l'épave
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
16 Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
3.1 Terminologie et analyse architecturale
Afin de mieux comprendre la description des éléments architecturaux mentionnés ci-après, voici une illustration identifiant les principales pièces du navire formant la carène du navire, soit la partie immergée du navire.
Définition des différents éléments architecturaux
1. La fausse quille assure une protection supplémentaire à la quille. 2. La quille forme l’épine dorsale du navire. Première pièce maîtresse de la charpente formant la partie axiale inférieure de la coque
réunissant l’étrave et l’étambot et où vient s’assoir les varangues. 3. Le galbord ou gabord est la première planche du bordé de chaque côté de la quille. Le bordé est l’ensemble des bordages, planches qui
forment le revêtement extérieur étanche du navire et qui sont fixées sur la charpente interne formée de membrures. 4. Massif de quille. 5. La varangue est une pièce de charpente courbe fixée perpendiculairement à la quille à son milieu et sert de base aux membrures de
chaque côté. Elle vient se lier au genou. 6. La carlingue est une pièce maîtresse de la charpente axiale placée directement au-dessus de la quille sur les varangues. 7. L’épontille de pont est une poutre s’appuyant sur la carlingue qui vient soutenir le pont. 8. Vaigre de pare close : première planche du vaigrage souvent amovible permettant un accès direct à la sentine. Le vaigrage recouvre les
membrures du côté intérieur du navire et vient croiser les membrures tout en les solidifiant. 9. Vaigre de renfort. 10. Le trou d’anguiller est une petite ouverture pratiquée dans la varangue qui permet à l’eau de voyager dans le fond du navire entre chaque
membrure vers un puisard pour y être pompé hors du navire. 11. La vaigre d’empatture est placée au jointoiement des varangues et des premières allonges. 12. Vaigre de fond. 13. Bordé. 14. Bordage de bouchain qui se situe entre le fond du navire et sa muraille, partie haute du navire. 15. Serre de bouchain sont des vaigres situées dans le rayon du bouchain pour y accroître la force de maintien. 16. L’allonge est une pièce de charpente transversale prolongeant les varangues. La première allonge s’appelle genou.
Sources : Steffy 1994; Paasch 1885; Desgagnés.1977
Figure 2 : Illustration de profil de la carène du navire
3.1.1 Quille
Comme nous l’avons mentionné, il est impossible de commenter la quille puisqu’elle n’a pu être observée directement. L’analyse d’identification des essences de bois indique qu’elle est sculptée dans de l’orme (Loewen, 2011).
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 17
3.1.2 Carlingue
Ce que nous croyons être la carlingue était visible en partie, mais seulement sa largeur a pu être mesurée. D’une largeur de 15 cm et d’une hauteur inconnue, son about présente un écart plat vertical d’une dizaine de centimètres qui pourrait être l’extrémité d’un écart longitudinal à redan présentant une clé métallique (voir photo 5). Tout comme la quille, elle est sculptée dans de l’orme (Loewen, 2011). Deux empreintes de chevilles transversales placées à l’horizontal sont visibles. L’empreinte d’une cheville métallique horizontale située entre les clés métalliques était de 1,5 cm de diamètre. Une cheville de bois d’un diamètre d’environ 3 cm venait vraisemblablement compléter la liaison entre les deux moitiés de carlingue ou entre la carlingue et le massif d’étambot (voir photo 5).
Photo 5 : Photo de l'about de la carlingue
3.1.3 Membrure
La membrure compose l'ossature de la coque liée transversalement à la quille. Elle est formée, à sa base, d’une varangue qui repose directement sur la quille et est suivie d’allonges aux extrémités qui viennent continuer les varangues et former les murailles du navire. Sur cette membrure vient s’attacher les revêtements extérieurs et intérieur, soit le bordé et le vaigrage. Pour l’identification des essences, seulement 5 échantillons furent prélevés, tentant de choisir des essences différentes selon les particularités visibles sur le terrain. De ceux-ci, 4 essences différentes ont été identifiées. Deux éléments s’avèrent être de la pruche, un élément possiblement de l’épinette et enfin une allonge est en orme et une en chêne (Loewen, 2011).
La partie bâbord de l’épave permettait d’observer en partie seulement 13 membrures, possiblement des varangues. Toutefois, comme la partie proximale de la première membrure ne se termine pas sur la quille, il semble donc que ces pièces de membrures soient en fait des allonges (voir photo 4). Du fait qu’il est impossible d’observer la relation entre ces pièces et la quille, le nombre d’allonges ou de varangues présentes dans cette section de l’épave demeure incertain. Dans l’ensemble, les membrures de cette section ont une largeur et une épaisseur variant autour de 10 cm. La plus petite membrure (6), n’avait que 9 cm de côté. Le tableau 1 présente les particularités pour chacun des éléments observés. Une seule gournable a été constatée, traversant le bordé au niveau de la membrure 4. Nous supposons que cette gournable se poursuivait dans la membrure. De nombreux trous de clous de forme quadrangulaire ont été observés sur la face supérieure des membrures. Une moyenne de un clou par vaigre est observée et de deux clous par bordage, tous de dimension variant autour de 0,8 cm².
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
18 Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
Tableau 1 : Dimension des membrures, section bâbord
Varangues/allonges
No Largeur (cm)
Épaisseur(cm)
Hauteur visible(cm)
Broché
1 11 9 102
2 11 10 90
3 10 9 62
4 10,25 9 75 Gournable (B)
5 10,25 9 76
6 9 9 77
7 9,25 9 75
8 11 9 77
9 11 9,5 15
10 11 9 22
11 10 9 20
12 9,5 9 5
13 9,5 n.d. 5
La membrure de la section bâbord est vraisemblablement composée de varangues et d’allonges; il est toutefois impossible de vérifier avec certitude la définition de chaque pièce ne pouvant observer leur relation avec la quille. La dimension moyenne des membrures, varangues comme genoux (première allonge), varie autour de 10 cm de largeur et 9 cm d’épaisseur. La majorité des membrures ont été taillées à fil droit suivant le grain du bois et dans des essences de bois différentes.
Dans l’ensemble, les couples ne sont pas brochés ensemble, à l’exception des membrures 4 et 3, 6 et 5, 8 et 7, 13 et 12, 15 et 14, 19 et 18 et enfin 21 et 20 illustrées en gris sur le croquis général et la photomosaïque (figure 1). Il est possible que les autres membrures aient été également brochées, mais leur proximité ne permettait pas d’observer les quatre côtés de chaque élément. Toutes les broches métalliques jointoyant les membrures ensemble vont dans la même direction, soit du centre du navire vers son extrémité, et elles sont toutes perdues, c'est-à-dire qu’elles ne traversent pas les deux membrures, mais se terminent à l’intérieur de la deuxième membrure. Une autre particularité est la présence de chevilles de cuivre traversant perpendiculairement les membrures 62 et 64 (en rouge sur le croquis de la figure 1). Notons que ces chevilles photographiées en décembre 2010 ont été brisées et ne sont visibles qu’en profil à l’intérieur des membrures. Il est possible que ces membrures témoignent du maître couple, soit la membrure située au centre du navire. Supposant que les membrures 62 et 64 sont effectivement le point central d’une dimension hors tout du navire, le navire d’origine aurait eu une longueur de plus de 30 m.
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 19
Sources : M. Erik Phaneuf, juin 2011 (gauche); M. Gabriel Blais-Morin, décembre-2010 (droite)
Photo 6 : Chevilles de cuivre transversales aux membrures 62 et 64
3.1.4 Bordé
Le bordé est majoritairement observé dans la section bâbord; la section tribord ne présentant qu’une seule virure visible qu’en partie. De ce fait, les dimensions des éléments du bordé proviennent uniquement de la section bâbord où 14 virures ont été partiellement observées puisque aucun bordage n’était visible dans sa totalité. Le tableau 2 présente les particularités de chacun des éléments observés du bordé. L’identification des essences propose, une fois de plus, des essences mixtes, soit de l’érable et du chêne (Lowen, 2011). Les bordages P1 et P2 ont été trouvés sur la plage et sont vraisemblablement associés à l’épave. Leur fonction de bordage, et non de vaigre, a été déterminée selon la disposition des clous, soit deux par membrure. L’identification de l’essence de P-1 démontre que celui-ci a été taillé dans du frêne (Loewen, 2011).
Le bordé est lié aux membrures à l’aide de clous quadrangulaires d’environ 0,8 cm² selon un cloutage double, soit deux clous par bordage et allonge. Aucun évidement au niveau de la tête n’a été observé. L’utilisation de chevilles métalliques a été remarquée sur le bordage; toutefois, aucune observation directe n’a été faite sur la section bâbord. Le trou vestige de la cheville observé sur le bordage P2 était de 1,3 cm de diamètre. La présence de gournable est attestée par un trou résiduel dans le bordage 12 ainsi que par les photos de M. Blais-Morin lors de sa visite en décembre 2010. Cependant, les éléments photographiés en décembre n’étaient plus en place lors de notre visite de juin 2011.
Photo 7 : Détail de clou du bordé et du trou de gournable du bordage 12
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
20 Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
Tableau 2 : Dimension des membrures, section tribord
Dimension des varangues et allonges tribord (cm)
No Largeur Épaisseur Hauteur Broché
1 9 10 28
2 10 9 65
3 9 9 35
4 10 9 36 4 vers 3
5 9 9 42
6 10 9 46 6 vers 5
7 11 9 64
8 10 10 67 8 vers 7
9 9 8 56
10 10 8 32
11 9,5 8 55
12 9,5 9 55
13 10 8 28 13 vers 12
14 10 9 50
15 9 8 30 15 vers 14
16 9,5 8 48
17 10 10 50
18 9 8 40
19 10 9 24 19 vers 18
20 10 9 50
21 10 9 26 21 vers 20
22 9,5 9 50
23 10 9,5 50
24 9,5 9 40
25 9 9 40
26 10 8 25
27 10 9 50
28 11 9 30
29 10 9 50
30 n.d. 8 45
31 8,5 8,5 20
32 11 10 45
33 10 9 45
34 10 8 5
35 10 10 35
36 10 10 35
37 9,5 9 5
38 10 0 5
39 9 8 35
40 9 0 5
Dimension des varangues et allonges tribord (cm)
No Largeur Épaisseur Hauteur Broché
41 10 9 45
42 10 9 45
43 n.d. n.d. n.d.
44 8,5 9 40
45 9 9 43
46 10 10 47
47 9,5 9,5 47
48 9,5 9,5 48
49 9,5 9 47
50 9 10 50
51 8,5 9 48
52 10 9,5 30
53 9,5 9,5 28
54 9,5 10 35
55 10 9 20
56 10 9,5 15
57 8,5 9 23
58 n.d. n.d. 12
59 9,5 9,5 13
60 9,5 9 21
61 n.d. n.d. n.d.
62 10 9 12 Tige de cuivre
63 12 10 10
64 11 10 12 Tige de cuivre
65 10 9 10
66 8 8,5 10
67 8 8 12
68 n.d. n.d. 8
69 n.d. n.d. 3
70 n.d. n.d. 2
71 n.d. n.d. 7
72 n.d. n.d. 3
73 n.d. n.d. 5
74 n.d. n.d. 6
75 n.d. n.d. 2
76 n.d. n.d. 4
77 n.d. n.d. 4
78 n.d. n.d. 7
79 n.d. n.d. 4
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 21
Photo 8 : Photomosaïque de la section tribord des vestiges architecturaux
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 23
La largeur des bordages varie de 18 à 13,5 cm, dont les plus larges se trouvent le plus près de la quille. Il est possible que les bordages 3 et 4, de par leur dimension supérieure, aient servi de bordages de bouchain et soient situés à la jonction varangue-allonge. L’épaisseur moyenne est de 5 cm, largeur observée à leurs extrémités érodées par l’effet des vagues.
Tableau 3 : Dimension des bordages de la section bâbord
Planche Largeur (cm)
Épaisseur(cm)
Longueur(cm)
Commentaire
1 17 5 Ind. Extrémité arrondie pour recevoir l'étambot
2 17 5 120 Extrémité arrondie pour recevoir l'étambot
3 18 5 120
4 18 5 110
5 17 5 110
6 15,5 5 90
7 15 5 80
8 14 5 60
9 13,5 5 150
10 13,5 5 150
11 14 5 110
12 15,5 5 100 Trou de gournable
13 15,5 5 100
14 ind. 4,5 90
Le bordage P1 trouvé sur la plage à plus de 40 m de distance de l’épave est d’une longueur de 2,4 m et d’une largeur de 20 cm. Tout comme les bordages observés sur la section bâbord, P1 est d’une épaisseur de 5 cm. En plus des deux clous quadrangulaires d’environ 0,8 cm² de diamètre, on remarque aussi la présence d’une cheville métallique de 1,5 cm de diamètre.
Photo 9 : Bordage P1 avec bordage P2 au-dessus
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
24 Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
Figure 3 : Dessin à l’échelle du bordage P1
Photo 10 : Vue du bordage P2 face extérieure (en haut) et face intérieure (en bas)
Figure 4 : Dessin à l’échelle du bordage P2
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 25
3.1.5 Vaigrage
Tout comme le bordé, le vaigrage a été observé uniquement sur la section bâbord puisque la section tribord ne présentait qu’une planche du vaigrage à peine visible. Des 18 vaigres observées, la première était la plus imposante de par sa largeur (17 cm). Cette première vaigre clouée en place ne peut être considérée comme vaigre de pare-close. Quant à la largeur moyenne des vaigres, elle est de 10 cm. L’ensemble des vaigres ont une épaisseur moyenne de 4,5 cm, à l’exception des deux premières vaigres d’épaisseur supérieure. Un clou quadrangulaire d’environ 0,8 cm² par membrure sert de mode de liaison du vaigrage. Comme l’ensemble du vaigrage semblait être fait du même bois, un seul échantillon a été recueilli. L’analyse de l’essence indique que les planches du vaigrage sont faites de sapin (Loewen, 2011).
Tableau 4 : Dimension des vaigres de la section bâbord
No Largeur (cm)
Épaisseur(cm)
Longueur(cm)
Commentaire
1 17 4,8 30 Intercalée (perdue)
2 14 4,7 110
3 14 4,5 112
4 13 4,5 108
5 13 4,5 96
6 10 4,5 110
7 10 4,5 115
8 10 4,5 115
9 10 4,5 115
10 10 4,5 115
11 10 4,5 120
12 10 4,5 30
13 9 4,5 100
14 10 4,5 35
15 10 4,5 105
16 10 4,5 85
17 10 4,5 105
18 10 4,5 55
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
26 Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
Photo 11 : Extrémité perdue de la vaigre 1 en bas à droite
3.1.6 Marsouin arrière
Élément du massif d’étambot, cette pièce disloquée ressemble à un marsouin arrière ou possiblement à une courbe d’étambot. En effet, sa forme rappelle soit l’une ou l’autre de ces pièces. Retrouvée sur la plage par un résidant et conservée, cette pièce faisait probablement partie de l’arrière du navire qui était toujours présent sur les photos de M. Gabriel Blais-Morin de décembre 2010 mais disparu en juin 2011.
D’une longueur totale de 1,18 m, cette pièce maîtresse était chevillée à la charpente axiale à l’aide de 5 chevilles métalliques de 1,7 cm de diamètre. Elle est taillée dans de la pruche (Loewen, 2011). Sa face bâbord présente trois gournables de 2,3 cm de diamètre, dont une est aveugle. Un bon nombre de clous quadrangulaires de 0,8 cm² sont également observés sur cette pièce, la majorité étant située à l’endroit des membrures, comme en témoigne l’empreinte de celles-ci (figure 5).
Figure 5 : Dessin technique et photo d’une pièce du massif d’étambot
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 27
3.1.7 Étambrai
L’étambrai est un renforcement en bois au niveau du pont venant étayer le mât. Il fut observé en décembre 2010 et était complètement ensablé lors de la visite diurne de l’épave. À la visite nocturne, l’étambrai était partiellement désensablé. Le ferrure était disparue, mais est présentement préservée chez un résidant local. La ferrure, de forme carrée, fait 31 cm de côté et était retenue à la structure du navire à l’aide de 4 tiges en fer forgé. L’ouverture dont les rebords ont une hauteur de 9 cm était évasée sur une face. L’ouverture réelle est de 24,7 cm de diamètre.
Sources : M. Gabriel Blais-Morin, décembre 2010 (gauche); M. Erik Phaneuf, juin 2011 (droite)
Photo 12 : Étambrai visible en décembre 2010 et lors de la visite de nuit en juin 2011
Photo 13 : Ferrure d'étambrai
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
28 Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
3.2 Éléments présents à l’intérieur du navire
Entre les deux sections, nous avons observé un bon nombre d’artéfacts et de vestiges appartenant à la structure du navire toujours en place. Nous avons photographié ces éléments sans vraiment avoir eu le temps d’en faire une description détaillée. Certains de ces éléments, comme la possible emplanture de mât, un caisson de bois et son ensemble de briques en place, ainsi qu’un volant de vanne, sont illustrés sur le croquis général (figure 1). Un deuxième volant de vanne a été observé lors de la première visite de l’épave, mais fut ensablé par la marée et n’a pu être observé de nouveau.
3.2.1 Caisson de bois recouvert de briques
Une série de planches reposant directement au centre de la carène était visible au niveau des membrures 28 à 40. La série de planches posées transversalement à la quille était recouverte de briques rouges qui semblaient structurées. La dimension des briques variait de 19 à 21 cm de longueur, de 9 à 10 cm de largeur et de 5,5 à 6 cm d’épaisseur. Cette structure semble poursuivre une plaque métallique observée en direction du centre du navire. La fonction de cette structure est indéterminée, mais pourrait être associée à la cuisine ou à l’utilisation d’une machinerie à vapeur (Ford et al., 2008). La présence de briques et du recouvrement métallique au niveau du plancher à l’intérieur d’un navire est souvent associée à l’utilisation du feu.
Photo 14 : Vue du caisson à l'intérieur de la carène
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 29
3.2.2 Artéfacts divers
La partie la plus immergée de l’épave présentait un grand nombre d’artéfacts métalliques. Ainsi, il était possible de voir une quantité de petites plaques de fer, dont la dimension était relativement régulière (autour de 17 cm de longueur, 10 cm de largeur et de 1 cm d’épaisseur). De nombreuses tiges, quelques fers à cheval et ferrures furent également observés. La présence de gros morceaux d’anthracite semble vouloir indiquer l’utilisation d’une machinerie à vapeur, ce que le volant de vanne et la bouilloire pourraient confirmer.
Photo 15 : Artéfacts divers et volant de vanne
3.2.3 Bouilloire
À quelques mètres de l’épave repose ce qui semble être une petite bouilloire d’une longueur approximative de 2,8 m par 80 cm de largeur. Une section fait 1,1 m de longueur et les orifices vestiges de rivets font 1 cm de diamètre. Les caractéristiques d’une première observation, soit l’ouverture du bas et le rivetage des sections métalliques, rappellent effectivement ce qu’illustre Paasch dans son dictionnaire relatif à la marine (voir figure 6).
Photo 16 : Bouilloire
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
30 Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
Figure 6 : Petite bouilloire tel qu’illustré dans le dictionnaire de marine de Paasch de 1885
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 31
4 Interprétation sommaire des données et recommandations
Suite aux observations faites au terrain, il est possible d’émettre certaines hypothèses sur les dimensions du navire et la date de son naufrage.
Selon les caractéristiques de la Lloyd’s de 1866 (Marcil, 2007), de Chapman pour navire léger datant de 1768 et de Steinhaus de 1856 (Marquardt, 2003) ainsi que les recherches comparatives de Ford (2008), un navire avec des dimensions similaires à cette épave devait faire autour de 50 tonneaux et avoir une longueur de quille d’environ 50 à 60 pi, soit une vingtaine de mètres.
L’utilisation d’essences différentes dans la construction navale se popularise après 1815 tout comme l’utilisation de la vapeur sur les navires. La présence de quatre feuillus et trois résineux, dont l’épinette et l’érable, semble témoigner d’une construction nord-américaine. Selon l’analyse des essences, quoique réalisée sur seulement 12 éléments architecturaux, la présence de ces essences vient témoigner d’une construction possiblement originaire de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et peut-être de la côte sud ou est gaspésienne (Loewen, 2011).
Enfin, l’absence de documents archivistiques témoignant du naufrage, malgré un historique régional assez complet, semble une fois de plus attester du premier quart du 19e siècle. En comparant ces données avec les naufrages connus, il est possible d’associer de façon très aléatoire le nom d’un navire pouvant représenter l’épave de Douglastown.
4.1 Épaves de la Baie de Gaspé
Avec une histoire maritime aussi riche et une économie régionale presque entièrement dépendante de la navigation sur plus de 300 ans, il faut s’attendre à ce que la navigation autour de la pointe de la Gaspésie ait laissée son lot de naufrages et de tragédies maritimes. Laissant pour compte plusieurs dizaine de naufrages répertoriés, une liste très sommaire des navires perdus pour la période pouvant correspondre à la date d’abandon de l’épave a été compilée. Cette liste a été conçue à partir des travaux de M. Fred Simard sur la caractérisation des épaves et naufrages du Québec, des recherches de M. Gilles Bossé et d’informations de Parcs Canada. Les trois noms d’épaves mentionnés en caractère gras dans le tableau qui suit sont les trois navires qui, uniquement selon les critères de l’endroit de leur perte et de leur date de naufrage, semblent les plus plausibles d’être l’épave de Douglastown.
Tableau 5 : Liste des navires potentiels pouvant constituer l'épave de Douglastown
Lieu Nom de l’épave Précision Source
Baie de Gaspé Elizabeth (1803) Dans la Baie Bossé, 2011
Minerva (1815) Au sud de la baie, près de Pointe Saint-Pierre Bossé, 2011
Gaspé Packet (1847) Simard, 2011
Quinton (1862) Île Rouge Simard, 2011
Unknown (1851) Simard, 2011
Whitby (1827) Au sud de la baie Bossé, 2011
Pointe Saint-Pierre Lady Cremorne (1848) Simard, 2011
Percé Jean-Joseph (1748) Simard, 2011
Irish Imm (1890) Simard, 2011
Bas-Saint-Laurent – Gaspésie Célina (1779) Simard, 2011
Saint-Joseph (1748) Parcs Canada
Lord Elbank (1764) Parcs Canada
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
32 Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
4.2 Recommandations
Ainsi, l’épave de Douglastown, d’architecture assez complète, riche en artéfacts et possiblement de construction locale, est un témoin important de l’histoire régionale et mérite d’être protégée. L’érosion constamment en action sur l’ensemble du site et la dégradation des vestiges sont des problèmes auxquels il faut réagir rapidement afin d’en contrer les effets négatifs et de préserver la totalité du site. Les scénarios d’interventions possibles sont l’enrochement et l’ensablement des vestiges avec préalablement une fouille de sauvetage et l’enregistrement des vestiges dans l’éventualité ou l’enrochement ne serait pas efficace. Un autre scénario possible serait une fouille complète des vestiges avec démantèlement de l’épave. Ainsi, tous les éléments architecturaux pourraient être enregistrés et l’ensemble des pièces pourrait être déplacé vers un endroit choisi et réenseveli, ou immergé pour sa conservation. Enfin, un dernier scénario propose la fouille complète du site, et suite à une consolidation des vestiges architecturaux en déplacer la structure dans le but d’une mise en valeur à l’intérieur d’une institution muséale.
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 33
5 Bibliographie
BAnQ. 1954. Péninsule de Gaspé : dans les comtés de Gaspé-Nord, Gaspé-Sud, Bonaventure, Matane, Matapédia et les Îles-de-la-Madeleine. G 3450 s190 C37 7-A 954 CAR. [En ligne] : http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/document.xsp?id=0002685604
BAnQ. Levé aérien, Gaspésie. Nos 1 à 5 : Comté de Gaspé, 1928-1930. Ministère des Terres et Forêts, Service des arpentages. G/3452/G3751/1928/S29 CA 1930 321699_01v. [En ligne] : http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/document.xsp?id=0000321699
BAnQ. 1927. Le village de Douglastown, l'embouchure de la Rivière Saint-Jean, Haldimand East et Haldimand West, comté Gaspé-Est. En ligne] : http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/Anq_Afficher_image?p_page=1&p_anqsid=201101271315301467&P_cote=E21,S110,SS1,SSS1,PK25-50&P_codedepo=03Q&P_numunide=899732&p_hauteur= 760&p_largeur=1425
BAnQ.1861. Map of the District of Gaspe and Part of the County of Rimouski. GG/3452/G3751/1861/T333 CAR. [En ligne]: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/document.xsp?id=0000065497
BAnQ. 1831. To his Most Excellent Majesty, King William IV: This Topographical Map of the Districts of Quebec, Three Rivers, St. Francis and Gaspé, Lower Canada. G/3450/1831a/B68 CAR pl. [En ligne] : http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/document.xsp?id=0000090117
BAnQ.1815. Plan of the District of Gaspé. G 3453 G3 1815 B6 CAR. [En ligne] : http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/document.xsp?id=0002662891
BOSSÉ, G.R. 2011. Navigating the Lower Saint-Lawrence in the 19th Century. Version-3. CD-ROM.
DESGAGNÉS, M. 1977. Les goélettes de Charlevoix. Les Éditions Léméac. 182 p.
DESJARDINS, M, Y. Frenette, J. Bélanger et B. Hétu. 1999. Histoire de la Gaspésie. Institut québécois de recherche sur la culture. 796 p.
DUFOUR, P. 1983. La construction navale à Québec : des débuts à 1825. Parcs Canada. Pp. 259.
DUFOUR, P. 1981. « La construction navale à Québec, 1760-1825 : Sources inexplorées et nouvelles perspectives de recherches ». Revue d'histoire de l'Amérique française. Vol. 35, no 2, pp. 231-251. [En ligne] : http://id.erudit.org/iderudit/303952ar
FAUCHER DE SAINT-MAURICE, H.-E. 1877. De tribord à bâbord. Trois croisières dans le golfe Saint-Laurent : nord et sud : une partie de la Côte Nord, naufrage de l'amiral Walker, Anticosti, archipel de la Madelaine, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Gaspésie. 457 p. [En ligne] : http://www.ourroots.ca/toc.aspx?id=4671&qryID=2efb327c-2955-4021-a509-8aad08c4de21
FORD, B., A. Borgens, W. Bryant, D. Marshall, P. Hitchcock, C. Arias et D. Hamilton. 2008. Archaeological Excavation of the Mardi Gras Shipwreck (16GM01), Gulf of Mexico Continental Slope. Department of Oceanography Center for Maritime Archaeology and Conservation College Station, Texas. 335 p.
FRANCK, A. 1897. « La goélette à voiles du Saint-Laurent (scientia canadensis). Canadian Journal of the History of Science, Technology and Medicine. Vol. 11, no 2 (33) : 109-123. [En ligne] : http://id.erudit.org/iderudit/800256ar
Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé AECOM
34 Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011
LOEWEN, B. 2011. Détermination des essences de 14 échantillons prélevés d’une épave échouée à la plage de Douglastown, Gaspé (DeDc-6). Groupe de recherche en dendrochronologie historique, Université de Montréal, Département d’anthropologie. 7 p.
MARCIL, E.R. 2007. On chantait « Charley-Man », la construction de grands voiliers à Québec de 1763 à 1893. Les Éditions GID. 475 p.
MARQUARDT, K.H. 2003. The Global Schooner: Origins, Development, Design and Construction, 1695-1845. Naval Institute Press. 239 p.
MCCARTHY, M. 2005. Ships' Fastenings: From Sewn Boat to Steamship. Texas A&M University Press. 176 p.
MCDOUGALL, D.J. 2009. Two Centuries of Settlement of the Gaspé Coast by English Speaking People. [En ligne] : http://www.restigoucheroots.net/History/gaspesettlement.htm
MIMEAULT, M. 2002. « La construction navale en Gaspésie au XIXe siècle ». Encyclobec. [En ligne] : http://www.encyclobec.ca/main.php?docid=121
MIMEAULT, M. 1995. « Le capital industriel des pêches dans la baie de Gaspé de 1760 à 1866 ». Acadiensis. XXV.1 Automne 1995. Pp. 33-53. [En ligne] : http://journals.hil.unb.ca/index.php/Acadiensis/article/viewFile/12020/12864
NEW YORK TIMES. 1884. The First Copper Sheathing. January 6, 1884. Consulté en juin 2011. [En ligne] : http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F00C11FB3E5C15738DDDAF0894D9405B8484F0D3
PAASCH, H. 1885. De la quille à la pomme de mât. Dictionnaire de marine en anglais, français et allemand. Anvers. 524 p.
PARCS CANADA. 2011. Liste de naufrages de la région de Gaspé. Communication personnelle.
PÉPIN, Y. 2011. Rapport de découverte fortuite. Signalement d’une épave à Douglastown, Gaspé (DeDc-6). Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Direction du patrimoine et de la muséologie. 7 p.
PINNA, S., A. MALENFANT, B. HÉBERT et M. CÔTÉ. 2009. Portrait forestier historique de la Gaspésie. Consortium en foresterie Gaspésie – Les-Îles. Gaspé, 204 p. [En ligne] : http://www.foretgaspesie-les-iles.ca/fichiers/consortium/Rapports/Rapport_2009/RapportPFH_ version_finale.pdf
RANKIN, J. 1921. A History of our Firm, being some account of the firm Pollock, Gilmour and Co. and its Offshoots and Connections 1804-1920. Liverpool. Henry Young & Sons. Limited. 350 p.
SAMSON, R. 1981. « Gaspé 1760 -1830 : L'action du capital marchand chez les pêcheurs ». Anthropologie et Sociétés. Vol. 5, no 1, 1981. Pp. 57-85. [En ligne] : http://www.erudit.org/apropos/utilisation.html
SIMARD, F. 2011. Patrimoine archéologique maritime. Deuxième volet : Caractérisation des épaves et naufrages. Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec. 112 p. [En ligne] : http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/patrimoine/archeologie/ epaves-naufrages.pdf
AECOM Expertise de l’épave de Douglastown (DeDc-6), Gaspé
Rapport final – 05-21762 – Octobre 2011 35
STEFFY. J.R. 1994. Wooden Ship Building and the Interpretation of Shipwreck. Texas A&M University Press, College Station. 314 p.
WHITE, A. 2000. The Douglastown Historical Review. Issue #2, Spring 2000. [En ligne] : http://www.gogaspe.com/douglastown/history2.html
WILSON, G. 1994. A History of Shipbuilding and Naval Architecture in Canada. National Museum of Science and Technology, Ottawa, Canada. Transformation Series 4. 94 p.
Groupe de Recherche en Dendrochronologie Historique Siège social : Université de Montréal, Département d’Anthropologie. C.P. 6128, Succ. Centre-Ville, Montréal H3C 3J7. Tél. : (514) 343-6111, poste 1-3047 [email protected] ; www.grdh-dendro.com Référence : ID18
Dossier suivi par : Brad Loewen [email protected]
Pour : Érik Phaneuf AECOM 231, boulevard La Salle Baie-Comeau (Québec) Canada G4Z 1S7 Tél. : 418 296-2345 Téléc. : 418 296-2333
IDENTIFICATION MICROSCOPIQUE
DÉTERMINATION DES ESSENCES DE 14 ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS D’UNE ÉPAVE ÉCHOUÉE
À LA PLAGE DE DOUGLASTOWN, GASPÉ (DeDc-6)
Montréal, le 19 octobre 2011
2
INTRODUCTION Dans le cadre d’une intervention sur une épave ancienne échouée à la plage de Douglastown, dans la Ville de Gaspé (DeDc-6), monsieur Érik Phaneuf, archéologue de la firme AECOM, a prélevé 14 échantillons de bois provenant de différentes pièces structurales de l’épave. Le GRDH a été approché afin de réaliser l’identification microscopique des 14 échantillons. Entre autres, il a été espéré que les espèces forestières en présence permettront de cerner le lieu de construction du navire, en Europe ou en Amérique du Nord.
MÉTHODE D’ANALYSE Les échantillons sont nettoyés dans un bain d’eau de Javel, puis observés au microscope sur des lames minces, en lumière transparente, à des grossissements allant de 40x à 1000x. L’analyse se fait à l’aide de clefs d’identification anatomique. Chaque essence se distingue par une série de caractéristiques morphologiques ou cellulaires particulières (Schweingruber 2004). Enfin, les aires de répartition des espèces forestières en présence ont été comparées, afin de cerner le lieu de construction du navire.
CORPUS Le corpus est composé de trois pièces longitudinales de l’épave (quille, talon de quille, carlingue), cinq membrures (trois varangues, deux allonges), trois bordages (deux du bordé, un du vaigrage), ainsi qu’une gournable, un bouche-trou en forme de cheville et un bordage détaché gisant sur la plage.
Figure 1. Vue générale de l'épave. Érik Phaneuf
3
Figure 2. Vue latérale du talon de quille (E3). Érik Phaneuf DÉTERMINATIONS
No fourni
Identification de la pièce de bois
No Échantillon
Essence (nom latin)
Essence (nom français) Commentaire
Carlingue E1 Ulmus sp. orme Quille E2 Ulmus sp. orme Talon de quille E3 Tsuga sp. pruche
19 Varangue E4 Tsuga sp. pruche 6 Varangue E5 Picea sp. (?) épinette Abîmé lors du bain.
Essence incertaine. 11 Varangue E6 Tsuga sp. pruche 32 Allonge E7 Ulmus sp. orme 18 Allonge E8 Quercus sp. chêne 4 Bordage du bordé E9 Acer sp. érable 6 Bordage du bordé E10 Quercus sp. chêne 7 Vaigre E11 Abies sp. sapin Gournable E12 Tsuga sp. pruche Bouche-trou
(cheville), allonge 2 tribord
E13 Fraxinus sp. frêne
P-1 Bordage du bordé, sur la plage
E14 Fraxinus sp. frêne
4
ANALYSE Notons d’emblée la grande variété d’espèces en présence : quatre feuillus et trois résineux. Si la plupart de ces espèces existent à la fois en Europe et en Amérique du Nord, l’échantillon E5, possiblement de l’épinette, est diagnostique d’un milieu nord-américaine, et l’érable est hautement typique de ce même continent.
C’est aussi l’ensemble d’espèces feuillues et résineuses identifiées, formant un mélange retrouvé aussi sur d’autres épaves nord-américaines, qui permet de suggérer une origine au Nouveau Monde pour ce navire. À titre de contraste, les constructeurs européens privilégiaient l’usage du chêne dans les membrures et le bordé, et celui d’essences résineuses, plus légères, pour le bordé de l’accastillage. L’usage précis qui a été fait des essences à l’étude, notamment les membrures en résineux et le bordé en essences diverses, est également typique de l’Amérique du Nord et atypique de l’Europe atlantique. Notons que l’érable est rarement retrouvé en contexte archéologique.
Quant à la distribution régionale des espèces, l’aire de répartition de chacune recoupe les provinces maritimes canadiennes. Par ailleurs, la faible représentation du chêne (un bordage, une allonge) et l’absence du pin tend à disqualifier le Maine et la vallée du Saint-Laurent comme origine du navire, tandis que la présence de l’orme et du frêne exclut définitivement Terre-Neuve. Notre meilleure hypothèse sur l’origine du navire est donc la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île de Prince-Édouard et peut-être la côte sud ou est gaspésienne.
5
DESCRIPTION DES ESSENCES MENTIONNÉES Orme (Ulmus sp.) Elm Le genre Ulmus compte trois espèces indigènes au Québec : l’orme d’Amérique (Ulmus américana L.), l’orme rouge (Ulmus rubra Mühl.) et l’orme liège (Ulmus thomasii Sarg.). La maladie hollandaise de l’orme a malheureusement décimé les populations. Seul l’orme de Sibérie, espèce introduite, résiste à la maladie. L’orme peut atteindre de 25 à 35 m de hauteur et un diamètre de 60 à 175 cm. Il vit généralement entre 125 et 175 ans. On le retrouve dans la zone des Grands Lacs méridionaux et de la vallée du Saint-Laurent. L’orme d’Amérique a une distribution plus nordique que l’orme rouge et l’orme liège. Le bois de l’orme liège est le plus résistant des trois et a été utilisé dans la fabrication de châssis de pianos et de bâtons de hockey. L’orme est un arbre qui occupe divers types de sol variant de bien drainés à mouillés. Il s’associe à d’autre feuillus comme l’érable, le tilleul et le noyer cendré. Il a une croissance rapide et tolère modérément bien l’ombre.
Chêne (Quercus sp.) Oak Onze essences du genre Quercus sont présentes au Canada. Le classement des chênes du Canada se fait en deux groupes : les chênes rouges et les chênes blancs. Au Québec, on retrouve surtout le chêne rouge (Quercus rubra L.), le chêne blanc (Quercus alba L.), le chêne à gros fruits (Quercus macrocarpa Michx.) et plus rarement, le chêne bicolore (Quercus bicolor Willd.). Les chênes atteignent des hauteurs allant de 15 m (chêne à gros fruit) à 35 m (chêne blanc) et des diamètres proportionnels, soit de 60 à 120 cm. Ils peuvent facilement vivre jusqu’à 200 ans. Le fût du chêne peut être assez droit en forêt, mais reste ramifié, avec de grosses branches. Le chêne est un bois dur, lourd et fort, résistant à la carie. Il est utilisé à cause de ses qualités pour l’ébénisterie et la marqueterie, et aussi pour la tonnellerie et la construction navale.
Cet arbre pousse dans la zone des feuillus et dans la zone des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Au Québec, le chêne rouge est le plus répandu : il se retrouve jusqu’à Québec. Par contre, les aires de répartition des autres espèces de chênes se limitent aux alentours de Montréal, sur les rives de l’Outaouais et de la Richelieu. Ils sont plus abondants près des Grands Lacs et le lac Champlain et vers le sud. Le chêne pousse sur des sols variés, généralement mélangé au tilleul, au cerisier tardif, au caryer, à l’érable à sucre, au frêne blanc, au pin blanc et à la pruche.
Frêne (Fraxinus sp.) Ash Le genre Fraxinus comprend une soixantaine d’arbres et d’arbustes, dont seulement trois sont indigènes au Québec. Le frêne blanc (Fraxinus americana) est l’espèce la plus commune, à laquelle s’ajoutent les frênes rouge (Fraxinus pennsylvanica) et noir (Fraxinus nigra). Le frêne commun d’Europe (Fraxinus excelsior) est planté de nos jours au Canada. Le frêne pousse jusqu’à une hauteur de 20 à 30 m et 50 cm de diamètre. Il vit généralement 100 ans ou
6
plus. Son port est droit ou légèrement courbe. Il s’agit d’un bois noble lourd, dur et résistant, au fil droit, mais flexible, de couleur brun crème. Il est utilisé pour les manches d’outils, les planchers, l’ébénisterie généralement et parfois la tonnellerie (Farrar 1995: 160-169).
On retrouve le frêne dans la zone des feuillus et dans le sud de la zone des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Il croit parfois en peuplement pur, mais souvent mélangé à d’autres essences, selon l’espèce et l’endroit. Le frêne habite des milieux très divers, mais il croit mieux sur les sols riches et humides. Il tolère plus ou moins bien l’ombre avec l’âge. Les frênes rouge et surtout noir poussent dans les marécages ou sur le bord des cours d’eau. Le frêne blanc préfère les sols secs et bien drainés (Farrar 1995: 160-169). Les variétés de frêne présentent la même anatomie microscopique et ne peuvent donc être distinguées sur lame mince.
Érable (Acer sp.) Maple Trois espèces d’érable du Nord-Est américain atteignent la taille d’un arbre : l’érable à sucre (Acer saccharum), l’érable argenté (Acer saccharinum) et l’érable rouge (Acer rubrum). Hormis l’érable à sucre dont le bois dense et résistant est utilisé pour les meubles, les planchers, les manches et d’autres outils, le bois léger des érables est peu important, entrant dans la fabrication de caisses de transport et de contreplaqué. Dans les campagnes, il sert au chauffage et à l’élaboration d’un sirop. Les trois espèces peuvent atteindre 30 à 40 mètres en milieu fermé, où elles développent un fut élancé et une petite couronne, mais seulement 15 à 20 mètres en milieu ouvert, avec des branches lourdes et basses. Elles s’étendent des Grands Lacs aux provinces maritimes. Tolérant de l’ombre, l’érable prolifère dans les étages inférieurs des boisés, pour enfin parvenir à dominer la forêt après un siècle ou deux (Farrar 1995 : 266, 272, 274).
Épinette (Picea glauca, Picea rubens, Picea mariana) Spruce Le genre Picea comprend trois espèces dans l’Est du Canada : l’épinette blanche (Picea glauca), l’épinette noire (Picea mariana) et l’épinette rouge (Picea rubens). Ces espèces présentent des dimensions sensiblement identiques, soit entre 20 et 25 m de hauteur, 60 cm de diamètre et 300 ans, sauf l’épinette noire qui ne vit guère plus de 200 ans. Elles forment un bois léger, tendre, au fil droit, mais assez fort et élastique. Leurs cernes sont plus étroits et plus marqués que ceux du pin, mais mois marqués que ceux du mélèze. L’épinette est beaucoup utilisée pour la pâte à papier, le bois d’œuvre et le bois ouvré. Historiquement, on l’utilisait dans les charpentes de maisons et pour les solives des planchers non exposés à l’humidité. Encore aujourd’hui, elle est exploitée pour la construction en général (Farrar 1995 : 95-107 ; Rouleau et al, 1990: 20-25).
Les épinettes blanche et noire ont des aires de répartition géographique très vastes. Elles poussent sur l’ensemble du territoire canadien, jusqu’au pergélisol. L’épinette rouge est beaucoup moins répandue et ne pousse que dans la basse vallée du Saint-Laurent et vers l’Est : Maine, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Les épinettes préfèrent les lieux humides et frais, bien drainés. Elles tolèrent bien l’ombre et poussent dans des stations
7
variées, le plus souvent humides. On les retrouve en peuplements mélangés aux autres essences, selon leur situation (Farrar 1995 : 95-107 ; Rouleau et al. 1990: 20-25). Il est impossible de différencier ces essences avec certitude, sans écorce ni aiguille. Elles sont aussi souvent difficiles à distinguer du mélèze (Larix laricina) sous l’objectif du microscope.
Pruche du Canada (Tsuga canadensis) Eastern Hemlock La pruche du Canada est la seule essence espèce du genre Tsuga dans l’Est du Canada. Elle a des dimensions atteignant 30 mètres et 100 cm de diamètre. Elle croit lentement et peut vivre jusqu’à 600 ans, mais son bois a une faible résistance mécanique : il se fend et se casse facilement. L’écorce de la pruche a été largement utilisée pour son tanin et le bois lui-même peut servir aussi à la construction (Farrar 1995: 120-121). On ne semble pas avoir reconnu les faiblesses mécaniques de cette essence dans le passé. La pruche se retrouve sur la côte est américaine, dans la zone forestière des Grands Lacs et du Saint-Laurent et la zone dite acadienne, comprenant la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Ile-du-Prince-Édouard. Cet arbre pousse sur des sols variés, mais dans un environnement humide le plus souvent. On le retrouve en peuplement pur ou en mélange avec le bouleau jaune, le pin blanc, l’épinette (blanche et noire) et l’érable à sucre et le hêtre (Farrar 1995: 120-121).
Sapin baumier (Abies balsamea) Balsam fir Une essence du genre Abies vit dans l’Est canadien et les Parklands de l’Ouest. Dans ce grand territoire, elle s’adapte à plusieurs sols et climats, formant des sapinières unies. Sujet aux infestations dévastatrices de la tordeuse de l’épinette, le sapin baumier régénère dans des boisés mixtes avec le peuplier faux tremble, le bouleau blanc et les épinettes. Son bois est léger, tendre, faible et parfois cassant, blanche, inodore et sans contraste entre le duramen et l’aubier; il est utilisé pour la pâte de papier. L’arbre atteint 17 à 22 mètres de hauteur et son fut droit mesure de 30 à 60 cm de diamètre (Farrar 1995 : 88). BIBLIOGRAPHIE Farrar, J. L., 1995, Les arbres du Canada, Ottawa, Fides et Service Canadien de Forêts.
Rouleau, R. et al., 1990, Petite flore du Québec, Québec, Les Publications du Québec. Schoch, W., Heller, I., Schweingruber, F.H., Kienast, F., 2004: Wood anatomy of central
European Species. En ligne : www.woodanatomy.ch (Consulté le 18 octobre 2011). Schweingruber, F. H., 1982, Anatomie microscopique du bois, Zurich, Institut Fédéral de
Recherche Forestière, Edition Zürger.
Lettre d’information concernant l’importance de consolider les vestiges. 4 juillet 2011 (Envoyée par courriel à Monsieur Clément Deschênes et Pierre Desrosiers) Ce compte-rendu fait suite à l’expertise de l’épave de Douglastown, Gaspé (DeDc-6) menée les 21 et 22 juin dernier. Il est rédigé tout particulièrement afin d’informer le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine de l’importante dégradation que l’épave a subit au cours des 6 derniers mois et de l’importance d’en préserver les vestiges. Afin d’en conserver l’information, Il est recommandé de stabiliser les vestiges immobiliers de la carène et de prévoir une excavation archéologique préalablement à la consolidation de l’ensemble des vestiges. Nous croyons que cette épave est un témoin important de l’évolution technique de l’architecture navale à une période de transition entre la vapeur et la voile. De plus, il demeure de nombreux vestiges à l’intérieur de la carène qui sont en en voie de perdition par l’effet composé de la marée et des collectionneurs de souvenirs. L’expertise de l’épave a été réalisée dans la journée de 21 juin 2011 et au cours de la nuit du 21 au 22 juin profitant ainsi du peu de temps que la marée basse exonde la majorité des vestiges architecturaux. La position des vestiges dans la zone de marnage permet d’observer l’épave dans sa presque totalité que pendant 2 ou 3 heures par jour selon l’horaire des marées. En fait, malgré une marée basse à 1.6 pieds (0,5 m), ce que nous croyons être l’étambot n’a jamais été exondée, la carlingue et la quille n’ont pu être observées directement étant demeurées sous l’eau au plus bas de la marée. Ce cours laps de temps aura toutefois permit de réaliser un plan d’ensemble des vestiges, une observation directe de la majorité des membrures et une couverture photographique de l’épave. Plus important encore, il a été possible de constater une dégradation importante de la coque au cours des derniers 6 mois. Également, le désensablement de l’intérieur du navire a mis au jour de nombreux vestiges mobiliers maintenant en voie de disparition par l’effet des marées et par les visites fréquentes des curieux. À ce titre, il faut mentionner que les tiges de cuivre photographiées en décembre ne sont plus présentes. Elles ont été brisées et retirées possiblement en guise de souvenirs ou pour leur valeur monétaire. De surcroit, les artéfacts situés sur l’étrave et photographiés par Monsieur Gabriel Blais-Morin en décembre 2010 ne sont plus présents sur l’épave. Il en est de même avec une partie de l’architecture photographiée par Monsieur Blais-Morin. Ainsi, le massif d’étambot (qui comprenait les éléments de la courbe d’étambot), quelques bordés extérieurs et plus de 4 varangues (squelette interne du navire) sont maintenant disparus. Avec la disparition du massif d’étambot, pièce unique et particulièrement éloquente dans la construction du navire, nous avons perdu un témoin important de sa construction ainsi que du savoir technique des charpentiers de l’époque.
Pièces architecturales majeures maintenant disparues (en rouge)
Photo : Clément Deschênes, janvier 2011
Évolution du désensablement de l’épave (en rouge) Photo Erik Phaneuf, juin 2011 (gauche) et Clément Deschênes, janvier 2011 (droite)
Disparition des tiges en cuivre Photo : Clément Deschênes, janvier 2011 (gauche) et Erik Phaneuf, juin 2011 (droite) Une interprétation préliminaire et sommaire des vestiges semble proposer une construction provenant du nord-est américain datant de la première moitié du 19e siècle. La présence d’anthracite et de pièces de machinerie semble vouloir témoigner d’un navire utilisant la vapeur et la présence d’un étambrai de mât photographié en décembre et retiré des vestiges témoigne de la présence d’une voilure. Une architecture presque complète de la carène et de nombreux ouvrages toujours en place avec quantité d’artéfacts font de cette épave un très riche témoin d’une grande importance tant pour l’histoire technique maritime que pour l’histoire régionale. Nous recommandons donc la réalisation d’une fouille et de l’enregistrement des vestiges préalablement à sa stabilisation. L’ensablement des vestiges protégé par une série d’épis ou un enrochement ciblé en forme de demi-cercle serait nécessaire afin de prévenir la continuation de la destruction des vestiges. Une nouvelle tempête serait aujourd’hui catastrophique pour les vestiges en place. Un rapport d’expertise sera remis au ministère avant la fin du mois de septembre.
AECOM 231, boulevard La SalleBaie-Comeau (Québec) Canada G4Z 1S7Tél.: 418 296-2345Téléc. 418 296-2333www.aecom.com
À propos d’AECOM
AECOM est un fournisseur mondial de services techniques professionnels et de gestion-conseil sur une grande variété de marchés comme le transport, le bâtiment, l’environnement, l’énergie, l’eau et les services gouvernementaux. Avec près de 46 000 employés autour du monde, AECOM est un leader sur tous les marchés clés qu’elle dessert. AECOM allie portée mondiale et connaissances locales, innovation et excellence technique afin d’offrir des solutions qui améliorent et préservent les environnements bâtis, naturels et sociaux dans le monde entier. Classée dans la liste des compagnies du Fortune 500, AECOM sert des clients dans plus de 100 pays et a enregistré des revenus de 6,3 milliards de dollars pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 2010.
Des renseignements supplémentaires sur AECOM et ses services sont disponibles au www.aecom.com.
Couvert_05-21762_111012.indd 2 2011-10-17 09:14:24