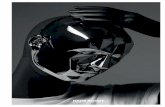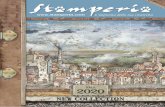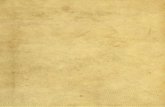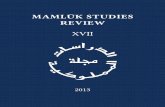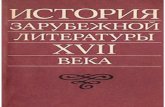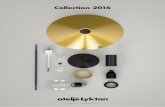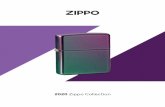COLLECTION TURCICA VOL. XVII.
Transcript of COLLECTION TURCICA VOL. XVII.
COLLECTION TURCICA
VOL. XVII
«∞∞L'ivresse de la liberté∞∞».La révolution de 1908 dans
l'Empire ottoman
sous la direction de
François GEORGEON
PEETERSPARIS - LOUVAIN - WALPOLE, MA
2012
94093_Georgeon_VW V94093_Georgeon_VW V 20/08/12 11:4020/08/12 11:40
TABLE DES MATIÈRES
AVANT-PROPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
PRÉSENTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV
PREMIÈRE PARTIE
Prémices révolutionnaires
≤erif MARDIN
Out of the Shadows : Exploring the Complex Background ofthe Young Turks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
M. ≤ükrü HANIOGLU
The Committee of Union and Progress and the 1908 Revolu-tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Erdal KAYNAR
Les Jeunes Turcs et l’Occident, histoire d’une déception pro-grammée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wajda SENDESNI
Les Turcs, les Arabes et la question du califat : une contro-verse entre le Türk et al-Manar (1903-1904) . . . . . . . . . . . . . 65
Erik J. ZÜRCHER
The Historiography of the Constitutional Revolution : BroadConsensus, Some Disagreement, and a Missed Opportunity . 91
DEUXIÈME PARTIE
La révolution entre discours et pratique
Nader SOHRABI
Illiberal Constitutionalism. The Committee Union and Progressas a Clandestine Network and the Purges . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Noémi LEVY
La reprise en main des institutions : l’exemple de la policeottomane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
94093_Georgeon_VW IX94093_Georgeon_VW IX 20/08/12 11:4020/08/12 11:40
X TABLE DES MATIÈRES
Nazan MAKSUDYAN
New ‘Rules of Conduct’ for State, American Missionaries, and Armenians : 1909 Adana Massacres and the Ottoman Orpha-nage (Dârü’l-Eytâm-ı Osmânî ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Dorothée GUILLEMARRE
Hüseyin Cahid Yalçın, témoin de la révolution jeune-turque . 173
Bedross Der MATOSSIAN
Formation of Public Sphere(s) in the aftermath of the 1908Revolution among Armenians, Arabs, and Jews . . . . . . . . . . . 189
Anastassia FALIEROU
La révolution jeune-turque : une révolution de la conditionféminine ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
TROISIÈME PARTIE
La révolution et les provinces
Bernard LORY
Manastir / Bitola, berceau de la révolution . . . . . . . . . . . . . . . 241
Nathalie CLAYER
Le temps de la liberté, le temps de la lutte pour le pouvoir : larévolution jeune-turque dans les provinces albanaises . . . . . . 257
Vangelis KECHRIOTIS
The Enthusiasm Turns to Fear : Everyday Life Relations between Christians and Muslims in Izmir in the Aftermath ofthe Young Turk Revolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Édouard MÉTÉNIER
Le moment 1908 à Bagdad : connections personnelles et convergences politiques entre la mouvance salafiste et le mou-vement constitutionaliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Juliette HONVAULT
Des faits étranges… Les échos de la révolution jeune-turqueau Yémen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Anne-Laure DUPONT
Réforme et révolution dans la pensée arabe après 1908 . . . . . 415
94093_Georgeon_VW X94093_Georgeon_VW X 20/08/12 11:4020/08/12 11:40
TABLE DES MATIÈRES XI
QUATRIÈME PARTIE
Au delà de l’Empire, 1908 dans un monde global
Renée WORRINGER
Rising Sun over Bear : The Impact of the Russo-Japanese Warupon the Young Turks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Houri BERBERIAN
Connected Revolutions: Armenians and the Russian, Ottoman,and Iranian Revolutions in the Early Twentieth Century . . . . 487
Stéphane A. DUDOIGNON
« Et l’Iran saigne encore… ». Les révolutions iranienne de 1906 et turque de 1908 vues par la presse des musulmans del’Empire russe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Édith YBERT
De Bakou à Saint-Pétersbourg : la «Turquie nouvelle» dansla presse russe (1908-1909) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
Rebecca E. KARL
Revolution and Politics : The Young Turks and the RepublicanChinese Revolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
Sophie BASCH
Au pays des firmans d’Eugène Marsan (1906) : une turquerieau temps des Jeunes Turcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
94093_Georgeon_VW XI94093_Georgeon_VW XI 20/08/12 11:4020/08/12 11:40
1 Sur les statistiques de parution de périodiques, voir Svetlana Jakovlevna Mahonina, Istorija Russkoj Zurnalistika nacala XX veka (Histoire de la presse russe du début du XXe siècle), Moscou, Flinta, Nauka, 2004, p. 38-42. Les données officielles mentionnent un plus grand nombre de titres, mais Mahonina adopte celui de 1 500, comme les auteurs qui ont procédé à l’élimination des doublons.
Édith YBERT
DE BAKOU À SAINT-PÉTERSBOURG : LA « TURQUIE NOUVELLE »
DANS LA PRESSE RUSSE (1908-1909)
Mon propos n’est pas de dresser un panorama des faits rapportés et des opinions exprimées dans la presse russe à propos de la révolution turque de 1908, panorama qui devrait balayer tout le champ des sensibilités politiques de la Russie d’alors. Il aurait fallu pour cela établir un échan-tillon représentatif de journaux et de revues à partir des quelques 1 500 publications périodiques recensées en 19081 et l’étudier. Pour la relation des événements qui constituent la révolution de 1908, la presse russe consultée utilise les dépêches de l’Agence télégraphique de Saint-Péters-bourg et celles de Constantinople, Belgrade, Berlin ou Paris… ; les chro-niques de politique extérieure des journaux et revues citent des publica-tions qui peuvent être autrichiennes, britanniques ou françaises. Ce n’est pas le déroulement des événements que je me propose de suivre, mais les questionnements et les analyses de quelques journaux et revues du Cau-case ou de la Russie centrale, durant l’année qui suit la restauration de la Constitution dans l’Empire ottoman. Ces questionnements portent sur la nature de la révolution intervenue à Istanbul et sur les obstacles que devra surmonter la nouvelle Turquie. Les réponses apportées, l’analyse des chances de succès dans l’entreprise de renouvellement de l’Empire et des possibilités de survie de la Turquie — c’est ainsi que la presse russe désigne l’Empire ottoman — sont diverses, allant des plus optimistes aux plus sceptiques et pessimistes. Dans leur diversité, elles permettent de dégager quelques spécificités des positions des musulmans du Caucase,
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 55394093_Georgeon_21_Ybert.indd 553 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
554 ÉDITH YBERT
2 Murad bey Mizancı (1853-1912), alias Gadzi Murad Amirov, est originaire d’un village dargin du Daghestan. Après des études à l’Institut professionnel de Temir Han Sura, puis à Stavropol et enfin à Zurich, il gagne la Turquie en 1873. Il va y devenir un fonctionnaire ottoman, y faire œuvre d’historien, de journaliste et devenir un Jeune Turc actif à Paris, à Genève et au Caire. (Son parcours est décrit avec plus ou moins de détails dans les ouvrages consacrés aux Jeunes Turcs. Parmi eux : Juri Asotovic Petrosjan : Mladotureckoe dvizenie (vtoraja polovina XIX-nacalo XX v.) (Le mouvement jeune-turc [seconde moitié du XIXe- début du XXe siècle]), Moscou, Nauka, 1971, p. 178-183.
3 Ahmed Saïb (Kaplan) (1859-1920), Kumyk du Daghestan, fils d’un officier de la suite du vice-roi du Caucase, lui-même capitaine de cavalerie, passé en 1888 au service des Ottomans. Actif dans les cercles jeune-turcs du Caire, éditeur du journal Sancak (le Drapeau), il enseigne, après 1908, la langue et l’histoire russes à l’université d’Istanbul. (Kamil Aliev, « Ahmed Saib Kaplan (1859-1920) », Vozrozdenie, Mahackala, 1999, n° 5, p. 19-20.
4 Ahmed Agaev ou Agaoglu, (1869-1939), qui, après s’être considéré comme persan pendant ses études à Paris, milite au Caucase (Bakou, Karabakh), le quitte en 1909 pour échapper aux poursuites policières, devient l’un des théoriciens du nationalisme turc et s’engage dans les mouvements jeune-turc puis kémaliste. C’est l’un des personnages les mieux connus de l’intelligentsia azerbaïdjanaise grâce aux travaux de François Georgeon et de Holly Shisler (François Georgeon, Des Ottomans aux Turcs. Naissance d’une nation, Istanbul, Isis, 1995, p. 41-54 ; 169-183 ; 429-438 ; A. Holly Shisler, Between two Empires, Ahmed Agaoglu and the new Turkey, New York, Columbia University Press, 2002).
5 Ali bey Hüseyinzade (1864-1941), originaire de Saljan (Azerbaïdjan), étudiant en médecine à Saint-Pétersbourg, il gagne Istanbul en 1889 où il devient le médecin en chef de l’hôpital militaire de Haydar PaÈa. Théoricien et militant du panturquisme, il retourne à Bakou où, de 1905 à 1910, il est l’un des ténors de la presse nationaliste azérie. (Sur son rôle et celui d’Agaev dans les journaux azéris créés au lendemain de la Révolution russe de 1905, v. Alexandre Bennigsen et Chantal Lemercier-Quelquejay, La presse et le mou-vement national chez les musulmans de Russie avant 1920, Paris, La Haye, 1964, p. 105-112).
qui ne sont sans doute pas très différentes de celles des musulmans des autres régions de l’Empire russe, étant donné les liens qui existent à cette époque entre leurs intelligentsias.
Mon point de départ a été la presse russophone des musulmans de Transcaucasie. J’ai complété son étude par celle de quelques revues et d’un recueil d’articles portant sur les événements au Proche-Orient, parus à Saint-Pétersbourg. Il semblait intéressant a priori de voir comment la presse musulmane russophone de Bakou présentait la révolution de 1908 dans l’Empire ottoman. En effet, plusieurs membres des intelligentsias musulmanes du Daghestan ou de Transcaucasie ont joué un rôle impor-tant dans le mouvement jeune-turc ou sont des théoriciens du nationa-lisme turc ou du panturquisme : Murad bey Mizancı 2, Ahmed Saïb3, actif d’abord au Caire puis à Istanbul, Ahmed Agaev (ou Agaoglu)4, Ali bey Hüseyinzade5. Certains journalistes et acteurs de la vie politique en Transcaucasie avaient eu des contacts personnels avec des Jeunes Turcs
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 55494093_Georgeon_21_Ybert.indd 554 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
DE BAKOU À SAINT-PÉTERSBOURG 555
6 Ali Mardan Bek Toptchibachy (Topcibasev) (1865-1934), personnalité de premier plan du mouvement national des musulmans de Russie. Né à Tiflis, petit-fils d’un profes-seur à l’Université des Langues Orientales de Saint-Pétersbourg, juriste et avocat, il s’installe à Bakou en 1893. Il y devient, en 1897, le rédacteur en chef du journal en langue russe Kaspij (La Caspienne), puis, à partir de 1905, du journal en turc azéri, Hayat ou Gejat (la Vie). Député à la première Douma, il signe le manifeste de Vyborg et n’est donc plus éligible. Il est aussi l’un des dirigeants du parti Ittifak-i Muslimin (l’Union musul-mane) créé à l’issue du congrès de Nijni-Novgorod (août 1905) et y joue un rôle de pre-mier plan jusqu’en 1917. Occupant durant quelques mois les fonctions de président du Parlement et de ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan procla-mée en mai 1918, il part pour Istanbul puis pour Paris afin de prendre part à la conférence de paix. Resté en exil après l’occupation bolchevique, il va s’investir dans les combats de l’émigration de l’ancien Empire russe à Paris.
7 Georgi Mihalilovic Tumanov, prince géorgien (1854-1920), juriste de formation, libéral qui réclame dès les années 1880 des réformes radicales de l’administration du Caucase, il créée, avec ses frères, en 1891, le journal de Tiflis Novoe Obozrenie (La Nou-velle Revue). (A. Hahanov, F.A. Brokgaus et I.A. Efron dir., Enciklopediceskij Slovar’, Moscou, reprint Terra, vol. 67, 1993, p. 58-59).
8 N. Hajlova, « Vestnik Evropy », V.V. Selohaev dir., Politiceskie Partii Rossii. Konec
et s’étaient déjà exprimé sur leur mouvement dans Kaspij (la Caspienne). Ce journal défend les intérêts des musulmans du Caucase et de l’Empire russe depuis sa création à Bakou en 1881. Ali Merdan bey Toptchibachy6 en assure la direction depuis 1897. Du fait d’une suspension administra-tive du 9 juin au 21 août 1908, il ne paraît pas lors des événements de Monastir et d’Istanbul. Mais, dès sa reprise le 1er septembre, il consacre un long article à la « Renaissance de la Turquie ». C’est dans les colonnes d’un journal de Tiflis, capitale du territoire du Caucase, que j’ai suivi les dits événements. Il s’agit de Zakavkaz’e, publié de 1906 à 1914 à Tiflis, avec des interruptions pendant lesquelles Zakavkazskoe Obozrenie (revue de Transcaucasie) prend le relai. Dirigé par le prince géorgien Georgui Mihailovic Tumanov7, ce journal de tendance libérale ouvre ses colonnes à des auteurs de toutes nationalités, et notamment à Ahmed Agaev qui continue de lui envoyer des articles après son départ pour Istanbul en 1909.
Les deux revues pétersbourgeoises sollicitées : Vestnik Evropy (le messager de l’Europe), et Russkoe Bogatstvo (la richesse russe), appar-tiennent toutes deux aux volumineuses revues, à la fois littéraires, poli-tiques et encyclopédiques qui ont joué un grand rôle dans la vie intellectuelle russe, surtout à la fin du XIXe siècle. Vestnik Evropy, men-suel qui paraît de 1866 à 1918, demeure fidèle à son orientation libérale et réformiste et à son ton académique et modéré, tentant de maintenir une ligne médiane dans la société russe divisée en camps hostiles par la révo-lution8. Russkoe Bogatstvo, mensuel qui paraît de 1879 à 1918, n’aban-
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 55594093_Georgeon_21_Ybert.indd 555 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
556 ÉDITH YBERT
XIX-pervaja tret’ XX veka (Les partis politiques de Russie. Fin du XIXe-premier tiers du XXe siècle), Moscou, Rosspen, 1996, p. 109.
9 N. Erofeev, « Russkoe Bogatstvo », Politiceskie Partii Rossii…, op. cit., p. 533-534.10 I.M. Bikerman dir., Tureckij Sbornik (k sobytijam na Bliznem Vostoke) (Le Recueil
turc [sur les événements au Proche-Orient]), Saint-Pétersbourg, Tipografija Sever, 1909. 11 Iosif Menasievic Bikerman (1867-1945), originaire de Podolie, autodidacte entré à
l’université de Novorossisk à l’âge de 30 ans, milite contre le sionisme et expose ses positions dans un article de Russkoe Bogatstvo de 1902. Travaillant à partir de 1905 comme journaliste à Saint-Pétersbourg, il émigre après la révolution d’octobre 1917. Il est l’un des auteurs de Rossija i Evrei (la Russie et les Juifs) paru à Berlin en 1924. (Russkij Biograficeskij Slovar’, t. II, Moscou, reprint Terra, 1998, p. 412., Encyclopedia Judaïca, vol.4, Jerusalem 1971, p. 992).
12 Vasili Vasil’evic Vodovozov (1864-1933), pétersbourgeois, juriste de formation, poursuivi à plusieurs reprises pour la publication d’écrits interdits par la censure, il fait paraître en 1895 des articles sur la Bulgarie sous le pseudonyme de Stefan Stambulov. Il poursuit une carrière de publiciste et travaille dans la commission d’établissement du pro-gramme du groupe travailliste à la Douma d’État. Il émigre en 1922 à Berlin puis s’installe à Prague. (O. Ishakova, « Vodovozov », Politiceskie Partii Rossii…, op. cit., p. 118-119).
13 Mahmed Sahtahtinskij (1846-1931), membre d’une famille noble du Nahicevan, il poursuit ses études supérieures à Saint-Pétersbourg puis à Leipzig et à Paris. Orientaliste et linguiste, il propose une réforme de l’ « alphabet musulman » et fonde en 1903 à Tiflis le journal turc azéri Sarq-i Rus (l’Orient Russe). Député musulman du gouvernement d’Erevan à la seconde Douma, il quitte la Russie en 1908 et travaille comme journaliste en Turquie, en Iran et en Iraq. De retour en Azerbaïdjan, il participe à la création de l’Université de Bakou en 1919 et y enseigne les langues orientales jusqu’en 1922. (Alexandre Bennigsen et Chantal Lemercier-Quelquejay, La presse…, op. cit., p. 45-46 ; Azerbaijan Sovet Enciklopedijasi, vol. X, Bakou 1987, p. 481).
donne jamais complètement sa ligne populiste mais adopte une orienta-tion socialiste, devenant de fait après 1905 l’organe des « socialistes populaires » puis des socialistes-révolutionnaires (S-R)9.
Enfin, je me référerai également à un livre paru à Saint-Pétersbourg en 1909 : Tureskij Sbornik (le recueil turc)10, dirigé par Iosif Menasievic Bikerman11. Composé d’articles écrits en août-septembre 1908 sur les événements au Proche-Orient, il présente en outre l’avantage de regrou-per en un seul volume des contributions de ténors de la presse de l’époque, engagés dans la vie parlementaire russe, comme Vasili Vasil’evic Vodovozov12, actif dans le groupe travailliste de la première Douma, et Mahmed Sahtahtinskij 13, député du gouvernement d’Erevan à la seconde Douma qui rallie le camp octobriste (progouvernemental).
La révolution turque
La première question posée est celle de la nature de la révolution. La grille de lecture des différents auteurs s’avère profondément marquée par leur perception de la révolution russe de 1905-1907.
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 55694093_Georgeon_21_Ybert.indd 556 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
DE BAKOU À SAINT-PÉTERSBOURG 557
14 Nikolaj Sergeevic Rusanov (1859-1939), révolutionnaire professionnel depuis 1877, il prend part aux discussions entre populistes, socialistes et marxistes et gagne Paris en 1883, où il est à partir du milieu des années 1890 le correspondant de la revue Russkoe Bogatstvo. En exil jusqu’en 1905, il publie ses articles et essais sous les pseudonymes de Tarasov ou de Kudrin. De retour en Russie, il milite au sein du Parti socialiste-révolution-naire, adopte les positions de son aile gauche en 1917-1918, puis, passé en Finlande en avril 1918, il organise à Stockholm la délégation de ce parti à l’étranger. (N. Erofeev, E. Cankevic, « Rusanov », Politiceskie Partii Rossii…, op. cit., p. 525-527).
15 N.E. Kudrin, « Revoljucija Bliznego Vostoka” (La Révolution du Proche-Orient), Russkoe Bogatstvo, Octobre 1908, p. 33.
16 Stepan Semenovic Konduruskin (1874/75- 1919), après des études universitaires à Kazan, travaille de 1898 à 1903 pour la Société de Palestine dans le réseau des écoles russes de Syrie et publie ses relations de voyages en Syrie dans Russkoe Bogatstvo (1901-1906). Il poursuit une carrière d’écrivain et de journaliste, est correspondant de guerre du journal constitutionnel-démocrate Rec’ en 1914-1918 et rejoint les Blancs en Sibérie. (V.N. Cuvakov, « Konduruskin », in P.A. Nikolaev, Russkie Pisateli. 1800-1917. Biogra-ficeskij Slovar’, (Les écrivains russe. 1800-1917. Dictionnaire biographique), vol. 3, Mos-cou, 1994, p. 50-51).
17 S. Konduruskin, « Ozivaet li Turcija ? » (La Turquie va-t-elle reprendre vie ?), Russkoe Bogatstvo, Mai 1909, p. 59.
18 Zakavkaz’e, n° 158, 15 (28) juillet 1908, p. 1. 19 « Novaja Turcija » (La Turquie nouvelle), Kaspij n° 130, 3 septembre 1908, p. 2.
Cet article, présenté comme l’interview à Paris d’une personnalité proche des dirigeants jeunes-turcs, est signé « M ».
20 « K sobytijam v Turcii » (Les événements en Turquie), Zakavkaz’e, n° 165, 23 juillet (5 août) 1908, p. 1-2. Cet article est signé des seules initiales « R V ».
La révolution turque s’inscrit dans un processus général de démocra-tisation des institutions qui touche tous les pays, écrit N.E. Kudrin14 dans le numéro d’octobre 1908 de Russkoe Bogatstvo15. Dans la même revue, un auteur dont les analyses sont à l’opposé de celles de Kudrin, S. Kon-duruskin16, déclare lui aussi que les événements en Turquie, comme les révolutions russe et persane, sont des manifestations particulières d’un mouvement mondial qui va du despotisme vers un pouvoir populaire17. Les journalistes de Transcaucasie inscrivent les événements turcs dans un mouvement général d’éveil des masses musulmanes et plus générale-ment de l’Asie. Le premier éditorial de Zakavkaz’e consacré à la révolu-tion turque annonce qu’« un puissant esprit de renouvellement passe sur l’Asie »18. Les journalistes musulmans de Bakou et de Tiflis évoquent, avant les révolutions en Russie et en Iran, la guerre russo-japonaise comme la première brèche dans l’ancien système19 ou l’expérience japo-naise d’assimilation réussie des principes européens de vie politique et sociale comme un exemple encourageant pour le monde musulman20. Leurs analyses diffèrent donc sur ce point de celles de leurs confrères de Saint-Pétersbourg.
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 55794093_Georgeon_21_Ybert.indd 557 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
558 ÉDITH YBERT
21 Ibid.22 « Inostrannoe Obozrenie » (Revue étrangère), Vestnik Evropy, T. IV livre 8, août
1908, p. 790.23 « Inostrannoe Obozrenie » (Revue étrangère), Vestnik Evropy, T. V livre 9, septembre
1908, p. 405.24 Belorussov, “Novaja i Staraja Turcija”(la nouvelle et l’ancienne Turquie), Vestnik
Evropy, Juin 1909, p. 350.
C’est cependant à la lumière des événements et des débats autour de la révolution russe de 1905-1907 que le journaliste de Zakavkaz’e s’inter-roge sur la suite de la révolution turque : est-ce que la promesse de la réunion du Parlement ottoman va être une concession suffisante pour faire cesser la révolution ? Il rappelle le programme du Congrès des partis d’opposition qui s’est tenu à Paris à la fin de 1907 et l’une de ses revendications primordiales, l’abdication d’Abd ul-Hamid, et constate que, parmi les Jeunes Turcs, il y a des partisans d’une monarchie consti-tutionnelle et des tenants d’une République sociale21, clivage qui était effectivement pertinent en 1905 en Russie.
À Saint-Pétersbourg aussi, le déroulement de la révolution en Turquie est comparé à celui de la révolution russe. Sa rapidité, son efficacité impressionnent très favorablement les réformistes russes du Vestnik Evropy. Dans la rubrique « revue étrangère » d’août 1908, cette révolu-tion est caractérisée ainsi : elle va droit aux buts qu’elle s’est assignés ; révolution exemplaire, presque non sanglante, elle a avec une étonnante rapidité conquis progressivement toute les mécanismes gouvernemen-taux, jusqu’au sultan…22 Dans cette même rubrique, le mois suivant, il est dit : « La révolution turque continue à donner un matériel très inté-ressant pour la réflexion sur la théorie et la pratique des mouvements révolutionnaires ; elle apporte des méthodes et procédés nouveaux et ingénieux, se distinguant nettement des traditions ordinaires de l’Europe occidentale en ce domaine. À la place de grands mots et de vastes pro-grammes, nous voyons ici une série de fortes mesures pratiques ». Et l’auteur de poursuivre en évoquant l’élimination des espions, de per-sonnes occupant des charges inutiles et le renouvellement du personnel gouvernemental23. Dans l’article de juin 1909 qu’il envoie de Constanti-nople, Belevskij-Belorussov oppose les révolutions russe et turque, aux antipodes l’une de l’autre : « À la richesse idéologique, à l’impuissance matérielle et à l’indiscipline de notre mouvement spontané s’oppose ici une indigence spirituelle, en partie préméditée, une grande force maté-rielle et de la méthode, permettant de mener à bien relativement peu, mais ce qui est vital et indispensable »24. Le populiste N. S. Rusanov,
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 55894093_Georgeon_21_Ybert.indd 558 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
DE BAKOU À SAINT-PÉTERSBOURG 559
25 N.E. Kudrin, art. cit., p. 56.26 Ibid., p. 58-59. 27 Ibid., p. 61.28 Belorussov, art.cit., p. 351-353. Aleksej Stepanovic Belevskij (1859-1919), membre
du groupe populiste « Narodnaja Volja », a passé plusieurs années en prison ou en rési-dence surveillée en Sibérie. À partir de 1908, il vit à l’étranger, comme correspondant permanent du journal Russkie Vedomosti à Constantinople puis à Paris, et poursuit son œuvre littéraire sous le pseudonyme de Belorussov. Dejateli revoljucinnogo dvizenija v Rossii (Les acteurs du mouvement révolutionnaire en Russie), t. 3, vyp. 1, Moscou, 1933, col. 238-242.
29 Bikerman, Tureckij Sbornik, op. cit., p. 15.30 “Cernosotennaja kontr-revoljucija i ee bystrij razgrom” (La contre-révolution des
Centuries noires rapidement écrasée), Vestnik Evropy, mai 1909, p. 413-424.
rentré en Russie après 23 années d’exil, à la faveur de la révolution de 1905, met lui-aussi en avant les traits caractéristiques de la Révolution au Proche-Orient dans la substantielle analyse qu’il signe sous le pseu-donyme de Kudrin : elle est le fait des officiers progressistes et d’une partie des jeunes fonctionnaires, et se distingue par la discipline de ses protagonistes et la définition précise des buts politiques poursuivis25.
Mais, partant de la constatation générale du rôle de premier plan de l’armée, il montre que cette révolution n’est pas un pronunciamiento. Se référant aux mouvements populaires ayant eu lieu en 1907 à Kastamuni (Kastamonu) et dans d’autres villes d’Asie Mineure, il conclut à la par-ticipation plus ou moins grande des masses26. Il poursuit une analyse rigoureuse, d’inspiration socialiste, et conclut que « l’armée turque s’est faite l’instrument du renouvellement du peuple ».27 Son analyse opti-miste s’oppose radicalement à celle de Belevskij-Belorussov pour qui les officiers et les fonctionnaires européanisés constituent une toute petite partie de la société ottomane encore archaïque. Cet auteur insiste sur le fossé entre les masses et l’intelligentsia peu nombreuse qui a réussi à instaurer un nouveau régime de gouvernement28.
Bikerman aussi ouvre le Recueil turc qu’il dirige par un article sur la « Renaissance de l’Orient » qui vient de vivre son « 1848 », et compare les révolutions russe et turque. Tout en prenant ses distances envers cette attitude, il constate que le grand public pose carrément les Jeunes Turcs en modèle.29
La victoire rapide des Jeunes Turcs sur l’insurrection du 31 mars (12-13 avril) 1909 et sur la contre-révolution impressionne les journalistes russes30. Même l’éminent historien et sociologue Maksim Kovalevski, après avoir évoqué les doutes que beaucoup ont éprouvés face à la révo-lution turque, conclut, au terme d’une analyse comparatiste savante et
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 55994093_Georgeon_21_Ybert.indd 559 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
560 ÉDITH YBERT
31 Maksim Kovalesvkij, « K ocenke nedavnyh sobytij v Turcii » (Une évaluation des récents événements en Turquie), Vestnik Evropy, juin 1909, p. 840-849.
32 S. Konduruskin, art. cit., p. 79.33 N.E. Kudrin,, art. cit., p. 63-65.
argumentée, au succès de la révolution grâce à l’organisation exemplaire de ses cadres, bien qu’ils ne représentent qu’une minorité dans l’Empire ottoman31. Konduruskin sait que son analyse personnelle très négative choquera l’opinion de la plupart de ses compatriotes. À leurs yeux, dit-il, « les Jeunes Turcs viennent à nouveau de remporter une victoire brillante sur la réaction — cela flatte tellement notre cœur endolori —. Ils se sont libérés en sept jours de ce qui nous opprime depuis trois ans »32.
Enthousiastes ou sceptiques, les commentateurs sont unanimes sur les deux problèmes qui attendent les nouveaux dirigeants ottomans : les rela-tions entre les différents éléments de la population ottomane et l’antago-nisme entre les nationalités qui la composent ; la situation internationale de l’Empire qui veut mettre un terme à l’ingérence des puissances euro-péennes mais doit aussi respecter ses engagements internationaux.
Les mouvements nationaux et l’islam
Le rédacteur de la revue de politique étrangère de Vestnik Evropy qui s’est montré très enthousiaste en août, le demeure le mois suivant mais aborde les problèmes délicats que le nouveau régime doit résoudre, et en premier lieu l’établissement de « relations normales entre les différentes nationalités de l’Empire ». Cette question est débattue sous deux angles : celui de la décentralisation, du fédéralisme et des dangers du centralisme autoritaire ; celui de l’islam, de la loi musulmane et de leur capacité de se réformer en profondeur. Et le premier mène le plus souvent au second et s’expriment alors des opinions antagonistes, opinions convaincues et passionnées, basées la plupart du temps sur des préjugés nationaux et religieux acquis de longue date par les représentants des diverses com-munautés.
Dès octobre 1908, Kudrin développe un vibrant plaidoyer pour la créa-tion d’un Empire ottoman fédéral, tout en prenant en considération les difficultés concrètes que poserait sa réalisation. Il exprime ses craintes de voir les Jeunes Turcs se montrer insensibles aux aspirations de chaque nationalité à défendre sa langue, ses écoles, son autonomie culturelle, et s’en tenir à leur défense d’une Turquie « une et indivisible », se heurtant à l’opposition acharnée de ces nationalités33. Son analyse reflète les
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 56094093_Georgeon_21_Ybert.indd 560 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
DE BAKOU À SAINT-PÉTERSBOURG 561
34 Voir à ce sujet l’article de Juliette Cadiot, « Un empire “un et indivisible” ? La question de la représentation politique des non Russes à la Douma après la révolution de 1905 (1905-1907) », Cahiers du Monde russe, 48/2-3, avril-septembre 2007, p. 221-242, fondé sur les travaux historiques récents menés tant aux Etats-Unis qu’en Russie.
35 Belorussov, “Voprosy nacional’nogo mira na Balkanskom poluostrove” (Questions de paix nationale dans la péninsule des Balkans), Vestnik Evropy, avril 1909, p. 826.
36 Ibid., p. 838-839.37 Ibid., p. 842.38 Belorussov, “Novaja i Staraja Turcija”, art. cit., p. 352.39 E. G. Kostrikova présente la formation du réseau de correspondants à l’étranger des
journaux russes dans : Russkaja pressa i diplomatija nakanune pervoj mirovoj vojny, 1907-1914 (La presse russe et la diplomatie à la veille de la Première Guerre mondiale, 1907-1914), Moscou, éditions de l’IRI, 1997, et précise que I.N. Kalina (Kasincev) occupe ce poste à partir de 1908 (p. 35).
40 I. Kasincev, « Konstitucionnaja Turcija i ee perspektivy » (la Turquie constitution-nelle et ses perspectives), Russkoe Bogatstvo, mars 1909, p. 59, 60, 65.
clivages de la société russe qui comporte un courant autonomiste repré-senté à la première Douma, opposé au maintien d’une Russie « une et indivisible » selon la formule du préambule aux lois fondamentales publiées le 23 avril 1906 34. Si Kudrin s’en tient à des réflexions d’ordre politique, ce n’est pas le cas des autres publicistes.
Dans son article paru en avril 1909, Belorussov expose le projet de « Fédération des peuples de la péninsule balkanique et de l’Asie Mineure », en mentionnant ses défenseurs français, tchèques ou russes35. Mais, s’il le défend en théorie, il n’y croit pas en raison du niveau cultu-rel des populations de l’Empire et du poids des religions. Il admet qu’il existe un clergé musulman moderniste pour les affaires politiques, mais celui-ci demeure profondément conservateur pour les mœurs et la culture36. Après avoir persiflé l’ottomanisme, il conclut qu’un système fédéral ne pourrait exister qu’au terme d’un long processus de séculari-sation des sociétés balkaniques et qu’après l’affermissement de la Tur-quie dans ses frontières et la disparition du rêve de partage de sa succes-sion37. Deux mois plus tard, il est encore plus sévère dans ses analyses sur les masses turques, au sein desquelles seule la charia, la loi reli-gieuse, serait solidement implantée38.
Le correspondant du journal Russkoe Slovo à Sofia, I.N. Kalina, sous le pseudonyme de I. Kasincev39, décrit la situation tragique des Jeunes Turcs : leur nationalisme leur aliène les chrétiens de l’Empire qui seraient leurs vrais alliés dans leur entreprise de modernisation ; mais, s’ils renon-çaient à ce nationalisme, ils perdraient le soutien des musulmans. D’où la situation dangereuse dans laquelle se trouve le nouveau régime40. Toutes ces contradictions nationales, l’opposition entre les réformes à
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 56194093_Georgeon_21_Ybert.indd 561 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
562 ÉDITH YBERT
41 S. Konduruskin, art. cit., p. 59-61, 73-75.42 L’article « Vozrozdenie Turcii » (La renaissance de la Turquie), Kaspij, n° 128,
1er septembre 1908, p. 2, est signé A. A. Le ton et l’argumentation employés permettent d’affirmer que l’auteur est certainement Ahmed Agaev.
43 Ahmed bek Agaev, « Nacional’nyj vopros v Turcii » (La question nationale en Turquie), Zakavkaz’e, n° 144, 31 juillet 1909, p. 2. Cet article est déjà paru dans Kaspij.
44 Mahmed Sahtahtinski, « Krizic musul’manskoj zizneposobnosti » (La Crise de la viabilité musulmane), in Bikerman dir., Turecskij Sbornik, op. cit., p. 97-115.
faire et la charia sont violemment dénoncées par S. Konduruskin, qui porte des jugements fort péjoratifs sur les Turcs41.
À l’inverse, à Bakou, Ahmed Agaev s’insurge dans Kaspij contre les préjugés sans fondements selon lesquels l’islam ne serait pas compatible avec le progrès. Et, au ministre des Affaires étrangères de Russie décla-rant que l’ancien régime turc reposait sur l’humiliation des nationalités non-musulmanes, il répond que ce régime combattait toute aspiration au progrès, à la lumière, à la liberté de ses sujets qu’ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Et ce genre de régime n’a rien de spécifiquement musul-man, il peut se rencontrer partout ; l’auteur invite d’ailleurs à comparer les relations établies par les maîtres arabes avec leurs sujets espagnols, à celles des Espagnols avec les Arabes après la Reconquête. Il conclut en affirmant l’esprit démocratique de l’islam42.
Quelques mois plus tard, Agaev, ayant quitté la Russie en juin 1909 pour s’établir à Istanbul, s’exprime dans la presse de Transcaucasie sur la question nationale en Turquie. Constatant l’acuité des antagonismes nationaux qui désormais s’expriment ouvertement, il conclut son analyse par la considération suivante : « L’aggravation des tensions nationales et des tendances partisanes ouvre la voie au retour du despotisme »43. Il a d’une certaine façon dû renoncer à sa défense de la tolérance de l’islam et à son optimisme sur le nouveau régime en Turquie.
Les points de vue diamétralement opposés sur l’islam, son archaïsme ou son potentiel progressiste font écho à des débats et perceptions qui ont cours depuis longtemps. En revanche, le point de vue d’un autre musul-man du Caucase, Mahmed Sahtahtinskij, qui s’exprime dans le Recueil turc consacré aux événements du Proche-Orient44, paraît beaucoup plus original. En effet, l’auteur constate la toute puissance de l’Europe et la faiblesse du monde musulman qu’elle domine. Cette faiblesse, selon lui, est due principalement au fait que les sociétés musulmanes sont régies par une loi immuable, d’essence divine. Il prône donc la sécularisation, et d’abord l’indépendance du droit. Il en fait la condition préalable à la renaissance de l’islam. Et, s’il ne fait pas explicitement référence à la
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 56294093_Georgeon_21_Ybert.indd 562 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
DE BAKOU À SAINT-PÉTERSBOURG 563
45 Ibid., p. 109.46 Ibid., p. 113-114.47 Ibid., p. 115.
révolution jeune turque, il semble bien l’évoquer lorsqu’il parle de « liberté politique, pouvoir populaire et parlementarisme » et il affirme qu’ils sont inutiles si les musulmans ne peuvent élaborer leurs propres lois. Car, dit-il, « la charia anéantit chez le musulman la liberté concrète mais aussi l’idée, la notion même de liberté »45. Il mentionne bien le Hatt-i hümayûn de 1856 qui a proclamé en Turquie l’égalité de droit entre chrétiens et musulmans, mais l’esprit général de la charia demeure46. Et il conclut ainsi :
« L’initiative de la diffusion des idées des libres-penseurs dans le monde musulman, c’est à nous-mêmes, musulmans sujets des puissances occiden-tales de la prendre. Nous sommes libres vis-à-vis de la censure musulmane religieuse et pouvons sans risque pour nous-mêmes appeler les choses par leur nom. Nos coreligionnaires vivant dans des pays musulmans ne peuvent pas avoir un rapport critique aux questions religieuses, en raison de la cen-sure de la charia. Parmi les musulmans sujets des puissances européennes, nous, musulmans russes, devons naturellement jouer le premier rôle dans toutes les questions concernant l’acquisition de la civilisation européenne par les musulmans. Parmi nous, le mouvement européiste est le plus conscient ; il est plus fort chez nous que chez nos coreligionnaires sujets des autres nations européennes. »47
Situation internationale de l’Empire ottoman.
Cette question est l'objet de nombreux débats et l’année 1908 avec les crises de Bosnie-Herzégovine, de Bulgarie et de Crète met souvent au premier plan les événements balkaniques et les réactions des Puissances européennes. Je l’évoquerai très rapidement, non pour suivre le déroule-ment des événements et les commentaires qu’ils suscitent mais pour dégager quelques grandes tendances dans les analyses des publicistes sur les conséquences de la révolution turque sur la situation de l’Empire ottoman et les relations des Grandes Puissances à son égard. En fait, les thématiques abordées précédemment : succès ou échec de la révolution, résolution ou aggravation de la question nationale, fédéralisme ou cen-tralisme sont inextricablement liées avec celle de la survie, du démem-brement ou de la mort de l’Empire ottoman. Or, ces chances de survie dépendent de divers facteurs dont la politique des Puissances européennes et de la Russie à l’égard du nouvel État turc.
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 56394093_Georgeon_21_Ybert.indd 563 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
564 ÉDITH YBERT
48 A. Agaev, « Vozrozdenie Turcii », art. cit. 49 Konduruskin, art. cit., p. 79.50 Bikermann, op. cit. p. 47-48.51 V.I. Spil’kova, Mladotureckaja Revoljucija (la Révolution jeune-turque) Moscou,
1977, p. 152-153.52 Une lettre du directeur de l’Agence télégraphique de Saint-Pétersbourg, A.A. Girs,
à son correspondant à Constantinople, datée du 13 septembre 1908, lui enjoint de se mettre
En ce domaine, les prises de position découlent des analyses et convic-tions que nous avons évoquées. Aux deux extrêmes, se trouvent : d’une part, Agaev, qui affirme : « La Turquie n’est pas morte et nous ne voyons pas d’obstacles sérieux à sa renaissance. À côté des grandes puissances chrétiennes, à nouveau prendra place, comme naguère, une grande puis-sance musulmane avançant dans la voie du progrès » 48 ; d’autre part, Konduruskin, pour qui, en mai 1909, la Turquie est irrémédiablement morte, même si, comme il le rappelle, « les empires meurent et les peuples demeurent »49.
Parmi les opinions moins tranchées, celle de Bikerman qui annonce la renaissance de la Turquie avec un déplacement de son centre de gravité à l’Est et un salutaire abandon de ses possessions européennes rési-duelles50. Enfin, la chronique de politique étrangère de Vestnik Evropy assure que la diplomatie à l’égard des Ottomans doit changer, puisque l’homme malade s’est relevé.
L’information sur la politique des Puissances européennes et sur la diplomatie russe est étroitement contrôlée par le ministère des Affaires étrangères et l’Agence télégraphique de Saint-Pétersbourg. Les revues consultées ne débattent pas de la politique russe envers la Turquie nou-velle. En revanche, il y a une volonté officielle de proclamer la bien-veillance de l’Empire russe en vers le nouveau régime et la recherche d’une alliance avec lui. Le pouvoir se sert particulièrement d’un journal conservateur jouissant d’une grande popularité, Novoe Vremja, dirigé par A.S. Souvorine et qui se targue de garder son indépendance à l’égard du pouvoir, le soutenant dans certains domaines et le critiquant à d’autres occasions.
À partir de septembre 1908, est orchestrée une campagne de presse sur le rapprochement entre la Turquie et la Russie, après l’envoi d’une cir-culaire du 7 août du ministre des Affaires étrangères, A. P. Izvol’ski, aux diplomates en poste à Constantinople sur l’attitude bienveillante de la Russie à l’égard du nouveau gouvernement de la Turquie51. Cette cam-pagne de presse est confiée à Istanbul à Andrej Nikolaevic Mandel’stam52, éminent spécialiste de droit international et ottoman qui vient d’être
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 56494093_Georgeon_21_Ybert.indd 564 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
DE BAKOU À SAINT-PÉTERSBOURG 565
à la disposition de Mandel’stam, chargé d’assurer la liaison avec la presse turque pour la mise au point du rapprochement russo-turc (RGIA, Archives nationales historiques de Russie, F.1358, D. 990, p.32, cité par Kostrikova, op. cit., p. 87-88).
53 A.N. Mandel’stam, Mladotureckaja Derzava (l’Etat jeune-turc), Moscou, 1915, p. 37-40. L’auteur donne des extraits de Ikdam des 22 et 25 septembre 1908, de Ëûra-yı Ümmet des 28 octobre et 21 novembre 1908, de Tanin du 24 novembre 1908.
54 V.I. Spil’kova, op. cit., p. 154.55 Hüseyinzade, « Nemcy na bliznem Vostoke » (Les Allemands au Proche-Orient),
Kaspij n° 61, 12 mars 1904, p. 2.56 A.M.-b Topcibasev, « Pis’mo Turskogo konstitucionalista » (lettre d’un constitutio-
naliste turc), Kaspij n° 228, 25 novembre 1905, p. 2.
nommé premier drogman auprès de l’ambassade de Russie. Dans l’ou-vrage qu’il consacre aux Jeunes Turcs, ce dernier la mentionne comme si elle s’était développée spontanément, faisant dialoguer le journal pétersbourgeois Novoe Vremja avec les journaux ottomans de différentes tendances : Ikdam, Tanin et Ëûra-yı Ümmet53. Cette campagne est relayée en Russie tant par les journaux libéraux comme Rec’ ou Russkie Vedo-mosti que par les conservateurs comme Novoe Vremja54.
Ce rapprochement entre la Turquie et la Russie, puissances jusqu’alors rivales et hostiles, est souhaité par les musulmans de Russie et évoqué à plusieurs reprises par les journaux de Bakou, bien avant la révolution jeune-turque. Dès 1904, Hüseyinzade considérant la menace allemande en Orient, exhorte la Russie et l’Orient musulman à s’allier pour se « libérer ensemble des convoitises des peuples du Nord-Ouest »55. Fin 1905, Toptchibachy, faisant écho à une lettre reçue de Ali Haydar Mid-hat, critique avec virulence la diplomatie traditionnelle russe, qui, depuis 1815, s’est aveuglément alignée sur la politique violente et inique des Puissances européennes et appelle la Russie « libre et nouvelle » à établir de bonnes relations avec ses voisins orientaux et à œuvrer pour la libé-ration des peuples turc et persan par leur propre gouvernement56.
Après l’infléchissement de la politique russe à l’égard de la Turquie de l’automne 1908, ce thème est abordé à plusieurs reprises dans les journaux de Bakou, mais avec la prudence que réclame l’évolution auto-ritaire du gouvernement de la Russie et la situation au Caucase, alors au centre de violentes polémiques opposant la droite nationaliste aux réfor-mistes libéraux dont le vice-roi soutient encore quelques revendications qu’il s’est engagé à satisfaire pour mettre fin à la révolution de 1905. Au début d’octobre 1908, l’éditorialiste de Kaspij critique cependant la poli-tique russe dans les Balkans, qu’il juge timorée en comparaison de celle de l’Autriche : « Nous pouvons, dit-il, soit énergiquement soutenir la jeune Turquie et acquérir ainsi pour le futur un allié sûr, un fidèle gardien
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 56594093_Georgeon_21_Ybert.indd 565 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
566 ÉDITH YBERT
57 Kaspij, n° 155, éditorial du 4 octobre 1908, p. 2.58 « Rec’ musul’manina » (discours d’un musulman), Kaspij, n° 231, 14 décembre
1908, p. 2. 59 Ëükrü Hanioglu, Preparation for a revolution : The Young Turks, 1902-1908, Oxford
University Press, p. 302-305.
de l’entrée dans notre mer Noire ; soit, poursuivre notre politique tradi-tionnelle en prenant la direction des mouvements des Slaves des Balkans. Mais, nous n’avons réussi ni l’un ni l’autre ».57 D’une façon générale, les interventions des musulmans de Russie dans la vie publique ou dans la presse d’alors sont empreintes d’une grande retenue afin d’éviter de nou-velles accusations de panislamisme ou de tendances séparatistes. Les appels en faveur d’un rapprochement russo-turc mettent en exergue l’in-térêt national de la Russie et sont accompagnés de déclarations sur la loyauté des musulmans de Russie à l’égard de l’Empire dont ils sont des citoyens dévoués. Ainsi, en est-il du discours à la Douma d’État du député de Kazan, Sadretdin Maksudov, discours reproduit dans les colonnes du même journal de Bakou. Il appelle de tous ses vœux une alliance avec la Turquie nouvelle, car « pour la Russie, l’amitié avec l’Orient musulman est une nécessité du temps présent ». 58
A défaut de faire un tour d’horizon de la presse russophone musul-mane, je m’en tiendrai à la constatation suivante : le souhait d’un rappro-chement russo-turc s’inscrit dans une analyse « anti-impérialiste » (au sens où Ëükrü Hanioglu l’entend quand il étudie les idées politiques des Jeunes Turcs59) menée par les intellectuels musulmans du Caucase s’ex-primant dans Kaspij et dans une durée plus longue que celle de la cam-pagne de presse orchestrée par le ministère des Affaires étrangères.
Conclusion
Avant d’esquisser une conclusion, une remarque s’impose qui carac-térise l’ensemble de cette production journalistique : une relative proxi-mité entre les sociétés et les situations politiques dans les Empires otto-man et russe permet aux journalistes d’employer des termes russes pour décrire les événements et les institutions ottomanes et de ne recourir qu’exceptionnellement à des termes turcs (« charia », « fetva » consti-tuant deux des rares exceptions rencontrées). Ainsi, les clivages natio-naux et confessionnels sont évoqués avec les termes en usage dans la société russe. La transposition va plus loin, et s’applique à des person-nages ou à des groupes, acteurs de l’histoire. Dès le début d’août 1908,
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 56694093_Georgeon_21_Ybert.indd 566 20/08/12 11:3620/08/12 11:36
DE BAKOU À SAINT-PÉTERSBOURG 567
60 « Said Paca- tureckij Vitte ? », Zakavkaz’e, n° 162, 20 juillet (2 août ) 1908, p. 1.61 Belorussov, « Novaja i staraja Turcija », art. cit., p. 350. 62 A. N. Mandel’stam, Mladotureckaja Derzava, op. cit., p. 62.
le journal Zakavkaz’e se demande si le nouveau grand-vizir Said PaÈa sera le Witte turc60. La contre-révolution de mars-avril 1909 porte le sobriquet de cernosotennaja (« Centuries Noires ») appliqué aux organi-sations ultranationalistes russes. Enfin, Belorussov compare la situation de la Turquie au début du XXe siècle à celle de la Russie deux siècles auparavant et s’interroge sur l’avenir de la révolution et du pays, en évoquant le rôle de Pierre le Grand en Russie.61Et en 1915, A. N. Man-del’stam constate que, pour sauver la Turquie, il aurait fallu le génie et la volonté de fer d’un Pierre le Grand.62
Si la grille de lecture de la révolution russe peut dans certains cas s’avérer un prisme déformant (comme dans la question de la poursuite de la révolution et du projet d’instauration d’une République sociale en Turquie), si les chronologies respectives des événements en Russie, au Caucase et dans l’Empire ottoman jouent un rôle important dans bien des analyses évoquées, il n’en reste pas moins que les différents auteurs ont placé au centre de leurs réflexions les processus d’occidentalisation et de sécularisation. Or, ce sont des thèmes fondamentaux des débats idéolo-giques de la seconde période constitutionnelle de l’histoire turque, qui s’articulent autour de deux questions principales : la dose d’occidentali-sation à adopter pour la régénération de la Turquie et la base de l’identité et de la loyauté pour le nouvel Etat ottoman, « européistes », selon l’ex-pression de Sahtahtinskij, ottomanistes, turquistes et islamistes apportant des réponses différentes.
94093_Georgeon_21_Ybert.indd 56794093_Georgeon_21_Ybert.indd 567 20/08/12 11:3620/08/12 11:36