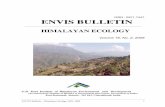Bulletin Maurice Carême n°57
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Bulletin Maurice Carême n°57
Historique de la fondation :
La Fondation Maurice Carême fut créée en 1975. Elle a pour but de promouvoir la dif-fusion de l’œuvre de Maurice Carême ainsi que de favoriser son étude scientifique, et ce, de la manière la plus large possible, tant en Belgique qu’à l’étranger. La Fondation Mau-rice Carême assure la conservation du patri-moine de manuscrits, de livres et d’œuvres d’art du Musée Maurice Carême. Elle tra-vaille également à la mise en valeur de la création poétique en Belgique, notamment grâce au Prix de Poésie Maurice Carême.
Conseil d’administration :
Présidente : Jeannine Burny ; Vice-président : Jean-Pierre Vanden Branden ; Administrateurs : Jacques De Decker, Diana Gonnissen, Jean Vanlatum, Liliane Wouters, Philippe Duhoux, Jean Jauniaux, l’Administration communale d’Anderlecht.
Droits de reproduction :
La Fondation Maurice Carême détient tous les droits légaux relatifs à l’œuvre de Maurice Carême, en ce compris les droits d’auteur, les droits de reproduction, de traduction, de mise en musique, etc. Aussi faisons-nous appel à tous afin de nous communiquer les articles, parutions de poèmes, communications dans la presse, à la radio ou à la télévision ainsi que les manifestations – conférences, récitals, etc. – en rapport avec l’œuvre de Maurice Carême. Seuls, les président, vice-président et adminis-trateurs de la Fondation Maurice Carême sont habilités à donner l’autorisation de reproduire des textes de Maurice Carême et à prendre toute initiative relative à l’œuvre de celui-ci et aux activités de la Fondation elle-même.
Soutiens :
Les activités de la Fondation Maurice Carême peuvent se développer grâce à l’appui de la Pro-motion des Lettres de la Communauté Française, de la Commission Communautaire de Bruxelles-Capitale, de la Province du Brabant wallon, de la Commune d’Anderlecht, de la Ville de Wavre, du C.G.R.I et de la fidélité et de l’enthousiasme des amis de Maurice Carême. Qu’ils en soient tous remerciés !
La vie des archives :
La Fondation Maurice Carême remercie très vive-ment les amis et admirateurs de Maurice Carême qui lui ont envoyé des documents durant l’année 2011. Grâce à leur aide précieuse, la connaissance de l’œuvre et du parcours de l’écrivain ne cesse de s’affiner. Elle est, en particulier, heureuse de vous annoncer que Marie-Angèle Delhaye lui a offert la correspondance de Maurice Carême à André Gascht pour que la conservation de ce patrimoine, qui lui tient à cœur, soit assurée. De même, la famille de Devi Tuszynski a légué 9 des-sins de celui qui fut l’ami de Maurice Carême et qui illustra l’édition de 1979 du recueil « Petites Légendes ».
N’hésitez donc pas à transmettre à la fondation les originaux ou des photocopies de lettres ma-nuscrites, de dédicaces ou de tout autre docu-ment relatif à l’œuvre ou à la vie de Maurice Carême. Les documents reçus sont versés aux archives du Musée Maurice Carême et viennent augmenter les collections qui appartiennent à la Fondation Maurice Carême.
La volonté de Maurice Carême de voir réuni dans sa maison tout ce qui fut le cadre de sa vie quotidienne et littéraire se réalise ainsi chaque jour un peu plus grâce aux bonnes volontés de ceux qui aiment son œuvre.
** *
Contact :Jeannine Burny Avenue Nellie Melba, 14 – 1070 Bruxelles Tél. : 02 521 67 75Fax : 02 520 20 86Courriel : [email protected] : www.mauricecareme.be
Pour suivre l’actualité des parutions et des activités autour de l’œuvre de Maurice Carême, consultez la page Facebook de la fondation Carême (tapez « Musée Maurice Carême Facebook » dans votre moteur de recherche).
Rédaction et mise en page de ce numéro : Jeannine Burny et François-Xavier Lavenne
3
Maurice Carême,
fournisseur de la cour des bonheurs
Le plus amusant, le plus frappant, le plus curieux, c’est que Maurice Carême porte un patronyme qui n’a absolument rien à voir avec son œuvre. Pas besoin de jeûne ni d’abstinence pour aller à sa rencontre. Et pas besoin de se prendre la tête pour apprécier les innombrables poèmes qu’il n’a pas arrêté d’écrire toute sa fructueuse vie durant et dont beaucoup ont été traduits et continuent sans cesse de l’être, à intervalles très réguliers, aux quatre coins de la planète.
Quand on lit ses poèmes, quand on les entend réciter ou chanter, sur des musiques de Florent Schmitt, de Darius Milhaud, de Francis Poulenc ou d’Henri Sauguet par exemple, on se sent toujours bien – bien au chaud comme chez soi, et presque heureux de vivre, presque étonnés et ravis d’être au monde, auprès des chiens, des chats, des éléphants, des sapins de Noël, des tableaux noirs sur les murs des écoles, des cartes à jouer sur les tables des tavernes, des bananes à La Havane, des bateaux à Pampelune, des épiceries à Londres ou d’une gigantesque tour métallique dressée par Gustave Eiffel à Paris…
Mais il ne faudrait pas oublier que Maurice Carême a aussi été un fantastiqueur et qu’avec son court roman Médua publié en 1976, il a donné une des histoires d’amour les plus insolites et les plus ambiguës de la littérature surnaturelle du XXe siècle : celle d’un homme d’âge mûr ramassant une méduse échouée sur une plage de la mer du Nord et s’attachant à elle, comme on s’attache, corps et âme, à une femme qui vous obsède. Quant à Un trou dans la tête, un roman paru en 1964, il met en scène un pauvre bougre en proie à de terrifiantes hallucinations et basculant petit à petit dans la folie.
On ne dénombre plus aujourd’hui les supporters de Maurice Carême. Parmi eux, il y a trois autres Maurice qui font, tous les trois, partie du sérail des lettres : le grammairien Maurice Grevisse qui aimait « le beau français, clair, adroitement cadencé, irréprochablement correct » de ses poèmes ; l’essayiste et romancier Maurice Toesca qui comparait ses vers « au rythme de la respiration » ; et Maurice Fombeure qui, sans lui ressembler, appartenait à la même famille que la sienne, la famille peu nombreuse, mais si agréable, si ardente, des poètes enchanteurs. Non, quoi qu’en pensent et quoi qu’en disent les cuistres, les faux savants et les bas-bleus de la critique, Maurice Carême n’est pas près d’être inscrit au compte de pertes et profits de la littérature.
Jean-Baptiste Baronian
Éditorial
4
Le musée Maurice CarêmeC’est en 1933 que Maurice Carême fit construire, à Anderlecht, la « Maison blanche » – nom qu’il donna plus tard à l’un de ses recueils – dans un style qui rappelle celui des béguinages flamands qu’il affectionnait. Son architecte est Charles Van Elst à qui l’on doit la restauration de la Maison d’Érasme toute proche.
Depuis la mort du poète en 1978, la maison est devenue un musée où le visiteur peut découvrir l’univers dans lequel il écrivit. Il s’agit, en Bel-gique francophone, du seul musée consacré à un écrivain qui conserve intact le cadre où il vécut avec ses meubles d’époque en chêne, sa vaisselle et ses bibelots anciens. Un riche patrimoine de manuscrits, lettres, photographies, éditions illustrées, peintures, dessins, sculptures y est conservé. Musée littéraire, le musée Carême est également un musée d’art. Les œuvres exposées témoignent des liens d’amitié que le poète noua avec des peintres comme Paul Delvaux, Felix De Boeck, Henri-Victor Wolvens, Luc De Decker, Léon Navez, Roger Gobron, Edgard Tytgat, Devi Tuszynski, Rodolphe Strebelle, Marcel Delmotte, Roger Somville, Jules Lismonde…
Le musée Carême fait partie de la « Fédération des maisons d’écrivains et des patrimoines littéraires de France ». Le poète y a laissé une présence que l’on perçoit lors des visites gui-dées assurées par celle qui fut sa secrétaire. Des conférences, des animations poétiques y ont lieu régulièrement.
La Bibliothèque
De son vivant, Maurice Carême était connu pour posséder une bibliothèque de poésie particulière-ment vaste et éclectique. Après sa mort, la fonda-tion Carême, a continué de l’enrichir. Plus de 5000 titres, dont un grand nombre de recueils sont rares ou épuisés, couvrent la poésie mondiale. La biblio-thèque de la fondation Carême est également riche en essais sur la littérature, l’art, les religions et la philosophie.
Elle possède une importante collection d’albums illustrés pour la jeunesse et d’ouvrages didactiques consacrés à l’enseignement de la poésie aux enfants. La fondation s’investit particulièrement dans ce do-maine en organisant des animations dans les écoles.
5
Le fonds d’archivesLe musée Maurice Carême abrite un fonds d’archives où sont conservés l’intégralité des manuscrits et des tapuscrits de l’auteur, de la correspondance, des éditions précieuses, des photographies et des enregistrements. Il regroupe également l’ensemble des œuvres tra-duites et mises en musique ainsi que les articles de presse et la critique scientifique consacrés à l’œuvre.
Parmi les pièces qui peuvent y être consultées figurent des lettres échangées avec des per-sonnalités du monde littéraire, comme Michel de Ghelderode, Paul Fort, Jules Supervielle, Thomas Owen, Paul Willems, Marie Gevers, Paul Neuhuys, Geo Norge, Pierre Seghers, Gaston Bachelard… ainsi que de la correspondance et des partitions autographes ou dédi-cacées de Francis Poulenc, Darius Milhaud, Jacques Chailley, Arthur Honegger, Carl Orff...
sainue les articles de presse et la critique scientifique consacrés à l’œuvr
Musée Maurice Carême :
Avenue Nellie Melba, 14 – 1070 BruxellesMétro Veeweyde ; tram 81 (jour), 31(soir) ;bus 46-75-89-118 Visites sur rendez-vous uniquement :Téléphone : 02.521.67.75 Courriel : [email protected]
Le fonds d’archives et la bibliothèque sont accessibles sur demande aux chercheurs et à ceux qui s’intéressent à la poésie.
6
Le dualisme entre monter et descendre dans la poésie de Maurice Carême
La verticalité est la ligne du qualificatif et de l’élévation. La vocation de l’homme est de vivre dans cette dimension verticale. L’axe vertical relie les trois niveaux cosmiques : l’enfer, la terre et le ciel. L’homme vit sur cet axe, faisant un voyage perpétuel dans les deux directions.
Dans les poèmes de Maurice Carême, le haut et le bas, les mouvements ascendants et descendants se manifestent parallèlement. Le dualisme, l’opposition de monter et de descendre, est représentée dans le lexique pur de l’énoncé poétique par la fréquence des mots : haut, hauteur, monter, lever, se soulever, hisser, lancer, grimper, voler, et l’opposition par les mots : bas, profondeur, descendre, tomber, s’abaisser, creuser, pencher, s’écrouler.
En ce qui concerne les images des poèmes, il y a un mouvement « de bas en haut, de haut en bas » perpétuel dans leurs projections, dans lesquelles des passages symboliques assurent la transition : l’échelle, l’escalier, la tour, le puits.
La mise en forme d’une aspiration vers le haut, de l’ascension, du dépassement, de la croissance est toujours réalisée dans la dialectique du haut et du bas, dans la tension entre ces deux extrémités.
Les uns passent, là-bas, très haut.D’autres, hélas ! passent très bas1
L’ascension est un progrès au sens de valeur ; ce qui se dirige vers le bas perd sa valeur humaine.Que l’homme puisse aller si hautEt descendre si bas parfoisMe confond.2
Se diriger vers le haut est un voyage de découvertes, une cognition. L’envie du savoir projette l’homme là-haut. Ce voyage est une sorte de purification : le but de cette élévation est d’atteindre la transcendance, l’assimilation progressive de ce qui représente le ciel : atteindre l’harmonie, la divinité, la « haute et pure présence » de Dieu3.
L’élévation, l’envie de se diriger vers le ciel, se manifeste dans des images allégoriques ou dans des images de vision. La mouette comme une haute voile « que des matelots de légende hissent là-bas sur le couchant ? »4, est une image d’ascension qui oppose le haut et le bas.
L’environnement connu et familier représente aussi une ascension éternelle vers le haut : les hauts peupliers, la hauteur des abeilles, les blés montant dans le soleil5, ainsi que l’image de vision qui exprime le mouvement vers la clarté :
Et ma maison aussi monte parfois le soirA si folle hauteur qu’on ne peut plus la voir...L’avenue à son tour se soulève en chantant.6
Les murs de ma maison s’étaient mis à voler.7
1. « Tant de pas d’hommes ! », in Complaintes, 1975, Bruxelles, Gérard Blanchart et Cie, 4e éd., 1994, p. 77.2. De feu et de cendre, Paris, Fernand Nathan, 1974, p. 76.3. Heure de grâce, 1957, Bruxelles, chez l’auteur, 2e éd., 1958, p. 183.4. « La mouette », in Petites légendes, Paris, Les Éditions du Sablier, 1949, p. 57.5. « Rien ne pouvait m’étonner », in Du ciel dans l’eau, Lausanne, Éditions de L’Âge d’homme, collection « La Petite Belgique », 2010, p. 45.6. « Et ma maison aussi… », in La maison blanche, 1949, Paris, Bourrelier et Colin, 6e éd., 1972, p. 36.7. Heure de grâce, op. cit., p. 138.
Agnès Toth
7
Le rapprochement de l’homme vers la hauteur rejoint le mouvement de descente de ce qui représente le haut et la transcendance. Les deux mouvements sur l’axe vertical, l’opposition entre l’ascension et la descente ne sont pas une confrontation. Ce sont plutôt les deux aspects d’une expérience vécue, la double polarité d’une même vie.
De même que les avenues se soulèvent, ainsi les chemins descendants des cieux apparaissent aussi dans les images. Il y a une interférence entre la terre et le ciel. La descente forme un lien entre la terre et le ciel où l’homme doit être vigilant : il est difficile d’attraper l’ange qui descend dans la demeure nocturne8. L’homme n’est pas prêt d’être confronté à cette vision transcendante. Voir un morceau de l’éternité (regarder en haut) et percevoir la profondeur de soi-même (regarder en bas), c’est troublant, pesant.
Le cavalier descend du ciel...Il a des prunelles parfaitesOù, dans la pureté du soir,Les âmes seules se reflètent…Et qui n’aurait peur de s’y voir ?9
Dans ce mouvement vertical les lois physiques disparaissent, c’est une dimension surnaturelle, non plus terrestre, un état d’apesanteur :
Il crut voir une grosse pierreDescendre de l’éternité,Grosse pierre, mais si légère…10
L’échange entre le haut et le bas, entre la hauteur et la profondeur se matérialise dans l’interférence entre l’étoile du ciel et la vague de la mer. Il existe un point où le fond de la mer et la hauteur de l’air se voient, se croisent, s’unifient. Ce n’est pas un point géographique, c’est « un port » sans signe « sans marées et sans mâts ». Il faut le trouver pour atteindre le mystère11.
La même image se retrouve dans le poème Le ciel dans l’eau. Le « haut » s’unifie au « bas » sous la branche basse, sous la nuée dans l’eau, dans « la clarté basse », et sur la branche basse un oiseau par son chant réunit l’espace : il « fait chanter, sous lui, l’espace»12. Sous la branche basse, on est capable de voir le haut, d’entendre le chant comme le pouvoir unifiant. S’accomplit ainsi la synthèse entre l’espace polarisé, le bas et le haut, le quotidien et le sacré.
L’homme en bas avec son désir de monter la pente peut atteindre le haut. Mais pour cela, il faut d’abord descendre au fond pour apprécier la hauteur, s’abaisser, se mettre à genou, creuser de plus en plus bas13, descendre dans la profondeur de soi-même, activer cette profondeur ; tout cela pour arriver au dépassement de soi.
Vivre dans cette tension entre les deux extrémités, tomber et remonter, ou s’envoler, être soulevé et redescendre, c’est le plus naturel, c’est la voie humaine. Tout ce qui monte et descend poursuit le dynamisme de la vie. Pour pénétrer cette voie, il existe des outils, une échelle, un escalier, un cerf-volant, des tréteaux, une poulie.
Pourquoi toute ma vie,Quoi que je fasse ou croie,Est-elle une poulieSuspendue à sa croix ?14
L’arc-en-ciel représente aussi la voie descendante, aussi bien qu’ascendante, par laquelle les habitants du ciel communiquent, créent une alliance avec ceux de la terre, comme avec une échelle. Inscrit à l’intérieur d’un cercle, l’arc-en-ciel permet, dans le même temps, la descente et la montée et
8. « L’ange était là », in L’envers du miroir, 1973, Fernand Nathan, 3e éd., 1975, p. 39.9. « Le cavalier », in Petites légendes, op. cit., p. 35.10. « La grosse pierre », in Entre deux mondes, 1970, Paris, Fernand Nathan, 3e éd., 1978, p. 72.11. « L’étoile et la vague », in Petites légendes, op. cit., p. 25.12. « Le ciel dans l’eau », in Du ciel dans l’eau, op. cit., p. 16.13. « Creuse… », in Entre deux mondes, op. cit., p. 23.14. « Oh ! Je sais bien... », in Être ou ne pas être, Lausanne, Éditions de l’Âge d’homme, collection « La Petite Belgique », 2008, p. 47.
Études
8
met en équilibre les deux mouvements.Oui, mais l’échelle se brisa.– Rien de bien curieux à cela –Et l’ours, sans le moindre embarras,Dansa dès lors sur l’arc-en-ciel.15
Essayez un peu comme moiDe vous asseoir sur l’arc-en-cielPour parler avec le soleil.16
Le poète est l’homme vigie « au mât le plus haut de la vie »17, assis sur l’arc-en-ciel qui, en chantant, « fait monter les peupliers »18 ; qui met les mots « à la voile », qui permet à la chanson de monter « sans fin vers la clarté »19. Le poète même est un passage, un lien entre le bas et haut, il parcourt tout l’axe vertical :
Et les mots que j’écris, pris dans ces hautes mailles,Semblables aux poissons des grandes profondeurs,Eclatent brusquement avec un bruit d’écaillesEt, déchirant un monde obscurci par l’attente,Retombent sur la terre en étoiles filantes.20
Le mouvement éclatant de cette force créative relie le plus bas avec les hauteurs éternelles. Le bas avec cette image d’écaille cache un trésor, le voyage vertical de la vie créatrice révèle les trésors terrestres et divins.
L’homme créateur est capable d’ouvrir un trou aux grandes profondeurs tout autant qu’un cratère et un trou profond aux hauteurs du ciel où :
chacun put voir, à son tour,Le visage de l’éternel.21
Sur cet axe vertical c’est toujours l’état d’enfant qui crée un équilibre. Il suffit d’un enfant pour que l’au-dessus et l’au-dessous, « ce vaste paysage se résume, en souriant sur un visage »22.
C’est l’enfant qui rêvait de monter sur les hauts peupliers, ce sont les rêves d’enfance que l’on ne s’acharne pas à réaliser23. Descendre au fond de soi c’est le pouvoir de faire remonter « à la lumière la voix de l’enfant que tu fus »24. Les enfants peuvent courir sur la hauteur des nues et peuvent rêver de bas en haut.
La tension du haut et du bas est dissoute dans l’âme d’enfant, comme symbole de la pureté : par rapport à un gueux « qui rêvait tout haut », un enfant « qui rêvait tout bas » peut sauver le roi transformé en corbeau25.
Agnès Toth
Université Catholique de Budapest
15. « L’ours », in Le Jongleur, Lausanne, Éditions de L’Âge d’homme, 2012, p. 56.16. « Rien ne plus simple », in Le Jongleur, op. cit., p. 91.17. « Exultation », in La maison blanche, op. cit., p. 72.18. « Dans la forêt », in Le Jongleur, op. cit., p. 95.19. « L’air ne fait pas la chanson », in Le Jongleur, op. cit., p. 66.20. « Il m’arrive, le soir… », in La maison blanche, op. cit., p. 35.21. « Les clés », in Entre deux mondes, op. cit., p. 70.22. « L’enfant », in Petites légendes, op. cit., 87.23. « Le peuplier », in Défier le destin, Bruxelles, éditions Vie Ouvrière, collection « Pour le plaisir », 1987, p. 23.24. Heure de grâce, op. cit., p. 34.25. « Le corbeau », in Petites légendes, op. cit., p. 24.
Agnès Toth
9
En hommage à Carême
En ce temps-là – c’était en 1969, j’avais 15 ans –, j’étais un tout jeune poète qui ne songeait pas à publier et qui n’avait montré ses poèmes qu’à quelques personnes de confiance. Mais j’écrivais déjà depuis plusieurs années : c’est juste avant Noël 1965 que je fis mon premier poème.
Je ne sais pas ce qui m’a pris, ce n’était pas de l’orgueil, plutôt un fort besoin de reconnaissance, j’ai envoyé à Maurice Carême quelques poèmes tapés à la machine, sans croire un instant qu’il me répondrait.
À ma grande surprise, il répondit et me fit don d’un ouvrage sur lui, dédicacé : c’était sa biographie parue dans la prestigieuse collection de chez Seghers, Poètes d’aujourd’hui.
Par la suite, j’ai continué à lui envoyer des poèmes, il me répondait à chaque fois et m’offrait à l’occasion l’un de ses livres récemment paru.
Il faut se rendre compte que Carême représentait un monument immense pour le jeune adolescent que j’étais, d’autant plus que le fameux Tu vates eris, (« tu seras poète ») me tomba dessus, comme une annonce, un pressentiment déjà très clair, lorsque j’étais en deuxième année primaire : et ce fut suite à l’étude en classe d’un poème de Maurice Carême !...
À l’été 1970 (j’avais 16 ans), Carême m’invita chez lui, à la « Maison blanche ». Nous partîmes de Tournai par un beau jour en direction de Bruxelles, mon père conduisait la voiture et j’étais accompagné par Madeleine Gevers, le poète qui m’a tout appris en poésie et qui m’initiait au métier de poète depuis mes quatorze ans, en 1968.
Arrivés à Anderlecht, Carême nous accueillit, Madeleine et moi (mon père attendant dans sa voiture). Il faisait beau. Notre hôte prestigieux nous fit patienter dans le petit jardin, je me rappelle qu’il y avait là un arbre qui semblait trôner, auprès duquel nous nous sommes assis Madeleine et moi. Puis le poète nous reçut à l’étage dans son bureau (c’était l’après-midi) avec un très grand sens de l’accueil, beaucoup de gentillesse – car il ne voulait pas davantage impressionner ce très jeune homme plein de vénération qui s’adressait à lui en l’appelant : « Maître »…
Il me fit des commentaires sur mes poèmes, sans du tout me donner de leçons, il me parlait de la Poésie, de ce qu’elle était, des poètes qu’il admirait et je me souviens qu’il me cita Verlaine : « Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme… ». Il me recommanda d’« écrire davantage avec le cœur qu’avec l’esprit », me demanda si je prenais le temps d’écrire régulièrement. Comme je lui disais que j’étais au collège, qu’il y avait les études, il me répondit clairement : « Vous devez voler du temps à l’école ! »… Cette parole bien subversive m’étonna, me subjugua, je la garde toujours. Je vole du temps au temps pour la poésie. Il me conseilla également d’abandonner mon pseudonyme de l’époque, que j’ai jugé après-coup franchement ridicule, et de garder mon propre nom : ce que je fis.
D’une manière étonnante, il se confia, il nous fit part des difficultés qui étaient les siennes, à savoir que certaines personnes du « milieu littéraire » le snobaient, etc… Mais, remarquablement, il ne mentionna jamais à quel point il était déjà traduit dans de nombreuses langues, il ne nous dit pas non plus que plusieurs de ses poèmes avaient été célébrés par de grands compositeurs de musique classique, mondialement reconnus. L’adolescent que j’étais a senti une souffrance chez Carême et aussi une très grande humilité.
Lorsque nous quittâmes la « Maison blanche », Carême m’impressionna terriblement : il nous raccompagna jusqu’à la voiture où attendait Laurent, mon père, et bavarda avec lui de longues minutes… Je n’en revenais pas, j’étais très touché, très fier que mon père, simple ouvrier à l’origine – lui qui ne lisait jamais aucun livre –, parlait ainsi, tout simplement, avec un grand poète. Ce souvenir ne m’a jamais quitté, il me demeure toujours à vif, très aigu. Je vois encore très clairement la scène de cette belle fin d’après-midi d’été.
Il y a quelques années, j’ai relu avec un jeune ami, Fabien Abrassart, et ce durant plusieurs heures, des poèmes de Carême, poèmes notamment destinés aux petits enfants. J’étais déjà Professeur de psychologie clinique à l’UCL et cet ami était lui aussi psychologue, d’obédience psychanalytique, mais avant tout poète lui-même.
Témoignage
10
Nous avons pris alors conscience que ces poèmes, clairs et limpides, étaient le fruit d’une longue décantation, qu’ils venaient du profond de l’âme, et qu’ils étaient construits en plusieurs strates. Œuvres d’un dépouillement, ils contenaient toute une archéologie, plusieurs plans ou couches sémantiques : pour qui sait lire, certains poèmes, mine de rien, avaient quelque chose de secrètement subversif, quoique sans violence. « Subversif » veut dire que ces poèmes avaient le pouvoir de nous atteindre jusqu’aux passions de l’enfance, de chambouler totalement la sagesse bien convenue de l’adulte assagi…
Ce que nous nous sommes dit alors, c’est que Carême, pour écrire de tels poèmes, avait dû, sans aucun doute, pénétrer jusqu’au noyau de feu qu’est cet enfant créateur en nous, enfant souvent refoulé, étouffé, mais toujours vivant sous les bâillons de l’adulte si bien dressé par les convenances, les idées et la langue toutes faites.
L’adulte dort, anesthésié (même s’il ne le sait pas) et la poésie de Carême vient réveiller ce qu’il y a de vivant et de créateur en lui.
Carême a soutenu et aidé de nombreux poètes, parfois très jeunes : je ne fus pas le seul. Notre grand homme avait le sens de la jeunesse, il veillait à sauvegarder les liens de la transmission des aînés vers les jeunes, c’était un grand connaisseur de l’âme humaine et il était sincèrement humble, d’une humilité à la mesure de sa grandeur.
Carême est toujours vivant pour moi, tout ce que j’ai vécu dans mon lien avec lui reste vivifiant, intact et ma gratitude envers lui n’a pas de fin.
Philippe Lekeuche 1er février 2012
** *
Philippe Lekeuche
11
L’humanisme dans l’œuvre de Maurice Carême
« Être ou ne pas être » (2008)
Comment situer cette œuvre posthume, la 4e à paraître des onze recueils inédits que Maurice Carême laisse à sa mort le 13 janvier 1978 ? Sans doute aucun, il faut se référer à l’immense culture du poète, non seulement dans le domaine poétique – elle couvre le monde et remonte à l’Égypte ancienne – mais à ses lectures des philosophes. S’il place Nietzsche et Herman von Keyserling au Panthéon de ses préférences, il a lu – même parfois avec agacement devant leur intellectualisme – les plus célèbres d’entre eux. La découverte de la psychanalyse de Freud l’a à ce point marqué qu’il l’évoquera tout au long de sa vie. Il est fasciné devant les dernières recherches des paléontologues. Il étudie de près les grandes religions et les sagesses orientales. Le Zen lui sera source de bien des poèmes.
Cette longue approche l’amènera à s’interroger sur le mystère de l’univers – il est passionné d’astronomie – sur l’insondable énigme de l’homme qu’il demeure à ses propres yeux, sur sa propre création dont le jaillissement échappe à sa volonté et à toute explication rationnelle.
Je me demande quelquefoisPourquoi, un matin, je suis né.Évidemment, il n’y a pasDe réponses à ce fait-là. Mais je me plais à l’évoquerLorsque mon esprit n’est pas làPour se mettre à le discuter,Car, avec lui, jamais de trêve.Même quand je dors, il se croitPermis de déranger mon rêve.Enfin, puisque l’on m’a fait naîtreQuand les oiseaux faisaient tremblerLe ciel de mai à la fenêtre,Contentons-nous donc d’exister.
Les poèmes d’« Être ou ne pas être » – comme l’ensemble des œuvres non publiées en 1978 – ont été écrits dans les vingt dernières années de sa vie. Les recueils se sont échafaudés parallèlement, même si la majorité des textes datent de 1971 à fin 1977. Dès le milieu des années soixante, Maurice Carême travaillera à plusieurs œuvres à la fois en ce qui concerne l’aspect grave de sa création. Cela explique, la diversité de ton de celui-ci. Cette année 2012 paraît « Le jongleur ». Nous l’évoquons dans ce bulletin.
Une longue gestation de tous ces acquis culturels va se faire à son insu en ces recès de la mémoire d’où il les verra parfois ressurgir au moment où il s’y attend le moins. Il a beau s’interroger sur les liens qui se tissent ainsi en lui, il lui faut avouer qu’ils échappent à sa raison et encore davantage à sa compréhension. S’il le savait, se dit-il, trouverait-il encore ces textes dont son crayon noircit sa feuille ?
Je laissais le poèmeAller où il voulait.Je ne savais pas bienCe qu’il cherchait sans finTel un chien aux aguets.Moi, je ne disais rien,Car c’était son secret.J’allais où il allaitEt comme il le voulait.
Études
12
Des hêtres, dans le ciel,Découpaient des trous bleusQui semblaient les fenêtresD’un château fabuleux.
Est-ce cela qui le rend aussi humble vis-à-vis de sa poésie, ou est-ce le mépris que lui oppose une grande partie du milieu littéraire belge ? Une question le hante : « Mes poèmes valent-ils quelque chose ? ». Il se répète : « Tant pis si je me trompe, cette simplicité est ma vérité ». Des traducteurs, des musiciens s’enthousiasment. On le publie dans un grand nombre de pays, les partitions musicales se multiplient, le public le lit, on l’enseigne au cours de français et dans les pays francophones et dans les pays étrangers. Parmi ceux-ci, la Russie lui donne une place de choix.
[…] N’étais-je pas fait pour briller ?Hélas ! et c’est ce qui me navre,Nul ne le sait pas même à WavreOù je suis né.
Dans un autre poème, il reprend à nouveau :[…] Ajoutons, pour être honnêteQue je suis un peu poète.Hélas ! personne n’y croit.
Le miracle de son enfance ne finit pas de l’étonner. On pourrait croire qu’il la magnifie. Mais aucune note de brume ne vient jamais en obscurcir l’image.
Eus-je une enfance, en eus-je mille ?Je ne sais plusTant j’ai de souvenirs en pile Dans mon cœur nu.Le beau visage de ma mèreBrille dessusComme une paisible lumièreSur un talus. […]
Puis soudain, en fin de poème, l’éternel constat ressurgit alors que rien dans le texte ne l’avait laissé soupçonner
[…] Et cependant, malgré cela,Je vous l’avoue, je ne suis pas Encore un homme.
La même vision revient ailleurs, mais dans un contexte positif.[…] J’aurais dû devenir un homme,Mais je n’ai pas mangé la pommeDe la science ni du progrès.Je suis resté ingénumentL’enfant qui, mordant un bluet,Sent le ciel craquer sous sa dent.
Est-ce à dire que Maurice Carême ne s’est intéressé ni à la science ni au progrès ? Ne nous y trompons pas. Mais il a été témoin des horreurs du XXe siècle, de ce que les hommes ont fait d’inventions qui, au départ, s’avéraient pleines d’humanité. À force de se laisser prendre aux pièges d’un monde matérialiste, l’homme finit par ne plus voir les véritables beautés : la simple fleur au bord du chemin, un beau paysage, l’étoile qui, dans la nuit, éclaire tout le ciel.
[…] Oui, j’aurais pu comme tant d’autres Me poser de graves questions,Mais la saveur d’un pain d’épeautreVaut pour moi toutes les leçons. […]
Jeannine Burny
13
Exprimer, dans un vocabulaire accessible à tous, ces vérités profondes que tant d’êtres oublient lui apparaît comme le devoir du poète :
[…] Les mots que j’emploie ?Tous ceux que ma mèreDisait autrefoisDroite en la lumière.
Il insiste sur la nécessité de ce choix en pensant à tant de faiseurs en littérature.Que vous me faites rireAvec vos mots abstraits !Que croyez-vous saisir D’essentiel dans leur rets ? […]
S’il semble se moquer de l’art poétique, c’est un leurre quand on connaît la place assignée en sa création à l’architecture du poème, la prosodie, le rythme des vers, leur musicalité.
Un art poétique ?Non, je n’en ai pas.Et je n’aime pasLa métaphysique. […]
En fin des textes, ce qui, au départ, était le plus souvent évidence se métamorphose et se multiplie en niveaux de lecture.
J’ai bien ri, bien bu, bien mangé.Je me suis assis au jardinDans l’ombre fleurie du pommierEt j’ai parlé à mon voisin.Le soir tombait. Je suis rentréAprès avoir vu les étoilesFaire trembler tout le ciel calmeAu-dessus de mon pigeonnier.Alors pourquoi, dans ma maison,Aussi heureux qu’on puisse l’être,Ai-je pensé à des prisons,À des libertés sans fenêtres ?
Cette dualité se retrouve au long de l’œuvre. Le bonheur est une conquête tant il est conscient de la misère et de la détresse humaine. Le poète, dira-t-il, se doit de rendre ce monde habitable.
[…] Bon ! ô certes, vous l’êtes, Car, sur cette planèteOù le mal est partout,Comment vivriez-vous ?...
Le temps qui passe ? Tu oublies que les années passent Et que tu deviens vieux.
Le temps, la mort ? Comment les séparer dans ce recueil qui n’est qu’une longue interrogation existentielle sur l’existence humaine ?
Allons, riez, sautez, dansezPendant qu’il en est temps encor.Qui court sans cesse au plus pressé,Oublie le bonheur d’existerEt se fait piéger par la mort.
Études
14
Ce livre est-il pessimiste ? Certes Maurice Carême a vieilli. L’argent, la richesse, la gloire, il en connaît les méfaits.
Hélas ! si deux et deux font quatre,L’argent, c’est toujours déplaisant. Moi, je ne compte jusqu’à centQue pour entendre mon cœur battre. […]
La vie ne lui fut pas toujours lumineuse, mais les ombres n’ont jamais terni en lui ce fonds de bonté, de dépassement de soi, d’humanisme. Sans celui-ci – il en est persuadé – vivre perd tout son sens. Cruellement lucide parfois, sa vision du monde confine alors au tragique :
[…] Dieu est-il mort ? N’est-il qu’un rêveSur une croix dressée ?Jamais, sur la terre, les glaivesN’ont autant et si haut parlé.[…] On naît, on vit, on meurt,Seul sur sa grande croix,Le Christ, ici, demeureOuvrant en vain les bras.
Et pourtant, il aura goûté au bonheur comme peu d’hommes l’ont fait. Il n’envisageait aucun paradis dans l’au-delà. Persuadé que le bonheur pouvait être terrestre et conquis de haute lutte sur le mal.
[…] On redira que la lumièreDont la bonté se répanditSur le visage de ma mèreFut la margelle de mon puits. […]Que rien ici ne fut trop sombrePour goûter ma joie d’être au monde.
Jeannine Burny
** *
Où t’en vas-tu, toi que l’on dit poèteAvec ton sac plein de soleil couchant ?Oublierais-tu que la joie n’a qu’un temps,Que les jours fuient ainsi que paille au vent ?Vois, les forains éteignent leurs comètes.Toi qui ne crois en faire qu’à ta tête,Où t’en vas-tu portant ton cœur battantComme un tambour au milieu de la fête ?
Maurice Carême – Être ou ne pas être
Jeannine Burny
15
Carême en carnavalPortrait du poète en jongleur
« J’aime à croire que dans la vaste salle commune de la poésie universelle, il y aura toujours une place, sur un banc, pour le vieux jongleur modeste »1. Lorsqu’il écrivit ces lignes, peu après la mort de Maurice Carême, Charles Bertin ne pouvait savoir que le poète avait prévu un recueil posthume dont la figure du jongleur serait le titre et le fil conducteur, mais sans doute avait-il perçu l’importance, dans l’œuvre, des mouvements cycliques : la grande partition du ballet cosmique que contemple le rêveur, la petite cadence de la vie qu’impriment les saisons sous les yeux du flâneur, les carrousels des fêtes foraines, les ritournelles des enfants, source secrète de jouvence où s’immerge l’instituteur. Le poète l’avoue : « Évidemment jongler m’amuse »2 et le dernier mot revient décomposé, au vers suivant, pour faire la rime : jongler « ma muse ». La figure du jongleur, qui devient si présente dans les dernières années de la vie de Maurice Carême, laisse entrevoir un autoportrait de l’écrivain, sous les traits d’un amuseur qui voit le terme de son parcours approcher. Le jongleur que Maurice Carême met en scène est un vieux jongleur, prêt à tirer sa révérence, mais qui monte sur les tréteaux pour accomplir une nouvelle fois – la dernière peut-être – son tour devant le public. Humble créateur de spectacle, il jette sur le spectacle du monde un regard ironique et désabusé derrière une apparente légèreté. Mais il est surtout un jongleur passionné, jongleur depuis l’enfance3, jongleur jusqu’à la mort, jongleur insatiable, ivre de jeux, prêt à faire jongler tout ce qu’il rencontre, même la mer4. L’écrivain ne jongle toutefois plus qu’avec des mots5 après avoir exercé son adresse avec des boules et, plus dangereux, des couteaux. Il s’affiche expert dans son petit artisanat et s’il avoue son âge, 76 ans, il refuse d’arrêter de jouer. À ceux qui s’étonnent et tentent de le dissuader au nom de la raison6, il oppose son désir de continuer à courir les fêtes foraines.
À travers la figure du jongleur-joueur, l’écrivain élabore une « posture d’énonciation »7 singulière : elle est une pirouette devant le monde qui s’autoproclame « sérieux » ; elle crée un rapport au temps qui doit être étudié dans la perspective d’une « poétique du sujet ». Pour Chr. Chelebourg, l’auteur « est celui qui construit l’œuvre et qui se construit à travers elle pour vaincre une difficulté de l’être »8. En l’occurrence, « l’autoportrait symbolique » de l’auteur en jongleur-joueur déjoue la question de l’âge qui se fait pressante9 en lui opposant l’imaginaire de la fête et de l’enfance.
Le chronotope de la fête foraine
La fête foraine est l’un des creusets où se cristallise l’imaginaire de Maurice Carême. Son œuvre déploie, dans le halo des lanternes magiques, tout un petit monde féerique, celui des funambules, prestidigitateurs, arlequins dansants et bariolés ; des cortèges évoluant sous les lampions et les feux de Bengale ; de la foule attirée par la mélodie d’un orgue de barbarie ou par le théâtre d’ombres chinoises que le soir peuple de bêtes qui parlent, de sorcières, de princesses et de rois. Pour l’écrivain qui aime jouer avec les effets de sens que crée son patronyme10, le carême ne s’oppose pas au carnaval qu’il suit dans le calendrier. Il donne sa propre interprétation du tableau de Breughel, qui semble l’interpeler
1. Charles Bertin, Témoignage sur Maurice Carême dans le Livre d’or de la fondation Maurice Carême.2. « Jongler m’amuse », dans Le jongleur, p. 45.3. « Jongleur, on peut l’être à tout âge. / Déjà, je l’étais à sept ans. » (« Jongleur, on peut l’être… », dans Le jongleur, p. 65).4. « Tu jonglerais avec des clous », dans Le jongleur, p. 115 ; « Vendredi treize », dans Le jongleur, p. 75.5. « Jongleur, on peut l’être… », dans Le jongleur, p. 65.6. « À soixante-seize ans, / Se complaire à jouer ? / Comment rester enfant / Peut-il vous contenter ? » (« À soixante-seize ans », dans Le jongleur, p. 112). Il est intéressant de noter que le poème a été écrit alors que Maurice Carême avait 70 ans ce qui montre que l’insistance sur le grand âge de l’écrivain – un âge où normalement on ne joue plus – est un trait central de sa posture auctoriale dans Le jongleur.7. Sur la posture auctoriale voir J. Meizoz, Postures littéraires : mises en scène modernes de l’auteur, Genève, Slatkine, 2007. 8. Chr. Chelebourg, L’imaginaire littéraire, Paris, Nathan, 2000, p. 106.9. « Ne me demandez pas pourquoi. / Il est difficile de croire / Que, bientôt, la mort sera là. » (« Ne me demandez pas pourquoi », dans Le jongleur, p. 25).10. Cette mise en scène ironique de son nom est présente dans de nombreux poèmes, par exemple dans « Généalogie », dans Être ou ne pas être, p. 7 ou dans « Les lauriers de Fombeure » dans Le jongleur, p. 13. Maurice Carême voit dans son nom une prédisposition au jeu sur les mots et à la poésie. Il le motive en l’interprétant comme une invitation à la simplicité et au dépouillement par opposition aux faux-semblants et aux vanités qu’il voit s’étaler autour de lui. Cependant, il en joue aussi, par contraste, pour faire ressortir la joie et la fête qu’il veut voir rayonner dans et par son œuvre. Cette sémantisation du patronyme se rapproche de la logique du geste pseudonymique décrite par David Martens (L’invention de Blaise Cendrars. Une poétique de la pseudonymie, Paris, Champion, 2010) en ce qu’elle nie l’arbitraire du signe qui caractérise le don du nom de baptême.
Études
16
personnellement, le « Combat de Carnaval et Carême »11. Pour lui, le carême annonce le carnaval. Il est son frère, un peu triste, mais nécessaire. Il est le temps qui ouvre vers la fête, le moment de dépouillement qui permet sa pleine libération. Le carnaval n’est d’ailleurs que le moment le plus fort, le plus vaste, du phénomène festif qui enlumine l’année d’une guirlande de kermesses et de fêtes foraines12.
La fête populaire déploie, dans l’œuvre de Maurice Carême, une scénographie rituelle de l’énonciation poétique au sens où l’entend Dominique Maingueneau : « C’est dans la scénographie, à la fois la condition et le produit de l’œuvre, à la fois “dans” l’œuvre et ce qui la porte, que se valident les statuts d’énonciateur et de co-énonciateur, mais aussi l’espace (topographie) et le temps (chronographie) à partir desquelles se développent l’énonciation »13. En particulier, le caractère forain de la fête – qui la circonscrit à la lisière de la Cité – la définit, pour Maurice Carême, comme le lieu d’une expérience de vie étrange.
La fête foraine détermine un chronotope14 singulier. Forain vient en effet du latin foranus et signifie « qui est en dehors, extérieur ». Ce n’est qu’ultérieurement que le mot sera rapproché de foire par étymologie populaire15. Au point de vue spatial, la fête foraine désigne donc, au départ, un rassemblement qui se tient à la limite de la ville dans un lieu où viennent des marchands et des amuseurs étrangers. Au point de vue temporel, elle délimite un temps à part au sein de la temporalité quotidienne, un moment saillant dans le calendrier. Des actes qui sortent de l’ordinaire s’y déroulent ; son attente rythme l’année. L’espace-temps de la fête foraine est donc un espace-temps marginal par rapport aux normes et aux contraintes de la vie de tous les jours. Comme le souligne Mikhaïl Bakhtine, le phénomène festif au sens large, et le carnaval en particulier, se caractérise par une dé-hiérarchisation du temps ce qui crée une « seconde vie »16. La fête foraine de l’enfance apparaît ainsi, chez Maurice Carême, comme une trouée vers une liberté, une fenêtre ouverte sur un monde latent, un espace potentiel. Il est la patrie que l’imaginaire poétique doit tenter de retrouver pour l’explorer.
Une analogie se révèle ainsi entre l’espace-temps physique de la fête, l’espace-temps mental du rêve et l’espace-temps de la lecture. Rêver, c’est jongler avec des idées et des images, c’est « sur corde d’or, / Savoir danser sans artifices »17. Dans l’immobilité apparente de sa rêverie, le rêveur voyage en secret. Il se laisse emporter à la lisière de l’ici-maintenant. Il vogue dans le flux irisé de sa lanterne magique intime. Ses pensées, en vadrouille buissonnière, flottent, heureuses et ignorantes des contraintes du Temps18. De même, lire un poème, c’est rêver autour du rêve d’un autre, faire jongler sa jonglerie de mots. Toute fête, tout rêve est par essence « forain ». Les espaces transitionnels dans lesquels ils se développent sont à l’image de ceux que veut créer l’écriture19. Comme la fête et le rêve, la lecture est un temps à part, un temps d’entre-deux délimité par des seuils au sein du quotidien. Pour entrer dans le tourbillon de la fête carnavalesque, pour y participer pleinement, l’homme doit se détacher, pendant un temps, de lui-même, de son identité sociale, des préoccupations matérielles qui accaparent son présent. Une opération similaire est nécessaire pour entrer dans le voyage imaginaire que propose le texte20. Il demande une disponibilité totale de l’esprit, voire, pour Carême, une virginité enfantine dans la capacité à s’émerveiller. Le texte et la fête foraine sont, en effet, les royaumes où règne le temps précieux du jeu. La fête foraine est le lieu où est inscrite socialement une latitude à dévier dans une certaine mesure. Ce 11. Maurice Carême était fasciné par Pierre Breughel, peintre dont la force carnavalesque de l’œuvre lui a inspiré le recueil, Pierre Brueghel. La kermesse racontée aux enfants par Maurice Carême.12. Dès le premier recueil de Maurice Carême, 63 illustrations pour un jeu de l’oie, un poème est consacré au carnaval et un autre à la kermesse.13. D. Maingueneau, Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004, p. 192.14. Mikhaïl Bakhtine a mis en évidence le concept de chronotope qui désigne la corrélation essentielle des rapports au temps et à l’espace telle qu’elle est enregistrée par la littérature : « Dans le chronotope de l’art littéraire a lieu la fusion des indices spatiaux et temporels en un tout intelligible et concret. Ici, le temps se condense, devient compact, visible pour l’art, tandis que l’espace s’intensifie, s’engouffre dans le mouvement du temps, du sujet, de l’Histoire. Les indices du temps se découvrent dans l’espace, celui-ci est perçu et mesuré d’après le temps » (Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard (Tel), 1978, p. 237-238). 15. Trésor de la langue française, sv. « Forain 1 ».16. M. Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard (Tel), 1970, p. 12-21.17. « Les lauriers de Fombeures », dans Le jongleur, p. 13.18. Cf. « Penser », dans Le Jongleur, p. 32.19. Sur la notion d’espace potentiel et de phénomène transitionnel voir D. W. Winnicott, Jeu et réalité : l’espace potentiel, Paris, Gallimard, 1975.20. La fiction demande une disponibilité de l’esprit, une « suspension volontaire et temporaire de l’incrédulité » pour reprendre l’expression de Coleridge (S. T. Coleridge, Biographia Literaria edited with his aesthetical essays, Oxford, Oxford University Press, 1979, vol. II, p. 5-6). Michel Picard (La lecture comme jeu, Paris, Minuit, 1986) distingue trois instances dans l’expérience de la lecture. D’abord, le « liseur » est la part du lecteur inséré dans le réel, celui qui tient le livre entre les mains. Le « lu » est la part pulsionnelle de lecture-participation et d’immersion fictionnelle. Le « lectant » est enfin le lecteur dans son activité de critique distanciée.
François-Xavier Lavenne
17
Études
qui est d’ordinaire relégué au second plan, perçu comme une perte de temps – l’activité ludique–, y est valorisé et prend toute la place. La fête se caractérise, en outre, par la porosité qu’elle crée en son sein. Tout ce que la vie sociale tend à distinguer s’y trouve mélangé. Une fois revêtu le masque du carnaval, les masques sociaux tombent, il ne subsiste plus de différence de classe, plus de différence d’âge21.
Le domaine enchanté de l’enfance
Le propre de la fête, dans l’imaginaire de Maurice Carême, est que, dès qu’elle a pris ses droits, les enfants peuvent laisser libre cours à leur fantaisie sans craindre les rappels à l’ordre. De même, l’âme de l’enfant endormie au plus profond des adultes y trouve enfin la permission de s’ébrouer. Dès Poèmes de Gosses et Proses d’Enfants, Maurice Carême construit sa posture d’énonciation en porte-à-faux par rapport à la logique rigide de l’institution scolaire22. Il est un instituteur qui a une tendresse pour le cancre. Les enfants se confient à lui lorsqu’ils ont fait l’école buissonnière sachant qu’il ne les désapprouvera pas23. Ce qu’il aime dans l’enfance est cette liberté rétive, l’envie « de ne pas vouloir être apprivoisé »24. Face au monde moderne défini par l’impersonnalité du machinisme et la recherche de l’efficacité, « le domaine enchanté de l’enfance »25 pose le discret contre-chant d’une résistance. L’instituteur en vient même à se demander si, dans le secret de leurs jeux, les enfants n’ont pas créé une société secrète, à l’insu des adultes, contre la bêtise savante de leur monde.
Aussi, pour lutter contre l’immense duperie sociale qui, dès le plus jeune âge, tend à mécaniser leurs instincts, édulcorer leurs pensées, briser leur fantaisie, les gosses ont-ils signé entre eux un pacte secret. Ils forment au sein de notre société, une secte fermée, jalousement repliée sur elle-même. Et l’écriture n’est que l’un des signes magiques que trace parfois spontanément – au hasard des révoltes, des joies ou des peurs – leur âme avide de liberté, leur âme avide de toucher une autre âme.26 Germe alors le projet d’écrire des poèmes susceptibles d’être lus par des enfants qui s’accompagne
de l’encouragement aux enfants d’écrire eux-mêmes des poèmes et de les lui faire lire. L’œuvre apparaît comme l’expression du désir de l’adulte de se faire admettre dans leur cercle. Elle est un gage et un espace de partage. Loin de la figure de l’éducateur distant et supérieur, Carême adopte celle du confident et du complice, souhaitant se mettre à l’école des enfants pour s’initier à leurs jeux et suivre leur route : « Mais voilà que les enfants eux-mêmes se risquent sur les routes inconnues. Et fort de leur naïveté, de leur ombre en forme d’aile, de leur ferveur instinctive pour tout ce qui est mystère, ils rentrent les bras pleins de fleurs et les poches gonflées de coquillages au fond desquelles chante, invisible, inconnaissable, mais présente, la poésie »27. L’instituteur, qui est déjà à l’époque un poète connu, renverse la hiérarchie et refuse l’autorité que lui octroie doublement sa position. « Les enfants sont spontanément poètes », affirme-t-il, ce qui l’amène à la conclusion que, pour être un bon lecteur, il faut avoir conservé sa sensibilité d’enfant28. Son métier est une aubaine pour celui qui se présente comme désireux de réapprendre, grâce aux « gosses », ce que son parcours vers l’âge adulte lui a fait perdre de vue : « Être poète consisterait donc à retrouver sous les sédiments apportés par les coutumes, les morales, les habitudes, les intérêts, cet état de disponibilité, de gratuité absolues qui, en nous rendant pareils au vent, au soleil, aux nuages, nous replonge dans le courant même de la vie […] Perdre la jeunesse équivaut pour la majorité des hommes à perdre le don poétique »29. L’instituteur veut nouer une relation d’égal à égal avec ses jeunes compagnons de lecture et d’écriture. Elle est, à ses yeux, plus riche que celle à sens unique entre l’éducateur et l’élève. La récréation, qui est toujours une recréation, en vient ainsi à apparaître comme plus importante que les cours.
Toutefois, ce n’est pas dans le confinement de la cour de récréation que peut se mener la résistance par l’enfance, seule l’inversion radicale des valeurs qui caractérise la fête et les temps carnavalesques peut lui donner une ampleur maximale. Dans l’axiologie que développe la poésie de Maurice Carême, le jeu occupe la place la plus haute. Il n’est en effet pas qu’un simple divertissement, mais une activité capitale qui permet à l’humain de se construire et de gérer son ancrage toujours problématique dans le réel30. Les travaux de 21. L’inversion des règles et des hiérarchies sociales est un trait du phénomène festif mis en évidence par M. Bakthine.22. « Et faut-il admettre que notre système d’éducation, basé avant tout sur le développement d’un moi d’autant plus aigu qu’il est intelligent, en nous opposant de plus en plus à la nature, nous précipite à jamais dans les ténèbres ? » (Poèmes de Gosses, Paris-Bruxelles, L’Églantine, 1933, p. 11).23. Cf. la lettre reproduite dans Proses d’Enfants, Bruxelles, Les cahiers du journal des poètes, 1936, p. 84.24. Proses d’Enfants, op. cit., p. 84.25. Poèmes de Gosses, op. cit., p. 13.26. Proses d’Enfants, op. cit., p. 8-9.27. Poèmes de Gosses, op. cit., p 10.28. « car il n’est pas de révélateur plus infaillible que la lecture d’un poème d’enfant pour juger du degré de sensibilité d’un homme » (Poèmes de Gosses, op. cit., p 11).29. Poèmes de Gosses, op. cit., p. 11-12.30. Interroger le jeu revient, selon Donald Winnicott (op. cit.), à interroger « ce qui fait que la vie vaut la peine d’être
18
Desmond Morris montrent que l’homme est un animal néoténique, c’est-à-dire un animal qui conserve ses qualités juvéniles à l’âge adulte31. Pour Maurice Carême, ce caractère néoténique est fragile, il doit être préservé avec ardeur, reconquis sans cesse, défendu contre les coups d’un monde où la rationalité a triomphé.
Il faut jouer, avoir la force de jouer. Le jeu vise en effet plus qu’un résultat pratique, un bonheur fugace ; il est une activité qui touche à l’essence de l’homme. Elle lui réinsuffle la vie et lui permet de mieux réaliser son humanité. Le jeu est aussi partage du jeu. Si les enfants jouent, pour Carême, c’est parce qu’ils sont « avide[s] de toucher une autre âme ». Par l’expérience ludique, ils approfondissent l’intimité de leur Moi, en découvrent les possibles en cherchant un échange avec une altérité. Le jeu est ce qui réunit, ce qui permet une communion des individus. Lorsque la fête bat son plein, aucune différence ne subsiste plus entre ceux qui produisent le spectacle et ceux qui en profitent. Les rôles peuvent en permanence s’échanger, ce qui caractérise la logique des rites carnavalesques pour M. Bakhtine. Dans un poème inédit « Le cortège », le poète contemple ainsi la foule transcendée par la fête, dansant au rythme des tambourins sous la lumière des feux de Bengale et des lampions, « ivre de son humanité ». Il se laisse inspirer par elle et aspirer en elle. Dieu lui-même assiste au spectacle, mais il peut juste se rendre compte qu’il est inutile ; les hommes n’ont pas besoin, à ce moment, de lui32.
Cette utopie ne doit pas laisser oublier les dérives potentielles de la fête, les débordements du carnaval qui porte en lui une violence latente. Le poème « Carnaval » dans les 63 illustrations évoque cette brutalité, ce moment d’excitation des « instincts fauves des hommes », les « bodégas » illuminées comme des taches de sang, les rires qui « sonnent faux ». Le « paradis des enfants » qu’est le carnaval a été dénaturé. Pour s’y réfugier à nouveau, la jeune fille ne peut plus qu’enlever le loup de la fête déchirée au milieu des loups bien réels, démasqués sous leurs masques. Elle ferme les yeux brusquement et tente de glisser dans le rêve dans une position équivoque qui, dans le repos retrouvé, semble annoncer la mort33.
Si le carnaval porte en lui l’idée de mort, c’est parce qu’il est le lieu où bouillonne la Vie. Il peut certes dérailler, mais il n’en est pas moins l’espace où le monde peut trouver une consonance harmonique, fulgurante et précaire. Loin de la fête, point de joie, point de salut. À la figure du jeune instituteur désireux d’être admis dans la « secte des enfants » répond, à la fin de l’œuvre, celle du vieux jongleur, leur ami de toujours. Elle permet de réunir sur la scène de l’énonciation l’amuseur et les enfants ou les enfants résistants. L’artiste les rassemble encore et encore pour leur montrer les tours dont ils sont friands. Il se veut un émulateur d’enthousiasme, enthousiasme qui signifie étymologiquement « le dieu en soi » : « Pour un rien, je vous crie merveille ; / Mes mains débordent de pigeons / Je ne dis pas que j’ai raison, / Mais qu’heureux sont ceux qui s’éveillent ! »34. Ce jeu, qui crée du dieu en l’Homme, est toutefois difficile. Le poète est celui qui met de la folie dans la langue, de l’imprévu dans les pensées, de l’inouï dans les images. Mais n’est pas fou qui veut35.
Il existe une saine folie, la folie de la fête, à laquelle tous sont conviés, mais seul un petit nombre acceptera de participer. Cette fête foraine est la vie portée à son intensité maximale, la vie miraculeuse et simple, la vie que les hommes ont trop tendance à sous-estimer, ce qui constitue l’un des leitmotive de la poésie de Carême. Dans cette conception, la mort ne peut être que la fin de la fête, le moment où « les forains éteignent leurs comètes »36. Mais cette image, elle-même, euphémise la mort, puisque le propre de la fête est de pouvoir toujours être relancée, de recommencer dès qu’en reviendra la saison, tant que du carême germera le carnaval...
(Suite dans le Bulletin Carême n° 58)
François-Xavier LavenneCentre de Recherche sur l’Imaginaire – Université catholique de Louvain
vécue », mais également à questionner la part créatrice de l’homme, celle qu’exploitent en permanence le conteur et ses lecteurs. Donald Winnicott souligne que le jeu joue un rôle crucial dans le développement du sujet et dans la médiation entre lui et le monde qui l’entoure. Si l’objet transitionnel est progressivement désinvesti, les phénomènes transitionnels persistent et sont constitutifs des expériences culturelles : « il existe un développement direct qui va des phénomènes transitionnels au jeu, du jeu au jeu partagé, et de là aux expériences culturelles » (D. Winnicott, op. cit. p. 73). L’activité fictionnelle et l’expérience de la lecture sont en effet étroitement liées au jeu. J.-M. Schaeffer (Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil, 1999) replace ainsi la « feintise ludique partagée », c’est-à-dire la fiction, au sein de processus cognitifs fondés sur le jeu et l’imitation qui permettent le développement de l’enfant. M. Picard (op. cit.) souligne l’importance du jeu qui est tout sauf un divertissement gratuit, mais est au contraire une activité essentielle de l’humain. La lecture détermine pour lui un temps transitionnel permettant la gestion du rapport entre le moi et le monde. Il reprend la distinction entre le game et le play pour les rapprocher des deux attitudes de lecture, celle du « lectant » et du « lu ».31. D. Morris, Le singe nu, Paris, Grasset, 1968.32. « Le cortège », dans L’évangile selon saint Carême.33. « Le carnaval », dans 63 illustrations pour un jeu de l’oie, Bruxelles, La Revue sincère, 1925, p. 29.34. « Mademoiselle Arsinoé », dans Le jongleur, p. 109.35. « […]N’est pas folle qui veut / Même royalement. / On dit ma muse folle, / On le dit. Cependant / Jamais elle ne ment. / Joue-t-elle à pigeon vole ? / C’est si ingénument. » (« N’est pas folle qui veut », dans Le jongleur, p. 79).36. « Où t’en vas-tu ? », dans Être ou ne pas être, p. 90.
François-Xavier Lavenne
Avis à tous les établissements scolaires et les cercles culturels
La
Fondation Maurice Carême
organise, avec l’accord du Ministère de la Communauté française de Belgique et de la Commission Communautaire française de Bruxelles-Capitale, dans les établissements scolaires maternels, primaires, secondaires et universitaires, dans les cercles culturels ainsi qu’au Musée Maurice Carême :
– des animations poétiques, des conférences (avec films, vidéocassettes, montages audiovisuels, DVD)
– des expositions
– des visites guidées du Musée Maurice Carême.
Elle rédige des articles, des études sur l’œuvre et la personnalité de Maurice Ca-rême.
Elle met à la disposition des chercheurs ses archives et ses documents. Elle possède un fichier thématique des poèmes de Maurice Carême ainsi qu’une vaste docu-mentation sur l’œuvre.
Pour tout renseignement : Fondation Maurice Carême – av. Nellie Melba, 14 - 1070 Bruxelles. Tél. 02.521.67.75 ; Fax 02.520.20.86 ; [email protected]
Prix Maurice Carême de Poésie
Durant toute sa vie, Maurice Carême n’eut de cesse d’aider et de conseiller les jeunes poètes qui venaient le voir. Grand lecteur, curieux de tout ce qui se faisait en poésie, toujours heureux de découvrir de nouveaux talents, il soutint avec passion les œuvres qu’il aimait. Le « Prix Maurice Carême de Poésie » s’inscrit dans cet esprit. Il a été créé en 1989 pour mettre en valeur la création poétique en Belgique francophone. D’une valeur de mille deux cent cinquante euros, il est décerné tous les deux ans.
Le prix Maurice Carême de Poésie sera remis pour la quinzième fois en mai 2013 (date et lieu à préciser). La date limite des envois des recueils et des manuscrits est fixée le 15.11.2012. Le jury du concours est composé par les administrateurs de la Fondation Maurice Carême auxquels se joignent deux députés provinciaux de la Province du Brabant wallon ainsi que quatre personnalités du monde artistique.
Conditions de participation :
– être de nationalité belge ou résider en Belgique– avoir dix-huit ans au 31 décembre 2012– être l’auteur d’un recueil de poèmes écrit en langue française (manuscrit ou
édité en 2011 ou en 2012)
– les candidats peuvent être titulaires de prix littéraires
Les recueils de poèmes, accompagnés d’une fiche biographique, faisant foi du nom et de l’âge de l’auteur, et d’une éventuelle fiche bibliographique, devront être envoyés en cinq exemplaires avant le 15.11.2012 à l’adresse de la Fondation Maurice Carême, fondation d’utilité publique, avenue Nellie Melba, 14 – 1070 Bruxelles
Lauréats du Prix Maurice Carême de Poésie
1989 Werner Lambersy1990 Anne-Marie Derèse 1991 Karel Logist1992 Guy Goffette1993 William Cliff1995 David Scheinert1997 Lucien Noullez 1999 Éric Brogniet 2001 Francis Dannemark2003 Yves Namur 2005 Roger Foulon 2007 Daniel De Bruycker2009 Jean-Claude Pirotte 2011 Philippe Lekeuche
21
Prix Maurice Carême de Poésie 2011 :Philippe Lekeuche pour son recueil « L’Éperdu »
« Je suis fort préoccupé par l’état du monde », confie Philippe Lekeuche, « Le cœur de l’homme est menacé. Aussi l’esprit. La poésie a une part à prendre pour garder la flamme allumée. »
[…] Tandis que se taisent les affamésOù sont les poètes ! […]
Il a seize ans lorsqu’il rencontre Maurice Carême. On imagine un tel contact quand on connaît l’ouverture du poète aux jeunes écrivains. Il commence à écrire à douze ans. En 1974, il dé-bute des études de psychologie qu’il mène jusqu’au doctorat avant d’enseigner la psychopathologie, la psychologie clinique et de la littérature à l’Université de Louvain. Ce métier va marquer profon-dément son œuvre.
Son premier livre Le Chant du destin paraît en 1987. Il reçoit en 1995 le Prix Triennal de Poésie. D’autres prix littéraires lui sont attribués : le Prix Polak et le Prix Jean Kobs de L’Académie Royale.
Comment cet écrivain, qui a passé sa jeunesse à Tournai, trace-t-il son cri dans le vaste paysage poétique d’aujourd’hui ?
[…] Las ! Je laissais gésir ma plumeEt me livrais à mes chimèresEspérant un corps : pauvre bougre !Son appel, un poignard m’élève
À la lecture de « L’Éperdu », on ne peut que parler d’une voix profonde, douloureuse, tragique même ! On pense à une Louise Labbé devant cet amour qui déchire le poète et donne au titre du recueil toute sa densité, son hallucinante vérité.
[…] Parler m’était blessureUn mot chassait l’autre, un videAsséchait mon sang vif. […]
Le Mal rôde que n’apaisent ni les anges ni une présence divine que le poète croit apercevoir et qui se dérobe au même instant. Homme de questionnement et de recherche aiguë, Philippe Lekeuche s’étonne de ce qui monte ainsi du plus intime de son être. « Je vais plein de lueurs étranges […] » écrira-t-il soudain lucide devant ce mystère qu’est sa création poétique.
[…] Dis-nous le donc, toi, hommeQui est en toiEt quelle est ta chimère si raisonnante ? […]
Qui oserait parler ici de littérature dans ce que ce mot peut receler parfois de superficiel ? La poésie de Philippe Lekeuche, si douloureusement humaine, se situe à l’opposé de celle de notre temps si souvent engluée dans son intellectualisme et sa recherche d’originalité.
[…] Ah, partout quelle fin, tout passe et péritEt nous, douleur, demeurons !
Jeannine Burny
Prix Carême
Prix d’Études Littéraires Maurice Carême
Ce prix d’une valeur de sept cent cinquante euros sera offert pour la treizième fois en 2013. Il est décerné tous les deux ans. Le jury du concours est composé des administrateurs de la Fondation Maurice Carême et de quatre personnalités du monde artistique.
Conditions de participation :
– aucune condition de nationalité, d’âge, d’études n’est imposée– les textes (sur Maurice Carême et son œuvre) seront présentés en langue française et envoyés en cinq exemplaires, munis d’une fiche biographique, au plus tard le 15.11.2012 à l’adresse de la Fonda-tion Maurice Carême, fondation d’utilité publique, avenue Nellie Melba, 14 – 1070 Bruxelles, Belgique– L’œuvre présentée devra comporter un minimum de cinquante pages où la reproduction des textes de Maurice Carême ne pourra excéder 20 %.
Lauréats du Prix Maurice Carême de Poésie
1991 : Laszlo Ferenczi (essayiste, professeur à l’Université de Budapest)1992 : Constantin Barbu (philosophe, Craïova, Roumanie)
1993 : Paul Herremans (conseiller à la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale)
1995 : Gloria Cavazzuti (mémoire à l’Université de Bologne) ; Jacques Dumont (thèse de doctorat aux Etats-Unis)1999 : Sonia Loretta Izzi (mémoire à l’Université de Bologne) Magdalena Lipka (mémoire à l’Université de Łodz, Pologne)2001 : Jalel El Gharbi (professeur à l’Université de Manouba-Tunis)2003 : Constantin Dumitru (médecin psychiatre à l’hôpital militaire
de Bucarest)2005 : Andrès Bansart (professeur aux Universités de Caracas et de Tours)2007 : Dominika Strozynska (mémoire à l’Université de Poznan, Pologne)2009 : Dagnija Dreika (poétesse et traductrice, Riga, Lettonie) Veronica Sbrocca (Licenciée de l’Université de Bologne)2011 : Béatrice Libert (poétesse et essayiste)
Les règlements des deux prix peuvent être obtenus sur simple demande auprès de la Fondation Maurice Carême.
23
Prix d’Études Littéraires Maurice Carême : Béatrice Libertpour son essai : « Au pays de Maurice Carême »
Fascinée dès l’enfance par le monde du langage et des mots, longtemps professeur de français et de théâtre, Béatrice Libert écrit, anime des ateliers d’écriture, des rencontres littéraires, organise des formations pour les enseignants désireux de s’ouvrir à la poésie contemporaine. Elle dirige la collection « L’horizon délivré », consacrée à la Pédagogie et aux Arts, aux « Éditions Couleur Livres » à Charleroi.
Qu’aurait pensé Maurice Carême de la place que sa poésie a prise dans l’enseignement à tous les niveaux de la langue française ? De page en page, Béatrice Libert cerne l’inimaginable diversité d’une œuvre ouverte à tous. La poésie pour les enfants, elle en est convaincue, cela n’existe pas. « C’est de la poésie et les enfants ont droit plus encore que les autres lecteurs au meilleur », affirmait le poète de « Mère ». Dans les manuels scolaires, en France notamment, ne paraissent plus à présent que des textes de grands poètes. Maurice Carême y détient une place de choix.
Dès l’introduction, on peut lire : « [Maurice Carême] est un des poètes majeurs de l’enfance. Sa popularité n’est plus à démontrer ». Et de citer Jacques Crickillon : « Les âmes simples reconnaissent dans sa voix, dans son poème, le poème qui est le leur, mais qu’elles n’ont pas le pouvoir d’écrire ». Béatrice Libert reprend : « La renommée de son œuvre, vaste, multiforme, universelle a largement dépassé nos frontières au point que sa nationalité semble se confondre avec celle de son lecteur. Ses vers conjuguent humour et gravité, contraintes de la prosodie classique et liberté de l’inspiration vagabonde, thématiques destinées aux jeunes comme aux aînés. Sa simplicité complexe révèle que le poète a su intégrer la leçon des anciens tout en forgeant sa propre langue. Une page de Carême se reconnaît entre mille ».
L’essayiste fixe d’emblée les facteurs de la réussite de l’ouverture à la poésie : « c’est la manière dont les enseignants initient leur groupe, se préparent au projet, l’y engagent, le motivent, mobilisent des ressources, instaurent une relation de confiance, un idéal de dépassement, un esprit de curiosité, le désir de mieux lire et de collaborer ». À l’interrogation : « quand commencer ? » elle répond : « Au berceau ! ». Il est d’évidence que « les parents ont une grande responsabilité dans l’éveil artistique de leurs enfants, car ils sont bien placés pour développer leur imagination ». Ce qui émerveille, c’est la diversité des sujets abordés. Est souligné l’apport de vocabulaire que la poésie permet. Béatrice Libert parle à ce sujet de « mots-merveilles ».
Cet essai s’avère une mine inépuisable pour les enseignants de la langue française. Ses aspects pédagogiques sont d’une variété inouïe. Une véritable anthologie illustre le livre. Poèmes puisés et chez Maurice Carême et chez d’autres très nombreux écrivains vivants pour la plupart. Dans notre pays, où le manuel scolaire a quasi disparu, cet ouvrage va s’avérer un outil indispensable à l’appren-tissage de la langue française.
Jeannine Burny
Prix Carême
24
Année Carême 2011
Remise des Prix Maurice Carême
Prix Maurice Carême de Poésie
Philippe Lekeuche pour son recueil « L’Éperdu » (voir ci-dessus)
Prix Maurice Carême d’Études littéraires
Béatrice Libert pour son essai « Au pays de Maurice Carême » (voir ci-dessus)
Prix « Maurice Carême » 2011 (établissements scolaires)
Anderlecht – École Maurice Carême : Camille Bové Beauvois-en-Cambresis – École Maurice Carême : Baptiste HubertChartres – École Maurice Carême : Léna TsopgniChatellerault – École Maurice Carême : Chloé JucquoisLabourse – École Maurice Carême : Jessica GoudalLandrecies – École Maurice Carême : Abraham Dylan Quelaines Saint-Gault – École Maurice Carême : non attribuéSaint-Denis-D’authou – École Maurice Carême : Zoé BompardSchaerbeek – École de La Sainte-Famille : Jasmin LeyingWavre – Athénée Maurice Carême :section préparatoire : Camille Lafargue,
Clarisse Devlésaversection secondaire : Thomas Bogaerts
Moussa SallAnderlecht – Athénée Bracops-Lambertpremier degré autonome : Maya Valicsection secondaire inférieure : Melody Olivierisection secondaire supérieure : Asmae El Atmani Anderlecht – Institut Marius Renard : David DesayerLeuven – T. Pedagogische Hogeschool : Felicia Deys
Année Carême 2011
25
Événements
2010 École de Sermoise (Nièvre) : classe de CE1 baptisée Classe Maurice Carême21.03 Aulnay-de-Saintonge : Balade poétique où a été dit le poème Pour ma mère18.11 Mouscron, bibliothèque municipale : Dis-moi si la rose par Marie-Claire Beyer et
Marie-Claude Buffenoir (avec un poème de Maurice Carême)201115.01 Asse Hopmarkt, salle des fêtes : Prévente de la série de 3 timbres : Musées Érasme, Maurice
Carême, Stijn Streuvels. Exposition « M. Carême »19.01 Musée Maurice Carême : Royal Camera Club Wavre réalisation du film M.Carême 20 au 22.01 Musée Carême : Accueil à table d’hôte d’Ilia Pedrina pour ses recherches sur
M. Carême24.01 Vicenza : Ilia Pedrina : Conférence avec deux poèmes de M. Carême29.01 Musée M. Carême : visite guidée pour Marie Durand et sa mère 31.01 Paris, Salle Michelin : Amis de Claude Delvincourt : Une saison en enfance, parcours
poétique et musical (Guy Sacre, récitant – Billy Eidi, piano). Poèmes : Baudelaire, Carême, Cocteau, Éluard, Fargue, Gautier, Mauriac, Régnier, Rimbaud, Rostand, Claude Roy, Saint-John Perse, Sartre, Schéhadé, Comtesse de Ségur, Supervielle, Tardieu
01.02 Musée M. Carême : visite guidée et interview de Yaël Vichnovsky 02.02 Musée M. Carême : visite guidée pour l’Internat M. Carême d’Anderlecht05.02 Musée M. Carême : visite guidée et interview de Joëlle Hardy 06.02 Marseille : Église Notre-Dame du Mont Impromptu musical et littéraire
par Ed. Exerjean, pianiste-conteur : poèmes de La Fontaine, Prévert et Carême07.02 Musée M. Carême : visite guidée et interview de Inge Taillie 08.02 Biélorussie, Minsk, Maison de l’Amitié : soirée littéraire consacrée à l’œuvre de
Maurice Carême (traductions biélorusses-belges)09.02 Musée M. Carême : visite guidée et interview par Christopher et Benno Barnard 11 au 20.02 Casablanca : Salon du livre : stand de WBI (œuvres de M. Carême)12.02 Musée M. Carême : visite guidée : Mme Lutz (projet de CD) 13.02 Musée M. Carême : visite guidée et interview de Jennifer Batla 17 au 21.02 Bruxelles : Foire du livre : stand de la Fondation M. Carême23.02 Musée M. Carême : visite guidée pour M. Vandenhaute (DEXIA)28.02 Musée M. Carême : visite guidée et interview pour Jennifer Robert de J.R. Concept
Productions 01.03 au 03.03 Musée M. Carême : accueil à table d’hôte d’Ilia Pedrina02.03 Musée M. Carême : visite guidée pour A. M. Sterckx et N. Rouillon 07.03 Musée M. Carême : interview et visite pour M. Lefevre et son fils 07.03 Bruxelles, Palais Bozar : Women’s show par Bérénice de Bel RTL et Paul Dewandre avec
I. Lenarduzzi, Chr. Thiry, S. Serbin, V. Colin-Simard, V. Toefart et J. Burny08.03 Musée M. Carême interview et visite guidée pour Jean Jauniaux 14.03 Bruxelles : Café Théâtre du Botanique : Dis-moi si la rose par Marie-Claire Beyer
et Marie-Claude Buffenoir 18 au 21.03 Paris : Salon du livre : stand de la Fondation Maurice Carême18 au 21.03 Paris : Salon du livre : stand de l’ADEB (œuvres de M. Carême)25 au 27.03 Rouen assemblée générale de la Fédération des Maisons d’écrivain et des Patrimoines littéraire
de France autour des Écrivains de Normandie03.04 Musée M. Carême : accueil à table d’hôte : Carmen Bolocan, professeur
à l’Université d’Iasi – Faculté orthodoxe 08.04 Musée M. Carême : visite guidée pour Mme Julia Andreiva (ambassade de Biélorussie)
don de partitions d’Aline Bezinson et de documents d’Edi Agnniatsvet,traductrice de M. Carême.
Événements
26
09.04 Musée M. Carême : accueil à table d’hôte des chansonniers Jacky Galou et CarolineLandemaine pour leur mise en musique de poèmes de M. Carême
15.04 Wavre projection du film sur Maurice Carême (Royal Caméra Club)16.04 Musée M. Carême : visite du musée et interview pour Jessica Bouguerra et sa nièce 21.04 Musée M. Carême : visite guidée pour M. Mme Huby et leurs deux fils 22.04 Musée M Carême : visite guidée pour les chansonniers MM. Furgerot, Pérez et
Houllier27.04 Musée M. Carême : visite guidée pour M. et Mme Lechevalier et M. et Mme Caplet
(France). Don de dessins de Devi Tuszynski28.04 Wavre, Hôtel de Ville : présentation du livre « Les Aventurêves dans la cité du Maca » :
écrit par les élèves (écoles et Athénée M. Carême)01.05 Musée M. Carême : Erfgoeddag : 3 visites guidées « Arme troef »01.05 Musée M. Carême : visite guidée pour Sylvie Grange, Conservateur du Patrimoine,
direction du Service des musées de France12.05 Wavre, Hôtel de Ville : remise des Prix Maurice Carême de Poésie à Philippe Lekeuche
et Prix Maurice Carême d’Études littéraires à Béatrice Libert 14 et 15.05 Musée M. Carême : Printemps des musées : 3 visites guidées 19.05 Musée M. Carême : visite guidée pour « Les Pensionnés heureux »21.05 Musée M. Carême : visite guidée pour Bernard Moock 23 au 26. 05 New York : Book Expo America : stand Bruxelles Export avec les œuvres de
Maurice Carême 27 au 30.05 Paris : Marché de la poésie : stand de la Fondation Maurice Carême31.05 Chatou : interview de Jeannine Burny par Jean-Luc Pujo09.06 Musée M. Carême : accueil de Madame Natan, photographe 19.06 Montmédy, Citadelle : exposition consacrée à La Ville haute de Montmédy « images et
souvenirs », sortie de l’ouvrage du même nom de G. Cady avec un poème de M. Carême écrit à Montmédy
23.06 Musée M. Carême : visite guidée pour Madame Burnonville directrice de la Bibliothèque municipale de Marche-en-Famenne et de son adjointe
25.06 Musée M. Carême : assemblée générale de l’UPF – visite guidée 26.06 Dilbeek : Den Tat : Dilbeek houdt van WALLONIE – Poetisch aperitief met Koen
Stassijns : La poésie belge. Verhaeren, Maeterlinck, Carême, Michaux, Wouters, Sojcher, Lamarche et les poètes surréalistes (Chavée, Mariën, Lecomte, Scutenaire, Nougé, Dotremont)
27.06 Wavre Athénée Maurice Carême : remise des Prix Maurice Carême (sections primaire et secondaire)
01.07 Leuven T Groep school : Prix M. Carême (régendat de français)06.07 Argelès-sur-mer (Salle Buisson) : Café poétique des Amis de la bibliothèque :
présentation de M. Carême par Jean-Marie Philippart08 au 12.07 Musée M. Carême : accueil en résidence de J.L. et M. Hibou22-30.07 Sète : Voix vives de Méditerranée en Méditerranée : présence de la Fondation M.
Carême et stand au Marché de la poésie08.08 Musée M. Carême : visite guidée pour M. Serge Woller11.08 Musée M. Carême : visite guidée pour M. et Mme Urbain14 au 21.08 Musée M. Carême : accueil en résidence d’Agnès Tóth (Hongrie) en vue d’un
travail de maîtrise sur Maurice Carême02.09 Musée M. Carême : visite guidée et interview de Sophie Franssen 02.09 Musée M. Carême : visite guidée et interview de Valérie Brixhe 06.09 Musée M. Carême : visite guidée pour Anita Van Belle11.09 Grez-Doiceau : Journées du Patrimoine « Des Pierres et des Lettres » à 10 et 14 h
promenade découverte de la Vallée du Train avec lecture de textes. Église d’Archennes :exposition « Nos écrivains inspirés par les lieux qui les entourent ». Poèmes de M. Carême exposés.
Année Carême 2011
27
16 au 18.09 Nancy : Le Livre sur la place : stand de l’ADEB avec les œuvres de M. Carême16.09 Nancy, Crèche Wunshendorf : 2 animations poétiques – Collège Charles de
Foucauld : 2 conférences en classes de 6e secondaires20.09 et 22.09 Musée M. Carême : visites guidées pour les élèves de 6e primaires de l’École
Notre-Dame d’Anderlecht21.09 au 01.10 Alger : Salon du livre : stand de WBI avec les œuvres de Maurice Carême10.10 Musée M. Carême : visite guidée pour Remy Lebbos et une Maltaise12.10 au 16.10 Francfort : Salon du livre : stand de l’ADEB avec les œuvres de Maurice Carême13.10 Musée M. Carême : Nocturne : 3 visites guidées15.10 Musée M. Carême : Place aux enfants : visite guidée (école M. Carême)25.10 Musée M. Carême : visite guidée pour Didier Cléro et sa compagne26.10 Musée M. Carême : visite guidée pour François-Xavier Lavenne27.10 Musée M. Carême : Nocturne : 3 visites guidées29.10 au 06.11 Beyrouth : Salon du livre : stand de WBI avec les œuvres de M. Carême30.10 Marche-en-Famenne : Salon EPEL : stand Fondation M. Carême07 au 13.11 Wavre, Hôtel de Ville et Syndicat d’initiative : Hommage à Maurice Carême :
exposition, concert, conférence, film, spectacle poétique (Athénée M. Carême), Les petitesvacances de M. Carême (Philippe Vauchel), café philo, ateliers d’écriture, promenades
11.11 Bois d’Haine : Etait-ce bien un éléphant ? Un autre regard sur l’œuvre de M. Carême par J. Lartelier, conteuse, et T. Dardenne, musicien
16 au 21.11 Montréal : Salon du livre : stand WBI et AWEX avec les œuvres de M. Carême19.11 Sibiu-Cisnadiora : Présentation de la poésie de Maurice Carême par Diana Rinciog,
lors d’un colloque littéraire (Université de Ploesti)21.11 Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschapen en Letteren : soirée internationale de
poésie en anglais, français et néerlandais avec la participation de la Fondation M. Carême : L’œuvre de Maurice Carême
24.11 Musée M. Carême : visite guidée pour Guy de Viron (Lausanne) et une amie belge26.11 Dortmund, Konzerthaus : Liederavond avec « La courte paille » de Poulenc : Sylvia
Schartz, soprano et Malcolm Martineau, piano30.11 au 05.12 Montreuil : Salon du livre de jeunesse : stand Wallonie-Bruxelles avec la
présence de la fondation03.12 Bruxelles, Atelier Marcel Hastir : récital : découverte de duos et solos de compositeurs
belges par Marie-Noëlle de Callataÿ, soprano et Sophie de Tillesse, mezzo-soprano et Anait Karpova, piano : 4 duos (Sortilèges de René Bernier – poèmes de M. Carême)
05.12 Bruxelles, Flagey studio 1 : concert : idem 03.1207.12 Chatou, Home MAPI (Cercle littéraire) : Mariam Francq et Jeannine Burny
viennent raconter Maurice Carême11.12 Musée M. Carême : visite guidée par Mmes Veldekens17.12 Musée M. Carême : visite guidée : Cercle de M. Alain Vanclooster24.12 France Musique Maîtrise de l’ORTF – Noëls pour Tobi, 6 chœurs de Julien Joubert 201213.01 Musée M. Carême : visite guidée pour Jacko Tomas, traducteur tchèque et Ludvik
Vegnet, graphiste04.02 Musée M. Carême : visite guidée : Damien Zanone, Adrien Cauchie,
Pierre-Marie et Geneviève Miroux14 au 19.02 Musée M. Carême : accueil à table d’hôte d’Ilia Pedrina10 au 19.02 Casablanca : Salon du livre : stand de WBI avec les œuvres de Maurice Carême01 au 05.03 Bruxelles : Foire du livre : stand de la Fondation Maurice Carême16 au 19.03 Paris : Salon du livre : stand de la Fondation Maurice Carême16 au 19.03 Paris : Salon du livre : stand de l’ADEB avec les œuvres de Maurice Carême23 au 23.03 Île de France assemblée générale de la Fédération des Maisons d’écrivain de
France : musées Aragon-Triolet, Mallarmé, Cocteau22.04 Musée M. Carême : Erfgoeddag : « Helden » 3 visites guidées
Événements
28
Bibliographie 2011
Travaux universitaires (en cours)Toth (A.), La poésie de l’espace. L’espace poétique dans la poésie de Maurice Carême,
Université catholique de Budapest (Hongrie).Bizeray (L.), L’image de l’enfant et de l’école dans l’œuvre, travail de maîtrise, I. U. F. M. de Paris.Berecki (A.), Les éléments fantastiques dans l’œuvre, thèse en projet (Hongrie).
Les éditions dans le mondeAllemagneArche Kinder Kalender 2012 – Bibliothèque internationale de la jeunesse de Munich avec
54 poèmes et images du monde entier dont « Le vieux piano » de Maurice Carême en version française et allemande.
FranceLe voyage merveilleux de Maurice Carême, illustrations de Lauranne Quentric, Éditions Mouck, 2011Jacky Galou et Caroline Marlande chantent Maurice Carême, CD 26 chansons,
Éditions « Au Merle moqueur – Enfance et musique ».Arlit (Paris), catalogue des revues de langue française.
Page consacrée à la revue annuelle de la Fondation Maurice Carême. Demain dès l’aube. Les cent plus beaux poèmes pour la jeunesse choisis par les Poètes d’aujourd’hui.
Réédition avec deux poèmes de Maurice Carême.Le jardin en cent poèmes avec 5 poèmes de Maurice Carême.Les plus belles comptines et poésies de mon enfance avec 5 poèmes de Maurice Carême.LettonieLa bille de verre en langue lettone, traduction de Dagnija Dreika.RussieMaurice Carême anthologie bilingue, traduction de Michaêl Iasnov, Éditions Tekst (Moscou).Pour dessiner un bonhomme. Poèmes et contes en langue russe, traduction de Michaël Iasnov,
Éditions André Olear, Tomsk (Sibérie), 2012.SuisseSouvenirs, L’Âge d’homme, Lausanne, 2011 (recueil posthume).Le Jongleur, L’Âge d’homme, Lausanne, 2012 (recueil posthume).
Articles de presseBelgiqueLe bibliothécaire, n° 4 octobre, novembre, décembre 2010, article sur « Du ciel dans l’eau ».Philanews, 1-2011 F, annonce de la série des trois timbres consacrée aux Maisons littéraires
avec un encart sur le timbre « Musée Maurice Carême ».Echarp Internet, Agenda 03-1, 16 au 28. 02 2011,
Maurice Carême à la Foire du livre de Bruxelles.Le bibliothécaire, n° 1 janvier, février, mars 2011,
articles sur le DVD « Maurice Carême, poète belge, poète européen, poète international, prince en poésie » et le recueil « Souvenirs ».
La Libre Belgique, 16.02.2011, Wavre honore son prince en poésie.
Année Carême 2011
29
Le Soir, 16. 02. 2011, Wavre, paradis du prince en poésie.Echarp Internet, Agenda 04-1, 1 au 29. 03 2011,
Maurice Carême au Salon du livre de Paris.Le carnet et les instants n° 166 avril-mai 2011,
présentation de « Souvenirs » et de « Le voyage merveilleux de Maurice Carême ». Le Bibliothécaire, n° 2 avril, mai, juin 2011, La revue Fondation M. Carême.Reflets Wallonie-Bruxelles, n° 28 avril-mai-juin 2011, La revue Fondation Maurice Carême.Le journal des poètes, n° 28 avril-mai-juin 2011, Prix Maurice Carême 2011.Echarp Internet, Agenda 07-1, 28. 05 au 30. 06 2011,
Maurice Carême à Paris – Marché de la poésie.Francophonie vivante, n° 2 juin 2011, Prix Maurice Carême.Echarp Internet, Agenda 08-1, 30. 06 au 20. 08 2011, Maurice Carême à Sète – Voix vives
de Méditerranée en Méditerranée et Marché de la poésie.Inédit, 251 juillet 2011, note sur la revue Fondation Maurice Carême.Maison de la Poésie et de la Langue française, juillet 2011,
article d’Éric Brogniet sur Philippe Lekeuche, Prix Maurice Carême de poésie 2011 et Béatrice Libert Prix d’Études littéraires Maurice Carême 2011.
Rif tout dju, juillet-août 2011 n° 493, Yvan Dewandelaer, Maurice Carême poète du Brabant.Inédit, 252 août 2011, Prix Maurice Carême 2011.Anderlecht contact, 106, octobre 2011, annonce des Nocturnes 13 et 27.10.2011. Inédit, 253 – 29. 10. 2011, Nocturnes 2011 dans les musées d’Anderlecht. Le Soir, 07. 11. 2011, Wavre honore son Prince en poésie.La Dernière Heure, 07. 11. 2011, De la rue des Fontaines à Chérémont.FranceFédération des Maisons d’écrivain et des Patrimoines littéraires de France, n° 24 mars 2011.
Annonce du site www.mauricecareme.be.Poésie sur Seine, n° 76 Printemps 2011, article d’Éliane Demazet sur la revue de la Fondation
Maurice Carême.Histoires à faire rêver – Projets pédagogiques, 16. 12. 2011, conte « La Lanterne » de Maurice
Carême.HongrieNouveaux chemins dans l’enseignement de la langue maternelle – Uj Utak – Trezor Kiadó,
article sur M. Carême par Anna Bereczki (2008).ItaliePemezia-Notizie, anno 19 n° 3 marzo 2011, Ilia Pedrina, Lettere aperte à Domenico
Defelice : voyage en Belgique et visite de la Maison blanche – Musée Maurice Carême. RussieLa langue française, octobre 2011, Jeannine Burny, Maurice Carême poète belge, poète
européen, poète célèbre en Russie. Revue accompagnée de 2 DVD consacrés à Maurice Carême réalisés par Igor Shtanev.
SlovaquieL’amitié 4-5 décembre 2010 – janvier 2011 Le coin des poètes : Maurice Carême,
article illustré par Anastasia OrlovaUkraineBCe Cbit 5-6. Revue littéraire, article sur Maurice Carême par Dmytro Tchystiak.
Bibliographie
30
Manuels scolaires
De nombreux manuels scolaires paraissent chaque année avec des exploitations pédagogiques autour des poèmes de Maurice Carême. Ils concernent tous les niveaux d’enseignement du jardin d’enfants à l’année du bac. L’œuvre de Maurice Carême est également très prisée pour l’enseignement du français, langue maternelle et langue étrangère. S’il s’avère impossible de citer ici l’ensemble des ouvrages parus, des maisons d’édition comme Bordas, Nathan, Hachette, Hatier... reproduisent ré-gulièrement dans leurs publications destinées à l’enseignement des poèmes de Maurice Carême. La plupart de ces livres peuvent être consultés à la bibliothèque du fonds Maurice Carême.
Ressources numériques
Le site Maurice Carême (www.mauricecareme.be) s’est encore enrichi cette année. Il constitue la référence pour tous ceux qui s’intéressent à l’oeuvre et à la vie du poète. Conçu par Emmanuel Hertens, il se veut, selon le désir de la présidente de la Fondation Maurice Carême, Jeannine Burny, ouvert tant aux enfants qu’aux enseignants, aux passionnés de poésie comme aux étudiants et aux chercheurs. Le visiteur peut y trouver une biographie détaillée, qui permet de comprendre le parcours poétique de l’écrivain et la quête spirituelle qui le sous-tend ; une biblio-graphie complète dans laquelle figurent les œuvres traduites ; le fichier thématique, véritable trésor pour les chercheurs, que la fondation n’a de cesse de compléter ; de nombreux poèmes, dont cer-tains manuscrits ; une riche iconographie ; la présentation de la Fondation Maurice Carême et du musée Maurice Carême ainsi que l’agenda des manifestations. En outre, depuis janvier, un espace de convivialité est à la disposition de tous ceux qui s’intéressent à l’œuvre de Maurice Carême sur la page Facebook du musée et de la fondation. Vous pourrez y trouver toute l’actualité des parutions et des événements organisés autour de l’œuvre.
*
* *
IN MEMORIAM
MARCEL CORNELOUP
1928 – 2010
Deux noms illuminent le mouvement choral « À cœur joie ». Son créateur, César Geoffray et Marcel Corneloup. Dès 1962, Geoffray appelle celui-ci à Lyon pour assurer, de concert, la direction du grand mouvement choral. Des liens étroits d’amitié se sont noués entre eux. En 1973, à la mort de César Geoffray, Marcel Corneloup, devenu président, fait d’« À cœur joie » sa seule raison de vivre. Il rêve de multiplier les chorales partout où l’on parle français. Il y réussit. Il crée les célèbres « Choralies de Vaison-la-Romaine ». En tant que compositeur, il va largement s’inspirer des poèmes de Maurice Carême. Ce sont 38 chœurs qu’il dirigera et mettra au programme des chorales « À cœur joie ». Il collabore au septante-cinquième anniversaire du poète à Bruxelles. En mars 1998, il lui rend hommage à Saint-Léger-sous-Beuvray.
Année Carême 2011
Les Amis De Maurice Carême
Pour obtenir ce bulletin, il suffit, soit de faire un don :
de 10 € minimum Belgique
de 12 € minimum pour la France
de 14 € minimum pour le reste du monde
soit de se faire membre de l’Association des Amis de Maurice Carême
Vous qui admirez l’œuvre de Maurice Carême et désirez qu’elle soit mieux connue encore dans le monde, vous pouvez aider la Fondation Maurice Carême à réaliser ses multiples activités
soit : en versant vos dons (sommes inférieures à 25 €)
soit : en devenant un membre de l’A.S.B.L.
Les Amis de Maurice Carême
membre adhérent par année civile cotisation 25 € minimum
membre bienfaiteur par année civile cotisation 50 € minimum
membre donateur par année civile cotisation 125 € minimum
membre adhérent à vie cotisation 250 € minimum
membre bienfaiteur à vie cotisation 500 € minimum
membre donateur à vie cotisation 1.250 € minimum
Le versement peut être effectué au compte de l’a.s.b.l. n° 068-0921940-79
En ce qui concerne nos amis étrangers, il est absolument nécessaire d’effectuer un transfert ; la remise d’un chèque occasionne des frais atteignant souvent 50 % de la somme offerte. Pour nos amis de France, il suffit de nous envoyer un chèque libellé au nom de la Fondation Maurice Carême.
Toute nouvelle affiliation vaut un tiré à part, uniquement réservé aux Amis de Maurice Carême, du recueil « De plus loin que la nuit » (jusqu›à épuisement du tiré à part)
Je voudrais que ma poésie soit comme une boule de cristal dont on ne verrait plus que la clarté.
Maurice Carême
Nouveautés Le Jongleur, recueil posthume (poèmes) – 2012 Souvenirs, recueil posthume (poèmes) – 2011 Maurice Carême, poète (DVD) (2010) Du ciel dans l’eau, recueil posthume (poèmes) – 2010 Au pays de Maurice Carême, essai pédagogique par B. LibertLe jour s’en va toujours trop tôt. par J. Burny
Jacky Galou et Caroline Marlande (CD)
PoésieAu clair de la lune° illustré (3) 6€ La lanterne magique° dessin (14) 10 €Le moulin de papier° illustré (2) 10 € Pomme de reinette° dessin (4) 10 € Almanach du ciel illustré (7) 15 € La bien-aimée illustré (15) 12,5 €Complaintes illustré (5) 25 € Défier le destin dessin (12) 10€ Defying fate (édition bilingue anglais/français) 15 € De plus loin que la nuit illustré (14) 13,5 € Du ciel dans l’eau dessin (22) 16 € Entre deux mondes dessin (1) 10 € L’envers du miroir illustré (7) 12 € Et puis après dessin (21) 13,5 € Être ou ne pas être dessin (14) 16 €Le Jongleur dessin (9) 17 € Mer du Nord illustré (4) 15 € Mère suivi de La Voix du Silence dessins (15) 10 € Pourquoi crier miséricorde album de luxe illustré (8) 22 € Souvenirs 19 € Sur les bancs° (gravures pressées à la main) (2) 28 € AnthologiesA l’Ami Carême° illustré (13) 4,9 € Emporte-moi, mon cerf-volant° illustré (17) 11,5 € Maurice Carême° illustré (3) 11,5 € Mini-livre° 3 € Poèmes de Maurice Carême° illustré (18) 17,9 € Dans la main de Dieu 15 € Les étoiles de la poésie de Flandre (traductions) 14 € Être poète (bilingue français - allemand) 10,5 € Nouveau florilège poétique dessin (10) 10 € 23 Poèmes de Maurice Carême illustré (6) 9 €
Romans – Contes – EssaisLa Bille de verre° (roman) 6 € Du temps où les bêtes parlaient° (contes et poèmes) 6 € Le Magicien aux étoiles° (conte) illustré (11) 11,5 € Au pays de Maurice Carême (essai par B. Libert) 14 €Le château sur la mer (contes) dessin (16) 10 € Dossier Maurice Carême (enseignement secondaire) 1,25 € Le jour s’en va toujours trop tôt. Sur les pas de Maurice Carême (essai par J. Burny) 25 €Maurice Carême ou la clarté profonde (colloque) 12,5 € Médua (roman fantastique) (réédition) 15 € La Narration lyrique de Maurice Carême (essai par J. Dumont) 23,5 €
Un trou dans la tête (roman) 12,3 €
Disques – Minicassettes – DVDMaurice Carême poète international (DVD) 20 €78 Poèmes dits par Maurice Carême (CD) 20 € Jacky Galou et Caroline Marlandechantent Maurice Carême° (CD) 15 € Picoti Picota° (cassette) 11,5 € Voici une chanson° (disque 33 tours) (20) 14 € Jacques Chailley (mélodies) (CD) 20 € Francis Poulenc (mélodies) (CD) 22,5 € Le quatuor de Léon (CD) 15 €
DiversCartes postales : photos de M. Carême par J. Burny 1 € Cartes postales : M. Carême par Felix De Boeck 1,5 € Cartes postales : poèmes manuscrits 1 € La série de 6 cartes : poèmes manuscrits 5 € Papier à lettres : vers de M. Carême et photos 6,2 € Lithographie : poème « Le maître d’école» (19) 75 € Poèmes gravés (poèmes de M. Carême) 10 € Dessin-poème – 12 signes du Zodiaque : (7) chacun 7 €
(1) S.Creuz - (2) dessins d’enfants - (3) Gabriel Lefevbre - (4) H.V.Wolvens - (5) F.De Boeck - (6) Svetlana Petrova - (7) M.Delmotte - (8) J.Dix - (9)R.Somville- (10) A. Dasnoy - (11) Teo Puebla - (12) P.Delvaux - (13) P.Dumas - (14) M.Ciry - (15) L.Navez - (16) Turner - (17) I. Charly - (18) J.F.Martin - (19) du Bois de Beauchesne - (20) I.Disenhaus (musicien) - (21) Camille Claus - (22) Corot ° = ouvrages accessibles aux enfants
Certains ouvrages existent en éditions de luxe numérotées avec des-sins originaux, eaux-fortes, linos, signatures.
Ces ouvrages peuvent être commandés à la Fondation Maurice Carême. Pour tout envoi : frais de port en sus.
Œuvres disponibles