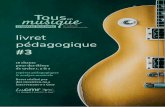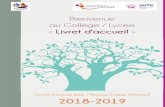A la rencontre des manuscrits hébreux, Institut Universitaire européen Rachi de Troyes –...
Transcript of A la rencontre des manuscrits hébreux, Institut Universitaire européen Rachi de Troyes –...
A la rencontre des manuscrits hébreux
Philippe Bobichon
Ce premier livret a été relu avec acribie par Colette Sirat (Comité de paléographie hébraïque),
Laurent Héricher (Bibliothèque nationale de France),
Delphine Yagüe, Catherine Hugot et Émeline Priadka (Institut Universitaire européen Rachi de Troyes),
Louis Burle, Geoffroy Grassin et Jérôme Ung (Médiathèque d’Agglomération Troyenne)
et Silvia Di Donato. Leurs questions, corrections et suggestions
l’ont grandement amélioré, et je les en remercie vivement.
Tous nos remerciements aux Imprimeries PATON, et particulièrement à Chrystelle Blasson, pour sa collaboration.
INTRODUCTION
L’enquête et les enquêteursDepuis le printemps 2004, une équipe constituée dans le cadre d’une collaboration entre l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS) et la Bibliothèque nationale de France, avec le concours et le soutien de l’Institut universitaire européen Rachi de Troyes, a entrepris l’étude approfondie des manuscrits en caractères hébreux de la Bibliothèque nationale (site Richelieu). L’enquête doit s’étendre à l’ensemble des manuscrits hébreux conservés dans les bibliothèques publiques de France : le second volume de la collection est consacré aux fragments bibliques de la Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle (Paris). L’entreprise est placée sous la direction scientifi que de Colette Sirat ; elle bénéfi cie de son conseil et prend appui sur la méthode que cette dernière a patiemment élaborée, avec Malachi Beit-Arié (Israël), pendant quarante années d’un commerce assidu avec les manuscrits hébreux.
Un patrimoine à découvrirCe projet est ambitieux et il s’inscrit dans le long terme : le fonds hébreu de la Bibliothèque nationale est en effet l’un des plus importants au monde par le nombre et la variété des documents qui le constituent. Pour être appréciée et exploitée comme il convient, cette richesse doit être mise en valeur. Mais les manuscrits ne dévoilent (certains de) leurs secrets que lorsqu’on les aborde avec patience et opiniâtreté. Les notices qui les décrivent (au moins 5 pages, souvent beaucoup plus) sont à la mesure de cette exigence. Chacune d’entre elles nécessite plusieurs jours de travail. A raison de trois ou quatre volumes annuels, la publication de la collection complète - environ cinquante volumes - s’étalera sur dix ans, au moins. L’étude des manuscrits hébreux contribue à la valorisation du patrimoine ; elle fait progresser la connaissance et enrichit celui qui s’y consacre. C’est dans cette triple dimension - culturelle, scientifi que et personnelle - qu’elle trouve sa spécifi cité, son utilité, et son caractère exaltant.
A la rencontre des manuscrits hébreux 3
Histoires de livres4
LE FONDS HEBREU DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE
Le fonds hébreu de la Bibliothèque nationale de France comporte près de 1500 manuscrits. Son intérêt pour notre connaissance de la vie juive au Moyen âge est exceptionnel1.
Un alphabet pour plusieurs languesToujours écrits en caractères hébreux, les textes sont rédigés en diverses langues : essentiellement l’hébreu et l’araméen, mais aussi, très souvent, l’arabe (ill. 1 : p. 5), le persan, le judéo-espagnol, le yiddish (ill. 2 : p. 4) et, moins souvent, le français, le latin, l’italien ou l’ottoman. Leur contenu couvre l’ensemble de l’activité humaine dans sa dimension intellectuelle, religieuse et pratique : écriture sainte, commentaires bibliques, écrits normatifs, liturgie, théologie, philosophie, cabale, sciences, mathématiques, physique, astronomie, médecine et chirurgie, philologie, histoire, poésie, polémique, etc.
Uniques et multiplesPour des écrits aussi connus que le Guide des Égarés, de Maïmonide (1138-1204), le fonds hébreu de la BNF possède plusieurs copies (ill. 3 : p. 8 ) ; dans d’autres cas - en particulier pour des textes de
diffusion restreinte - , l’exemplaire de la Bibliothèque est l’unique témoin conservé. Quelques manuscrits sont autographes, donc particulièrement précieux ; d’autres portent des notes anciennes de la main de lecteurs renommés dans la tradition juive2.
1 Son histoire donnera lieu à un prochain numéro de cette collectin.
2 Par exemple Hébreu 691, annoté par Azarya de Rossi, le plus grand
érudit juif italien de la Renaissance (ca 1511 – ca 1578), ou Hébreu 677 et 702, annotés par Caleb Afendopoulo,
savant qaraïte (Constantinople, ca 1464 – 1525).
(ill. 2)Paris, BnF, hébr. 1312
(XVe-XVe s.), ff. 1v-2rManuel de blanchissa-ge en judéo-allemand.
Les compartiments situés près de la
circonférence portent des chiffres en lettres
hébraïques corres-pondant à diverses quantités de l’objet
dont le nom est inscrit au haut du feuillet.
5
(ill. 1)Paris, BnF, hébr. 1203 (XIVe s.), f. 45v Abrégé de quelques ouvrages de Galien, par Moïse Maïmonide (1138-1204), en arabe caractères hébreux. Écriture espagnole. La formule d’introduction, musulma-ne (« Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux »), est elle aussi en arabe. Enluminures d’origine catalane. Manuscrit acheté au Caire par Salomon Munk, pour la Bibliothèque royale, en 1841.
A la rencontre des manuscrits hébreux
Nains et géantsSelon leur destination (usage privé ou public, dans un lieu fi xe ou en déplacement, etc.) ils sont de tailles et de formats très variables : le manuscrit Hébreu 33 (ill. 4 : p. 6), bible probablement copiée à la fi n du XIIe s. ou au début du XIIIe s. mesure, lorsque le livre est ouvert, 15 cm de large sur 10 cm de haut, dimensions qui l’apparentent à certaines bibles latines que l’on vit apparaître à Paris, à la même époque. Une autre bible (Hébreu 7), richement décorée, mesure, fermée, 53 cm de haut pour 37 cm de large. Le plus petit manuscrit hébreu de la BNF (Hébreu 1322) est un livre de prière de 6, 7 cm sur 4, 7 cm (504 feuillets) : sa description a nécessité un temps de travail inversement proportionnel à sa taille. Des disparités analogues
Histoires de livres6
(ill. 4)Paris, BnF, hébr. 33 (XIIIe s.),
ff. 325v-326rBible suivie d’un livre de prières.
Manuscrit copié en France. Deux acrostiches, placés en tête du vo-lume et à la fi n du Deutéronome,
donnent le nom du copiste : Hayyim, fi ls de Meshullam.
A la rencontre des manuscrits hébreux 7
peuvent être observées pour la plupart des manuscrits, quel que soit leur contenu. Les reliures sont elles aussi fort diverses et les plus anciennes sont souvent les plus belles.
Singuliers et plurielsA la Bibliothèque nationale comme ailleurs, les objets désignés comme « manuscrits » ne correspondent pas à une réalité homogène : ils portent, selon le cas, un ou plusieurs textes, complet(s) ou fragmentaire(s), copié(s) par un seul ou plusieurs scribes ayant travaillé séparément ou simultanément, à une même époque ou en des temps (et des lieux) divers. Certains d’entre eux présentent une remarquable unité matérielle, paléographique et intellectuelle (support, écriture,
Histoires de livres
(ill. 3)Paris, BnF, hébr. 685 (XVe s.),
f. 28r Maïmonide (1138-1204),
Guide des égarés (fi n du livre I et début du livre II).
Manuscrit vraisemblablement copié en Italie,
mais l’écriture est séfarade.
8
A la rencontre des manuscrits hébreux 9
teneur des textes) ; d’autres sont constitués d’éléments disparates artifi ciellement réunis dans une même reliure à un moment donné de leur histoire.
Des cheminements très diversCes manuscrits sont entrés dans la bibliothèque « royale », « impériale » ou « nationale » au terme d’un parcours plus ou moins sinueux et selon divers processus : achats faits en Orient ou en Occident (en particulier l’Italie) par les émissaires des rois de France ou de leurs ministres (Mazarin, Colbert), legs, confi scations révolutionnaires, achats. Pour la période antérieure, leur histoire est mal connue ; elle fut assurément pleine de vicissitudes pour certains d’entre eux, et il n’est pas rare que leur état de conservation en garde la mémoire. Copiés pour la plupart, entre le XIIe et le XVe siècle, les manuscrits proviennent, comme leurs scribes et leurs possesseurs, des diverses aires culturelles qui accueillaient, au Moyen âge, des communautés juives : Ashkénaz (nord de la France, Allemagne et Angleterre), Séfarad (Espagne et Afrique du Nord), Provence, Italie, monde byzantin, Orient, et Yémen. Leurs spécifi cités codicologiques (aspects matériels), paléographiques (écritures) et esthétiques portent la marque de ces différents univers. La graphie cursive de l’hébreu, par exemple, peut présenter de fortes disparités selon le pays d’origine du copiste3 (ou de celui qui lui a enseigné son art) (ill. 5 : p. 12). Il en va de même pour la décoration (ill. 6 : p. 18), qui n’est pas toujours l’œuvre d’un juif.
Mise en page et mise en texteLa mise en page est plus ou moins complexe et plus ou moins élaborée : les textes peuvent être copiées « à longue ligne »4 ou en colonnes (ill. 7 et 12 : p. 16 et 11), leurs articulations étant à peine visibles ou soigneusement mises en évidence par différents moyens (taille et couleur des caractères, alinéas, etc. : ill. 8 : p. 21) ; de longueur variable, les commentaires sont très diversement répartis sur le feuillet - quelquefois d’une manière fort décorative -, afi n que soit maintenue, autant que possible, leur proximité avec le passage sur lequel ils portent (ill. 9 : p. 21). Figures, diagrammes et illustrations
3 A distinguer du pays où le manuscrit a été copié : dans leurs déplacements volontai-res ou forcés, les scribes emportaient avec eux les habitudes culturelles dans lesquelles ils avaient été élevés.
4 Sur tout l’espace qui s’étend d’une marge latérale à l’autre.
Histoires de livres10
- qui n’émanent pas toujours du copiste - sont situés à l’intérieur de l’espace écrit, à cheval entre les marges et l’espace écrit (ill. 10 : p. 25), dans les marges ou sur des feuillets distincts. Dans la plupart des cas, ces éléments sont disposés de telle sorte que deux pages en regard, et non la page isolée, offrent une composition harmonieuse et équilibrée (ill. 5 et 8 : p 12 et 21). Les problèmes posés par la mise en page étant indépendants du champ linguistique et du sens de l’écriture, les copistes de textes hébreux ont souvent adopté des solutions analogues à celles qui sont appliquées dans les manuscrits grecs, latins ou arabes. La confi guration particulière d’une page de Talmud, par exemple, s’apparente à celle des manuscrits latins universitaires de l’époque scolastique (ill. 11 : p. 10) ; elle refl ète, comme cette dernière, les « disputes » des commentateurs autour du texte principal (ici, la Mishna). Cette disposition s’est imposée lors des premières éditions et a été reproduite telle quelle dans toutes les versions imprimées, en sorte qu’aujourd’hui encore, une citation du Talmud renvoie au feuillet (recto ou verso) où fi gure le passage dans l’édition publiée par Daniel Bomberg (un chrétien), à Venise, en 1520-1527. La diversité des dispositifs élaborés par la tradition manuscrite pour la mise en page et la « mise en texte » des écrits est largement représentée dans le fonds hébreu de la Bibliothèque nationale.
SPECIFICITE DES MANUSCRITS HEBREUX
Des objets chargés d’histoireLe « manuscrit » est un livre écrit à la main ; c’est ce qui le distingue, aujourd’hui encore, de l’imprimé5. En ce sens, il est toujours un document unique lié à des circonstances précises.
Par qui et pour qui a-t-il été copié ? En quel lieu ? A quelle époque ? Par qui a-t-il été lu ? Quelle fut son histoire avant et après l’entrée dans une bibliothèque institutionnelle ? La réponse à ces différentes questions est inscrite dans ses composantes matérielles et textuelles. Il arrive que le manuscrit porte un colophon (ill. 12 : p. 11), sorte de signature dans laquelle le scribe s’adresse à l’utilisateur, se nommant, donnant une
5 On a continué à copier des livres bien après
l’invention de l’imprimerie.
(ill. 11)legende à venir
A la rencontre des manuscrits hébreux 11
date, un lieu, et quelquefois d’autres indications : identité du commanditaire, circonstances particulières, détails personnels. Dans le manuscrit Hébreu 631 de la Bibliothèque nationale, il est rédigé en ces termes :
Moi, Juda b. Reuben, surnommé Vital Bonasgurug […] ai terminé l’ordonnance de ce rituel de prières de la sainte communauté d’Avignon et sa vocalisation le 29 Eloul 5213 de la Création [1453] […]. En cette année, de fausses accusations furent portées contre la sainte communauté d’Arles : qu’ils égorgeaient des enfants et se servaient de leur sang pour la Pâque. Ils auraient été en grand danger si Dieu n’avait eu pitié d’eux. Le Roi René - que Dieu augmente sa puissance - et le Gouverneur vice-roi reconnurent que les accusations étaient fausses et mensongères. L’affaire fut portée en justice le second jour de la fête des Cabanes [Souccot]. La même année, des prédicateurs de l’ordre des Mineurs vinrent nombreux à Avignon, du 1er Tammouz au 1er Eloul [juillet-août] et nous fûmes forcés d’assister [à leurs sermons]. Ils tinrent contre nous des propos impossibles à rapporter et prirent à notre encontre des décrets très durs, au point que nous aurions perdu tout espoir si Dieu ne nous avait pris en grâce6.
Les précisions relatives à l’histoire du manuscrit peuvent être données par ses lecteurs : au feuillet A recto du manuscrit Hébreu 672, l’un d’entre eux indique qu’un tremblement de terre - heureusement sans gravité - eut lieu à Naples, au soir du vendredi 11 août 1475.Les manuscrits ne portent pas toujours des indications aussi explicites et les colophons, lorsqu’ils existaient, ont fréquemment disparu avec le (dernier) feuillet sur lequel ils étaient inscrits7. En pareil cas, seul un examen détaillé fournit les éléments susceptibles d’être utilisés pour dater et localiser le document qu’on a sous les yeux.
6 Extrait de Colette SIRAT, Du scribe au livre, CNRS Éditions, Paris 1994, p. 188-189.
7 Avant qu’un manuscrit ne soit relié (souvent de façon tardive), ses feuillets extérieurs étaient particulièrement exposés.
(ill. 12)Paris, BnF, hébr. 44, ff. 166v-167rDans le colophon ornementé qui se trouve sur la page de droite, le scribe, Abraham ben Jacob, précise qu’il a achevé son travail « ici, à Paris, en l’an 5063 de la Création du monde » (1303).
De précieux témoins de l’histoire juiveLes manuscrits copiés dans des langues et dans des lieux divers présentent des caractéristiques communes, mais ils ont aussi leurs spécifi cités. Tout en s’inspirant de la méthode élaborée pour les manuscrits grecs ou latins, l’étude des manuscrits hébreux prend en compte et met en évidence ce qui caractérise ces derniers. Les manuscrits hébreux n’ont pas été copiés, comme les manuscrits grecs ou latins médiévaux, dans des institutions ; le scriptorium, pièce réservée à cette activité dans certains monastères et dotée d’un ameublement approprié (sièges, pupitres, cornets à encre, coffres renfermant la provision de parchemin et les modèles à reproduire), est inconnu de la tradition juive : même pour les manuscrits destinés à un usage liturgique, la copie y est individuelle et elle est exécutée, le plus souvent dans un espace privé. La méthode des scribes juifs ne s’apparente à celle de leurs homologues chrétiens que dans un cas très particulier : certains manuscrits philosophiques copiés en Espagne ou en Provence sont manifestement l’œuvre de plusieurs personnes qui se sont partagé la tâche, destinant leur travail commun à une étude
Histoires de livres
(ill. 5)Paris, BnF, hébr. 341
(XIVe-XVe s.), ff. 76v-77r Maïmonide (1138-1204),
Mishne Torah (synthèse monumentale
de la loi juive). Écriture séfarade.
Le format oblong caractérise l’Orient ou le Maroc.
12
collective. L’existence de ces yeshivot (écoles) philosophiques est une découverte récente qui procède directement de l’analyse de certains manuscrits8 où plusieurs mains sont intervenues pour copier un même texte ; elle est régulièrement confi rmée, au cours du travail effectué à la BNF, par la mise en évidence de nouvelles pièces constituées sur le même modèle. L’intérêt historique des manuscrits hébreux est illustré aussi par des découvertes de cette nature. Les traces concrètes de la vie juive au Moyen âge sont fort rares (la mise à jour des vestiges d’une synagogue, à Rouen, en 1976, est exceptionnelle). Aussi les manuscrits hébreux copiés à date ancienne sont-ils particulièrement précieux car ils demeurent, dans bien des cas, les seuls monuments encore palpables de ce que fut l’activité pratique, intellectuelle et religieuse des communautés médiévales. De ce point de vue, les manuscrits les plus beaux ne sont pas nécessairement les plus dignes d’intérêt ; mieux préservés par leur qualité esthétique - souvent liée à leur statut - et par leur valeur marchande, ils sont souvent moins stimulants, et moins attachants que ceux dont l’apparence est plus modeste.
A la rencontre des manuscrits hébreux 13
8 Cf. C. Sirat, in : C. SIRAT et M. GEOFFROY, L’original arabe du grand com-mentaire d’Averroès au De Anima d’Aristote. Prémices de l’édition, Paris, 2005, p. 69-86.
Histoires de livres14
L’intérêt historique des manuscrits hébreux réside aussi dans les liens particuliers qui les unissent à ceux qui les ont copiés, possédés et utilisés : comme ces derniers, beaucoup ont erré de pays en pays au cours d’une existence très mouvementée, ne trouvant une certaine stabilité qu’aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, lorsque érudits et institutions chrétiennes commencèrent à les collectionner. Ils entrèrent par la suite dans les grandes bibliothèques royales et universitaires d’où provient la plus grande partie des fonds actuellement conservés. En Italie, ceux qui furent remis à l’Inquisition pour être censurés portent les marques de l’examen subi (passages effacés rayés ou « caviardés »9 , signatures de censeurs : (ill. 13 : p. 26), mais de manière un peu paradoxale cela a parfois contribué à les préserver puisqu’ils étaient « à l’abri » pendant cette période.
Dans le détail de leur présentation, les manuscrits hébreux offrent de nombreuses autres particularités qui tiennent à leur histoire, à la nature des textes (en particulier pour la Bible, dont la copie est codifi ée), aux traditions, et à l’infl uence du milieu. C’est en tenant compte de ces différents paramètres que les observations recueillies pendant le travail d’analyse sont réunies, organisées, et interprétées.
UNE DEMARCHE SCIENTIFIQUE
L’étude scientifi que d’un manuscrit hébreu demande de la méthode et un peu d’intuition. Elle se mène en plusieurs étapes.
Premiers éléments d’enquêteLors d’un « premier contact », on s’attache aux aspects extérieurs du manuscrit en notant au passage ce qui devra donner lieu à un examen plus poussé : une reliure ancienne, des inscriptions sur la tranche, des irrégularités dans la taille des feuillets, des marques très visibles de réparation, etc. Le livre ouvert, on le feuillette lentement en relevant, là aussi, tous les détails qui attirent l’attention : différences dans la qualité du papier et/ou du parchemin ; changements d’écriture, d’encre, de mise en page
9 Recouverts d’encre noire
(le mot désigne, à l’origine, la technique de censure
qui était pratiquée en Russie, au XIXe siècle).
10 Annotations et commentaires.
11 Ensemble des lignes droites, verticales ou horizontales,
tracées le plus souvent à la pointe-sèche ou à la mine de plomb, qui permettent
au scribe de disposer son texte et guident son écriture. Ce travail préliminaire à la copie n’est pas effectué dans tous les
manuscrits. (Les défi nitions données dans les notes de bas de page sont tirées, pour
l’essentiel, de l’ouvrage de Denis Muzerelle dont les références sont données dans la
bibliographie).
A la rencontre des manuscrits hébreux 15
ou de mains ; gloses10 marginales rognées ; taches plus importantes que les autres et différemment réparties ; espaces laissés blancs dans la copie ; réglure11 très apparente par endroits ; marques de censure (ill. 13 : p. 26) ; feuillets mutilés ; présence de titres courants, d’une numérotation ancienne pour les feuillets ou les cahiers, d’illustrations ou de manicules12, etc.
Recherche d’indices…Puis vient l’examen des cahiers13, opération fondamentale car elle donne la « structure » du manuscrit. Combien le manuscrit en comporte-t-il ? Ont-ils tous la même composition? Comment sont- ils regroupés ? Les changements de mains correspondent- ils au passage d’un cahier à un autre ? Cette analyse met en évidence le nombre des « unités codicologiques »14, les problèmes qui se sont posés au(x) scribe(s), les incidents survenus au cours de la copie, l’intervention d’autres personnes, des remplacements, des ajouts, ou encore la disparition de feuillets puisque leur nombre doit être identique de part et d’autre du bifeuillet central qui porte le fi l de couture.
… et de preuvesLe soupçon d’une lacune peut être confi rmé ou infi rmé, pour les feuillets de papier, par l’examen des fi ligranes15 : ils sont généralement situés dans le pli du bifeuillet ; les deux parties doivent donc être visibles de part et d’autre du cahier. Si l’une d’entre elles manque, c’est peut être un autre indice. Lorsqu’elles existent et sont régulières, les « réclames » fournissent un autre élément d’investigation : pour contrôler la bonne succession des cahiers, certains copistes inscrivaient au bas d’une page, dans la marge inférieure, le ou les premier(s) mot(s) de la page suivante (ill. 5 et 816 : p. 12 et 21). Très utile pour les relieurs, cette indication l’est aussi pour qui examine le manuscrit : si la réclame fait défaut à l’endroit précis où l’on a soupçonné une lacune, la disparition d’un ou de plusieurs feuillets est plus vraisemblable encore.
14 Ensembles de feuillets dont l’exécution peut être considérée comme une opération unique, réalisée dans les mêmes conditions de lieu, de temps et de technique.
15 Marques de fabrique que les moulins à papier européens ont imprimées dans la feuille, grâce un fi l métallique formant une fi gure.
16 Elle est située sur le feuillet de droite, à gauche dans la marge inférieure, puisque l’hébreu se lit de droite à gauche.
13 Ensemble des bifeuillets (pièces de parchemin ou de papier pliées en deux pour former deux feuillets) emboîtés les uns dans les autres et unis par un même passage du fi l de couture ». Les bifeuillets peuvent être réunis par deux (binions), par trois (ternions), par quatre (quaternions), par cinq (quinions), par six (sénions) ou davantage : (ill. 14)
12 Signe représentant une main dont l’index est dressé, tracé en marge pour attirer l’attention sur un passage du texte (ill. 16).
Histoires de livres16
(ill. 7)Paris, BnF, hébr. 980
(fi n du XIVe s.), ff. 25v-26r« Vers sur l’âme et les dénominations
de Dieu », par Lévi ben Abraham de Villefranche (ca 1245-1315).
Écriture provençale.
(ill. 6)«Collection du Consistoire
de Paris déposée à l’AIU (Paris)».
Paris, Alliance Israélite universelle, Hébreu 24 (XIVe s.),
ff. 42 Livre de prières. l’image de droite représente
un maître dans une cathèdre, en train d’enseigner,
et celle de gauche la sonnerie du shofar.
Histoires de livres18
L’examen du texte est un autre moyen de s’assurer que la copie est complète : se lit-il sans interruption là où un feuillet semble perdu ? Pour le vérifi er, il faut lire le passage et le comparer, si possible, à d’autres versions : édition de référence, lorsqu’elle existe, ou autres témoins manuscrits conservés dans la même bibliothèque. La méthode vaut aussi pour tous les éléments sur lesquels se fonde la caractérisation d’une copie : espaces laissés blancs qui correspondent peut-être à des endroits illisibles dans le modèle, ordre et numérotation des chapitres, etc.
Tout se tientLes autres rubriques de la notice type (voir ci-après) sont toutes examinées selon la même méthode et dans le même esprit. La pratique des manuscrits montre en effet que les différentes approches (codicologique17, paléographique18 et textuelle), sont complémentaires et interdépendantes. Pris isolément, les matériaux repérés et inventoriés n’ont qu’une valeur relative. Seule une confrontation mise en forme dans un discours organisé et hiérarchisé peut les rendre intelligibles : les éléments de datation et de localisation que fournissent par exemple, en l’absence de colophon, les fi ligranes, les écritures, la liste des textes copiés et les notes personnelles doivent concorder. Dans la notice qui lui est consacrée, le manuscrit, même mutilé, doit retrouver sa cohérence.
Enquêteurs et explorateursSon étude doit être envisagée comme une enquête au cours de laquelle aucun détail ne saurait être négligé (les manuscrits les plus simples en apparence sont parfois ceux qui demandent le plus de travail). Elle tient aussi de l’exploration : celui qui l’entreprend ignore où elle le mènera, combien de temps elle lui prendra, combien de détours seront nécessaires ; mais les voies qu’il aura tracées pourront être empruntées par d’autres : un manuscrit n’a jamais fi ni de révéler ses secrets et en ce domaine comme ailleurs, le questionnement évolue avec la science.
A la rencontre des manuscrits hébreux 19
17 Examen des aspects matériels du manuscrit.
18 Examen des écritures.
Histoires de livres20
A la découverte de nouveaux écritsL’intérêt historique des manuscrits hébreux réside aussi dans les textes dont ils sont porteurs. Aussi leur examen s’attache-t-il à mettre en évidence ce qui permet de les identifi er et de les décrire. Certains de ces textes sont bien connus car ils furent, dès l’époque de leur rédaction, largement diffusés, et commentés ; même en pareil cas, la comparaison des témoins ne manque jamais d’intérêt car elle peut faire apparaître des disparités riches d’enseignements. Les différentes versions d’un écrit correspondent parfois aux étapes successives de sa rédaction : tant qu’il était en vie, l’auteur pouvait toujours procéder, sur son exemplaire personnel, à des corrections dont la tradition manuscrite conserve la mémoire ; l’édition scientifi que devrait toujours prendre en compte cette réalité. D’autres écrits sont plus rares car dans le domaine hébraïque comme ailleurs, seuls les plus répandus — ceux qu’on était sûr de vendre — furent imprimés19.
L’analyse textuelle des manuscrits consiste donc à répertorier les écrits dont ils sont porteurs en soulignant, autant que possible, l’originalité de chaque copie. Elle favorise parfois l’identifi cation d’œuvres inconnues ; c’est à cette tâche que Georges Vajda a consacré quatre après-midi par semaine, pendant trente années de sa vie. Notre entreprise permet encore de découvrir des textes ou de préciser leur nature. Ainsi les derniers feuillets du manuscrit hébreu 712 (écrits de polémique avec le christianisme) portent des passages en latin caractères hébreux vocalisés qui étaient présentés, jusqu’à présent, comme un fl orilège de citations néotestamentaires (ill. 14 : p. 28). Ce sont en réalité des citations tirées de divers écrits (et sermons ?) chrétiens, introduites, en hébreu et en ancien français caractères hébreux, par des considérations relatives à leur usage potentiel dans la controverse avec les chrétiens. Révélé pendant l’analyse du manuscrit, ce document exceptionnel apporte un éclairage nouveau sur la prononciation du latin au Moyen âge et sur les modalités pratiques des controverses religieuses entre juifs et chrétiens, dans le nord de la France, à la fi n du XIIIe siècle. Son intérêt est historique et linguistique.
19 A partir de 1469 pour les textes hébreux.
A la rencontre des manuscrits hébreux 21
(ill. 8)Paris, BnF, hébr. 642 (XVe s.), ff. 3v-4r Rituel de prière copié dans le sud de la France. Dans les manuscrits hébreux, c’est généralement le premier mot - et non la première lettre, comme dans les manuscrits grecs ou latins - qui est écrit en caractères de plus grand module, et quelquefois enluminé.
(ill. 9)Paris, BnF, hébr. 311 (fi n du XIVe s.), f. 174v-175r Abrégé du Talmud, par Rabbi Isaac Alfasi, de Fez, (1013-1103), accompagné du commentaire de Rashi (1040-1105) sur le Talmud et de diverses autres gloses. Manuscrit ashkénaze. Au centre, la colonne, en écriture carrée, du texte d’Alfasi ; dans les marges, en écriture semi-cursive, le commentaire de Rashi sur le Talmud, et les autres gloses.
Histoires de livres22
Mise en forme des résultatsLa notice rédigée est le refl et du travail effectué sur le manuscrit. Elle s’adresse à différents utilisateurs et se prête à des lectures multiples. Sa structure identique pour tous les manuscrits, mais tenant compte de leur variété, a fait l’objet d’une longue élaboration :Les indications qui fi gurent en tête de la notice constituent la « carte d’identité » du manuscrit. Quelques lignes de présentation, qui sont une synthèse des observations détaillées dans le corps de la notice, donnent ensuite ses principales caractéristiques.
Le manuscrit : objet matériel et intellectuelLes rubriques qui composent cette notice ont toutes donné lieu à un examen approfondi dont le bilan doit, autant que possible, être formulé avec concision. La distinction entre « description matérielle » et « contenu textuel » est de pure forme ; dans le détail de l’investigation - et bien souvent dans son résultat écrit - les différents aspects du manuscrit sont constamment mis en relation car ils demeurent indissociables.
A qui s’adresse notre travail ?Les informations données dans les notices intéressent divers publics : éditeurs de textes, historiens, conservateurs, paléographes, codicologues, et plus généralement tous les spécialistes des domaines illustrés par le contenu textuel des manuscrits. Le choix d’une même structure favorise la consultation « transversale » et toutes les formes de comparaison qui font progresser la science des manuscrits. Les « remarques » accueillent les éléments qui n’ont pas trouvé leur place dans la notice, mais dont il eût été dommage de priver le lecteur : hypothèses sur la datation et la localisation du manuscrit, sur l’identifi cation des scribes, des commanditaires et des possesseurs ; précisions historiques ; suggestions de recherche. Comme l’ensemble de la notice, ces remarques refl ètent l’intensité des liens tissés avec le manuscrit.
A la rencontre des manuscrits hébreux 23
Cote.Reproduction de deux feuillets en regard.
Nombre des feuillets ; papier / parchemin ; dimensions ; lieu et date de la copie ; nom du copiste et du commanditaire.
Courte présentation (« chapeau »). Liste des auteurs et des textes.
I – DESCRIPTION MATERIELLENombre des feuillets ; feuillets de garde… ; Feuillets restés blancs… ; Description du papier… ; identifi cation des fi ligranes… ; description de l’état du manuscrit : trous… ; taches… ; réparations… ; Cahiers… ; réclames… ; titres courants… ; numérotation des cahiers…; Dimensions… ; Piqûres (points de repère pour le tracement de la réglure)… ; réglure… ; texte copié à longues lignes ou en colonnes ; nombre de lignes écrites et réglées… ;Écriture (cursive, semi-cursive, carrée ; de type séfarade, ashkénaze, byzantin, etc.)… ; présentation des premiers mots, des titres et des fi ns de textes ; Encre ; Eulogies (formules de bénédiction)… ; notes et corrections marginales… ; interventions dans la copie (corrections, etc.)… ; manicules… ; (pour les scribes principaux) : deux lignes d’écriture à grandeur originale.Colophon (texte hébreu et traduction). Bibliographie sur le manuscrit.
II – CONTENU TEXTUELPour chaque texte (complet ou fragmentaire), auteur, titre hébreu, titre hébreu dans le manuscrit (s’il est différent du titre reçu), titre français ; premières lignes, dans le manuscrit, de la préface/introduction et du texte proprement dit ; dernières lignes.
Brève description de la copie conservée dans le manuscrit (structure, comparaison avec d’autres manuscrits et/ ou avec l’imprimé) ; remarques éventuelles.
Bibliographie essentielle sur le texte (édition princeps, édition de référence ; études fondamentales).
III – HISTOIRE DU MANUSCRITNotes d’achat, de vente… ; marque(s) de possesseur(s)… ; note(s) d’origine… ; ex-libris… ; marques de censure et signatures de censeurs… ; cotes anciennes… ; estampille(s)... ; reliure.
IV – REMARQUESSugestions pour l’identifi cation de scribes, de possesseurs ; notes historiques ; pistes de recherche, etc.
Notice type(modèle appliqué à tous les manuscrits, quel que soit leur contenu)
Histoires de livres24
UNE RENCONTRE PERSONNELLE
L’étude des manuscrits doit être menée avec rigueur et méthode, mais elle comporte aussi une dimension humaine.
Une véritable coopération…Notre entreprise est un authentique travail d’équipe - une équipe dans laquelle plusieurs pays (France, Espagne, Italie, Israël) sont représentés. Les plus expérimentés prodiguent leurs conseils et relisent soigneusement chacune des notices, manuscrit en main ; les conservateurs sont régulièrement consultés pour l’histoire des fonds et pour la description des reliures ; au cours de la recherche, il n’est pas rare qu’un collègue travaillant sur un autre manuscrit soit sollicité pour déchiffrer une inscription, identifi er un fi ligrane ou distinguer les écritures et, selon la spécialité qui est la sienne par ailleurs, chacun apporte son concours aux autres. Pour les questions qui échappent à nos domaines de compétence, des savants sont consultés. Chaque volume est signé par celui qui en est l’auteur, mais il est relu, auparavant, par plusieurs personnes, et sa présentation défi nitive (typographie, mise en page) est le fruit d’un travail collectif : erreurs et imperfections se dérobent moins facilement à l’acuité de plusieurs regards…
…au-delà du temps et de l’espacePour les manuscrits de théologie, de philosophie, de cabbale et de sciences, nos travaux s’appuient sur ceux de Georges Vajda ; ce qu’il n’a pas eu le temps d’achever est ainsi prolongé et perpétué. Cette part de transmission que comporte notre recherche devrait contribuer à sa pérennité. Elle est le signe qu’une véritable collaboration peut quelquefois s’instaurer au-delà des limites fi xées par l’existence humaine. Certaines entreprises s’inscrivent dans un temps qui n’est pas celui des individus. On le savait au Moyen âge. On l’oublie trop souvent, aujourd’hui.L’étude des objets du passé nous met en contact avec ceux qui les ont fabriqués, possédés, et utilisés. Cela s’applique tout particulièrement
25
aux manuscrits qui ont une dimension matérielle et intellectuelle. Ils portent la trace perceptible, palpable de tous ceux qui sont intervenus dans leur histoire : un feuillet isolé, un changement de main, une faute de copie (corrigée ou non), un espace laissé blanc dans l’attente d’un titre ou d’une illustration, tous ces détails absents des imprimés témoignent d’un travail en train de se faire. Les notations personnelles, les commentaires ou les corrections qui sont inscrits dans les marges perpétuent la présence de leurs auteurs ; marques de possession (parfois grattées…), notes d’achat et cotes anciennes nous disent un peu l’histoire de ceux qui ont tenu le manuscrit entre leurs mains.
Dialogue avec le manuscrit La rencontre est aussi celle de deux individus car le manuscrit est vivant ; il a une « personnalité », irréductible à sa « physionomie » ; ses secrets ne sont accessibles qu’à une curiosité empreinte de détermination et de délicatesse ; sa disponibilité ne dépend pas tout à fait de la nôtre, ni sa générosité de nos exigences. Dans le dialogue qui s’instaure avec lui, école de patience et de courtoisie, le « catalogueur » engage - et enrichit - toute sa personne.
(ill. 10)Paris, BnF, hébr. 1011 (milieu du XVe s.), ff. 8v-9r Les Éléments d’Euclide, dans la traduction hébraïque, faite à partir de l’arabe, de Moïse ibn Tibbon (XIIIe s.). Écriture séfarade.
A la rencontre des manuscrits hébreux
Histoires de livres26
Programme de nos publicationsLes travaux décrits dans les pages qui précèdent porteront leurs premiers fruits cette année : deux volumes sont sous presse, qui paraîtront en mai20; quatre autres verront le jour à la fi n de 2008 ou au début de 200921. Ils seront suivis de publications régulières embrassant les différents domaines illustrés par le fonds hébreu de la Bibliothèque nationale, et accompagnées d’études synthétiques ou ponctuelles sur les sujets apparus dignes d’intérêt pendant l’analyse des manuscrits.
Tradition et modernité Cette entreprise est un exemple de collaboration entre diverses institutions, et un éditeur (BREPOLS) réputé pour la qualité de ses publications. Elle ne peut être menée à bien que grâce aux facilités
20 Catalogue des manuscrits en caractères hébreux conservés dans les bibliothèques publiques
de France, I : Bibliothèque nationale de France,
Manuscrits de théologie (Hébreu 669 à 703), Brepols,
Turnhout, 2008, par Philippe BOBICHON
sur la base des notices de Georges VAJDA ;
II : Fragments bibliques de l’Alliance Israélite universelle,
par Michèle DUKAN.
(ill. 13)Paris, BnF,
hébr. 347, ff. 281v-282r Maïmonide (1138-1204),
Mishné Torah. Manuscrit copié à Rome, en 1324. Sur la page
de droite, passages « caviardés » où il est question des « mensonges »
et des « erreurs » relatifs à la venue du Messie. Au bas des feuillets,
signatures de Domenico Irosolo-mytano et de Giovanni Domenico
Carreto, deux célèbres censeurs qui sont respectivement intervenus
sur le manuscrit en 1597 et 1621.
CONCLUSION
27
offertes par les moyens modernes — en particulier informatiques — de recherche et de communication. Le caractère pluridisciplinaire de son objet et la dimension internationale de sa mise en œuvre illustrent la nécessaire complémentarité des approches dans le domaine des sciences humaines ; ses multiples incidences montrent que le produit des sciences dites « de l’érudition » n’est pas réservé à des spécialistes, mais peut toucher un large public en contribuant à la réputation de notre pays et de ses richesses. Ces considérations orientent, organisent et inspirent notre travail quotidien ; elles le situent dans un large contexte qui lui donne sens et portée et dans la perspective d’un avenir d’autant plus prometteur qu’il se nourrit de tradition.
A la rencontre des manuscrits hébreux
BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE
GEHIN P. (dir.), Lire le manuscrit médiéval, Paris, 2005.
MARTIN H.-J., VEZIN J., Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, Paris, 1990.
MUZERELLE D., Vocabulaire codicologique. Répertoire méthodique des termes français relatifs aux manuscrits, Paris, 1985 (peut être consulté sur Internet).
GAREL M., D’une main forte. Manuscrits hébreux des collections françaises, Seuil – Bibliothèque nationale, 1991.
SED-RAJNA G., Les manuscrits hébreux enluminés des bibliothèques de France, relevé des inscriptions par Sonia Fellous, Louvain, 1994.
SIRAT C., Du scribe au livre. Les manuscrits hébreux au Moyen Âge, Paris 1994.
On trouvera des indications bibliographiques plus complètes ainsi qu’une riche documentation sur le site Internet de l’IRHT (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes) : www.irht.cnrs.fr.
21 Bibliothèque nationale de France : Bibles, par Javier DEL BARCO DEL BARCO ; Commentaires bibliques, par Silvia DI DONATO ; Manuscrits de liturgie, par Jules DANAN ; Théologie, II, par Philippe BOBICHON
Histoires de livres28
(ill. 14)Paris, BnF, hébr. 712
(Ashkénaz, fi n du XIIIe s.), f. 57r. Ce manuscrit porte
deux textes de controverse judéo-chrétienne,
dont celui de la célèbre « Dispute de Paris » qui eut lieu en présence de Louis IX
(Saint Louis) et de sa mère Blanche de Castille, en 1240.
Sur les derniers feuillets, dont celui qui est ici représenté,
on trouve un « manuel » de controverse constitué
de passages chrétiens en latin caractères hébreux vocalisés,
surmontés d’une traduction hébraïque interlinéaire, et accompagnés (ici en caractères plus petits)
d’indications sur l’usage qui peut en être fait dans la controverse
avec les chrétiens.