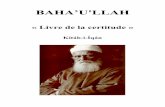« Le régime fiscal du livre numérique – Aspects techniques et politiques », Légicom, n° 51...
Transcript of « Le régime fiscal du livre numérique – Aspects techniques et politiques », Légicom, n° 51...
Boris Barraud, « Le régime fiscal du livre numérique –
Aspects techniques et politiques », in J.-M. Bruguière et
alii, Le livre numérique : une révolution juridique en
marche ?, Victoires éditions, coll. Légicom, 2013, p. 61 s.
manuscrit de l’auteur, extraits (droits cédés aux éditions Victoires)
2 Boris Barraud, « Le régime fiscal du livre numérique – Aspects techniques et politiques » (manuscrit de l’auteur, extraits)
Cela fait cinq cents ans que le livre est le complice de tous les bouleversements
— socio-politico-économiques — qui affectent le monde. Mais, aujourd’hui, il est
plus qu’un moyen de révolution ; il est la révolution. Le numérique remplace le
papier et le livre n’échappe pas à la rupture technologique1. Or, du défi
technologique au défi juridique, il n’y a qu’un pas. Et, parmi le défi juridique, il se
trouve toujours une bonne part de défi fiscal.
Le livre est certainement le premier mass media de l’histoire. Depuis le XVe
siècle, son support est le papier. Depuis quelques mois, son support est aussi l’écran.
Et, dans quelques mois — une fois la « grande conversion » achevée2 —, son
support ne sera plus que l’écran. C’est bien de révolution qu’il faut parler. Le livre
numérique n’est d’ailleurs qu’une facette de bouleversements qui se situent à l’égal
de la découverte du feu, l’invention de la roue ou… l’invention de l’écriture et,
beaucoup plus tard, celle de l’imprimerie. L’avènement du monde de l’internet et du
numérique — qui, par hasard mais symptomatiquement, correspond au passage dans
le troisième millénaire — interroge le droit et, spécialement, le droit fiscal3. Les
régimes juridiques existants peuvent-ils « naturellement » s’adapter aux nouvelles
technologies et à l’accélération du temps ? Ou revient-il au législateur et/ou au juge
d’intervenir afin de prévenir l’ « obsolescence programmée » du droit ?
Assurément, publications numériques et publications imprimées ne sont « ni
tout à fait [les] mêmes, ni tout à fait [des] autres » 4
. Les règles de droit doivent alors
évoluer partiellement, s’adapter en quelques points, mais sans doute pas être
refondues totalement. La révolution technologique n’entraînera pas de révolution
juridique. Le droit doit se montrer compréhensif et flexible à l’égard de l’armada
numérique, mais il ne doit pas s’y soumettre et la suivre aveuglément. Seulement,
l’équilibre est instable et l’entreprise délicate pour ceux qui défendent la forteresse
juridico-étatique. Internet a déjà démontré combien il pouvait se passer de droit et,
surtout, d’État. Or, s’il peut être du « droit sans l’État »5, il ne peut être de « droit
fiscal sans l’État ».
S’intéresser aux aspects de droit fiscal est certainement révélateur de
mouvements qui le dépassent. En effet, alors que rien n’est plus juridique et étatique
que du droit fiscal, rien n’est plus anti-juridique et anti-étatique que la numérisation
et l’internetisation de la planète. Le fait que les règles fiscales applicables au livre
survivent sans peine dans le « nouveau monde » ou, au contraire, ne s’acclimatent
1 B. PATINO, Le devenir numérique de l’édition. Du livre objet au livre droit, La Documentation française,
2008.
2 M. DOUEIHI, La grande conversion numérique, Le Seuil, 2008.
3 Cf. B. BARRAUD, « De l’imprimé au numérique. Le régime juridique des médias écrits à l’épreuve de leur
dématérialisation », RLDI, n° 85, sept. 2012, p. 105 s.
4 F. BENHAMOU, « Le livre numérique, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre », Esprit, mars 2009,
p. 73 s.
5 L. COHEN-TANUGI, Le droit sans l’État, Puf, coll. Quadrige, 2007.
3 Boris Barraud, « Le régime fiscal du livre numérique – Aspects techniques et politiques » (manuscrit de l’auteur, extraits)
guère à la dématérialisation est un indice nécessairement probant quant à de lourdes
tendances affectant les droits et, plus largement, les sociétés.
Si les techniques et mécanismes fiscaux ne varient guère, quel que soit le
domaine, il en va différemment des fins poursuivies. Aussi convient-il de distinguer
les problématiques de fiscalité générale, où ces premiers ont pour fonction de
financer — en partie — les dépenses publiques, et les problématiques de fiscalité
incitative ou dissuasive, où ils sont utilisés dans le but d’encourager ou limiter
certaines activités. La fiscalité peut donc être analysée tantôt comme simple
technique neutre et objective (I), tantôt comme instrument au service de décisions
politiques (II).
I. Éléments de technique fiscale applicables au livre
numérique
Avec le livre numérique, de nouveaux modèles économiques sont appelés à se
développer, la vente physique au sein des librairies étant par nature impossible. À
l’avenir, que l’e-book soit offert en échange de quelques secondes ou minutes de
« temps de cerveau disponible » — c’est-à-dire proposé par un service qui se finance
en vendant ce « temps de cerveau » à des annonceurs —, qu’il soit vendu
directement par l’éditeur, sans intermédiaire aucun, ou qu’il soit présenté parmi des
bouquets, forfaits et autres abonnements donnant accès à un catalogue, les
mécaniques fiscales seront certainement mises au défi. Pour l’heure, toutefois, il
semble que peu d’éléments, mis à part la matière, distinguent le livre numérique du
livre papier. Avant de chercher à appréhender l’activité de l’e-éditeur (B), la
technique fiscale doit déjà arrêter la notion de livre numérique (A).
A. La notion de livre numérique comprise par le droit fiscal
[…]
B. L’activité de l’éditeur numérique saisie par le droit fiscal
[…]
II. Réflexions de politique fiscale autour du livre numérique
Toutes les activités médiatiques, qu’elles soient écrites ou audiovisuelles,
bénéficient du soutien public, ce dernier étant, selon les cas, plus ou moins
prononcé. Pareil encouragement passe soit par une réduction des charges des
4 Boris Barraud, « Le régime fiscal du livre numérique – Aspects techniques et politiques » (manuscrit de l’auteur, extraits)
entreprises concernées, soit par l’augmentation de leurs revenus. Aussi les aides
prennent-elles une multitude de formes, souvent sans qu’aucun semblant de
cohérence ou de logique ne les relie les unes aux autres. Elles peuvent ainsi consister
en un régime de subventions, un régime économique attractif ou encore un régime
fiscal de faveur — quand impôts et taxes deviennent, paradoxalement, aides
publiques —. Tandis que, principalement, ces faveurs visent à garantir les
pluralismes et la liberté de communication, la fin poursuivie par la fiscalité des
médias est d’abord le soutien à la création culturelle et à sa diffusion. Le législateur
participe alors de la diversité culturelle, par des mécanismes d’incitation et de
solidarité. La fameuse « exception culturelle » est au centre du jeu, se faisant sentir
surtout dans le domaine cinématographique.
Or, de ce point de vue, le livre, écrit comme numérique, compte plutôt parmi
les parents pauvres. Sans doute l’État s’intéresse-t-il de longue date au sort juridique
et économique des acteurs de la chaîne du livre, en faisant un marché très largement
régulé1 — la proposition de loi adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 3
octobre 2013 et ayant pour objet d’interdire la gratuité des frais de port en cas
d’achat à distance en est le dernier témoignage — ; il n’a cependant jamais estimé
nécessaire de voler au secours d’un secteur longtemps demeuré fleurissant et qui,
aujourd’hui, se montre capable de prévenir les dégâts potentiellement attachés à
l’évolution des technologies et à celle des modes de vie et de consommation
culturelle qui l’accompagne. Alors que, dans certains secteurs, les aides publiques
sont une question de survie, le marché du livre demeure suffisamment dynamique
pour pouvoir au moins vivoter sans soutien étatique. Il est d’ailleurs abusif de dire
que l’État s’enquiert du sort du livre, car ce n’est que celui des libraires qui lui est
important. À moins que des motivations tout autres conduisent la sphère politique à
ne pas encourager l’édition ? Comparativement, ce sont en tout cas des sommes
himalayennes qui maintiennent — difficilement — debout une presse écrite
imprimée qui titube chaque jour davantage.
La littérature relative à ces questionnements est quasi-inexistante. Mis à part
quelques brefs articles détaillant les évolutions retenues chaque année parmi les lois
de finances, les orientations politico-fiscales adoptées sont trop peu commentées.
Cette apparente indifférence se comprend difficilement. Si la technique fiscale est
globalement neutre, tel n’est évidemment pas le cas des choix politiques qui les
chapeautent ; et il y a beaucoup à dire2. Certainement le retrait de la doctrine peut-il
s’expliquer par le manque d’homogénéité de la matière, par sa complexité et par sa
volatilité ; mais, concomitamment, l’intérêt est pluriel.
Bien que le livre numérique profite désormais d’un taux réduit de TVA, ce qui
n’est pas le moindre des acquis (B), les politiques fiscales incitatives se font rares,
1 Y. GAILLARD, La politique du livre face au défi du numérique, rapport pour le Sénat au nom de la
Commission des finances, 2010.
2 Cf. B. BARRAUD, « Le régime fiscal des médias. Étude critique d’une “foire aux niches” », RLDI, n° 83,
juin 2012, p. 87 s.
5 Boris Barraud, « Le régime fiscal du livre numérique – Aspects techniques et politiques » (manuscrit de l’auteur, extraits)
spécialement en comparaison de leur omniprésence dans le domaine de la presse
écrite (A).
A. La maigreur des dispositifs fiscaux incitatifs à l’édition électronique
La fiscalité des médias se contente parfois d’être un simple instrument de
police ; ainsi les contenus pornographiques sont-ils systématiquement surfiscalisés.
Souvent, néanmoins, elle est la traduction technique de choix politiques forts, ne
relevant pas de l’évidence, arbitraires. Il est, dès lors, parfaitement opportun de
mesurer la pression fiscale exercée sur un secteur d’activité, en l’occurrence celui du
livre numérique ; étant précisé que le principe de neutralité technologique, qui se
situe aujourd’hui au carrefour du droit des réseaux et des médias, implique l’égalité
de traitement entre l’imprimé et l’électronique. Ainsi les observations et conclusions
établies à propos du premier sont-elles normalement valables au sujet du second et
réciproquement.
Deux mécanismes principaux sont utilisés par les pouvoirs publics afin de
soutenir fiscalement un domaine d’activité quelconque : les réductions d’impôt, qui
permettent seulement d’épuiser l’impôt brut, sans le dépasser ; et les crédits d’impôt,
plus attractifs, qui s’apparentent, in fine, à de véritables subventions.
La presse écrite et imprimée, qui évolue dans le contexte économique que nul
n’ignore, profite d’un intense soutien public qui se traduit spécialement en matière
fiscale, à travers divers réductions et crédits d’impôt. L’article 39 bis A du CGI
prévoit un régime fiscal de faveur en matière d’impôt sur les bénéfices pour « les
entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au
maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et
générale ». Lesdites entreprises peuvent « constituer une provision déductible du
résultat imposable […] en vue de faire face à [certaines] dépenses ». La loi du 12
juin 2009 (« HADOPI ») a étendu cette disposition aux services de presse en ligne.
De plus, en vertu de l’article 220 undecies du CGI, le crédit d’impôt peut également
servir au financement de prises de participation dans des entreprises ayant pour
activité principale l’édition d’une publication périodique ou d’un service de presse
en ligne. Quant à l’article 1458 du même Code, il dispose que « sont exonérés de la
cotisation foncière des entreprises les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés
dont ils détiennent majoritairement le capital […] ». Et ces mêmes éditeurs d’être
encore exonérés de taxe professionnelle, à condition que la partie littéraire,
scientifique ou d’information constitue l’essentiel de la publication (article 1458, 1°
du CGI).
Certes, afin d’encourager la parution d’écrits à commercialisation lente et
difficile, les libraires — toujours eux — sont autorisés à constituer une provision ne
dépassant pas 40 % de la valeur moyenne d’inventaire des ouvrages neufs publiés
depuis plus d’un an et dont le dernier réapprovisionnement remonte à plus de trois
mois. Mais cette disposition — à l’identique de celles présentées en la première
6 Boris Barraud, « Le régime fiscal du livre numérique – Aspects techniques et politiques » (manuscrit de l’auteur, extraits)
partie de cette étude —, ne peut matériellement concerner les « libraires
numériques ».
Au-delà de la grave crise du lectorat affectant la presse, qui ne saurait être
niée, d’aucuns se demandent s’il ne s’agit pas aussi sinon surtout de « répondre aux
revendications d’un secteur d’activités “faiseur d’opinion”, dont les responsables
politiques espèrent, en retour, qu’il se montre conciliant à leur égard »1. À chaque
changement de majorité à l’Assemblée nationale correspondent des mécanismes
nouveaux répondant à des exigences nouvelles, alors que, dans le même temps, nul
n’ose proposer de supprimer les anciens qui, peut-être, ont perdu de leur légitimité.
Il semblerait que le livre, lui, n’ait ni la puissance ni l’influence d’un quatrième (ou
cinquième) pouvoir. Il est trop peu d’ouvrages d’orientation politico-polémique
parmi le total des publications ; là où la loi précise que seule la « presse
d’information politique » a accès aux régimes de soutien. Le secours aux journaux et
magazines peut encore s’expliquer de façon plus noble, en avançant la volonté de
préserver le pluralisme des courants d’opinion — principe que le Conseil
constitutionnel couve paternellement2 — par la prévention d’une concurrence par
trop féroce. Il n’en demeure pas moins certain que le pouvoir politique n’est pas prêt
à entrer en conflit avec des industries médiatiques capables de modeler la psyché
collective.
Par ailleurs, les aides publiques aux éditeurs de presse sont accordées sans
aucun égard quant à la réalité de la contribution à la diffusion de la culture, au débat
démocratique ou à l’information du public. Or ce sont ces objectifs qui, selon le
législateur, justifient leur existence. La quasi-automaticité du soutien, et en premier
lieu de l’octroi des réductions d’impôt, est d’autant plus critiquable que, dans le
même temps, nombre d’œuvres et de documents de qualité pourraient être publiés si
les éditeurs percevaient des contributions publiques substantielles. Seulement, toute
distorsion de concurrence est prohibée ; les entreprises exerçant une activité
identique doivent être traitées également, ce qui oblige à rejeter toute intrusion du
subjectivisme. Il n’en demeure pas moins que réfléchir à la pertinence et à
l’efficacité d’un régime fiscal paraît naturel alors que le peuple consent chaque
année à l’impôt. Les profiteurs rôdent et l’assistanat économique comme la
dépendance aux pouvoirs politiques ne sont jamais sains, tandis que c’est toujours
aux citoyens-contribuables qu’il revient de compenser le manque à gagner induit par
les privilèges fiscaux.
Aborder la question de la TVA ne permet que modérément de nuancer ces
propos puisque, alors que le livre — dont le livre numérique — se voit appliquer un
taux réduit, la presse — mais pas la presse en ligne — se voit appliquer un taux
super-réduit.
1 E. DERIEUX, « Les aides publiques aux médias. Objectifs, effets et réalités », RLDI, n° 61, juin 2010,
p. 72.
2 Déc. n° 82-141 DC du 27 juillet 1982 ; Déc. n° 86-217 DC du 18 sept. 1986 ; Déc. n° 89-271 DC du 11
janv. 1990.
7 Boris Barraud, « Le régime fiscal du livre numérique – Aspects techniques et politiques » (manuscrit de l’auteur, extraits)
B. La tardive extension du taux réduit de TVA au livre numérique
Il n’est plus besoin de démontrer la congruence des politiques publiques
menées en matière de librairie et d’édition de livres1 ; et certainement l’accès au
taux réduit de TVA est-il une pierre angulaire de cet édifice. Le fait que, souvent, ce
sont de parfaites décisions politiques qui se traduisent par les appareils fiscaux
apparaît ici clairement : soit le taux réduit ne profite qu’aux livres imprimés, ce qui
avantage les libraires mais nuit aux éditeurs ; soit le taux réduit est étendu aux livres
numériques, ce qui profite aux éditeurs mais pénalise les libraires. La récente
disparition de la distorsion physique/virtuel est donc une opportunité offerte aux
éditeurs alors même que ce sont les libraires qui appellent en priorité le soutien
public face aux déferlantes technologiques. L’esprit de la loi de 1981 aurait-il
disparu ? Rien n’est moins sûr à l’aune du projet de loi « anti-Amazon » récemment
discuté par les chambres.
La TVA étant un impôt « indirect », ce sont d’abord les consommateurs qui se
trouvent touchés puisque c’est à eux qu’il incombe, en définitive, de le supporter.
Du point de vue des opérateurs économiques, en revanche, la TVA pourrait être
analysée comme neutre dès lors qu’ils perçoivent puis reversent la même somme. En
réalité, le taux de la TVA n’est assurément pas anodin ou secondaire pour des
entreprises dont les ventes sont nécessairement déterminées, pour une part
conséquente, par le prix affiché. L’application d’un taux réduit s’apparente donc à
un régime de soutien, tout autant que les crédits et réductions d’impôt. Et le sujet est
d’autant plus crucial que, à l’instar des pratiques qui existent en matière de
commerce électronique, la concurrence fiscale entre les États s’accentue ô combien
dès lors que l’on passe du monde physique au monde immatériel2.
Initialement, en vertu de l’article 278 bis 6° du CGI, le taux réduit de TVA
concernait uniquement les opérations relatives à des livres imprimés, y compris leur
location. Par la suite, il a été étendu, dans un premier temps, au « livre » audio3,
puis, consécutivement à l’adoption de la directive du 5 mai 20094, à l’ensemble des
livres homothétiques sur support dématérialisé5, à condition – c’est le sens de
« homothétique » – qu’aucune fonction et aucun élément inexistant dans les éditions
papiers ne soit ajouté. Mais le livre numérique au sens strict, i.e. initialement
numérique, demeurait exclu. Aussi le Syndicat national de l’édition ne se privait-il
pas de contester ce traitement fiscal discriminatoire. Après avoir affirmé
1 On pense évidemment en premier lieu à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.
2 S. BARRY, Ch. FORMAGNE, Ph. MARTEL, Les enjeux de l’application du taux réduit de TVA au livre
numérique, rapport au Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et au Ministère du budget,
des comptes publics et de la réforme de l’État, 2011.
3 Rescrit n° 2009/48 (TCA) du 15 sept. 2009.
4 Dir. n° 2009/47/CE du 5 mai 2009 qui étend le bénéfice du taux réduit à la fourniture de livres sur tous
types de supports.
5 Rescrit n° 2009/63 (TCA) du 17 nov. 2009.
8 Boris Barraud, « Le régime fiscal du livre numérique – Aspects techniques et politiques » (manuscrit de l’auteur, extraits)
qu’ « étendre le taux réduit au livre numérique est indispensable au développement
d’une offre légale attractive »1, il avait lancé une pétition
2. En guise de réponse à
cette demande pressante, l’administration fiscale avait laconiquement démontré que
« le téléchargement de livres par fichiers numériques, qui constitue une prestation de
service par voie électronique, demeure soumis au taux normal de la taxe,
conformément au droit communautaire »3. C’est finalement la loi de finances pour
2011 qui a décidé l’application, depuis le 1er
janvier 2012, du taux réduit de TVA au
téléchargement de livres4. Désormais, l’article 278-0 bis 3° A du CGI soumet au
taux réduit les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition, de vente, de
livraison, de commission, de courtage et de location portant sur les livres sur tout
type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.
Cette incorporation du livre numérique dans la sphère du taux réduit paraît
autant relever du bon sens qu’être audacieuse puisque, d’une part, les États membres
de l’Union européenne ne possèdent normalement qu’une marge de manœuvre très
limitée en matière de TVA et, d’autre part, la directive du 28 novembre 20065
prohibe expressément l’application du taux réduit aux fournitures de services par
voie électronique6. De plus, la modification de l’ordre existant peut se comprendre
comme une mesure de dumping fiscal non conforme aux règles de concurrence
européennes. Et puis il est parfaitement paradoxal d’exclure les services de presse en
ligne de l’accès au taux réduit en invoquant le droit communautaire et d’ignorer ce
même droit dès lors qu’il s’agit de livres numériques. Néanmoins, aux côtés du
principe de neutralité technologique, il semble délicat de ne pas convenir que, papier
ou numérique, un ouvrage demeure constamment un seul et même objet – un bien
culturel plus qu’un service –. Si, parmi les arts, le fond ne prime pas forcément sur
la forme, il en va bien ainsi en littérature ; et un consommateur a nécessairement le
sentiment que, quel que soit le support, il acquiert un contenu, l’œuvre littéraire
n’étant que contenu. Quelles que soient leurs éditions, Le neveu de Rameau sera
toujours Le neveu de Rameau et Le Cid sera toujours Le Cid.
1 Syndicat national du livre, « Le livre numérique : idées reçues et propositions », 17 mars 2009.
2 Dans cette pétition, est expliqué, en particulier, que la clé du développement de ce marché de l’immatériel
est le prix de vente. Celui-ci doit être attractif et permettre au lecteur de profiter des économies réalisées à
travers le passage au support numérique. Et le syndicat d’invoquer « l’intérêt général qui préconise de
favoriser la circulation et l’accès aux œuvres de l’esprit ». Syndicat national de l’édition, « Pétition en
faveur d’une TVA à taux réduit sur le livre numérique », nov. 2009.
3 Réponse de l’administration fiscale du 17 nov. 2009. Citée par E. DERIEUX, « Le livre à l’ère numérique.
Questions juridiques sans réponse », précité, p. 96.
4 Loi n° 2010-1657 du 29 déc. 2010 de finances pour 2011, art. 25.
5 Dir. n° 2006/112/CE du 28 nov. 2006, dite « TVA », art. 56 et art. 98.2.
6 Un règlement communautaire du 17 oct. 2005 précisait même que les contenus numérisés de livres, les
publications électroniques, les journaux ou périodiques en ligne, ainsi que la consultation ou le
téléchargement de musique ou de films sur ordinateurs ou téléphones mobiles étaient exclus de
l’applicabilité du taux réduit.
9 Boris Barraud, « Le régime fiscal du livre numérique – Aspects techniques et politiques » (manuscrit de l’auteur, extraits)
Par ailleurs — et enfin —, que le taux réduit de TVA s’applique au livre ne
saurait en aucune façon compenser le déséquilibre, en termes de soutien public,
existant avec le secteur de la presse écrite. Bien au contraire, ce dernier est ici
encore privilégié puisqu’il se voit offert, suivant les dispositions de l’article 298
septies du CGI, non pas un taux réduit mais un taux super-réduit à 2,1 %. Où se
trouve confirmé combien les pouvoirs publics ont davantage d’égards en direction
des journalistes, « faiseurs d’opinion », que des écrivains, « faiseurs de rêve ». Il
existe assurément d’autres pans de l’économie nationale qui aspirent à quelques
bouffées d’oxygène fiscale. Seulement ceux-là ne sont pas capables de modeler les
idées populaires à leur guise et, partant, d’attirer pareille sollicitude.
*
* *
À l’heure où tout converge vers le Web et vers le numérique, l’application
d’un même taux de TVA à tous les livres — tandis que, auparavant, l’effet d’aubaine
lié au moindre coût de production était amorti par la différence de traitement fiscal
entre les supports —, contribue à agrandir la part de marché des publications
numériques ; cette dernière demeurant, étonnamment, assez marginale, notamment
en comparaison de ce qu’elle est déjà aux États-Unis. Certainement des explications
culturelles sont-elles à apporter pour justifier cet attachement très français au papier.
Reste que la présente étude témoigne du maigre encouragement de la part des
pouvoirs publics à l’édition de livres, lequel trouve sans doute son origine avant tout
autre chose dans le fait que ce secteur évolue au sein d’un contexte économique qui
interdit de le plaindre. Toutefois, il demeure tentant de s’interroger dès lors que les
mêmes pouvoir publics font en revanche montre d’une totale complaisance à l’égard
du milieu de la presse écrite, reconduisant quasi-automatiquement les aides – sortes
d’ « avantages acquis » –, peu important qu’elles aient été édictées afin de répondre
à des besoins temporaires.
Le politique demeure donc en retrait, n’osant s’aventurer en ces contrées
hostiles. L’observateur extérieur, lui, n’a nulle raison de ne pas dénoncer et de ne
pas proposer, peu important que dans toute « niche fiscale » il y a un chien qui
aboie. Mais il doit prendre garde ; car un danger plane sur les hommes de doctrine et
sur les commentateurs en général : celui de ne pas se maintenir les deux pieds à
l’extérieur de la pratique, d’acquérir, d’une façon ou d’une autre, des intérêts qui
conduisent à délaisser les pourtant nécessaires objectivité et neutralité. Dès lors
qu’un Professeur est aussi avocat, qu’il lui appartient de déstructurer ou remodeler le
droit à l’avantage de ses clients — sans se soucier du fait qu’ils aient aux yeux de la
droite Justice tort ou raison —, alors il est probable que son indépendance d’esprit
10 Boris Barraud, « Le régime fiscal du livre numérique – Aspects techniques et politiques » (manuscrit de l’auteur, extraits)
est en péril1. Cette menace avait été conjurée à Rome par la stricte séparation entre
les fonctions d’avocat et de jurisconsulte, toutes ne pouvant être réunies en de
mêmes mains. Pratiquer subjectivement ou réfléchir objectivement, il fallait choisir.
Pourtant, actuellement, d’aucuns s’inquiètent « de l’inflation des consultations
données par des professeurs des universités qui risque de conduire à
l’asservissement de la doctrine »2. En 1981, un Professeur-avocat mettait en lumière
les dangers contenus dans cette tendance à la confusion de la théorie désintéressée
avec la pratique intéressée ; si elle venait à se confirmer, écrivait-il, elle aboutirait à
une « vraie prostitution de la pensée juridique » et au « mépris de la doctrine »3.
Il n’est pas inutile, ici, d’en revenir à Kelsen, Hart et Bobbio pour rappeler
qu’il ne relève guère de l’office du juriste positiviste d’apposer un regard critique
sur l’œuvre et les choix politico-législatifs ; son rôle doit se borner à les comprendre
pour les expliquer. Mais le juriste positiviste peut parfaitement, de temps à autre,
tomber le masque kelsénien. Il s’en recoiffera avec hâte une fois la parenthèse
refermée.
(Papier ou numérique, sur la forme comme sur le fond, un livre est supérieur
en tout point qualitatif à un périodique qui, alors que le premier est écrit patiemment
à mesure des fulgurances et de l’inspiration, doit paraître même lorsqu’il n’a rien à
dire. Mais, dans le même temps, si un livre vaut mieux qu’un journal, un journal
vaut mieux qu’un programme télévisé. Or il semble que tous les éditeurs soient
menacés par un mal qui dépasse largement la révolution numérique — laquelle est
bel-et-bien une chance pour tout ce qui relève du culturel, sans exception4 — : la
baisse du lectorat. 55 % des français préfèrent regarder la télévision plutôt que lire,
cette proportion atteignant 70 % des 18-34 ans5. Tous dans le même bateau, hélas ;
et technique et politique fiscales sont bien impuissantes face à de tels mouvements
de décitoyennisation de la société. La parenthèse peut, avec hâte, être refermée.)
1 O. BEAUD, « Doctrine », in D. ALLAND, S. RIALS, dir., Dictionnaire de la culture juridique, Puf,
coll. Quadrige, p. 387.
2 Ibid.
3 J.-D. BREDIN, « Remarques sur la doctrine », in Mélanges Pierre Hébraud, Dalloz, 1981, p. 111.
4 M. TESSIER, Rapport sur la numérisation du patrimoine écrit, rapport au Ministère de la culture et de la
communication, 2010.
5 Sondage 20 minutes-BVA, publié le 21 mars 2013.