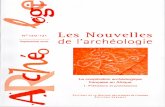Variabilité spatiale de la productivité aquifère du socle sahélien en hydraulique rurale
Transcript of Variabilité spatiale de la productivité aquifère du socle sahélien en hydraulique rurale
Hard Rock HydroSystems (Proceedings of Rabat Symposium S2, May 1997). IAHSPubl.no. 241, 1997
Variabilité spatiale de la productivité aquifère du socle sahélien en hydraulique rurale
PHILIPPE GOMBERT Projet RESO, 01 BP 806, Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso
Résumé Malgré de modestes besoins en eau et un effort de prospection important, la productivité des forages d'hydraulique rurale en zone sahélienne est difficilement prévisible: dans les aquifères discontinus du socle, les taux d'échecs dépassent localement 50%. A chaque échelle de travail, on peut définir des paramètres corrélés à la productivité. Certains sont rarement pris en compte dans les critères d'implantation qui sont trop souvent axés sur les investigations géophysiques. Un effort reste à faire dans la précision, à l'échelle métrique, de l'implantation des forages.
INTRODUCTION
On appelle ici "productivité" la capacité d'un aquifère à fournir, par le biais d'un captage, un débit minimal susceptible d'être exploité. Dans le cas des projets d'hydraulique rurale, les débits recherchés sont généralement inférieurs à 1 m3/h. Malgré un effort de prospection important, les taux d'échecs des forages peuvent dépasser 50% dans les aquifères discontinus du socle, lequel couvre près de 62% de l'Afrique centrale et orientale (Diagana, 1990). Le Tableau 1 résume les principaux paramètres corrélés à la productivité en fonction de l'échelle de travail. Dans le présent document, la notion de signification statistique s'entend au seuil de confiance de 0.05.
ECHELLE CONTINENTALE
A cette échelle de 105m correspondent les grandes zonations climatiques du Sahel, considéré comme la bordure subsaharienne située entre les isohyètes 100 et 1000 mm et caractérisée par un régime pluviométrique unimodal. L'intensité et la fréquence de l'unique saison pluvieuse vont en décroissant vers le Nord, ce qui conditionne l'importance de la recharge des aquifères et influe indirectement sur le taux de succès moyen des forages (Tableau 2).
ECHELLE REGIONALE
A cette échelle de 104 m correspondent les grandes structures pétrographiques homogènes du socle (batholites granitiques, zones métamorphisées, épanchements volcaniques) ainsi que les mégalinéaments structuraux. C'est le domaine de prédilection de la télédétection.
114 Philippe Gombert
Tableau 1 Paramètres influant sur la productivité des forages selon l'échelle de travail.
Echelle
Continentale Régionale Microrégionale Locale Ponctuelle
Dimension
105m 10" m 103m 102m 10° m
Paramètre
Climat Géologie Géomorphologie Anomalies géophysiques Venues d'eau
Méthodologie d'étude
Climatologie Télédétection, pétrographie Photo-interprétation Géophysique Diagraphie
Tableau 2 Taux de succès des forages en fonction de la pluviosité.
Pays
Ghana, Côte-dTvoire Tchad, Mali, Niger, Burkina Faso
Tchad, Mauritanie
Pluviosité
1000-2000 400-1000
100-400
Taux de succès
83% 55%
40%
Effectif
1624 1314
657
Références
Engalenc (1978) Gombert (1990), Diagana (1990), Pointet (1989a), Omo (1990) Gombert (1990), Omo (1990)
Tableau 3 Taux de succès moyen en fonction de la pétrographie du socle (d'après CIEH, 1984).
Faciès Taux de succès moyen Classe
Grès pur, grès argileux > 80% Grès calcaire, calcaire, schiste, pélite, 65-80% granite Roche métamorphique et volcanique, < 65% quartzite, dolérite
très favorable favorable
peu favorable
Tableau 4 Taux de succès des différents types de granitoïdes au Tchad (d'après Gombert, 1988).
Granitoïde
Granite alcalin, leucogranite Granite, monzogranite Granodiorite, diorite quartzique
Taux de succès Effectif
56% 25 41% 73 13% 15
Pétrographie
La nature pétrographique du socle joue un grand rôle dans la productivité (Tableau 3). Pour les roches cristallines, le terme "granite" est généralement employé dans un sens abusif et Gombert (1988b, 1990) a montré qu'une distinction plus fine entre pôles acide et calcosodique permettait de discriminer leur comportement hydrogéologique (Tableau 4).
Etude structurale
En Côte-dTvoire, Savane et al. (1995) ont examiné 13 000 km2 d'images Landsat TM: malgré une répartition équitable du nombre de forages implantés sur chaque direction structurale, ils mettent en évidence une discrimination dans la productivité du socle (Tableau 5). Dans une région contiguë à la précédente, située à 200 km au
Variabilité spatiale de la productivité aquifère du socle sahélien en hydraulique rurale 115
Tableau 5 Fréquence directionnelle des linéaments et des débits élevés en Côte-d'Ivoire.
Référence
Savane et al. (1995) Biémi et al. (1995)
N-S
3% 25%
NE-SW
30% 0%
E-W
32% 12%
NW-SE
35% 63%
Effectif
134 103
nord-ouest, Biémi et al. (1995) montrent un phénomène similaire sur 12 500 km2: cependant, les débits élevés sont ici prédominants dans la direction NW-SE, tandis que la direction E-W n'apparaît pas productive, ce qui montre bien l'hétérogénéité de comportement du socle à cette échelle de travail.
Au Soudan, Bérard et al. (1990) ont réalisé une étude structurale à partir des photos Landsat TM: il s'agissait d'extraire 18 sites à explorer sur une zone de 4000 km2 de granitoïdes et de métavolcanites. En tenant préférentiellement compte d'une contrainte tectonique en distension orientée NW-SE, le taux de succès atteignit 42% dans cette zone semi-aride (Gombert, 1989).
Approche fractale
Le caractère fractal d'une roche fragmentée est évoqué par Turcotte (1992) qui remarque que la dimension Dfàu réseau de discontinuités est souvent voisine de 2.5 quelle que soit la roche considérée. Il pose l'hypothèse d'un modèle unique de fragmentation: partant d'un cube de coté r, on le divise en huit cubes de coté r/2 dont seulement six seront à nouveau divisés dans le rapport Vi à l'itération suivante (Fig. 1). La dimension fractale de ce cube fragmenté à l'infini vaut 2.59 alors que celle du réseau de discontinuités apparaissant sur chacune des faces vaut 1.59.
On peut comparer cette dimension fractale à celle d'un réseau de linéaments: au Tchad, Gombert (1993) montre que les linéaments repérés sur 100 000 km2 dessinent
..
Fig. 1 Modèle fractal de fracturation à la 4e itération (d'après Turcotte, 1992).
116 Philippe Gombert
une fractale de dimension 1.57 dont les caractéristiques peuvent être représentées par le modèle de fragmentation décrit plus haut. Au stade représenté sur la Fig. 1, 44% de la superficie du carré initial est fragmentée, valeur identique au taux de succès moyen obtenu ici sur 550 forages. D'après ce modèle, moins de la moitié d'un territoire de roches dures pourrait être fracturée — donc aquifère — en réponse à une sollicitation tectonique. Bien que le pourcentage de vides soit déterministe, leur répartition est aléatoire, ce qui peut expliquer l'existence de zones d'échec au sein de secteurs aquifères: ainsi, 80 villages ont été abandonnés après 160 forages négatifs alors que le taux de succès a atteint 71% dans les 183 villages où la demande en eau a été satisfaite. On remarque que ce taux de succès se rapproche singulièrement de celui obtenu en Afrique de l'Ouest: tout se passe comme si l'absence intrinsèque de fractures du socle, résultant de son assimilation à une fractale, pouvait localement être compensée par la présence d'eau dans un autre aquifère (altérites).
ECHELLE MICROREGIONALE
Il s'agit de l'échelle kilométrique principalement étudiée à l'aide de la photographie aérienne. Les documents fournis sont essentiellement d'ordre géomorphologique et tectonique.
Géomorphologie
Pour Savane et al. (1995), la position topographique d'un forage en Côte-d'Ivoire joue faiblement, mais significativement, sur sa productivité avec un avantage aux forages situés à mi-pente (Tableau 6). Au Tchad, Joseph (1990) montre que le massif granitique est plus productif que le piémont avec des taux de succès respectifs de 32% et 4%.
Analyse multicritère
Toujours au Tchad, Gombert (1990) a étudié la productivité du socle dans 124 forages répartis sur 6500 km2 avec un taux de succès moyen de 40%. Les
Tableau 6 Taux de succès des forages selon leur position topographique (in Savane et al., 1995).
Débit Bas fond Interfluve Mi-pente Effectif _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
>0.5m3h-' 27% 14% 58% 113
Tableau 7 Taux de succès par classe de productivité au Tchad (in Gombert, 1988).
Paramètre Productivité nulle Productivité faible Productivité moyenne
Codage (M 2 3 « Taux de succès 5% 36% 54% Effectif de forages 20 53 48
Variabilité spatiale de la productivité aquifère du socle sahélien en hydraulique rurale 117
village
productivité nulle
| | productivité faible
llllllll productivité moyenne
N
î 10 km
Fig. 2 Zonation de la productivité dans le socle fissuré du Tchad (in Gombert, 1992).
paramètres utilisés sont: l'altitude du village, la pluviosité trentenaire moyenne, l'indice pétrographique qui traduit le degré de basicité du granitoïde (depuis un leucogranite jusqu'à une granodiorite) et l'intensité de fracturation, mesurée in situ dans un cercle de 20 m de diamètre, exprimée en "unité de fracture" (uf). Le traitement statistique choisi consiste à "seuiller" chaque paramètre par rapport à sa moyenne, de manière à ce qu'il ne prenne que la valeur 0 ou 1. La discrimination est maximale lorsqu'on somme, pour chaque forage, les valeurs obtenues et qu'on les regroupe en classes de productivité (Tableau 7). Le report cartographique des résultats met en évidence un comportement hétérogène du socle avec l'existence de secteurs non ou peu productifs au sein de zones globalement aquifères (Fig. 2). Ceci est à mettre en rapport avec l'hypothèse d'une distribution fractale de l'eau souterraine en roche dure fissurée (voir chapitre précédent).
ECHELLE LOCALE
Cette échelle de travail est la première à aborder directement le terrain: c'est le domaine de prédilection des techniques géophysiques dont les investigations s'étendent généralement sur 102 à 103 m. En théorie, il s'agit de mettre en évidence certaines caractéristiques physiques du sous-sol qui seraient directement ou indirectement liées à la présence d'eau souterraine.
Méthodologies d'investigation
Les techniques géophysiques employées en hydrogéologie ont été développées pour la recherche de cibles géologiques variées: amas métalliques conducteurs (VLF) ou ferromagnétiques (magnétométrie), minerais uranifères (radon), recherche de corps
118 Philippe Gombert
conducteurs (géorésistivité, électromagnétométrie, magnétotellurique), contraste de densité (gravimétrie) ou de propriétés élastiques (sismique). La grande majorité des investigations géophysiques porte sur la mesure des variations de résistivité dans le proche sous-sol, technique bien adaptée au repérage d'anomalies conductrices, larges et peu profondes. Or, en roche dure et non poreuse, l'on s'accorde à penser que l'eau ne peut circuler et être emmagasinée qu'au sein de discontinuités d'ouverture centimétrique à métrique dont la signature géophysique est discutable: diaclases, failles, zones tectonisées, contacts lithologiques... La question se pose légitimement de savoir si ces méthodes géophysiques sont aptes à caractériser la présence d'eau en roche dure fissurée.
Zone soudanienne
La zone soudanienne est la bordure méridionale de la zone sahélienne s. I., au delà de l'isohyète 800 mm. En Afrique de l'Ouest, le taux de succès en forage a pu être corrélé avec l'importance des anomalies géoélectriques (Bernardi et al., 1988), sismiques (Bro, 1989) ou radométriques (Pointet, 1989b). Le CIEH (1984) a également montré une différence modérée mais significative sur 2 069 forages avec un taux de succès qui passe de 57.6% à 60.6% avec l'emploi de la géophysique. Dans une zone où le débit moyen des forages productifs est de 1.4 m3 h"1, Pointet (1989b) obtient un débit moyen de 4.0 m3 h4 sur 28 forages implantés par prospection radon. Cependant, les relations entre l'épaisseur d'altération et le débit des forages montrent que les anomalies repérées n'intéressent que les altérites, lesquelles sont aquifères lorsqu'elles sont perméables et saturées, ce qui ne peut être le cas qu'en climat humide (CEFIGRE, 1990).
Zone sahélienne
Sous le climat plus aride de l'Afrique centrale, les altérites sont dénoyées et l'eau souterraine se réfugie dans les fractures du socle: les anomalies géophysiques détectées ne signent plus la présence d'eau et, dans la littérature, on ne trouve aucun résultat probant de relations entre paramètres géophysiques et hydrogéologiques. Ainsi, au Tchad, l'analyse de 146 sites de forages implantés par deux méthodes géoélectriques combinées ne montre aucune différence significative entre les sites implantés sur des anomalies fortes ou faibles. Au Burkina Faso, Ouédraogo (1988) note que la résistivité des terrains n'est pas en relation avec la présence d'eau souterraine et que l'épaisseur d'altérites devient défavorable lorsqu'elle est trop importante. Au Tchad, Gombert (1988a) ne trouve aucune corrélation entre le débit de 80 forages et 10 paramètres d'anomalies VLF, ni entre le débit en fin de foration et l'épaisseur d'altérites (Gombert, 1988b). Sur 53 autres forages implantés par carré croisé, par traîné de résistivité et par sondage électrique, l'analyse en composante principales de 22 paramètres géophysiques mesurés ne fournit aucune corrélation significative avec le débit (Gombert, 1992a).
Variabilité spatiale de la productivité aquifère du socle sahélien en hydraulique rurale 119
Thèmes de recherche
A ce jour, aucune méthode géophysique ne permet de déceler directement la présence d'eau souterraine dans le socle fissuré. Les résultats des forages traduisent simplement la dichotomie entre zones humides, où l'eau est relativement aisée à trouver en subsurface, et zones arides où elle se réfugie en profondeur dans le socle anisotrope: les taux de réussite voisins de 50% devraient inciter plus d'un géophysicien à la prudence, si ce n'est au doute! Il conviendrait dans un premier temps, de tenter de relier certains des paramètres géologiques impliqués dans la productivité du socle (voir chapitres 3 et 5) à leur éventuelle signature géophysique, notamment dans les zones les plus arides. D'autre part, un effort de recherche considérable reste à faire pour mettre au point une véritable technique d'investigation géophysique basée sur la spécificité de la présence d'eau souterraine, et non dérivée de la recherche d'autres cibles géologiques. A cette échelle de travail, on ne dispose donc toujours pas d'une méthodologie d'investigation fiable.
ECHELLE LOCALE
L'échelle locale concerne ici l'environnement immédiat d'un forage. Sur le plan hydrodynamique, on peut l'assimiler à la zone circonscrite par le rayon d'influence ce qui correspondrait, sur le plan physique, à la zone où les discontinuités aquifères sont interconnectées. Parmi les méthodes d'investigation disponibles se trouvent les diagraphies directes et différées ainsi que l'interprétation des tests de pompage. Nous ne parlerons que des premières.
La recherche d'eau étant axée sur les discontinuités de la roche, une attention particulière est à apporter aux paramètres pouvant traduire, lors du suivi du forage, l'existence d'une fracturation à l'échelle métrique. Ainsi, au Tchad, huit paramètres ont été mesurés mètre par mètre en cours de foration (Gombert, 1992b): épaisseurs de recouvrement (Rec), d'altérites (Alt) et de socle sain traversé (Soc), nature pétrographique du socle (Nps), vitesse d'avancement dans les altérites (Vaa) et dans le socle sain (Vas), nombre de venues d'eau (Nve) et profondeur de la première venue d'eau (Pve). Une analyse en composantes principales des résultats de 124 forages a permis de définir que l'axe 1 représente le socle sain, tandis que l'axe 2 oppose les deux types de formations sous-jacentes ou leurs caractéristiques (Fig. 3). Les variables traduisant la présence d'eau (Pve et Nve) sont préférentiellement corrélées avec l'axe 1, ce qui corrobore l'idée que la productivité des forages est essentiellement liée aux caractéristiques du socle non altéré. Ainsi, 96% des forages à fort débit présentent une abscisse positive sur le plan factoriel 1-2, alors que 82% des forages secs ont une abscisse négative, les forages à faible débit étant intermédiaires.
Par régression linéaire multiple, on met en évidence une corrélation significative entre la productivité en fin de foration (X) et les paramètres représentatifs du socle non altéré et de l'existence d'eau. On peut traduire cela en "équation de productivité" qui permet de classer les forages productifs et improductifs avec une marge d'erreur de 10%:
120 Philippe Gombert
a) dans l'espace des 8 paramètres
Axe 2 (19%)
Axe / (27%)
b) dans l'espace des 124 forages
Axe / (19%) Q = 0 tni/h
<» l>Q>0mS/h
O Q > 1 mi/h
les enveloppes renferment 90% de chaque famille de forages
ixe2(27%)
Fig. 3 Analyse en composantes principales de données de forages (in Gombert, 1992).
X = 141 - 8.90-Soc + 132- Nve - 6.39- Pve + 7.89-Vas
Des travaux sont en cours pour vérifier sa validité en cours de foration: l'on pourrait alors estimer les chances de succès d'un forage en temps réel et définir une profondeur limite d'investigation en assimilant celle-ci à Pve et en posant X = 0 pour une vitesse d'avancement supposée constante. Ce cette manière, au Tchad, Gombert (1993) a montré que 58% des forages ont ainsi été surcreusés de 27 m sans aucune amélioration de leur productivité. A l'échelle du projet, 1800 m de foration ont ainsi été inutilement réalisés, soit l'équivalent de 30 forages.
Ouédraogo (1988) a étudié 11 paramètres de forages en analyse en composantes principales et mis en évidence des indicateurs de productivité: si aucune venue d'eau n'est recoupée à une profondeur donnée, variable d'un forage à l'autre, la probabilité est forte pour que le forage soit sec. Il montre également un surcreusement inutile de 21 m des forages négatifs.
Enfin, il faut mentionner le problème de la localisation exacte du site de forage:
Variabilité spatiale de la productivité aquifère du socle sahélien en hydraulique rurale 121
de nombreuses fractures ne sont pas subverticales et le site de forage doit donc être décalé afin de recouper la cible visée en dessous du niveau statique. D'autre part, pour obtenir le drainage le plus efficace au sein d'un milieu rocheux à perméabilité anisotrope, Colas (1993) propose de déduire l'inclinaison du forage de l'ellipsoïde des perméabilités.
CONCLUSION
Les cibles hydrogéologiques sont généralement individualisées et sélectionnées à l'échelle hectométrique ou décamétrique: dans le socle, il s'agit de zones fracturées — ou supposées telles — correspondant à des photolinéaments ou superposées à des anomalies géophysiques. A chaque échelle de travail, on peut mettre en évidence des paramètres statistiquement corrélés à la productivité du socle: ces paramètres diffèrent d'une échelle à l'autre alors que la productivité n'est toujours due qu'à la fracturation ouverte des terrains. Il reste donc à réaliser un effort important de synthèse bibliographique et de réflexion en intégrant les dizaines de milliers de données de forages actuellement disponibles. On note par ailleurs que les taux de succès des projets sont très sensibles à l'état de saturation des altérites: alors que plus des trois quarts des forages sont productifs en Afrique de l'Ouest, aucune méthodologie de recherche ne semble en mesure de fournir un taux de succès supérieur à 50% en zone aride où la géophysique atteint là ses limites actuelles. Enfin, il existe une lacune dans la connaissance de l'environnement immédiat d'un site de forage: aucun élément fiable ne permet à l'heure actuelle d'implanter un forage au mètre près, en tenant compte notamment du pendage de la cible hydrogéologique.
REFERENCES
Biémi, J., Jourda, J. P., Deslandes, S. & Gwyn, H. (1995) Positionnement, productivité et gestion des forages en milieu fissuré de Côte-d'Ivoire par télédétection et système d'information géographique. In: Coll. Application de la Télédétection (Montpellier, 1995), 111-120.
Bérard, P., Castaing, C. & Scanvic, J. Y. (1990) Alimentation en eau de la mine d'or d'Hassaï (Soudan): impact de l'étude de télédétection. Hydrogéologie, 1990, no. 2, 101-111.
Bernardi, A., Detay, M. & Machard de Grammont, H. (1988) Recherche d'eau dans le socle africain. Corrélation entre les paramètres géoélectriques et les caractéristiques hydrodynamiques des forages en zone de socle. Hydrogéologie 4, 245-253.
Bro, M. (1989) Utilisation de la méthode sismique réfraction en recherche hydrogéologique sur le socle. Bull. CIEH 74-75, janvier 1989, 3-22.
CEFIGRE (1990) L'hydrogéologie de l'Afrique de l'Ouest. Minist. de la Coop, et du Dév., Collect. Maîtrise de l'Eau, Paris, T édn.
CIEH (1984) Synthèse des Connaissances sur VHydrogéologie du Socle Cristallin et du Sêdimentaire Ancien de l'Afrique de l'Ouest. Doc. CIEH-CEFIGRE.
Colas (1993) Fracture porosity and permeability on cores. 2' Journées Tunisiennes de Géol. Appl. (ENIS, Sfax, 17-19 mai 1993), 578-580.
Engalenc, M. (1978) Méthode d'Etude et de Recherche de l'Eau Souterraine des Roches Cristallines de l'Afrique de l'Ouest. GEOHYDRAULIQUE-LCHF, Maisons-Alfort.
Diagana, B. (1990) Expériences du CIEH. Séminaire sur l'Optimisation des Méthodes de Recherche et d'Exploitation des Eaux Souterraines dans les Régions de Socle Sahélien à Faible Pluviosité (PNUD, N'Djaména, avril 1990).
Gombert, P. (1988a) Premiers résultats statistiques sur la prospection par VLF au Ouaddaï. PNUD-DTCD, Projet CHD/85/004, Rapport 05/HYDROGEO/88, avril 1988.
Gombert, P. (1988b) Synthèse des connaissances acquises par le projet CHD/85/004 sur l'hydrogéologie du Ouaddaï (République du Tchad). PNUD-DTCD, Projet CHD/85/004, Rapport 13/HYDROGEO/88, septembre 1988.
122 Philippe Gombert
Gombert, P. (1989) Alimentation en eau des mines d'Hassaï et d'Adal Aweteb (Soudan). Rapport GéFrance 8913, BRGM 3E, Orléans, France, août 1989/
Gombert, P. (1990) Analyse des facteurs de productivité des sondages et optimisation de la profondeur d'investigation dans la préfecture du Ouaddaï (Tchad). Séminaire sur l'Optimisation des Méthodes de Recherche et d'Exploitation des Eaux Souterraines dans les Régions de Socle Sahélien à Faible Pluviosité (PNUD, N'Djamena, avril 1990).
Gombert, P. (1992a) Bilan des prospections géophysiques dans la préfecture du Salamat (République du Tchad). BRGM-GEOFRANCE, Rapport R72/GF72/HV, avril 1992.
Gombert, P. (1992b) Eléments d'appréciation de la présence d'eau souterraine dans le socle de la bordure orientale tchadienne. Actes du Coll. int. sur l'hydrogéol. des mil. discontinus sous climat aride. Rev. de la Fac. des Sci., Sect. Sci. de la Terre, no. spécial, Marrakech, avril 1992, 123-126.
Gombert, P. (1993) Analyse fractale et multifactorielle du socle sahélien en bordure de la cuvette tchadienne. 2e
Journées Tunisiennes de Géol. Appl. (ENIS, Sfax, 17-19 mai 1993), 11-19. Joseph, G. (1990) Ouaddaï: l'expérience des années 1970. Sém. sur l'Optimisation des Méthodes de Recherche et
d'Exploitation des Eaux Souterraines dans les Régions de Socle Sahélien à Faible Pluviosité (PNUD, N'Djaména, avril 1990).
Omo, H. (1990) Synthèse des connaissances hydrogéologiques sur les formations cristallines de la Mauritanie. Sém. sur l'Optimisation des Méthodes de Recherche et d'Exploitation des Eaux Souterraines dans les Régions de Socle Sahélien à Faible Pluviosité (PNUD, N'Djaména, avril 1990).
Ouédraogo, B. (1988) Productivité des forages sur socle cristallin et cristallophyllien en région subsahélienne. Thèse de Doct., Univ. du Maine, Lab. Géol., Le Mans, 20 avril 1988.
Pointet, T. (1989a) Applications de la télédétection à la prospection hydrogéologique en zone aride. BRGM, Note Tech. 89 EEE 24, avril 1989.
Pointet, T. (1989b) Exploration of fractured zones by radon determination in the soil. Int. Workshop on Appropriate Methodologies for Development and Management of Groundwater Resources in Developing Countries (Hyderabad, India, March 1989), 37-46.
Savane, I., Goze, B. B. & Gwyn, H. Q. (1995) Evaluation des ressources en eau dans le socle par l'étude des fractures à l'aide des données Landsat dans le bassin d'Odienné. Atelier International sur la Télédétection et la Gestion des Ressources en Eau (CEMAGREF/ENGREF/ORSTOM, Montpellier, décembre 1995), recueil prov. de coram.
Turcotte, C. (1992) Fractals and Chaos in Geology and Geophysics. Cambridge Univ. Press, UK.