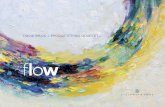Une analyse de Violin and String Quartet de Morton Feldman
Transcript of Une analyse de Violin and String Quartet de Morton Feldman
! !
UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE - UFR de Musicologie CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE REIMS - classe de composition
Une analyse de
Violin and String Quartet
de Morton Feldman
Jean-Baptiste MASSON, MA
2015
Table des matières
Introduction 3 I. Un examen du matériau : les motifs 4 I.1. Les motifs 4 I.2. Les motifs du violon solo 4 II. La forme 5 III. Le langage musical de Feldman dans Violin and String Quartet :
la composition par motifs 17 III.1. La composition par motifs : la permutation 17 III.2. La composition par motifs : la rétrogradation 18 III.3. La composition par motifs : le déphasage 19 III.4. La composition par motifs : le silence 19 III.5. Battements et tempérament non-égal 20 III.6. La composition visuelle 21 III.7. La composition par système et par page 22 III.8. Feldman, sur sa méthode de composition par motifs 22 IV.L’inspiration des tapis orientaux : tisser le temps 23 IV.1. La production du différent à partir du même 23 IV.2. Le tissage du temps 26 V. Les aspects perceptifs de la réception de la musique de Feldman
28 V.1. Une concentration sur le son 28 V.2. Une absence de repères : le déphasage et la métrique comme brouillage perceptif 29 V.3. L’écoute et la mémoire dans la musique de Feldman 29 V.4. Temps et forme 31 V.5. Construction dramatique et narrativité dans Violin and String Quartet 33 Conclusion 37 Bibliographie 38
Introduction
Violin and String Quartet a été composée en 1985 et fait partie de la dernière période créatrice de Morton Feldman (1926-1987). Celle-ci s’ouvre en 1979 et se caractérise par une durée s’allongeant considérablement. Le premier Quatuor à cordes (1979) dure 1h40, le deuxième, en 1983, dépasse les 5h. For Philip Guston (1984), pour flûte, piano et per-cussions, atteint les 4h. Violin and String Quartet dépasse les 2h.
Le langage de Feldman est très caractéristique : une temporalité très étirée, des nuances infimes flirtant avec le silence, un matériau très restreint, des harmonies à base de cluster de secondes, septièmes et neuvièmes.
Ces caractéristiques, jointes à la longueur extrêmes des pièces posent un certain nombre de questions. Au niveau de l’organisation formelle tout d’abord : comment Feld-man procède t-il pour faire tenir la musique sur une telle durée ? Quelles sont les stratégies mises en place pour organiser la pièce ? Des questions se posent aussi au niveau de la ré-ception de ces œuvres : comment écoute t-on une pièce d’un seul tenant d’une telle durée ?
Cinq points seront abordés pour apporter des éléments de réponse : • un examen du matériau : les motifs ; • la forme ; • le langage musical de Feldman dans Violin and String Quartet : la méthode de
composition par motifs ; • temps et narrativité musicale dans Violin and String Quartet ; • les aspects perceptifs de la réception de la musique de Feldman.
La partition a est éditée par Universal Edition, à Londres, en 1985, sous la référence UE 17 968. C’est cette édition dont nous nous sommes servis pour l’analyse.
L’enregistrement qui nous sert de référence est celui de Peter Rundel avec le Pellegrini Quartet, paru chez HatHut Records en 2002. 1
RUNDEL Peter & PELLEGRINI QUARTET, Violin and String Quartet, disque compact HatHut Records, 1
hat[now]ART 2-137, 2002
I. UN EXAMEN DU MATÉRIAU : LES MOTIFS
I.1. Les motifs La composition de la pièce suit une unique méthode : à chaque mesure est associé un
contenu spécifique. C’est celui-ci que nous nommerons motif. Typiquement, il s’agira d’un accord du quatuor, auquel participe ou non le violon solo. Quand ce dernier ne participe pas à l’accord, il développe son propre motif par dessus, toujours à l’échelle de la mesure. Celles-ci sont donc très respectées, et ce n’est qu’au cours de sections précises qu’une note est tenue par-delà la barre de mesure.
Il n’y aucune modification du motif à l’intérieur de la mesure. La croche est l’unité de base pour la construction et la variation des motifs. Le silence est utilisé comme motif à part entière. Il est possible de ramener la pièce à 10 motifs principaux (Fig.2, légende). Leur suc-
cession met à jour une organisation formelle (Fig.2).
I.2. Les motifs du violon solo Outre le balancement de neuvième sol-la ou septième la-sol qui occupe une grande
partie de la pièce, le violon solo possède un motif jouant un rôle particulier, véritable mar-queur du développement de la pièce. C’est un motif en double dièse et double bémol au-tour du sol 6 (Fig.1). Il est le seul endroit de la pièce où semble exposé un fragment de mé-lodie, et sert de marqueur de début ou fin de section à plusieurs reprises. C’est également lui qui clôt la pièce.
Le balancement sol-la servira aussi de motif principal pour plusieurs sections de la pièce.
! Fig.1 : motif C, marqueur formel de Violin and String Quartet (mesure 76, violon solo).
II. LA FORME
L’examen de l’évolution des motifs, mis en regard avec ceux mettant en évidence l’ex-pression de la durée - métrique et présence/absence de reprise - permet de mettre à jour une progression construite (Fig.2). Nous pouvons distinguer une introduction suivie de 9 sections. Nous constatons un certain équilibre entre les longueurs des différentes sections : 81 mesures pour l’introduction, 189 pour la section I, 270 pour la section II, 108 pour la section III, 162 pour la section IV, 108 pour la section V, 108 pour la section VI, 27 pour la section VII, 135 pour la section VIII, 270 pour la section IX. Tous ces chiffres sont des mul-tiples de 9. Cela est dû à la méthode de composition de Feldman, qui se calibre sur la taille du papier utilisé. Pour Violin and String Quartet, celui-ci porte, du début à la fin, 9 me-sures par ligne. Différentes échelles sont ensuite utilisées : un premier niveau se trouve à la mesure, un second au système (9 mesures), puis un troisième à la page (3 systèmes, soit 27 mesures). Les changements de système et de page sont les points d’articulations princi-paux, correspondant à différents niveaux de structuration : à l’échelle des sections, c’est l’articulation à la page qui est la stratégie unique (changement de section lors d’un chan-gement de page), tandis qu’à l’échelle des motifs, c’est le système qui prévaut (changement de motif lors d’un changement de système).
Chaque section est caractérisée par la variation d’un motif particulier. Les clusters illustrant ceux-ci sont la plupart du temps étalés sur trois octaves. Pour la description qui suit, quand il y a un intérêt à la noter de par sa stabilité, l’harmonie indiquée sera l’harmo-nie principale des sections. Il faut garder en mémoire qu’il y a toujours des variations in-ternes plus ou moins nombreuses.
motifs : ABCDEFGHI
Introductionm
s 1 à 840’00’’ à 12’27’’durée : 12’27’’
81 mesures
Section Im
s 82 à 27012’27’’ à 33’56’’durée : 21’29’’189 m
esures
LÉG
EN
DE
Graphique d’évolution des m
otifs :A
: quatuor : accords clusters, violon solo : balancement sol-la (9
ème) ou la-sol (7
ème) à la blanche ou à la noire pointée.
B : violon solo : accélération du balancem
ent à la croche ou à la noire pendant toute une mesure (quatuor : accord cluster).
C : violon solo : m
otif en double dièse et double bémol (quatuor : accord cluster).
D : violon solo ne joue pas, quatuor seul.
E : m
otif de silence : deux instruments ou plus du quatuor ne jouent pas. Lien avec I selon les configurations.
F : quatuor : reprise du motif de balancem
ent sol-la (9èm
e) ou la-sol (7èm
e) du violon solo par un ou plusieurs instruments du quatuor.
G : quatuor : tenue pendant plus de 4 tem
ps avec franchissement de la barre de m
esure / tenue franchissant la barre de mesure.
H : violon solo / violon 1 : m
otif de notes répétées sur la mêm
e note ou dans un ambitus de seconde.
I : motif de silence : silence du quatuor pendant plus de 4 tem
ps ou pendant une mesure com
plète.J : violon solo / alto / violoncelle : pizzicato d’un ou de plusieurs instrum
ents en mêm
e temps.
Fig.5 : Violin and String Quartet : la form
e à travers l’évolution des motifs
J
Section IIm
s 271 à 54033’56’’ à 54’32’’durée : 20’37’’270 m
esures
Section IIIm
s 541 à 64854’32’’ à 62’36’’
durée : 8’04’’108 m
esures
Section IVm
s 649 à 81062’36’’ à 74’52’’durée : 12’16’’162 m
esures
Section VIm
s 919 à 102682’33’’ à 90’30’’
durée : 7’57’’108 m
esures
Section VIIm
s 1027 à 105390’30’’ à 94’08’’
durée : 3’38’’27 m
esures Section VIIIm
s 1054 à 118894’08’’ à 103’43’’
durée : 9’51’’135 m
esures
Section IXm
s 1189 à 1458103’43’’ à 133’47’’
durée : 30’04’’270 m
esures
Section Vm
s 811 à 91874’52’’ à 88’23’’
durée : 7’40’’108 m
esures
Introduction, mesures 1 à 81 - 0’00’’ à 12’27’’
• Motif A : cluster si b - do - ré - ré b étalé sur 3 octaves par le quatuor, balancement la 3 - sol 4 ou sol 4 - la 5 à la noire ou en triolet ou quintolet de blanches au violon solo :
! fig. 3 : exemple du motif A, figure principale de l’introduction et de la section I (mesures 1 à 9).
• Variation du motif : par déphasage à travers la permutation des durées entre les ins-truments.
• Jeu en harmonique de quarte aux violons 1 et 2, en harmonique naturelle pour l’alto, le violoncelle et le violon solo.
• Barres de reprise systématique à chaque mesure. • Motif B, accélération du balancement la-sol du violon solo, qui se fait alors à la
croche, avec une variation à la noire (fig.4) :
! fig. 4 : exemple du motif B, à la croche (mesures 61-62), puis à la noire (mesure 63) (mesures 55 à 63).
• Clôture de l’introduction par le motif C (fig.1).
Section I, mesures 82 à 270 - 12’27’’ à 33’56’’
• Motif A : cluster identique à celui de l’introduction, mais avec répartition dans la tessiture différente pour le quatuor. Navigation do - sol par le violon solo. Homorythmie quasi permanente du quatuor.
• Variation du motif : incursions vers mi, fa, et sol. • Motif D : violon solo ne joue pas. Il est accompagné dans ce silence par le violon 1
(mesures 116, 141) ou, plus souvent, par le violon 2 (mesures 113, 128, 147, 156, 239, 257). Dans les deux cas, les mesures sont toujours identiques.
• En miroir du motif D, le motif E, où le violon solo est seul avec l’alto ou le violon 1 (fig.5).
! Fig.5 : exemple des motifs D (ms 147) et E (ms 150) de la section I (mesures 145 à 153).
• Nombreux changements de métrique. • Présence de barres de reprise, d’abord à chaque mesure, puis par groupes de me-
sures, puis disparition. Réapparition pour la clôture de la section. • Clôture de la section avec le motif C en double dièse et double bémol (fig.1).
Section II, mesures 271 à 540 - 33’56 à 54’32’’
• Évolution du motif A : cluster do - ré - mi par le quatuor, balancement la - sol au violon solo.
• Variation du motif A : déphasage et phasage du quatuor, par permutation des du-rées entre les instruments.
• Transmission progressive aux violons 1 et 2 du motif du violon solo (balancement la - sol). C’est cette transmission qui illustre le motif F (dégradé de couleurs sur la fig.2 en fonction du nombre d’instruments reprenant le balancement) (fig.6).
! Fig.6 : exemple du motif F de la section II (mesures 388 à 396).
• Retour des motifs C et B, au cours des mesures 472 à 540, exposant un mouvement et son rétrograde, avec un centre mesure 506.
• Le motif G est introduit à la suite de ce mouvement : tenue de 4 temps avec fran-chissement de la barre de mesure (fig.7). Première fois de la pièce que le cadre de la me-sure est franchi :
! Fig.7 : exemple du motif G de la section II (mesures 541 à 549).
Section III, mesures 541 à 648 - 54’32’’ à 62’36’’
• Brusque changement harmonique, et abandon du motif F. Le motif G, jusque là can-tonné au seul violoncelle, occupe maintenant l’ensemble du quatuor, le violon solo continuant son balancement sol-la.
• L’harmonie devient très tendue. Cluster ré-ré b-la b-si b. • Premier motif de la section : reprise du motif G, avec des tenues pouvant dépasser
les quatre temps. Le violoncelle et l’alto joue une ligne uniquement interrompu au pre-mier et dernier temps des systèmes pendant la moitié de la section (fig.8).
! Fig.8 : exemple du motif G, premier motif de la section III (mesures 568 à 576).
• Second motif de la section : motif H (fig.9). Pour la première fois, apparition de notes répétées, à la noire ou noire pointée : la b pour le violon 2 et si b pour le violon 1 (mesures 577-585 ; mesures 595-603 ; mesures 640-648). Variation du motif à travers la durée des notes, le temps de silence ouvrant la mesure, et la transformation de la note répétée à une note répétée dans un ambitus de seconde majeure (mesures 604-612).
! Fig.9 : exemple du motif H, deuxième motif de la section III. Motif G à l’alto et au vlc (mesures 577-585).
• Troisième motif de la section : reprise du motif F, balancement sol-la du violon solo aux violons 1 et 2, l’alto et le violoncelle restant sur le motif G. Variation : déphasage constant entre le violon solo, les violons 1 et 2 et l’alto dans l’énoncé du motif (fig.10).
! Fig.10 : section III, troisième motif, reprise du motif F, motif G à l’alto et au violoncelle (mesures 586 à 594).
• Les motifs sont superposés en permanence, mais jamais H avec F, ni les trois en même temps : uniquement G avec H ou F.
• Un système à part, couvrant les mesures 613 à 621 (p.23). Celui-ci est tiré de la sec-tion I, mesures 127 à 135 (p.5), où il s’agissait déjà d’un système conclusif de page. Vis-à-vis du matériau de la section III, c’est l’apparition d’un matériau très différent. La suite n’en est toutefois aucunement affectée.
Section IV, mesures 649 à 810 - 62’36’’ à 74’52’’
• Premier motif de la section : motif I, silences de 4 temps ou plus, négatif des tenues de la section précédente (motif G). Première fois de la pièce que le silence occupe une telle place. Le violon solo joue des notes répétées (de la noire pointée à la blanche poin-tée) pendant ces silences du quatuor (fig.11).
! Fig.11 : exemple du motif I, premier motif de la section IV : mm 758-759 et mm 761-762 (mesures 757-765).
• Second motif de la section : reprise du motif G, avec des tenues atteignant cette fois les 7 temps au quatuor (p.28 ou 31), le violon solo jouant alors une note unique par me-sure (d’une durée comprise entre la noire pointée et la blanche pointée), ou ne jouant pas (motif D) (fig.12).
! Fig.12 : exemple du motif G, second motif de la section IV, avec présence du motif D (mesures 748-756).
• Troisième motif de la section : retour, avec beaucoup plus de présence, du motif D (silence du violon solo) (fig.13).
! Fig.13 : exemple du motif D, troisième motif de la section IV. Notez aussi le motif I, mm 861-862 (mesures 856-864).
• Homorythmie du quatuor pendant toute la section. • Stabilité harmonique sur l’ensemble de la section : sol b - la b - si - do par le qua-
tuor, sol 6 au violon solo.
La section IV, jusqu’à la section VIII, est la dernière à introduire de nouveaux motifs : les sections précédentes serviront ensuite de réservoir de matériau.
section 5 section 5 section 5
Section VI, mesures 919 à 1026 - 82’33’’ à 90’30’’
• Grande similitude avec la section II. La page d’introduction de VI (p.35) est d’ailleurs, moyennant une inversion des deuxièmes et troisièmes systèmes et d’infimes variations au niveau des triolets et quintolets de blanches du violon solo, identiques à la p.18 (section II). Le deuxième système de cette même page 18 fournit le matériau à toute la page 36, mais cette fois troué de silence. Il y a une symétrie vide / plein entre les deux premiers systèmes de la p.36 pour les violons 1 et 2, la partie de violon solo étant identique. En page 37, le violon solo continue d’utiliser le même matériau : les deux premiers systèmes de la page 37 sont identiques aux deux premiers de la page 36. L’alto et le violoncelle reprennent leurs parties du 3ème système de la page 36. Les violons 1 et 2 ont une symétrie vide / plein entre les deux premiers systèmes de la page 37, avec un matériau légèrement différent (do b / ré b au violon 1, et la b / sol b au violon 2). La page 38, dernière de la section V, continue de présenter un matériau très homogène, moyennant octaviation (violon solo, alto et violoncelle) et transposition au demi-ton (violon 1). Le violon 2 conserve son matériau de la page précédente.
• Le silence, touchant d’abord les violons 1 et 2, va jusqu’à affecter l’ensemble du qua-tuor (mesures 984 et 987). Il peut être considéré comme le motif principal de la section.
• Quasi ouverture de la section avec le motif marqueur double dièse double bémol (mesure 929, 931, 933).
! Fig.15: exemple de la section VI, avec les motifs E (silences au quatuor) et F (reprise du balancement du violon solo
par le quatuor) (mesures 973 à 981).
Section VII, mesures 1027 à 1053 - 90’30’’ à 94’08’’
• La section la plus courte. • Matériau tiré de sections antérieures. La première page (p.39) est une copie directe
de la section I, p.5, mais jouée à partir de la fin (ce sont les mesures entières et non leur contenu qui sont inversés). Le premier système de la p.40 est une copie du deuxième de la p.38 (section VI) joué en partant de la fin, et le deuxième système de la p.40 est
quand à lui une copie du troisième système de la p.38 (inversion du mouvement du mo-tif du violon solo, note de l’alto joué par le violoncelle et inversement).
Section VIII, mesures 1054 à 1188 - 94’08’’ à 103’43’’
• Proximité avec la section IV : homorythmie du quatuor et alternance de tenues franchissant la barre de mesure (motif G) et de silences (motif I) (section IV, p.31 à 34). Le violon 1 tient la même note tout au long de la section, comme dans IV (si 5) (fig.16).
! Fig.16 : exemple de la section VIII : grande similarité de matériau avec la section IV (mesures 1171 à 1179).
Section IX, mesures 1189 à 1458 - 103’43’’ à 133’47’’
• Motifs de la section : le matériau évoque tour-à-tour la section I (p.45), la section IV (le quatuor et ses notes isolées dans le silence, p.46 et ss.), la section III (balancement à la seconde majeure, au violon solo et une quinte plus bas cette fois-ci, p.48-49), puis à nouveau la section IV (p.49 et ss.).
• Motif spécifique de la section : les pizzicati, qui apparaissent à la mesure 1216, se-ront la marque distinctive de cette section finale : c’est le motif J (fig.17).
! Fig.17 : exemple du motif J, motif principal de la section IX. Notez la présence du motif D (ms 1405-1408, violon solo
ne joue pas) et du motif I (ms 1413, silence du quatuor) (mesures 1405-1413).
• Importance du silence en tant que motif : le motif I, est étendu à une mesure de si-lence complet pour la première fois (mesure 1245 pour la première). Forte présence du motif D : 6 systèmes complets, 4 systèmes partiels, et de nombreuses mesures isolées où le violon solo ne joue pas. Retour du motif E, mesures où le violon solo ou le violon 1 sont les seuls à jouer (fig.18). Motif I et E peuvent se confondre selon leur configuration (mesure 1413 par exemple).
! Fig.18 : exemple du motif E (ms 1207 et 1214) pendant la section IX. Présence de reprise quasi-systématique. Les
deux mesures où intervient le motif E sont celles qui sont répétées 9 et 6 fois (mesures 1207-1215).
• Retour des barres de reprise, à chaque mesure ou par groupe de mesures. Pour la première fois, des mesures peuvent être répétées plus de deux fois (mesure 1200 pour la première fois), et jusqu’à 9 fois (mesure 1207). Cela a toujours lieu lors du motif E (fig.18).
• Homorythmie du quatuor à partir de la page 46, mesure 1216 (apparition qui est donc synchrone avec celle des pizzicati), rejoint par le violon solo à partir de la mesure 1351 (p.51). Première fois qu’une homorythmie complète a lieu. Celle-ci survient après un silence du violon solo de plus d’une page (mesures 1315-1350), qui faisait suite au motif H très marquant de balancement à la seconde majeure tiré de la section III.
• Changement de métrique quasi-systématique à chaque mesure. • Clôture de la pièce avec le motif en double dièse et double bémol (motif C).
La dernière section, IX, apparaît donc comme une véritable section conclusive, avec rappel d’anciens matériaux et présence de signes annonciateurs forts : le violon solo qui disparaît pendant des systèmes entiers après avoir repris le motif perceptivement très marquant d’une ancienne section (balancement de seconde majeure), le mi b en pizzicato qu’il répète, et l’arrivée même de ces pizzicati, très surprenante après près d’1h45 passée sur des accords et notes tenues arco. Une écoute attentive de la pièce fait alors apparaître sa conclusion à travers le motif en double dièse et double bémol du violon solo comme ‘lo-gique’.
Ce découpage formel est cohérent avec l’évolution d’autres paramètres musicaux tel que la métrique ou la présence / absence de barres de mesure (fig.19) :
! Fig.19 : évolution des patterns en regard de l’évolution de la métrique et de la présence ou absence de barre de répétition (la ligne horizontale de la courbe métrique représente le 8/8 occupant la majeure partie de la pièce. Les gradations vers le
bas ou le haut sont faites à la croche, unité rythmique de base de la pièce.).
patterns: A
B
Intro. Section I
bar 10’00’’
bar 8512’54’’
bar 27133’56’’
bar 4154’32’’
bar 64962’36’’
bar 91982’33’’
bar 102790’30’’
bar 105494’08’’
bar 1189103’43’’
bar 1458133’47’’
metric: 8/8
repeat bar
no repeat bar
Section II S. III Section IV S. VI S. VII S. VIII Section IX
C
D
E
F
G
H
I
J
bar 81174’52’’
S. V
III. LE LANGAGE MUSICAL DE FELDMAN DANS VIOLIN AND
STRING QUARTET : LA COMPOSITION PAR MOTIFS
Le motif est l’unité de base de la composition. Ils sont constitués par le contenu d’une mesure, ne sont jamais développés au cours de la pièce et ne sont jamais modifiés au sein d’une mesure. Les modifications, mesure après mesure, affectent leurs surfaces : propor-tions son/silence, mouvements dans la tessiture, permutations de hauteurs, déphasage entre les instruments. Mesure, système, page et sections sont les quatre échelles de présen-tation et de variation des motifs.
III.1. La composition par motifs : la permutation La composition par motifs est la répétition du même toujours varié, à travers la désyn-
chronisation des attaques, les temps de jeu, la répartition dans la tessiture. Feldman procède par permutation : tel instrument jouait pendant telle durée après tel
silence au début de la mesure. À la mesure suivante ce schéma sera repris par un autre ins-trument. Le temps de jeu du violon 2 sera pris par l’alto, celui de l’alto sera pris au violon-celle, qui donnera le sien au violon 1, qui a donné le sien de la mesure précédente au violon 2. La première page de la partition, mesures 1 à 27, fournit une explicitation très claire de la méthode. Un retour sur la fig.3 permet d’observer le phénomène à l’échelle d’un système (mesures 1 à 9).
! Fig.20 : la permutation : mesures 1 à 9.
Les permutations sont aussi appliquées aux hauteurs entre les instruments, mais jamais en même temps que la permutation rythmique.
La permutation peut aussi intervenir à l’échelle de système entier : p.14, deuxième sys-tème, les 9 mesures jouées par le violon 2 se retrouve au troisième système jouées par le violoncelle, puis au premier système de la p.15 retourne au violon 2, la ligne de l’alto (deuxième système p.14) passant au violon 2, puis p. 15 au violoncelle, celle du violoncelle (deuxième système p.14) passant à l’alto et restant à l’alto en p.15.
III.2. La composition par motifs : la rétrogradation La rétrogradation est l’autre méthode privilégiée de composition. Elle se fait à l’échelle
de quelques mesures (mesures 272-275 par exemple) ou sur des sections plus importantes (section II, mesures 472 à 540 avec un centre mesure 506, entre autres). Ce n’est pas le contenu de la mesure qui est inversé, mais les mesures elles-mêmes qui s’intervertissent. La rétrogradation rentre dans le principe de la symétrie. Celles-ci sont systématiquement tordues (fig.20 et 21), pour une «mise en place décalée du motif», à la recherche de «l’équilibre entre mouvement et statisme» . 2
L’exemple le plus évident (mesures 472 à 540) est trop long pour être reproduit, mais est visible sur le graphique de la forme globale grâce aux motifs B et C (fig.2). Sous une autre forme de représentation, la fig.21 donne une image évidente de la technique :
! ! ! ! ! !
!
Fig.21 : permutations de hauteurs et symétries tronquées (mesures 352 à 459). Les hauteurs sont représentées par une échelle arbitraire en ordonnée : 1=do, 1,5= ré bémol, 2=ré, etc.
! Fig.22 : rétrogradation et symétries tronquées (mesures 424 à 432).
ms 352 ms 406 ms 424 ms 432 ms 450
FELDMAN Morton, Symétrie tronquée, in: Écrits et paroles, Dijon, Les Presses du Réel, 2008, p.3362
III.3. La composition par motifs : le déphasage Celui-ci intervient sans suivre de logique organisationnelle. Il se fait par utilisation de
triolets et quintolets (violon solo), et par permutation des durée de silence ou de jeu (qua-tuor). En fonction des sections, le déphasage affecte les cinq instruments, ou seulement le quatuor. L’absence de règle conduit à une complète irrégularité, une impossibilité à poser des repères et donc à un renouvellement constant. Le motif peut revenir en phase à tout moment sans que le niveau de déphasage qui précédait n’informe de l’événement. Nous constatons donc une utilisation du phénomène très différente de celle que peut avoir Steve Reich, dont le déphasage a été le centre du travail durant les années 60 et 70.
! Fig.23 : phasage et déphasage : mesures 55 à 63.
III.4. La composition par motifs : le silence Le silence occupe une place très importante. Il ouvre une grande partie des 1458 me-
sures du quatuor, et il permet d’isoler chaque motif pour mieux les donner à entendre. Naissance et résonance du son sont ainsi contrôlées. A travers ce contrôle de l’enveloppe de chaque son, c’est la plus grande leçon qu’il a reçu d’Edgard Varèse que Feldman ap-plique : «Tu dois penser au temps que prend le son pour atteindre l’auditeur qui est au fond de la salle.» 3
Une telle place du silence permet la mise en place d’un jeu de présence / absence, vide / plein, au cours de certaines sections (sections III, IV, V, VIII).
Pour moi le silence est aussi un substitut au contrepoint. C’est : rien contre quelque chose. Différents degrés de rien contre quelque chose, ça existe réellement, c’est quelque chose qui respire. Je travaille par modules, je ne travaille pas dans la conti-nuité, je travaille de façon modulaire. Et j’aime cela parce que de cette façon, je peux mettre ça dans tous les sens. 4
FELDMAN Morton, Conférence de Francfort, ibid., p.3633
ibid, p.373-3744
Cette vision, tant du contrepoint par le silence que du travail par module est très bien exprimé par un examen des pages 36 et 37 déjà mentionnées. La fig.24 en donne un exemple :
! Fig.24 : exemple d’arrangement visuel de la partition (mesures 991 à 999, p.37).
III.5. Battements et tempérament non-égal Feldman n’a jamais écrit de microtons, mais est très conscient de leur existence, de leur
fonctionnement et de ce qu’ils peuvent apporter :
Personne ne veut regarder directement dans la lumière ; mais Monet a réussi à obte-nir cette réfraction, un mot très intéressant, parce que je pense que c’est la même chose avec les sons, en terme de battements. 5
Le mode de jeu, en harmonique naturel ou de quarte pendant quasiment toute la pièce, facilite la lecture du phénomène des battements par le filtrage de la fondamentale. Le jeu ppp facilite également la production claire des harmoniques supérieurs. La majorité des motifs étant basée sur des clusters à base de secondes, septièmes et neuvièmes, les interac-tions entre harmoniques sont très nombreuses, et les battements par-conséquent très pré-sents.
! Fig.25 : ‘réfraction’ de la seconde majeure ré b- mi b à partir de la mesure 1280 (mesures 1279 à 1287).
ibid, p.3735
La fig.25 présente ce phénomène de ‘réfraction sonore’ dont parle Feldman. À partir de la mesure 1280, la seconde majeure ré bémol - mi bémol au violon solo et violon 1 est tra-vaillée à un niveau purement timbral, à travers les arrivées du violon 2 et de l’alto à l’unis-son (mesure 1281), puis du violoncelle en harmonique de quarte (mesure 1282). Ce sont bien les micro-déviations de hauteur qui sont recherchées par Feldman au cours de ce sys-tème (qui trouve sa rétrogradation à la page suivante, mesures 1306 à 1314).
Je n’utilise pas les quarts de ton, mais différentes manières d’écrire. Par exemple, je pourrais avoir une certaine octave fausse, comme un mi b avec un ré #(...). Je fais cela (...) dans le but d’obtenir une plus grande clarté à l’intérieur de petits intervalles, comme par exemple dans un cluster. Il me semble... C’est un peu comme la térében-thine, comme la dilution de la musique au moyen de la térébenthine. 6
De là découle cet attrait à concevoir différemment les bémols et les dièses et à user si-multanément de fa b et de mi # (exemple), ou de do b et de si (exemple). D’où aussi le motif en double bémol et double dièse (fig.26). En ce sens, nous pouvons dire que Feldman use d’un tempérament non-égal, ce qui a parfaitement du sens pour des instruments à cordes et se retrouve dans ses autres pièces de musique de chambre pour cordes de la même époque (le Quatuor n°2 notamment).
! Fig.26 : distorsion d’intervalles à travers les double dièse et double bémol (mesure 76, violo solo).
III.6. La composition visuelle Il s’agit des endroits de la partition où, à l’échelle de la page, un arrangement purement
visuel des motifs et des silences semble guider le placement des éléments au sein des sys-tèmes. Les pages 36 et 37 sont les exemples les plus frappants de cette méthode, qui rejoint la pensée modulaire que Feldman mentionne . L’exemple est trop long pour être reproduit, 7
mais la fig.22 que nous avons donné en montre une expression.
Conversation avec Xenakis, ibid., p.4286
Conférence de Francfort, ibid., p.3637
III.7. La composition par système et par page L’examen de la partition révèle que les changements de motif ou de mode de variation
d’un motif se font toujours à l’occasion d’un changement de système ou de page. De même à l’échelle supérieure, les sections sont toujours calées à la page. L’équilibre entre les lon-gueurs des différentes parties découle de cette méthode. Elle est aussi l’extension au sys-tème et à la page de la pensée modulaire par motifs. Nous retrouvons aussi à de multiples endroits des recopies directes de systèmes voire de pages entières (sections III, VI, VII).
III.8. Feldman, sur sa méthode de composition par motifs
L’aspect le plus intéressant pour moi, dans le fait de composer exclusivement avec des motifs, est qu’il n’y a pas de procédure organisationnelle plus avantageuse qu’une autre, peut-être parce qu’aucun motif ne prime jamais sur les autres. La concentra-tion compositionnelle s’opère uniquement sur le choix d’un motif à répéter, et pour combien de temps, ainsi que sur le caractère et son inévitable transformation en quelque chose d’autre . 8
La répétition des motifs en accord ne doit pas progresser de l’un à l’autre mais inter-venir selon des intervalles de temps irréguliers, de manière à dissimuler le caractère d’étroite imbrication qui se dégage du travail sur les motifs ; tandis que, dans cer-taines situations, les motifs rythmiques plus évidents doivent être ‘marbrés’ pour obs-curcir leur périodicité. Pour moi, les motifs sont réellement des groupements de sons indépendants qui me permettent de rompre sans préparation pour passer à autre chose. 9
L’organisation de ces différentes techniques doit beaucoup à l’intérêt de Feldman pour les tapis d’Orient, dont il était un fin connaisseur. L’examen de la technique même du tissage nous apporte des éclairages pertinents sur cette influence.
Symétrie tronquée, ibid., p.3378
ibid., p.3389
IV.L’INSPIRATION DES TAPIS ORIENTAUX : TISSER LE TEMPS
IV.1. La production du différent à partir du même Les fig.27a, 27b et 27c donnent un aperçu des tapis qui intéressaient Feldman :
! ! Fig.27a : tapis, Daghestan, XIXème s. Fig.27b : tapis, Ghiordès, XIXème s.
! Fig.27c : tapis, Turkestan, XIXème s.
On note que chacun d’eux est constitué de différents motifs qui se répètent, tout en étant variés. On note aussi que cette notion de motif peut être vue à différentes échelles : les grands motifs se répètent et apparaissent variés parce qu’ils sont constitués par la répé-tition, elle-même variée, de motifs de plus petites tailles. Et le processus se répète pour ces derniers, créant un emboîtement de motifs, jusqu’au motif de base formé par l’entremêle-ment même des mailles. Un exemple très simple permet d’illustrer limpidement cela (fig.27a, 27b).
! Fig.28a : naissance des motifs dans le tissage . La répétition d’un même micro motif forme un macro motif . 10
Un micro motif est répété à 4 reprises (a, a2, a3, a4) avec à chaque reprise une rotation à 90° : le macro motif A est ainsi formé (fig.27a). En gardant le même angle de 90° de rota-tion pour la répétition du micro motif a, mais en appliquant un décalage vertical du macro motif A, un nouveau macro motif est formé, B. Un autre décalage vertical permet de for-mer C. Un décalage cette fois horizontal forme D, toujours à partir de a (fig.27b) :
! Fig.28b : variation des motifs dans le tissage : le même engendre le différent . 11
Ce bref exemple permet de constater que la répétition du même peut engendrer le diffé-rent. L’exemple présenté est en noir et blanc, mais l’ajout de la couleur multiplie d’autant les possibilités. Dans Violin and String Quartet, l’entremêlement des mailles est constitué par les micro motifs, dont l’enchaînement forme les macro motifs des sections. Un retour sur les exemples précédents permet d’éclairer d’un point de vue musical ces analogies vi-suelles. L’inspiration des tapis orientaux apparaît alors très clairement. tiorr,rr^
eun ç proq,.p tlepuodse,oc e11e.nb srolY 'Jll"roc?p;iü;iâ'rnâs êt rnoo àir:àer âllnsuo 91? B^'âllê,9le.,, êrnl,urs red ISSnE ê?puellr.ro, l" '1etqo un.p e8esn'1 red e9rut1c9renbtle.rd uollnlos "l op 'prESErl iti' tpu, ,t*lo:
e11e1 'senbpqcels?lrssec?u sep luêl^ ,11\ iut4"uo'r-e91edde e'r1g lleunod 're1ec9pp ,i.,"11rn,p ollcglp 1e e93r13eu luâ^nos ?-t1:: t'l"n oun SIBIAI
'êlqISI^ sren'uà.1 ep selcelceds sâl snol co^E JoSIIB^IJp ?uâur" ned ç'ned e e11e.nb'1re.l êp sollâIluêsse seqcu€rq sopoun ênuo^âp lse oile 'dàù*oq sep sêlu€sslorc ecuetrgdxe'1 le?lêltqEqc[ 3â^v 'utElunq êltg.l op elto^'qlno.tutuElu np no uostqnp uorleluesordêr EI trïn tàii n".,i33ns elle. : a^twm3y' ecrnosnir.r.àon trLr.rnod'uo.nb oc lso.c'lollEulIuE luotuâllêlluessêproq€(p 'elsII€?J 1rr.1 ,1-rot 1se 'tssne-seul^3]'^1t"I s?p '?l âC 'êrlnp-orde: sel ep JIS?p e1 ràd 'tpreseq sês êp 1â âJn18u €I 0p uoll€̂rês-ào.i rro'""n i.ii"o3 t.r1g n""od eu 'eiterluoc ne 'n'rgrdurt'1
'na,9rdur.P âcuâsq€ eun P 'esset-eqc?s oul€uâc âun p egsodxe srnoinol sJ1l-sêJ segrpue8ue tsutesâruJoJ sop âllns e1 'e8üeso1 e1 : elgldruoc eln8g eu-n 'lueureleug'lâ ercs âp sluâp ,.1 '1.rr.,à'ioJcêrluo.l 'selplered sol eJnqcEqeldruts e[ êp JoJI] p nuea'red'rsute 1se':s1ueuêI]nqleq s'letuard
:illl
;.,ÏmP
._ ,rrrmf{
i-.d: -' lfl|ll;
-- r ml
---- "liü:il
:,;' ..lnttr
^....'!-- - " .ii
...-: -
_ l
'>: -L-:-
l..,ttl'.x1,*.r;.".,,?.,,
I
tiorr,rr^ eun ç proq,.p tlepuodse,oc e11e.nb srolY 'Jll"roc?p
;iü;iâ'rnâs êt rnoo àir:àer âllnsuo 91? B^'âllê,9le.,, êrnl,urs red ISSnE ê?puellr.ro, l" '1etqo un.p e8esn'1 red e9rut1c9renbtle.rd uollnlos "l op 'prESErl iti' tpu, ,t*lo:
e11e1 'senbpqcels?lrssec?u sep luêl^ ,11\ iut4"uo'r-e91edde e'r1g lleunod 're1ec9pp ,i.,"11rn,p ollcglp 1e e93r13eu luâ^nos ?-t1:: t'l"n oun SIBIAI
'êlqISI^ sren'uà.1 ep selcelceds sâl snol co^E JoSIIB^IJp ?uâur" ned ç'ned e e11e.nb'1re.l êp sollâIluêsse seqcu€rq sopoun ênuo^âp lse oile 'dàù*oq sep sêlu€sslorc ecuetrgdxe'1 le?lêltqEqc[ 3â^v 'utElunq êltg.l op elto^'qlno.tutuElu np no uostqnp uorleluesordêr EI trïn tàii n".,i33ns elle. : a^twm3y' ecrnosnir.r.àon trLr.rnod'uo.nb oc lso.c'lollEulIuE luotuâllêlluessêproq€(p 'elsII€?J 1rr.1 ,1-rot 1se 'tssne-seul^3]'^1t"I s?p '?l âC 'êrlnp-orde: sel ep JIS?p e1 ràd 'tpreseq sês êp 1â âJn18u €I 0p uoll€̂rês-ào.i rro'""n i.ii"o3 t.r1g n""od eu 'eiterluoc ne 'n'rgrdurt'1
'na,9rdur.P âcuâsq€ eun P 'esset-eqc?s oul€uâc âun p egsodxe srnoinol sJ1l-sêJ segrpue8ue tsutesâruJoJ sop âllns e1 'e8üeso1 e1 : elgldruoc eln8g eu-n 'lueureleug'lâ ercs âp sluâp ,.1 '1.rr.,à'ioJcêrluo.l 'selplered sol eJnqcEqeldruts e[ êp JoJI] p nuea'red'rsute 1se':s1ueuêI]nqleq s'letuard
:illl
;.,ÏmP
._ ,rrrmf{
i-.d: -' lfl|ll;
-- r ml
---- "liü:il
:,;' ..lnttr
^....'!-- - " .ii
...-: -
_ l
'>: -L-:-
l..,ttl'.x1,*.r;.".,,?.,,
I
d’après HUYGHE René, Sens et destin de l’art, 2 tomes, Paris, Flammarion, 1985, tome 1, p.2510
d’après HUYGHE René, Sens et destin de l’art, 2 tomes, Paris, Flammarion, 1985, tome 1, p.2511
a a2 a3 a4 = A
B C D
! Fig.29 : la création du différent à partir du même (mesures 1 à 9).
!
! Fig.30 : variation du motif et enchaînement plein / vide (mesures 748 à 765).
! Fig.31 : différents éclairages jetés sur la seconde majeure ré b 5 / mi b 5 (mesures 1279 à 1287).
IV.2. Le tissage du temps Observer le spectrogramme de la pièce permet d’appréhender ce phénomène sur de
vastes périodes de temps. Cette prise de recul met en évidence de façon très claire la struc-turation de la pièce à la page et au système (fig.32a, 32b, 32c).
! Fig.32a : spectrogramme des mesures 541 à 756. p.22 à 24 : échelle du système comme niveau de structuration de la
composition. p.21 puis p.25 à 28 : échelle de la page comme niveau de structuration de la composition.
système 1 système 2 système 3 système 1 système 2 système 3 système 1 système 2 système 3 système 1 système 2 système 3
!
!
! Fig.32c : spectrogramme des mesures 604 à 621, systèmes 2 et 3 de la page 23. La mesure comme module de base pour la
composition. Présence de barres de reprise pour les mesures 613 et 621, d’où leurs tailles supérieures aux autres. Notez la ‘carrure’ de 3 mesures en p.23.
Fig.32b : spectrogramme des mesures 541 à 648 : échelle du système comme niveau de structuration intermédiaire de la composition. Les mesures peuvent être distinguées.
p.21 p.22 p.23 p.24 p.25 p.26 p.27 p.28
p.21 p.22 p.23 p.24
p.23, système 2 p.23, système 3
mm 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
V. LES ASPECTS PERCEPTIFS DE LA RÉCEPTION DE LA MUSIQUE DE
FELDMAN
V.1. Une concentration sur le son Violin and String Quartet, et de façon générale la musique de Feldman, ne présente au-
cune mélodie, aucun développement, aucune relation logique entre ses éléments musicaux. Les motifs sont donnés à entendre pour eux-même, hors de tout repère classique.
Quand vous travaillez avec une seconde mineure aussi longtemps que moi, c’est très large. J’entends une seconde mineure presque comme une tierce mineure. C’est très, très large (rires). Donc le sens de l’ouïe est un phénomène très intéressant. Parce que, conceptuellement, vous ne l’entendez pas, mais au niveau de la perception, vous pour-riez être capable de l’entendre. 12
C’est-à-dire qu’une seconde mineure est un intervalle posé abstraitement (selon un sys-tème harmonique) qui fera toujours la taille d’une seconde mineure (selon le système choi-si). Mais perceptivement, à force d’écouter, de travailler son ouïe, celle-ci devient plus pré-cise et est capable de discerner plus de détails à l’intérieur du même intervalle. Celui-ci ‘s’élargit’. De là l’exagération humoristique de Feldman qui la voit aussi grande qu’une tierce mineure . 13
Le jeu ppp incite à une écoute concentrée, d’autant plus renforcée par la présence im-portante du silence autour des motifs. Cela incite à écouter au-delà de la note, et à prendre conscience du phénomène des battements, très présent tout au long de l’œuvre.
Il faut certainement voir ici une influence de la pensée zen, dans laquelle John Cage, grand ami de Feldman, était versé sous la conduite de Daisetz Teitaro Suzuki. Sa position de ne pas agir sur le son dérive directement du concept zen de non-action. Il s’agit pour Feldman de pouvoir remonter au son dans son existence non-structurée, (« ce qui m’inté-resse, c’est d’obtenir du temps dans son existence non-structurée » ) cette structuration 14
étant faite par l’esprit humain. Il faut remonter avant que celui-ci n’interviennent. Une des facettes de cette volonté est aussi de se détacher de la tradition européenne, toute les mé-thodes de structuration du temps de la sphère occidentale en provenant.
Conférence de Darmstatd, ibid, p.39912
C’est le même phénomène d’élargissement de la perception dont parle Giacinto Scelsi : SCELSI Giacinto, 13
Les anges sont ailleurs, piste 3 du cd accompagnant le livre
FELDMAN M., Entre catégories, op.cit. (note 50, p.54), p.26914
V.2. Une absence de repères : le déphasage et la métrique comme brouillage perceptif
L’absence de repère est due à la temporalité très étirée, sur laquelle il est très difficile de poser des jalons précis d’évolution, mais aussi au déphasage des motifs qui apparaît à tra-vers les permutations des valeurs de jeu ou de silence (quatuor) et par l’utilisation de trio-let et quintolet au sein d’une mesure binaire (violon solo). Déphasage et changements mé-triques apparaissent souvent ensemble, mais ne semble obéir à aucune logique organisa-tionnelle. Cette absence de règle génère une irrégularité complète, d’où une impossibilité de poser des repères. Phasages et déphasages peuvent intervenir à tout moment sans que les mesures précédentes ne l’indiquent. Et quand une homorythmie apparaît stable pen-dant un temps, c’est soit la métrique très fluctuante qui se charge de brouiller la perception rythmique (section I, p.5-6), soit des tenues débordant la mesure (section IV). Des déca-lages du motif d’une croche étant réalisés à chaque mesure, le brouillage est complet. Les parties les plus complexes à l’écoute sont celles où le motif de balancement sol-la du violon solo est repris par le quatuor. Ces parties présentent également peu de silence, saturant l’écoute d’informations nouvelles et peu claires.
Malgré le statisme apparent, le mouvement est donc permanent, et l’attention constamment sollicitée, sans que celle-ci puisse trouver d’élément où poser des repères d’écoute.
V.3. L’écoute et la mémoire dans la musique de Feldman Cette absence de repère fait partie du complet changement de paradigme d’écoute qui a
lieu avec Feldman. Il ne faut plus chercher de mélodies, de développements, de relations logiques entre les éléments. Les motifs sont donnés à entendre pour eux-même, d’où aussi le silence dans lequel ils apparaissent et disparaissent. Feldman fait d’un principe de base de ne pas intervenir sur le son, pour le laisser être. Il donne par là-même le temps d’écou-ter. Ce temps de l’écoute est une des problématiques au cœur de la musique de Feldman, et la répétition et la variation des motifs entre dans ce cadre. Chaque répétition (‘réitération’ est le terme que préfère Feldman ) présente un point de vue différent sur le motif exposé. 15
Il s’agit d’en imprégner l’auditeur, pour qu’il s’en souviennent. Car la deuxième probléma-tique, et certainement la plus importante de la musique de Feldman, est la mémoire. Il a mentionné à plusieurs reprises que celle-ci était au centre de ses préoccupations musicales.
Formaliser la désorientation de la mémoire. Les accords sont entendus répétés sans aucun motif discernable. Dans cette régularité (même s’il y a de légères gradations de tempo), il y a une suggestion : ce que nous entendons est fonctionnel et directionnel ; cependant nous nous rendons bientôt compte que c’est une illusion. 16
Conférence de Darmstatd, ibid, p.41715
Symétrie tronquée, ibid, p.33516
Les formes musicales occidentales sont devenues des paraphrases de la mémoire. Moi, je suis intéressé par d’autres formes de mémoire. Plus une pièce dure longtemps, mieux l’auditeur se souvient de ce qu’il a entendu. On a le temps de réfléchir, de se souvenir de ce que l’on a entendu. Ces pièces longues ressemblent plus à des romans. Je voulais que mes accords soient très différents des suivants, en quelque sorte ca-pables d’effacer dans la mémoire de l’auditeur ce qui s’est passé avant. C’est ainsi que je voulais maintenir le temps en suspens... en effaçant précisément les rapports entre les accords et leur provenance. A chaque instant on était pleinement disponible et on n’établissait pas de liens avec ce qui précédait. 17
Si la comparaison au roman peut surprendre vis-à-vis de tout ce que nous venons de voir (à moins de se référer uniquement à Proust, Joyce ou Beckett), nous constatons que Feldman a une pensée très picturale, et donc spatiale, de sa musique. L’auditeur est absor-bé dans les micro-motifs comme il l’est dans la couleur, et observe leurs chatoiements dans la variation du même ( « C’est un peu comme la térébenthine, comme la dilution de la mu-sique au moyen de la térébenthine » ). S’il se laisse absorber dans l’écoute, il va pouvoir se 18
souvenir de ce qu’il a entendu (voir le schéma formel, fig.2) et il aura le temps de réfléchir. Les procédés de permutations, de symétrie, de rétrogradation sont éclairés d’une nouvelle lumière. Nous n’allons pas suivre la rétrogradation pas-à-pas en ayant conscience qu’il s’agit d’une rétrogradation, mais nous avons un sentiment de familiarité. La prégnance et l’espacement du motif en double dièse et double bémol et des motifs marqueurs de chaque section sont aussi logiques sous cet angle. Les rendre plus fréquent nuirait au projet esthé-tico-conceptuel de Feldman. Leur importance est signalée par l’impact qu’ils ont dès leur apparition : au milieu d’un contexte de répétition de motifs pianississimo isolés dans le si-lence, le moindre changement est très marquant. Leur construction même vise à une pré-gnance maximum, à ce que l’auditeur puisse se souvenir d’eux quand ils reviennent après 20 ou 30 minutes. Car c’est bien la mémoire qui est au centre de Violin and String Quar-tet. L’absence de repère régulier conduit à l’impossibilité de se guider dans le déroulement temporel de la pièce. Les motifs constamment en mouvement tout en étant similaire, déso-rientent la mémoire («formaliser la désorientation de la mémoire»), qui ne peut se fixer individuellement sur eux. Leur couleur générale et le type de matériau mis en œuvre sont les seules informations qui restent. C’est alors que les sections, prises chacune comme un tout, permettent, par leurs longueurs et leur aspect contrastant, le travail de la mémoire : le ‘macro-chemin’ devient très identifiable. Ce changement d’échelle est une construction intellectuelle rendue possible par la longueur de la pièce : «on a le temps de réfléchir, de se souvenir de ce qu’on a entendu». C’est lui qui donne un sens à la pièce.
Zimmermann W., Entretien avec Morton Feldman, in, Contrechamps, 6 : Musiques nord-américaines, 17
Genève, L’Âge d’Homme, avril 1986, p.11-23
FELDMAN M., Conversation avec Xenakis, op.cit. (note 50, p.54), p.428. Rappelons que Feldman était un 18
proche ami de tous les peintres de l’école new yorkaise : Rauschenberg, Guston, Newman, Jones, etc.
Cette question de l’écoute et de la mémoire se trouve donc directement reliée aux conceptions du temps et de la forme qu’a développé Feldman. Sa volonté de d’aller au-delà de cette dernière pour aborder les échelles prend ainsi tout son sens.
L’échelle de ce qui doit être représenté, qu’il s’agisse de l’ensemble ou d’une partie, est un phénomène en soi. De fait, les rapports propres à l’échelle m’ont fait comprendre que les formes musicales et les processus qui leur sont liés sont seulement essentielle-ment des méthodes pour disposer le matériau et n’ont pas d’autre fonction que de rendre plus facile le travail de la mémoire. 19
C’est donc un double objectif que poursuit Feldman : se détacher des formes tradition-nels qui rendent « plus facile le travail de la mémoire », à travers la création d’une nou-velle méthode de composition, la composition par motif, qui par la réitération du même et le changement sans transition va « formaliser la désorientation de la mémoire ». Inscrire la méthode dans une nouvelle échelle temporelle très étirée va lui permettre d’atteindre son deuxième objectif : l’ouverture d’un nouveau champ où l’écoute, dans son fait même, est au centre. Alors, ayant le temps d’écouter, nous aurons aussi le temps de réfléchir, « de se souvenir ».
V.4. Temps et forme
La raison pour laquelle les pièces sont si longues, vient de ce que la forme, telle que je la comprends n’existe plus. (...) Pour moi, la forme n’est que le découpage d’objets en différentes parties. Non pas les rapports qu’engendre le démontage d’une chose en parties, mais le simple fait de démonter quelque chose. Une échelle, c’est quelque chose d’autre : on laisse tout simplement courir, et puis on voit ce qui se passe. 20
Ce qui m’intéresse, c’est d’obtenir du temps dans son existence non-structurée . 21
Cette importance de la perception de la durée pour Feldman se retrouve dans Violin and String Quartet par l’usage qu’il fait de la métrique et des reprises.
J’utilise le mètre comme construction : pas le rythme, mais le mètre et le temps, la du-rée qui exige quelque chose. 22
Symétrie tronquée, ibid, p.334-33519
Monographie, ibid, p.12020
Feldman M., Entre catégories, in, Ecrits et paroles, op. cité (note 2, p.13), p. 26921
Feldman M., Ecrits et paroles, op. cité (note 2, p.13), p. 14722
Lui [Stockhausen] voulait mesurer, il voulait du temps mesuré sur la partition et je voulais du temps ressenti, une sensation plus subjective du temps. 23
C’est une expérience du temps que recherche Feldman, c’est-à-dire un acte vécu par la conscience de l’auditeur. Nous avons commencé à voir comment est structurée cette expé-rience : le trajet à échelle locale, micro, est très difficile à suivre et semble aléatoire. Mais une organisation apparaît quand nous changeons d’échelle et que nous passons au macro, au niveau des sections : celles-ci deviennent identifiables et individualisables. Finalement, le motif lui-même peut être vu à une autre échelle, et ce sont alors les sections entières qui constituent des macro-motifs. Les micro-motifs à l’échelle de la mesure étant le lent et pa-tient tissage de ceux-ci.
Une question se pose : y a-t-il besoin de la longueur, d’une durée aussi étendue, pour exposer ces problématiques ? Nous pensons que oui, car il y a besoin d’avoir une perte de repères locaux. En parallèle, la variation perpétuelle des micro-motifs permet de maintenir l’attention. Celle-ci n’est pas non plus surchargée d’informations grâce à leur simplicité, au fait qu’ils ne sont pas variés au sein de la mesure, et à la lenteur à laquelle ils se déroulent. Des motifs chargés d’informations, variant au cours de la mesure, et se déroulant à grande vitesse satureraient l’attention, qui décrocherait alors très vite. Au contraire, Feldman fait tout pour exposer le plus clairement possible ses micro-motifs, et les silences les entourant en début et fin de mesure trouvent ici une très bonne explication. La conscience a tout le temps nécessaire pour les enregistrer comme proches, de la même ‘famille’, mais diffé-rents. La présence des battements et la tension apportée par les clusters donnent dans le même temps beaucoup à écouter.
Samuel Beckett a écrit quelque chose pour moi en 1977. Quand je l’ai reçu, j’ai com-mencé à le lire. Il y avait quelque chose de singulier. Je n’arrivais pas à le saisir. Fina-lement, j’ai constaté que chaque ligne était en réalité la même pensée, dite d’une autre manière. Et pourtant la continuité donne l’impression qu’il se passe autre chose. Mais il ne se passe rien d’autre. En fait, vous êtes en train de vous imbiber de plus en plus profondément, de manière presque proustienne, de la pensée. 24
Il apparaît ainsi que la musique de Feldman est extrêmement cohérente, depuis son propos esthétique jusqu’à sa méthode de composition et la façon dont la musique sonne.
Si la longueur des pièces est une nécessité pour l’exposition du propos de Feldman, celle-ci peut toutefois être problématique pour l’auditeur. Les macro-motifs que consti-tuent les sections sont certes identifiables, mais ils constituent des blocs importants. Leur statisme apparent est assurément animé de l’intérieur par les méthodes que nous avons vu
Conférence de Francfort, ibid, p.37023
Feldman M., Conférence de Darmstadt, in, Ecrits et paroles, op. cité (note 2, p.13), p.39224
de permutation, déphasage, rétrogradation, etc., mais est-ce la seule stratégie dont use Feldman pour maintenir l’attention ?
V.5. Construction dramatique et narrativité dans Violin and String Quartet
Malgré le peu de repères, l’œuvre reste très cohérente, autant à l’écoute qu’à l’analyse. À l’écoute par son matériau restreint doté d’une très forte unité, et à l’analyse par la gestion formelle que nous avons présenté. À travers le tissage non plus des motifs mais des sec-tions en tant que tout, une direction est présente, et la dernière en particulier fait vraiment figure de coda. Toutefois, bien qu’elles soient claires à l’analyse, ces données restent diffi-cile d’accès à la seule écoute. Nous pouvons alors nous demander s’il n’y a pas, à l’échelle des micro-motifs et de leur enchaînement, autre chose qu’une simple juxtaposition, si elles ne suivent pas un schéma de type dramatique, qui permettrait alors d’orienter la conscience de l’auditeur :
Le mouvement orienté vers un but laisse dans son sillage immédiat la tendance à vivre les événements en termes de lignes et d’actions temporelles dramatiques. 25
Que révèle l’examen de la partition et son écoute attentive ? Observons par exemple l’évolution des mesures 109 à 135 (fig.31) :
Stern D., La constellation maternelle, Paris, Calmann-Lévy, 1997, p.123-12425
! Fig.31 : Ligne d’action temporelle dramatique (mesures 109 à 135).
Des mesures 109 à 114, nous avons le matériel typique de la section I (en vert sur la fig.31, cluster homorythmique étalé sur quatre octaves (deux instruments maximum par oc-tave)). A la mesure 115 l’ambitus du cluster s’étale subitement sur six octaves, de l’extrême grave du violoncelle à l’extrême aigu du violon (en bleu sur la fig.31). La dissonance est di-luée dans cet étalement. Deux instruments disparaissent à la mesure suivante dans une harmonie toujours très étalée, avant une contraction brutale aux mesures 117 et 118 : le violoncelle, l’alto et le violon 1 se rejoignent dans un ambitus de tierce mineure (pendant que le violon 2 est à l’octave inférieure, et le violon solo à l’octave supérieure, en rouge sur la fig.31). La mesure 119 retourne à un état de détente par l’étalement du cluster sur 6 oc-taves (bleu), qui se recontracte mesure 120 en une tierce mineure (rouge). Cette contrac-tion se poursuit 3 mesures avant qu’une nouvelle détente n’intervienne pour 2 mesures (bleu), suivie d’une nouvelle contraction, puis de la disparition soudaine de trois instru-ments (mesures 12è et 128, en jaune sur la fig.31). Les deux restants (violon 1 et violon solo) jouent alors une seconde mineure à la cinquième octave. La fin de la page se déroule ensuite par un retour au matériel typique de la section I (vert). À travers le jeu des reprises (systématique à chaque mesure pour I), ces 25 mesures s’étalent sur plus de 3 minutes.
Le final de la pièce, la section IX, a déjà été décrit, et montre clairement l’inscription d’une direction vers la conclusion de la pièce, qui est bien ressentie par une écoute atten-tive.
Autre élément, la présence du silence en début et/ou fin de mesure pendant une grand partie de la pièce autorise le jeu d’une succession vide/plein, avec la présence très marquée du silence ou au contraire sa disparition. Nous pouvons par exemple observer le passage de la section III à la section IV. La section III (mesures 532 à 648) expose les tenues les plus longues de la pièce - durant un système complet (la tenue n’est pas effectuée dans le même archet, cinq ré-attaques sont effectuées) - en même temps qu’un maximum perceptif a lieu avec la reprise aux violons 1 et 2 du motif de balancement sol-la du violon solo avant un motif de notes répétées déphasé. Nous trouvons au cours de cette section à l’endroit le plus chargé d’informations de la pièce, où aucune interruption de son n’a lieu : disparition du silence qui occupait systématiquement une partie de la mesure jusque là. Ce plein est brutalement suivi du vide de la section IV (mesures 614 à 918), qui fait apparaître pour la première fois des silences de plus de 4 temps. L’impression est d’autant plus renforcée que le quatuor traverse toute la section en homorythmie. L’apport dramatique de ce contraste est très clair à l’écoute.
Ce jeu du plein et du vide est aussi un moteur du discours musical. Si l’on poursuit l’examen de la partie IV, après deux pages de sons isolés dans le silence (p.29 et 30), de nouvelles tenues apparaissent, mais cette fois entourées de silence, jouées par l’ensemble du quatuor, et surplombées de silence du violon solo une mesure sur deux. C’est donc, après un contraste plein/vide à l’échelle de deux sections, un contraste plein/vide qui a lieu à l’intérieur de la section même. Le zoom à l’intérieur du matériau se poursuit, cet aspect plein/vide pouvant se retrouver à la section suivante à l’échelle du système (section V, en particulier les pages 36 et 37). Observons avec cette perspective le premier système de la page 37, où nous avons une alternance à chaque mesure d’un silence de deux instruments du quatuor - vide - avec le quatuor au complet - plein -, qui aboutit à un silence généralisé à la dernière mesure du système - vide. Une telle lecture de la pièce rend à nouveau évi-dente l’inspiration des tapis orientaux de Feldman, où un motif semble répété de façon fractale en se retrouvant à tous les niveaux (fig.27a, 27b, 27c).
Et c’est aussi toute une partie du parcours de la pièce qui se voit bâtit sur l’idée très simple de plein/vide. D’abord construite au niveau macro, elle trouve au fur-et-à-mesure des ramifications jusqu’à la plus petite unité de la pièce, la mesure. Notons que c’est par le chemin inverse que le plein s’était construit, à travers la prolifération d’une idée énoncée dès la mesure 3 par le violon solo (le balancement legato de sol à la). Il faudra attendre la section II, mesure 370, pour que celle-ci soit transmise à un instrument du quatuor. Le mouvement ne cessera alors de proliférer pour atteindre le maximum de la section III que nous avons vu, à partir de la mesure 541. Un minutage de la pièce permet de se rendre
compte des proportions face auxquelles nous nous trouvons. La transmission du motif au quatuor démarre à la mesure 370, soit 41’25’’. Elle atteint son maximum à la mesure 541, soit 54’32’’, qui est maintenu jusqu’à la section IV, mesure 649, soit 62’36’’. Le tout étant joué ppp, nous sommes face à une sorte de ‘climax silencieux’, ou de ‘climax dans le calme’, qui explose dans le silence avec la section IV.
Ainsi, et malgré ce qui est souvent dit de l’aléatoire et de l’aspect instinctif de la musique de Feldman, nous pouvons clairement distinguer, lors de la juxtaposition d’un certain nombre de micro-motifs, la présence d’une construction dramatique. Celle-ci est un mo-teur important, sinon le principal, du maintien de l’attention au sein des macro-motifs. En effet, l’éclairage constamment modifié des micro-motifs, sur les durées que propose Feld-man, demande une forte capacité d’abstraction et un décentrage cognitif vis-à-vis de nos habitudes d’écoute classique. L’usage de schémas tension / détente, qui mettent en œuvre une progression d’ordre dramatique, amène à un ressenti émotionnel qui se raccroche au paradigme traditionnel de l’écoute occidentale. Ils permettent à intervalles réguliers de re-lancer l’attention. Remarquons pour conclure que l’extension de ces idées de discours dramatique se retrouve aussi à l’échelle des macro-motifs, dans leurs rapports contras-tants.
Conclusion
C’est peut-être Gisèle Brelet qui, 40 ans avant la composition de Violin and String Quartet, nous fournit une définition particulièrement aigüe de la musique de Feldman :
La musique n’a ni forme ni sens hors de la durée concrète : celle-ci est pour elle non plus un moyen mais sa fin même, non plus le phénomène de son être, mais son être même. 26
Ce sont bien ces questions, de la durée, de son expérience intime, et de la portée spiri-tuelle que cet acte peut avoir, qui sont au cœur de la musique de Morton Feldman. Au terme de notre analyse, nous voyons que sa démarche est extrêmement cohérente, depuis ses idées conceptuelles jusqu’au résultat sonore, en passant par toutes les étapes de la composition. C’est grâce à cette unité, qu’à partir d’un matériau extrêmement simple et ré-duit, il parvient à élaborer une musique particulièrement intense, emplie de climax silen-cieux explosant dans un calme apparent. Les schémas archétypiques de la musique, ten-sion/détente, simple/complexe, vide/plein, sont conservés, tout comme une organisation formelle, ainsi que des éléments de progression dramatique. Tout ceci est dilué dans une expérience temporelle intense qui fait éclater les cadres habituels de l’écoute et du concert, et propose une des expériences musicales les plus singulières du XXème siècle.
L’autre clef consiste à comprendre ce que signifie l’imagination, non ce qui est intéres-sant. 27
Brelet G., Le temps musical, Paris, Presses Universitaires de France, 1949, tome I, p.2226
Feldman M., Conversation avec Xenakis, in, Ecrits et paroles, op. cité (note 2, p.13), p.42627
Bibliographie
BRELET Gisèle, Le temps musical, essai d’une esthétique nouvelle de la musique, deux
tomes, Paris, Presses Universitaires de France, 1949
FELDMAN Morton, Écrits et paroles, Dijon, Les Presses du Réel, 2008
HUYGHE René, Sens et destin de l’art, 2 tomes, Paris, Flammarion, 1985
REED Stanley, Les plus beaux tapis d’Orient, Paris, Robert Laffont, 1976
STERN Daniel, La constellation maternelle, Paris, Calmann-Lévy, 1997
ZIMMERMANN Walter, Entretien avec Morton Feldman, in Contrechamps, 6 : Musiques
nord-américaines, Genève, L’Âge d’Homme, avril 1986, p.11-23