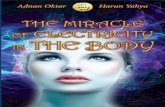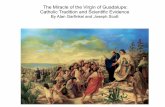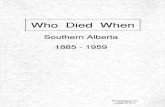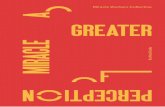Le "miracle suisse": une analyse des spécialisations industrielles (1885-1905)
-
Upload
xn--universit-rennes2-jtb -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Le "miracle suisse": une analyse des spécialisations industrielles (1885-1905)
Seediscussions,stats,andauthorprofilesforthispublicationat:https://www.researchgate.net/publication/258840506
Le"miracle"suisse:uneanalysedesspécialisationsindustrielles(1885-1905)
ARTICLEinÉCONOMIESETSOCIÉTÉS·SEPTEMBER2013
CITATION
1
READS
17
1AUTHOR:
LéoCharles
UniversityofBordeaux
6PUBLICATIONS5CITATIONS
SEEPROFILE
Allin-textreferencesunderlinedinbluearelinkedtopublicationsonResearchGate,
lettingyouaccessandreadthemimmediately.
Availablefrom:LéoCharles
Retrievedon:27January2016
Le « miracle suisse » : une analyse des spécialisations industrielles
(1885-1905)1
Léo CHARLES
GREThA, CNRS, UMR 5113
Université Montesquieu Bordeaux IV2
Résumé
La spécificité de la forte croissance de l’économie Suisse au XIXème siècle est un
sujet bien connu des historiens économistes. De nombreuses contributions ont mis en
avant le rôle des institutions, de la taille du pays ou du contrôle des lobbies pour
expliquer la croissance économique soutenue, en particulier à partir des années
1880. A partir d’une base de données originale et très désagrégée, cet article propose
de prendre en compte les choix de la Suisse en termes de spécialisations industrielles
dans l’explication du « miracle » suisse. Il en résulte que le développement de
spécialisations modernes ainsi qu’une montée en gamme dans les spécialisations plus
anciennes peut aider à mieux comprendre le succès suisse.
Mots-clés : croissance économique, spécialisations, économie Suisse.
Code JEL : N13, O4
Why did Switzerland succeed? An analysis of Swiss specializations (1885-1905)
Abstract
The singularity of the Swiss economy during the first globalization is a well-known
subject in historiography. Many authors highlight the role of institutions, the size of
the country or the weak influence of the lobbies on economic decisions to explain the
high economic growth from the 1880’s. Using an original and highly disaggregated
database, this article takes into account the Swiss choices in terms of industrial
specializations. We found out that the development of modern specializations as well
as a move upmarket in the “old” specializations can be one of the explanations of the
Swiss ‘miracle’.
1 Article publié dans Economies et Sociétés, Série « Histoire économique quantitative », AF, n°47, 9/2013,
p.1605-1620. 2 L’auteur remercie chaleureusement les personnes travaillant au Bureau des statistiques du commerce extérieur
suisse, en particulier M. Demagistri et Mme Staub pour leur accueil plus qu’amical. Nous souhaitons remercier
l’ensemble des participants de la conférence « European trade policies 1850-1913 » qui s’est tenue le 21 et 22
mars 2012 à Bordeaux et plus particulièrement M. Tena-Junguito et M. Meissner. Un remerciement tout
particulier à B. Blancheton, S. Becuwe, K. Onfroy, G. Pastureau, L. Elie, A. Berthe et M. Lemaitre pour leurs
commentaires. L’auteur reste bien entendu le seul responsable des éventuelles erreurs restantes.
Keywords: economic growth, specialization, Swiss economy
Introduction
La seconde partie du XIXème siècle est l’objet d’un débat récurrent entre les
économistes et les historiens de l’économie. En effet, la période étant le théâtre d’un
changement global, nommé plus tard « Première Mondialisation », il est intéressant
d’interroger les conséquences économiques d’un tel bouleversement des dynamiques du
commerce international. Notamment, le débat est toujours vif sur l’explication des différences
de taux de croissance, en particulier entre les pays européens, tant les opinions des
économistes diffèrent à ce sujet. Pour certains, le libre-échange, l’ouverture commerciale et
les politiques libérales ont offert aux pays développés la possibilité d’atteindre de nouveaux
marchés, accélérant de ce fait leur croissance économique [Irwin D.A. (2002)]. Pour d’autres,
ce fut la mise en place de mesures protectionnistes, restreignant le commerce mondial en
particulier à partir des années 1880, qui favorisa le développement économique [O’Rourke
K.H. (2000) ; Tena Junguito A. (2009)].
Concernant le désormais fameux « tariffs-growth paradox » ou « paradoxe Bairoch »,
de nombreux auteurs ont tenté d’expliquer l’émergence ou le déclin des nations européennes,
sans systématiquement utiliser l’opposition habituelle entre libre-échange et protectionnisme
[Becuwe S. et Blancheton B. (2013)]. Parmi eux, Becuwe, Blancheton et Charles (2012)
expliquent les difficultés françaises en pointant le repli des exportations vers des marchés de
proximité. David (2009) souligne l’importance de la taille des pays et plus particulièrement la
taille du marché domestique. Tena-Junguito (2005) et Bairoch (1996) ont mis en avant
l’importance des changements de spécialisations vers des productions à haute valeur ajoutée
et le rôle des exports.
Prenant en compte ces dernières avancées, la Suisse semble être un bon sujet d’étude.
En effet, entre 1870 et 1910, la Suisse connaît le taux de croissance le plus rapide (derrière
l’Argentine) parmi les pays développés avec une moyenne de 2,1% par an [David T. (2009b),
p. 272]. Il est intéressant de noter que la Suisse a fait l’expérience de gouvernements libre-
échangistes aussi bien que de périodes protectionnistes. Si des auteurs avancent l’hypothèse
que le « protectionnisme sélectif » introduit au milieu des années 1880 a favorisé l’émergence
de l’économie suisse [David T. (2009b), p. 266-268 ; Humair C. (2004)], de nombreuses
explications complémentaires émergent. Ainsi, le rôle des institutions [David T. et Mach A.
(2006)], la taille du pays [Bairoch P. (1990), p. 103-104], ou les choix judicieux en termes de
politiques commerciales sont mobilisés pour expliquer le « miracle » suisse, démontrant par la
même occasion l’originalité et la complexité de l’économie suisse. Par conséquent, plutôt que
de donner une explication unique du miracle suisse, il est nécessaire de prendre en compte
l’ensemble des singularités de ce petit pays en plaçant notre étude dans la continuité des
travaux précédemment cités.
Ainsi, prolongeant la réflexion sur les explications possibles de la croissance
économique suisse, cet article met l’accent sur le rôle des spécialisations industrielles dans le
succès helvète. En effet, il semble que des choix judicieux de spécialisations peuvent soutenir
l’émergence d’une croissance durable et soutenue en donnant la possibilité au pays de
développer de nouvelles économies d’échelle et de nouvelles parts de marché pour ses
exportations. [Dalun B. et Al. (1999)]. Cet article souligne aussi le rôle central des
importations comme soutien à la structure des exports.
L’article se décompose en trois parties. La première section présente la base de
données et la méthode statistique utilisée, la section 2 montre les résultats de l’analyse
statistique tant des exportations que des importations. Enfin, la section 3 discute l’influence
des spécialisations suisses sur sa croissance économique.
1. Base de données et méthode employée
Dans le but d’analyser le commerce extérieur suisse, nous avons collecté les flux
d’exportation et d’importation à partir des « Statistiques du commerce de la Suisse avec
l’étranger » présent à l’office fédéral des douanes à Berne. Les données de cette nouvelle base
ont été collectées pour chaque année couvrant la période 1885-1905 aussi bien en valeur
qu’en quantité. La base de données intégrale se compose d’environ 1100 produits différents
par année, assemblés en 17 groupes de produits. Malgré tout le soin que nous avons apporté à
cette collecte, il est nécessaire de rester prudent quant à l’interprétation des résultats de
l’analyse statistique. En effet, la base de données est incomplète pour l’année 1890, les flux
pour le groupe « textile » étant manquants. Ce manque peut ainsi introduire certains biais dans
l’analyse statistique en donnant par exemple une place trop importante à l’année 1890.
La taille de la base constituée nous a obligés à utiliser les derniers développements de la
statistique multidimensionnelle en particulier ceux de l’Analyse Factorielle des
Correspondances (AFC) afin de mettre en valeur les caractéristiques dominantes du
commerce extérieur de la Suisse. L’AFC est appliquée à un tableau de contingence, de taille
m x n où m représente le nombre de lignes (ici les produits) et n le nombre de colonnes (les
années). Cette méthode d’analyse statistique multidimensionnelle développée par Benzecri
(1992) nous permet de résumer un nombre important de données (1100x20=22000, soit 44000
données exports-imports confondus) dans un graphique à deux dimensions dans lequel chaque
ligne et colonne est représentée par un point. Cette méthode statistique permet de clairement
déterminer les produits qui dominent les exportations et importations suisses ainsi que les
années qui influencent le plus la période. En effet, l’AFC peut suggérer des relations
insoupçonnées entre les variables-colonnes (années) et les individus-lignes (produits).
L’application de cette méthode sur nos données fournit les principaux profils tant au niveau
des lignes que des colonnes. Nous appelons ces profils « axes factoriels » ou dimensions dans
la mesure où ils représentent un certain pourcentage de l’inertie totale du phénomène. Nous
avons gardé seulement les dimensions interprétables, ce qui explique que dans les tableaux
présentés, la somme des contributions de chaque axe n’est pas égale à 100%.
Dans le but de donner une image la plus claire et la plus précise possible de chaque axe,
nous avons gardé seulement les produits (ou les années) qui contribuent substantiellement à
sa construction. Afin de guider notre choix, nous avons retenu les variables qui contribuent
plus que le point moyen (c’est-à-dire supérieur à [1- (nombre de lignes (colonnes) / (min
nombre lignes ; colonnes)]). Nous présentons ainsi les points qui contribuent le plus à la
variance de la dimension.3
3 Nous utilisons pour l’analyse le logiciel SAS version 9.2.
2. Résultats de l’analyse empirique
2.1 Un choix de spécialisation judicieux : l’analyse des exportations suisses
Afin de déterminer les produits influençant le plus les exportations suisses, nous avons
analysé les flux d’exportation grâce à la méthode de l’AFC. Pour ce faire, les exportations
suisses ont été assemblées en 17 groupes de produits pour la période 1885-19054. L’analyse
statistique nous permet de révéler les spécialisations de l’économie Suisse. L’analyse
factorielle des correspondances a mis en valeur deux axes factoriels qui expliquent 80% de la
variance totale du phénomène.
Un changement de spécialisations
Le premier axe factoriel explique 60% de la variance du phénomène. Le tableau 1
présente les principaux résultats :
Tableau 1: Premier axe factoriel (exportations)
Signe négatif (contribution en %) Signe positif (contribution en %)
1888 (27.08) 1890 (23.19)
1887 (8.78) 1898 (3.71)
1886 (8.51) 1899 (3.58)
1889 (7.22)
1885 (5.78)
Matières textiles (34.94) Objets mécaniques (25.15)
Métaux (20.47)
Espèces chimiques (7.99)
L’analyse des flux d’exportations donne une vision claire du changement de
spécialisation opéré par la Suisse dans les années 1890. Il apparaît que l’économie suisse était
dans un premier temps spécialisée dans les matières textiles au cours de la première partie de
la période et s’est ensuite tournée vers des industries modernes comme les objets mécaniques,
les métaux ou les espèces chimiques durant la fin de la période étudiée. Même si l’analyse
met en avant seulement trois années significatives pour la fin de période, nous pouvons élargir
les conclusions à l’ensemble de la période tant le graphique à deux dimensions résultant de
l’analyse montre un nombre important de points proches les uns des autres.
4 Les 17 groupes sont : Déchets et engrais ; Espèces chimiques ; Verre ; Bois ; Produits agricoles ; Cuir ; Objets
de littérature, de science et d’art ; Objets mécaniques ; Métaux ; Matières minérales ; Comestibles, Boissons,
Tabacs ; Huiles et Graisses ; Papier ; Matières textiles ; Animaux et matières animales ; Poteries ; Articles
divers.
Le second axe factoriel apporte des détails supplémentaires et permet de préciser
l’analyse de la spécialisation de l’économie suisse.
Des spécialisations en continuité et non en rupture
Le second axe factoriel explique 20% de la variance totale du phénomène. Les
résultats de l’analyse statistique sont présentés dans le tableau 2.
Tableau 2: Deuxième axe factoriel (exportations)
Signe négatif (contribution en %) Signe positif (contribution en %)
1896 (7.26) 1890 (42.06)
1894 (5.35)
1893 (4.58)
Métaux (40.99) Comestibles, Boissons, Tabacs (12.50)
Matières textiles (6.95) Objets mécaniques (11.41)
Ce second axe factoriel donne une image plus précise des spécialisations suisses. La
fin de la période est ainsi corrélée avec deux groupes de produits : les Métaux et les Matières
textiles. Ainsi, contrairement à ce qu’on pouvait supposer à la lecture du premier axe, le
tableau 2 indique clairement que la spécialisation dans les matières textiles n’a pas disparu à
la fin de la période mais a seulement été complétée par de nouvelles spécialisations. Cela
signifie que l’économie suisse était dans un premier temps spécialisée dans une seule
production (spécialisation mono produit) puis, tout en gardant cette ancienne spécialisation,
en a développé trois nouvelles, assorties à la seconde révolution industrielle. Par conséquent,
la structure de spécialisation de l’économie suisse est devenue moins concentrée (plus
« éclatée ») et s’est finalement diversifiée.
Afin de confirmer ces résultats, nous avons calculé l’indice d’Herfindahl qui rend
compte de la concentration des exportations suisses5.
5 L’indice d’Herfindahl se calcul ainsi: H = ∑i Xi² avec Xi la part du produit i dans les exportations totales. La
valeur maximale est 100.
Graphique 1: Indice d’Herfindahl
Source: Statistiques du commerce de la Suisse avec l’étranger, calculs de l’auteur
Cet indice confirme que la spécialisation suisse devient de moins en moins concentrée
entre la période 1885-1890 et la période 1891-1905. On peut observer qu’après les années
1890 la spécialisation suisse reste stable autour de quatre produits. Le graphique suivant
(graphique 2) qui montre les principaux produits exportés en pourcentage des exports totaux,
confirme la stabilité de la nouvelle structure de spécialisation.
Graphique 2: Principaux produits exportés en pourcentage du total des exportations
Source: Statistiques du commerce de la Suisse avec l’étranger, calculs de l’auteur
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
18
85
18
86
18
87
18
88
18
89
18
90
18
91
18
92
18
93
18
94
18
95
18
96
18
97
18
98
18
99
19
00
19
01
19
02
19
03
19
04
19
05
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
Matières textiles
Nouvelles spécialisations
Comestibles, Boissons, Tabacs
Comme on peut le constater avec le graphique 2, la part des exportations des matières
textiles est en déclin au début de la période et se stabilise par la suite autour de 50% des
exportations totales. Au contraire, la part des nouvelles spécialisations (Objets mécaniques,
Métaux et Espèces chimiques) augmente, passant de moins de 20% au début de la période à
plus de 30% en 1905. La part du groupe « Comestibles, Boissons, Tabacs » dans les
exportations totales reste stable tout le long de la période.
Afin d’avoir une vue plus globale de l’économie suisse, nous avons appliqué à la
section 2 la même méthode statistique que précédemment, cette fois-ci sur les flux
d’importation.
2.2 De Ricardo à Krugman : la nature des importations suisse
Nous avons, pour cette section, appliqué la méthode de statistique multidimensionnelle
utilisée précédemment sur les flux d’importations suisses. L’AFC est réalisée sur les mêmes
17 groupes de produits, sur la même période (1885-1905). Nous avons retenu deux axes
factoriels pour l’analyse qui représentent 80% de la variance du phénomène.
Une spécialisation intra-branche
Le premier axe factoriel représente 63% de la variance totale du phénomène. Le tableau 3
présente les résultats de l’analyse statistique.
Tableau 3: Premier axe factoriel (importations)
Signe négatif (contribution en %) Signe positif (contribution en %)
1886 (16.01)
1890 (12.16)
1885 (14.98) 1900 (6.60)
1887 (12.41) 1899 (6.38)
1888 (9.98) 1898 (5.27)
1889 (5.06)
Matières textiles (42.68) Métaux (37.93)
Matières minérales (9.18)
Objets mécaniques (4.70)
L’analyse statistique résultant des flux d’importation semble être très proche du
premier axe résultant de l’analyse des exportations. En effet, il apparaît que les importations
de matières textiles dominent le début de la période puis, à la fin de la période, un mouvement
s’opère en faveur d’importations de nouvelles spécialisations. La similitude des deux
analyses laisse entrevoir la possibilité d’une spécialisation suisse de nature intra-branche.
Afin de confirmer cette intuition, nous avons calculé un indice de commerce intra-
branche6 [Grubel H.G et Lloyd P.J., 1975] pour les produits simultanément importés et
exportés7, ce qui représente plus de 200 produits par année. Le graphique 3 présente les
résultats.
Graphique 3: Indice de Grubel et Lloyd
Source: Statistiques du commerce de la Suisse avec l’étranger, calculs de l’auteur
L’indice ainsi calculé nous révèle que près de 40% du commerce extérieur suisse est
composé par des produits de même nature. Néanmoins, il convient de prendre ce résultat avec
précaution. En effet, l’indice présenté ici est un indice global basé sur la moyenne des indices
calculés pour chaque produit, ce qui peut cacher certaines disparités. Ainsi, il est nécessaire
d’entrer dans les détails afin de mieux comprendre la structure du commerce extérieur suisse.
Commerce inter-branche vs. Commerce intra-branche
Le second axe factoriel de l’analyse des flux d’importations de la Suisse explique 20%
de la variance totale du phénomène. Le tableau 4 présente les résultats.
6 L’indice de Grubel et Lloyd est défini comme:
avec i, le produit ; X, les exports et M les
imports. Il est compris entre 0 (absence de commerce intra-branche) et 1 (total commerce intra-branche).
7 Nous avons fait le choix de ne garder que les indices GL supérieurs à 0.1.
0,300
0,350
0,400
0,450
0,500
0,550
0,600 1
88
5
18
86
18
87
18
88
18
89
18
90
18
91
18
92
18
93
18
94
18
95
18
96
18
97
18
98
18
99
19
00
19
01
19
02
19
03
19
04
19
05
Tableau 4: Deuxième axe factoriel (importations)
Signe négatif (contribution en %) Signe positif (contribution en %)
1900 (10.25) 1890 (46.27)
1894 (8.51)
1886 (4.03)
Matières textiles (13.96) Animaux et matières animales (51.26)
Métaux (10.73) Comestibles, Boissons, Tabacs (6.08)
Cuir (3.91)
Articles divers (3.85)
Le second axe factoriel oppose donc les produits exhibant indice de Grubel et Lloyd
moyen aux produits présentant un indice important, comme nous pouvons le voir dans le
graphique qui suit.
Graphique 4: Indice GL pour les produits qui contribuent le plus au second axe
Source: Statistiques du commerce de la Suisse avec l’étranger, calculs de l’auteur
Le commerce extérieur de la Suisse semble être caractérisé par un niveau élevé de
commerce intra-branche. L’opposition révélée par le second axe nous amène à nous interroger
sur le contenu de ce commerce intra-branche suisse.
Afin d’éclairer les spécificités des spécialisations suisses, il est nécessaire de rentrer
dans les détails, à un niveau plus désagrégé. Nous avons donc analysé les produits constituant
les différents groupes dominants les importations et exportations suisses. Nous avons calculé
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Matières textiles
Animaux et matières animales
la part de chaque produit (exporté et importé) dans le total des exports (imports) du groupe
auquel ils appartiennent.
Des stratégies différentes pour des résultats similaires
En prenant en compte les produits constituant chaque groupe, une opposition nette
émerge. En effet, il apparaît que certains groupes sont déterminés par l’importation de
produits nécessaires à l’exportation de produits à haute valeur ajoutée (commerce inter-
branche classique) alors que les autres sont basés sur du commerce intra-branche (échange de
produits similaires à haute valeur ajoutée). Le tableau 5 résume cette opposition.
Tableau 5: Commerce inter-branche vs. Commerce intra-branche
Commerce inter-branche Commerce intra-branche
Matières textiles Objets Mécaniques
Comestibles, Boissons, Tabacs
Produits Chimiques
Si on considère les matières textiles, il apparaît que les importations sont dominées par
les matériaux bruts (laine, coton) et les exportations par des produits finis (Chapeaux,
Vêtements, Toile cirée). Il est important de noter que les produits exportés sont à haute valeur
ajoutée, ce qui traduit une claire montée en gamme afin de bénéficier de nouvelles économies
d’échelle.
En revanche, si on considère les objets mécaniques par exemple, il apparaît que les
échanges sont purement de type intra-branche. Ainsi, la Suisse importe et exporte des produits
finis appartenant à la même catégorie.
Cependant, comme pour les Matières textiles, nous pouvons noter que même si la
Suisse échange des produits de même catégorie, ils sont très certainement différenciés par leur
qualité ou par le degré de valeur ajoutée.
Enfin, si on considère le groupe des « Espèces chimiques » la même conclusion
émerge. La Suisse importe et exporte des produits à haute valeur ajoutée de même catégorie.
De plus, la Suisse adopte clairement une stratégie basée sur l’innovation et
l’imitation/variation [Vernon R. (1966)]. En effet, il semble que la Suisse abandonne la
production de masse pour une spécialisation dans des produits chimiques à haute valeur
ajoutée. Selon David (2009), l’industrie chimique suisse au tournant des années 1880 est
incapable de concurrencer les firmes allemandes et décide donc de changer de stratégie.
3. Agenda de recherche
L’analyse statistique des flux d’exportations nous apporte une vision claire des
spécialisations de l’économie suisse. Dans un premier temps, les résultats confirment les
recherches anciennes sur l’économie suisse notamment concernant les spécialisations dans le
Textile, les Objets mécaniques (en particulier l’industrie des montres), la Chimie, les Métaux
et les Machines. Selon David (2009), l’explication de la forte croissance suisse peut trouver
ses sources dans les avantages comparatifs dont la Suisse dispose dans ces branches
industrielles. Dans un second temps, nous avons mis en exergue certains éléments nouveaux.
En effet, l’économie suisse est passée d’une spécialisation mono produit à une structure plus
« éclatée » basée sur quatre branches principales. Le choix de changer la structure de la
spécialisation de son économie semble avoir favorisé la croissance économique durant la
période [Bairoch P. (1990), p.107). Il apparaît que la Suisse a fait le choix de productions
modernes, avec une spécialisation dans les produits à haute valeur ajoutée afin de développer
de nouvelles économies d’échelle, ce qui a profité à la croissance économique [Tena-Junguito
A. (2005)]. Malgré cette évolution, la Suisse a réussi à maintenir ses anciennes spécialisations
dans les Matières textiles, tout en opérant ici aussi un changement vers des productions
textiles à plus haute valeur ajoutée. Pour résumer, la Suisse a maintenu une position
compétitive dans les branches de la première révolution industrielle (qui sont des secteurs
déclinants) mais s’est aussi imposée dans les spécialisations de la seconde révolution
industrielle (secteurs émergents) [David T., (2009)].
En comparaison, Becuwe, Blancheton et Charles (2012) proposent une analyse statistique
similaire sur les flux d’exportations français. Les spécialisations françaises apparaissent
fragmentées en un trop grand nombre de produits, empêchant les industries de réaliser des
économies d’échelle. Selon les auteurs, la fragmentation des spécialisations peut être une des
explications des difficultés françaises sur la période. La Suisse quant à elle a fait le choix
politique de moderniser ses industries, notamment grâce à des tarifs douaniers spéciaux, afin
de proposer au marché mondial de nouveaux produits [Humair C. (2004)].
En résumé, le choix d’un nombre restreint de spécialisations qui ciblent les marchés
extérieurs peut entrer en ligne de compte pour expliquer le miracle suisse en termes de
croissance économique. Il semble que le développement de l’économie suisse pendant les
vingt années précédant la Première Guerre Mondiale est dû en grande partie à l’exportation de
produits industriels [David T., (2009)].
Si on considère maintenant l’analyse statistique des importations suisses, cet article met en
avant les deux stratégies adoptées par la Suisse afin de soutenir sa croissance économique.
D’un côté la Suisse favorise l’importation de matériaux bruts dans le but de produire des
produits finis à plus haute valeur ajoutée. D’un autre côté, la Suisse a développé un commerce
de type intra-branche avec ses partenaires basé sur l’échange de produits différenciés.
L’importance de l’indice de Grubel et Lloyd sur la période révèle que les exportations suisses
ont en partie ciblé les marchés développés géographiquement proches. Une différence entre la
France et la Suisse émerge ici encore. En effet, la France a aussi principalement développé un
commerce extérieur vers ses partenaires de longue date mais sans connaître une croissance
économique soutenue. La différence réside dans la volonté suisse de maintenir à partir des
années 1890 la même structure de spécialisation alors que la structure de l’économie française
devient au fil du temps de plus en plus dispersée [Becuwe S., Blancheton B. et Charles L.
(2012)]. De plus, la Suisse a fait le choix de protéger les nouvelles industries émergentes afin
de développer de nouvelles spécialisations plus favorables à la croissance économique que les
anciennes spécialisations françaises.
La découverte d’un commerce intra-branche important entre la Suisse et ses partenaires
est intéressante tant elle semble éloignée de la théorie économique. En effet, le commerce
intra-branche a été « découvert » par Verdoorn en 1960 et ce concept a été majoritairement
appliqué aux périodes récentes. Cet article confirme ainsi que le commerce intra-branche a
existé bien avant sa découverte et réaffirme la nécessité de le prendre en compte afin de
mieux comprendre la première mondialisation. Cette nécessité est d’autant plus forte que ce
que nous avons souligné pour la Suisse est vrai aussi pour d’autres pays comme la France
[Becuwe S., (1989) ; Charles L., (2012)]. Ainsi, l’un de nos objectifs est de développer une
base de données nouvelle et très désagrégée pour clairement identifier ce phénomène et en
mesurer l’importance durant la première mondialisation.
Pour conclure, la politique économique suisse semble avoir été bien pensée. En effet, la
Suisse a clairement gardé une spécialisation ricardienne dans le textile (secteur déclinant) tout
en montant en gamme. Néanmoins, la Suisse a été capable de développer de nouvelles
spécialisations dans les produits chimiques, les objets mécaniques… (secteurs émergents) en
se basant sur un échange intra-branche de produits différenciés. Selon Villa et Buisson (1997)
cette dernière stratégie peut permettre d’expliquer la croissance économique soutenue.
Cet article a donc mis en valeur le rôle des choix économiques de la Suisse en termes de
spécialisations pour expliquer le « miracle suisse ». Cette explication prend pleinement sa
place au côté des autres présentées en introduction tant les institutions suisses et la taille du
pays ont dû aider à analyser les changements et les évolutions résultant de la première
mondialisation. Dans le souci de compléter les explications de la croissance économique
suisse, il semble important d’analyser la distribution géographique des exportations et
importations. Ceci pouvant permettre de confirmer notamment la spécialisation intra-branche
de l’économie suisse.
Bibliographie
Bairoch P. [1990], « La Suisse dans le contexte international aux XIXe et XXe siècles », dans
Bairoch P. et Körner M. (ed.), La suisse dans l’économie mondiale, Droz, Genève, p. 103-
140.
Bairoch P. et Körner M. (ed.) [1990], La suisse dans l’économie mondiale, Droz, Genève.
Bairoch P. [1996], « Les exportations d’articles manufacturés de la Suisse dans le contexte
international (1840-1994) », dans Körner M. et Walter F. (éd.), Quand la montagne aussi
a une histoire, Berne, Stuttgart, Vienne, Paul Haupt, p. 205-234.
Becuwe S. [1989], « Les déterminants macroéconomiques du commerce intra-branche de la
France: une approche de long terme (1850-1980) », Revue économique, volume 40, n°5, p.
863-886.
Becuwe S. et Blancheton B. [2013], « Les controverses autour du paradoxe Bairoch, quel
bilan d’étape ? », Revue d’économie politique, volume 123, n°1, p. 1-27.
Becuwe S., Blancheton B. et Charles L. [2012], « The decline of French trade power during
the first globalization (1850-1913) », Cahiers du Gretha, n°2012-22.
Benzecri J.P. [1992], Correspondence analysis handbook, Marcel Dekker, New York.
Blancheton B. et Bonin H. (dir.) [2009], La croissance en économie ouverte (XVIIIe-XXIe
siècles), Peter Lang, Bruxelles.
Charles L. (2012), « Le commerce intra-branche de la France en perspective historique : une
approche empirique (1850-1913) », mémoire de master 2 Recherche en Economie
Appliquée, Université Montesquieu Bordeaux IV.
Dalum B., Laursen K. and Verspagen B. [1999], «Does specialization matter for growth »,
Industrial and corporate change, volume 8, n°2.
David T. and Mach A. [2006], « Institutions and Economic Growth. The successful
experience of Switzerland (1870-1950) », Research Paper n°2006/101, United Nations
University, World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER).
David T. [2009a], Nationalisme économique et industrialisation. L’expérience des pays de
l’Est 1789-1939, Droz, Genève.
David T. [2009b], « Le paradoxe Suisse ? Croissance et régulation en économie ouverte »,
Dans Blancheton B. et Bonin H. (dir.), La croissance en économie ouverte (XVIIIe-XXIe
siècles), Peter Lang, Bruxelles, p. 263-296.
Département fédéral des finances, Statistiques du commerce de la Suisse avec l’étranger,
Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, Section statistique
du commerce extérieur, Bern, Suisse.
Dormois J.P. [2006], « The impact of late-nineteenth century tariffs on the productivity of
European industries (1870-1930) », In Dormois J.P. and Lains P. (eds), Classical trade
protectionism 1815-1914: fortress Europe, Explorations in Economic history, Routledge,
London and New York, p. 160-192.
Etemad B. [1990], « Structure géographique du commerce entre la Suisse et le Tiers Monde
au XXe siècle », dans Bairoch P. et Körner M. (ed.), La suisse dans l’économie mondiale,
Droz, Genève, p. 165-181.
Gern P. et Arlettaz S. [1990], « Les échanges entre la France et la Suisse au XIXe siècle »,
dans Bairoch P. et Körner M. (ed.), La suisse dans l’économie mondiale, Droz, Genève, p.
207-226.
Grubel H.G. and Lloyd P. [1975], Intra-industry trade: the theory and measurement of
international trade in differentiated products, The MacMillanPress ltd, Londres.
Humair C. [2004], Développement économique et Etat central 1815-1914: un siècle de
politique douanière suisse au service des élites, Peter Lang, Berne.
Irwin D.A. [2002], « Interpreting the tariff-growth correlation in the late nineteenth century »,
American economic review (paper & proceedings), 92, p. 165-169.
Körner M. et Walter F. (éd.) [1996], Quand la montagne aussi a une histoire, Berne,
Stuttgart, Vienne, Paul Haupt.
Krugman P. [1981], « Intra-industry specialization and the gain from trade », Journal of
political economy, 89, p. 950-959.
Messerlin P.A. et Becuwe S. [1986], « Intra-industry trade in the long run : the French case,
1850-1913 », In Greenaway D. and Tharakan P.K.M. (eds.), Imperfect competition and
international trade. The policy aspects of intra-industry trade, Wheatsheaf Books.
O’Rourke K.H. [2000], « Tariffs and growth in the late 19th
century », Economic Journal,
110, p. 456-483.
Tena-Junguito A. [2005], « The good reputation of late XIX century protectionism:
manufacture versus total protection in the European tariff growth debate », Paper
presented to the 6th
conference of EHES, Istanbul, September 9th
2005.
Tena-Junguito A. [2009], « Bairoch revisited: tariff structure and growth in the late nineteenth
century », European review of Economic History, p. 1-33.
Verdoorn P.J. [1960], « The intra-bloc trade of Benelux », In Robinson E.A.G. (ed.), the
economic consequences of the sizes of nations, MacMillan, Londres.
Vernon R. [1966], « International Investment and International Trade in the Product Cycle »,
Quarterly Journal of Economics, 2, p. 190-207.
Veyrassat Béatrice [1990], « La Suisse sur les marchés du monde », dans Bairoch P. et Körner
M. (ed.), La suisse dans l’économie mondiale, Droz, Genève, p. 287-316.
Villa P. et Busson F. [1997], « Croissance et spécialisation », Revue économique, Volume 48,
n°6, p. 1457-1483.