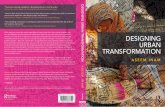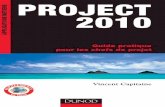Théorie de la restauration et Art contemporain: une conceptualisation au service de la pratique.
Laville, transformation de la pratique journalistique
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Laville, transformation de la pratique journalistique
CAMILLE LA VILLE
LES TRANSFORMATIONS DE LA PRATIQUEJOURNALISTIQUE : LE CAS DES CORRESPONDANTS
ÉTRANGERS DE L'AGENCE FRANCE PRESSE DE 1945 À2005
Thèse en cotutelle présentéeà la Faculté des études supérieures de l'Université Laval, Québec
dans le cadre du programme de doctorat sur mesure encommunication et science politique
pour l'obtention du grade de Philosophiœ Doctor (PhD)
FACULTE DES ÉTUDES SUPERIEURESUNIVERSITE LAVAL
QUEBEC
et
UNIVERSITE DE PARIS VIII VINCENNES - SAINT-DENISPARIS, FRANCE
pour l'obtention du grade de docteur en Sciences de l'information et de la communication
2007
© Camille Laville, 2007
RESUME en français
L'environnement médiatique, l'entreprise de presse et les pratiques journalistiques ont connu
un changement de configuration entre 1945 et 2005. La configuration formée par
l'environnement médiatique mondial et le jeu des acteurs est passé d'une régulation politique
à une régulation commerciale. Cela entraîne des transformations de la dépêche : éventail
élargi des contenus, fragmentation des textes, multiplication des analyses. Les acteurs
entretiennent des rapports d'interdépendance, les pratiques journalistiques sont marquées par
une forte réflexivité. Les défis du journaliste : conquête permanente de sa clientèle, distinction
et dépassement de ses concurrents, diversité du traitement de l'événement et recherche
perpétuelle de l'approbation de sa hiérarchie. La conception de l'information évolue, passant
de bien public à bien marchand ; si les anciens journalistes affichaient une position de
magistère, la génération actuelle adopte un comportement plus individualiste.
TITRE en anglais
Changes of journalism practice : the case of AFP's foreign correspondents from 1945 to 2005.
RESUME en anglais
The média environment, the news firm and the journalism practice underwent a change of
configuration between 1945 and 2005. The configuration formed by the world média
environment and the play of its participants changed from a political to a commercial
régulation which involved transformations of the journalistic text : widened range of the
contents, fragmented texts and enhanced analyses. The participants maintain interdependent
relationships, and journalistic practices are characterized by a strong reflexivity. A journalist
faces such challenges as permanent conquest of customers, distinction and overtaking of its
competitors, diversity in the treatment of the events, going from public service to commodity.
While former journalists exercised authoritative towards their public, the présent génération
has adopted a more individualistic behavior.
DISCIPLINE - SPECIALITE DOCTORALE
MOTS-CLES
Agence France Presse, Correspondants étrangers, Journalisme, Sociologie, Informationinternationale, Agence de presse, Pratiques journalistiques, Identité journalistique.
INTITULE ET ADRESSE DE L'U.F.R. OU DU LABORATOIRE
Je remercie Jean Charron, pour sa présence, et son aide permanente par delà l'Atlantique.Je le remercie de m'avoir ouvert de nouveaux horizons, et de m'avoir amenée à me dépasser.Je tiens à souligner également son exigence, sa rigueur scientifique, sa patience à mon égardquand il m'arrivait de douter de moi, et finalement je le remercie de m'avoir transmis lapassion qui l'anime à analyser le monde journalistique et son intérêt pour l'humain.
Je remercie Armand Mattelart, pour son soutien, ses encouragements et la confiance qu'ilm'a accordée durant toutes ces années.
Je remercie Patricio Tupper, pour m'avoir initiée à la recherche et m'avoir soutenue tout aulong de mon parcours universitaire. Ses conseils avisés et son esprit d'analyse ont grandementcontribué à la progression de ma recherche, je n'oublierai pas nos discussions souvent animéeset toujours fructueuses qui ont ponctué l'ensemble de ce travail.
Je remercie également l'équipe enseignante du département Information et Communicationde l'université Paris VIII, et tout particulièrement Gisèle Boulzaguet et Marie Thonon quin'ont eu de cesse de m'encourager.
Toute ma reconnaissance va à l'équipe enseignante de l'Institut Français de Presse qui m'aaccueillie deux ans durant comme ATER avec une pensée toute particulière pour JosianeJouet, Rémy Rieffel, Valérie Devillard, Tristan Mattelart, Christine Leteinturier et IsabelleDernier, qui ont toujours été de bon conseil.
Je remercie enfin l'équipe enseignante du département Communication de l'universitéLaval, avec une pensée toute particulière pour Jean de Bonville, Colette Brin et FlorianSauvageau, ainsi que la Faculté des Études Supérieures.
Mes remerciements vont également à Dominique Marchetti pour ses conseils et son écouteattentive.
Je tiens à remercier tous les journalistes de l'Agence France Presse qui m'ont accordétemps et intérêt ainsi que l'équipe du bureau du Caire pour m'avoir accueillie pendant unmois.
Je tiens à remercier ma mère pour m'avoir donné amour et encouragements, ma sœur, pourson écoute et son soutien les soirs de peine, et mon père pour son appui et sa confiance.
Je remercie Thomas Robache, pour avoir été un professeur, un employeur puis un ami quim'a suivi avec encouragements et bienveillance tout au long de ce chemin.
Mes plus sincères remerciements à Magali B. et Magali L. pour être des amies si aimanteset si disponibles. Mes remerciements vont également à Sophie, Hélène, et Rostom pour sestraductions. Leur présence et leur amitié m'ont accompagné tout au long de ce parcours.
Enfin, je remercie tous les membres de mon jury de thèse, Colette Brin, Jean Charron, ArmandMattelart, Rémy Rieffel, Michael Palmer et Patricio Tupper de me faire l'honneur d'assister àma soutenance.
m
Table des matières
INTRODUCTION 1PREMIÈRE PARTIE : FONDEMENTS THÉORIQUES DE LA QUESTION DERECHERCHE 11
-CHAPITRE 1- PRÉSENTATION DES CONCEPTS 12Section 1 - Environnement médiatique et globalisation 13Section 2 - L'entreprise de presse 20Section 3 -Pratiques et identité journalistiques 24
-CHAPITRE 2 - CADRE THÉORIQUE, DÉFINITION DES IDÉAL TYPES ETMÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 28
Section 1 - Construction du modèle théorique fondé sur le concept de configuration....291.1 Un cadre général d'analyse fondé sur le concept de configuration 291.2 La méthode idéale typique : définition et cadre d'application 32
Section 2 - Définition des idéal-types 342.1 L'environnement médiatique 352.2 L'entreprise : l'Agence France Presse 372.3 Les pratiques journalistiques 382.4 La dépêche 412.5 L'identité professionnelle journalistique 42
Section 3 - Méthodologie de la recherche 433.1 Le choix d'une méthode qualitative : l'entretien semi - directif auprès de 45journalistes 44
3.1.1 Constitution de l'échantillonnage 443.1.1.1 Le choix du critère générationnel 443.1.1.2 Autres critères 453.1.1.3 Les modes d'accès aux informateurs 46
3.3.2 Élaboration du plan d'entrevue 473.2 L'observation participante : le bureau de l'AFP au Caire 49
3.2.1 Présentation du bureau 503.2.2 Les conditions de l'observation , 50
3.3 Analyse documentaire 513.3.1 L'analyse d'un nombre limité de dépêches 513.3.2 Les manuels de l'agencier 513.3.3 Les documents disponibles sur le réseau intranet de l'AFP : ASAP 52
-CHAPITRE 3- L'ENVIRONNEMENT ET L'AGENCE : 53D'UNE CONFIGURATION À L'AUTRE 53
Section 1 - Une gestion étatique de l'agence 531.1 La naissance de l'agence 531.2 Le statut de 1957 : la mainmise de l'État perdure 551.3 L'état de la concurrence 58
Section 2- 1960-1990 : Entre crises et restructuration 592.1 La remise en cause du système international de production de l'information 602.2 Informatisation et décentralisation de l'agence 602.3 Crise économique et financière de l'agence 622.4 Intensification de la concurrence 63
Section 3 - 1990-2005 : Vers un modèle d'entreprise à visée commerciale 64
IV
3.1 Le redressement économique de l'agence 643.2 Les nouvelles orientations de l'agence 67
DEUXIÈME PARTIE : LA DÉPÊCHE 68-CHAPITRE 4- ANALYSE DES CONTENUS INFORMATIONNELS 70
Section 1 - Hégémonie du fait politique dans les dépêches 711.1 Un traitement prioritaire du fait politique 711.2 Le service diplomatique, joyau de l'AFP 711.3 Un contexte politique national et international qui oriente le contenu des dépêches
72Section 2 - Une société en mutation qui engendre une fragmentation et unediversification des contenus informationnels 75
2.1 Une société en mutation 762.2 L'explosion de l'offre informationnelle réoriente la demande des clients del'agence 78
Section 3 - Un contenu informationnel en mutation 793.1 Dimensions politique, diplomatique et humaine du traitement de l'information ...803.3 De nouvelles thématiques : thématique société et « information divertissante » ...84
3.3.1 l'information sociétale 843.3.1.1 le life style 843.3.1.2 l'information fonctionnelle 86
3.3.2 L'information divertissante 873.3.2.1 le succès des Insolites 893.3.2.2 le fil people 91
3.4 Écrire en couleur 94-CHAPITRE 5- DU JOURNALISME ÉVÉNEMENTIEL AU JOURNALISMESITUATIONNEL. ANALYSE DU MODÈLE JOURNALISTIQUE À TRAVERS LAHIÉRARCHISATION DES DÉPÊCHES 97
Section 1. La première configuration : classification rudimentaire des dépêches et règnedu factuel 97
1.1 Les caractéristiques de la dépêche 971.1.1 Une copie bipolaire : factuels et features 971.1.2 Absence de normalisation de la taille des dépêches 103
1.2 Le journalisme événementiel 106Section 2 -Une hiérarchisation des dépêches revisitée 108
2.1 Développement des dépêches hors factuels 1082.2 Normalisation de la taille de la dépêche 111
Section 3. La seconde configuration : fragmentation de la dépêche et règne dujournalisme situationnel 113
3.1 Les caractéristiques de la dépêche 1133.1.1 Le factuel, mode de traitement traditionnel de la copie agencière 1143.1.2 L'expansion des papiers à attribut 1163.1.3 Une taille de dépêche normalisée 117
3.2 Le journalisme situationnel 1193.2.1 L'évolution de la demande 1203.2.2 Le journalisme de décryptage 1213.2.3 Un journalisme d'analyse fondé sur la parole des experts 124
-CHAPITRE 6-L'ÉCRITURE JOURNALISTIQUE 128Section 1 : Configuration A - Un texte journalistique narratif et descriptif qui induit unstyle journalistique personnel 128
1.1 Conjugaison des textes narratifs et descriptifs 128
1.2 La notion d'objectivité s'incarne à travers une énonciation journalistiquesubjective 131
Section 2 : Processus de normalisation de l'écriture agencière 135Section 3. Homogénéisation et normalisation de l'écriture agencière 137
3.1 Adoption d'un style d'écriture anglo-saxon 1383.2 Le style d'écriture comme outil d'offensive commerciale 140
3.2.1 Évolution du lead 1403.2.2 La recherche de la concision 141
3.3 Spécialisation linguistique et glocalisation de l'information 1433.4 Personnalisation de la copie : l'accroissement de la dépêche signée 155
TROISIÈME PARTIE : PRATIQUES ET IDENTITÉS PROFESSIONNELLES 159-CHAPITRE 7- LA CHAÎNE DE PRODUCTION DE L'INFORMATION 161
Section 1 -Nombre restreint de sources, des artisans de la dépêche nombreux 1621.1 Les sources 162
1.1.1 Un rapport direct aux sources 1621.1.2 Le poids des sources institutionnelles 1631.1.3 Le journaliste de l'AFP comme représentant de l'État français 1642.2.2 La dépêche, produit de la collaboration entre le correspondant et le rédacteur
168Section 2 : Transformations de la chaîne de production 170
2.1 À la conquête de nouvelles sources 1702.2 L'informatisation de l'agence modifie les conditions de la pratique journalistique :redéfinition des tâches professionnelles et renforcement des normes rédactionnelles
171Section 3 - Multiplication des sources et diminution du nombre d'artisans de la dépêche.
1743.1 Les sources : un rapport aux sources transformé, sources multiples, multiformes
1743.1.1 Accès aux sources transformé 1743.1.2 La professionnalisation des sources 1753.1.3 Internet comme source d'information 1783.1.4 Les chaînes d'information en continu : alerte et sources des journalistes 181
3.2 Un journalisme pris entre mimétisme et différenciation 1883.3 Les relations entre le correspondant étranger et le desk 190
-CHAPITRE 8- TECHNIQUES, TRANSMISSIONS ET COMMUNICATIONS 193Section 1 - Les transmissions au temps de la première configuration : autonomie etpolyvalence du correspondant 194
1.1 Un journaliste expert en transmissions 1941.2 Le relatif isolement du correspondant étranger 196
1.2.1 Isolement par rapport à la concurrence et à la rédaction centrale 1971.2.2 Un rédacteur multilingue 199
1.3 Incidences de la technique sur la copie 199Section 2- Transformations des rapports entre le correspondant et le desk et desmodalités de la concurrence 201
2.1 Des ressources multiples à la disposition du correspondant 2012.2 Journalistes sous le contrôle du desk 204
2.2.1 Le service Alerte et Analyse : journalistes sous surveillance 2042.2.1.1 Les call backs : évaluation de la veille concurrentielle exécutée par lesjournalistes 205
VI
2.2.1.2 Notes d'impact et pointages : évaluation des performances commercialesdes journalistes 2082.2.2.1 Une veille concurrentielle permanente 209
2.2.2 Un journalisme réflexif imprégné par la logique d'urgence 210-CHAPITRE 9-IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 214
Section 1 - Les journalistes entrés entre 1945 et 1960 2141.1 Formation 2141.2 Un engagement professionnel profond 216
1.2.1 Attachement et engagement professionnels 2161.2.2 Un état de santé fragilisé 2201.2.3 Une fidélité à l'agence au-delà de la mobilité du journaliste inter média 222
1.3 Conception de l'information et du rôle professionnel : L'information comprisecomme bien public et journalisme magister 224
Section 2 - Les journalistes entrés à l'agence entre 1960 et 1980 2262.1 Une formation universitaire et diversifiée 2262.2 Un engagement évolutif: de la fusion à la position de retrait 2292.3 Une conception de l'information en mutation et une conception professionnellepolitisée 231
Section 3 - Les journalistes entrés à l'agence entre 1990 et 2006 2353.1 L'école de journalisme, voie d'excellence 2353.2 Un engagement et un attachement dictés par des intérêts personnels 2373. 3 Une conception commerciale et individualiste du métier 239
CONCLUSION 242BIBLIOGRAPHIE THÉMATIQUE 248BIBLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 267LISTE DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS 278ANNEXES 280
vu
INTRODUCTION
Notre recherche se donne pour objectif d'identifier et d'expliquer les transformations
des pratiques et de l'identité professionnelles des correspondants étrangers de l'Agence
France Presse depuis cinquante ans. Nous pensons en effet qu'en raison des importants
changements qu'a connus l'environnement médiatique mondial au cours des dernières
décennies, les pratiques et l'identité professionnelles des correspondants étrangers de l'AFP
se sont profondément transformées. Nous expliciterons plus précisément cette hypothèse au
cours de notre introduction. Précisons dès à présent que le concept d'identité professionnelle
regroupe à la fois la conception que les journalistes se font de leur rôle professionnel, leur
statut socio - professionnel ainsi que les valeurs qui guident leur pratique.
Notre choix s'est porté sur le journaliste agencier car il exerce dans un média qui occupe une
place particulière au sein de l'espace médiatique mondial. Historiquement, les agences de
presse sont les premières organisations qui opèrent sur le plan mondial, à tous les niveaux, de
la mise en forme à la distribution en passant par le recueil des informations, constituant à ce
titre un élément incontournable dans la chaîne de production de l'information. De plus,
compte tenu de leur fonction de fournisseur d'informations pour une grande diversité de
médias, nous pensons que les règles traditionnelles du journalisme d'information -
objectivité, « factualité », rigueur, vérification - s'appliquent de manière plus impérative pour
les agenciers que pour les journalistes qui travaillent dans les autres médias. Il est donc
vraisemblable, comme nous le préciserons plus loin, que les facteurs qui contribuent à la
transformation du journalisme contemporain agissent sur eux différemment.
Les transformations du journalisme : une littérature abondante et diversifiée
II a été établi que le journalisme connaît une période de profonds changements. Les nombreux
travaux portant sur l'évolution des pratiques journalistiques empruntent différentes
perspectives. Un premier courant de recherche analyse l'évolution des pratiques
journalistiques sur un plan historique'.
D'autres travaux abordent également la question du changement dans les pratiques
journalistiques mais dans une perspective méthodologique différente. Ainsi, plusieurs
chercheurs ont pris le parti d'orienter leur analyse sur la spécialisation des journalistes. Des
travaux de plus en plus spécifiques sont publiés. Cela répond sans doute à une double
nécessité : celle de restreindre son objet d'étude pour pouvoir mener à terme sa recherche, et
une seconde qui répond à une évolution propre au journalisme contemporain : la
fragmentation. L'éclatement du journalisme entraîne une segmentation des études portant sur
l'évolution du journalisme. De nombreux travaux ont souligné la spécialisation2 de plus en
plus forte des journalistes. Dès la fin des années soixante, Jeremy Tunstall3 a produit une
étude sur les journalistes spécialisés de grands médias britanniques. Une spécialisation qui
peut être fonctionnelle ou thématique. Les travaux portant sur des spécialités du journalisme
se sont multipliés : travaux de Julien Duval4 et Philippe Riutort5 sur le journalisme
économique, travaux de Jean Charron6 sur le journalisme politique, travaux de Sandrine
Lévêque7 sur le journalisme social, les travaux de Patrick Champagne et Dominique Marchetti
' Schudson, Michael, Discovering the News, A Social History of American Newspapers, New York,Basic Books, Inc, 1978, 228 pages. Delporte, Christian, Histoire du journalisme et des journalistes enFrance, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1995, 128 pages. Delporte, Christian, Les journalistes en France,1880-1950: naissance et construction d'une profession, collection le Seuil, Paris, janvier 1999, 450pages.2 A ce sujet, la revue Réseaux a consacré un numéro au mouvement de spécialisation qui saisi laprofession journalistique : Neveu, Erik, Rieffel, Rémy, Ruellan, Denis, « Journalistes spécialisés »,Réseaux n° 111, Paris, 2002, 292 pages.3 Tunstall, Jeremy, Journalists at Work, Londres, Constable, 1971, 304 pages.4 Duval, Julien, Critique de la raison journalistique, les transformations de la presse économique enFrance, Le Seuil, Paris, 2004, 366 pages. Duval, Julien, « Concessions et conversions à l'économie. Lejournalisme économique en France depuis les années 80 », Actes de la recherche en sciences sociales,n°131-132, mars 2000, pp. 56-75.5 Riutort, Philippe, « Le journalisme au service de l'économie. Les conditions d'émergence del'information économique en France depuis les années 50", Actes de la recherche en sciences sociales,n° 131/132,2000, pp. 41-55.6 Charron, Jean, La production de l'actualité : une analyse stratégique des relations entre la presseparlementaire et les autorités politiques au Québec, éditions Boréal, Montréal, 1994, 446 pages.7 Lévêque, Sandrine, Les journalistes sociaux. Histoire et sociologie d'une spécialité journalistique,Rennes, Presses de l'université de Rennes, 2000, 234 pages.
sur le journalisme médical ou scientifique et ou ceux de Dominique Marchetti ou encore
ceux de Bertrand Dargelos sur le journalisme sportif9.
D'autres chercheurs ont focalisé leurs recherches sur des tendances spécifiques du
journalisme contemporain. Ainsi plusieurs chercheurs évoquent le développement du
«journalisme de marché »10. Depuis deux décennies, les exigences commerciales et le
marketing pèsent plus lourdement sur la pratique du journalisme. Le journalisme de marché
ou « market driven journalism » se traduit par la recherche de la rentabilité maximale de
l'activité des journalistes et du fonctionnement des entreprises de presse. Le monde de
l'information tend à devenir un domaine d'activités qui n'est plus entre les mains des seuls
journalistes mais dans lequel les gens d'affaires ont, de plus en plus, leur mot à dire. Ainsi
Mathien observe que la présence croissante des « gestionnaires-décideurs » et des hommes de
commerce au sein de l'entreprise de presse, davantage préoccupés par le marketing et la
communication que par l'information, «fait que les journalistes ne constituent plus le seul et
unique groupe professionnel déterminant dans les entreprises médiatiques »".
D'autres travaux de recherche traitent des mutations survenues sur le marché du travail
journalistique. Alain Accardo12 a ainsi étudié le mouvement de précarisation qui totiche
Champagne, Patrick et Marchetti, Dominique, « L'information médicale sous contrainte. À proposdu « scandale du sang contaminé » » , Actes de la recherche en sciences sociales, n° 101-102, mars1994, pp. 40-62.9 Marchetti, Dominique, « Les transformations de la production de l'information sportive: le cas dusport-spectacle», Les Cahiers du Journalisme, n°ll, décembre 2002. Marchetti, Dominique etDargelos, Bertrand, « Les professionnels de l'information sportive. Entre exigences professionnelles etcontraintes économiques », Regards sociologiques, n°20, 2000, pp. 67-87.10 McManus, John, Market Driven Journalism : Let the Citizen Beware?,, Sage, Londres, 1994. Lathèse de McManus a été reprise par Michel Mathien : Mathien, Michel, « Le journalisme professionnelface aux mutations de l'information et de la communication », Quaderni, n°37, 1998-1999, pp.11-42.Eveno, Patrick, L'argent de la presse française des années 1820 à nos jours, Paris, éditions du Comitédes travaux historiques et scientifiques, 2003, 236 pages.1 ' Mathien, Michel, Les journalistes et le système médiatique, Hachette université communication,1992, page 7.12 Accardo, Alain, dir., Journalistes précaires, Bordeaux, le Mascaret, 1998, 411 pages.
l'ensemble de la profession, alors que Rémy Rieffel a mis en exergue deux qualités exigées
aujourd'hui par les entreprises de presse : la mobilité et la polyvalence.13
En Amérique du Nord, plusieurs chercheurs ont mené des travaux portant sur l'émergence du
journalisme public14. Le journalisme public repose sur une critique de la fonction sociale
traditionnelle du journalisme. Ce concept, nommé également civic journalism, est apparu aux
États-Unis au début des années quatre-vingt-dix. Il porte sur différentes expériences menées
par des journaux pour susciter et encourager la participation démocratique du public. Ces
différentes appellations recouvrent une même réalité : la redéfinition de la position
traditionnelle du journaliste dans la société. Le journaliste ne doit plus se limiter à transmettre
de l'information, il doit susciter le débat démocratique et encourager les actions collectives.
Une autre évolution du journalisme contemporain est désignée alternativement sous les termes
de tabloïdization du journalisme15, marketization/l5 ou encore popularization'7. La
tabloïdization est un processus qui se caractérise par une accentuation des aspects dramatiques
et sensationnels des événements et privilégie des réalités comme les faits divers, les scandales,
la vie des célébrités ou le sport. Ce type de contenus est associé à un format spécifique qui
privilégie les effets visuels. Plusieurs observateurs jugent sévèrement ce type de journalisme
car, non seulement la tendance à la tabloïdization fait craindre une uniformisation des
contenus et un nivellement par le bas, mais ils y voient une remise en question de l'existence
3 Rémy, Rieffel, «Vers un journalisme mobile et polyvalent?», Quaderni n°45, automne 1991,pp.153-169.
' Watine, Thierry, « Journalistes : une profession en quête d'utilité sociale », Les Cahiers duJournalisme n° 2, Lille, décembre 1996, 396 pages. Beauchamp, Michel, Watine, Thierry,« Journalisme public et gestion des enjeux sociaux : étude de la campagne 'spécial emploi' du journalLe Soleil de Québec», Communication, vol.19, n°2, hiver 1999/2000, pp. 91-121. Beauchamp,Michel, Watine, Thierry, « Le journalisme public aux États-Unis : émergence d'un nouveau concept »,in Les Cahiers du journalisme, n°l, juin 1996, pp. 142-159. Le lecteur pourra également se reporter aunuméro spécial des Cahiers du journalisme, « Le journaliste acteur de société », n°2, décembre 1996,200 pages.15 Connell, Ian, « Mistaken identities : Tabloid and broadsheet news discourse ». Javnost-The Public,Vol. 5, n° 3, 1998, pp. 11-31. Bird, S.Elizabeth, « News we can use : An audience perspective on thetabloïdisation of news in the United States ». Javnost-The Public, vol. 5, n° 3, 1998, pp. 33-49.16 Fairclough, Norman, Media discourse, Edward Arnold, Londres, 1995, 224 pages.17 Dahlgren, Peter, Télévision and the public sphère, Sage, Londres, 1995. Eide, Martin, « A new kindof newspaper ? : Understanding a popularization process », Media, culture & society, vol. 19, n°2,1997, pp. 173-182.
même de la sphère publique. La popularisation du journalisme rendrait de plus en plus faible
la marge de manœuvre dont dispose l'audience potentielle de ces médias pour former sa
propre opinion. La notion d'infotainment (le terme est le produit de la contraction de
information et de entertainmeni) est apparentée à celui de tabloïdization. Elle désigne plus
particulièrement la présence de plus en plus marquée d'éléments de divertissement dans
l'information; plus encore, c'est l'information elle-même qui, pour attirer les auditoires,
adopte les formes, le ton et le registre du divertissement. L'infotainment se conjugue avec la
tabloïdization dans la mesure où l'information est vendue comme un produit de
divertissement, « les données sont converties dans les catégories suivantes : l'intérêt humain
et les soft news »18. A propos de la presse quotidienne, McManus écrit : « (...)/'intérêt des
journaux s'est déplacé vers de sujets tels que laparentalité, les loisirs et le shopping (...) »19
Si les travaux portant sur les transformations du journalisme contemporain sont nombreux,
leurs auteurs traitent d'un changement particulier et omettent de les intégrer dans un processus
de transformation global du journalisme. A cet égard, François Demers propose une
explication politique aux transformations du journalisme contemporain. Considérant le cas du
journalisme au Québec, il y voit un processus de « destruction créatrice » qui mène à une
« déstructuration- restructuration » du journalisme. Selon lui, on passe d'un journalisme
classique à un journalisme « fonctionnel », pragmatique, qui correspond au changement du
système politique. Demers situe en effet ce processus dans le contexte du déclin de l'État-
Providence au profit d'un État libéral. Ce changement se traduit sur le plan des pratiques
d'information, par le repli de l'éditorial, la montée de l'information ludique et la promotion de
l'enquête. La remise en cause de l'État-providence conduit alors à une nouvelle logique de
l'information. «Ayant perdu son axe central et pôle d'attraction : le politique, l'information
devient un territoire où la hiérarchie des contenus et des priorités est déterminée par le
18 Djupsund, Goran, Carlson, Tom, Trivial Stories and Fancy Pictures, Suède, 2001, page 65 : « thematerial is converted in catégories ofhuman interest and soft news » (traduction réalisée par l'auteur).19 McManus, John, Market Driven Journalism : Let the Citizen Beware?, Sage, Londres, 1994, page 7: « Newspapers are now moving 'to embrace such topics asparenting or hobbies or shopping (...) »(traduction réalisée par l'auteur).
marché/public »20. Il s'ensuit une modification de la hiérarchie des objets du discours de
presse : «Avant les contenus de l'information s'organisaient dans un ordre hiérarchique de
priorités et de valeurs qui s'éloignaient graduellement du centre/sommet, c 'est-à-dire de la
politique pure et dure, passant par les réalités sociales et économiques susceptibles de
traduction, puis les arts de la haute culture, puis le sport, puis les arts populaires, jusqu 'au
sang et aux potins. Aujourd'hui chaque domaine de couverture peut s'autonomiser et
développer ses propres façons de faire, ses pratiques dominantes et même ses normes
éthiques». Me Quail21 abonde dans le même sens en évoquant la dépolitisation de la vie
sociale, qui serait directement liée à la perte de prestige des institutions politiques dans les
médias. La perte de puissance de l'État dans la société et l'augmentation de la logique
commerciale conduisent le journalisme à revêtir de nouveaux habits.
Les chercheurs québécois, Jean Charron et Jean de Bonville procèdent depuis plusieurs
années à une analyse globale de la transformation du journalisme au sein du Groupe de
recherche sur les mutations journalistiques (GRMJ) de l'université Laval. Ils ont publié en
2005 avec la collaboration de Colette Brin22, une synthèse de leurs recherches présentant
conjointement une théorie du changement journalistique et des recherches empiriques
réalisées par plusieurs chercheurs nord-américains. Ils proposent une théorie des changements
paradigmatiques du journalisme. Les auteurs constatent que les transformations que connaît le
système médiatique depuis une vingtaine d'années conduisent les journalistes à procéder à des
ajustements dans leurs pratiques et leurs normes professionnelles; ces ajustements conduisant
à l'émergence d'un nouveau paradigme journalistique. Après le développement du
journalisme d'opinion (qui se maintient jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle) et journalisme
d'information (apparu au début du vingtième siècle), nous assisterions à l'émergence du
journalisme de communication. Ce paradigme journalistique se caractérise notamment par une
conception différente de l'information : « (...) La notion d'information recouvre, dans le
journalisme contemporain, un champ sémantique beaucoup plus large que la stricte
20 Demers, François, « Impacts des nouvelles technologies de l'information et de la communication(NTIC): Déstructuration (et restructuration?) du journalisme », Technologies de l'information etSociété. Vol. 8. No 1, pp. 55-70.21 Mac Quail, Denis, « Research into Political Communication and the Current Crisis of Media anDemocracy », revue de l'Institut de sociologie, n°l-2, université libre de Bruxelles, 1995, pp. 47-57.12 Brin, Colette, Charron, Jean, de Bonville, Jean (sous la direction de), Nature et transformation du
journalisme, Théorie et recherches empiriques, les Presses de l'université Laval, Québec, 2005, 454pages.
« actualité » ; les objets dont traite la presse et la manière de les aborder se diversifient.
L'élargissement de la notion d'information tient aussi au fait que le journaliste s'adresse à un
public perçu comme un ensemble de consommateurs plutôt que de citoyens »23.
Selon les auteurs, le nouveau paradigme du journalisme de communication serait le produit
des stratégies des acteurs qui participent au système de presse : « Par des innovations et par
l'imitation de ces innovations, de nouvelles pratiques, et de nouvelles conceptions émergent et
se répandent jusqu 'à constituer une nouvelle orthodoxie professionnelle, c 'est-à-dire un
nouveau paradigme journalistique ».24 Ils en déduisent que cette matrice transforme non
seulement les pratiques, mais la fonction sociale de la presse, l'identité sociale des
journalistes, le rapport au public et les modèles et postulats dont se réclame le journalisme.
L'accentuation des fonctions expressive et phatique (le « contact ») du discours d'information
tend à faire du journalisme nord-américain une pratique de communication, au sens fort du
terme.
Notre thèse s'inscrit dans la démarche empruntée par ces chercheurs dans la mesure où notre
travail vise à identifier les transformations des pratiques et de l'identité journalistiques, mais
aussi à les inscrire dans un processus global de transformations du journalisme.
Le choix des correspondants étrangers de l'Agence France Presse
Les agenciers font bel et bien partie du système médiatique mondial - et ce qui affecte le
système les affecte aussi -, mais ils occupent dans ce système une position qui leur est
spécifique, d'où l'intérêt de les étudier spécifiquement.
D'autre part, nous avons choisi de circonscrire notre étude aux correspondants étrangers car
nous considérons que les journalistes producteurs de l'information internationale sont
!3 De Bonville, Jean, Charron, Jean, « Le paradigme du journalisme de communication : essai dedéfinition », Communication, vol.17, n°2, 1996, page 75.24 De Bonville, Jean, Charron, Jean, « Le paradigme du journalisme de communication : essai dedéfinition », Communication, vol. 17, n°2, 1996, page 88.
susceptibles d'avoir ressenti avec davantage d'intensité que les autres journalistes certaines
transformations de l'environnement mondial de l'information et leurs répercussions au sein de
leur entreprise. La position géographique du correspondant par rapport à l'agence nous laisse
penser que celui-ci est plus que tout autre journaliste également susceptible d'être soumis à
des tensions provenant de l'environnement. Comme tout journaliste, il est également
susceptible d'être soumis à des pressions provenant de l'entreprise, il est possible toutefois
que ces pressions soient moins fortes compte tenu de son éloignement.
Enfin, l'Agence France Presse, première agence de presse à avoir été créée, a conservé depuis
sa création un statut particulier, semi - étatique. Ce statut ne lui permet pas d'adopter une
stratégie libérale à l'image de ses deux concurrentes, Associated Press et Reuters, l'AFP mène
en parallèle une logique d'usager et une logique commerciale. Elle dispose par ailleurs de
moyens financiers qui sont moindres en comparaison des deux autres agences internationales
et qui limitent ses capacités de développement.
L'ancienneté de l'AFP, son budget financier réduit et son statut laissent à penser qu'elle
rencontre des difficultés à suivre l'évolution de son environnement. Pour autant, l'AFP
souhaite rester un des principaux fournisseurs d'information sur le plan mondial et elle tente
de s'adapter aux changements de son environnement.
Nous pensons que les changements opérés au sein de l'agence, de la pratique et de l'identité
de ses journalistes vont être d'autant plus aisément identifiables dans cette agence que les
changements initiés par la direction sont discontinus. Les caractéristiques de l'agence et de
ses pratiques sont particulièrement distinctes en fonction des périodes temporelles. Si les
journalistes disposent de caractéristiques particulières en fonction du poste qu'ils occupent, du
média pour lequel ils travaillent, pour autant, ils sont tous confrontés aux mêmes changements
de leur environnement, même s'ils les éprouvent à des degrés différents. Cependant les
observations des chercheurs (sur la subjectivité, les nouvelles thématiques, la tabloïdization,
le sensationnalisme, Yinfotainment, etc.) et leurs explications portant sur les médias
(concentration et fmanciarisation de la propriété, financement publicitaire, concurrence sur le
marché publicitaire, etc.) ne s'appliquent que partiellement aux agences de presse, qui ne sont
pas des « médias » au même titre que les autres. Par ailleurs on peut penser qu'en raison de
leur fonction dans le système médiatique - fournisseur d'informations brutes et factuelles
destinées à une grande variété de clients disséminés un peu partout dans le monde - les
agences sont plus attachées aux normes du journalisme traditionnel et moins disposées à les
changer. Bref le cas des agences de presse demeurent un point d'ombre dans le débat actuel
sur les transformations du journalisme, d'où la pertinence de la thèse.
La partie empirique de notre démarche (observation et analyse des données) portera
exclusivement sur les journalistes agenciers de l'Agence France Presse qui ont exercé dans un
bureau étranger de l'agence entre 1945 et aujourd'hui. Nous avons réalisé des entretiens semi-
dirigés auprès de quarante-cinq journalistes de trois générations successives. Ces entretiens
ont été complétés par une période d'observation participante menée par la chercheuse durant
un mois au bureau du Caire, en Egypte.
La démarche
Nous consacrerons la première partie de notre thèse aux fondements théoriques de notre
question de recherche : comment aborder le changement journalistique ? Nous présenterons
successivement les concepts mis en œuvre à cet effet et la construction de notre cadre
théorique fondé sur le concept de configuration, au sens que lui donne Norbert Elias.
Nous faisons l'hypothèse que l'environnement médiatique, l'entreprise de presse et les
pratiques journalistiques ont connu un changement de configuration entre 1945 et 2005. La
configuration formée par l'environnement médiatique mondial et le jeu des acteurs s'est
caractérisée par un changement progressif de son mode de régulation, évoluant d'une
régulation à dominante politique à un mode de régulation dans lequel les considérations
économiques et commerciales se font plus présentes. La régulation qualifie les rapports entre
les différents acteurs de l'environnement médiatique mondial, et notamment ceux
qu'entretient l'Agence France Presse avec ses différents partenaires. Dans la configuration du
début de la période étudiée, les principes qui régissent ces rapports sont de nature politique et
économique. Toutefois, les choix stratégiques de l'AFP et les pratiques des journalistes sont
orientés vers une finalité davantage politique que commerciale. Progressivement, il va y avoir
un déplacement des orientations des acteurs de la production d'information. La finalité
économique prend le pas sur la finalité politique, nous considérons alors qu'à la fin de la
période, la régulation de la configuration est davantage d'ordre économique. L'AFP et ses
journalistes adoptent des stratégies qui sont guidées par une motivation avant tout
économique. Afin de mettre en relief les caractéristiques distinctives des deux configurations,
nous construirons pour chacune un idéal type de l'environnement médiatique, de l'entreprise
de presse, de la dépêche, des pratiques et de l'identité professionnelle des journalistes.
Nous achèverons notre première partie par une première analyse de l'évolution de l'Agence
France Presse. Dans la seconde partie, nous analyserons la dépêche tant du point de vue de ses
caractéristiques formelles que de ce qu'elle donne à voir et à lire des transformations des
pratiques et de l'identité journalistiques. Nous étudierons successivement les contenus
informationnels, la hiérarchisation de la dépêche et enfin l'évolution de l'écriture des
agenciers. Dans la troisième partie de notre thèse, nous procéderons à l'analyse des pratiques
journalistiques selon deux axes : la chaîne de production de l'information et l'évolution des
techniques de transmission et de communication. Le dernier chapitre sera consacré aux
transformations de l'identité professionnelle du journaliste qui nous permettra à la lumière des
entretiens que nous avons menés, de déterminer une identité professionnelle propre à chacune
des trois générations de journalistes.
Comme nous l'avons précisé plus haut, notre cadre théorique s'articule selon trois niveaux,
mais ce qui nous intéresse tout particulièrement ce sont les transformations survenues au
niveau micro sociologique, loin de négliger les deux autres niveaux d'analyse, nous porterons
un intérêt tout particulier aux pratiques et identité professionnelles des journalistes.
10
-CHAPITRE 1- PRÉSENTATION DES CONCEPTS
Dans ce chapitre, nous nous proposons de définir les différents concepts en jeu dans notre
recherche, à savoir l'environnement médiatique et la globalisation, l'entreprise de presse et les
pratiques et identité professionnelles journalistiques. Nous les articulerons ensuite au sein de
notre modèle théorique que nous présenterons dans le chapitre suivant.
Poser la question de l'évolution des pratiques et de l'identité professionnelle des
correspondants étrangers de l'AFP depuis 1945 requiert un certain nombre de concepts pour
désigner les facteurs qui interviennent directement ou indirectement dans la pratique
quotidienne des agenciers et dans la construction de leur identité professionnelle. Le
journaliste est un acteur qui agit en fonction de son environnement que ce soit au niveau
micro sociologique ou au niveau macro sociologique. La pratique et l'identité professionnelle
du journaliste sont donc le produit d'une interaction entre plusieurs environnements qui se
superposent25 et influencent considérablement le journaliste. Comme nous le préciserons dans
le second chapitre, nous distinguons trois niveaux d'analyse, à chaque niveau d'analyse
correspond un ou plusieurs facteurs que nous présentons dans le premier chapitre, parmi
lesquels, l'environnement médiatique mondial (niveau macro sociologique), l'entreprise de
presse (niveau meso sociologique), la pratique journalistique et l'identité professionnelle
(niveau micro sociologique).
25 Notre méthode s'inspire de celle des chercheurs Jean de Bonville et Jean Charron qui mènent desrecherches portant sur les mutations du journalisme. Afin d'élaborer leur modèle explicatif, ils ontréalisé une figure représentant les différents paramètres constitutifs de leur problématique. Constituéedes différentes variables qui participent à la pratique journalistique, cette figure distingue notamment,le texte journalistique, le texte journalique, la pratique journalistique, les journalistes, l'organisation depresse, la production médiatique, les médias, les sources d'information, les sources de financement, lepublic, les pratiques culturelles et les valeurs, les institutions socioculturelles, le droit et le systèmepolitique et l'économie. Brin, Colette, de Bonville, Jean et Charron, Jean, Nature et transformation dujournalisme. Théorie et recherches empiriques, Presses de l'Université Laval, Québec, 2005, chapitre3: « Les mutations du journalisme modèle explicatif et orientations méthodologiques », pp. 87-120.
12
Section 1 - Environnement médiatique et globalisation
Lorsque nous évoquons l'environnement médiatique mondial, nous nous situons d'un point de
vue macro-sociologique. L'environnement médiatique mondial désigne à la fois les différents
acteurs médiatiques pris séparément (les bailleurs de fonds, les entreprises de presse, les
annonceurs, etc.) et les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres.
Depuis une vingtaine d'années, les relations entre les différents acteurs de l'environnement
médiatique mondial se sont intensifiées de telle sorte qu'aujourd'hui la grande majorité des
analystes qualifient cet environnement de « globalisé ».2 Le concept de globalisation et celui
de mondialisation sont, pour certains chercheurs, interchangeables; pour notre part nous
opérons une distinction entre les deux concepts. Nous devons préciser que l'emploi du terme
"globalisation" dans notre travail ne constitue pas un anglicisme. Il ne désigne pas la même
réalité que la notion de mondialisation. Le terme « globalisation » a été directement emprunté
à la langue anglaise to "globalize" dans les années soixante; la notion de globalisation a
réellement pris de l'amplitude dans les années quatre-vingt et renvoie avant tout à l'extension
de la sphère économique et commerciale à toutes les autres sphères de la société. Le terme de
« mondialisation » désigne plutôt un processus historique qui conduit les individus, les
activités humaines et les structures politiques à entretenir des rapports d'interdépendance
croissants et à multiplier les échanges entre eux. La globalisation se distingue de la
mondialisation notamment d'un point de vue chronologique, puisque la globalisation se situe
dans le prolongement de la mondialisation. En terme d'échelle, la globalisation traduit un
niveau d'interdépendance supérieur à la mondialisation. L'interconnexion entre les différentes
dimensions est considérée comme une caractéristique essentielle de la globalisation des
médias. « La multidimensionnalité ne doit pas être comprise comme une simple addition de
26 Les ouvrages portant sur le phénomène de globalisation sont nombreux, nous proposons ici unesélection d'ouvrages dont la lecture nous semble primordiale pour saisir les enjeux de ce mouvement :Michalet, C. A., Qu'est ce que la mondialisation ?, La Découverte, Cahiers Libres, 2002 ; Hirst,Thompson, J. B, Globalization in Question, Cambridge, Polity Press, 1996, 336 pages; Held, David,Mac Grew, Anthony, Goldblatt, David, Perraton, Jonathan, Global Transformations, Politics,Economies and Culture, Stanford, 1999; Laidi, Zaiki, Le temps mondial, éditions Complexe,Bruxelles, 1997, 313 pages; Mattelart, Armand, La mondialisation de la communication, PUF, 4e éd.,Paris, juin 2005, 126 pages; Mattelart, Armand, Histoire de l'utopie planétaire, La Découverte, Paris,2005, 422 pages ; Badié, Bertrand, La fin des territoires, Fayard, 1995, 276 pages.
13
sphères différentes » , les différentes dimensions fonctionnent de façon simultanée et en
interdépendance.
Le concept de globalisation a fait l'objet de plusieurs interprétations témoignant ainsi de la
difficulté à circonscrire la globalisation à son seul concept théorique. Nous pouvons recenser
trois courants de pensée qui procèdent à la théorisation du mouvement de globalisation : les
hyperglobalistes, les sceptiques et les transformationnalistes. Les hyperglobalistes considèrent
la globalisation comme un phénomène essentiellement économique qui se traduit par la fin de
l'État Nation. Le second courant de pensée qui regroupe les sceptiques considère que la
globalisation est un mythe28. Ils considèrent que la globalisation et la régionalisation
constituent des tendances contradictoires. Par ailleurs, les sceptiques ne considèrent pas
l'internationalisation comme préfigurant l'émergence d'un nouveau pouvoir étatique central
et rejettent l'idée selon laquelle le pouvoir des gouvernements et des États serait sapé par
l'intervention de la politique globale. Enfin le troisième courant de pensée de la globalisation
défend la thèse transformationnaliste. Les transformationnalistes considèrent que la
globalisation est le moteur central de changements rapides à la fois sociaux, économiques,
culturels et politiques, modifiant ainsi la structure des sociétés modernes et celui de l'ordre
mondial. Si nous devions nous situer dans une école de pensée, celle des
transformationnalistes correspondrait à notre approche dans la mesure où nous considérons la
globalisation comme un mouvement qui au-delà de la transcendance des frontières
territoriales et étatiques, se caractérise par son aspect multidimensionnel.
Toutefois, à plus d'un titre, nous n'utiliserons pas le concept de globalisation comme seul
facteur explicatif des transformations journalistiques tant du point des pratiques que de
l'identité des journalistes. Si, nous considérons à l'instar d'Armand Mattelart que le concept
de globalisation constitue avant tout un « prêt à porter idéologique » : « Le terme de
globalisation évoque incontestablement les nouvelles modalités de l'interdépendance des
économies ainsi que des cultures. Il n'empêche qu'il s'enchâsse dans une configuration
idéologique. La représentation de la « communauté globale » qu 'il charrie exprime une façon
particulière de découper le processus historique d'unification du monde. Ce biais fait d'un
27 Michalet, C. A., Qu 'est ce que la mondialisation ?, La Découverte, Cahiers Libres, 2002, page 20.28 Hirst, Thompson, J. B, Globalization in Question, Cambridge, Polity Press, 1996, 336 pages.
14
phénomène aux dimensions multiples, symboliques et réelles, le socle d'une pensée unique.
(...) L 'environnement d'atopie sociale qui a présidé à son intronisation comme sens commun
pour désigner l'état et l'avenir de la planète est pour beaucoup dans le flou qu'il
entretient.»7' D'autre part, il faut distinguer la globalisation des médias et la globalisation de
la diffusion de l'information et la globalisation de sa réception. Si nous pouvons évoquer la
globalisation des moyens d'information, des entreprises d'information, le message délivré par
les médias est loin d'être global si on entend par globalisation, l'homogénéisation des
contenus.
Enfin, nous considérons que la nature des processus qui régissent une société est diverse. « La
société moderne ne forme pas un tout unifié, un système intégré mû par une force unique. Il y
a des logiques et des tendances multiples qui interfèrent. La modernité est
multidimensionnelle »30, en conséquence la globalisation ne peut à elle seule être considérée
comme seul facteur explicatif des transformations de l'environnement médiatique.
Au regard de notre objet de recherche, nous portons notre intérêt sur des dimensions de
l'environnement médiatique associées à la globalisation : l'hyper concurrence, les nouvelles
technologies, l'effacement des frontières politiques et territoriales.
• La dimension économique
Le système global des médias se caractérise notamment par des aspects économiques
spécifiques. La globalisation se traduit par un processus de concentration qui mène à un
contrôle de la distribution du contenu des médias par un petit nombre de multinationales. La
concentration peut être définie comme « un processus économique et financier qui caractérise
un marché marqué à la fois par la réduction du nombre des acteurs et l'augmentation de leur
29 Mattelart, Armand, «Vers une globalisation» In Flichy, Patrick et d'Iribarne, Alain,« Communiquer à l'ère des réseaux », Réseaux n°100, 2000, pp. 83-84.30 Giddens, Anthony, entretien, Sciences Humaines, n°84, juin 1998, page 39.
15
envergure »31. Ce processus de concentration peut revêtir deux types de concentration : une
concentration verticale et une concentration horizontale.
Lorsque la concentration est particulièrement intensive et se développe dans différents
secteurs de production, on parle alors d'intégration multisectorielle. « Une intégration est dite
multisectorielle lorsqu 'une entreprise contrôle plusieurs types de médias différents et dans le
même temps se trouve impliquée dans d'autres activités connexes »32. Les conglomérats
médiatiques incarnent cette intégration multisectorielle même si l'origine de leur création se
situe au XIXème siècle. La globalisation des médias se traduit donc par la réduction du
nombre de groupes médiatiques. Dans son ouvrage « The Media Monopoly »33, Ben
Bagdikian souligne que le nombre de groupes médiatiques a diminué considérablement, « en
1996, le nombre de corporations médiatique disposant d'un pouvoir de domination dans la
société était au nombre de dix »34. John B. Thompson35 ajoute une dimension géopolitique
transnationale à la notion de conglomérat médiatique. Les conglomérats médiatiques mènent
une politique d'expansion de leur activité hors de leur région d'origine. Les intérêts
industriels et financiers sont de plus en plus importants et participent aux politiques globales
expansionnistes et de diversification.
Sur le plan économique, l'environnement médiatique mondial se traduit également par une
intensification de la concurrence. Le contexte de concurrence voire d'hyper concurrence n'est
pas seulement dû au processus de globalisation mais à la révolution industrielle des sociétés.
Nous reprendrons à notre compte la notion d'hyper concurrence telle que définie par Charron
et de Bon ville36, l'hyper concurrence désignant à la fois une intensification du jeu
31 Raboy, Marc, Les médias québécois, presse, radio, TV, inforoute, Montréal, Gaétan Morin, 2000 (2e
éd.), p.386, in « La concentration de la presse à l'ère de la convergence », dossier remis à lacommission de la culture de l'Assemblée Nationale du Québec, CEM, sous la direction de F.Sauvageau, février 200132 Sauvageau, Florian, La concentration de la presse à l'ère de la convergence, dossier remis à lacommission de la culture de l'Assemblée Nationale du Québec, CEM, février 2001, page 10.33 Bagdikian, Ben, The Media Monopoly, Beacon Press, 1997, 251 pages.
Bagdikian, Ben, The New Media Monopoly, Beacon Press, 2004, 368 pages.34 Bagdikian, Ben, in News, a Reader, Tumber Howard, Oxford University Press, 1999, page 150 : «in1996, the number of média corporations with dominantpower in society is doser to ten.»35 Thompson, J. B., The Media and The Modernity, a social theory ofthe Media, Polity Press, 1995.36Charron, Jean, de Bonville, Jean, «Le journalisme et le marché: de la concurrence à l'hyperconcurrence », chapitre 8 in Brin, Colette, Charron, Jean, de Bonville, Jean, Nature et transformation
16
concurrentiel, des rapports d'interdépendance et un élargissement du champ dans lequel la
lutte concurrentielle se joue. « L'attention du consommateur est aujourd'hui sollicitée par une
offre d'information qui atteint un volume et une diversité sans précédent, les conditions
techniques de réception des messages rendent cette attention très volatile, voire capricieuse,
le consommateur jouit aujourd'hui de la possibilité de passer d'un message à l'autre
librement, rapidement (...) les conditions techniques de production permettent aux
journalistes de savoir en temps réel ou presque comment les concurrents couvrent les
événements en cours; ils ont aussi la possibilité de savoir en temps réel ou presque comment
les concurrents couvrent les événements en cours (...) » .
• La dimension technologique
L'apparition de nouvelles techniques est assimilée à la dimension technologique de la
globalisation. En effet, les techniques de production, de transmission et de distribution de
l'information se sont modifiées considérablement ces vingt dernières années.
Nous distinguons quatre développements décisifs :
- Le développement du câble a permis une très grande capacité de transmission de
l'information.
- L'extension des satellites de communication. Les satellites sont intégrés dans les
réseaux de télécommunication habituels. Les satellites permettent d'introduire des
programmations directes par satellite. Ils constituent de nouveaux systèmes de
distribution en dehors des réseaux de programmation territorialisés et sont donc par
nature transnationaux.
- L'utilisation croissante des méthodes digitales de processus d'information et de
stockage. La digitalisation de l'information combinée au développement des
technologies électroniques ont amélioré considérablement la capacité de stockage et de
transmission de l'information et ont été les fondements de la convergence des
du journalisme, théorie et recherches empiriques, Les Presses de l'Université Laval, Québec, 2005,pp. 273-316.37 Brin, Colette, Charron, Jean, de Bonville, Jean, Nature et transformation du journalisme, théorie etrecherches empiriques, Les Presses de l'Université Laval, Québec, 2005, page 275.
17
technologies de l'information et de la communication. L'information peut alors être
convertie d'un support médiatique à un autre. La convergence des supports
médiatiques induit une convergence des langages.
- La miniaturisation des outils.
• La dimension politique et géopolitique
La conceptualisation de la globalisation a été développée par différents chercheurs anglo-
saxons et français. Bien qu'ils explorent parfois des voies divergentes comme nous allons le
constater, ces chercheurs partent d'un postulat commun : la globalisation met fin au modèle
étatique traditionnel.
La globalisation transcende les frontières traditionnelles de l'État. Bien qu'ils restent des
acteurs incontournables, les États et les gouvernements doivent s'adapter à une nouvelle
réalité. Le modèle westphalien qui décrivait « le développement de l'ordre mondial constitué
d'États souverains (...) »38 n'a plus cours. Si auparavant on déterminait un État par son
territoire, sa souveraineté, son autorité, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les flux
interrégionaux et globaux ont transformé et étendu les espaces et nécessairement dépassé les
limites territoriales traditionnelles. La globalisation fait éclater la notion de territoire, le
pouvoir réel transcende les frontières et les politiques globales mettent fin aux distinctions
traditionnelles entre les affaires intérieures et l'international, entre l'interne et l'externe, entre
la politique territoriale et la politique extérieure.
La globalisation telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui a engendré non pas la fin de l'État
mais un nouveau contexte et de nouvelles structures de l'État. C'est le lieu du Politique qui a
changé.
î8 Held, David, Mac Grew, Anthony, Goldblatt, David, Perraton, Jonathan, Global Transformations,Politics, Economies and Culture, Stanford, 1999, page 30.
IX
Des concepts connexes à celui de globalisation politique ou géopolitique seront développés
dans cette recherche. Toutefois, il nous semble important d'associer la globalisation à deux
logiques : la régionalisation et la glocalisation. La globalisation s'est accompagnée de la
création ou du renforcement de groupes régionaux. Ces nouveaux groupes régionaux sont
définis par les auteurs de l'ouvrage « Global Transformations » comme « un ensemble d'États
voisins qui partagent des points communs, qui pratiquent de nombreuses interactions, et qui
souhaitent développer une coopération institutionnalisée par une structure multilatérale
officielle. »39
Loin d'aller à rencontre du mouvement de globalisation, ces regroupements régionaux
participent à la construction d'un monde interrelié en contribuant à une meilleure
identification des acteurs et luttant ainsi contre l'exclusion de certains pays du mouvement de
globalisation. La globalisation ne peut être comprise comme un "tout global" mais comme
une mise en interrelation de différents groupes aux points communs aussi divers que la
langue, la tradition, les intérêts idéologiques, économiques. La glocalisation constitue un autre
concept satellite de la globalisation politique. La glocalisation correspond à une
interpénétration du local dans le global. Ce terme désigne la nécessité pour les entreprises et
les médias d'un compromis entre les exigences de la mondialisation des marchandises et
celles des habitudes ou des cultures locales. Pour le chercheur en science politique, Zaiki
Laidi, le « temps mondial »40 (qu'il identifie à la globalisation) est une matrice qui s'actualise
en permanence, c'est le lieu de tous les enchaînements mais aussi de toutes les disjonctions.
Ces enchaînements et disjonctions donnent lieu à l'apparition de médiations sociale, culturelle
et régionale qui n'ont pas nécessairement pour objet de choisir entre le global et le local mais
bien de réconcilier ces deux réalités, c'est-à-dire « diffuser le global dans le local ».
Ce concept met en évidence le rapport entre la diffusion globalisée par les médias et
l'appropriation localisée de l'information. « L'appropriation des produits médiatiques est
toujours un phénomène localisé, dans le sens où il induit des individus particuliers qui sont
19 Held, David, Mac Grew, Anthony, Goldblatt, David, Perraton, Jonathan, Global Transformations,Politics, Economies and Culture, Stanford, 1999, page 74.40 Laidi, Zaiki, Le temps mondial, éditions Complexe, Bruxelles, 1997, 313 pages.
19
dans des contextes socio-historiques particuliers, et qui exploitent les ressources dont ils
disposent pour donner un sens aux messages médiatiques et les incorporer à leurs vies. »41
Section 2 - L'entreprise de presse
L'entreprise de presse est un concept essentiel de notre analyse, elle constitue la « variable
intermédiaire » en ce sens que la structure de l'entreprise de presse, sa nature, sa position sur
le marché, son statut économique, son organisation conditionnent, en aval, la pratique
journalistique et sont eux - mêmes influencés, en amont, par l'environnement médiatique
mondial.
L'entreprise de presse possède toutes les caractéristiques communes à l'ensemble des
entreprises : elle a un mode de propriété et de financement, une méthodologie de gestion, des
moyens techniques de production, une culture organisationnelle, etc. Mais, en tant
qu'entreprise de presse, elle comporte des caractéristiques spécifiques, comme celle, par
exemple, de relever d'une « économie de l'information ». L'ensemble des caractéristiques de
l'entreprise de presse, qu'elles lui soient spécifiques ou non, influencera la pratique
journalistique et le texte journalistique lui-même.
L'agence de presse répond aux critères de définition de l'entreprise de presse; toutefois elle se
distingue des autres entreprises de presse par certains aspects. Avant de déterminer les
dimensions du concept d'agence que nous prendrons en compte, nous nous devons de
distinguer les différents qualificatifs associés au terme d'agence. On parle indifféremment
d'agence d'information ou d'agence de presse, d'agence d'information de presse mondiale,
internationale, globale ou transnationale. Les différents niveaux d'actions seront discutés plus
41 Thompson, J. B., The Media and the Modernity, a social theory of the Media, Polity Press, 1995,page 174 : « The appropriation of média products is always a localized phenomenon, in the sensé thatis always involves spécifie individuals who are situated in particular, social - historical contexts, andwho draw on the resources available to them in order to make sensé of média messages andincorporate them into their lives.» (traduction réalisée par l'auteur).
20
tard dans le développement de notre réflexion; toutefois nous nous devons de justifier le choix
des terminologies que nous utiliserons au cours de notre recherche. Dans son ouvrage, « The
International News Services », Jonathan Fenby définit les agences de presse internationales
comme «des organisations à caractère commercial qui ont pour unique objet de recueillir,
distribuer, vendre et fournir de la manière la plus rapide et la plus exacte possible de
l'information internationale.»42 En 1953, l'UNESCO définit l'agence de presse comme
Une entreprise qui a principalement pour objet, quelle que soit sa forme juridique de
rechercher des nouvelles et d'une façon générale des documents d'actualité ayant
exclusivement pour objet l'expression ou la représentation des faits et de les distribuer
à un ensemble d'entreprises d'information, exceptionnellement à des particuliers en
vue de leur assurer, contre paiement d'une redevance, et des conditions conformes aux
lois et usages du commerce un service d'information aussi complet et impartial que
possible. 43
C'est cette définition que nous retiendrons dans notre recherche et à laquelle on pourra se
référer chaque fois que nous mentionnerons le concept d'agence de presse. Dans un souci de
clarté, le terme d'agence de presse internationale sera employé en référence aux trois agences
considérées comme telles : l'Agence France Presse, Associated Press (AP) et Reuters.
Nous considérons l'agence de presse comme un système producteur d'information. L'agence
de presse est comprise comme l'entreprise qui dicte les règles de conduites et les normes à ses
salariés, notamment à travers un cahier des charges précis : le Manuel de l'agencier. L'agence
de presse est également considérée dans sa dimension économique, comme pourvoyeuse d'un
produit consommable qui a une valeur économique : l'information. Elle est donc comprise
comme une structure soumise à une demande.
Les clients de l'agence de presse sont les médias, les entreprises et les institutions financières
et les acteurs politiques. Les médias sont les programmateurs radio, télévisuels, les journaux
42 Fenby Jonathan, The International News Services, Schocken Books, New York, 1986, 275 pages.43 UNESCO, Les agences télégraphiques d'information, Paris, 1953, 229 pages.
21
et les pourvoyeurs de contenu en ligne. Parmi les entreprises et les institutions financières, on
distingue les producteurs d'information et les courtiers en informations. Les clients peuvent
également être des « traders », des analystes et des investisseurs. Les principaux clients
politiques sont le gouvernement français, les représentants de l'État à l'étranger (ambassades),
et les organismes soutenus par l'État.
Enfin, l'agence de presse est comprise comme système interagissant avec l'environnement
médiatique mondial. Appréhendée comme une configuration (au sens que lui donne Norbert
Elias), l'entreprise de presse est vue comme un système d'échanges généralisés. Ce système
d'échanges est nourri par les apports des individus et des groupes qui constituent le collectif
de travail formé par l'entreprise.
Entre les années soixante-dix et les années quatre-vingt, les travaux sur les agences de presse
se sont multipliés. Nous distinguons deux courants d'analyse. Le premier, descriptif,
concentre son intérêt sur les pratiques, les conditions de production et le rapport à
l'environnement. Les travaux de Michael Palmer et Oliver Boyd Barrett, publiés en 1980 sous
le titre « Le trafic des nouvelles, les agences mondiales d'information »44, restent malgré sa
date de parution ancienne, une source d'information incontournable en matière de recherche
sur les agences de presse. Le second courant d'analyse développé sous l'impulsion de
l'UNESCO et de la publication en 1980 du rapport Mac Bride aboutit à des études engagées.
À la fin des années quatre-vingt et durant les années quatre-vingt dix, nous avons assisté à un
regain d'intérêt pour les agences de presse45, qui s'explique par la transformation de leur
environnement. Certains de ces travaux traitent de la situation des agences face aux
transformations de leur environnement concurrentiel, notamment lorsqu'elles se trouvent
confrontées à l'émergence des chaînes internationales d'information4 .
44 Boyd Barrett, Oliver, Palmer, Michael, Le trafic des nouvelles, les agences mondiales d'information,éd. Alain Moreau, Paris, 1980, 712 pages.45 Plusieurs travaux portant sur l'avenir des agences de presse ont été publiés à la fin des années quatrevingt et au cours des années quatre-vingt dix, parmi eux : Baudelot, Philippe, Les agences de presse enFrance, Paris, SJTI, Paris, La Documentation française, 1991. Mathien, Michel, Conso, Catherine, Lesagences de presse internationales, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1997, 128 pages. Fenby, Jonathan,The International News Services, Schocken Books, 1986, 275 pages.46 Pigeât, Henri, Les agences de presse, institutions du passé ou médias d'avenir, Paris, les Études dela Documentation Française, Paris, 1997, 130 pages.
22
Nous puiserons également dans les travaux d'Oliver Boyd Barrett et Terhi Rantanen47 qui
s'inscrivent dans le cadre de l'économie politique. Les deux auteurs analysent le
fonctionnement des agences de presse en fonction des conditions de production, des pratiques
et se penchent sur le concept d' « agence » en opposition à celui de « structure » dans la
théorisation de la globalisation. En effet, les deux auteurs considèrent que les agences de
presse sont les premières organisations médiatiques mondiales et qu'elles jouent elles-mêmes
un rôle déterminant dans le processus de globalisation de l'information. Leur approche
contribuera à éclairer notre analyse du point de vue macro sociologique.
Enfin, Michael Palmer a publié plusieurs travaux sur les agences de presse mondiales réalisés
dans une perspective historienne, qui bien que différente de la nôtre, n'en est pas moins
pertinente à notre problème de recherche48. Michael Palmer a procédé à plusieurs analyses de
la copie agencière, ainsi il a étudié la copie agencière portant sur la Yougoslavie entre 1991 et
200049. Il a également concentré ses recherches sur les contraintes professionnelles dans
lesquelles les journalistes étrangers exercent, en portant un regard particulier sur l'urgence
inhérente à leurs pratiques et sur la nécessité pour les agenciers de satisfaire une multiplicité
de clients médias et non médias50.
White, Patrick, Le village CNN: La crise des agences de presse, Presses de l'Université de Montréal,Montréal, 1997, 192 pages.
Tupper Patricio, « IPS, quarante ans après. Une offre internationale hors normes », revue de l'AFRI,Association française des relations internationales, La Documentation française, volume VI, 2005, pp.991-1010.47 Boyd Barrett, Oliver, Rantanen, Terhi, The Globalization o /News , Sage Publications, 1998, 230pages.48 Palmer, Michael, « L'information agencée, fin du siècle, Visions du monde et discours enfragments », Réseaux n°75, Cnet, Paris, 1996, pp. 87-110.
Palmer, Michael, Des petits journaux aux grandes agences, Paris, Aubier, Historique, 1983, 352pages.49 Palmer, Michael, Quels mots pour le dire ? Correspondants de guerre, journalistes et historiensface aux conflits yougoslaves, Paris, coll. l'Harmattan, 2003, 232 pages.50 Palmer, Michael, « Agencer l'urgence en Irak », in Charon, Jean-Marie et Mercier, Arnaud (sous ladirection de), Armes de communication massive, information en Irak 1991-2003, CNRS, Paris, 2004,pp. 122-127 pages.
Palmer, Michael, « News : ephemera, data, artefacts and...quality control - Iraq now and then »,Journalism, London, Thousand Oaks CA and New Delhi, 2003, vol 4 (4) : pp. 459-476.
Vitalis, André, Têtu, Jean-François, Palmer, Michael, Castagna, Bernard (sous la direction de),Médias, temporalités et démocratie, éditions Apogée, PUF, Rennes, 2000, 269 pages.
23
Section 3 -Pratiques et identité journalistiques
Les pratiques professionnelles se réfèrent aux usages et aux savoir-faire des journalistes et des
médias. Les pratiques professionnelles sont ancrées dans un système normatif composé de
normes formelles et informelles. Le sociologue Raymond Boudon définit les normes comme
des manières défaire, d'être, de penser qui orientent d'une manière diffuse l'activité
des individus en leur fournissant un ensemble de références idéales, et du même coup
une variété de symboles d'identification, qui les aident à se situer eux-mêmes et les
autres par rapport à cet idéal. 5 '
Les règles formelles correspondent aux codes et aux conventions définies par l'entreprise de
presse. Ces normes explicites sont produites notamment par le biais de documents officiels
(comme par exemple les conventions collectives négociées avec les syndicats). Au sein de
l'Agence France Presse, les règles qui régissent le comportement, la rédaction et les valeurs
du journaliste sont présentées notamment sous la forme d'un manuel de l'agencier délivré à
tout journaliste entrant. À ce document, s'ajoutent des notes régulières de la rédaction en chef
aux différents bureaux. Les normes de rédaction des dépêches et de traitement de
l'information sont particulièrement prégnantes en matière d'information internationale
agencière. Les conflits relatifs à ce genre de normes sont plus courants dans les agences que
dans les autres entreprises de presse. Il s'agit de veiller à la normalisation du discours de
l'agence en tous points du globe.
Les règles informelles correspondent aux règles implicites que le journaliste acquiert lors de
sa formation et à travers sa pratique quotidienne, en côtoyant ses confrères. L'initiation au
journalisme consiste en effet, pour une bonne part, en l'imitation et l'intériorisation de ce que
font les autres journalistes. Ce sont des règles de ce genre qui, par exemple, permettent au
51 Boudon, Raymond, Bourricaud François, Dictionnaire critique de la sociologie, Quadrige, Paris,juillet 2002, page 417.
24
journaliste de juger de l'intérêt journalistique d'un événement ou encore de structurer
convenablement les éléments d'information dans une dépêche. Ces règles, bien
qu'informelles, n'en sont pas moins fondamentales du point de vue du problème de recherche
qui nous occupe, puisqu'elles contribuent à la définition de ce qu'est, pour un agencier, la
pratique concrète et quotidienne du journalisme. Loin d'être statiques, les pratiques évoluent
au rythme des changements environnementaux; de nouveaux usages et savoir-faire
apparaissent, se développent et vont peu à peu devenir la règle.
Analyser les pratiques journalistiques consiste non seulement à étudier les nonnes et les règles
qui guident le journaliste au quotidien, mais également à étudier les rapports qu'il entretient
avec les différents acteurs qui interviennent dans le processus de production de la dépêche.
Dans notre travail, nous porterons notre attention sur les interactions entre le journaliste, ses
sources d'information, sa hiérarchie, les techniciens (quand ils sont présents) et ses pairs.
Les pratiques journalistiques propres aux agenciers ont été relativement peu analysées, outre
les travaux d'Oliver Boyd Barrett et Michael Palmer que nous avons déjà cités, Eric Lagneau
a publié des travaux récents portant sur l'écriture agencière et l'éthique journalistique. Éric
Lagneau cherche notamment à mettre en évidence les spécificités du travail des journalistes
d'agence et à définir le style agencier. En associant la notion de style journalistique
développée par Cyril Lemieux et celle de rhétorique journalistique développée par Jean-
Gustave Padioleau, Éric Lagneau53 définit les caractéristiques du style agencier : célébration
de l'urgence, fiabilité de l'information, mise en forme agencière, contraintes d'écriture. Par
ailleurs, à la spécificité du style, il confronte une autre spécialisation, la spécialisation
thématique.
>2 Lagneau, Éric, « Agencier à l'AFP : l'éthique du métier menacé », Hermès, n°35, Les journalistesont-ils encore du pouvoir, CNRS, Paris, 2003, 340 pages.
Lagneau Éric, « Le style agencier et ses déclinaisons thématiques, l'exemple des journalistes del'Agence France Presse », Réseaux n°l 11, 2002.53 Lagneau, Éric, « Le style agencier et ses déclinaisons thématiques, l'exemple des journalistes del'Agence France Presse », Réseaux n°l 11, 2002.
25
Enfin, si les pratiques changent, l'identité professionnelle des journalistes change aussi, en
vertu du rapport dialectique qui existe entre identité et pratique. L'identité professionnelle se
définit en effet en fonction de la pratique, et vice-versa. L'identité professionnelle des
journalistes ne se réduit pas à des normes, des règles et des croyances sociales abstraites
auxquelles les journalistes seraient amenés à adhérer; elle se construit également à travers les
actions quotidiennes et les interactions entre les journalistes eux-mêmes et avec les cadres et
les responsables de leur entreprise. L'identité professionnelle est donc le produit de
l'interaction du discours et de la réalité. Elle est un discours sur la réalité et une réalité
modelée par le discours. Il existe une dualité entre le modèle idéal imaginé et le modèle
pratique caractérisé par les tâches quotidiennes.
Nous entendons par identité professionnelle, la conception que développent les
journalistes de leur propre rôle, la conception qu'ils ont de l'information mais aussi
leur formation, leur statut, leur rapport à l'entreprise de presse. Le concept d'identité
professionnelle ne renvoie donc pas à la conception que le public se fait du métier
journalistique54, ni même au processus de professionnalisation du corps journalistique,
deux thèmes qui ont fait l'objet de nombreux travaux. En effet, la littérature et les
travaux de recherche qui portent sur l'identité journalistique ont porté un grand intérêt
à l'identité professionnelle du journaliste, notamment pour souligner la difficulté d'en
repérer des contours clairement définis. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur
l'identité professionnelle du journaliste en s'appuyant sur une approche socio-
historique55 de la construction de cette identité. Les travaux portant sur l'identité
professionnelle des journalistes soulignent leur lent processus d'institutionnalisation56
alors que les travaux sur la profession tendent à mettre en évidence un métier aux
frontières fluctuantes, ce que le chercheur Denis Ruellan nomme le
54 Rémy, Rieffel (In Rieffel, Rémy, « Pour une approche sociologique des journalistes de télévision »,Sociologie du travail, n°4, Paris, 1993, page 373) évoque ici la sphère sociale du journaliste, c'est-à-dire l'image qu'il renvoie dans l'opinion, son influence sur l'orientation du débat public.5 Les travaux de Christian Delporte sont à cet égard éclairants. Delporte, Christian, Histoire du
journalisme et des journalistes en France, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1995, 127 pages. Les journalistesen France (1880-1950), naissance et construction d'une profession, édition du seuil, Paris, 1998, 456pages.
Delporte, Christian, Les journalistes en France (1880-1950), naissance et construction d'uneprofession, édition du seuil, Paris, 1998, 456 pages.
26
«professionnalisme du flou»57. Notre approche de l'identité professionnelle
s'apparente à la démarche de Rémy Rieffel dans ses travaux sur l'élite des
journalistes58. Dans son ouvrage, il analyse l'identité journalistique à partir de la
manière dont se pensent les journalistes, leur conception du métier, la définition de
leur rôle professionnel.
57 Ruellan, Denis, le professionnalisme du flou, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 1993,240 pages.58 Rieffel, Rémy, L'élite des journalistes, les hérauts de l'information, Sociologie d'aujourd'hui, PUF,Paris, 1984, 220 pages.
27
-CHAPITRE 2 - CADRE THEORIQUE, DEFINITION DES IDÉALTYPES ET MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
Nous posons comme hypothèse générale que, depuis les années cinquante, les pratiques
journalistiques des correspondants étrangers de l'AFP et la façon dont ils conçoivent leur rôle
se sont considérablement transformées en raison de l'évolution de la configuration
médiatique. Sur le plan analytique, il faut voir cette évolution comme le passage lent et
progressif d'une configuration à une autre, sans rupture apparente. Cependant, pour saisir
cette évolution, nous élaborons une représentation idéal-typique de chacune des deux
configurations de manière à en dégager, théoriquement, les traits essentiels et distinctifs et à
les opposer comme les deux extrémités d'un continuum. Notre hypothèse peut alors être
formulée ainsi : la configuration médiatique des années 1945-1960 (configuration A) et les
pratiques journalistiques spécifiques qui lui sont associées se rapprochent davantage d'un côté
du continuum alors que celles des années 1990-2005 (configuration B), suivant une évolution
dont il faudra relever les principaux déterminants, se situent plutôt de l'autre côté.
L'élaboration de ces idéal-types donne lieu à la formulation d'un grand nombre d'hypothèses
que nous tenterons ensuite de valider sur la base de notre recherche empirique.
Avant de présenter les deux configurations, il nous faut présenter les critères à partir desquels
les configurations A et B ont été construites. Nous caractérisons et opposons les deux
configurations en fonction des quatre dimensions suivantes :
- la « densité » du système, c'est-à-dire le nombre et la diversité des acteurs dans le système ;
- la nature et l'intensité de la concurrence dans le système ;
- les modes de transmission de l'information ;
- le mode de régulation de la configuration, c'est-à-dire les principales logiques qui animent le
jeu des acteurs dans le système.
28
Section 1 - Construction du modèle théorique fondé sur le concept deconfiguration
Plusieurs facteurs économiques, politiques, techniques influencent l'activité journalistique.
Ces facteurs influent de manière conséquente sur le nombre et la nature des acteurs (joueurs),
les jeux de tension entre les acteurs, la nature et le volume de leurs échanges et enfin le mode
de régulation de ces échanges. Ces facteurs vont influencer le fonctionnement des différents
systèmes avec lesquels les journalistes interagissent. Parmi eux, nous retiendrons, d'une part
le système médiatique et d'autre part l'agence de presse comme système particulier de
production de l'information. L'environnement médiatique mondial constitue un premier
système, l'entreprise de presse un second système qui s'insère au premier.
1.1 Un cadre général d'analyse fondé sur le concept de configuration
Nous faisons l'hypothèse que ces facteurs n'influencent pas avec la même intensité l'activité
journalistique, ni même toutes les dimensions selon les moments historiques. Au final, ils
interagissent les uns avec les autres pour former un « système » de facteurs c'est-à-dire une
configuration, au sens que Norbert Elias donne à ce terme.59
Une configuration est, suivant Norbert Elias, « est un champ social, de taille variable, au sein
duquel les individus sont liés entre eux par un ensemble de dépendances réciproques et dont
l'équilibre de tensions est variable selon les époques »60; elle désigne toute situation concrète
d'interdépendance, de la partie de cartes à la Nation. « Ce qu 'il faut entendre par
configuration, c 'est la figure globale changeante que forment les joueurs, elle inclut non
seulement leur intellect, mais toutes les personnes, les actions et les relations réciproques
(...). Cette configuration forme un ensemble de tensions. L'interdépendance des joueurs,
condition nécessaire à l'existence d'une configuration spécifique est une interdépendance en
tant qu'alliés mais aussi en tant qu'adversaire. »61 La configuration se caractérise par la
relation d'interdépendance qui lie les actes, que les acteurs aient ou non conscience du
59 Elias, Norbert, Qu 'est ce que la sociologie, éditions de l'Aube, Paris, 1991, 222 pages.60 Elias, Norbert, Qu 'est ce que la sociologie, éditions de l'Aube, Paris, 1991, 222 pages.61 Elias, Norbert, op.cit., page 157!
29
caractère interdépendant de leurs rapports. Toutefois, même si la dépendance est réciproque,
elle n'est pas nécessairement équilibrée. C'est pourquoi Norbert Elias distingue les
« established » (les établis) des « outsiders » (les étrangers, les intrus). Les « established », les
anciens, se posent dans leur spécificité et tiennent les nouveaux ( « les outsiders ») à distance.
Dans la perspective de Norbert Elias, le comportement des « established » vise à préserver les
situations en opposant précisément leur cohésion sociale aux « outsiders ». Ces derniers sont
soumis à des logiques d'exclusion.
L'ensemble des facteurs (incarnés dans des réalités concrètes : des entreprises, des acteurs,
des techniques, etc.) forment une configuration, par définition instable, changeante, en tout
cas à l'échelle historique. Cet ensemble de facteurs ou cette structure se transforme au fur à
mesure que les facteurs qui la constituent (les facteurs économiques, culturels, techniques,
etc.) et les relations entre ces facteurs (par exemple l'innovation technique qui favorise de
nouvelles initiatives économiques) se transforment. Dans notre modèle explicatif, nous
retiendrons trois types de facteurs qui nous paraissent exercer une influence particulièrement
importante sur l'activité journalistique et sur son évolution : les facteurs économiques,
politiques et techniques. Ces facteurs peuvent influer de manière directe sur les pratiques des
journalistes. Ainsi l'apparition du téléphone portable satellitaire a modifié immédiatement la
pratique journalistique des correspondants étrangers qui peuvent désormais envoyer leur
dépêche sans délai en tous points du globe. Ces facteurs peuvent également influencer
indirectement la pratique des journalistes. Ainsi la concentration de la propriété des médias
agit d'abord sur l'environnement médiatique mondial et le fonctionnement de l'entreprise de
presse, les journalistes en ressentent les effets par le biais de leur entreprise dont les objectifs
peuvent évoluer. Pour saisir la complexité du processus de changement, notre modèle
théorique introduit trois niveaux d'analyse : le niveau macro sociologique (l'environnement
médiatique), le niveau meso sociologique (l'entreprise de presse) et le niveau micro
sociologique (les pratiques des journalistes).
Notre recherche se donne pour objectif d'analyser comment les changements de
l'environnement médiatique mondial affectent le fonctionnement de l'agence et la pratique et
l'identité des journalistes agenciers. Nous avons construit notre modèle théorique selon trois
niveaux d'analyse. Au niveau macro-sociologique, nous nous situons du point de vue de la
société dans son entier et plus précisément, au niveau de l'environnement significatif de
30
l'agence. Celle-ci est en effet en relation avec d'autres instances qui appartiennent à différents
systèmes, plus ou moins emboîtés (notamment aux systèmes politique, économique, culturel,
médiatique). C'est le cas plus particulièrement des sources d'information et autres
fournisseurs d'information ou de services, des clients, des compétiteurs et des bailleurs de
fonds.
Nous analysons ces relations en tant que configuration dans la mesure où les journalistes se
situent au cœur d'un réseau d'interdépendances englobant tous les types de relations du niveau
macro social au niveau micro, et qui façonnent leur pratique et leur identité professionnelle.
Par ailleurs, le concept de configuration accorde une place centrale à l'historicité considérant
que « les hommes, leurs modes de relations et leurs formes de sensibilités qui leur sont
associés sont des produits historiques dont les caractéristiques varient en fonction des
époques »62. Par ailleurs ces hommes et ces modes de relations forment un système, c'est-à-
dire « un ensemble humain structuré qui coordonne les actions de ses participants par des
mécanismes de jeux relativement stables et qui maintient sa structure, c'est-à-dire la stabilité
de ses jeux et les rapports entre ceux-ci, par des mécanismes de régulation qui constituent
d'autres jeux. »63 Les rapports entre les acteurs du système ou de la configuration obéissent
donc à des « règles du jeu » ou à une régulation, elle-même changeante. La régulation peut
être comprise comme un principe de fonctionnement du système, une finalité, qui impose en
quelque sorte sa logique aux autres dimensions de la configuration et donc aux choix des
joueurs dans cette configuration.
Nous pouvons donc reformuler notre hypothèse de la façon suivante: entre la fin de la
Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui, il y a eu une reconfiguration du système
médiatique mondial dont fait partie l'AFP, en conséquence, les règles du jeu qui régissent
l'action des journalistes et que, par leur action, ils contribuent en retour à reproduire et à
modifier, s'en sont trouvées profondément modifiées. Plus précisément, la configuration
médiatique que forme l'environnement médiatique mondial et le jeu des acteurs (niveau
macro sociologique) s'est caractérisée depuis les années cinquante par le passage d'une
12 Corcuff Philippe, Les nouvelles sociologies : constructions de la réalité sociale, Armand Colin,coll. 128, Paris, 2004.63 Crozier, Michel, Friedberg, Erhard, L'acteur et le système, le Seuil, Point Essais, Paris, 1977, page286.
31
régulation à dominante politique vers une régulation à dominante économique. Dans les
années cinquante et soixante, l'AFP (et ses journalistes) fait des choix stratégiques orientés
vers une finalité politique, quitte à ce que ces choix paraissent irrationnels du point de vue
d'une finalité économique. Depuis quelques années, ces choix sont davantage conditionnés et
justifiés par des calculs économiques et commerciaux. Suivant notre hypothèse, le
déplacement progressif d'une configuration à régulation politique du système de production
de l'information à une configuration à régulation économique (1990-2005) s'accompagne
d'une modification de la pratique et de l'identité journalistiques. Cette hypothèse sera
développée ultérieurement.
Le changement du mode de régulation de la configuration amène l'agence (niveau meso
sociologique) à faire des choix différents, à modifier ses stratégies et ses politiques. Ce sont
ces changements de nature organisationnelle qui amènent les journalistes à donner à leurs
pratiques concrètes des inflexions nouvelles.
Le niveau micro sociologique se situe du point de vue des individus, les correspondants
étrangers de l'AFP et à leur expérience individuelle. Nous posons comme seconde hypothèse
que le changement de configuration induit indirectement (c'est-à-dire suivant les choix
stratégiques de l'agence) une transformation des pratiques et de l'identité journalistique.
Chaque configuration correspondant à des pratiques et identité journalistiques spécifiques.
1.2 La méthode idéale typique : définition et cadre d'application
Le passage d'une configuration politique à une configuration à régulation économique s'opère
sans rupture apparente, comme un déplacement progressif le long d'un continuum. La
méthode idéal-typique proposée par Max Weber facilite l'analyse de tels phénomènes socio -
historiques. Elle consiste, en l'occurrence, à élaborer une représentation théorique épurée (un
idéal-type) de chacune de ces configurations (politique et économique) définies en opposition
l'une par rapport à l'autre, de manière à les poser comme les deux extrémités d'un continuum.
Ces deux extrémités (ces types conceptuellement purs) sont théoriques ; elles n'existent pas
dans la réalité, en tout cas elles ne se présentent pas dans la réalité sous cette forme épurée ;
32
elles servent plutôt de balises ou de repères théoriques et méthodologiques pour guider
l'observation. La recherche empirique consistera à montrer que, de la fin des années quarante
jusqu'aux années soixante, la configuration « réelle » se rapproche davantage du type pur
« configuration à régulation politique » alors que, depuis les années quatre-vingt-dix, le mode
de fonctionnement de l'environnement médiatique mondial se rapproche davantage du pôle
« configuration à régulation économique ». Reste à expliquer pourquoi et comment on est
passé de l'un à l'autre.
La méthode idéale-typique formalisée par le sociologue Max Weber permet de constituer une
vision globale et pertinente de la nature des interactions passées et en cours entre les formes
de pratique et d'identité du journalisme d'une part, et les transformations de l'environnement
international de l'information et de l'entreprise médiatique au cours du temps historique,
d'autre part.
La méthode idéal-typique est particulièrement utile dans le champ des sciences sociales qui
ont à éclaircir le fonctionnement et la nature d'un monde particulièrement complexe : le
monde social. Max Weber a tenté, en proposant cette méthode de résoudre les problèmes
soulevés par les écarts - souvent importants - entre la réalité sociale telle qu'elle peut être
observée ou mesurée et les représentations, globalisantes ou partielles, que sont les théories et
les modèles. Au lieu de chercher à réduire ces écarts à tout prix, ce qui reste la stratégie de
recherche la plus répandue, Max Weber64 a, au contraire, cherché sinon à les amplifier du
moins à les rendre le plus évident possible eh les construisant volontairement et
méthodiquement. C'est alors dans la compréhension de la nature et de la signification de ces
écarts que se joue en bonne partie le progrès des connaissances sur le monde social.
Construire un idéal type, c'est donc accentuer « unilatéralement » tel ou tel caractère de
l'objet étudié, choisir quelques critères particulièrement significatifs, mais isolés et bien
identifiés, puis construire ainsi une figure idéale du phénomène social auquel on s'intéresse.
L'idéal type n'a pas vocation à décrire la réalité. Son principe est de produire des concepts les
64 Weber, Max, « L'objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales », in Essaissur la théorie de la science, Pion / Presses Pocket, coll. « Agora », n° 116, 1992, pp. 117-201.
33
plus univoques possibles afin de les comparer à la réalité sociale constituée en objet de
recherche.
Nous proposons d'utiliser la méthode idéale typique pour présenter deux configurations de
l'environnement médiatique mondial. Nous avons construit chaque idéal type des
configurations en isolant quatre critères qui nous apparaissent particulièrement significatifs et
que nous avons énumérés au début de ce chapitre : la « densité » du système (le nombre et la
diversité des acteurs), la nature et l'intensité de la concurrence à laquelle la configuration
donne lieu, les modes de transmission de l'information et finalement le mode de régulation de
la configuration. Nous procédons à la définition de deux idéal types correspondant à deux
périodes : un premier idéal type correspondant à la configuration A et un second idéal type
correspondant à la seconde configuration (configuration B) qui caractérise la génération
d'agenciers qui ont expérimenté les deux types de configuration de l'environnement
médiatique.
Section 2 - Définition des idéal-types
Dans la configuration A, les quatre dimensions évoquées précédemment se caractérisent, par
hypothèse, de la façon suivante :
• un nombre restreint de joueurs, auxquels correspond une offre d'information
relativement limitée ;
• une concurrence circonscrite et homogène ;
• des techniques de transmission peu fiables, laborieuses et limitées ;
• une régulation de la configuration à la fois politique et commerciale.
La configuration B se caractérise par hypothèse, de la façon suivante :
• un grand nombre de joueurs dans le système et une offre d'information surabondante ;
• une concurrence nébuleuse et hétérogène ;
• des techniques de transmission quasi simultanée, sûres, au volume illimité ;
• une régulation de la configuration à dominante commerciale.
À la lumière de ces quatre critères, nous allons examiner notre objet à chaque niveau
d'analyse; l'environnement médiatique mondial (niveau macro sociologique), l'agence de
presse (niveau meso sociologique) et au niveau micro sociologique, les journalistes (la
dépêche, les pratiques journalistiques et l'identité professionnelle du journaliste). Pour chaque
niveau nous allons esquisser un idéal-type. Il s'agit en somme d'élaborer un réseau
d'hypothèses à partir duquel nous pourrons ensuite entreprendre l'analyse empirique de notre
objet d'étude.
2.1 L'environnement médiatique
1
2
3
4
Configuration A
Faible concurrence
Concurrence homogène
Transmissions fragiles, au volume limité
Offre d'information limitée
Configuration B
Hyper-concurrence
Concurrence nébuleuse et hétérogène
Techniques de transmissions quasi-simultanées, sûres au volume illimité
Offre d'information surabondante
1- L'Agence France Presse fait face à une concurrence relativement faible lors de la
configuration A en comparaison de la concurrence à laquelle elle est confrontée aujourd'hui.
En effet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la concurrence est circonscrite aux
quatre autres agences internationales, AP, Reuters, UPI et TASS. Les concurrents de l'AFP
sont donc des acteurs aisément identifiables. Le passage d'une configuration à l'autre se
traduit par une intensification de la concurrence, au point que nous pouvons qualifier le
contexte dans lequel évolue l'AFP aujourd'hui d'hyper concurrentiel.
2- La configuration A se caractérise également par une concurrence homogène. Les
concurrents de l'AFP ont un principe de fonctionnement relativement similaire et produisent
des informations dont la nature et le format sont comparables. Mais la multiplication des
supports de diffusion de l'information et le processus de concentration des entreprises de
presse ont modifié considérablement la nature de la concurrence, nous pouvons donc qualifier
la concurrence de l'AFP au sein de la configuration B de nébuleuse et hétérogène.
3- La configuration A se caractérise par la faillibilité des moyens de transmission. Limités et
fragiles, ils ne permettent pas aux agences de varier les contenus et les formats de
l'information. Puis, les innovations techniques se multiplient et participent du processus de
reconfiguration de telle manière que la transmission des dépêches se fait à un rythme
extrêmement rapide lors de la seconde configuration.
4- Au sein de la configuration A, la production de l'information est le fait d'un petit nombre
d'acteurs, les agences et quelques correspondants étrangers de grands journaux et de radios,
tandis que la production de l'information, au sein de la configuration B, est assumée par une
diversité et une multiplicité d'acteurs, parmi lesquels, les agences de presse internationales,
régionales et nationales, mais également les chaînes d'information en continu et les sites
Internet.
36
2.2 L'entreprise : l'Agence France Presse
1
2
3
4
5
Configuration A
Organisation de l'entreprise centralisée
Ingérence de l'État dans la gestion del'Agence France Presse
Une couverture des desks déterminée par lesintérêts politiques de la France.
Contrôle de la copie réalisé a posteriori parle siège
Clientèle homogène et constituée des médiaspresse écrite et radio
Configuration B
Organisation régionale de la production
Intervention plus limitée de l'État dans lagestion de l'AFP
Les intérêts français ont une incidence relativesur le contenu des dépêches.
Contrôle de la copie réalisé a priori et a
posteriori par le siège
Clientèle diversifiée, média et hors média
1- Dans le cadre de la configuration A, l'organisation de l'Agence France Presse est
centralisée, tous les services et les postes décisionnaires de l'agence ainsi que les services de
traduction sont situés au siège de l'agence, place de la Bourse, à Paris. Le processus de
reconfiguration s'accompagne d'une décentralisation de la production et de la distribution des
dépêches. Lors de la configuration B, la couverture de l'information par l'agence s'effectue
selon un nouveau mode d'organisation, l'AFP compte cinq bureaux régionaux : une région
Europe-Afrique dont le bureau régional est à Paris, la région Moyen-Orient dont le bureau
régional est à Nicosie (Chypre), la région Amérique du Nord dont la direction régionale se
situe à Washington et la région Amérique Latine dont le bureau régional se situe à
Montevideo.
2- Dans la configuration A, l'AFP est un organisme public, et bien qu'en 1957, son statut
devienne mixte, elle reste dépendante économiquement des abonnements de l'État. Les
rapports de dépendance économique qui lient l'AFP à l'État français ont des conséquences
importantes sur le fonctionnement, l'organisation et la position de l'agence sur le marché
mondial de l'information. La configuration A se caractérise par une mainmise de l'État sur la
gestion de l'Agence France Presse. Dans la configuration B, bien que l'État reste le principal
bailleur de fonds de l'agence, sa participation au budget de l'agence est proportionnellement
moins importante en comparaison de la configuration A. Par ailleurs, son intervention dans la
gestion de l'AFP est moindre en comparaison de la configuration A.
37
3- Lors de la configuration A, la couverture de l'information est affectée par des critères
politiques et idéologiques. Ainsi, certains pays liés historiquement et politiquement à la
France sont intégrés dans la zone géographique française. Ce sont donc les intérêts politiques
de la France qui déterminent la couverture de chaque desk, souvent en dépit de la logique
géographique, ce qui n'est plus le cas dans la configuration B.
4- En matière d'information internationale, le siège exerce une tutelle sur la production des
bureaux étrangers lors de la configuration A. La rédaction en chef centrale contrôle en effet la
production et la diffusion des dépêches issues de l'étranger. Le contrôle se fait a posteriori de
la production de la dépêche, les techniques de transmission ne permettant pas un contrôle a
priori. Lors de la configuration B, le contrôle de la copie est effectué non seulement a
posteriori mais également a priori par le siège et par le bureau régional.
5- Lors de la configuration A, la clientèle de l'AFP est constituée d'une part des services
publics usagers de l'État, et d'autre part des titres de presse écrite et de quelques radios. La
clientèle est donc relativement homogène contrairement à la configuration B où la clientèle de
l'agence est fortement diversifiée.
2.3 Les pratiques journalistiques
1
2
3
4
5
6
7
8
Configuration A
Autonomie par rapport au desk
Relative autonomie par rapport auxconcurrents
Evaluation sporadique de la copie
Un nombre limité de sources
Journalisme événementiel
Une course contre le temps ralentie par lafragilité des techniques de transmission
Rapports directs avec les sources
Le journaliste en tant que témoin est expert
Configuration B
Sous le contrôle du desk
Réflexivité
Evaluation rationalisée de la copie
Multiples sources
Journalisme situationnel
Le règne de l'urgence
Rapports indirects avec les sources
Recours aux experts
1- Lors de la configuration A, l'organisation centralisée de l'agence conjuguée aux difficultés
de transmission font que le journaliste est rarement en contact avec ses pairs de l'AFP, ni
même en contact avec la rédaction en chef centrale. Il travaille de manière autonome et exerce
un grand contrôle sur son propre travail. La situation est radicalement différente lors de la
configuration B, où le journaliste est en relation permanente avec le bureau local voire le
bureau régional dont il dépend via son téléphone portable ou par le biais de son ordinateur. Le
directeur du bureau est en mesure de diriger l'activité du journaliste sur le terrain. Les
journalistes deviennent des exécutants.
2- Lors de la configuration A, le journaliste dispose d'une certaine autonomie par rapport aux
concurrents. En comparaison avec la configuration B, le journaliste ne dispose pas de moyens
techniques lui permettant de prendre connaissance des productions de ses confrères en temps
réel. La réflexivité du journaliste - c'est-à-dire sa capacité à s'auto évaluer au regard des
informations produites par ses concurrents et d'adapter sa copie si besoin est - est donc très
faible. La configuration B place le journaliste dans une situation de réflexivité maximum. Le
journaliste est donc soumis à une double source de réflexivité, qui s'exerce d'une part depuis
le siège, et d'autre part depuis son propre bureau local. Le journaliste est en situation de
réflexivité en temps réel. Il suit ce que sort la concurrence et ajuste simultanément sa copie en
fonction de celle-ci.
3- Dans la configuration A, la copie agencière est soumise à une évaluation sommaire
contrairement à la configuration B, où l'AFP a mis en place un processus d'évaluation
rationnel.
4- Dans la configuration A, les journalistes disposent d'un nombre limité de sources : presse
locale, interlocuteurs privilégiés et sources officielles. La reconfiguration s'est accompagnée
d'une multiplication des sources d'information de l'agence. Lors de la configuration B, les
journalistes dispose de sources d'information supplémentaires telles les chaînes d'information
en continu et Internet.
39
5- Au sein de la configuration A, le travail du journaliste est centré sur l'événement. Si le
journaliste peut effectuer des analyses et des commentaires de l'événement, il produit
rarement des dépêches portant sur une situation sans qu'un événement en soit le prétexte. Lors
de la configuration B, si le journaliste continue de produire des dépêches portant strictement
sur l'événement, il produit également de nombreuses dépêches d'analyse. Non seulement il
narre l'événement, mais il donne des indications sur le contexte, sur les causes et les
conséquences, il facilite la compréhension de l'événement par le public.
6- Lors de la première configuration, les moyens de transmission disponibles ne permettent
pas de transmettre un grand nombre de mots de manière rapide et sûre. Par ailleurs, les
concurrents de l'AFP ne disposent pas de moyens de transmission plus rapides que ceux de
l'AFP. La course contre le temps se réalise donc à un rythme plus lent qu'aujourd'hui. En
effet, la configuration B se caractérise par le règne de l'urgence. La course contre le temps se
réalise extrêmement rapidement et s'évalue maintenant en secondes. La pression temporelle
s'est généralisée à l'ensemble de la production et s'exerce désormais sur la rédaction et la
diffusion des autres types de dépêches.
7- Au sein de la configuration A, le journaliste entretient des rapports directs avec ses sources,
contrairement à la configuration B, où les sources sont bien plus nombreuses et plus
diversifiées que dans la configuration précédente. Ainsi avec le développement d'Internet,
elles sont accessibles à tous et à distance. Le journaliste entretient donc des rapports indirects
avec les sources.
8- Le journaliste de la configuration A étant considéré comme un expert en regard des
situations qu'il décrit et commente, il fait peu ou pas appel à des points de vue extérieurs, il
analyse et interprète les événements. Le journaliste de la configuration B doit produire un
grand nombre de dépêches d'analyse et dans un temps record, aussi fait-il appel aux experts
pour commenter l'actualité.
40
2.4 La dépêche
1
2
3
4
5
Configuration A
Écriture personnalisée et peu normalisée
Règne du factuel
Faible éventail des thématiques :l'information politique et générale sérieuseest privilégiée
Faible distinction entre les dépêches
Taille des dépêches peu normalisée
Configuration B
Écriture fortement normalisée
Faits et contexte associés dans une mêmedépêche
Large éventail des thématiques : thématiquesvariées.
Forte distinction entre les dépêches
Taille limitée des dépêches
1- L'écriture des dépêches telle qu'elle apparaît lors de la configuration A est personnalisée
et peu normalisée, contrairement à la dépêche de la configuration B où l'écriture
journalistique est universalisée.
2- La dépêche de la configuration A est essentiellement tournée vers l'événement, la dépêche
factuelle est le genre par excellence. La dépêche de la configuration B se distingue de la
première dans la mesure où elle associe narration des faits, présentation du contexte et
analyse.
3- Dans la configuration A, le champ thématique de l'information est relativement restreint.
L'information politique et l'information générale sérieuse constituent la matière principale de
la production de l'agence à privilégier l'information politique et diplomatique « sérieuse » à
l'information sociétale et au divertissement. Dans la configuration B, l'éventail des
thématiques abordées dans les dépêches est très large. Les thématiques politique et
diplomatique privilégiées dans la configuration A, sont concurrencées par l'économie, la
thématique société ou life style, le divertissement et le sport.
4- Dans la configuration A, l'AFP dispose d'un système de genre plutôt rudimentaire en
matière de dépêches contrairement à la configuration B, où la différenciation entre les
dépêches est extrêmement forte.
41
5- Dans la configuration A, en dépit des difficultés de transmission, la taille des dépêches est
relativement importante, contrairement à la configuration B, où la taille des dépêches est
limitée.
2.5 L'identité professionnelle journalistique
1
2
3
4
5
6
Configuration A
Journalisme masculin
Formation et culture générale, littéraire etpolitique
Mobilité des journalistes entre plusieursmédias
Journaliste indépendant du siège
Les journalistes conçoiventl'information comme un bienpublic
Les journalistes exercent unefonction de magister auprès deleurs lecteurs
Configuration B
Journalisme mixte
Formation professionnelle et techniquespécialisée
Fidélité à l'agence motivée notamment par laprécarisation de la profession
Journaliste sous surveillance
Les journalistes développent une conceptioncommerciale de l'information
Les journalistes se perçoivent commepourvoyeurs d'un bien marchand.
1- Au sein de la configuration A, les femmes journalistes sont peu nombreuses, elles ne sont
pas envoyées à l'étranger car elles sont considérées comme trop fragiles; par conséquent les
hommes constituent presque exclusivement le contingent des correspondants étrangers. Le
passage d'une configuration à l'autre s'est accompagné d'une accession des femmes aux
postes de correspondant étranger.
2- Le journaliste de la configuration A a reçu une formation de culture générale, littéraire et
politique. Le journaliste de la configuration B, quant à lui, dispose d'une formation
professionnelle et technique spécialisée.
3- Bien que le journaliste de la configuration A témoigne d'un attachement particulièrement
fort envers l'agence, la mobilité du journaliste de l'AFP à un autre média existe, le chômage
est très relatif, et le journaliste souhaite explorer d'autres formes de journalisme. Le
42
journaliste de la configuration B témoigne, quant à lui, d'un fort attachement à l'agence guidé
par des considérations matérielles.
4- Dans la configuration A, la technique ne permet pas à la rédaction centrale d'avoir un
contact régulier avec son journaliste, aussi le journaliste exerce son métier dans une grande
indépendance. Le journaliste travaille de manière autonome, et exerce un grand contrôle sur
son propre travail. Ce n'est pas le cas du journaliste de la configuration B, qui est sous la
surveillance permanente du bureau régional dont il dépend mais aussi de la rédaction centrale.
5- Dans la configuration A, les journalistes conçoivent l'information comme un bien
public tandis que dans la configuration B, l'information est essentiellement conçue
comme un bien marchand.
6- Les journalistes exercent une fonction de magister auprès de leurs lecteurs lors de la
configuration A, tandis que les journalistes de la configuration B considèrent qu'ils sont avant
tout des pourvoyeurs d'un bien marchand.
Section 3 - Méthodologie de la recherche
Notre démarche de recherche vise donc trois objectifs :
1. Identifier les évolutions dans la pratique et l'identité journalistique.
2. Établir les relations entre ces évolutions et les facteurs de changements supposés. Pour
cela nous dessinerons deux modèles idéaux typiques de configuration auxquels nous
associerons deux formes idéales typiques de journalisme.
3. Nous devrions être alors en mesure de déterminer l'origine et la nature du processus de
changement qui fait que les journalistes intègrent, luttent ou participent à l'évolution de leurs
pratiques et de leur identité journalistique.
Pour répondre à ces objectifs, nous avons conjugué trois techniques de recherche : des
entrevues semi-dirigées auprès des journalistes de trois générations; un stage d'observation
43
d'un mois dans le bureau de l'AFP au Caire et l'analyse d'une sélection de dépêches et de
documents internes de l'agence.
3.1 Le choix d'une méthode qualitative : l'entretien semi - directif auprès de 45
journalistes
Compte tenu des objectifs de notre recherche, nous faisons appel à la méthode qualitative de
l'entrevue semi-dirigée. Ce type d'entrevue nous permet de faire ressortir l'expérience et les
perceptions d'un informateur, en l'occurrence l'agencier exerçant à l'étranger, dans un
domaine spécifique, la production de l'information internationale dans un bureau étranger de
l'AFP. Cette méthode souple nous permet d'analyser le sens donné par les journalistes à leurs
pratiques actuelles ainsi qu'à leurs expériences passées.
3.1.1 Constitution de l'échantillonnage
Pour analyser les changements, il nous faut des points de comparaison dans le temps. La
composition de l'échantillon des journalistes porte sur trois groupes d'âge qui représentent
des « générations »65 différentes de journalistes. Pour chaque groupe d'âge, nous avons
interrogé quinze journalistes ayant exercé ou exerçant leur fonction à l'étranger. Comme nous
avons travaillé avec un petit échantillon, nous ne pouvons pas prétendre à sa représentativité
statistique; il n'empêche que les différences observées entre les trois groupes d'âge suffisent à
valider ou invalider nos hypothèses.
3.1.1.1 Le choix du critère générationnel
La génération peut être définie comme « une catégorie abstraite, un produit de l'imaginaire
social, qui contribue à classer et hiérarchiser les hommes au sein de la société et à organiser
65 Nous avons préféré employer le terme de « génération » plus usuel que celui de « cohorte » employéen démographie, le terme de génération est ici employé comme synonyme de cohorte de naissance, lacohorte de naissance se rapportant à un groupe de personnes nées pendant une période déterminée.
44
le temps » . Par génération, nous entendons désigner un ensemble d'individus appartenant à
un même groupe d'âge, dont la principale caractéristique est d'avoir été témoins
d'événements communs ou d'avoir participé à des expériences historiques communes, les
conduisant à développer une vision commune du monde. Le critère génerationnel nous semble
donc être le plus adéquat pour comprendre le processus de changement dans la production de
l'information en recueillant le discours de journalistes appartenant à trois générations
distinctes.
Afin d'obtenir des discours les plus caractéristiques qui soient, nous avons constitué des
catégories discontinues. La première catégorie est composée de journalistes en fin de carrière
ou en retraite (soixante ans et plus) dont la pratique s'est effectuée dans le cadre de la
première configuration, et qui, selon notre hypothèse, seront critiques en regard de l'évolution
des pratiques journalistiques, telles qu'ils les observent aujourd'hui, de l'extérieur. La
seconde catégorie est composée de journalistes encore en exercice qui ont dû s'adapter,
comme on le suppose, au changement de configuration (entre 45 et 55 ans) et qui, ayant
connu auparavant un contexte différent, sont susceptibles de nourrir un regard critique sur les
tendances nouvelles induites par le changement de configuration. La dernière catégorie est
composée des journalistes plus jeunes (de 25 à 40 ans) qui ont débuté leur carrière dans la
deuxième configuration et qui, pensons-nous, adoptent « naturellement », pourrait-on dire, des
pratiques et des conceptions en phase avec les exigences de la configuration économique.
3.1.1.2 Autres critères
Si le critère génerationnel est déterminant dans la constitution de la population étudiée, nous
avons également pris en compte d'autres critères dans l'échantillonnage de notre population
de journalistes. Nous avons construit notre échantillon avec la méthode dite des « choix
raisonnes », c'est-à-dire que nous avons composé notre échantillon au regard de variables
jugées pertinentes du point de vue de la représentativité de notre échantillon. C'est ainsi que
66 Attias-Donfut Claudine, «La génération, un produit de l'imaginaire social», in L'identité,l'individu, le groupe, la société, coordonnée par Jean-Claude Ruano-Borbalan, éditions SciencesHumaines, Auxerre, novembre 1999, page 157.
45
nous avons varié les lieux géographiques couverts par les journalistes, leurs fonctions
(journaliste rédacteur, envoyé spécial, directeur de bureau, directeur adjoint), leur statut
(local, régional et siège), leur sexe et leur nationalité. Nous présentons ci-dessous un tableau
décrivant le profil des journalistes interrogés.
Tableau descriptif des profils de journalistes interrogés
sexe
Femmes
Hommes
statut
statut siège
statut régional
statut local
stringer
nationalité
Français
Espagnol
Anglais
Libanais
Algérien
Poste occupé lors del'entretien
Journaliste au seind'un service
Directeur adjoint
Directeur de bureau
Totaux
Génération
25-40 ans
6
9
10
2
2
1
13
2
14
1
15
Génération
45-55 ans
4
11
15
12
1
1
1
12
3
15
Génération
60 ans et plus
2
13
14
1
15
6
4
5
15
Totaux
12
33
39
3
2
1
40
2
1
1
1
32
5
8
45
3.1.1.3 Les modes d'accès aux informateurs
46
Afin de mener nos entrevues, nous avons effectué des séjours en Amérique du Nord, en
Russie et au Moyen-Orient, nous permettant de mener des entrevues avec des journalistes en
poste à l'étranger au moment de l'entretien. Toutefois, compte tenu de notre localisation
géographique, une grande part de nos entrevues ont été menés à Paris, siège de l'AFP. Ceci ne
constitue pas une barrière à la réalisation de nos entrevues dans la mesure où l'AFP pratique
la polyvalence et l'alternance depuis 1978 en imposant une rotation entre la fonction
d'agencier au sein du siège et celle d'agencier à l'étranger selon un rythme de changement, en
principe quadriennal. Les journalistes que nous avons rencontrés au siège avaient occupé
plusieurs postes à l'étranger, et bon nombre d'entre eux sont repartis en poste à l'étranger entre
le début et la fin de l'enquête.
Nous avons essuyé un seul refus de participation à l'enquête. Les journalistes se sont montrés
vivement intéressés par notre travail de recherche, considérant que l'activité d'agencier était
méconnue et que les évolutions considérables de leur contexte de travail justifiaient leur
participation à cette recherche.
Enfin, précisons que nous avons effectué ces entrevues conformément aux règles éthiques
établies par le Comité d'Éthique de la recherche de l'Université Laval (CERUL)67.
3.3.2 Élaboration du plan d'entrevue
67 Conformément à ces règles, nous assumons pleinement les obligations éthiques qui incombent àtoute recherche portant sur des sujets humains. Les entrevues, d'une durée en moyenne d'une heure ettrente minutes, ont fait l'objet d'un enregistrement audio. Chaque participant pouvait mettre fin àl'entrevue en tout temps, sans avoir à fournir de raison, ni à subir de préjudice quelconque. Lesparticipants ont été prévenus que les propos recueillis lors de ces entrevues pouvaient être cités dansdes rapports de recherche ou des articles scientifiques produits par la chercheuse, mais dans le respectde leur l'anonymat. Les enregistrements audio seront détruits après le dépôt final de la thèse et lesVerbatim seront conservés sous forme anonyme et accessibles à d'autres chercheurs que sous cetteforme.
Pour garantir la confidentialité des personnes interviewées, les noms des personnes n'apparaissent suraucun document. Les personnes sont identifiées par un code ; seule la chercheuse a accès à la liste des •noms correspondants aux codes. Les propos des journalistes ne seront jamais versés à leurs dossiersd'employés. Un formulaire de consentement a été signé par chaque répondant. ( Annexe C-l)
47
Notre guide d'entrevue a été construit à partir des différents questionnements qui sous-tendent
notre recherche. Nous avons testé préalablement le guide d'entrevue dans le cadre d'entretiens
exploratoires auprès de cinq journalistes. Le guide d'entretien comportait les thèmes suivants :
• présentation des journalistes interrogés, de leur parcours et d'un bref descriptif de leurpratique
• fonction, statut et parcours professionnel de la personne interrogée
• formation, raisons de ce choix professionnel et de l'entreprise
• description d'une journée de travail
Le rapport aux sources
• description des sources utilisées
• la place des chargés de communication
La nature de l'information
• les critères utilisés dans la sélection de l'information
• l'évolution des thèmes couverts : nouvelles thématiques (notamment le « life style »),le fil people.
• le découpage de la copie
• le format et la nature des papiers : papiers factuels et papiers d'analyse, papiersprévus.
• l'encadrement du bureau de veille Alerte et analyse, le contrôle du desk sur la copie.
Les normes agencières et les principes de l'agencier
• les valeurs et principes du journaliste
• le manuel de l'agencier
L'écriture rédactionnelle
• le registre et le style
• le rapport au client et au lecteur
Les innovations techniques
• les évolutions techniques et leurs effets sur les pratiques du journaliste : revue desdifférents outils (tandy, télex, antenne satellite, biper, téléphone portable diversesgénérations, Internet; réseaux télévisés par câble ou satellite)
• les chaînes d'information en continu comme sources d'information, alerte.
48
• les chaînes d'information en continu comme concurrentes
• Internet comme source d'information
• Internet comme concurrent
La concurrence
• l'identification des concurrents
• la notion de suivisme entre les médias
Le journaliste et l'Agence France Presse
• l'attachement des journalistes à l'agence
• les spécificités de l'agencier par rapport aux journalistes exerçant dans un autre média;
• regard du journaliste sur la manière de pratiquer le journalisme d'agence dans le passéet maintenant.
L'évolution des contenus
• l'évolution de la demande des clients
• la thématique économique
• la thématique transnationale
• la thématique « société et divertissement »
Au terme de l'entrevue, des énoncés à qualifier ont été soumis à chaque journaliste68. Les
journalistes devaient qualifier dix-neuf énoncés portant sur des points particuliers, ne
demandant pas a priori un discours de leur part. Ces énoncés formulés sous la forme
d'affirmations « fortes » ont présenté un intérêt certain pour la recherche car ils ont donné lieu
à un discours spontané de la part des répondants. Les Verbatim recueillis lors de cet exercice
sont venus compléter ceux obtenus lors de l'entrevue.
3.2 L'observation participante : le bureau de l'AFP au Caire
1 Annexe C-2
49
3.2.1 Présentation du bureau
Le bureau dans lequel nous avons réalisé notre enquête de terrain est situé en Egypte, au
Caire. Ce bureau constitue avec onze autres bureaux69 le réseau de couverture de la région du
Moyen-Orient; ils sont tous sous la responsabilité d'un bureau régional, situé à Nicosie
(Chypre). Ce bureau régional emploie actuellement une soixantaine de personnes partagées
entre trois desks de langue, dont le desk général arabe.
Lors de l'enquête, le bureau du Caire comportait douze personnes de nationalité et de statut
très divers; auxquels s'ajoutaient deux journalistes soudanais du bureau détaché de Khartoum.
Seul le directeur disposait du statut siège, le reste de l'équipe était composé de deux
journalistes égyptiennes employées en contrat local depuis une dizaine d'années, une
journaliste française recrutée en statut régional depuis quinze jours rédigeant exclusivement
en anglais, deux journalistes égyptiens employés localement. Le directeur adjoint, employé en
statut local est fréquemment envoyé à Bagdad pour couvrir la résolution du conflit. Enfin, le
bureau compte également deux photographes, un égyptien et un chilien, et deux techniciens et
une secrétaire. Outre l'actualité égyptienne, le bureau du Caire couvre également le Soudan.
3.2.2 Les conditions de l'observation
Afin d'intégrer un bureau de l'AFP à l'étranger, nous avons effectué une demande de stage en
journalisme auprès de l'agence. Nous avons informé le directeur du bureau du Caire de notre
statut de chercheur et des objectifs généraux de notre recherche. Les autres journalistes du
bureau n'en ont été informés qu'au moment où nous leur avons sollicité un entretien. Nous
avons donc réalisé ce stage aux côtés de trois stagiaires en journalisme inscrits en troisième
année de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, ce qui nous permettait d'avoir un contact avec
déjeunes aspirants.
69 Les bureaux du Moyen-Orient sont situés à Amman, Bagdad, Beyrouth, Damas, Doha, Dubaï, Gaza,Jérusalem, Koweït, Riad et Téhéran
50
Notre statut de stagiaire en journalisme nous laissait toute liberté de prendre des notes sur les
pratiques et les comportements des différents acteurs du bureau. Quelques jours avant la fin
de notre période d'observation, nous avons procédé à des entrevues semi-dirigées avec les
journalistes du bureau.
3.3 Analyse documentaire
3.3.1 L'analyse d'un nombre limité de dépêches
Le texte journalistique, ici la dépêche, porte les traces de l'identité journalistique70 mais
également des pratiques journalistiques qui sont à l'origine de ces dépêches. Aussi l'analyse
d'un certain nombre de dépêches est un outil complémentaire dans la compréhension des
pratiques et de l'identité de l'agencier. Nous avons eu un libre accès aux archives de l'AFP au
siège de l'agence, toutefois l'archivage des dépêches sous un mode thématique ne facilite pas
une analyse diachronique de la dépêche.
Nous ne prétendons pas procéder à une analyse de contenu, ni même à fournir une analyse
exhaustive des dépêches de l'AFP. Nous avons procédé à une sélection raisonnée des
dépêches en fonction de nos hypothèses, nous avons porté un intérêt tout particulier au style
d'écriture, au format, à la longueur pour l'ensemble des dépêches, et nous avons souhaité
disposer, pour les dépêches récentes, des différents formats de dépêches diffusées
actuellement par l'agence.
3.3.2 Les manuels de l'agencier
Nous avons procédé à une analyse des trois manuels de l'agencier publiés respectivement en
1971, 1982 et 2004. Le manuel de l'agencier regroupe l'ensemble des règles journalistiques
70 Charron, Jean, « Parler de soi en faisant parler les autres. Identité journalistique et discoursrapporté ». In Rieffel, Rémy et Watine, Thierry. Les mutations du journalisme en France et auQuébec. Paris: Éditions Panthéon Assas. 2000b, pp. 83-117.
51
prescrites par la rédaction en chef et constitue à ce titre un outil particulièrement pertinent en
vue d'analyser l'évolution des normes et des pratiques rédactionnelles.
3.3.3 Les documents disponibles sur le réseau intranet de l'AFP : ASAP71
Au cours de l'enquête de terrain, nous avions un libre accès au réseau intranet de l'Agence
France Presse, ASAP, qui s'est révélé une source d'information particulièrement riche tant par
la diversité des acteurs qui interviennent sur ce réseau, que par l'exhaustivité des informations.
En effet, tous les documents publiés ces sept dernières années sur le réseau sont conservés;
outre la rédaction en chef centrale qui diffuse un grand nombre de documents normatifs
{Manuel de l'agencier, rapport de couverture, mise à jour des normes en fonction de
l'évolution de l'information, communication à l'ensemble des salariés, nominations), d'autres
acteurs interviennent sur le réseau : les syndicats, la direction $ Alerte et Analyse, un comité
créé pour l'équité homme-femme en termes de recrutement, etc.. .
71 ASAP est aussi l'abréviation en anglais de « as soon as possible », une indication supplémentaire del'importance accordée à la rapidité par l'agence ?
52
-CHAPITRE 3- L'ENVIRONNEMENT ET L'AGENCE :
D'UNE CONFIGURATION À L'AUTRE
Michael Palmer et Boyd Barrett ont mené une étude particulièrement pertinente sur
l'évolution de l'AFP et sur ses consœurs étrangères. D'autres ouvrages sont venus s'ajouter à
cette étude et ont procédé à une analyse de l'évolution de l'Agence France Presse. Ce chapitre
n'a pas pour objectif de relater l'histoire de l'agence, mais plutôt de souligner à travers
l'évolution du statut et du financement de l'agence, le passage d'une configuration à
régulation politique conjuguée à une concurrence relativement limitée, à une autre
configuration, où les préoccupations commerciales et de rentabilité ont progressivement
préséance sur les « calculs » politiques.
Section 1 - Une gestion étatique de l'agence
La création de l'AFP s'inscrit dans une configuration médiatique où les rapports entre les
différents acteurs s'établissent en fonction de priorités essentiellement politiques. Outre la
relance du secteur informationnel au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'État
français voit dans l'AFP, le moyen d'affirmer sa présence à l'étranger.
1.1 La naissance de l'agence
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'État est le bâtisseur de la reconstruction de la
France en matière d'information. Il promulgue des lois et des ordonnances qui réorganisent le
système informationnel de la France et subventionne largement cette reconstruction. L'État
justifie ses mesures comme le seul moyen permettant de redresser le système informationnel
français, et notamment afin d'en garantir la transparence et l'objectivité. En s'arrogeant lui
seul la relance du secteur informationnel, il va instaurer un contrôle absolu du contenu dans
les secteurs de la radio et de la télévision (monopole sur la radio en mars 1945 puis sur la
télévision en 1949). Les premières manifestations de cette implication voient le jour lors du
processus de décolonisation des anciens territoires français.
L'Office français d'information qui avait été créé par le gouvernement de Vichy à
partir de la branche Information de l'agence Havas devient l'Agence France Presse par
les ordonnances du 30 septembre 1944 et lui donne provisoirement le statut
d'établissement public administratif. Les ordonnances visent notamment à permettre le
développement de la presse libre en dehors de toute emprise d'une puissance
économique ou politique. L'ordonnance du 30 septembre 1944 créé un organisme
provisoire chargé de recueillir l'information et de la diffuser en France et à l'étranger.
L'Agence France Presse est un établissement public doté d'une personnalité civile et
de l'autonomie financière. En réalité l'agence ne parvient pas à être autonome
financièrement. Bien qu'héritière d'Havas, l'AFP n'a pas hérité de sa branche
publicité, ce qui la rend financièrement dépendante de l'État dans la mesure où les
abonnements publics (ministères et ambassades notamment) et la subvention du
ministère de l'information constituent la recette principale de l'agence.
Ponctuellement, l'État ajoute par ailleurs des subventions supplémentaires pour
combler le déficit budgétaire. L'État est à la fois le principal bailleur de fonds et le
principal client de l'agence. Les rapports de dépendance économique qui lient l'AFP à
l'État français ont des conséquences importantes sur le fonctionnement, l'organisation
et la position de l'agence sur le marché mondial.
Pendant douze ans, l'AFP dispose d'un statut provisoire qui la place sous la dépendance
financière et administrative du gouvernement. Le gouvernement peut nommer et révoquer à
son gré le directeur de l'agence, ce qu'il ne manquera pas de faire, puisque l'AFP change de
directeur sept fois en neuf ans. Palmer et Boyd Barrett évoquent à ce propos « la valse des
directeurs » et relatent avec force témoignages dans leur ouvrage, les nominations
« politiques » successives à la tête de l'agence. La nomination d'Yves Morvan dit Jean Marin
à la tête de l'agence en 1954 met fin à cette instabilité de la direction, il occupera en effet ce
poste pendant près de vingt ans.
54
1.2 Le statut de 1957 : la mainmise de l'État perdure
Si l'état du système informationnel français pouvait justifier l'intervention de l'État après la
guerre, une décennie plus tard, son intervention se justifie plus difficilement. Pour autant,
l'État va conserver sa mainmise sur l'AFP tout en donnant l'apparence d'une nouvelle
indépendance par le vote d'un nouveau statut de l'agence en 1957.
Le statut de l'Agence France Presse est revisité et passe sous le contrôle conjoint de l'État et
de la presse française. Il est composé de deux organismes. L'agence dispose d'un conseil
d'administration composé de quinze membres, huit représentants des directeurs d'entreprises
françaises de publication de journaux quotidiens désignés par les organisations
professionnelles, deux sièges réservés aux représentants de l'ORTF (Office de radiodiffusion
télévision française), trois sièges destinés aux représentants des établissements publics et des
ministères abonnés à l'agence, et enfin deux sièges réservés aux représentants du personnel.
Quant au conseil supérieur, il veille au respect des obligations de l'agence : veiller à
l'objectivité de l'information, fournir une information exacte, impartiale et digne de confiance
à ses clients français et étrangers et s'assurer de l'existence d'un réseau d'établissements lui
conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial. Il est composé
de huit membres : son président, un magistrat de la Cour de cassation, deux représentants des
directeurs d'entreprises de publication des journaux quotidiens désignés par les organisations
professionnelles les plus représentatives, un représentant de la radio-diffusion télévision
française, et deux membres cooptés (l'une parmi les personnalités ayant exercé de hautes
fonctions à l'étranger, l'autre ayant exercé de hautes fonctions outre-mer). Enfin s'ajoute à ces
deux organismes, une commission financière chargée de la gestion financière de l'agence
composée de deux membres de la Cour des comptes et d'un expert nommé par le ministre des
Finances. La composition du conseil d'administration pourrait laisser penser à une
prééminence des entreprises de presse sur l'administration de l'Agence France Presse, mais la
composition des deux autres organismes met en exergue l'intervention de l'État dans la
direction de l'agence. Ce statut place l'agence en porte-à-faux vis-à-vis de la concurrence
dans la mesure où l'AFP est la seule agence mondiale à entretenir de tels rapports de
dépendance vis-à-vis de l'Etat. «L'environnement doctrinal gui a entouré l'élaboration du
statut relève d'une tradition très française, fort éloignée de la volonté farouche des médias
anglo-saxons de tenir l'État à distance »72.
À plusieurs reprises, les journalistes de l'AFP tentent de faire modifier le statut de l'agence
sans jamais y parvenir. Ainsi en mai 1968, une assemblée générale des journalistes de l'AFP
vota par 286 voix contre 133 (avec 24 abstentions et 550 inscrits) une résolution critiquant le
statut inadapté et réclama un nouveau statut garantissant la représentation majoritaire du
personnel et l'indépendance financière de l'agence. À chaque crise interne de l'agence et à
chaque nouvelle nomination du directeur général, la question du statut de l'AFP est évoquée,
mais rarement entendue par les dirigeants. Le 19 juin 2006, Pierre Louette, à la tête de l'AFP
depuis décembre 2005 affirme : « Dès mon arrivée, j'ai précisé que je n 'avais aucune
vocation à réformer les statuts de l'agence. Cela ne fait pas partie de mes préoccupations. Je
note juste que les statuts de l'AFP n 'ont pas empêché l'agence de vendre ses produits à
l'international et d'être probablement la première agence généraliste en Asie et au Moyen-
Orient. En outre, ces statuts sont sévères sur l'éthique et la déontologie journalistique, des
valeurs plus que jamais indispensables dans le monde actuel de l'information de masse. »
Dans la mesure où elle est financée majoritairement par l'État, et que son statut permet
à l'État d'imposer ses dirigeants, l'Agence France Presse apparaît aux yeux de ses
clients, des acteurs internationaux comme de ses concurrents comme une agence au
service de l'État français et est surnommée la « soft Tass » en référence à l'agence
nationale russe TASS. Michael Palmer souligne que la réputation de l'AFP a été
particulièrement mise à mal du fait même des hommes politiques français. « A aucun
moment il y a eu en France une analyse réelle de la situation de l'AFP. Les membres
du gouvernement ont examiné le cas de l'agence dans les moments de crise du
« dossier l'AFP » davantage comme un exercice de gestion de crise que comme la
gestion d'opérations complexes sur les positions nationales et internationales de
72 Pigeât, Henri, Les agences de presse, institutions du passé ou médias d'avenir ?, La DocumentationFrançaise, 1997, page 91.
"Louette, Pierre, « L'AFP ne perdra pas d'argent en 2006 », Le Figaro, 19 juin 2006, page 29.
56
l'AFP. Les considérations franco-françaises déforment les visions des dirigeants
français, ce qui ne contribue pas à la réputation internationale de l'AFP, et détruit la
réputation soigneusement acquise grâce à la crédibilité de ses informations »1A.
L'AFP constitue un outil de la diplomatie française. Les rapports qu'entretient l'AFP
avec l'Etat est une spécificité de l'agence, en effet les agences de presse à dimension
internationale présentes en 1945 n'entretiennent pas de tels rapports de dépendance
avec l'État.75
L'agence subit de nombreuses critiques sur les liens étroits qu'elle entretient avec l'État
français non seulement de la part des journalistes extérieurs à l'agence mais également de la
part des dirigeants de l'agence, après qu'ils aient quitté leurs fonctions. Ainsi, M. Nègre
dénonça dans un article paru dans le Monde en date du 24 mars 1948, la dépendance de l'AFP
à l'État qui ne lui permettait pas de fonctionner en toute indépendance. Des journalistes
exerçant dans des quotidiens français critiquent les rapports étroits entre l'agence et l'État,
Albert Mousset dans le Monde du 28 février 1952 remet en question les rapports entre le
gouvernement français et l'AFP : «Ainsi au moment où la libre circulation des informations
est solennellement proclamée par les organismes internationaux, ONU, UNESCO, etc., les
démentis et les mises au point sont moins recevables qu 'ils ne le furent jamais, et, les
déformations les plus grossières de la vérité viennent encore aggraver la tension politique
entre l'Est et l'Ouest (...) Le problème de l'agence d'Etat reste épineux, d'abord parce que
les partis y voient - à tort ou à raison- une position clé qu 'ils se disputent ou cherchent à
noyauter, ensuite parce que l'agence a cessé d'être le circuit obligatoire de la grande
information par suite du développement de la technique des communications » . Gilles
Martinet, journaliste à l'Observateur publie deux articles (21 et 28 février) dans lesquels il
remet en cause le système même de l'AFP.
74 Palmer, Michael. «At no time was there a considered analysis in France of the situation at AFP.Government politicians examined in times ofcrisis of 'AFP file ' as an exercise in crisis -management,rather than a considered understanding of AFP 's complex national and international opérations andstanding. Franco-french considérations regrettably distort the visions of government politicians,which doès not help the international reptutation of AFP, and undoes the painstakingly acquiredréputation for credibility».75 Au lendemain de la seconde guerre mondiale, hormis l'AFP, les quatre autre agences mondiales,Reuters, AP, UP et INS disposent d'un statut différent de l'AFP, qui les placent en dehors de la tutellede l'État. Ainsi AP (Associated Press) est une coopérative à but non lucratif, UP (United Press) et INS(International News Services) sont des coopératives fondées par les propriétaires de grands journaux.Quant à Reuters, elle constitue une quasi-coopérative sous le contrôle de NPA et PA. En 1958, UP etINS s'allient pour former l'agence de presse UPI et adopter un statut privé et commercial.76 Études de presse, « la presse à travers la presse », Paris, 1952, page 316.
57
L'agence affiche une ambition d'agence internationale et étend son réseau de couverture à
l'étranger. Le 1er octobre 1958, l 'agence ouvre un bureau à Pékin, dix ans plus tard, l 'agence
ouvre un service en arabe (1 e r janvier 1969). Toutefois, le statut et l 'organisation vont freiner
ces ambitions d'agence internationale. L'organisation de l 'agence est centralisée, le siège,
Place de la Bourse est constitué du desk central de l 'agence, où s'effectuent la réception de
toutes les dépêches des quatre coins du monde et également le travail de réécriture. L 'AFP est
la plus centralisée des agences internationales. « Cette concentration importante a été justifiée
par l'AFP parce qu'elle lui permet une plus grande commande et permet des économies
d'échelle : par exemple, la main d'œuvre, même la main d'œuvre spécialisée, peut être
déplacée d'un bureau à un autre en fonction des besoins » . Si les services de l 'AFP
distribués aux clients français sont diversifiés, la copie distribuée par l 'agence aux clients
étrangers est identique, l 'agence se contente de la traduire en plusieurs langues par ses
services. «Les clients hors de France ne reçoivent, en général, qu'un service unique,
transmis de Paris au centre régional dont ils dépendent ; le bureau local n 'y ajoute rien ou
peu de choses »78.
1.3 L'état de la concurrence
L'État organise la concurrence sur le plan national de l 'agence. En effet les ordonnances
décident la suppression de six autres agences de presse existant sur le territoire national. Sur
le plan national, outre l'ACP, l'AFP se heurte à deux agences étrangères concurrentes, AP et
Reuters qui ont développé des services en français, mais ne visent pas les mêmes objectifs. Si
AP tente de vendre ses informations en français sur la France, Reuters et UPI concentrent
leurs efforts sur la vente des informations étrangères en langue française.
77 Boyd Barrett, Oliver, The International News Agencies, page 80 : « This heavy concentration wasjustifiée by AFP on the grounds that it gave it greater control and permitted économies ofscale : forinstance, manpower, even «specialist » manpower, could be rotated from desk to desk as the needarose » (traduction réalisée par l'auteur).78 Boyd Barrett, Oliver, Palmer, Michael, Le trafic des nouvelles, les agences mondialesd'information, éd. Alain Moreau, Paris, 1981, 712 pages
Au dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle, les agences de presse avaient conclu
un accord afin de se partager la couverture informationnelle mondiale. Bien que les agences
de presse mettent fin au cartel en 1934, dix ans après les aires géographiques couvertes par
chaque agence sont encore marquées par les lignes de partage. Ainsi, l'AFP en tant
qu'héritière de l'agence Havas voit son implantation actuelle fortement marquée par celle
d'Havas : l'AFP est aujourd'hui fortement implantée en Amérique Latine (dans le partage du
monde, des aires de couverture, l'Amérique Latine était revenue à l'AFP).
L'AFP se heurte aux agences anglo-saxonnes, AP, United Press, INS qui n'ont jamais cessé
de fonctionner et ont donc connu une expansion conséquente pendant la guerre. La période
d'après-guerre est également marquée par la création de nombreuses agences nationales, ainsi
l'agence allemande DPA (Deutsch Press Agentur) voit le jour en 1948, suivie par l'agence
égyptienne, MENA {Middle East News Agency). Les agences nationales ne constituent pas
une concurrence aux agences de presse internationales pour plusieurs raisons. L'agence
nationale peut avoir des visées essentiellement politiques comme ce fut le cas pour l'agence
espagnole EFE jusqu'à la fin du franquisme en 1975. D'autres agences comme l'agence
égyptienne MENA se destinent à être avant tout des agences régionales.
Le nombre réduit de producteurs de l'information internationale peut s'expliquer par la faible
diversité des supports et par l'inefficacité des moyens de transmission qui rend le travail des
correspondants difficile et peu rentable, particulièrement pour les journaux et les stations de
radio, qui s'en remettent aux agences. Les capacités réduites de transmission et le petit
nombre d'acteurs font de l'information internationale une denrée rare et valorisée. Ceux qui la
produisent, c'est-à-dire les agences de presse, sont donc en position de force et fixent l'agenda
international de l'information.
Section 2-1960-1990 : Entre crises et restructuration
L'avènement de la guerre froide avait scindé le monde des agences de presse en deux camps,
selon l'axe politique et idéologique Est-Ouest. Le bloc de l'Ouest réunit les agences
59
occidentales, AP, AFP, Reuter et UPI, qui font face à l'agence soviétique, TASS79, les enjeux
politiques étaient donc encore prééminents dans le fonctionnement du système médiatique
mondial et dans la stratégie de développement de l'AFP. Toutefois, avec la fin de la guerre
froide, les enjeux politiques vont s'amoindrir ; l'agence, confrontée à une concurrence de plus
en plus aiguë, va alors s'engager dans un processus de transformation de son mode de
production.
2.1 La remise en cause du système international de production de l'information
À la fin des années soixante-dix, l'UNESCO diffuse un rapport intitulé «News dépendance :
the case for a new world information order » (novembre 1977) qui précise que les
informations en provenance et au sujet des pays du Tiers Monde sont relatées dans des
perspectives ethnocentriques et confirment l'idée selon laquelle la vision de la réalité des pays
tiers mondistes est structurée à partir de la demande des pays occidentaux. Cette thèse est
confirmée par Oliver Boyd Barrett et Michael Palmer au cours de leur enquête publiée sous le
titre de « Trafic des Nouvelles » dans laquelle ils soulignent que les agences d'information
réorganisent le flux événementiel, produisant ainsi des catégories, créant une hiérarchie. Ce
débat a placé au centre les agences de presse occidentales, dont l'AFP, soulignant le
déséquilibre Nord Sud en termes de flux informationnels et posant plus largement la question
de l'influence des médias dans la représentation sociale que le public se fait du monde.
2.2 Informatisation et décentralisation de l'agence
L'AFP à l'instar de ses principaux concurrents, AP et Reuters, informatise son système de
production de l'information, réalise au cours des années soixante-dix et des années quatre-
vingt de lourds investissements technologiques et crée de nouveaux produits.
Le 9 octobre 1973, le conseil d'administration décide l'informatisation de la rédaction, deux
ans plus tard, le 25 novembre 1975, les syndicats signent un protocole sur l'informatisation du
1 TASS, Telegrafnoïe Agvenstvo Sovetskovo Soïouza,, est fondée en 1925.
60
desk, le processus d'informatisation peut alors débuter, le desk latino-américain est le premier
à être informatisé en 1976. Les concurrents de l'AFP procèdent eux aussi, à l'informatisation
de leur production ; Reuters s'était engagé la première dans l'informatisation dès 1964 ; quant
à AP, elle procède à l'informatisation de ses réseaux de distribution quelques années avant
l'AFP (1972). Au début des années quatre-vingt, l'AFP débute une seconde phase
d'informatisation et accélère son développement technique. Ainsi elle inaugure le 1er janvier
1981 la banque de données Agora sur la base des dépêches de l'AFP, le 15 octobre 1984,
l'agence crée le service audio AFP, qui sera complété quelques mois plus tard, par la création
d'un service photographique international (le 1er janvier 1985).
C'est à cette même période, que la direction de l'agence entend procéder à une réorganisation
du système de production de l'information. Elle procède à la décentralisation de ses services
étrangers. La décentralisation peut être assimilée à une délocalisation de la production
informationnelle, cela permet à l'agence de disposer d'une main d'œuvre locale moins
onéreuse et de réduire les frais généraux. Par ailleurs, l'implantation de desks régionaux
répond également à des motifs d'ordre rédactionnel et commercial. Les journalistes d'un desk
régional sont plus à même de comprendre les centres d'intérêt des clients locaux et régionaux
et donc en mesure de produire une copie qui soit adaptée à leurs besoins spécifiques, ce que
confirme un directeur de bureau que nous avons interrogé : « Si on est à Paris, même si on a
un télescope, on n 'a pas une bonne vue : le diable niche dans les détails. »
Au terme de la décentralisation de l'agence en 1997, celle-ci compte cinq desks régionaux, le
desk Europe-Afrique situé au siège à Paris, ainsi qu'un desk latino-américain (Montevideo),
un desk Amérique du Nord (Washington), un desk Moyen-Orient (Nicosie), un desk Asie
(Hong Kong).
Toutefois, au sein de l'agence, la régionalisation s'est faite dans la douleur. Les journalistes
contestent la régionalisation considérant « qu 'elle n 'estpour la direction qu 'un moyen d'avoir
les mains libres à Paris et de recruter ailleurs un personnel docile et bon marché. » Par
ailleurs, ils jugent que le découpage régional répond davantage à des critères politiques que
géographiques comme le soulignent deux journalistes interrogés :
80 Huteau, Jean, Ullman, Bernard, AFP, Une histoire de l'Agence France Presse : 1944-1990, RobertLaffont, Paris, 1992, page 456.
61
- La régionalisation, ça a été Yalta bis, saufqu 'à Yalta il y avait des critères.
- La régionalisation a un costume mal taillé.
- On [la direction] n 'apas vraiment réfléchi en termes d'un certain nombre de critères
invariables (...). // n'y a pas eu d'études scientifiques de la division régionale, on a
pratiquement entériné le fait accompli de l'histoire. Pourquoi l'Iran est-elle présente
au Moyen-Orient, quand la Turquie est présente en Europe, et l'Afghanistan en Asie ?
(...) C'est une division institutionnelle. A l'AFP on aime bien l'institutionnel.
Les journalistes de l'AFP acceptent d'autant moins la régionalisation des desks que leur
agence fait face à une crise financière qui conduit la direction à supprimer 300 emplois, soit
15% du personnel ainsi que les services magazines, écoutes et contrôle. 450 journalistes sur
les 750 employés par l'AFP fondent une société des rédacteurs. Après huit jours de grève,
Henri Pigeât, président directeur général de l'AFP, présente sa démission au conseil
d'administration de l'agence.
2.3 Crise économique et financière de l'agence
L'Agence France Presse connaît entre 1970 et 1990, une grave crise économique dont les
causes sont multiples.
Pour faire face à la concurrence, l'Agence France Presse a dû procéder à de lourds
investissements techniques que nous avons évoqués précédemment. Par ailleurs, elle a entamé
un processus de régionalisation de l'information, qui vise à terme l'augmentation des revenus
issus des médias étrangers, notamment en proposant une copie adaptée à leurs besoins. A ces
dépenses, s'ajoute la hausse des frais de collecte de l'information à l'étranger et les charges
salariales des journalistes, qui sont présentées par Henri Pigeât comme une véritable menace
pour la survie de l'agence.
62
Le déficit de l'agence ne cesse de se creuser, il s'élève à 31.5 millions en 1982, auquel
s'ajoute l'année suivante le coût des investissements techniques réalisés. En 1983, le déficit
de l'AFP correspond à 84,52 millions de francs, soit 10% de son chiffre d'affaires.81 La
dépendance financière de l'agence vis-à-vis de l'État s'accentue, « En 1981, 60pour cent des
ressources proviennent alors des abonnements des services publics, et même 65 pour cent si
l'on y ajoute les abonnements de la radio et de la télévision officielle, 15 pour cent sont
apportés par la presse française et 15 pour cent sont tirés des ventes à l'étranger. »
2.4 Intensification de la concurrence
Sur le plan national, l'autre principale agence d'information française, l'ACP ne bénéficiant
pas du soutien de l'État, connaît des difficultés financières telles qu'elle est mise en faillite en
1992. L'Agence France Presse devient la seule agence d'informations générales française .
Sur le plan international, Reuters s'est spécialisée dans la production et la diffusion de
l'information économique et financière bien avant les autres agences. Si « en 1950 : les
informations financières et commerciales étaient une rubrique négligeable dans les journaux
d'information générale américains ; en 1970 elles représentaient entre une et cinq pages de
la plupart des quotidiens »83, Reuters a su tenir compte de cette évolution du marché
informationnel et adopter sa stratégie de développement en conséquence. A partir de 1963,
Gérard Long, nouveau directeur de l'AFP depuis 1961 juge que l'information doit être
compétitive, il développe un service appelé Money Monitor, qui lui permet de collecter et de
distribuer les cours des devises mondialement. Outre la communication des devises, le
système de Reuters permet aux institutions financières de passer leurs ordres d'achat et de
vente par les ordinateurs de l'agence. Cette stratégie permet à Reuters de multiplier ses
profits : «De 1976 à 1980, les recettes de Reuters doublent. En 1981, ses bénéfices après
81 Huteau, Jean, Ullman, Bernard, AFP, Une histoire de l'Agence France Presse : 1944-1990, RobertLaffont, Paris, 1992, page 428.82 Huteau, Jean, Ullman, Bernard, AFP, Une histoire de l'Agence France Presse : 1944-1990, RobertLaffont, Paris, 1992, page 424.83 Boyd Barrett, Oliver, Palmer Michael, Le trafic des nouvelles, les agences mondiales d'information,éd. Alain Moreau, Paris, 1980, page 350.
63
impôt passent de 3.25 millions de livres sterling (36 millions de francs) à 13.9 millions de
livres sterling (156 millions de francs). »84
Section 3 - 1990-2005 : Vers un modèle d'entreprise à visée commerciale
Les enjeux politiques qui prévalaient dans la première configuration ont laissé place aux
impératifs commerciaux. L'AFP doit faire face à une concurrence accrue, quant à l'État, sans
évoquer de désengagement vis-à-vis de l'agence, il exige de l'AFP un retour à l'équilibre
budgétaire.
3.1 Le redressement économique de l'agence
Les difficultés financières vécues par l'agence au milieu des années quatre-vingt ont provoqué
une réaction de la part de l'État français, qui ne souhaite plus assumer les déficits de l'agence.
À partir de 1991, Claude Moisy, PDG de l'AFP lance un plan quadriennal de rétablissement
des finances de l'agence. Cela se traduit notamment par une suppression de salariés, une
contribution plus forte de l'État et enfin une hausse de 5% des tarifs d'abonnement des
quotidiens.
En 1992, si l'AFP avait un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un milliard de francs, son déficit
est estimé à 28 millions de francs. Ses recettes proviennent à 86% des divers organes
médiatiques, le reste étant fourni par des produits « non média » comme la vente d'utilisation
de canaux d'information (les satellites) par exemple. Les deux principaux pourvoyeurs de
fonds sont la presse, à 37%, et l'État, par le biais des ministères et des administrations, à 49%.
Entre 1993 et 2002, l'AFP parvient à accroître son chiffre d'affaires, lui permettant de
dépendre dans une moindre mesure des abonnements de l'État. En effet, la part des
abonnements de l'État dans le chiffre d'affaires a considérablement diminué, passant de
84 Huteau, Jean, Ullman, Bernard, AFP, Une histoire de l'Agence France Presse : 1944-1990, RobertLaffont, Paris, 1992, page 416.
64
48.2% en 1993 à 37.8% en 2002. Toutefois la situation financière de l'agence est telle, que
l'AFP conclu le 20 novembre 2003, un contrat d'objectifs et de moyens avec l'État couvrant
la période 2004-2007. Dans ce contrat, l'État s'engage à maintenir une progression de ses
abonnements supérieurs à l'inflation tandis que l'AFP s'engage à parvenir à rééquilibrer ses
finances grâce au développement de ses recettes commerciales et à un effort de gestion. Par
ailleurs, afin de financer le déficit de 45 millions d'euros cumulés sur les quatre années
précédentes (2000-2003), l'AFP signe un crédit-bail sur son immeuble, Place de la Bourse.
Grâce au respect strict du contrat d'objectifs et de moyens, l'AFP parvient en 2005 à
l'équilibre budgétaire, et le chiffre d'affaires en 2006 est évalué à 270 millions d'euros. Par
ailleurs, l'agence a réduit considérablement sa dette et la direction envisage à terme le rachat
du siège historique de l'agence.
65
Tableau représentant les objectifs fixés par l'État dans le contrat d'objectif et de moyens2003-2007 (en millions d'euros)
Abonnement de
l'État
Évolution
CA France
Evolution
CA International et
événements sportifs
Evolution
CA Filiales
Evolution
Total recettes
commerciales
Évolution
Total personnel
Évolution
Charges (hors
personnel)
Évolution
Marge
d'exploitation
Évolution
2003
98,6
70,2
61,1
23,8
155,1
181,8
69,9
2,0
2004
101,6
3,0%
72,2
2,8%
65,3
6,9%
25,9
8,8%
163,4
5,4%
185,1
1,8%
72,8
4,1 %
7,0
250,0%
2005
104,0
2,4%
74,3
2,9%
67,2
2,9%
28,2
8,9%
169,7
3,9%
189,6
2,4%
71,9
-1,2%
12,2
74,3%
2006
106,1
2,0%
76,2
2,6%
73,2
5,9%
31,0
9,9%
180,4
6,3%
196,8
3,8%
73,9
2,8%
15,8
29,5%
2007
107,7
1,5%
78,1
2,5%
75,8
3,6%
33,9
9,4%
187,8
4,1 %
202,7
3,0%
73,7
-0,3%
19,1
20,9%
Sources : loi des finances 2005, Assemblée Nationale.8S
85Assemblée Nationale, loi des finances pour 2005. Disponible sur : < http://www.assemblee-nationale.fr/12/budget/plf2005/discussion.asp> (consulté le 12.05.05).
66
3.2 Les nouvelles orientations de l'agence
L'AFP avait enregistré un retard certain par rapport à ses principaux concurrents dans la
diversification de ses activités. Le développement de l'agence se concentre autour de deux
axes : la vidéo, et le multimédia. La participation de l'agence à la constitution d'une chaîne
d'information en continu en Europe, nommée provisoirement CFII, l'a encouragée à
développer une offre vidéo complète.
La branche multimédia, qui correspond à 10% du chiffre d'affaires de l'agence, poursuit son
développement via des partenariats établis avec des entreprises extérieures. C'est le cas d'un
joint-venture signé avec l'entreprise Softbank au Japon ou le prolongement pour trois ans de
l'accord qui lie l'AFP à l'agence photographique américaine Getty.
Au cours de ce chapitre, nous avons tenté d'établir les grandes phases de transformations de
l'AFP au regard de notre hypothèse de départ. Nous avons pu établir que l'Agence France
Presse, malgré son statut et son histoire profondément ancrés dans un cadre national français,
avait amorcé depuis le début des années quatre-vingt dix un virage technique et commercial
dans sa stratégie de développement, qui s'est accompagné par un désengagement récent mais
progressif de l'État.
67
Dans cette seconde partie, nous nous proposons d'analyser les changements survenus dans
l'écriture journalistique des agenciers depuis 1945. Dans notre analyse, nous considérons la
dépêche dans ses caractéristiques formelles mais également comme la manifestation du
discours journalistique.
Les caractéristiques formelles désignent les éléments spécifiques à la dépêche et les règles
auxquelles elle répond. La structure de la dépêche en pyramide inversée86, le format, la taille,
mais aussi le caractère événementiel, l'absence de commentaire, la précision, l'exactitude, et
la concision des informations, sont autant de caractéristiques sur lesquelles nous porterons
notre attention au cours des prochains chapitres.
Nous analyserons également la dépêche comme une manifestation du discours journalistique,
en partant du postulat suivant : « tout discours porte des traces de l'identité de celui qui
énonce »87. En rédigeant la dépêche, le journaliste ne relaie pas seulement l'événement, il
« met en représentation » sa propre identité.
Nous consacrerons le premier chapitre à l'analyse des contenus informationnels. Nous
évoquerons notamment la diversification et la fragmentation des contenus sous l'effet
conjugué des changements sociétaux et de l'explosion de l'offre informationnelle.
Le second chapitre sera consacré à l'évolution du modèle journalistique à travers la hiérarchisation
des dépêches. Nous démontrerons notamment comment le journalisme pratiqué par les agenciers se
caractérise par le passage d'un journalisme événementiel, modèle dominant de la première
configuration à un journalisme situationnel, caractéristique de la seconde configuration. Enfin dans le
dernier chapitre, nous aborderons les transformations de l'écriture journalistique et notamment le
passage d'un style journalistique personnel, relativement libre, caractéristique de la première
configuration à un style d'écriture davantage normalisé.
S(i Cumuie les agences américaines, l'AFP a adopté une piéseulaliuii de ses infuiiiialiuns sous funne depyramide inversée ou de dépêche à tiroirs. Les éléments les plus importants se situent dans le « lead »(premier paragraphe de la dépêche), puis les éléments sont développés du plus important au moinsimportant au fil des paragraphes.17 Charron, Jean, « Parler de soi en faisant parler les autres. Identité journalistique et discoursrapporté ». In Rieffel, Rémy et Watine, Thierry. Les mutations du journalisme en France et auQuébec. Paris: Éditions Panthéon Assas. 2000b, pp. 83-117.
69
-CHAPITRE 4- ANALYSE DES CONTENUS INFORMATIONNELS
Dans ce chapitre, nous nous proposons d'analyser l'évolution des contenus informationnels
des dépêches, c'est-à-dire déterminer quels sont les thèmes dominants et démontrer en quoi ils
coïncident avec une configuration particulière du système médiatique auquel l'agence
appartient. Ainsi, notre analyse nous conduit à souligner une diversification des thèmes
abordés et du mode de traitement de l'événement par les agenciers.
Lors de la première configuration, le mode de traitement est dominé par les thématiques
politiques et diplomatiques et par l'information « sérieuse ». Les bouleversements que connaît
la société à la fin des années soixante et au cours des années soixante-dix - avènement de la
consommation de masse, développement du temps libre et des loisirs, crise des institutions
traditionnelles- associées à un système médiatique fortement concurrentiel conduit l'agence à
élargir progressivement l'objet et le mode de traitement de ses dépêches.
La seconde configuration caractérisée par un contexte hyper concurrentiel, c'est-à-dire un
contexte où grâce à l'innovation technique, la concurrence et ses modalités s'intensifient au
point que les acteurs médiatiques opèrent une surveillance simultanée et permanente de leurs
concurrents. Cette configuration, qui se caractérise également par une clientèle aux intérêts de
plus en plus disparates, donne lieu à une diversification et une fragmentation de l'offre
informationnelle de l'agence. Le mode de traitement sérieux de l'information et les
thématiques politique et diplomatique s'élargissent à des thèmes plus légers et où la
dimension humaine prend une large place. La copie agencière contemporaine se caractérise
donc par l'introduction de l'information sociétale et de l'information divertissante.
70
Section 1 - Hégémonie du fait politique dans les dépêches
1.1 Un traitement prioritaire du fait politique
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les dépêches qui circulent sur les fils de
l'agence traitent majoritairement des domaines politiques et diplomatiques. Cela ne laisse
guère de place à d'autres thématiques comme l'économie, les thématiques de société ou les
loisirs, autant de thématiques qui, tiennent aujourd'hui une place significative dans les
dépêches diffusées par l'agence. L'intérêt présumé des lecteurs, des clients et donc des
journalistes tend quasi-exclusivement vers le politique. Cet intérêt pour l'information
politique, qui est une caractéristique du journalisme « sérieux » tout au long des dix-neuvième
et vingtième siècles, est particulièrement marqué en ces années d'après-guerre, quand les
populations sont particulièrement préoccupées par le retour et le maintien de la paix. Cet
intérêt est visible notamment dans la répartition des services de couverture de l'agence et au
degré d'importance que leur accordent les journalistes. C'est ainsi que conformément aux
intérêts du public, les services diplomatique et politique sont les services les plus considérés
au sein de l'agence. Les informations générales et l'économie constituent alors des services de
moindre importance et disposent de peu de reconnaissance au sein de l'agence comme en
témoigne un ancien journaliste.
L'AFP s'est donnée une image d'elle-même : exprimer l'information de la France dans
le monde, avec l'exemple de la BBC. Les départements nobles quand je suis rentré à
l'AFP, étaient le desk étranger, le service diplomatique et puis le service politique. Le
service informations générales était vraiment mal considéré, moi je n'aurais jamais
travaillé là quand je suis rentré à l'AFP. Le service économique se constituait en
marge, tellement en marge, que l'on ne savait plus où il avait sa place, on ne pouvait
pas y faire carrière, à la différence de Reuters
1.2 Le service diplomatique, joyau de l'AFP
Dans les années cinquante, le service diplomatique était le service le plus prestigieux de
l'AFP et faisait la fierté de son PDG, Jean Marin. Ce service, distinct du service politique qui
71
couvrait la politique nationale, avait pour mission de couvrir l'information politique
internationale et de produire également des papiers d'analyse. La plupart des journalistes qui
exercent au sein de ce service se sont illustrés à l'étranger; bénéficiant d'une grande
connaissance de la politique internationale, ils sont également considérés comme de « grandes
plumes » .
Quand je suis rentrée à l'AFP, être au service diplomatique, c'était la gloire de la
gloire, ça réunissait tous les gens qui avaient fait intelligemment l'étranger, les chefs
de poste, les fameuses plumes. Jean Marin, qui était à l'époque PDG disait : "le
service diplomatique, c'est la cerise sur le gâteau". Il y avait tous les samedis matins,
un papier d'analyse sur la semaine, il était très très repris et c'était très bien écrit.
Dans les années quatre-vingt, le service diplomatique perd peu à peu de son importance. La
crise que traversent les institutions politiques, la dépolitisation du public et le développement
d'autres thématiques, provoquent le déclin, puis la disparition du service diplomatique, ce qui
ne va pas sans susciter du ressentiment chez les journalistes les plus âgés : « Je suis écœurée
qu'on ait littéralement déchiqueté le service diplomatique, qui était Le Grand Service. »
1.3 Un contexte politique national et international qui oriente le contenu des dépêches
L'État et les institutions politiques concentrent un pouvoir important. « II y a trente ans, on
était dans l'institutionnel, c'est l'État et les grandes organisations internationales qui
donnaient le la. » Au lendemain de la guerre, les clients de l'agence sont en grande partie des
journaux nationaux. Or la presse écrite d'après-guerre est une presse politisée, qui accorde
une grande importance aux questions politique et diplomatique et qui reprend volontiers les
papiers de l'agence traitant de l'actualité politique.
La période de la guerre froide, qui tend à maintenir élevée le demande des clients pour
l'information politique internationale, contribue à pérenniser au sein de l'agence la
primauté du politique sur les autres domaines de l'actualité. L'affrontement entre les
blocs de l'Est et de l'Ouest, influence aussi de manière déterminante le contenu même
72
des dépêches. Au sein de l'agence, il est impératif de couvrir l'actualité politique
mondiale au-delà des blocs; aussi le service des écoutes de l'agence est créé afin
d'assurer une veille permanente des médias des pays de l'Est. Ce service permet à
l'agence de couvrir l'actualité internationale au-delà des barrières idéologiques et de
réaliser ainsi plusieurs scoops comme la mort de Staline par exemple88.
Par ailleurs, l'importance accordée aux sujets politiques durant la période d'après-
guerre est liée aux liens particuliers qui unissent l'AFP avec l'État français. Comme
nous l'avons souligné précédemment, l'AFP est créée sur l'initiative de l'État français
qui dote l'agence d'un statut provisoire d'« établissement public»89. En 1957, elle
acquiert un statut mixte qui vise à renforcer son indépendance. Indépendance relative,
puisque la part publique de recettes de l'AFP a parfois dépassé 60%90. On ne s'étonne
pas, dans ces conditions, de constater que les dépêches portant sur la politique
nationale française et sur l'action de la France à l'étranger soient nombreuses dans la
production de l'agence et que les intérêts nationaux y soient mis en valeur, même dans
les papiers traitant d'affaires étrangères.
La proximité de l'AFP avec l'État est un peu structurelle, c 'est la puissance de l'État
gaulliste. Il y avait une façon de travailler dans l'international il y a une trentaine
d'années qui était différente d'aujourd'hui. On travaillait l'international à partir d'une
base nationale très forte et donc on était dans le sillage de la diplomatie nationale, des
entreprises nationales. Lorsque la France fait le Concorde qui est un peu boudé par
les Américains, l'AFP fait tout pour que le Concorde devienne quelque chose
d'accepté sur le plan international malgré le refus des Américains.
Sans être un outil de propagande, l'Agence France Presse se fait donc le porte-parole
du gouvernement. Il n'est pas rare à cette époque que les dépêches reproduisent dans
8 Grâce à son service d'écoute des radios de Moscou et des autres capitales d'Europe de l'Est, l'AFPlance un flash qui tombe un quart d'heure avant l'annonce officielle de ce décès par Radio Moscou. Ladépêche annonçant la mort de Staline est située en annexe A-6.89 Ordonnances de 1945.90 Pigeât, Henri, Les agences de presse, institutions du passé ou médias d'avenir ?, la DocumentationFrançaise, 1996, 130 pages.
73
leur intégralité les discours du général de Gaulle , souvent suivis d'une analyse
« bienveillante » du discours92.
C'était une explication de texte, beaucoup plus qu'un papier d'analyse. Aujourd'hui,
l'analyse est beaucoup plus basée sur le fait que sur le discours. Ça correspondait à
une époque où on était beaucoup plus attaché au discours institutionnel et
politique (...) Le papier d'analyse est aujourd'hui certainement beaucoup plus riche
(..) beaucoup plus proche de la réalité, que les papiers d'analyse d'il y a 30 ans ou
plus, qui étaient beaucoup plus basés sur le discours politique par conséquent sur
l'espoir, "le wishfullthinking". Aujourd'hui, les journalistes et les hommes politiques,
nous ne sommes plus dans la même harmonie.
L'emploi du terme «harmonie » pour qualifier les rapports entre les journalistes de
l'agence et les hommes politiques souligne l'étroitesse des liens qu'entretenaient les
agenciers et les hommes politiques à cette période et qui n'étaient pas étrangers au
mode de financement de l'agence.
91 Une dépêche retranscrivant un discours du général de Gaulle est présentée à titre d'exemple enannexe A-2.92 Pour illustrer le traitement accordé au général de Gaulle par l 'AFP, on peut se reporter à la dépêchediffusée par l 'Agence Française de Presse (avant qu'elle ne devienne l 'AFP) le 12 septembre 1944 surles réactions de la population écoutant le premier discours du général de Gaulle qui est alors présidentdu gouvernement provisoire de la République Française. Si l 'emphase et la solennité du ton dujournaliste peuvent s 'expliquer par le contexte exceptionnel de la libération de la France, la dépêchen 'en reste pas moins particulièrement probante.
74
Dans les années cinquante, le factuel, type de dépêche dominant la production des
dépêches de l'AFP, désigne le compte-rendu de l'actualité politique, militaire et
générale (accidents majeurs, catastrophes naturelles, etc.) et laisse peu de place à
d'autres sujets (affaires sociales et culturelles, nouvelles économiques, etc.). Sur le
plan du registre, l'agence opte pour le ton sérieux et distancié qui convient à
l'information générale et politique et évite de tomber dans ce qui serait perçu comme
de la frivolité.
La primauté du politique sur les autres thématiques conduit ainsi à exclure certains
sujets plus légers qui ne trouvent pas leur place dans le fil de l'agence. Dans les années
cinquante, les journalistes ont une conception de l'information telle, qu'il est
impensable que l'actualité des célébrités puisse être traitée par les journalistes. Or
aujourd'hui, l'AFP consacre à ce type d'information un fil spécifique qui symbolise
l'extension des contenus informationnels et l'allégement des informations diffusées
par l'agence. Le fil people n'est, bien sûr, pas représentatif de l'ensemble des
informations diffusées par l'agence, toutefois il cristallise les divergences de vue entre
les journalistes de l'ancienne génération et ceux des générations plus récentes sur le
bien fondé de diffuser ce type d'informations. Les journalistes entrés à l'AFP durant
les vingt premières années de l'agence sont profondément choqués par la création d'un
fil people à l'agence. « Maintenant, on fait des choses plus futiles. Avant, on ne
s'intéressait pas à savoir si madame Khrouchtchev avait des relations avec monsieur
machin. Maintenant on fait beaucoup plus cela ».
Dans la section suivante, nous allons analyser les processus qui ont conduit à la
transformation des contenus de la dépêche, c'est-à-dire analyser comment et pourquoi
l'agencier a été amené progressivement à couvrir d'autres thématiques et à modifier son mode
de traitement de l'information.
Section 2 - Une société en mutation qui engendre une fragmentation et unediversification des contenus informationnels
75
La transformation des contenus informationnels diffusés par l'AFP s'explique certes par les
transformations de la société, mais plus particulièrement par un élargissement des intérêts des
individus et par les transformations radicales de l'environnement médiatique mondial. Depuis
la fin des années soixante, la société a été traversée par de nombreuses transformations
politiques, économiques et humaines qui ont contribué à redéfinir les lieux de pouvoir et qui
ont ainsi modifié les centres d'intérêts des individus. Jusqu'au début des années quatre-vingt,
la couverture de l'agence était institutionnelle, le politique étant le principal pôle d'attraction
de l'information. L'intérêt pour l'information politique et diplomatique ainsi que pour
l'information dite « sérieuse » s'est reportée progressivement vers d'autres pôles d'intérêt
comme l'économie, le divertissement ou encore l'intérêt humain. La hiérarchie des contenus
et des priorités informationnelles s'en trouve alors profondément modifiée.
Le développement des loisirs, l'avènement de la consommation de masse et la réduction du
temps de travail sont autant d'éléments qui ont conduit à une montée de l'individualisme et
par conséquent à la privatisation des intérêts des individus. L'information médiatique a suivi
et reflète l'orientation de plus en plus privée des individus afin de conserver sa pertinence du
point de vue de sa clientèle, cela conduit alors à une certaine « privatisation » des référents
journalistiques. « Ceux-ci correspondent de plus en plus aux intérêts quotidiens des
consommateurs perçus comme personnes privées, la vie familiale, les hobbies, les sorties. »
Le contexte d'hyper concurrence a accéléré le processus de fragmentation des intérêts et donc
de l'offre informationnelle. Les agences doivent proposer des informations de plus en plus
diversifiées et spécifiques. En conséquence les journalistes tendent à traiter de sujets en marge
de la sphère publique. Les journalistes interrogés confirment que les papiers société et le fil
Life style, distribué par l'agence afin de répondre à ces nouveaux besoins d'informations, ont
connu une forte expansion ces dernières années.
2.1 Une société en mutation
Depuis le début des années soixante-dix, la société connaît une crise de ses institutions. Dans
les années cinquante, l'organisation de la société se faisait autour d'institutions telles que
93 Charron Jean, de Bonville Jean, « Le paradigme du journalisme de communication : essai dedéfinition », Communication. Vol. 17, no 2 (1996b), page 24.
76
l'État, la famille ou l'Église. L'effondrement des idéologies et par la même des institutions
qui les soutenaient conduit à une mise à distance du Politique par les individus. Le
mouvement de globalisation qui s'accélère au cours des années soixante-dix transcende les
frontières traditionnelles de l'État. La transnationalisation du politique modifie les limites de
l'exercice du pouvoir et multiplie le nombre de ses acteurs. Le dépassement des repères
traditionnels de l'exercice du politique, c'est-à-dire des limites territoriales, rend de plus en
plus difficile la localisation du politique. L'exercice du politique est diffus, fragmenté à
l'intérieur de nouveaux groupes, de nouvelles populations et de nouveaux réseaux. Le pouvoir
de décision n'est plus dans les seules mains des acteurs politiques. Les acteurs sont multiples
et le pouvoir fragmenté. D'autres types d'acteurs apparaissent, tels les organisations non
gouvernementales, les entreprises multinationales, les mouvements associatifs etc., qui
traduisent l'émergence de nouvelles formes d'action citoyenne. Ces acteurs constituent de
nouvelles sources pour les journalistes qui ne font plus uniquement appel aux sources
institutionnelles.
La fin de la guerre froide contribue à la fin de l'hégémonie du politique sur toutes les
autres sphères de la société, notamment en modifiant la grille d'interprétation des
affaires internationales. « Pendant près d'un demi-siècle, la grille de polarisation Est -
Ouest a naturalisé la géopolitique comme maître du jeu dans l'ordre et les désordres
du monde. Le bris du cercle vertueux de la croissance au seuil des années soixante-dix
hâte le retour du refoulé des représentations géo - économiques.» 4
Par ailleurs, la « fmanciarisation » et la concentration du capital des acteurs
médiatiques, semblent être aussi des facteurs décisifs dans le passage d'une société à
régulation politique, à une société à régulation économique. La fmanciarisation des
acteurs médiatiques se traduit notamment par une transformation du mode de propriété
des médias. Les médias passent aux mains d'entrepreneurs industriels qui voient en
eux de « nouvelles possibilités de valorisation du capital, induites par les
changements technologiques et par les nouvelles règles du jeu économique
(notamment la libéralisation des marchés, l'internationalisation des structures de
94 Mattelart, Armand, Histoire de l'utopie planétaire, de la cité prophétique à la société globale, laDécouverte, 1999, page 323.
77
production, le mouvement de déréglementation et de privatisation) »95. Une grande
part de ces entrepreneurs industriels ont dû faire appel au capital financier, et
notamment à des investisseurs institutionnels, pour financer le développement de leurs
entreprises médiatiques. Ce changement dans le mode de propriété modifie la stratégie
de l'entreprise de presse, cette dernière répondant de moins en moins à une logique
informationnelle (où les principales fonctions d'un média sont d'informer, de relayer
la parole des différents groupes de la société, etc.) au profit d'une logique de
rentabilité.96
Du point de vue de la société, la mise à distance de la chose politique s'accompagne d'un
intérêt croissant du public pour l'économie, les besoins informationnels se déplacent du pôle
politique vers le pôle économique. Les acteurs économiques mais aussi le grand public,
notamment les actionnaires portent un intérêt considérable à l'information économique et
financière. Dans son ouvrage, Julien Duval explique comment des journaux tels le Monde et
le Figaro sont parvenus à recruter des lecteurs dans la même sphère socio-économique des
cadres moyens ou supérieurs, ce lectorat étant, selon lui, particulièrement concerné par les
questions économiques qui rejoignent ses centres d'intérêt (investissement immobilier,
épargne...).
2.2 L'explosion de l'offre informationnelle réoriente la demande des clients de l'agence
Comme nous l'avons vu dans le troisième chapitre de la première partie consacrée à la
présentation des deux configurations, la seconde configuration médiatique se caractérise
notamment par l'explosion de l'offre informationnelle. Les clients de l'agence exercent leur
activité dans un contexte hyper concurrentiel, où la tâche de plus en plus difficile de s'attacher
des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs devient un défi quotidien. Les clients de
l'AFP vont donc faire le choix d'une stratégie de différenciation et de spécialisation
95 Brin, Colette, Charron Jean, de Bonville Jean, Nature et transformation du journalisme : Théorie etrecherches empiriques, Presse de l'Université Laval, Québec, 2005, page 289.96 En France, le départ de Serge July du quotidien Libération suite à sa cession au groupe financierRothschild est à cet égard un exemple pertinent.97 Duval, Julien, Critique de la raison journalistique. Les transformations de la presse économique enFrance, Le Seuil, Paris, 2004, 366 pages.
7 S
maximales. « A force de distinction et de différenciation, certains médias en arrivent à
circonscrire des marchés spécifiques ; le système tend progressivement vers la spécialisation
des discours médiatiques et la segmentation des publics. »98
La production de masse qui caractérise le capitalisme depuis la Seconde Guerre
mondiale entraîne, tout naturellement, une consommation de masse. Au-delà du
simple effet quantitatif, cela modifie profondément la structure sociale et mentale de la
société qui s'oriente vers des revendications privées et particulières. Au cours des
années soixante-dix, la société évolue donc vers un individualisme grandissant.
Les besoins en information sont de plus en plus différenciés en fonction des individus.
Compte tenu de la multiplication des pourvoyeurs d'informations, le public peut se permettre
d'exiger une information qui réponde à ses intérêts aussi disparates soient-ils. L'individu peut
vouloir disposer d'une information économique sur les résultats d'une entreprise précise, et
également disposer d'indications sur des lieux touristiques pour préparer ses prochaines
vacances. Par ailleurs, l'augmentation du temps libre représente un facteur majeur des modes
de vie. Les individus consacrent davantage de temps aux loisirs, à leur habitat, ils disposent
d'un pouvoir d'achat plus grand. En conséquence, les centres d'intérêt se diversifient.
Les besoins informationnels s'élargissent également à des informations portant sur des
questions de société. Nommées d'abord dépêches à « intérêt humain », ces dépêches étaient
produites par le service d'informations générales; puis l'AFP crée un département Société qui
traite de thématiques sociétales dont le fil life style est un des fleurons.
Section 3 - Un contenu informationnel en mutation
L'information produite aujourd'hui par les médias est une information diversifiée et
fragmentée tant du point de vue des contenus que du traitement journalistique. « On ne
pisse pas de la copie froide et bureaucratique, on doit rendre attrayante la copie.
Avant, on accordait une énorme importance à la diplomatie, aux visites des chefs
d'État, maintenant plus personne ne s'intéresse à cela ». Selon ce journaliste, plus
'8 Brin, Colette, Charron, Jean, de Bonville, Jean, Nature et transformation du journalisme, théorie etrecherches empiriques, Presses de l'Université Laval, Québec, 2005, page 305.
7 M
personne ne s'intéresse à ce qui autrefois constituait la catégorie modale de la
production de l'agence : la diplomatie et un style journalistique distant.
Si l'AFP conserve son rôle traditionnel de fournisseur d'information politique et générale, elle
a dû, pour répondre aux besoins de ses clients, élargir l'éventail des thèmes abordés dans ses
dépêches et en modifier le traitement. Nous proposons dans cette section d'analyser trois
changements importants au chapitre du contenu des dépêches : l'importance accordée
dorénavant à la dimension humaine des événements (le human interest), le développement de
l'information sociétale et la part croissante de l'information divertissante, dont nous
analyserons trois manifestations : le fil life style, le fil people et la rédaction des insolites".
3.1 Dimensions politique, diplomatique et humaine du traitement de l'information
Les événements, notamment les conflits, étaient autrefois principalement traités sous les
angles politique et diplomatique. L'information provenait de sources officielles,
gouvernementales ou étatiques et exprimait les points de vue officiels et institutionnels.
Aujourd'hui, le journaliste dispose d'une plus grande diversité de sources (les organisations
non-gouvernementales, les associations diverses, les organismes transnationaux, les
entreprises et même de simples citoyens, etc.); or, les sources non officielles et non-étatiques
mettent en relief des aspects différents des événements, notamment la dimension humaine et
l'aspect tragique des faits.
Aujourd'hui le statut international de l'information ne dépend pas seulement de
l'institutionnel mais dépend de tous les autres acteurs de la société. Ce qui donne son
statut international à un événement, c'est le côté tragique d'un événement, ce n'est pas
seulement la guerre en tant que guerre, mais en tant qu 'effet sur la société.
Si aujourd'hui, la dimension humaine des événements et des conflits a acquis une
grande importance dans la représentation qu'en donnent les médias, ce n'est pas
seulement parce que l'éventail des sources disponibles s'est élargi; c'est aussi pour
répondre à la demande des clients. L'importance croissante de la dimension humaine
99 L'information insolite est un fait relaté sur le mode de la narration, le texte est généralement court,et relate un fait surprenant où les dimensions humoristiques et parfois dramatiques sont privilégiées.
80
dans la couverture d'un événement s'inscrit en effet dans une configuration du
système médiatique où les contraintes de la concurrence sont de plus en plus fortes et
exigeantes. Les journalistes doivent en effet produire des histoires susceptibles de
susciter l'intérêt et de retenir l'attention d'un public extrêmement sollicité; l'accent
mis sur les dimensions humaine ou dramatique des événements y contribue, comme le
souligne cette jeune correspondante de l'AFP fréquemment envoyée sur des zones de
conflit. « Les histoires humaines, ce qui se cachent derrière (les événements), tout le
monde aime ça. Derrière une guerre, il y a toujours des gens qui souffrent, il faut
mettre un visage sur tous ces gens, il faut mettre un nom. Il faut rapprocher les gens
des lecteurs ».
Mais si l'humain fait vendre, il est néanmoins peu probable que le journaliste lui-
même soit motivé uniquement par des préoccupations commerciales. Il agit surtout en
fonction d'une certaine conception du journalisme qui s'est définie progressivement à
mesure que les contraintes commerciales sont devenues de plus en plus fortes. Les
« sujets humains » semblent donc correspondre à une forte demande de la part du
public. Dans un contexte de surabondance de l'information, le journaliste doit plus que
jamais lutter pour intéresser le public, aussi met-il l'accent sur les aspects de
l'événement auxquels le public de ses clients pourrait s'identifier. L'information mise
désormais sur des phénomènes psychologiques d'identification et de proximité. L'effet
d'identification et la proximité confèrent à la dimension humaine de l'information une
valeur particulière qui peut devenir décisive dans un contexte où l'attention du public
est en permanence sollicitée dans une surabondance d'information.
Enfin, l'accroissement du traitement humain dans les dépêches d'agence est dû aussi
au fait que le public est habitué à ce type d'information privilégié par la télévision. La
télévision est un médium de l'image et de l'instantané, apte à impressionner l'esprit et
les sens, mais moins apte que l'écrit à informer en profondeur, aussi le journalisme
télévisuel laisse-t-il une large place aux conséquences des conflits et non plus
seulement à leur dimension institutionnelle comme le souligne ce correspondant
étranger. « La mère qui perd ses enfants, le village qui est détruit, la fameuse image de
l'enfant palestinien qui est tué dans les bras de son père par un soldat israélien : les
télévisions ont donné à travers l'image ce que l'on ne peut pas restituer par l'écrit
comme le fait l'image, l'émotion. »
81
Par ailleurs, les médias écrits connaissent une crise du lectorat importante depuis une
vingtaine d'années100, qui s'explique en partie par la part croissante de la télévision et
d'Internet dans la consommation médiatique des individus. Les journaux cherchent
donc à « tirer leur épingle du jeu » en s'adaptant à ce lectorat davantage attiré par la
télévision que par la lecture.
Ce journalisme d'intérêt humain, qui s'écarte sensiblement du journalisme
d'information politique et général traditionnel est perçu positivement par certains
journalistes de la plus jeune génération, qui y voient l'expression d'une conception «
humaniste » de leur métier. Certains conçoivent même leur profession comme un
engagement « humanitaire » qui consiste à mettre en lumière des conflits ou des
populations auxquels l'opinion internationale et les pôles décisionnaires ne portent pas
d'intérêt.
Une journaliste ayant le statut siège et qui a plusieurs fois couvert le conflit irakien
souligne l'importance de donner la parole aux populations : « En Irak, il faut raconter
autre chose que la liberté, c'est un pays inconnu. Il y a des milliers d'histoires, des
gens qui n'avaient pas de noms, qui n'avaient pas de prénoms, qui avaient
complètement été annihilés pendant des années et qui avaient plein de choses à dire. »
La mise en valeur de la dimension humaine serait donc une manière de concilier une
vision humanitaire et noble du journalisme avec les intérêts commerciaux de l'agence.
Cependant, les contraintes de l'organisation, notamment la pression temporelle qui
pèse sur les journalistes rendent difficile la pratique de ce journalisme « humaniste ». «
C'est des journées énormes et en même temps, quand je vais sur le terrain en
reportage, j'arrive toujours à faire plus. Il y a des histoires que je garde pour moi, et
je me dis, un jour je les ferai pour un magazine. » Le journalisme humanitaire semble
relever de l'apostolat, comme l'illustre le cas de cette journaliste free lance (pigiste) de
10 Le lectorat de la presse quotidienne française a diminué considérablement, ainsi le nombre dequotidiens d'information générale est passé de 28 à 10 à Paris entre 1946 et 2001, et de 175 à 56 enprovince. Au cours de la même période, le tirage des quotidiens a reculé, de 15 millions en 1946 à 9millions en 2001. Entre 1946 et 2001, le nombre d'exemplaires tirés pour 1.000 habitants a diminué de370 à 150, soit une baisse de 60 %. (sources : Rapport d'information publié le 7 juillet 2004 (N° 406)au Sénat par Paul Loridant. Disponible sur <http://www.senat.fr/rap/r03-406/r03-4060.html> (consultéle 15.10.04). La presse écrite nationale d'information générale et politique est donc particulièrementtouché par une diminution de son lectorat ; depuis 1990, sa diffusion a diminué de 15% depuis 1990,les recettes ont diminué de 14%. En volume, son chiffre d'affaires a diminué de 31%.
H 2
l'AFP qui a pratiqué pendant deux ans cette forme de journalisme en Amérique Latine.
Son statut de stringex lui a permis d'échapper partiellement aux contraintes
commerciales de l'entreprise, ainsi elle a pu disposer du temps nécessaire pour couvrir
pendant deux ans le génocide des Indiens d'Amérique Latine. « Étant donné que
j'étais free lance, j'étais capable de passer un mois dans un village de prendre le
temps de les écouter, de les mettre en confiance. » Le coût de son engagement
journalistique était avant tout financier : «en moyenne sur deux ans, j'ai gagné trois
cents dollars par mois ».
Nous constatons que cette conception du métier ne peut s'actualiser que si le journaliste
dispose d'un laps de temps suffisamment important pour vivre au contact des populations.
Cela engage un coût financier qui ne peut pas être supporté par les médias en général et par
l'AFP en particulier, dont la situation financière est particulièrement difficile.101
3.2 Le développement de l'information économique
Le 1er avril 1968, l'agence amorce un large développement du service économique102 qui
était alors relégué à un rang secondaire. Le développement de l'information économique et
financière est significatif de la diversification des thèmes couverts par l'AFP, mais questionne
également le statut de l'information. En effet, à ses débuts l'information économique et
financière consiste essentiellement dans la transmission de données brutes, chiffrées.
Aujourd'hui les agences produisent de plus en plus de dossiers, d'analyses103, mais la
distinction entre les données chiffrées et le reste de l'information économique est toujours
fortement marquée. Le desk économique de l'AFP est divisé en deux sous-services, l'un traite
de l'information économique, l'autre du reportage économique. Le service consacré à
l'information économique traite essentiellement des données brutes, d'informations chiffrées,
101 La politique actuelle de l'agence ne vise pas à encourager le journalisme de reportage ni lesinitiatives personnelles des journalistes. La recherche de la rentabilité, la politique de réduction descoûts et la normalisation des pratiques journalistiques au sein de l'agence sont autant de facteurs quiexpliquent cette réduction du reportage. Nous aborderons plus longuement cette question dans latroisième partie.102 A propos du traitement de l'information économique et des pratiques journalistiques spécifiquesqui s'y rattachent, on peut notamment se référer aux travaux de Julien Duval. « Concessions etconversions à l'économie. Le journalisme économique en France depuis les années 80 », Actes de larecherche en sciences sociales, n°131-132, mars 2000, pp. 56-75.103 Une dépêche extrait d'un dossier est présentée en annexe, A -14.
83
des résultats des entreprises, des cours des monnaies, de la Bourse, tandis que celui du
reportage économique produit des dépêches plus longues. Le premier service existe de longue
date au sein de l'agence, le service de reportage économique est plus récent et s'inscrit dans la
tendance à valoriser le «journalisme situationnel » dont il sera question plus loin dans la
thèse, c'est-à-dire un journalisme où la contextualisation et l'analyse des informations sont
privilégiées. Par ailleurs, l'existence de deux services économiques témoigne de l'importance
que l'on accorde aujourd'hui aux affaires économiques.
3.3 De nouvelles thématiques : thématique société et « information divertissante »
Si le traitement de l'événement s'est sensiblement modifié, la montée de nouvelles
thématiques informationnelles marque l'extension du concept d'information ou du moins la
transformation de sa nature. Bien que l'économie et le sport constituent des thématiques
privilégiées au sein de l'Agence France Presse et disposent chacune d'un fil qui leur est
propre, le développement d'autres thématiques répond à une évolution de la demande. Nous
traiterons ici de deux thématiques qui nous paraissent particulièrement pertinentes à cet
égard : l'information sociétale et l'information divertissante104.
3.3.1 l'information sociétale
3.3.1.1 le life style
L'appellation life style désigne donc à la fois les intérêts personnels des individus mais aussi
les dépêches portant sur des thématiques à la mode. Régulièrement les journalistes proposent
à leurs clients des séries magazines dont le thème n'est initié ni par l'actualité, ni par les
clients, mais par ce que les journalistes pressentent comme étant des sujets qui pourraient
104 Le développement d'informations divertissantes au sein des fils de l'agence s'inscrit dans lemouvement de Y infotainment (contraction des termes : information et entertainment). Les règles deproduction de l'information ont atteint un nouveau stade : si pendant une longue période lesinformations divertissantes étaient intégrées aux valeurs professionnelles des journalistes, aujourd'huiles informations sont produites comme un divertissement. A propos de la notion à'infotainment, lelecteur pourra se reporter aux travaux de Brants, K. (1998), «Who's afraid of infotainment ? »European Journal of communication 30 (3), pp.315-336.
intéresser le public. « C'est un truc où il n'y a pas d'actu, c'est du magazine à l'état pur, un
sujet qui n'a pas d'actualité brûlante. On décide défaire des sujets sur les trains par exemple,
parce que quelqu 'un a décidé dans un bureau quelque part que ça serait intéressant. »
Les papiers magazines sont plus longs et exigent un investissement plus important des
journalistes pour la recherche d'information, des illustrations; l'écriture des papiers magazine
est par ailleurs moins soumis à des contraintes de style. Aussi, constituent-ils pour les
journalistes un moyen de s'extraire de la pression quotidienne et de l'urgence. Par ailleurs, la
rédaction des papiers magazines permet aux journalistes de s'investir dans des produits
inédits, distinctifs, tout en répondant aux demandes des clients pour des sujets uniques,
colorés et de société.
La demande des clients pour ce type de sujets s'est multipliée. Un audit réalisé en 2003 par
l'agence auprès de sept quotidiens régionaux, les quotidiens parisiens, TF1, France 2, France
3, et trois radios précisait que parmi les principaux reproches adressés à l'agence, les clients
regrettaient que l'AFP soit encore faible dans les secteurs qui touchent au life style105. « Les
gens aiment bien avoir des histoires humaines, et je ne parle pas des faits divers. Sur la
France, il faut qu'on parle de l'Islam, des homosexuels, tous ces sujets qui sont à la mode, il
faut qu'on renvoie aux gens une image d'eux-mêmes ». Le journaliste associe l'intérêt pour les
faits de société au fait que les gens s'y reconnaissent. Le journaliste recherche un effet
psychologique d'identification entre les sujets et le public, il ne traite pas de sujets parce
qu'ils relèvent de l'intérêt public, mais parce qu'ils sont à la mode et qu'ils font l'objet d'une
demande importante au moment où il rédige. Cette recherche d'adéquation entre l'information
et les préoccupations des individus s'inscrit dans ce qu'Yves Lavoinne nomme « le
journalisme de communication »106 : «Dans la rhétorique de la communication, (...), prime
la relation entre le journaliste et l'auditeur (interlocution) ou le lecteur (allocution). La
105 Audit de l'AFP, automne 2003, annexe B-7.
La notion de «journalisme de communication» a été évoquée pour la première fois par YvesLavoinne In « Le journaliste saisi par la communication », In Martin, Marc, Histoire et médias.Journalisme et journalistes français, 1950-1990, Paris, Albin Michel, 1990, pp. 161-173. Jean Charronet Jean de Bonville (In Charron, Jean, de Bonville, Jean, « Le paradigme du journalisme decommunication : essai de définition, Communication. Vol. 17, no 2 (1996b), pp. 51-97.) ont repris àleur compte cette notion dans leur analyse du changement journalistique. Les deux auteurs pensent lestransformations du journalisme comme un changement paradigmatique conduisant à l'émergenced'une nouvelle forme de journalisme : le journalisme de communication.
85
nouvelle, son intérêt cessent de s'imposer d'eux-mêmes ; désormais, il faut signifier au
destinataire qu 'il est concerné. »107
La rédaction de sujets qui s'apparentent au life style ou à la culture rencontre parfois des
résistances auprès de journaux et journalistes de l'agence qui ne considèrent pas ce type
d'information comme étant de première importance. Ainsi ce journaliste, spécialiste de la
rubrique cinéma explique, « les sujets société, tendance, life style, il y a plein de bureaux que
ça n'intéressent pas du tout. C'est dur de changer les mentalités, moi j'ai du mal à revendre
mes festivals en province, eux [les journaux] ils ne couvrent que la politique et le faits
divers .» Ici, il s'agit moins d'un effet de génération entre les innovateurs qui valoriseraient le
life style et les anciens qui privilégieraient la politique et les faits divers, qu'un clivage entre la
capitale et la province. En effet, les informations nationales présentes dans les médias locaux
sont essentiellement constituées de politique, d'économie, voire de faits divers. Les médias
locaux ou régionaux sont moins enclins à publier des sujets de tendance, life style ou culturels
car ces sujets sont perçus de la part des lecteurs comme des sujets typiquement parisiens. Par
ailleurs, de nombreux sujets traitant de la culture ou du life style traitent majoritairement de
l'actualité de la capitale.
3.3.1.2 l'information fonctionnelle
Les journalistes doivent traiter de diverses manières un même événement et donner une
couverture plus vivante, qui réponde aux multiples intérêts des individus. Outre la multiplicité
des thèmes abordés par l'agence, les journalistes produisent davantage d'information
fonctionnelle, c'est-à-dire une information qui traite des aspects pratiques de la vie
quotidienne des lecteurs comme le bricolage, des conseils pour l'achat d'une voiture etc. Les
besoins d'information fonctionnelle du public peuvent s'expliquer par la hausse du temps
consacré aux loisirs, conséquence de la réduction et de l'aménagement du temps de travail108.
107 Lavoinne, Yves, « Le journalisme saisi par la communication ». In Martin, Marc (dir.), Histoire etmédias. Journalisme et journalistes français, 1950-1990. Actes du colloque de Nanterre, Paris, AlbinMichel, 1991, pp. 163-164.IO8Entre 1970 et 2002, le nombre d'heures travaillées a régressé dans 14 pays des 19 pays de l'OCDEpour lesquelles les données sont disponibles, OCDE, Synthèses, Différentes facettes du temps detravail : évolution récente du temps de travail, mars 2005, 8 pages.
86
Le contexte de surabondance conduit les journalistes à produire de l'information fonctionnelle
afin de répondre aux demandes explicites des clients qui eux-mêmes constatent que le public
apprécie ce genre d'information. « Une information service allant au devant des intérêts de
ses publics dans le domaine de la santé, des loisirs et de la consommation. Fonctionnant
comme l'interface entre une offre de biens, de services, de conseils et des publics de
consommateurs (...) ».
Ainsi, les journalistes relient-ils un sujet général aux préoccupations singulières des
individus. « Pour un sujet sur l'environnement, il faudra faire tous les sujets sur le
protocole de Kyoto, tous les papiers scientifiques et politiques, mais il faudra faire
aussi du concret, du quotidien comme les gestes à faire en cas de canicule ». Cela
traduit non seulement un élargissement des angles de traitement de l'événement, un
souci de rendre proche du lecteur des sujets globaux, mais aussi une modification
significative de la hiérarchisation de l'information. L'information pratique est placée
sur le même plan que l'information politique et globale. L'objectif des journalistes est
de faire jouer « un effet de proximité », il s'agit de rendre l'événement pertinent dans
la vie quotidienne des individus. La proximité accroît la valeur et la pertinence, donc
l'attrait de l'information.
3.3.2 L'information divertissante
L'information divertissante et le divertissement proprement dits, prennent une part de plus en
plus importante dans les médias. Chalaby considère que le divertissement est devenu le
contenu qui génère le plus de revenus pour les nouveaux médias et que le marché médiatique
n'est plus pour longtemps dominé par l'information dite sérieuse, « Quel que soit le format, le
divertissement est devenu le contenu privilégié par les nouveaux médias. »' . Sans établir un
constat aussi radical qui touche plus fortement Internet que les autres médias, force est de
109 Neveu, Erik, Sociologie du journalisme, collection Repères, Paris, avril 2001 , page 97.110 Chalaby, Jean K., « Journalism Studies in an Era of Transition in Public», What is JournalismStudies, Journalism, 2000, pp. 33-39: « In eitherformat, entertainment has become the content that isprivilégiée by newly established média organization» (traduction réalisée par l'auteur).
87
constater une augmentation de dépêches ayant pour objet le divertissement, comme le sport
ou certains sujets du life style; voire à visée divertissante, comme l'information people ou la
catégorie des insolites.
Cette tendance n'est pas spécifique à l'agence et peut être généralisée à de nombreux
médias et pays. Une étude réalisée par «Journalism.org» en 1998 et intitulée
« Changing Définitions of News » a mis en évidence cette évolution en constatant
qu'entre 1977 et 1997, le nombre d'informations traitant de l'actualité des célébrités
ou de divertissement a triplé, passant de une nouvelle sur cinquante à une nouvelle sur
quatorze. '"
Cette évolution de l'information ne fait pas l'unanimité auprès de tous les journalistes. Les
journalistes les plus anciens notamment considèrent que ce type d'information n'a pas sa place
sur les fils de l'agence. Lorsqu'ils exerçaient les fonctions d'agencier, ils produisaient des
informations « sérieuses », leur conception de l'information était plus étroite qu'aujourd'hui.
Les journalistes de la seconde génération (dont l'âge varie de 45 à 55 ans), qui ont été les
témoins et les acteurs de cette redéfinition de l'information, ont conscience de l'importance de
la demande pour ce type d'information, d'autant plus que bon nombre d'entre eux dirigent ou
ont dirigé par le passé des bureaux; à ce titre ils ont une conscience aiguë des objectifs
commerciaux de l'agence. Aussi, ces derniers admettent qu'il est essentiel de produire ce type
d'information, sans pour autant verser dans l'exagération.
On fait de l'information divertissante pour des raisons commerciales, mais notre rôle
n'est pas de divertir, on n'est pas un cirque. On peut diversifier l'information, on peut
faire des problèmes de société, de l'insolite, mais notre rôle n'est pas défaire un
cabaret, un casino.
1 The Project for Excellence in Journalism « Changing Définitions of News », 6 mars 1998.Disponible sur : <http://www.journalism.org/resources/research/reports/definitions/default.asp>(consulté le 10.02.05) : «D'une pour cinquante histoires, à une pour quatorze » (traduction effectuéepar l'auteur).
88
Une grande majorité (78%) des journalistes âgés de 45 à 60 ans de notre échantillon refusent
l'idée que divertir compte aujourd'hui autant qu'informer.
3.3.2.1 le succès des Insolites
La production des Insolites ne constitue pas un phénomène récent pour l'agence; toutefois, ce
type d'information a connu une expansion sans précédent au cours des dix dernières années.
A cet égard, Dominique Marchetti considère qu'il y a une nouvelle définition dominante de
l'actualité internationale qui accorde une place importante aux « événements imprévus,
surprenants, «décalés» (faits divers, histoires humaines, etc.) »"2; le développement des
Insolites participe de ce mouvement.
L'information insolite a connu un succès grandissant avec l'apparition d'Internet. Les
sites d'information tels Yahoo ou Voilà diffusent tous les insolites publiés sur les fils
des trois agences mondiales. Ce type d'information connaît un grand succès auprès des
internautes qui s'échangent fréquemment ce type de dépêches, ce que confirme un
journaliste en poste à Londres :
A Londres, un des papiers les plus repris de tous ceux quej 'ai fait est un papier sur un
perroquet qui aurait appartenu à Churchill. Le propriétaire expliquait qu 'il était un
peu vieillissant mais qu'il continuait d'insulter les gens comme Churchill insultait les
nazis. C'est une dépêche qui a fait le tour ins-tan-ta-né-ment. C'est vraiment l'épisode
qui n 'a aucun intérêt, dans l'échelle de la gravité, c 'est au niveau 0 ou 1. Mais c 'est le
truc insolite, original, ce genre de sujet ça marche toujours.
112 Marchetti, Dominique, "La fin d'un Monde, les transformations du traitement de la politiqueétrangère dans les chaînes de télévision françaises grand public ». In Arnaud Lionel, Guillaunet Louis,Les Frontières du politique, enquête sur les processus de politisation et de dépolitisation, Res Publica,2005, pp. 49-77.
Dépêche AFP, Insolite ; Charlie, l'un des perroquets de Winston Churchill, fête cette annéeses 104 ans et continue de maudire Adolf Hitler et les nazis, comme le lui avait appris sonmaître. Londres, 19.01.04 :
LONDRES (AFP) - Charlie, l'un des perroquets de Winston Churchill, fête cette année
ses 104 ans et continue de maudire Adolf Hitler et les nazis, comme le lui avait appris
son maître.
Selon le quotidien Daily Mirror, Charlie, une femelle ara comme son nom ne l'indique
pas, est sans doute le plus vieil oiseau vivant en Grande-Bretagne. À la mort en 1965
de l'ancien Premier ministre, héros de la Seconde guerre mondiale, Charlie avait été
acheté par Peter Oram, propriétaire d'une animalerie à Reigate (sud de Londres).
Si son plumage bleu et or a quelque peu perdu de sa superbe avec les années, le
perroquet a apparemment gardé toute sa tête: parmi ses expressions préférées figurent
toujours les "Putain de Hitler" et "Putains de nazis" qu'il prononce "avec l'inflexion
caractéristique de Churchill", explique le Daily Mirror. Ces mêmes jurons avaient
autrefois choqué maints généraux ou amiraux lors de réunions de crises avec le
Premier ministre, rappelle le journal.
"Pour dire la vérité, Charlie est dans un état un peu négligé mais elle est très populaire
auprès des visiteurs", a expliqué au quotidien une employée du magasin de jardinage
de M. Oram, qui accueille l'oiseau depuis 12 ans. "Nous y sommes tous très attachés".
Churchill avait acheté Charlie en 1937 et il lui avait immédiatement appris à jurer.
L'oiseau avait rejoint la ménagerie hétéroclite de l'homme d'État où se côtoyaient
agneaux, cochons, bétail, d'autres perroquets et même un léopard.
"Churchill n'est peut-être plus parmi nous mais (grâce à Charlie) son esprit et ses mots
de résistance et de détermination perdurent", explique pour sa part James Humes,
expert de l'ancien Premier ministre, cité par le journal.
La publication en ligne des insolites permet à l'agence d'acquérir une visibilité
importante auprès du grand public, à la grande satisfaction des agenciers qui y
trouvent une forme de reconnaissance : « Quand, à Londres, je faisais une dépêche
90
insolite, je regardais sur Yahoo, et elle faisait toujours partie des cinq les plus
envoyées ». Par ailleurs, le journaliste a le sentiment de s'adresser directement au
lecteur par le biais des dépêches insolites. Rédiger des insolites permettrait donc de
combler la frustration que peuvent ressentir certains agenciers à rédiger
essentiellement pour les clients de l'agence et non pour des particuliers, « Là, j'ai
l'impression défaire mon métier parce que les gens la lisent, les gens adorent ça. »
Enfin la rédaction des Insolites constitue une forme de récréation pour le journaliste dans la
mesure où le style et le registre des insolites sont beaucoup plus détendus que pour les autres
types de dépêches : « C'est une espèce de respiration dans l'actualité : quand vous avez fait
un papier sur les troubles en Irlande du Nord, et que vous faites un papier comme ça, c'est
facile à faire, ça permet de se lâcher sur le plan stylistique, défaire des plaisanteries, d'avoir
un style plus léger. »
D'autres journalistes s'inquiètent de la multiplication parfois excessive des insolites et
déplorent qu'une information sérieuse se voie relatée sous la forme d'un insolite sous prétexte
qu' elle sera plus « vendeuse ». Au cours de notre enquête de terrain, un jeune journaliste du
bureau du Caire s'indignait du traitement qui avait été réservé à une dépêche qu'il avait
envoyée à sa rédaction régionale. La dépêche relatait l'histoire d'un égyptien qui, désolé de ne
pas avoir eu de garçons, tua par dépit ses sept filles, or la dépêche avait été diffusée sous la
rubrique Insolite : «II n'y a que ça [les insolites] qui les [c 'est-à-dire les lecteurs] intéresse à
en croire les contrôles. C 'est désespérant! Ca a été repris mais sous l'angle des insolites, on
ne va pas regarder ce qui se passe derrière. »
3.3.2.2 le fil people
L'information divertissante ne se réduit pas aux Insolites, elle se traduit également par
l'explosion de l'information people, c'est-à-dire les nouvelles et les potins concertant les
célébrités. L'Agence France Presse compte en effet parmi ses fils, un fil dédié à l'actualité des
célébrités. Ce fil people s'est consolidé lorsque l'agence, qui dispose d'un service photo
international depuis 1985 a signé le 1er avril 2003, un accord avec l'agence photographique
1 Journal de terrain, 20 mars 2005.
91
Getty" dont l'objectif principal est de fournir des photos au fil people. L'actualité des
célébrités est un thème qui a connu dans les médias une expansion particulièrement forte ces
dernières années. En France, la presse people compte en 2005 pas moins de 13 millions de
lecteurs pour 2,5 millions d'exemplaires vendus"5. C'est sans compter les contenus people
que l'on retrouve dans la presse généraliste. L'Agence France Presse est donc sollicitée par
ses clients pour fournir ce type d'information.
La diffusion d'information people a connu un accueil mitigé au sein des journalistes. Le débat
porte d'une part sur le statut informationnel accordé à l'actualité des célébrités, et d'autre part
sur l'aspect éthique du traitement de ce type d'information. Les journalistes les plus jeunes
considèrent que l'actualité des célébrités constitue un segment de l'information générale et
doit donc être traitée par l'agence au même titre que le reste des événements, en résumé, ils
approuvent l'existence du fil people. « J'ai une approche libérale. Si l'AFP est une sorte de
généraliste de l'information, il faudrait qu 'elle fournisse tout ce qui est considéré comme de
l'information par les clients, autrement dit la presse écrite. Donc je pense qu 'il faut faire du
people aussi. »
Les journalistes qui soutiennent l'existence du fil people inscrivent leurs pratiques dans une
logique commerciale. Ils considèrent que l'AFP doit être en mesure de répondre aux
demandes de ses clients; de ce point de vue refuser de diffuser de l'information people serait
contre productif pour l'agence. D'autres journalistes acceptent mal l'élargissement de
l'information à ces thématiques; c'est le cas notamment d'une majorité de journalistes des
anciennes générations qui y voient une dérive. L'information people ne serait pas une
information digne et n'entrerait pas dans la ligne de conduite de l'agence.
114 L'agence Getty compte 250 photographes et produisent entre 700 et 1000 photos par jour. L'agenceest spécialisée dans la production d'images d'actualité, de sport et de divertissement, et ceparticulièrement aux Etats-Unis.115 Le Monde, 16/09/05
92
Je ne parlerai pas de nouvelles orientations, mais de dérives : les dérives
people. Nous ne sommes pas une agence people et surtout pas en photo. On
nous en demande et on commence à en faire, d'autant plus qu'on est associé
au groupe Getty qui lui n 'a pas les préoccupations d'une agence de presse. Ça
tire vers le bas!
Quand il s'agit de servir la soupe, tout ce qui est people, là je suis plus
réservé. Les rumeurs sur machin... on sort un peu de la bande passante de
l'AFP.
Malgré ces dissensions, les journalistes sont unanimes quant au traitement à accorder à
l'actualité des célébrités : un traitement prudent, sobre, réservé, qui conduit l'agence à réaliser
alors une couverture plutôt « mondaine ».
Le people est encore quelque chose de méprisé. Il faut appliquer les règles d'agence
au people : / 'éthique, pas raconter n 'importe quoi, pas tomber dans Voici. Nous, on
fait plutôt du Gala, assez institutionnel : les mariages, la royauté, on fait un truc qui
s'appelle les « Échos de la nuit parisienne », à partir du moment où ça tombe pas
dans le trash et qu 'on respecte les règles de l'agence, ça ne pose aucun problème.
Le rapport aux sources en matière d'information people remet en question l'éthique
journalistique de l'agence et révèle une transformation du mode de production de
l'information. En effet, l'agence ne dispose pas de journalistes assignés à l'information people
proprement dite, les sources de l'agence sont essentiellement les autres médias. Cet aspect de
la production de l'information people suscite des réactions parmi les agenciers qui considèrent
que l'AFP doit disposer de ses propres sources et non pas se contenter de reprendre des
informations diffusées par les autres médias. L'agence ne dispose pas d'un réseau
d'informateurs qui lui permettent de s'assurer de la véracité des informations people diffusées
par les autres médias comme ils le font pour les autres types d'information dont ils prennent
connaissance par d'autres médias. Enfin, la production d'information people exige une
adaptation du style agencier et doit, sur le plan de la forme, répondre aux attentes du client.
Les textes doivent être courts et rédigés dans un style particulier :
93
Les clients radios cherchent des brèves pour alléger leurs journaux, la presse écrite
des brèves pour boucher les trous dans des maquettes de plus en plus rigides"6. (...),
Il faut la [l'écriture] soigner. Elle doit être vive : le people se satisfait mal [du style]
des rapports de police.
3.4 Écrire en couleur
Au cours de nos entretiens et de notre enquête de terrain, nous avons constaté que l'expression
« papier couleur » revenait fréquemment dans les discours des journalistes. Les papiers
couleur désignent les papiers qui traitent d'un événement attrayant. Ils désignent également
tout type de papiers où le journaliste met l'accent sur les détails évocateurs, les éléments
descriptifs, le pittoresque, les anecdotes susceptibles d'accrocher le lecteur. Ce sont des
dépêches où la suggestion visuelle des termes est sollicitée.
Le souci de la « couleur » est aujourd'hui très présent et valorisé pour plusieurs raisons. La
couleur permet d'accroître la valeur du papier sur le marché, et cela de plusieurs manières. La
« couleur » est valorisée par les clients, qui cherchent à attirer un public de plus en plus
sollicité ; ils misent notamment sur la « couleur » pour y parvenir. La « couleur » constitue,
autant pour le client que pour l'agence, qui a ses propres concurrents, un important élément de
distinction. La « couleur » fait référence à des éléments d'information que l'on ne retrouve
pas nécessairement chez les concurrents, le papier devient alors « unique » c'est-à-dire rare, et
c'est la rareté qui va créer la valeur du papier.
Par ailleurs, les journalistes accordent davantage d'attention à la couleur car les papiers
rédigés par les agenciers sont destinés de plus en plus à être publiés tels quels ou avec un
faible remaniement de la part des clients. La couleur est incorporée à la dépêche de telle
manière que celle-ci devienne publiable sans que le client (le média) n'ait à investir ses
propres ressources pour obtenir un résultat publiable. Autrement dit l'information produite par
116 AFP, Rédaction en chef: notes rédactionnelles, Informations «people», 12/01/2000, ASAP-»Annexe B-8117 AFP, Rédaction en chef, op.cit.
94
le client est moins coûteuse si l'agence prend à sa charge le coût de traitement de
l'information ; la transaction est d'autant plus intéressante pour le client.
Rédiger des papiers couleur nécessite une présence des journalistes sur le terrain pour décrire
les lieux, saisir une atmosphère. Or les journalistes sont de plus en plus sédentaires et le temps
dont ils disposent pour rédiger une dépêche est de plus en plus court. La rédaction de papiers
couleur se satisfait mal du mode de production actuel de l'agence. Pour autant comme les
papiers couleur font l'objet d'une forte demande de la part des clients, les journalistes sont
amenés à rédiger leurs papiers, puis à y ajouter ensuite de la couleur. Au cours de notre
enquête de terrain, nous avons été témoin à plusieurs reprises du remaniement des dépêches
par le directeur du bureau afin, disait-il, « d'ajouter de la couleur » aux papiers. Par exemple,
une journaliste avait rédigé une dépêche sur une rencontre entre plusieurs dirigeants politiques
dans un hôtel situé à Charm el Sheikh. À la relecture de la dépêche, le directeur, jugeant que
le papier manquait de couleur, s'enquiert auprès de la journaliste du lieu de la rencontre,
L'Hôtel du 6 octobre. Il ajoute alors des informations d'ordre esthétique (ambiance, prestige
du lieu etc.) sur le lieu de la rencontre et ajoute ainsi au potentiel visuel à la dépêche.
Ce souci de la couleur ne caractérise pas tant un rapport au réel, c'est-à-dire une manière
d'aborder les événements, de les saisir, de les comprendre, puis d'en rendre compte, mais
d'un rapport au client, c'est-à-dire une manière de concevoir un « produit » qui va satisfaire la
demande des clients. Cette « mise en couleur » des dépêches par les journalistes est un indice
du passage au journalisme de communication. Le journaliste devenu plus sédentaire, consacre
une plus grande partie de son activité à la mise en forme de l'information. Nous pouvons donc
affirmer que l'agencier pratique aujourd'hui de plus en plus ce qu'Yves Lavoinne nomme un
journalisme de communication, « le journaliste apparaît-il désormais avant tout comme un
expert en matière de formes efficaces : graphique, linguistique, iconique; un spécialiste du
traitement de données parfois éparses, qu 'il adapte à ce public qu 'il lui faut sans cesseI 1 R
reconstituer. »
118 Lavoinne, Yves, « Le journalisme saisi par la communication ». In Martin, Marc (dir.), Histoire etmédias. Journalisme et journalistes français, 1950-1990. Actes du colloque de Nanterre, Paris, AlbinMichel, 1991, page 171.
95
Les journalistes disposent rarement du temps nécessaire pour réaliser de « vrais
papiers couleur » c'est-à-dire des dépêches qui comprennent tous les éléments cités
précédemment : récit des événements, témoignages, anecdotes, éléments visuels etc.
Ces composantes des « vrais papiers couleur » ne sont pas ajoutés a posteriori; ce sont
le résultat d'un travail de terrain. Or le contexte de concurrence et la pression
temporelle conduisent l'agence à inciter les journalistes à produire en grande quantité
et donc à réduire leur présence sur le terrain. Les journalistes qui s'essaient encore à la
rédaction de « vrais papiers couleur » ont alors le sentiment de « sortir de l'agence ».
Une correspondante qui est fréquemment envoyée pour couvrir les conflits, regrette de
ne pas avoir le temps de « gâter un peu plus le papier ». Pour échapper à la pression
temporelle qui pèse sur les agenciers, elle met en place une stratégie de contoumement
qui consiste à préparer ses papiers couleur en parallèle avec les tâches qui lui sont
assignées : « Tu prépares des papiers sans dire que tu les fais, tu les sors et tu dis
voilà j'ai fait ça. Personne ne sait que tu les prépares, tu as le temps de bien les
préparer. »
Dans ce chapitre, nous avons constaté que les contenus informationnels s'étaient
profondément modifiés depuis 1945. Le passage d'une configuration à l'autre s'est
traduit par une fragmentation et une diversification des thématiques traitées par les
agenciers. Les transformations produites par cette reconfiguration médiatique se
traduisent également par un renouvellement de la typologie des dépêches, qui traduit
un changement radical du modèle journalistique même.
96
-CHAPITRE 5- DU JOURNALISME EVENEMENTIEL AUJOURNALISME SITUATIONNEL. ANALYSE DU MODÈLE
JOURNALISTIQUE À TRAVERS LA HIÉRARCHISATION DESDÉPÊCHES
Dans ce chapitre, nous nous proposons de mettre en évidence une transformation de la
conception du journalisme en analysant la typologie des dépêches et son évolution. Nous
verrons que la période de l'après-guerre se caractérise par un journalisme événementiel, le
regard du journaliste étant centré sur l'événement. La dépêche privilégie alors le récit et la
description des événements par le biais du « factuel », modèle dominant de la dépêche. Par la
suite, la multiplication des médias conjuguée à l'amélioration technique des modes de
transmission va inciter l'agence à adopter une approche plus commerciale, notamment en
ajoutant un élément de distinction à ses dépêches. Le journaliste ne se contente plus de relater
l'événement ; il en fournit une analyse, une interprétation qu'il souhaite unique, originale et
propre à susciter l'attention. Le regard du journaliste va s'élargir au contexte de l'événement ;
le journalisme situationnel devient le modèle journalistique dominant de la seconde période.
Section 1. La première configuration : classification rudimentaire des dépêches etrègne du factuel
1.1 Les caractéristiques de la dépêche
1.1.1 Une copie bipolaire : factuels et features
Dans les années cinquante, l'AFP dispose d'un système de genre plutôt rudimentaire qui
distingue deux grandes catégories de dépêches, les factuels et les features ou papiers
magazines. Un factuel n'est pas nécessairement synonyme d'une dépêche courte annonçant
97
un événement qui vient de survenir, l'appellation fait référence à toutes les dépêches qui
traitent de l'actualité « chaude » et qui la contextualisent. Les journalistes désignent donc par
« factuels » aussi bien des papiers courts comme des bulletins, des flash ou des urgents que
des papiers plus longs pouvant atteindre 1500 mots. De plus, le factuel est inscrit dans le
temps, sa durée de validité est limitée, il est envoyé en urgence au siège via les réseaux de
transmission tels le télex ou le télégraphe.
Les factuels dominent le flux de dépêches qui proviennent de l'étranger. Le primat des
factuels s'explique notamment par le coût élevé des transmissions. En plus d'être fragiles, les
transmissions ont un coût très élevé. Les correspondants étrangers, qui disposent d'un budget
limité pour transmettre leurs dépêches, ont une conscience aiguë du prix des transmissions.
Cela les conduit à condenser leurs dépêches, à effectuer une sélection étroite de l'information
qu'ils souhaitent voir diffuser et donc à privilégier l'événement et à réserver les éléments
contextuels.
Les features désignent l'ensemble des dépêches produites par l'agence qui traitent d'un
événement, d'un fait, sur une période temporelle plus large. Les features sont essentiellement
constitués de reportages, de témoignages et de récits. Ils peuvent être distribués sur le fil
général sur l'initiative de l'agence ou bien commandés à l'agence par un autre média, le plus
souvent par les journaux de presse écrite. Les reportages ont une taille plus importante que les
factuels, ils traitent de l'événement dans des dimensions plus larges. Les features, dont le
degré d'urgence est relativement faible en comparaison des factuels, parviennent au siège via
les services postaux.
En matière de factuels, on distingue trois types de dépêches suivant le caractère d'urgence de
l'information et la longueur du texte. Le flash est exceptionnel; il annonce une information
d'importance capitale devant faire ultérieurement l'objet de longs développements. Son texte
se limite généralement à une phrase nominale courte. Le bulletin, suit immédiatement le flash
en apportant les premières précisions, mais plus généralement, il est utilisé directement pour
annoncer un événement majeur qui sera largement développé plus tard. Son texte est constitué
également d'une phrase, mais plus longue que le flash. Enfin, l'urgent est la suite logique du
98
flash et du bulletin; il annonce une première information au degré de priorité moindre; son
texte est composé d'une à deux phrases.
Les dépêches d'agence de cette époque répondent à des normes relativement peu élaborées en
comparaison d'aujourd'hui. En 1971, le premier manuel de l'agencier rédigé par le président
directeur général de l'AFP à l'époque, Jean Marin, propose alors une typologie fondée sur le
contenu des dépêches, le manuel de l'agencier distingue cinq catégories de factuels.
Le «running» désigne «la couverture chronologique d'un événement important au
fur et à mesure de son déroulement. (...) sa nature même, non élaborée, le running
doit être le plus souvent suivi d'un papier reprenant, par ordre d'importance et non
plus chronologique, les éléments de l'événement »"9
le « complément-développement ». Le « complément » ou le « développement »
peuvent être employés alternativement. Le « complément » est utilisé « lorsque les
éléments essentiels de l'information ont été donnés dans le ou les bulletins. (...) Il
fournit des indications complétant le contenu du ou des bulletins ». Quant au
développement, il constitue « un papier complet qui reprend tous les éléments
contenus dans le ou les bulletins. Il permet de présenter par ordre d'importance et non
plus chronologique ces éléments »120.
les « points principaux » « reprennent, précisent et amplifient les bulletins dans le cas
d'une conférence de presse ou d'un discours important »121.
le « round-up » désigne la dépêche regroupant « / 'ensemble des informations diffusées
antérieurement mais dispersées et étalées dans le temps sur un sujet précis »122, le
round-up fournit tous les éléments constituant le background d'un événement.
119 AFP, Manuel de l'agencier, 1971, pp 26-27.120 AFP, Manuel de l'agencier, 1971, pp.27-28.121 AFP, Manuel de l'agencier, 1971, page 30.122 AFP, Manuel de l'agencier, 1971, page 31.
99
• la « synthèse » résume l'ensemble des informations, mais contrairement au « round-
up », elle ne se veut pas exhaustive.
À ces catégories s'ajoutent d'autres types de dépêches qualifiées d'« autres papiers » par Jean
Marin, le commentaire, le reportage, « le film et la chronologie », le périodique, « les échos et
les à-côtés » et \efeature.
Si nous nous reportons au tableau comparatif des classifications de dépêches établies par les
trois manuels de l'agencier successifs, nous pouvons en conclure aisément que la
classification des dépêches est peu élaborée en comparaison d'aujourd'hui. Par ailleurs, bien
que les coûts de transmission aient une incidence sur le volume des dépêches, leur taille reste
peu normalisée comme nous allons le voir dans la partie suivante.
100
TYPES DE DÉPÊCHES DEFINIS PAR LES MANUELS DE L'AGENCIER
FACTUELS
AUTRES PAPIERS (dits
papiers à attribut)
avant l'événement
Pendant et juste après
l'événement
Après l'événement
1971
Flash
Bulletin
Urgent
Commentaire
Complément
développement
1982
Flash
Bulletin
Urgent
Additif
avant papier
lever de rideau
papier d'ouverture
synthèse
running
papier d'éclairage
Les Echos
les réactions
2004
Flash
Bulletin
Urgent
Premier lead
papier de présentation
lever de rideau
synthèse
synthèse
thématique
papier d'éclairage
papier d'angle
l'enquête
le running
les principaux points
le Verbatim
papier d'analyse
reportage
le papier général
le papier bilan
101
Documentation
autour de l'événement
Autres Papiers
le bilan
encadré
fiche technique
biographie
portrait
film et chronologie
papiers spéciaux
papiers magazines
features
le compte-rendu
les réactions
commentaire
dossier
e compte-rendu d'audience
documentation express
encadré
technique
biographie
bio portrait
bio express
portrait
fiche de lecture
la chronologie
le film
interview
trois questions
le magazine
le week ender
revue de presse
Sources : AFP, Manuels de l'agencier, 1971, 1982, 2004.
102
1.1.2 Absence de normalisation de la taille des dépêches
Bien que la technique ne permette pas d'envoyer aisément des dépêches en grand nombre et
en permanence, les dépêches des années cinquante ont néanmoins une longueur largement
supérieure aux dépêches qui circulent aujourd'hui sur les fils de l'agence. Dans les factuels
comme dans les reportages, le journaliste des années cinquante s'exprime abondamment, il
emploie un style littéraire, use de métaphores et d'images pour décrire une situation. La
dépêche prend souvent la forme d'un récit narratif et descriptif. Qu'on en juge :
Dans le brillant soleil, c'est une fête d'entendre au grand jour la voix si souvent
couverte par les brouillages allemands ou vichyssois, là où il y a deux semaines
retentissaient les coups de feu.(,..) 16 heures, il fait beau, le ciel est bleu, mais on a
fermé les fenêtres (,..), dans le décor familier, un décor modeste, mais bien français,
s'élève la voix énergique qui tant de fois pendant les heures sombres a versé au cœur
des Français l'espoir en la grandeur et la pérennité de notre pays (...) 123
Bien que la faillibilité de la transmission et son coût limitent la taille des dépêches, les
factuels peuvent atteindre tout de même plus de 1000 mots, «II n'y avait pas de
moyenne, une simple dépêche factuelle dépassait rarement 1000 ou 1500 mots.»
Quant aux reportages, ils parviennent par voie postale au service features de l'agence
et ne semblent pas souffrir de restriction en termes de taille, comme le souligne cette
ancienne journaliste, « // m'arrivait d'écrire dans les années cinquante, une dizaine de
feuillets, 2000 mots, dans les papiers magazines (...) Dans les reportages avant, on
pouvait avoir une plume tout à fait à l'aise. » Les reportages sont des produits
commandés essentiellement par les journaux qui ne disposent pas de ressources
financières suffisantes pour couvrir un grand nombre de pays. Ils
passent régulièrement commande auprès de l'agence. C'est ainsi que les agences
dominent la production de l'information internationale grâce à la puissance de leurs
réseaux de correspondants.
123 Agence Française de Presse, dépêche, « Paris, pendant le discours du général de Gaulle», 12septembre 1944, annexe A-3.
103
La longueur des dépêches s'explique également par leur exhaustivité. L'énonciation des faits
et l'analyse sont réunies dans une même dépêche. Les papiers rédigés par les journalistes de
l'AFP n'étaient pas fragmentés comme ils le sont aujourd'hui. Ils traitaient d'un fait dans son
ensemble, le journaliste abordant dans une seule et même dépêche toutes les dimensions de
l'événement. Le souci d'exhaustivité de la dépêche associé à la couverture d'événements
exceptionnels comme celle des conflits commandent parfois des dépêches particulièrement
longues (jusqu'à douze feuillets), comme en témoigne cette ancienne correspondante qui a
couvert pendant trois ans les débuts de la guerre du Vietnam pour l'AFP.
Les papiers qu'on faisait au Vietnam, c'était moins rigide qu'aujourd'hui(...)il y avait
quand même des normes. Juste après le cessez-le-feu, on a été les deux premiers
journalistes à passer du côté Viet Kong, et on y a passé deux jours alors que le
président sud vietnamien avait décrété la peine de mort pour tous ceux qui repassaient
la frontière. Quand on est sorti de là, on a fait des papiers et ça a duré six jours.
Mon chef de poste de Saigon voulait m'envoyer à Bangkok écrire mes papiers, pour
des raisons de sécurité. Je lui ai dit : « Non, j'écris d'ici ou j'écris pas », j'ai pris mon
carnet je l'ai mis à la poubelle. Je lui ai dit : « Ecoute, moi je m'en fous, le truc, je l'ai
fait après si tu veux que je ne l'écrive pas c'est d'accord, mais j'irai pas à Bangkok ».
Il m'a laissé faire, et le lendemain, j'ai fait un papier de douze feuillets alors que la
norme c 'était trois. Tous les jours qui ont suivi, j'ai fait des papiers.
Outre la technique, d'autres facteurs expliquent la longueur des dépêches des années
cinquante. A cette époque, l'agencier cherche à transmettre les informations pertinentes sans
trop se soucier des contraintes de forme. Ses dépêches parviennent au desk sous une forme
abrégée (en nègre) et le journaliste sait que sa dépêche fera l'objet d'une relecture attentive et
d'une réécriture. Tandis qu'aujourd'hui, l'objectif du journaliste est de produire des articles
« prêts à publier » suivant les standards des médias contemporains. Dans les bureaux à
l'étranger, la dépêche rédigée par un journaliste est relue par le directeur du bureau avant
qu'elle ne soit envoyée au desk régional. Durant notre enquête de terrain, nous avons constaté
que le desk régional effectuait très peu de corrections sur les textes. Toutefois, il arrive que le
desk demande des précisions sur un élément de la dépêche s'il juge qu'il faudrait fournir des
informations supplémentaires ou lorsque le contenu de la dépêche diffusée par l'AFP diffère
104
des informations transmises par la concurrence'24. Le rôle du bureau régional consiste
notamment à composer les différents fils et à transmettre les demandes des clients aux
bureaux locaux, en commandant des papiers.
Enfin, dernière explication à la longueur des dépêches, dans les années cinquante, les
journalistes rendent compte de la vie des institutions dans le respect des normes qui
définissent ces institutions alors qu'aujourd'hui les médias imposent leur propre logique et
leurs propres règles discursives. En effet, le journalisme d'agence tel qu'il est pratiqué après-
guerre, laisse une large place à la retransmission des discours125, et notamment pour ceux
tenus par le général de Gaulle en France et à l'étranger. Les journalistes manifestent alors un
grand respect envers les institutions politiques, leur action se limite à retranscrire en
intégralité les discours sur les fils de l'agence, ce qui conduit l'AFP à diffuser des dépêches
particulièrement longues. Dans les dépêches de cet ordre, le journaliste dans sa dimension
discursive n'apparaît pas dans la dépêche, le lecteur «possède très peu d'indications sur
l'énonciateur qui anime l'article, puisque celui-ci se tient en retrait, n 'intervenant
explicitement que très peu dans son texte. »126
Doit-on pour autant en déduire que, dans les années cinquante, il y avait absence de norme en
ce qui concerne la taille des dépêches ? Bien qu'implicite, il existait une norme qui n'était
traduite pas en nombre de mots ou de feuillets. Le journaliste au contact de ses pairs
intériorisait des savoirs et des savoir-faire comme les différents contenus rédactionnels et la
taille qui y correspondait. Par ailleurs, si les journalistes à l'étranger n'avaient pas une
conscience aiguë des exigences des clients en matière de volume de la dépêche, les
journalistes du desk en contact avec les clients se chargeaient de modifier la taille des
dépêches et de la rendre conforme aux attentes de la clientèle.
24 Sur les rapports entretenus par le bureau local et le bureau régional, on pourra se référer à l'extraitdu journal de terrain au chapitre 2 de la troisième partie, section 2, 2.2.1.1.
25 Dépêche du 4 juillet 1945 : « Allocution du Général de Gaulle », annexe n°A-2.126 On peut se référer à l'étude de Jean de Bonville et Lise Moreau sur le concept d'identité discursive,« Journalistes et magistrats : le concept d'identité discursive appliqué à la couverture de l'actualitéjudiciaire en 1950 et 2000 ». In Brin Colette, de Bonville Jean Charron Jean, Nature et transformationdu journalisme, Théorie et recherches empiriques, les Presses de l'Université Laval, Québec, 2005,chapitre 9, page 365.
105
Il faut attendre la parution du premier manuel de l'agencier rédigé par Jean Marin en 1971
pour que soient établies officiellement des normes en matière de taille de la copie. Ces normes
sont parachevées par les deux manuels suivants et surtout par l'introduction de l'informatique
à l'agence. L'emploi des premières consoles informatiques contraint le journaliste à réduire la
taille de ses dépêches. Un lead ne peut dépasser plus trois lignes et demi sous peine d'être
coupé.
L'absence de normalisation conjuguée à la prééminence du factuel sur les autres types de
dépêches sont les conditions préalables à l'avènement d'un modèle spécifique de journalisme,
le journalisme événementiel.
1.2 Le journalisme événementiel
Le journalisme qui prédomine dans les vingt premières années de l'agence est un journalisme
que l'on peut qualifier d'événementiel, c'est-à-dire une forme du journalisme qui privilégie
l'événement à la description du contexte et à l'explication de l'événement. Dans les années
cinquante, les dépêches sont centrées sur l'événement, les textes journalistiques sont
essentiellement d'ordre narratif et descriptif. La légitimité du correspondant à l'étranger
réside dans le fait qu'il assiste à l'événement. C'est dans sa présence physique sur le terrain
que le journaliste trouve sa raison d'être. Sa compétence repose alors sur sa capacité à narrer
l'événement et à en donner une description la plus précise possible.
Le journalisme événementiel coïncide avec le modèle du factuel. « Le factuel, c'était notre
raison d'être », c'est ainsi qu'un ancien journaliste de l'agence qualifie son activité dans les
années cinquante. Sous le règne du journalisme événementiel, il n'y a pas de dépêche
consacrée à l'analyse proprement dite, l'énoncé des faits et l'analyse constituent une seule et
même dépêche. En comparaison du découpage actuel de la copie de l'AFP, la définition du
factuel en 1950 est bien plus large.
Si le journaliste peut effectuer des analyses et des commentaires de l'événement, il ne produit
que peu de dépêches portant sur une situation sans qu'un événement soit prétexte à la
dépêche. C'est uniquement dans les reportages envoyés par voie postale que le journaliste
106
peut développer un point de vue situationnel. En outre, le volume des dépêches produites est
limité par la technique et les coûts de transmission, aussi les journalistes donnent la priorité au
factuel.
Les longs papiers, les commentaires sont considérés comme des dépêches de second ordre par
l'agence. Ainsi dans le manuel de l'agencier, Jean Marin précisait, en 1971, que « les longs
papiers de commentaires ou relatifs à des sujets de moindre intérêt, ou encore limités à un
secteur géographique, peuvent parfois être reportés au-delà des heures de pointe. »127
Le factuel est associé par les journalistes de la plus ancienne génération à la vérité et à
l'objectivité, c'est pourquoi l'analyse ou les attributs ne sont pas acceptés par de nombreux
journalistes qui ont tendance à les considérer comme autant de possibilités de travestissement
des faits.
- On est tous les gardiens de la vérité avec un grand V, on suit l'actualité, le factuel,
- Il y a de plus en plus de papiers de mise en perspective, on s'est très nettement
éloigné du métier que je faisais en rentrant à l'AFP où on faisait du factuel, où
éventuellement on racontait des histoires.
Lorsque les correspondants étrangers sont plusieurs à couvrir un événement simultanément,
ils ne sont pas en mesure de fournir une information exclusive à leurs services. Or,
contrairement aux correspondants étrangers qui exercent aujourd'hui, les journalistes de cette
époque ne cherchent pas à se différencier de leurs concurrents en réalisant un traitement
original ou une mise en forme particulière de l'information. Par ailleurs, en matière de
factuels, la marge d'innovation est relativement faible. Les journalistes mesurent alors la
réussite de leur copie à ses similitudes avec celle de ses concurrents. Les journalistes mesurent
l'efficacité de leur activité au nombre d'éléments communs entre leurs dépêches et celles de
leurs concurrents. «Au Congo, on était tout le temps fourrés ensemble [les journalistes
concurrents], à se surveiller éventuellement et souvent très amis. On s'amusait parce qu'on
127 AFP, Manuel de l'agencier, Jean Marin, 1971, page 80.
107
s'apercevait que lorsqu 'on avait bien travaillé, les deux premiers paragraphes étaient les
mêmes. » L'exhaustivité exigée en matière de factuels conduit à l'homogénéisation de la
copie des différentes agences.
Section 2 - Une hiérarchisation des dépêches revisitée
Le manuel de l'agencier publié en 1982 comprend 227 pages et son format est deux
fois supérieur à celui du premier manuel rédigé par Jean Marin qui ne comprend que
93 pages. Ce nouveau manuel, qui prescrit un grand nombre de règles inédites et
présente de nouveaux types de dépêches, témoigne d'un grand nombre de
changements mais aussi d'une perte de repères liée à une période de transition dans la
rédaction de la dépêche. En effet, l'intégration de l'outil informatique conjuguée aux
nouveaux modes de transmission par satellite auront une forte incidence sur la
conception de la dépêche rendant nécessaire l'instauration de «balises» par la
rédaction en chef pour mettre en place de nouveaux modes rédactionnels et de
nouveaux formats de dépêches. Le manuel de l'agencier vient préciser dans les
moindres détails tous les aspects de la pratique journalistique et de la copie agencière.
2.1 Développement des dépêches hors factuels
L'accroissement de la concurrence et le développement de la télévision conduisent l'agence à
se repositionner sur le marché médiatique afin d'être en mesure de proposer un produit
informationnel distinctif des autres médias. Dès le milieu des années soixante-dix, l'Agence
France Presse encourage ses journalistes à rédiger des papiers qui dépassent le cadre du
simple récit des événements, comme le précise Claude Roussel, président directeur général de
l'agence de 1975 à 1978 :
Depuis quelques années, nous constatons que les journaux - aussi bien à l'étranger
qu 'en France - souhaitent que nous développions l'aspect commentaire de nos
informations. Cela leur permettrait, en effet de se démarquer plus nettement des
108
moyens audiovisuels, de présenter des « papiers » et non plus des nouvelles sèches.
Nous essayons donc aujourd'hui d'adapter nos services dans le sens de la
systématisation de synthèses sur certains sujets à certaines heures. l28
Cela se traduit notamment par le développement de papiers avant que l'événement
n'ait lieu, si celui-ci est prévisible. Le manuel de l'agencier publié en 1982 recense
trois types de papiers de ce genre : l'avant-papier, le lever de rideau et le papier
d'ouverture.
L'avant papier, d'un volume de 400 à 600 mots, est diffusé 48 heures à 36 heures
avant l'événement.
Le lever de rideau, appelé également « papier balai », est diffusé la veille de
l'événement. Il est plus succinct que l'avant papier, et « ne reprend que les toutes
grandes lignes de ce que l'on attend de l'événement, en développant un peu plus le
déroulement de sa première journée. Il doit, en somme, déboucher sur l'événement
comme si l'on y était presque arrivé.»
Le papier d'ouverture est une dépêche courte diffusée à l'ouverture des fils le jour
même de l'événement.
128 Roussel, Claude, L'Écho de la presse et de la publicité, 17 novembre 1975. Claude Rousselemploie le terme de commentaire mais ici le terme ne désigne pas les papiers d'opinion mais lespapiers de synthèse et d'analyse129 AFP, Manuel de l'agencier, 1982, page 98.
109
L'agence développe également des papiers où le journaliste procède à un retour sur
l'événement à travers deux types de dépêches qui viennent s'ajouter aux dépêches
déjà existantes : le bilan et le papier d'éclairage.
Le bilan est une dépêche qui comprend 400 à 600 mots et qui « cherche à dégager la
signification principale d'un événement qui s'est prolongé dans le temps, tout
rappelant dans ses grandes lignes en quoi cet événement a consisté. »
en
Le papier d'éclairage est un papier qui dégage la portée d'un événement en le situant
dans son cadre et dans sa perspective.
Ces nouveaux types de papiers sont créés en fonction des besoins des clients de l'agence.
Ainsi, pour chaque papier, le manuel de l'agencier précise quand celui-ci doit parvenir aux
clients et dans quel but. Le manuel précise ainsi que l'avant papier doit être diffusé 36 à 48
heures à l'avance afin qu'il puisse être utilisé par la presse écrite la veille de cet événement, et
pour que le journaliste s'en souvienne, les mots « utilisé » et « la veille » apparaissent en gras
dans le manuel. Quant au papier d'ouverture, il est destiné particulièrement aux clients
radios : « il est diffusé à l'ouverture des fils le jour même de l'événement, avant le deadline
matinal des radios auxquelles ce papier d'ouverture est essentiellement destiné. »
Les impératifs commerciaux sont donc omniprésents dans le second manuel, contrairement au
premier, où l'intérêt porté aux clients se traduisait essentiellement par une mention sur le
respect des fuseaux horaires. Désormais, l'agencier doit écrire en ayant en tête les besoins des
clients, voire en prévoyant les réactions du public : « La couverture d'un événement important
ne doit pas être abandonnée brutalement. Une fois éveillé, l'intérêt du public persiste un
certain temps. »130
130 AFP, Manuel de l'agencier, 1982, page 100
110
Le développement de nouvelles formes de dépêches qui ne se limitent plus au récit et à la
description des événements s'accompagne d'une réaffirmation, par la direction, des règles
d'objectivité et d'anonymat propres au métier d'agencier. L'agence ressent la nécessité de
préciser à nouveau la fonction de l'agencier et ainsi de distinguer l'agencier du journaliste de
presse écrite : « Le commentaire n 'a pas sa place dans un service d'agence. Il est réservé à
nos confrères des autres médias qui ont la liberté de s'exprimer, sous leur signature et leur
responsabilité, leurs opinions personnelles. »131 Outre l'introduction de nouveaux types de
dépêches, le second manuel de l'agencier, sous le poids de l'informatisation est contraint de
procéder à une normalisation de la taille de la dépêche.
2.2 Normalisation de la taille de la dépêche
L'amélioration des techniques de transmission des dépêches et l'informatisation progressive
de l'agence conduisent à une explosion du volume de dépêches produites par l'agence. Cette
multiplication des dépêches s'explique en outre par la diversification des formats de dépêches.
L'agence va être contrainte de mener une politique de normalisation de la dépêche en
imposant un volume de mots pour chaque format de dépêche. Bien que le premier manuel de
l'agencier précisait déjà des normes en termes de volume, les journalistes n'obéissaient pas
strictement aux règles prescrites par l'agence, comme le précise ce journaliste entré à l'agence
à la fin des années soixante :
A mon entrée à l'agence on m'a appris à faire un urgent d'un paragraphe, on ne m'a
jamais dit quelle était la taille du paragraphe. Aujourd'hui, on ne parle pas de
paragraphe, on dit : on fait un urgent de trois lignes maximum, si on dépasse sur la
quatrième c'est autorisé.
131 AFP, Manuel de l'agencier, 1982, page 100.
111
Le manuel de l'agencier publié en 1982, précise désormais la taille d'un paragraphe : «Le
paragraphe, qui constitue chacun des étages de la pyramide inversée, doit être lisible. S'il
dépasse trois lignes, il doit être coupé en deux phrases au moins. Aucun paragraphe ne doit
dépasser cinq ou six lignes. »132 Dès les premières pages, le premier manuel alerte l'agencier
sur les exigences en termes de normes de la copie. La dépêche « doit donc obéir à des normes
fixes et constantes (...) le lead est l'élément essentiel de l'information, son résumé en un
minimum de mots. »
Les journalistes les plus anciens rencontrent des difficultés à s'adapter à cette politique, où les
journalistes du desk sont chargés de sélectionner les dépêches qui vont être diffusées sur les
fils et de « retailler » la copie s'ils les jugent trop longues. Les journalistes sur le terrain, et
les correspondant étrangers d'autant plus, ressentent cela comme une ingérence dans leur
travail. Ils ont le sentiment que les journalistes du desk ne mesurent pas l'importance de
l'événement qu'ils couvrent. Ainsi cette correspondante désormais à la retraite qui relate son
voyage avec le président français François Mitterrand à Sarajevo :
C'est un truc dingue aujourd'hui. Par exemple quand je suis allée à Sarajevo (...), ils
étaient convaincus que je ne pourrais rien transmettre parce que j'avais juste ma
petite console. En fait j'ai réussi à trouver des téléphones satellites et j'ai pu
transmettre toute la journée. La seule chose qu'ils m'ont fait passer c'est le dernier
papier de 800 mots, pour un sujet comme ça qui était une exclusivité ! En d'autres
temps, cinq, six, huit feuillets, ça passait.
Aussi, ces derniers adoptent-ils des stratégies de contoumement pour éviter que le journaliste
du desk ne procède à des modifications trop conséquentes de leur copie : « Comme on en avait
marre de voir toujours nos papiers coupés, à la fin, on ajoutait toujours un dernier
paragraphe supplémentaire, parce qu 'on savait que de toutes façons il serait coupé. Comme
ça, on était sûr de voir notre papier diffusé sans trop être abîmé. »
Au sein de cette section, nous avons souligné combien les années soixante-dix et quatre-vingt
ont constitué une période de transformation des modes rédactionnels de la dépêche, qui ont
conduit l'agence à réévaluer la hiérarchisation des dépêches notamment en multipliant les
m. AFP, Manuel de l'agencier, 1982, page 39.
112
formats de dépêches hors-factuel, et en menant une politique de normalisation de la taille des
papiers. Les modifications opérées dans la classification des dépêches au cours des années
soixante-dix et quatre-vingt préfigurent une transformation plus radicale de la copie agencière
qui se traduit notamment par une fragmentation de la copie et le développement des papiers à
attribut. Ces changements impliquent le développement d'une nouvelle forme de journalisme :
le journalisme situationnel, caractéristique de cette nouvelle configuration journalistique.
Section 3. La seconde configuration : fragmentation de la dépêche et règne dujournalisme situationnel
3.1 Les caractéristiques de la dépêche
Le développement des techniques de distribution des informations, l'apparition de nouveaux
supports (Internet, téléphone portable, canaux d'information en continu, etc.), l'intensification
de la concurrence et la diversification des intérêts de la clientèle ont conduit l'AFP à accroître
sa production et à diversifier les formats des dépêches et les angles de traitement des
événements. L'agence doit réagir toujours plus vite face à la concurrence et chercher à s'en
distinguer en proposant des angles inédits de couverture de l'événement et des formats les
mieux adaptés aux besoins de ses clients.
Dans cette section nous verrons qu'au factuel, qui a longtemps constitué le modèle de
référence de la dépêche, s'ajoutent de plus en plus de « papiers à attribut » qui ont connu une
forte expansion ces quinze dernières années. Cette diversification des formats entraîne un
accroissement de l'activité de mise en forme de l'information et sollicite des compétences
nouvelles chez les journalistes. Nous verrons également que cette multiplication des formats
et l'exigence accrue des clients qui disposent d'une offre informationnelle plus importante
qu'autrefois, conduit l'agence à s'engager dans une politique de normalisation de la taille des
dépêches.
113
3.1.1 Le factuel, mode de traitement traditionnel de la copie agencière
Comme nous l'avons vu précédemment, le factuel désigne le texte journalistique dans lequel
le journaliste se contente de relater les faits dans un souci d'objectivité, d'exactitude et de
neutralité, ce qui conduit l'agence et les journalistes à qualifier ce type de dépêches, de
« nouvelles sèches ». Le factuel traite généralement d'événements fortement marqués
temporellement et dispose d'une taille modérée. Le « factuel » exclut par conséquent tous les
textes journalistiques aux dimensions éditorialisantes133 ainsi que les dépêches fournissant un
nombre important de détails et d'éléments contextuels.
Le découpage de l'information factuelle en plusieurs types de dépêches a connu peu de
modifications entre 1945 et aujourd'hui. En 1945, le factuel désignait trois types de dépêches,
le flash, le bulletin et l'urgent.
Au début des années quatre-vingt, l'additif et le lead se joignent aux trois types de factuels
cités précédemment.
• L'additif peut être utilisé comme un complément express du bulletin mais peut
également compléter une première dépêche urgente.
• Le lead'34 ou papier d'ensemble reprend le dernier état d'un événement. Il fait la
synthèse des différents aspects d'un même événement traité dans les dépêches
précédentes.
En 2000, l'additif qui avait été créé pour pallier les lenteurs de transmission, et le lead sont
remplacés par le premier lead et le factuel court.
133 L'information éditoriale est bannie des dépêches d'agence.134 Le terme lead désigne à la fois « l'attaque » d'une dépêche c'est-à-dire les deux ou trois premièreslignes de la dépêche, mais également un format spécifique de dépêche. Le second manuel de l'agencierdéfinit le lead comme la dépêche venant à la suite des bulletins et de l'urgent.
114
• Le premier lead succède à l'urgent. Il rassemble les informations contenues dans les
différents urgents portant sur un même événement et comporte quelques éléments
contextuels nécessaires à la compréhension du lecteur.
• Le factuel court traite d'un événement qui ne mérite pas d'être envoyé en urgent mais
qui doit être diffusé rapidement pour répondre aux besoins de certains clients.
Bien que le factuel constitue une forme de couverture incontournable de l'agence, ce n'est pas
lui qui permet à l'agence de se distinguer de la concurrence. En effet, l'AFP est aujourd'hui
largement concurrencée par d'autres médias sur l'information factuelle, notamment par les
médias d'information en continu. C'est pourquoi, dans la copie agencière telle qu'elle nous
apparaît depuis les années quatre-vingt-dix, le factuel, modèle classique, est sérieusement
concurrencé par d'autres formes de dépêches, les papiers à attribut. Ces derniers connaissent
une expansion considérable et concurrencent le factuel. Les papiers à attribut désignent tous
les papiers qui n'appartiennent pas au factuel (flash, bulletin, urgent, premier lead, factuel
court) et qui traitent de l'événement en fonction d'un choix rédactionnel (l'attribut) défini et
énoncé préalablement. Ainsi, outre le traitement d'un événement par des dépêches factuelles
(flash, bulletin, urgent, lead), le directeur du bureau peut demander à ses journalistes de
rédiger des types de dépêches spécifiques sur ce même événement, telle une dépêche intitulée
« les principaux points », récapitulant les éléments essentiels de l'événement, ou bien réaliser
un « portrait » de l'interlocuteur principal, etc.
Dans un contexte d'hyper concurrence, l'agence s'inscrit dans une démarche de différenciation
par rapport à ses concurrents et d'adaptation à la demande de ses clients. Elle propose donc à
ses clients un large éventail de dépêches, dont quarante-deux papiers à attribut qui'proposent
un traitement différent de l'événement. Nous nous proposons donc de porter une attention
particulière aux papiers à attribut ainsi qu'aux papiers d'analyse, qui constituent un sous-genre
des papiers à attribut, ces derniers ayant connu une expansion particulièrement forte au cours
de la dernière décennie.
115
3.1.2 L'expansion des papiers à attribut
La surabondance de l'offre d'information permet aux clients de disposer aussi d'un choix
important, la clientèle des agences se fait de plus en plus volatile et infidèle.135 Pour satisfaire
des besoins et des demandes de plus en plus variés, l'agence doit être en mesure de proposer
des produits adaptés aux besoins particuliers de ses différents types de clients. L'agence
emprunte alors de nouvelles stratégies rédactionnelles parmi lesquelles le développement des
papiers à attributs qui proposent des formats différents dans le traitement d'un même
événement. En 1971, le premier manuel de l'agencier comptabilise douze dépêches hors
factuels. Le dernier manuel de l'agencier publié en 2004 comptabilise pas moins de quarante-
deux types de dépêches différents n'appartenant pas au genre du factuel.136
L'apparition des papiers à attribut est un point de clivage entre la jeune génération et la plus
ancienne. La majorité des journalistes aujourd'hui en exercice sont favorables au
développement des papiers à attribut ; pour certains, la rédaction des attributs est un moyen de
pratiquer un « vrai «journalisme. La génération la plus ancienne, considère au contraire que
le factuel, « les faits rien que les faits », est le seul modèle de dépêche imaginable. « Le boulot
de l'AFP ce n'est pas de faire des reportages. Pigeât [ PDG de l'Agence France Presse de
1979 à 1986] avait employé le terme de "grossiste en informations". Ce n 'est pas beau parce
que ce n 'est pas vrai, on fait aussi dans le détail, mais l'essentiel c'est le factuel ». Toutefois,
aujourd'hui la rédaction des factuels est moins valorisée car le choix rédactionnel du
journaliste est moins sollicité dans les factuels que dans les papiers à attribut.
C'est valorisant pour un journaliste de s'extraire du factuel pur et de prendre du recul
et déjouer son vrai rôle de correspondant à l'étranger (...) J'ai envie de ça : j'ai envie
de lire des reportages, des analyses et des papiers d'angles, sans compter les papiers
très pratiques comme les encadrés, les bios, les chronologies et je suis absolument
convaincue que ça permet à un fil de dépêches de respirer.
135 Pour s'attacher une clientèle de plus en plus volatile, certaines agences, Reuters et AP, proposentdes «packages » d'informations ou vendent leurs dépêches à l'unité. Jusqu'à présent l'AFP ne s'estpas encore engagée dans cette voie.136 La classification des dépêches des trois périodes est présentée aux pages 109 et 110.
116
Alors que les journalistes les plus anciens considèrent que le factuel constitue la production
noble de leur activité, les journalistes plus jeunes s'épanouissent davantage dans les papiers
hors factuels. Un tel découpage de l'événement dans une multitude de formats potentiels est
parfois difficile à suivre pour les journalistes. Ils ne gardent pas en tête toutes les formes
possibles de dépêches et ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour passer en revue
tous les types de papiers et décider lequel serait le plus approprié, sans compter que les
distinctions entre les papiers sont parfois difficiles à saisir. « La différence entre papier
d'éclairage et papier d'analyse est quand même assez ténue ». Certains journalistes ont confié
qu'il leur arrivait de se référer au manuel de l'agencier pour s'assurer des différences entre tel
et tel papier à attribut. La multiplication des formats entraîne une réduction de la taille des
dépêches et une surveillance encore plus stricte du respect des normes en matière de taille.
3.1.3 Une taille de dépêche normalisée
Deux processus conduisent conjointement à la multiplication des papiers. D'une part, l'agence
doit toujours réagir plus vite et « coller » à l'événement ce qui force les journalistes à
multiplier les papiers pour rendre compte des moindres développements. D'autre part, comme
nous l'avons précisé plus tôt, l'agence doit couvrir des angles inédits, trouver des
compléments d'informations auxquels les concurrents n'ont pas pensé ou n'ont pas accès afin
de remporter la considération du client. « On est dans une logique du toujours plus, toujours
plus de papiers dans la journée et toujours d'angles possibles et inimaginables pour ne pas
être dépassé par la concurrence. »
Par ailleurs, les moyens techniques permettent aujourd'hui de diffuser les dépêches des
agenciers sans limite de volume. Le rôle de l'agence est donc de veiller à ce que le fil de
l'AFP ne soit pas redondant. Chaque dépêche doit s'intégrer dans la composition du fil afin de
veiller à ce que celui-ci ne soit pas saturé de dépêches. À cet effet, l'agence prône une
réduction de la taille des dépêches : « Privilégier la qualité sur la quantité. Réfléchir à ce que
nous faisons, pourquoi, comment et pour qui. Faire plus court (factuels de 200 mots maxi,
117
papiers de 600 mots maxi, voire moins) »137. Cette affirmation souligne que les critères et les
pratiques habituelles, routinières ne permettent pas d'agir efficacement, l'agence invite à
« réfléchir », sous-entendant que ce qui est prescrit par la routine et les manuels coïncide mal
avec les exigences actuelles, c'est donc l'indice qu'il y a du changement.
Dans un rapport publié en juin 2000138 sur le réseau intranet de l'agence, l'AFP rappelle six
priorités rédactionnelles à ses journalistes. Parmi celles-ci, le chapitre consacré aux mesures
visant à améliorer les contenus réitère les impératifs liés à la taille de la copie.
Quelle que soit la langue de travail, la longueur des papiers doit être au maximum de
600 mots pour les papiers principaux, sauf pour des événements mondiaux d'ampleur
exceptionnelle. Les angles et reportages peuvent avantageusement être limités à 400 -
500 mots. m
Le dernier manuel de l'agencier rationalise la taille de la copie en intégrant une grille de
classification des différents types de « papiers »140. À chaque type de dépêche correspond un
nombre de mots maximum. La majorité des dépêches doivent comporter entre 300 et 600
mots, deux dépêches peuvent être plus longues, seuls les attributs « En bref» qui malgré son
titre peut comporter jusqu'à 700 mots et « Principaux points » qui comprend 800 mots.
La réduction de la taille des dépêches répond à une tendance identique pour les journaux. Au
cours de ces dernières décennies, les journaux ont eu tendance à diminuer la longueur
moyenne des textes qu'ils publient. La dernière maquette du quotidien « Le Monde » ou celle
de « Libération » témoignent de cette tendance. Par ailleurs, les clients Internet qui constituent
de nouveaux clients de l'agence exigent un format plus court des dépêches. En 1999, le
producteur senior de Yahoo affirmait que son site diffusait pas moins de 600 dépêches par
7 Document AFP diffusé sur l'intranet, « Rédaction en chef: notes rédactionnelles, les prioritésrédactionnelles », p.4, juin 2000, annexe B-9.138 Document AFP diffusé sur l'intranet, «Rapport sur les priorités rédactionnelles de l'agence»,2000, annexe n° B-9.n9op.citp.l.140 Annexe n° B-6.
118
jour141. Internet exige un autre format de dépêche auquel les journalistes doivent s'adapter.
« // est à remarquer que les impératifs du multimédia nous obligent à être encore plus concis
(sur un site web, une histoire en 400 mots est déjà longue). »142
3.2 Le journalisme situationnel
Une grande part des papiers à attribut sont des papiers d'analyse. Le développement de ce
type de papiers s'inscrit dans le mouvement qui a vu le journalisme événementiel céder
progressivement sa place au journalisme situationnel. Les dépêches ne se limitent plus à la
seule description de l'événement comme dans les années cinquante, mais comprennent
également une mise en contexte de l'événement. La compétence du journaliste repose
désormais sur sa capacité à synthétiser un événement, à le contextualiser, à en donner une
analyse. Dans le cadre du journalisme situationnel, les journalistes « mettre en valeur les
groupes plutôt que les individus et dépendent des sources expertes extérieures. Ils expliquent
une époque en se rapportant à d'autres époques. Ils se concentrent sur de grandes régions
plutôt que sur des lieux particuliers, et se penchent davantage sur le comment et le pourquoi
de l'événement plutôt que sur l'événement lui-même. »
Les agences de presse ne peuvent pas concurrencer la télévision, aussi elles proposent de s'en
différencier en rendant l'information "vivante". Barnhurst explique que les journalistes vont
«raconter» l'événement en y ajoutant plus de détails, d'explications et d'éléments
contextuels qu'ils ne l'auraient fait auparavant. Ainsi les journalistes tendent à proposer des
textes plus analytiques. L'événement particulier n'a un sens que si on peut le rattacher à un
cadre universel ou global. Le journaliste doit être en mesure de mettre en perspective
l'événement particulier. Il s'agit pour le journaliste d'expliquer les causes de l'événement,
141 Grégoire Clémencin, producteur senior de Yahoo France, entretien au Journal du Net, 11 mars1999, extrait « les Journaux face à la concurrence d'Internet, Nouveaux barbares de l'information enligne » Marc Laimé, Le Monde Diplomatique, juillet 1999, page 24.142 Document AFP diffusé sur l ' intranet, op.cit., page 2.143 Barnhurst, Kevin G., Mutz Diana C , «American Journalism and the Décline in Event-CenteredReporting», Journal of Communication, 41.4, 1997, pp 27-53, p.44 : « emphasize groups rather thanindividuals and dépend on outside expert sources. They explain a period by referring to other timeperiods. They focus on larger régions rather than particular addresses, and they emphasize the howand why rather than on the event itself. » (traduction réalisée par l 'auteur).
119
comment il s'est déroulé mais également de le resituer dans un cadre plus large. Par ailleurs,
le public dispose aujourd'hui de nombreux moyens de s'informer. Dans un contexte de
surabondance de l'information, l'AFP se doit de proposer une information « rare » voire un
service.
L'Agence France Presse constitue un label de sérieux en comparaison des autres sources
d'information, toutefois, dans un contexte où les enjeux sont devenus multidimensionnels, à la
fois globaux, et à la fois régionaux voire locaux. Le journaliste adopte une nouvelle fonction,
il relate l'événement et l'explique. Le journalisme situationnel se traduit donc du point de vue
du journalisme d'agence par un accroissement du journalisme de décryptage avec l'apparition
de nouveaux formats de dépêches et de nouveaux acteurs, les experts, ainsi que d'une
redéfinition du rôle journalistique.
3.2.1 L'évolution de la demande
L'avènement du journalisme situationnel répond à une évolution de l'environnement
médiatique marquée notamment par la multiplication conjointe des canaux de diffusion de
l'information et des acteurs médiatiques qui ont conduit à une situation de surabondance de
l'offre d'information. L'agence évolue dans un environnement qui se caractérise notamment
par un contexte de surinformation. En effet, le début des années quatre-vingt-dix a été marqué
par l'avènement des chaînes d'information en continu qui ont permis la diffusion simultanée
et mondiale d'événement en direct. La chaîne CNN 144 en a été l'initiatrice et s'est notamment
illustrée lors de la couverture de la première guerre du Golfe.145 En 1995, Internet participe à
l'élargissement de la sphère informationnelle. L'agence est aujourd'hui concurrencée
intensément sur la production de factuels. Dans ce contexte les faits sont déjà connus par les
lecteurs grâce à la télévision, la radio et Internet :
4 Ted Turner a lancé la première chaîne télévisée d'information en continu, CNN, Cable NewsNetwork le 1er juin 1980, puis CNN International en 1985, mais c'est la couverture de la premièreguerre du Golfe en 1991 qui signe l'essor des chaînes d'information en continu.145 Nous renvoyons le lecteur aux travaux de Jocelyne Arcquembourg, « L'événement en direct et encontinu », Réseaux n°76, 1996, Paris, pp.31-45.
120
L'info, les lecteurs l'ont par des tas de médias, il suffit de se connecter à Internet.
L'info est disponible partout, on peut aller la chercher à la source. Nous on va couvrir
des conférences de presse mais l'auteur de la conférence de presse va mettre son
rapport sur Internet, les gens peuvent aller le voir directement. Les gens ont toujours
besoin de plus d'info car il faut alimenter ce truc. Comme l'info part dans tous les sens
et qu'elle est disponible, il faut des gens qui leur disent : voilà ce qu'on peut penser de
cette info.
Les clients de l'agence exigent des papiers d'analyse, ils veulent offrir une information
différente, inédite à leurs propres clients. L'analyse est pour l'agence un moyen de produire
un discours original et distinctif; l'analyse comporte une plus value par rapport à
l'information brute qui, du fait même de son abondance et son accessibilité, est dévalorisée.
Enfin, les médias, qui luttent farouchement pour accaparer une partie de l'attention du public,
sont de plus en plus soucieux d'offrir des contenus dans des formes attrayantes et très
« lisibles » (encadrés, schémas, cartes, chronologie etc.). Cette nouvelle demande modifie de
manière conséquente la conception du rôle des journalistes. Ils sont de moins en moins des
producteurs, des rédacteurs d'information mais davantage des « metteurs en forme » de
l'information.
3.2.2 Le journalisme de décryptage
Le journalisme de décryptage ou d'analyse, peut être défini comme une démarche
journalistique consistant pour le journaliste non seulement à relater les faits, mais également à
avancer des explications afin qu'ils puissent être compris par le public. Le journaliste rapporte
les faits et les replace dans leur contexte géographique, historique, économique et culturel. Il
effectue des observations, relève des constantes, des évolutions, des contradictions qui lui
permettent d'en tirer des conclusions et de provoquer ainsi la réflexion chez son lecteur. Il
cherche également les antécédents et les causes des événements ainsi que leurs conséquences
réelles ou possibles. Si le journalisme d'analyse était présent dans la dépêche des années
cinquante, il prend aujourd'hui une place considérable dans la production agencière comme
en témoigne un correspondant étranger de l'AFP à Londres : « Je l'ai ressenti à Londres où,
presque pour un oui ou pour un non, pendant la guerre en Irak, on nous demandait
121
quotidiennement des analyses sur la dernière cassette de Ben Laden via Internet par exemple.
On donne aux gens l'info, mais de plus en plus ils veulent qu'on leur donne le mode d'emploi
de l'info, le décryptage, le décodage », et le journalisme d'analyse adopte différents formats.
« On n 'écrit plus les choses de la même manière, un papier d'analyse ne va pas plus s'écrire
comme une dépêche à tiroirs. On a besoin de papiers d'analyse, d'éclairage, d'angles,
d'encadrés, machin, chronologie, truc. »
L'AFP propose plusieurs types différents de dépêches d'analyse de l'événement :
• Le papier d'éclairage vise à éclairer un événement en exposant, de façon factuelle, les
différents points de vue et en les resituant dans leur contexte. Le papier d'éclairage
exige un solide background.
• Le papier d'analyse vise à expliquer une situation, un événement, une disparité de
points de vue, de positions. Il prend appui sur l'analyse de spécialistes pour
comprendre une situation.
• Le papier d'angle privilégie un aspect particulier de l'événement qu'il illustre. Il
reprend les éléments essentiels de compréhension de l'événement afin de faire
ressortir l'angle retenu.
• Le papier bilan est rédigé après les papiers d'analyse cités précédemment. Il vient
clore temporairement la couverture d'un événement en rassemblant les principaux
éléments et s'efforce d'en dégager la signification principale.
La démarche journalistique répond à un double objectif. Le journaliste vise la compréhension
de l'événement et s'assigne donc la tâche de vulgariser, de simplifier l'information, il joue en
quelque sorte le rôle de « réducteur de complexité » comme le précise Nicolas Pélissier146.
Mais s'il est réducteur de complexité, ce n'est pas tant parce que le monde est plus complexe,
mais parce que le public, pressé, apprécie une information pré-digérée. Ainsi, aux papiers
d'analyse, s'ajoutent donc un grand nombre de dépêches aux formats les plus divers qui sont
16 Pélissier, Nicolas, Les mutations du journalisme à l'heure des nouveaux réseaux numériques,AFRI, 2001 publication en ligne. Disponible sur:<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001421.pdf> (consulté le 02.02.04).
122
autant d'outils au service de la compréhension de l'événement par le public (chronologie,
carte, biographie, fiche technique, etc.). Une jeune journaliste précise: «Aujourd'hui, on veut
de l'info prédigérée qu'on puisse appréhender immédiatement, y compris en la voyant (visuel)
: c'est-à-dire qu'on a un papier corps, et des encadrés à côté, éventuellement une analyse, en
général, en colonne sur le côté, et ça c'est visuel. »
La multiplication des dépêches explicatives sur un événement est particulièrement sensible
sur la couverture anticipée que fait l'agence à propos de certains événements. L'agence
produit alors un dossier qui va offrir différents angles de traitement de l'événement. À titre
d'exemple, nous présentons ci-dessous la couverture anticipée du lancement de la navette
spatiale américaine le 7 juillet 2005. Le dossier qui parvient aux clients avant que l'événement
n'ait lieu comporte pas moins de deux portraits, trois papiers d'angles, deux encadrés et une
fiche technique, auxquelles viendront s'ajouter les dépêches qui seront rédigées a posteriori
de l'événement.
123
titre de la dépêche
"Eileen, le roc", commandant de bord
de Discovery
l'astronaute japonais Soichi Noguchi,
un novice des vols spatiaux
les astronautes : bricoleurs spatiaux pour réparationen orbite
Mission Discovery : priorité à la sécurité
Discovery : un sans-faute nécessaire aux ambitionsaméricaines
La navette, autobus et camion de l'espace
La mission de la navette spatiale
De la Floride à l'orbite terrestre en 8 mn et 40secondes
type de la dépêche
portrait
portrait
papier d'angle
papier d'angle
papier d'angle
encadré
fiche technique
encadré
nombre de mots
673
510
515
628
555
361
381
425
3.2.3 Un journalisme d'analyse fondé sur la parole des experts
La demande d'analyses s'adresse à l'ensemble des médias; tous les clients de l'agence
demandent donc aux journalistes de l'AFP d'être des pédagogues, des « décrypteurs » de
l'information. Cependant, les agenciers ne sont pas des journalistes spécialisés147, ils ne
7 Les chercheurs Denis Ruellan et Dominique Marchetti ont constaté que le recrutement desjournalistes variait entre deux pôles : le premier concentrant les généralistes (généralistes polyvalentsavec une grande adaptabilité, des formations professionnelles différentes), le second réunissant lesjournalistes de plus en plus spécialisés et les experts. Les journalistes de l'agence s'inscrivent dans lepremier pôle, ils peuvent développer des savoir ou des savoir-faire spécifiques, mais ils sont tenus dechanger de poste tous les deux ans pour l'étranger et tous les quatre ans pour le siège. Ruellan Denis,
124
disposent pas de l'expertise suffisante que certains journalistes de presse écrite par exemple
peuvent avoir. Le caractère polyvalent148 des agenciers est particulièrement accentué chez les
correspondants étrangers ayant le statut siège. Ils doivent se plier à la règle de rotation
instituée par la direction. Tous les deux ans, les journalistes en poste à l'étranger doivent
revenir au siège et exercer leur métier au sein d'un desk avant de pouvoir repartir. Par ailleurs,
l'anonymat et l'objectivité et la neutralité sont des fondements du métier d'agencier. Le
journaliste ne peut apparaître comme l'énonciateur du discours, il ne peut se présenter comme
un analyste de l'événement. Si, au fil du temps, le journaliste peut parfois développer une
certaine expertise dans un domaine149, il ne peut produire des analyses et en assumer la
paternité. Les experts ont cette autorité pour s'exprimer sur le sujet que n'ont pas les
journalistes comme le précise cette jeune journaliste.
Imaginons qu 'on me demande un week ender sur le futur en Irak après les élections,
comment tu fais ça, si tu n 'appelles pas un expert? Qui va te parler? Il faut appeler
quelqu'un de l'institut de recherche. (...) Tu ne peux pas raconter que des faits, tu ne
peux pas raconter que du background, il faut que tu trouves quelqu'un qui te dit « Bah
moi je pense que...tatata ». Ce sont des gens qui ne font que lire, étudier, qui
regardent la télé comme nous, mais eux ils sont profs, alors eux ils peuvent parler,
pas nous.
L'expert peut occuper des positions différentes : «L'expert peut fonctionner comme marque
véridictive du dire-vrai du discours, et dans ce cas, il se porte garant d'un discours engendré
par d'autres énonciateurs. Dans une autre configuration, l'expert peut assumer en son nom la
production du discours et, dans ce cas, il qualifiera la matière textuelle avec sa figure. D'un
point de vue technique, ce qui change, est le degré de syncrétisme entre l'énonciateur et le
Marchetti, Dominique, Devenir journalistes, sociologie de l'entrée sur le marché du travail, laDocumentation Française, Paris, septembre 2001, 167 pages.148 Pour une analyse approfondie du caractère polyvalent du journaliste, nous renvoyons à la lecturedes travaux de Rémy Rieffel, « Vers un journalisme mobile et polyvalent ? », Quaderni, n°44,automne 2001, pp. 153-169.149 Certains correspondants étrangers de l'agence qui ont vingt à trente ans d'expérience au sein del'AFP sont devenus des spécialistes de certaines régions du monde. Bien qu'ils doivent suivre la règlede la rotation de poste instituée par l'agence, ils ont postulé pour des postes à l'étranger dans unemême région, voire ont occupé à plusieurs reprises des postes de directeur de bureau ou de journalistedans des bureaux similaires à plusieurs années d'intervalle.
125
narrateur. L'expert peut occuper une position strictement textuelle, et il reste alors un
instrument, parmi d'autres, de la stratégie pédagogique de l'énonciateur, ou il peut assumer
aussi une position énonciative, en se présentant comme l'origine du discours. Dans ce cas,
l'expert, plus que pour certifier un discours produit ailleurs, se pose comme source
caractérisée de la légitimité du discours ». Dans le cas du journalisme d'agence, la parole
de l'expert ne peut constituer le point de départ d'une dépêche, il est un outil supplémentaire
pour rendre accessible un événement au lecteur. Il occupe donc le plus souvent une position
strictement textuelle selon la typologie d'Andréa Semprini. Le développement du journalisme
d'analyse s'inscrit dans la «rhétorique de l'expertise critique» définie par Jean-Gustave
Padioleau comme distinct du journalisme d'opinion au sens où nie journalisme d'opinion
émet des jugements immédiatement informés par la référence à des valeurs explicites » tandis
que l 'expertise critique argumente.1 5 1 L 'expert ise critique «n'a plus rien à voir avec
l'expression d'opinions personnelles puisqu'elle vise à mettre en perspective les faits à l'aide
d'une argumentation logique et d'une compétence technique » 52. Le recours à l'expertise
répond, dans le cas de l'Agence France Presse, à un certain nombre de règles. Si le journaliste
est amené à produire une analyse, il doit faire appel à trois experts153 au minimum. Experts et
journalistes sont interdépendants, le journaliste a besoin de l'expert154 pour pouvoir produire
des papiers d'analyse, quant à l'expert, dans certains cas, il peut rechercher l'attention du
journaliste pour acquérir de la notoriété par son biais.155 « La règle dans l'information c'est :
150 Semprini, Andréa, Analyser la communication, éditions l'Harmattan, Paris, 1996, page 187.151 Fabien Blanchot et Jean-Gustave Padioleau, « Une économie politique du travail journalistique » inLes journalistes ont-ils encore du pouvoir ? coordonné par Jean-Marie Charon et Arnaud Mercier,Hermès n° 35, 20 mars 2003, 344 pages.152 Rieffel, Rémy, Sociologie des médias, Ellipses Infocom, Paris, 2002, page 104.153 AFP, Manuel de l'agencier, 2004, page 50.
>4 Les experts sont parfois issus des think tanks. Les think tanks que l'on peut traduire par réservoirsde pensée sont des institutions privées non partisanes sans but lucratif, indépendantes desadministrations, des universités et des intérêts économiques, dont l'objectif est de nourrir les débatspublics et de promouvoir le développement économique et social de la Nation, en réalisant et endiffusant des études auprès du grand public, des médias, des dirigeants d'entreprise et surtout desresponsables politiques. Les rapports entre journalistes et experts sont parfois ténus au point que nouscomptions, dans notre échantillon, un journaliste à la retraite qui exerce actuellement dans un thinktank européen.
'5 Sur la question du recours à l'expertise, nous renvoyons à la lecture des travaux de CarmellaLettieri, « Formes et acteurs des débats contemporains. Les tribunes publiées dans la pressequotidienne en Italie et en France », thèse, université Paris II, 2002.
126
plus tu es cité, et plus de journalistes te citeront ».156 Dans le cas de l'agence, les experts
doivent être identifiés et pouvoir être cités. « Ils ne se masquent pas derrière les noms
génériques « d'observateurs » ou « d'analystes » »
Le recours aux experts répond à plusieurs fonctions. En premier lieu, le recours aux experts
fournit une caution au texte journalistique et lui confère une valeur ajoutée. En second lieu, le
recours aux experts est également un moyen pour les journalistes de répondre aux exigences
des clients et de leur direction puisqu'il permet de produire, en grande quantité et en temps
record, des analyses de l'événement, c'est-à-dire des dépêches d'analyse qui, autrement,
nécessiteraient un temps de rédaction plus long que celui d'un factuel. « On se retrouve à
devoir pondre une analyse en une demi-heure. Je n'ai jamais vu aucun autre journaliste à
part le journaliste d'agence faire ça ». Le recours à l'expert permet donc au journaliste de
conjuguer la logique commerciale, qui exige que l'on produise le plus rapidement possible
des dépêches d'analyse, et l'exigence d'expertise critique.
En conclusion, les clients, via la rédaction centrale de l'agence, exigent des journalistes qu'ils
produisent des analyses dans un laps de temps le plus court possible, tout en respectant la
règle de neutralité de l'agence. Quel que soit l'événement analysé, l'analyse tend à se réduire
à un tableau résumant chacune des positions dans la voix des experts, à chaque position
correspondant un expert. « On est pas censé faire de l'éditorial, quand on fait une analyse, on
la fait dans les règles de l'agence : ça n 'est jamais l'AFP qui pense quelque chose, on est
censé avoir blanc et noir.» Cette situation vaut pour les journalistes encore en exercice. Les
journalistes plus anciens faisaient peu appel aux experts, dans la mesure où l'analyse était peu
présente dans les dépêches et où les sources officielles qu'ils citaient, les responsables
politiques et économiques, étaient des sources expertes et en autorité.
I5V the rule in the news is, the more you're cited, the mosl journalists will cite y ou» (traductioneffectuée par l'auteur), Bamhurst, Kevin, The New Long Journalism, 2004. Disponible sur : <http://tigger.uic.edu/~kgbcomm/longnews/pdf/bamljchl.pdf> (consulté le 05.04.05).157 AFP, Manuel de l'agencier, 2004, page 50.
127
-CHAPITRE 6- L'ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
Nous avons constaté dans les deux chapitres précédents que le passage d'une configuration à
l'autre a entraîné une diversification des thématiques et des catégories de dépêches. Bien que
l'écriture agencière soit particulièrement codifiée, elle a connu des transformations
conséquentes tant du point de vue de la nature du texte journalistique que de renonciation.
Dans ce chapitre nous voulons montrer que, dans les années cinquante, la dépêche se
caractérise également par la prééminence des textes narratifs et descriptifs qui donnent lieu à
un style journalistique personnel. Au cours des années soixante-dix et quatre-vingt, dans un
contexte hyper concurrentiel, l'agence va procéder à une normalisation plus poussée de
l'écriture, notamment en prenant modèle sur le style journalistique anglo-saxon.
Section 1 : Configuration A - Un texte journalistique narratif et descriptif quiinduit un style journalistique personnel
Durant les premières décennies de l'agence, les textes narratifs et descriptifs constituent les
deux genres dominants de la dépêche et dans lesquels le journaliste se pose comme témoin
crédible des événements.
1.1 Conjugaison des textes narratifs et descriptifs
L'observation des dépêches publiées dans les années 1945 à 1960 nous conduit en effet à
distinguer deux types de dépêches. La première catégorie de dépêches que nous pouvons
nommer « les nouvelles » relatent de manière concise les événements et fournissent peu
d'éléments de contexte. Elles sont fortement marquées par l'objectivité du journaliste. On
retrouve aussi des textes dans lesquels le journaliste, en tant que locuteur, est absent. C'est le
128
cas notamment des retranscriptions intégrales des discours des dirigeants politiques158 ou de
leurs communiqués15 . La seconde catégorie de dépêches est constituée des reportages et des
témoignages. Ce sont des dépêches où le journaliste ne se contente pas de relater l'événement
mais donne un certain nombre d'éléments contextuels, donne la parole à la population voire
exprime ses propres sentiments dans la dépêche. À cette époque, et contrairement à ce que
l'on observe aujourd'hui, l'analyse ne constitue pas un type spécifique de dépêche.
Plusieurs traits linguistiques et textuels caractérisent les textes journalistiques agençiers de
cette période. Dans les dépêches, le temps verbal employé par le journaliste est le temps du
récit, le passé simple. Ainsi, le flash annonçant le décès de Staline en 1953 se présente ainsi :
« Staline décéda »160; il faut attendre l'année 1976 pour que le flash annonçant le décès de
Mao se conjugue au présent : «Mao est mort »161. La dépêche présente également les
caractéristiques d'un récit littéraire. Le texte peut être composé de phrases très longues; le
journaliste ne cherche pas à tenir un discours percutant ou rythmé; il n'hésite pas à recourir
aux formules littéraires imagées. Le style littéraire des dépêches tient au fait que parmi les
journalistes qui exercent au sein de l'AFP au lendemain de la guerre, un certain nombre sont
issus de l'agence Havas. Ces journalistes ont conservé le style d'écriture littéraire. Par ailleurs,
les nouveaux entrants de l'agence ont suivi des études littéraires et sont imprégnés de
l'écriture journalistique de la presse quotidienne, particulièrement dynamique à cette époque
(la presse française compte près de deux cent titres au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale).
Par ailleurs, l'importance des textes journalistiques narratifs et descriptifs s'explique par le
journalisme d'enregistrement pratiqué par les agençiers dans la mesure où une grande part de
leur activité consiste à retranscrire les dires, les déplacements et les actions dans les moindres
détails. On peut illustrer cette pratique par l'analyse d'une dépêche datant du 9 décembre
158 Des dépêches retranscrivant des discours sont présents en annexe A-2159 Ces dépêches peuvent être qualifiées d'institutionnelles, au sens où elles sont exclusivement le faitde sources institutionnelles, le journaliste n'intervenant à aucun moment de la rédaction de la dépêche.À cet égard, l'agence peut être considérée comme un outil de communication pour les institutionspolitiques françaises. Cette pratique est particulièrement fréquente durant les années d'après-guerre etpendant les présidences du Général de Gaulle.160 Annexe n°A-6161 Annexe n°A-9
129
1944 et intitulée « Le dîner offert par le maréchal Staline au Général de Gaulle »162; Cette
dépêche, composée de quatre feuillets, comporte pas moins de onze termes relatifs au
déplacement dans l'espace {devant, de lieu, après avoir traversé, passe par, dans un salon
attenant où, à la table, le tour complet de la salle, pour repasser, dans la salle de cinéma,
autour, quittent la salle). Elle comporte également trente-quatre indications temporelles (dès,
à son tour, successivement, encore, puis, ensuite, vient, alors, suivent, se poursuit quelques
temps, termine, encore, alors, à ce moment, vient encore, au cours du repas, puis,
successivement, se termine, pour, puis, à minuit, succède, pendant, puis, à 2h30, ensuite, se
termine, quitte, samedi, aujourd'hui, après, à peine achevée, quelques instants plus tard), et
de très nombreux adjectifs. La multiplicité de ces expressions est caractéristique de la
narration, qui implique une série d'actions dans le temps et dans l'espace.
La domination du reportage n'est pas contradictoire avec les règles de l'objectivité à laquelle
l'agence doit se soumettre. Pour reprendre la définition de Denis Ruellan, le reportage doit
être compris comme le «produit d'une démarche active de recherche et de divulgation
d'informations réalisée par un individu placé en position (même provisoire) de témoin ».' '
C'est le genre journalistique par excellence qui réunit la narration et la description. La
description journalistique, très présente dans le reportage accentue l'aspect réaliste et objectif
de l'information; elle se fait du point de vue du témoin, des émotions qu'il ressent. Pour
conclure cette partie, il est important de souligner qu'à cette période, la valeur des dépêches
dépendait largement de la qualité d'écriture du journaliste. Il fallait que la dépêche soit bien
écrite, car c'est le style d'écriture qui conférait à la copie sa valeur. Contrairement à
aujourd'hui, l'agence n'associait pas le texte aux photos ou à d'autres éléments
iconographiques (diagrammes, chronologie, cartes, etc.).
162 Annexe n°A- 4.163 Ruellan, Denis, Le professionnalisme du flou, identité et savoir-faire des journalistes français,Grenoble, Presse Universitaire de Grenoble, 1993, pp. 109 - 129.
130
1.2 La notion d'objectivité s'incarne à travers une énonciation journalistique subjective
En amont de la chaîne de production de l'information, la dépêche serait, selon les termes de
Guy Lochard, « un modèle matriciel »164 de tous les autres énoncés journalistiques au sens où
elle se caractérise par un comportement délocutif; l'énonciateur s'efface au point de
disparaître. Cette définition ne correspond que partiellement à la dépêche produite durant les
trente premières années de l'agence165. En effet, dans les premières années de l'agence, le
journaliste agit discursivement dans la dépêche. Les journalistes qui traitent l'information
internationale sont peu nombreux; ils sont principalement issus des agences de presse, de
quelques radios et titres de presse écrite; ils ne sont pas en sur effectif et produisent une copie
qui leur est propre sans subir l'influence des autres médias pour traiter l'événement.
Contrairement à aujourd'hui, les journalistes ne rédigent pas leurs dépêches en pensant
systématiquement à ce que font les concurrents. Leurs dépêches ne sont pas le résultat d'une
confrontation entre leurs propres impressions et celles de leurs collègues.166 Par ailleurs, les
techniques de communication ne permettent pas au journaliste et à sa rédaction d'entretenir un
dialogue permanent comme c'est le cas quotidiennement pour les journalistes contemporains.
En 1945, le journaliste agit de manière autonome sur le terrain, la rédaction centrale ne
disposant pas toujours de moyens techniques suffisamment puissants pour orienter son
correspondant quant au traitement à accorder à l'événement. Le journaliste contribue donc
fortement à la définition des événements.
Parmi les dépêches que nous avons observées et au cours de nos entretiens avec les
journalistes, nous nous sommes interrogés sur renonciation de l'agencier afin de déterminer
si celle-ci s'était modifiée au fil du temps. De 1945 à 1971, les règles qui régissent l'écriture
agencière ne sont pas « écrites » et « officialisées ». Bien que les journalistes affirment
répondre à des impératifs d'objectivité et de neutralité, il n'est pas rare qu'ils s'expriment à la
164 Lochard, Guy, « Genres rédactionnels et appréhension de l'événement médiatique ? Vers un déclindes « modes configurants » ? », Réseaux n°76, Cnet, 1996, pp. 83-102.165 Nous prenons la date de publication du premier manuel de l'agencier comme la premièreformalisation des règles rédactionnelles de la dépêche166 Dans le second chapitre de la troisième partie, nous reviendrons sur les pratiques journalistiquesréflexives qui se sont développées depuis une vingtaine d'années avec l'informatisation et ledéveloppement des satellites de communication.
131
première personne dans les dépêches. Les journalistes considèrent l'emploi du «je » comme
un gage d'honnêteté. Ce journaliste entré à l'agence en 1954 explique ainsi :
D'une certaine façon, même à l'agence, on s'exprimait d'une façon personnelle. Même
si la façade était un petit peu impersonnelle, il arrivait que l'on dise «je ». A un
certain moment, il faut bien le faire, ne serait-ce que pour dire : « moi je peux juste
vous dire ça ». Je crois que le «je » doit être un «je » de modestie contrairement à
ceux qui pensent que le «je » est un «je » emphatique}61
Les journalistes de l'époque se distinguent des journalistes contemporains en mettant en avant
l'authenticité de leurs dires, en étant leur propre source et en se signifiant dans le texte par
l'emploi du pronom personnel «je». Dans la dépêche actuelle, le mode d'écriture tend au
contraire vers un discours sans sujet.
L'emploi de la première personne du singulier s'explique également par le fait que le
journaliste ne fait pas nécessairement appel à d'autres personnes pour commenter
l'événement; pour reprendre une figure incontournable aujourd'hui pour les journalistes
d'agence il est son propre « expert ». Dans le cas d'un témoignage, le journaliste ne se fait pas
le relais de la parole d'autrui, c'est sa propre parole de témoin qui est mis en valeur, c'est ce
que nous pouvons qualifier de «je testimonial » couramment employé par les reporters.
Géraldine Mulhmann parle de «témoin ambassadeur », le journaliste se présente comme « un
simple témoin, mais un témoin légitimé par une communauté entière, comme un observateur
singulier mais mandaté, justifié. »168
L'usage du «je testimonial » est particulièrement présent dans les reportages ; or pendant les
années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'agence est le média qui emploie le
167 Si dans la presse nord-américaine, on observe actuellement un certain retour du «je » que l'on peutassocier à la valorisation d'un style personnel, on ne constate pas une tendance similaire en France.68 Mulhmann Géraldine, Une histoire politique du journalisme, Le Monde, Paris, PUF , 2004, pp. 23-
24.
132
plus de journalistes à l'étranger. Les autres médias, les journaux notamment, font
régulièrement appel aux effectifs de l'AFP pour les pourvoir en reportage.
La prolifération du grand reportage, son implantation dans la presse régionale, sont
liées pour une part aux agences qui fournissent des enquêtes aux journaux. (...) Au
Monde, où Hubert-Beuve Mery impose une politique d'économies afin que le journal
demeure indépendant et libre, nombre de grands reportages sont signés par des
journalistes extérieurs à la rédaction. Celui dont la signature revient le plus souvent
dans les premières années du quotidien est Pierre Frederix, de l'AFP ; entre janvier et
avril 1952, il fournit cinq séries. 69
L'observation de plusieurs dépêches datant de cette période nous a permis de relever plusieurs
occurrences d'énonciations subjectives. Le journaliste s'exprime parfois à la première
personne du singulier, voire du pluriel. Le « nous » peut inclure le lecteur, parfois le « nous »
peut désigner également le journaliste et ses collègues quand il est intégré dans un pool,
comme dans cet extrait de dépêche.
« Pourtant au hasard de la route, on a pu, a plusieurs reprises apprécier le sens de
l'hospitalité et la générosité khmère. Au soir du 30 avril, les vingt passagers de notre
convoi se sont vu offrir par des paysans leurs chambres pour passer la nuit et nous
avons tenté en vain de leur faire partager notre maigre repas et notre thé. (...) C'est
aussi sur une note chaleureuse que nous quittons la terre cambodgienne. Notre ehefde
convoi, un ancien instituteur qui refuse de dire son nom - cela n 'a pas d'importance -
mais qui parle remarquablement bien le français, apprend que les journalistes ont
décidé de ne rien dire sur les événements des deux dernières semaines tant que tous
les réfugiés n 'auront pas franchi la frontière. Il s'en étonne et espère que la presse ne
sera pas trop sévère lorsque nous raconterons comment s'est passé notre voyage. (...)
Il nous offre une dernière cartouche de cigarettes que nous ne pouvons refuser, mais il
j9 Martin, Marc, Les Grands Reporters, les débuts du journalisme moderne, éditions Audibert, Paris,septembre 2005, page 366.
133
ne répond pas lorsque nous lui disons que nous souhaitons tous pouvoir rapidement
revenir au Cambodge »170.
Le journaliste peut constituer lui-même sa propre source comme dans cet extrait de dépêche,
la dépêche s'inscrit alors dans le genre du témoignage :
TEMOIGNAGE
PEKIN, 13 septembre 1973 (AFP) (Par René Flipo) « J'ai vu la dépouille mortelle de
Mao Tse Toung et, comme beaucoup de chinois autour de moi, j'ai eu beaucoup de
mal à retenir mes larmes. D'autres qui s'étaient dominés jusque là ont soudainement
été brisés par la douleur devant le catafalque sur lequel repose, dans un bain de
lumière jaune diffuse, le corps de Mao Tsetoung. Je me suis joins avec mon épouse et
le personnel de notre bureau à Pékin à une file de centaines de personnes gravissant à
pas lents quarante marches de granit bleu menant à l'imposante entrée du congrès
national populaire (assemblée chinoise) sur la place Tien An Men (...) » .
L'expression des sentiments éprouvés par le journaliste au sein même de la dépêche
participe à une visée gratificatrice, il souhaite «faire ressentir, c 'est-à-dire provoquer
chez l'autre un état émotionnel agréable ou désagréable»17 . Enfin, le récit à la
première personne du singulier ne se limite pas au genre du témoignage, il peut
également se retrouver dans des dépêches qui sont rattachés au genre du factuel
comme celle-ci :
170 Dépêche AFP, «Phnom Penh est vide, le Cambodge se purifie, des millions de khmers ont faireretour aux rizières », Jean Jacques Cazaux, 8 mai 1975.171 Dépêche AFP, « témoignage, Pékin », René Flipo, 13 septembre 1976, annexe n°A-10.72 Mulhmann Géraldine, Une histoire politique du journalisme, Le Monde, Paris, PUF , 2004, pp. 23-
24.
134
L'adieu de la Chine à Mao Tse Toung a été digne et simple. Bouleversant. Je me
trouve, seul étranger, au milieu de quelques milliers de Chinois sur le parvis de la
grande gare centrale de Pékin quand trois heures sonnent à la grande horloge.173
Contrairement à aujourd'hui, les journalistes de l'époque disposaient d'une certaine marge de
liberté dans la rédaction de leurs dépêches, « Les normes n 'étaient pas notre préoccupation
première » affirme une journaliste entrée à l'agence dans les années soixante. Cela ne signifie
pas qu'il n'y avait pas de normes, mais celles-ci n'étaient pas généralisées et uniformes. La
création du premier manuel de l'agencier par Jean Marin en 1971 marque une première étape
dans la rationalisation de l'écriture et du format de la dépêche. Depuis, cet effort de
rationalisation de la copie n'a cessé de s'accentuer avec les deux manuels qui lui succéderont
en 1982 et en 2004.
Section 2 : Processus de normalisation de l'écriture agencière
Jusqu'en 1971, l'écriture agencière n'est donc pas codifiée par un manuel et il n'y a pas de
modèle contraignant d'écriture agencière. La production et la reproduction des normes
d'écriture se font de manière informelle par socialisation; les journalistes qui entrent alors à
l'agence copient le style des agenciers les plus anciens.
La rédaction d'un premier manuel de règles d'écriture destiné aux journalistes en 1971,
témoigne d'un processus de normalisation de la dépêche tant du point de vue de la taille, du
découpage que de l'écriture du texte journalistique. Jean Marin, alors directeur de l'AFP,
rédige un manuel afin d'uniformiser le style pratiqué par ses journalistes. Il justifie cet effort
de normalisation comme un moyen de lutter contre la concurrence anglo-saxonne,
« / 'application de ces Règles, dont nos concurrents anglo-saxons observent notre
défaillance conditionne notre capacité de compétition, donc notre succès.» Le premier
73 Dépêche AFP, « L'adieu de la Chine », Georges Biannic, 18 septembre 1976, annexe n°A-11.4 L'emploi de la majuscule au terme «règles» ajoute à l'importance qu'accorde Jean Marin au
respect de celles - ci.175 AFP, Manuel de l'agencier, 1971, page 1.
135
manuel de l'agencier a donc été initié afin de « s'aligner » sur la rigueur et les règles de
rédaction des agences anglo-saxonnes. En regard des deux manuels qui succéderont au « petit
livre rouge »176, ces règles paraissent peu nombreuses, générales et sommaires.
La publication de ce premier manuel est considérée comme inutile pour la génération des
journalistes les plus anciens qui n'y voient qu'un moyen de pallier les difficultés d'écriture
des jeunes journalistes. « Les manuels de l'agencier sont de plus en plus gros, parce qu'ils [les
jeunes] ne savent pas écrire ». Les journalistes quinquagénaires, qui sont entrés à l'agence
alors que le premier manuel venait d'être publié, considèrent, en grande majorité, que le
manuel de l'agencier leur est inutile; ils n'éprouvent pas le besoin de se référer au manuel car
ils disent avoir intégré les règles d'écriture lors de leur entrée dans l'agence.
L'informatisation de l'agence qui débute en octobre 1973 et s'achève en 1979 entraîne une
modification significative des normes d'écriture au point qu'un nouveau manuel est publié en
1982. Le volume et la taille du manuel de l'agencier ont quadruplé. Le processus
d'informatisation modifie la dépêche sur deux aspects principaux. Les outils de transmission
permettent de véhiculer un volume plus important de dépêches, les outils limitent de moins en
moins le volume des dépêches. Le second manuel de l'agencier insiste donc sur la nécessité
pour les journalistes de réfréner cette tendance à écrire toujours plus, « à tirer à la ligne »177.
En résumé, l'agence demande aux journalistes d'écrire des textes plus courts. Cette concision
des dépêches coïncide avec l'effort de normalisation de la taille de la dépêche qu'impose
l'utilisation des consoles par les journalistes de l'agence. Une console d'agence ne permet pas
de visualiser plus de 200 mots maximum par feuillet. L'outil informatique constitue une
contrainte supplémentaire.
La diffusion des dépêches via un système informatique a pour conséquence que les clients
apportent une attention toute particulière au lead, qui est le seul élément qui apparaît sur
l'écran. La dépêche doit donc accrocher le regard du client dès les premiers mots. Les chefs
176 surnom donné par les agenciers au premier manuel à cause de son petit format et de la couleurrouge de sa couverture, en référence au recueil des pensées de Mao Ze Dong publié en 1966.177 Cette expression est employée de manière récurrente dans le second manuel de l'agencierstigmatisant la recherche de la concision, notamment en supprimant les incidentes, les métaphoresparticulièrement appréciées par les journalistes les plus anciens.
136
de desk vont donc insister sur là nécessité de rédiger des leads qui répondent aux critères fixés
par l'agence et stipulés dans les manuels. Un indice de l'importance grandissante accordée à
cette question : dans le premier manuel, les règles concernant la rédaction du lead
apparaissent à la page 48 du manuel (qui compte 93 pages), tandis que le second manuel traite
de la rédaction du lead dès la page 7 (le manuel compte pas moins de 227 pages). Les critères
concernent notamment la taille des leads qui est très limitée; le journaliste ne peut écrire un
lead de plus de trois lignes au risque que celui-ci ne soit tronqué.
L'informatisation des outils de rédaction des journalistes n'est pas le seul facteur qui induit
des transformations du style et de l'écriture des agenciers. En effet, l'agence ressent
davantage le poids de la concurrence. L'agence réalise que l'écriture est un enjeu commercial
et que ce qui était exigé des agenciers dans ce domaine dans les années cinquante et soixante
(le style littéraire du grand reportage) est différent de ce que les médias attendent aujourd'hui
comme écriture. Ainsi, les médias ne souhaitent pas nécessairement retrouver dans les
dépêches de l'agence leur propre style d'écriture. Cela est notamment visible en matière
d'information internationale, où ils disposent de leurs propres grands reporters, contrairement
aux années d'après-guerre. En conséquence, les médias vont exiger de moins en moins de
grands reportages.
Section 3. Homogénéisation et normalisation de l'écriture agencière
La spécialisation de la copie nécessite que l'écriture des journalistes de l'AFP réponde aux
mêmes critères en tous points du globe. En effet, face à un même événement, les journalistes
de l'agence vont publier plusieurs types de dépêches, chacune étant adaptée à une aire
géographique ou à une population particulières. Nous pouvons supposer que la déclinaison
d'une même information dans plusieurs types de dépêches multiplie les risques que cette
information varie d'une dépêche à l'autre. La spécialisation de la dépêche en fonction de la
clientèle visée nécessite donc que l'écriture des journalistes de l'AFP réponde aux mêmes
critères en tous points du globe et conduit donc à une homogénéisation de l'écriture au sein
des bureaux de l'AFP. Cette homogénéisation de l'écriture constitue un argument commercial
dans la mesure où l'agence peut se vanter de proposer une copie d'une qualité égale en tous
points du monde.
137
En 2004, un nouveau manuel de l'agencier est publié. Moins long que le précédent, il se
distingue par l'importance accordée à la définition des papiers à attribut ainsi qu'au contrôle
et à la relecture de la copie, notamment par l'action du service Alerte et Analyse et par les
notes qui proviennent de la rédaction centrale et des rédactions générales. Les transformations
de l'écriture se traduisent notamment par l'adoption d'un style journalistique proche du
modèle anglo-saxon, une écriture qui s'inscrit dans une démarche commerciale à travers la
rédaction du lead, la recherche de la concision des dépêches et une adaptation notable de la
copie au public visé.
3.1 Adoption d'un style d'écriture anglo-saxon
L'AFP a concentré ses efforts sur les services en anglais, notamment en recrutant un grand
nombre de journalistes anglo-saxons. En 1999, la direction de l'agence place à la rédaction en
chef générale, Eric Wishart, premier anglophone occupant ce poste. Cette nomination a crée
des remous parmi les journalistes de l'agence, certains anciens journalistes interrogés s'en
sont fait l'écho. Par ailleurs, l'agence exige des journalistes rédigeant en français ou dans une
autre langue qu'ils adoptent un style d'écriture qui se rapproche de l'écriture anglo-saxonne.
« L'écriture s'est internationalisée, on s'est calé sur une écriture plus sèche inspirée du monde
anglo-saxon, un découpage plus nerveux en termes de paragraphes. »
Un jeune correspondant étranger, de mère anglophone et de père francophone, témoigne des
différences qu'il ressent dans la pratique et l'écriture journalistiques à l'anglo-saxonne et à la
française :
J'aime pouvoir être un journaliste typiquement anglo-saxon, plus agressif dans une
conférence de presse, cuisiner la personne, pour soutirer l'info. Et parfois j'aime être
un peu plus impressionniste dans ma démarche, on n 'a parfois pas envie de parler, se
laisser porter par son instinct.
138
Si certains journalistes évoquent l'internationalisation de l'écriture, la majorité d'entre eux
considèrent que l'écriture de l'AFP tend à devenir similaire à celle de Reuters ou d'Associated
Press, les deux agences concurrentes anglo-saxonnes.
Bien qu'elle se présente comme une agence d'information internationale, l'AFP a depuis sa
création, été perçue comme une agence française à vocation internationale. Cette dimension
était particulièrement ressentie à travers le style d'écriture de l'AFP, plus littéraire, au
vocabulaire élargi et avec des phrases plus longues comportant de nombreuses incidentes.
Cette spécificité de l'écriture, qui propose un autre traitement que celui fourni par les autres
agences d'information internationales, exclusivement anglo-saxonnes, a permis à l'AFP de
s'octroyer un certain nombre de clients intéressés par une écriture et par un traitement de
l'information sensiblement différents, comme c'est le cas notamment des clients européens et
ceux d'Amérique Latine.
Cependant, l'intensification de la concurrence et la multiplication du nombre de médias
traitant l'information en temps réel et sur un plan mondial ont limité la possibilité pour
l'agence de s'attacher de nouveaux clients. Par ailleurs, le marché mondial de l'information
étant dominé par la langue anglaise (langue du secteur économique et des finances, et de la
première puissance économique et politique mondiale), la stratégie de l'AFP consiste à offrir
des services de langue anglaise afin de concurrencer les autres agences sur leur propre terrain
et d'élargir son nombre de clients potentiels. Dans un contexte où l'offre doit répondre de
manière pointue aux demandes des clients, l'AFP ne peut se contenter d'adapter ses services
en français aux clients anglophones et étrangers; elle doit disposer d'équipes rédactionnelles
anglophones et étrangères. Les impératifs commerciaux ont donc conduit l'agence à recruter
des journalistes anglophones. En Asie, où l'AFP détient une position avantageuse, et où les
revenus générés par ses services sont importants, la copie de l'AFP est délivrée à 90% en
anglais ; en Europe, plus de la moitié de la copie de l'AFP est distribuée en anglais.17 Mais le
changement de style n'est pas seulement dicté par des préoccupations commerciales (percer le
marché anglo-saxon), mais aussi par un souci d'efficacité de la communication. Les
journalistes de l'AFP considèrent en effet que la langue anglaise permet d'écrire de manière
! Chiffres fournis par Robert Holloway, journaliste à l'AFP.
139
plus concise, plus directe, plus agressive et que les rédacteurs de langue française devraient
s'en inspirer, notamment en ce qui concerne la rédaction des leads.
3.2 Le style d'écriture comme outil d'offensive commerciale
3.2.1 Évolution du lead179
Les agenciers ont toujours exercé leur métier dans un contexte de grande concurrence.
Toutefois, entre 1945 et aujourd'hui la concurrence s'est complexifiée : les concurrents et les
supports sont plus nombreux, la concurrence devient plus intense et les journalistes ont
progressivement intériorisé cette nouvelle donne. Leur écriture est conditionnée par la
concurrence et cela se traduit notamment par un style de plus en plus offensif.
Dans la composition de la dépêche, le lead'80 a toujours constitué la « vitrine » du texte
journalistique agencier comme le souligne Michael Palmer.
Tout se joue lors des premiers mots. Premiers mots du titre, premiers mots du
paragraphe, et premiers mots de la phrase d'ouverture, l'accroche, le « lead ».
Comment faire pour capter l'attention du lecteur pressé et sollicité (par la
concurrence notamment) ? Rédigé pour être vu/lu à l'écran, pour l'usager 'cliqueur '
et 'zappeur ', le titre doit tenir en 50 ou 80 signes, et le lead ne doit pas dépasser les1 R1
vingt a trente mots.
De plus, comme nous l'avons souligné dans la section précédente, l'introduction de
l'informatique et donc de la visualisation des fils à l'écran a accru l'importance du lead. Le
lead est ce qui va déterminer le choix du client de retenir ou non la dépêche. L'intensification
de la concurrence entre les agences conduit celles-ci à porter un intérêt toujours plus vif à la
179 Le lead se traduit par « chapô » en français.180 Le lead est le développement naturel de l'urgent. Il commence à préciser l'information donnée etcomporte quelques éléments de background afin d'en renforcer la compréhension.181 Palmer, Michael, « L'information agencée », Réseaux n° 75, Paris, janvier 1996.
140
rédaction du lead de manière à lui faire jouer efficacement son rôle de captation d'attention.
Au cours de notre enquête de terrain, le directeur du bureau a entrepris d'enseigner aux quatre
stagiaires l'art de rédiger un lead. Durant cette séance, le directeur souligne que le style du
lead a évolué, quittant un style littéraire pour adopter un style plus sobre et direct.
On a beaucoup évolué sur la définition du lead. Le lead c 'est un factuel plutôt qu 'une
appréciation. A un moment donné, on était encore dans le journalisme du bon mot,
littéraire, le lead était le moment où on allait placer le bon mot comme « bras de fer »
par exemple. Aujourd'hui l'expression « bras de fer » est prohibée. C'est de la jolie
littérature pour dire qu 'on connaît bien le français, c 'est comme le gothique
flamboyant dans les églises.
Pour ce journaliste âgé d'une soixantaine d'années, le lead tel qu'il était rédigé autrefois,
était l'occasion pour le journaliste de « faire de la jolie littérature », c'est-à-dire le lieu de
toutes les prouesses littéraires. Aujourd'hui la «bataille du lead» ne se joue plus sur un
« bon mot » mais sur sa pugnacité.
Aujourd'hui on est dans le factuel, dans le coup de poing [il accompagne ses mots par
le geste, comme s'il donnait par trois fois un coup de poing dans la paume de sa main],
il faut aller directement aux faits, c 'est une façon de réveiller les gens, le mot « refus »
ça frappe, les périphrases ça ne frappe pas. Il faut les rendre plus nerveux (...) Il faut
que le lead soit le plus concis possible, qu 'il frappe les gens.
Le discours que tient le journaliste aux stagiaires se caractérise par un champ lexical de la
lutte : plusieurs luttes se superposent, celle menée par le journaliste contre les tentations
d'emprunter un style littéraire et celle contre les concurrents pour accrocher le lecteur.
3.2.2 La recherche de la concision
Le lead à lui seul ne suffit pas à se distinguer de la concurrence, l'accent est mis également
sur le découpage de la copie notamment afin de rendre la dépêche plus dynamique.
141
« L'écriture s'est internationalisée, on s'est calé sur une écriture plus sèche inspirée du
monde anglo-saxon, un découpage plus nerveux en termes de paragraphes. Les papiers sont
plus courts, simplement rédigés. »
Une des qualités qu'accordent certains journalistes à l'écriture journalistique anglo-saxonne
est la concision. Les agenciers tendent à adopter un style plus proche de ceux de leurs
concurrents anglo-saxons. Le style anglo-saxon est ainsi présenté par certains journalistes
comme un modèle à l'instar du directeur du bureau du Caire :
Moi j'aime bien le lead en anglais.(...) L'anglais se prête davantage à la concision. En
français, il faut faire davantage attention. Au point de vue de la rigueur, on a
beaucoup à apprendre dans la section francophone de la section anglaise. La
tendance chez nous, francophones, c'est de diluer les choses là où il faut les
concentrer. La rigueur qui est imposée dans les sections anglaises de l'AFP, c 'est
essentiel, (...) mais une partie du personnel continue d'être 'old school', des vieux
turbans.
La rédaction centrale de l'agence encourage les journalistes dans cette voie, une analyse des
dépêches des services de production parisiens, réalisée par l'AFP de septembre à novembre
2002, montre que :
Des efforts notables ont été faits dans les services sur le découpage de la copie. Mais
il reste encore beaucoup de P4 [des dépêches de niveau d'urgence P4 c'est-à-dire non
urgentes] trop longs qui auraient mérité un découpage plus dynamique en P3 + lead
correspondant mieux à l'importance de l'information traitée.
182 ASAP (réseau intranet de l'AFP), «Rédaction en chef: notes rédactionnelles, amélioration du filFrance », 24/02/03. L'agence a instauré quatre niveaux de priorité dans la transmission des dépêches,PI, P2, P3, P4. Le niveau PI constitue le niveau le plus urgent, le niveau P4 constitue le niveaud'urgence le plus bas.
142
Nous constatons que l'agence multiplie les procédures afin que l'activité des journalistes soit
guidée par la captation de l'attention de la clientèle. L'écriture est plus offensive, et la
spécialisation de la dépêche en fonction du public visé est généralisée.
3.3 Spécialisation linguistique et ^localisation de l'information
Jusqu'au milieu des années quatre-vingt, les journalistes envoyaient leur copie aux services de
traduction de l'agence. Dans un grand nombre de bureaux à l'étranger, les journalistes locaux
étaient les seuls à rédiger dans la langue du pays lorsque le journaliste, très souvent
français183, ne la maîtrisait pas. Il n'était pas rare en effet qu'un journaliste français soit
envoyé comme directeur du bureau sans maîtriser la langue du pays ; aujourd'hui, cette
situation est moins courante. Les journalistes locaux ne sont donc plus les seuls à maîtriser la
langue locale et à être responsable de la rédaction des dépêches dans cette langue.
Par ailleurs, la population des journalistes des bureaux s'est profondément diversifiée;
l'agence recrute davantage de journalistes non francophones, par conséquent les bureaux
étrangers produisent des dépêches dans un plus grand nombre de langues qu'auparavant. Le
bureau du Caire par exemple diffuse des dépêches en trois langues (français, anglais et arabe).
Quant au bureau de Moscou, il regroupe des journalistes français, anglais, russes, allemands et
espagnols. Si nécessaire, les bureaux à l'étranger font appel ponctuellement aux bureaux de
traduction du siège. Par ailleurs, les agenciers maîtrisent généralement plusieurs langues, la
maîtrise de deux langues étrangères au moins constituant une condition sine qua non pour
valider les tests de recrutement de l'agence.
183 Dans l'enquête réalisée par Oliver Boyd Barrett et Michael Palmer et rapportée dans leur ouvrage,« Trafic des Nouvelles », les deux auteurs soulignaient que sur les 17 bureaux étrangers de l'AFPqu'ils avaient visité, 12 des bureaux étaient dirigés par des Français (In Boyd Barrett, Oliver, Palmer,Michael, Trafic de Nouvelles, Paris, 1981, page 576).
143
Lorsque l'AFP dispose d'un nombre de journalistes suffisant dans un bureau à l'étranger, les
journalistes peuvent se spécialiser dans une langue de rédaction, souvent leur langue
maternelle. Ainsi, et paradoxalement, les agenciers qui exercent à l'étranger sont de plus en
plus amenés à rédiger dans une seule et même langue. Si l'AFP exige du rédacteur qu'il
maîtrise parfaitement la langue dans laquelle il rédige, il doit par ailleurs avoir une grande
connaissance de la culture des pays ou des régions pour lesquels ses textes sont destinés. C'est
pourquoi, il peut arriver qu'un journaliste soit amené à se spécialiser dans une langue qui
n'est pas sa langue maternelle; sa connaissance du public et du pays visé le prédestine à
rédiger dans une langue plutôt que dans une autre. Aujourd'hui, l'agence recrute de plus en
plus de journalistes qui ont non seulement une connaissance de la langue mais une
connaissance du public visé. Ainsi, au Caire, une journaliste française rédige exclusivement
en anglais; elle a en effet exercé dans plusieurs publications américaines appartenant au
groupe The Economist et elle a vécu plusieurs années aux États-Unis; ses différentes
expériences laissent supposer à ses supérieurs qu'elle dispose d'une connaissance privilégiée
de la culture et des mentalités du public anglo-saxon auquel le bureau du Caire est susceptible
de s'adresser. Cet atout ne se limite pas à une connaissance savante et abstraite de la société,
de l'histoire du pays, de ses institutions, mais à des aspects impalpables de la société qui
permettent au journaliste d'instaurer une relation de connivence avec le lecteur dans ses
dépêches. « Tu connais ton public par ton background culturel mais tu as aussi une
sensibilité, ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer. »
Le traitement linguistique de la copie a évolué au point qu'aujourd'hui il est difficile de parler
uniquement en termes de traduction ou de « rewriting » de la copie agencière. Autrefois, on
procédait à la traduction de la copie, rendant si possible l'événement relaté intéressant aux
yeux du public visé, en suivant les règles de proxémique, mais cela était loin de satisfaire les
journalistes voire les clients, comme en témoigne Eric Wishart, journaliste anglophone à
l'AFP et ancien directeur de la rédaction en chef :
(En 1984), j'ai rédigé des reportages en français et on m'a demandé d'en écrire la
version en anglais. Pas une traduction mot à mot, qui pour un traducteur signifierait
une mauvaise traduction. Nous prenions en notes le reportage en français et nous
écrivions une version anglaise. Dans le service anglais évidemment nous n'avions pas
le même réseau que les journalistes français, et il y avait davantage de journalistes
144
français bien qu'il y avait les journalistes anglais, ainsi nous avons dû traduire assez
rapidement. Le service français pensait que c'était une bonne idée que le service
anglais se charge de la traduction du français, mais rapidement nous avons constaté
que c'était loin d'être satisfaisant. Les journalistes qui s'en chargeaient avaient certes
des compétences linguistiques mais ils n'étaient pas des traducteurs professionnels.
Très souvent les textes ressemblaient à de mauvaises traductions. Nous avions
également de temps en temps des erreurs de traduction (...) . '84
La nécessité de capter un public qui dispose d'une offre informationnelle extrêmement large
conduit l'agence à ne plus se contenter de traduire la dépêche. Les journalistes tendent à
personnaliser l'information diffusée dans la copie de l'agence, notamment en organisant la
copie différemment; la hiérarchie des éléments peut changer, le lead peut varier, des
informations peuvent être ajoutées. La conversion d'une langue à l'autre a parfois des
conséquences sur le traitement de l'information, comme le souligne Eric Wishart, qui était à
la tête de la rédaction en chef générale au moment de son intervention :
Je pense que sur le fil d'informations générales de l'AFP, nous publions chaque jour
environ 350,000 mots (...) ainsi si vous multipliez cela par six services auxquels
s'ajoutent les fils spécifiques, nous avons des millions de mots qui circulent autour du
monde quotidiennement dans un flux constant de traduction. Nous pouvons dire que
nous sommes multilingues, multiculturels - nous sommes un melting pot, et
certainement pas la voix de la France. Un journaliste arabe couvrant Feluja ne
travaillera pas de la même manière qu'un journaliste américain. La question de la
184 The Languages of Global News, symposium, University of Warwick, 23 Avril 2004. Disponiblesur : <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/activitiesnews/workshops/2004ws/language/>(consulté le 12.05.05), page 1 : «(In 1984), I was given news stories in French and asked to writeEnglish versions of them. Not word by word translations, which for someone who knows translationwould mean a bad translation. Basically, we 'd take the French story as rough notes and we 'd write anEnglish version. In the English service obviously we didn 't hâve the same network as the Frenchjournalists did, and there were far more French journalists than there were English journalists, so wehad to translate pretty quickly. The French felt it was a good idea that the English service consisted oftranslation from French, but pretty soon we saw that it really was not satisfactory. The journalists whodid it had language skills but were not professional translators. Quite often the stories looked like badtranslations. We also occasionally had translation errors » (traduction réalisée par l'auteur).
145
traduction révèle des différences culturelles essentielles dans le traitement de
l'information.^
Le background dont disposent les journalistes est déterminant dans la rédaction de la copie,
c'est leur connaissance du pays qui va leur permettre d'adapter la copie au public visé.
Au moment où tu rédiges, tu sais que ça, il faut que tu l'expliques pour ton lecteur
anglais, et tu vas mettre deux phrases, c'est dans les gênes. Dans la mesure où tu as un
public anglophone, tu peux dire que pour qu'il comprenne cette nuance, il faut que tu
fasses un petit rappel.
L'adaptation de la dépêche au public donne une valeur ajoutée aux informations diffusées par
l'agence dans la mesure où elle accroît l'intérêt, la pertinence de l'information pour le public
auquel s'adresse le client. Par ailleurs, elle diminue le coût de traitement de l'information que
le client devrait consentir s'il devait lui-même adapter la copie pour son public. Afin
d'illustrer notre propos, nous avons procédé à l'analyse comparative de trois dépêches traitant
du même événement : les manifestations des Frères Musulmans en Egypte le 27 mars 2005, et
diffusées à quelques minutes d'intervalle. Les dépêches, en arabe, en français et en anglais,
ont été rédigées par trois journalistes distincts du bureau.
185 The Languages of Global News, symposium, University of Warwick, 23 Avril 2004. Disponiblesur : <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/activitiesnews/workshops/2004ws/language/>(consulté le 12.05.05), page 2. : « / think on gênerai AFP news wire we probably run every day about350.000 words (...) so if y ou multiply that by six services plus différent targeted wires we hâvemillions words moving around the world every day in a constant spate of translation. We can say thatwe are multilingual, multicultural - we're melting pot, so certainly not the voice of France. An Arabiewriter reporting from Feluja is not going to work the same way as an American. The translationaspect really shows up quite important cultural différences in the treatment of news ». (traductionréalisée par l'auteur).
146
Dépêche en arabe
RLR99 NIC 0103 ARA.ARG G EMI 270305-16h34 WÛ243
Û L j L a I / a jA I "'*•/ j j—J-tJ-uiI / )"** *
y_3 £5 J I J^aJ I ,j j_j Là *. U J LJ U J LLJ j \ A 11 n A \ I j I jà»V I <£ Lia.
j l ySi\ Ac Lo. j ^ Le j - . û L U J I d j U i - ( u ù l ) r YY î > LUI
j j j U «. UJ L j M 1 LL« S jA LUI y i ia.1l I j»J-J-!l Cil jA Uâli Ù5LJ y i
L l L£ j Julj-a j LJ 1 U im-. L J J J I I U I J I û L^LiV I j-o X J J ^ J L j [ j j l ^L l l
je Ù jkJ I Ci Irt JUL.II Ji» "| y-J-ll » J j i i i - i J I j i A \\a A \\ j l j iV I ÀL. Lta. ÛLJ L£ j
U iùij-a j LaJ (_j-it (. L«_JJV I Clt J l jiSj j , i\ j-a Ifl j " * ' L (J_llu_j j Lj-j La LûJ
.I,H,..ULJI JHIK A j_Lo j» LtI " l J-LJS i jA LLJ" yJI Li i Le. (_j i _ji x*sm yJcKI
(.J j\ jJaJI j j _ j Lj { >j-5 .il ,'i < <û j 'i A A f j l JJJ-SI (_J-3 Cil jA 1 li") II j l y_ll j Lui-j
. \ *\ Al j> Le Cil J L J I j j_j I ^ j ' ' j 11 J Lpé I j j l Jus-a y j
l « <... tpàJ* ûJ l JAJ i^VI J>J-JJI CûLUI û l j» LklJl j - i i l ^ J télj L i j
5 j4 LLJI Jiuij j " j ' " j j l •) j « y_3 I (j j /iU \ < (_ima, (_àV I 4_L>LJJ û Ua_iuJI CljLJI
j l I J > L J j LS 'y-UI 4_lkj_<dl ijjj I Cil >5 j-a 4_LJ U j l X I ûJJé I j l A*_i
• j , ' j " ' i j ' j ^ j " ^ ' AJ< i (j—le S jA LLJJ I 1 { \ °\ ik_LJ
. a j L_« (. 'ii in ^ j«i <i 111
Ù j LJLJI ^y-le J 4 j <un j J I (J_j I i o.ll h \^ o _3 j j j ) 4 j i.nl û l j_jja_j Cl^iii") il j
û U L J I y j j i jA LUI Jauij yJ A_ij Lk j j_JI j 4_iij_i_«V I 0-pJ
. j-JjA Ih'i <i 11 jsXJLj j j û J j ^aJJ 'LU
j L t i LaA j i l i j j "a XJJJLJI "bk LUJ (j J_LJI U LJ y_J j l y±i I j I « » ' i l l
V • ' y j l Y«« j_LJ Lu j-AJjA UaJjJl y_3 (ilj Lùij <_J jua_x-J I <JHÛ Lx_ll y j
. Cj ' ** * '" ' I LJ J L à I I t\ \ 11\ "\ | y. -\ I**I
jua L e j«« j . ii.ii/i.-> j-> i ("i .lin,] I (ju-j I i1"' I «"'"•• I 4_j j i- i i 11 j jsV I Cl I j j CLJ LS J
. i jA UàJjJ I 4 ;ùi,r. U j J I j i j-o J jfr j ^ - i i j-c-J j i o Li o 11 j I j iV I <e LIA
147
traduction :
Egypte / Islamistes / Manifestations / réformes
Les frères musulmans en Egypte réclament l'annulation de la Loi d'urgence
Le Caire 27/3 (AFP)
Certains des éléments des frères musulmans ont participé aux trois manifestations
organisées ce dimanche, au Caire en réclamant l'annulation de la loi d'urgence et de
plus des réformes constitutionnelles, a affirmé l'Agence France - Presse.
La confrérie, interdite mais tolérée avait, en effet, appelé selon son chef supérieur
Mohamed Mahdi Akef à une grande manifestation devant l'assemblée du peuple pour
réclamer davantage de réformes politiques. Il faut signaler que les manifestations sont
interdites depuis l'application de la loi d'urgence, suite à l'assassinat du président
Sadaat en 1981. Les autorités sécuritaires ont affirmé qu'un millier de personnes
environ, ont participé à la plus grande manifestation, trois mille selon la confrérie.
Les manifestants se sont dirigés vers la place Ramsès, au centre-ville, soit à deux
kilomètres du siège du parlement, après le blocage de la route devant eux opéré par la
police. Les manifestants, pour leur part, ont demandé l'annulation de la loi d'urgence
en protestant contre l'immixtion américaine dans les affaires intérieures. D'ailleurs,
ils ont réclamé plus de réformes constitutionnelles proposées par le président
Moubarak. De grands dispositifs sécuritaires sont stationnés autour des sièges officiels
de la capitale et à côté des ambassades des États-Unis et de la Grande Bretagne afin
d'empêcher le passage des manifestants. Les deux autres regroupements ont eu lieu à
Bab El Louk et à la place d'El Sayeda Zeinab, deux quartiers populaires du Caire.
Selon les autorités, les manifestants étaient environ 200 à 300 personnes dans chacun
des quartiers.
Les forces d'ordre égyptiennes ont arrêté samedi, la veille des manifestations, environ
cinquante membres de la confrérie dont certains cadres.
148
Dépêche en français
3RLR27 PAR 0148MOA I EMI 27O3O5-15H3O wO349Egypte - islamistes
manifestations - réformes
Egypte : manifestation des Frères musulmans pour la levée de l'état d'urgence
LE CAIRE, 27 mars (AFP) - Plusieurs centaines de membres des Frères musulmans
ont participé dimanche à trois manifestations au Caire pour demander la levée de l'état
d'urgence et des réformes constitutionnelles, selon des journalistes de
l'AFP.Mouvement interdit mais toléré par les autorités, les Frères musulmans avaient
appelé publiquement mercredi, par la voix de leur guide suprême Mohamed Mahdi
Akef à une « grande manifestation » devant le siège de l'Assemblée du peuple. Les
manifestations de rue sont interdites en Egypte, au titre de l'état d'urgence en vigueur
depuis l'assassinat du président Anouar el Sadate en 1981. La plus importante des trois
manifestations de dimanche, comptant un millier de personnes, selon les autorités, et
3000 selon les organisateurs, s'est déroulée place Ramsès, dans le centre de la
capitale, après avoir été détournée par un impressionnant cordon de policiers du siège
de l'Assemblée du peuple où elle devait initialement avoir lieu à environ deux
kilomètres.
« Abrogez l'état d'urgence », criaient notamment les manifestants, qui demandaient
aussi de « s'opposer aux immixtions américaines » dans les affaires intérieures de
l'Egypte et réclamaient une « extension des réformes constitutionnelles » proposés par
le président égyptien Hosni Moubarak. Des cordons de plusieurs milliers de policiers
ont été disposés autour des bâtiments officiels et aux abords des ambassades
américaine et britannique dans le centre du Caire, ou en carrés compacts sur les places
publiques pour bloquer toute avance des manifestants.
Les deux autres rassemblements ont eu lieu à Bab El-Louq et à Sayyeda Zeinab, deux
quartiers populaires de la capitale égyptienne. Ils ont réuni entre deux et trois cents
personnes chacun, selon les autorités. Les forces de sécurité égyptiennes avaient arrêté
préventivement samedi une cinquantaine de membres de la confrérie, dont les cadres,
à la veille de ces manifestations. Hz/lr/mj
149
Dépêche en anglais 3RLO67 PAR 0270 EAA I EMI 270305-14H48 wO412
Egypt-Islamist, RPT265 Egypt's Muslim Brotherhood holds pro-reform rallies despites arrests
ATTENTION-INCORPORATES -arrest séries///
I^AIRO, March 27 (AFP) - Several thousand membres of the banned Muslim Brotherhood
ook part in restrictive emergency laws.
The main démonstration, consisting of 1.000 people according to authorities and 3.000
according to organisers, took place on the central Ramses Square after tight security measures
prevented them getting to parliament. The two other gatherings, involving 200 to 300 people
ach, took place in the central Bab el -Luk and Sayyeda Zeinab districts, authorities said.
Street démonstrations are banned in Egypt thanks to emergency laws that hâve been in place
since président Anwar al- Sadat's assassination in 1981.
"End the state of emergency " demonstrators shouted, calling also for "opposition to
American interférence " in Egyptian affairs and "more constitutional reforms ".
Last month, US Président George W. Bush used his State of the Union address to call for
démocratie reforms in Egypt.
The great and proud nation of Egypt, which showed the way toward peace in the Middle
East, can now show the way towarddemocracy in the Middle East", Bush said.
Brotherhood leader Mohammed Mahdi Akef called for the démonstration last week during a
press conférence on constitutional reforms put forward by Président Hosni Mubarak that will,
in theory, allow a degree of choice for voters in presidential élections due to be held later this
year.
Mubarak is currently serving his fourth uncontested term as président.
Several thousand police were deployed around gouvernment building in the capital as well as
the US and British embassies. Egyptian security forces regularly detain members of the
generally tolerated Brotherhood, which constitutes the main opposition to Mubarak 's ruling
National Démocratie Party, although members are required to sit in parliament as
independents. Lr-hz/cj o/kir
150
La dépêche en arabe se différencie des deux autres dépêches en nommant le président
égyptien par son seul nom, ce qui s'explique notamment par le fait que le journaliste traite
d'un personnage connu du monde arabe, Hosni Moubarak. Elle adopte un ton beaucoup plus
sobre que les deux autres dépêches, notamment en remplaçant le cri des manifestants :
«remplacez l'état d'urgence» par « les manifestants, pour leur part, ont demandé
l'annulation de la loi d'urgence en protestant ». Le texte ne comporte pas de citations directes,
mais rapporte au discours indirect des paroles tenues par les principaux protagonistes, donnant
au texte journalistique un ton moins dynamique. Notre connaissance limitée de la langue
arabe ne nous permet pas d'avancer une explication linguistique à la sobriété du ton, toutefois
le contexte politique pourrait expliquer en partie les précautions avec lesquelles le journaliste
relate les événements. Les organes de presse, l'AFP y compris, font l'objet d'une surveillance
étroite de la part du pouvoir égyptien qui nous laisse penser que les journalistes de l'AFP
ajustent le style, la formulation sans modifier le récit de l'événement. Rappelons que, dans un
pays comme l'Egypte, les journalistes d'agence ont des contraintes que n'ont pas les
journalistes d'autres organes de presse étrangers. En effet, un envoyé spécial qui couvre une
région du monde peut écrire ses articles sans entrave aucune dès qu'il quitte le pays; en
revanche, un correspondant d'agence qui demeure dans le pays doit, quant à lui, tenir compte
du contexte politique du pays qu'il couvre et des risques qu'il encourt en le faisant. En effet,
en tenant des propos qui froissent le pouvoir politique, il prend le risque d'être interdit
d'exercer voire d'être expulsé. Un correspondant étranger de l'AFP en Egypte précise :
En Egypte, il y a un certain nombre de restrictions sur la liberté d'expression, L 'AFP
a un bureau dans chaque région du monde, on est là et c 'est important qu 'on y reste.
Alors parfois, on est obligé défaire certaines concessions aux autorités pour pouvoir
rester. En Libye, par exemple, on ne peut pas écrire n 'importe quoi, car on aura
besoin d'y retourner. On doit un service minimum au client et on se doit d'y retourner.
Un hebdomadaire français peut se permettre d'envoyer un reporter qui ne va rien
écrire pendant la semaine où il sera en Libye, mais qui va rentrer ensuite écrire son
papier, s'il le veut au vitriol, sur le régime libyen. Il ne remettra jamais plus les pieds
en Libye, mais il fera un papier qu 'il aura jugé honnête.
Or, une agence de presse de taille mondiale dont l'objectif est de couvrir le plus grand espace
possible, ne peut prendre le risque de devoir fermer un bureau. Bien que les journalistes soient
151
réticents à évoquer cette difficulté dans l'exercice de leur métier à l'étranger, l'interdiction
d'exercer dont faisait l'objet le photographe de l'AFP à notre arrivée au Caire nous confirme
l'importance de cette contrainte.
L'activité journalistique est sous surveillance dans les pays où la liberté de la presse est
bafouée ou lorsque le journaliste couvre une région conflictuelle. « Tous les jours, on a un
ange gardien de la sécurité de l'Etat. Régulièrement, il vient nous dire bonjour. Gaymard
était là, il avait rendez-vous avec moi et d'autres journalistes, il nous a suivis jusque dans la
salle de conférence, il a fallu que l'ambassadeur le raccompagne gentiment par le bras pour
que les journalistes français puissent discuter tranquillement avec le ministre ». Cela peut
aboutir à des interdictions d'exercer comme c'est le cas pour le photographe du Bureau du
Caire, qui ne peut plus exercer jusqu'à nouvel ordre sous prétexte qu'il a pris une photo jugée
tendancieuse par le pouvoir. L'aspect tendancieux de la photo résiderait dans la position du
pied du ministre français qui est dirigé vers la tête du président Hosni Moubarak.
152
Dans la dépêche en anglais, les données chiffrées interviennent très tôt dans la dépêche, dès la
troisième ligne, «1.000 people according to authorities and 3.000», alors que dans les
dépêches en arabe et en français, il faut atteindre la moitié de la dépêche pour obtenir le
nombre de manifestants.
Les citations sont nombreuses dans la dépêche en anglais, une citation supplémentaire du chef
des Frères Musulmans est ajoutée dans la dépêche : « Brotherhood leader Mohammed Mahdi
Akef called for the démonstration last week during a press conférence on constitutional
reforms put forward by Président Hosni Mubarak that will ». Les citations rendent le texte
journalistique plus vivant, plus dynamique et confirme le jugement que les journalistes portent
sur la copie anglophone, c'est-à-dire une copie particulièrement « percutante » pour reprendre
les termes employés par les journalistes que nous avons rencontrés.
L'effort de contextualisation est particulièrement important dans la dépêche en anglais, le
journaliste relie l'événement au contexte américain notamment au positionnement du
président américain face à la situation égyptienne, « Last month, US Président George W.
Bush used his State ofthe Union address to callfor démocratie reforms in Egypt. "The great
andproud nation of Egypt, which showed the way toward peace in the Middle East, can now
show the way toward democracy in the Middle East", Bush said». Cela s'explique
notamment par les relations politiques et économiques qui lient l'Egypte aux États-Unis' .
Les journalistes suivent la loi de la proxémique de l'information, ce qui les conduit à montrer
la pertinence de l'information étrangère pour les publics locaux. Ici, il leur faut donc montrer
au public américain qu'une affaire interne à l'Egypte concerne les Américains. L'adaptation
des dépêches consiste à faire jouer la loi de la proxémique en accentuant la portée locale de
l'information pour accroître son intérêt.
Autre point de distinction de la dépêche anglophone, seul le journaliste qui a rédigé en anglais
éprouve le besoin de préciser qui sont les protagonistes, les Frères Musulmans,
« Brotherhood, which constitutes the main opposition to Mubarak 's ruling National
Démocratie Party, although members are required to sit in parliament as independents ».
186 Les États-Unis et l'Egypte entretiennent depuis 1970 des relations stabilisées sur les planséconomiques (les États-Unis versent une aide de 2 milliards), politiques et militaires afin d'assurer lastabilité du Moyen-Orient.
153
La dépêche en arabe et la dépêche en français sont construites sur un modèle relativement
similaire, honnis l'emploi du discours indirect pour la première en remplacement des
citations. La dépêche en anglais est sensiblement plus longue que les autres dépêches (412
mots), tandis que la dépêche en français comporte 349 mots et la dépêche en arabe, 248 mots;
elle comporte davantage de citations et d'éléments visant à contextualiser l'événement et à le
relier aux intérêts des Américains. Cela est notamment visible lorsque le journaliste précise la
position de Georges Bush sur l'événement.
L'examen de ces dépêches souligne que la hiérarchisation des informations varie d'une
dépêche à l'autre. Les différences de traitement que l'on observe entre les dépêches dépassent
les exigences de la proxémique; les journalistes procèdent en effet à une véritable adaptation
de la copie. Cette adaptation participe à un mouvement de « glocalisation » de l'information.
Le processus de glocalisation peut être résumé comme la coexistence entre deux mouvements
en apparence contraire : la globalisation et la localisation. La glocalisation correspond en
somme à l'interpénétration du local dans le global. En matière d'information internationale,
cela signifie que la multiplication des sources et un contexte d'hyper concurrence ne
favorisent pas nécessairement la «mise en globalisation» de l'information, c'est-à-dire la
diffusion d'une information universelle destinée à une communauté mondiale, mais au
contraire l'ancrage de l'information internationale et de son traitement dans la culture locale
du public visé. Ce concept met en évidence le rapport entre la diffusion globalisée par les
médias et l'appropriation localisée de l'information.
La spécificité de l'AFP par rapport aux autres agences de presse est de produire toutes ses
dépêches dans une grande variété de langues. L'agence Associated Press produit des dépêches
en moins de langues, et essentiellement en anglais, langue de son public captif. Certains
journalistes considèrent que cette volonté de glocaliser l'information entraîne un surcroît de
travail, voire une perte de temps, qui les empêche de concurrencer les autres agences, comme
en témoigne ici cette correspondante située au Caire :
On produit en deux langues. On produit en anglais, en français, et tout le monde est
producteur et traducteur. Moi je produis une dépêche, Hassan va la traduire. Il y a
une déperdition de temps et d'énergie parce qu 'il faut toujours doubler. Même si on
est un bon traducteur et très rapide, il y a une déperdition de temps parce que l'on fait
tout en double. Si je prends l'exemple de Bagdad, AP pour le même staff peut produire
154
deux fois plus puisqu 'ils ne traduisent rien. Quand ils ont fini leurs dépêches en
anglais, c'est fini ils passent à la prochaine, ils n'ont pas les dépêches des autres à
traduire. On a plus de travail de desk à faire pour que la copie soit systématiquement
en deux langues.
Cette démarche d'adaptation aux spécificités linguistiques et culturelles des clients s'inscrit
dans un contexte de concurrence accrue entre les agences. En faisant ce choix, l'AFP espère
ainsi faire face à ses concurrents anglo-saxons (AP et Reuters)187 qui disposent d'une clientèle
anglophone bien plus importante que la clientèle francophone mondiale. L'AFP se présente
comme une agence européenne qui fournirait une information adaptée non seulement aux
différentes communautés linguistiques de l'Europe élargie mais également au reste du monde.
3.4 Personnalisation de la copie : l'accroissement de la dépêche signée
L'anonymat a constitué pendant longtemps l'une des caractéristiques essentielles de l'activité
du journaliste agencier mais cette caractéristique tend à disparaître. Les rédacteurs en chef
comme les journalistes justifient l'accroissement de la signature par la multiplication des
dépêches hors factuels et des papiers à attribut. En effet, les hors factuels font appel à une plus
grande subjectivité du journaliste dans son rapport au réel, un plus grand engagement de sa
part dans l'analyse et l'interprétation des événements; la signature est une reconnaissance de
cette subjectivité.
Par ailleurs, dans le journalisme contemporain, il y a une plus grande reconnaissance, voire
une valorisation de la subjectivité, de sorte qu'un papier signé paraît avoir une plus grande
valeur et présenter un plus grand intérêt qu'un papier non signé. L'absence de signature qui
était autrefois un garant de l'objectivité du journaliste, dénote davantage aujourd'hui un
désengagement du locuteur.
187 Ce contre positionnement n'est pas nouveau, il s'inscrivait déjà dans le projet initial de la créationde l'AFP.
155
Le directeur du bureau de Moscou confirme cette valorisation de la signature du point de vue
des clients :
II y a un aspect purement marketing; on dit qu 'un papier signé, ça attire davantage le
journal. Même le lecteur dans une salle de rédaction, qui voit le papier signé, a plus
envie de le lire pensant que la rédaction est plus individuelle, qu 'il y a quelque chose
de plus. Chez les Anglais, c'est la règle : pour que nos papiers soient repris il faut
signer.
Les journalistes estiment donc que la signature est un argument commercial; elle répondrait à
une demande des clients qui souhaitent reprendre les dépêches dans leur forme d'origine. Une
dépêche signée attirerait davantage l'attention du client qu'une dépêche anonyme. La
signature est aussi un outil de distinction dans un système très concurrentiel. La signature
personnalise en effet le rapport non seulement au lecteur mais aussi au client, c'est-à-dire au
média qui va choisir de publier ou non les dépêches. Elle permettrait aux clients de se
familiariser avec le travail de certains agenciers et, par conséquent, d'être enclins à reprendre
les dépêches d'un journaliste dont ils apprécient le travail. C'est pourquoi la pratique de la
signature est encouragée par le dernier manuel de l'agencier qui précise « la signature des
papiers doit être développée. Elle met en valeur notre production auprès de nos clients. »'
Finalement, du point de vue de l'agence et plus particulièrement pour les directeurs de bureau,
la signature constitue un outil particulièrement efficace de valorisation et de motivation des
journalistes. La signature agit comme un marqueur de compétence, comme le confirme le
directeur du bureau de Moscou : « Signer un papier ça motive les journalistes. J'ai à gérer un
certain nombre de journalistes, je sais bien que la perspective de faire un papier signé ça
l'incite à mettre plus d'efforts dans la préparation du papier. » Bien que le manuel de
l'agencier prenne soin de préciser que « la signature n 'est en aucun cas une récompense, et
son absence une punition attribuée à un producteur »189, elle reste pour certains journalistes,
un moyen de se faire connaître à l'extérieur de l'agence et reconnaître en son sein.
188 ^pp^ Manuei fa l'agencier, 2004, page 67.189 AFP , Manuel de l'agencier, 2004.
156
La direction a adopté une position officielle à propos de la signature des dépêches en
proposant, dans le dernier manuel, une codification des papiers en fonction de la présence ou
de l'absence de signature. Celui-ci comporte un tableau190 répertoriant les différents types de
dépêches ou attributs et précisant 1) celles qui doivent être signées (douze types de dépêches :
papier de présentation, papier d'analyse, papier d'angle, enquête, compte-rendu, compte-
rendu d'audience, bio-portrait, portrait, magazine, weekender), 2) celles qui peuvent
éventuellement être signées (cinq types de dépêches : papier général, papier d'éclairage,
papier bilan, interview, bio-longue), et 3) celles qui ne doivent pas porter de signature (seize
types de dépêches).
Toutefois, ces règles ne sont guère respectées sur le terrain; les journalistes témoignent en
effet d'une absence d'harmonisation des pratiques en la matière, de sorte que le volume de
signatures varie d'un service à l'autre et d'un journaliste à l'autre. Un journaliste affirme :
Maintenant tous les papiers prévus sont signés sans état d'âme, y compris les papiers
qui ne devraient pas l'être comme la couverture d'une conférence de presse. A l'AFP,
on est une grande équipe de 2000 journalistes anonymes, il y a des gens qui s'en
fichent, il y a des gens qui tirent une gloire de l'anonymat, et d'autres qui ont envie de
se montrer au moins à l'intérieur de la boîte.
Un autre ajoute :
Je continue de penser que l'on n 'a pas une position assez claire sur la signature, les
règles ne sont pas très claires, vous avez des chefs de service qui vont cosigner,
d'autres parcimonieux, et au bout du compte ça crée de la frustration. Même si on sait
qu 'on est d'abord des anonymes, on a quand même de temps en temps envie d'être mis
un peu en valeur.
Nous avançons que la personnalisation de la copie, notamment par la signature, a un effet sur
la façon dont le journaliste se perçoit. Par ailleurs, la signature gomme une distinction
190 AFP, Manuel de l'Agencier, 2004, page 60.
157
essentielle entre les agenciers et le reste de la population journalistique, l'anonymat constitue
une caractéristique essentielle de l'identité agencière.
Dans les années cinquante, l'information produite par l'agence n'est pas fragmentée mais
s'inscrit dans une thématique dominante : celle de l'information politique et générale.
Aujourd'hui, l'information agencière est segmentée et se présente sous forme de thématiques.
L'activité de l'Agence France Presse n'est plus constituée essentiellement par l'information
diplomatique et politique mais s'élargit à d'autres domaines. Chalaby191 évoque ainsi un
processus de dépolitisation de l'information. L'intérêt des individus s'est déplacé vers d'autres
pôles d'information tels l'information pratique ou ludique. Le niveau d'exigence des individus
en matière d'information s'est élevé. Ils font face à une offre d'information plus importante en
termes de supports, de pourvoyeurs d'information et de contenus, aussi exigent-ils une
information qui réponde à l'ensemble de leurs besoins. Les clients de l'agence répercutent ce
changement d'orientation auprès des journalistes de l'AFP. Ces observations nous invitent à
conclure que depuis les quinze dernières années, la copie de l'agence a connu des
transformations essentielles. Une première transformation concerne le choix de l'information
et son agencement, elle se traduit par un large processus de fragmentation : les thématiques se
sont multipliées, les formats des dépêches se sont diversifiées et l'écriture s'est adaptée au
public visé. La seconde transformation concerne la forme des dépêches qui fait l'objet d'un
processus d'homogénéisation qui touche le style, la longueur des phrases et des textes, le lead,
que l'AFP cherche à normaliser, notamment en les calquant sur les formes anglo-saxonnes.
191 Chalaby, Jean K., « Journalism Studies in an Era of Transition in Public », What is JournalismStudies, Vol. 1(1): 9-6, Journalism, vol. 1(1): 9-60, 2000.
158
Dans la troisième partie de notre thèse, nous nous proposons d'analyser les transformations
des pratiques journalistiques et de l'identité professionnelle des correspondants étrangers de
l'Agence France Presse.
Nous consacrerons le premier chapitre à l'analyse de la chaîne de production de l'information
au sein de l'agence, de la source d'information jusqu'au client. Nous porterons un intérêt tout
particulier aux différents acteurs qui interviennent dans le processus de conception de
l'information (sources, correspondants, opérateurs techniques, journalistes du desk) et à la
redéfinition de leur rôle au sein de la chaîne de production au fur et à mesure des
transformations techniques et de celles de l'environnement médiatique. Nous consacrerons le
second chapitre aux transformations des pratiques journalistiques sous l'influence des
innovations techniques. Nous aborderons notamment les changements dans les techniques de
transmission des dépêches, la portabilité des outils de rédaction, et les outils de
communication.
Enfin dans le dernier chapitre, nous analyserons les transformations de l'identité
professionnelle des journalistes de l'agence, en regard notamment de leurs caractéristiques
socioprofessionnelles, leurs parcours professionnels et leur formation, leur conception de
rôle et leur engagement professionnel.
160
-CHAPITRE 7- LA CHAINE DE PRODUCTION DE L'INFORMATION
Depuis 1945, la chaîne de production de l'information a connu de nombreuses et importantes
transformations. Le nombre d'acteurs intervenant aux différentes étapes de la conception de la
dépêche a augmenté; leur identité et leur fonction ont également évolué.
Sur le plan du recueil des informations, les journalistes ont été confrontés à une augmentation
du nombre et de la diversité de leurs interlocuteurs. Au début de la période à l'étude, soit dans
les années 1940 à 1960, les sources, moins nombreuses qu'aujourd'hui, étaient constituées
essentiellement d'acteurs politiques et diplomatiques. Aussi, les rapports entre les journalistes
et les sources s'établissaient-ils de manière plus directe. Au cours des décennies suivantes, les
sources avec lesquelles les journalistes de l'agence interagissent sont plus nombreuses et plus
diversifiées. Ils transigent avec des représentants de la société civile et des entreprises et
associations de toutes sortes, mais aussi avec les porte-parole des O.N.G., alors en pleine
expansion et de plus en plus présents sur la scène internationale. Us transigent également avec
leurs collègues des agences régionales d'information. Cette croissance du nombre et de la
diversité des sources connaît son point culminant avec le développement de la télévision et
d'Internet qui deviennent des sources incontournables pour les agenciers.
Sur le plan de la conception et de la transmission de la dépêche, les changements sont
également notables. Lors de la première configuration, les employés non-journalistes chargés
de veiller à la retranscription des dépêches et à leur transmission sont nombreux. Le
développement de l'informatique conjugué aux innovations en matière de transmission vont
modifier cette division du travail puisque, lors de la seconde configuration, les journalistes
assument eux-mêmes la retranscription et la transmission de la dépêche.
Enfin, le partenariat «journaliste de desk» et «journaliste de terrain» qui caractérise les
pratiques journalistiques lors de la première configuration va considérablement évoluer,
161
notamment par la mise en place de nonnes et de procédures de plus en plus spécifiques. Le
journaliste de terrain disposant des outils pour concevoir sa copie en quasi-autonomie,
le journaliste de desk contrôle le travail des correspondants étrangers et compose la
composition du « menu », en s'assurant de la diversité et de l'exhaustivité de l'offre et en
veillant à ce que celle-ci réponde à la demande des clients.
Section 1 - Nombre restreint de sources, des artisans de la dépêche nombreux
Au cours de la première période, l'agence met peu de ressources à la disposition du
correspondant, elle lui apporte peu de soutien et en même temps elle le contrôle peu parce
qu'elle ne dispose pas des moyens de communication adéquats. En conséquence, le
journaliste doit se débrouiller, être créatif, autonome. Il doit être polyvalent par la force des
choses (reporter, technicien en télécommunication, coursier, traducteur, et un peu aventurier).
Il est contraint dans une certaine mesure par l'isolement et les problèmes de communication,
mais il en tire aussi l'avantage de l'autonomie.
1.1 Les sources
Dans les chapitres précédents nous avons qualifié le journalisme dominant dans les années
cinquante et soixante d'« événementiel ». Le journaliste d'agence cherche à relater
l'événement le plus rapidement possible, dans un style factuel, en ayant recours à des sources
d'informations fiables. Ne disposant pas de moyens de communication aussi performants que
ceux d'aujourd'hui, il fait appel à un nombre plus limité de sources d'information et il n'est
pas toujours en mesure d'intégrer à sa dépêche tous les éléments contextuels pertinents. Il est
en somme contraint à une plus grande sélectivité quant au choix des sources et des
informations.
1.1.1 Un rapport direct aux sources
À cette époque, le correspondant étranger est un journaliste de terrain, de première ligne, aussi
établit-il un contact direct avec ses sources. « Quand on travaillait à l'étranger, c 'était pas
162
pour travailler comme au desk, on libérait au maximum les gens [les journalistes] pour
pouvoir aller sur le terrain, même pour rien raconter, mais pour être en contact avec le
Parlement. »
Comme le suggère ce journaliste, leurs sources sont essentiellement des sources
diplomatiques et politiques, puisque « le terrain » équivaut au « Parlement ». Le journaliste
est donc amené à fréquenter essentiellement les élites politiques du pays qu'il couvre. Les
radios et les journaux et les radios locaux sont les seuls médias susceptibles d'être des sources
d'information pour le journaliste. Contrairement à la situation qui prévaut aujourd'hui, le
journaliste ne dispose pas de moyens techniques lui permettant de prendre connaissance des
productions de ses confrères en temps réel. Dans ces conditions, il est fréquent que le
journaliste soit le témoin direct des événements et qu'il soit, en quelque sorte, sa propre
source d'information; il s'intègre alors dans le récit de l'événement en tant que témoin.
1.1.2 Le poids des sources institutionnelles
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France reste un pays fortement centralisé où les
pouvoirs publics exercent un contrôle sur un grand nombre de secteurs d'activités. Aussi le
journalisme français - même celui que pratiquent les journalistes de l'AFP en poste à
l'étranger - est-il traditionnellement tourné vers les affaires politiques et diplomatiques. Les
journalistes des années cinquante s'abreuvent donc tout naturellement aux sources politiques
et diplomatiques. Les journalistes de l'agence, même en mission à l'étranger, ont donc le
réflexe professionnel de s'adresser en priorité aux sources institutionnelles et aux porte-parole
officiels. « II fallait toujours avoir une source quasi officielle, si la source n'était pas officielle
du tout, elle n'était pas fiable ». Pour les acteurs politiques et diplomatiques, les journalistes
de l'AFP sont des interlocuteurs privilégiés, ils entretiennent avec eux des relations plus
proches de la diplomatie que du journalisme, et font preuve d'une certaine déférence à l'égard
de la gent politique. Un ancien journaliste de l'AFP qui intègre le bureau de Beyrouth au
début des années soixante, le décrit en ces termes : « Avant c'était un poste de convenances,
de relations diplomatiques ». Les journalistes adoptent une logique de représentation, comme
le relate un ancien correspondant à Téhéran : « On rentrait des fois très très tard, le soir, on
163
invitait les intellectuels et les diplomates. On était obligé d'inviter les diplomates, on avait
alors des informations que l'on n 'avait pas toujours autrement ».
1.1.3 Le journaliste de l'AFP comme représentant de l'Etat français
Le poids des sources institutionnelles s'explique également par l'implication de l'État français
dans le statut et le financement de l'AFP. De 1944 à 1957, le statut de l'Agence France Presse
est fixé par l'ordonnance du 30 septembre 1944. Selon la volonté du gouvernement provisoire,
l'AFP devient un établissement public et reçoit une subvention de l'État. L'agence est ainsi
placée sous l'autorité directe et entière du chef du gouvernement. Elle est administrée par un
directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de l'information. Le statut de
l'AFP et le mode de financement qu'il induit, fait l'objet de nombreuses critiques que ce soit
de la part de la presse française par l'intermédiaire de la Fédération Nationale de la Presse
française qui représente une grande part de la presse française que par les agences
concurrentes.
Cette proximité avec le pouvoir place l'agencier dans une position délicate; il est amené à
privilégier les sources institutionnelles parce que ce sont les plus légitimes à cette époque
mais aussi parce que la direction influence parfois le choix de ses interlocuteurs. Comme nous
l'avons précisé dans le paragraphe 1.2, le journaliste est parfois assimilé à un diplomate. Cette
proximité avec le pouvoir n'est pas sans conséquences pour le correspondant étranger qui a
pour concurrents les journalistes des trois agences américaines (AP, UP, INS) et de Reuters
qui n'ont pas de telles contraintes. Les journalistes de l'AFP sont fortement critiqués par leurs
confrères qui les considèrent comme des journalistes au service du pouvoir. « J'ai ouvert un
bureau au Nigeria après l'indépendance. L'agence Reuters a envoyé à tous les journalistes et
correspondants une note annonçant que l'AFP était une agence d'Etat et faisait de la
propagande pour les essais atomiques. »
Jean Marin, nommé à la tête de l'Agence France Presse en 1954, va vouloir faire de l'agence
un organisme indépendant politiquement et économiquement de l'État : «II souhaite que le
Parlement n 'aitplus à connaître, chaque année, l'ensemble du budget de l'agence, mais qu 'il
doive simplement discuter des moyens de financements par lesquels l'Etat s'assure les
164
services de l'agence »' 2. Ses efforts vont aboutir à une modification du statut de l'agence en
1957193. La loi de 1957 met fin au statut d'établissement public de l'AFP. Les journalistes
entrés à l'agence avant 1957 considèrent que ce nouveau statut permet à l'agence de retrouver
une légitimité au regard de ses clients et des agences concurrentes. « L'AFP jusqu'au vote du
statut, a remonté le handicap de prestige aux yeux de la concurrence. L'AFP était l'agence
gouvernementale, il fallait constamment montrer que nous étions des journalistes
indépendants et pas des fonctionnaires gouvernementaux. »
L'AFP est donc une entreprise fortement imprégnée par les forces politiques françaises du fait
de son statut et de son financement qui la lient à l'État français. Les journalistes ont parfois le
sentiment de représenter à l'étranger non seulement l'État français, mais une certaine idée de
la France : « Par la nature même de cette agence, on représentait la France mais pas
officiellement. On représentait une puissance, une image française non officielle mais
puissante. » Les agenciers n'ont pas le sentiment d'exercer leur activité en collusion avec
l'État français, pourtant ils sont souvent perçus comme tels : « Les correspondants étrangers
d'agence ont été parfois comparés aux diplomates, perçus comme représentants de leur pays
et de ses médias. »194 L'implication de l'État français dans l'agence tant du point de vue de son
statut que de son financement, contribue à ce que ce préjugé frappe plus particulièrement les
journalistes de l'AFP.
Par ailleurs, l'Agence France Presse s'inscrit dans le sillage de la politique extérieure du
général de Gaulle marquée par son attachement à la souveraineté nationale, une politique
d'indépendance qui passe par le refus de l'hégémonie américaine. L'Agence France Presse
prolonge cette affirmation d'indépendance à l'étranger. Un correspondant étranger à la retraite
précise :
192 Montané, Jade, L'Agence France-Presse (1944-1957), La recherche d'une liberté d'information,Maîtrise d'Histoire, Université Paris X-Nanterre, 1999, page 77.193 Texte du statut de l 'AFP, 1957, annexe B - l .194 Boyd Barrett, Oliver, Rantanen, Terhi , «News Agency Foreign Correspondents» . In Tunstall ,Jeremy, Media Occupations and Professions, a Reader, Oxford Universi ty Press , N e w York, 2 0 0 1 ,page 128 : «News agency foreign correspondents hâve sometimes been compared to diplomats,perceived as représentatives oftheir country and its média » (traduction réalisée par l 'auteur) .
165
L'AFP avait pas mal d'importance, ça tenait aussi à de Gaulle, le régime gaulliste
mettait du vent dans les voiles de l'AFP parce qu'on voyait ça surtout à l'extérieur
comme dans des continents en Amérique du sud, et on était une agence pour les pays
comme ça, qui ne voulaient pas être sous l'influence directe des États-Unis. Le
gaullisme et la politique gaulliste, avec une espèce d'indépendance par rapport aux
États-Unis et à la politique américaine, c'était très fort en Amérique Latine.
2.2 Une production collective de la dépêche
2.2.1 L'opérateur technique : un acteur incontournable
À cette époque, les outils et les techniques de transmission sont lourds et complexes et exigent
des spécialistes chargés de l'envoi des dépêches. En 1952, les techniciens chargés des
transmissions représentent 20% des employés de l'agence et les employés de presse 25% pour
40% des journalistes. « C'était une époque où il y avait une brigade de mécaniciens, de
machinistes. Il y avait une. brigade qui venait pour changer les rubans, les réparateurs de
machines à écrire. Les téléscripteurs, c'était des bêtes exigeantes. On emmenait les
opérateurs avec nous, ils travaillaient comme des bêtes sauvages. »
Si le journaliste se charge de la rédaction de sa copie, c'est le télexiste qui s'occupe de taper le
texte sur les télex. À l'étranger, le télexiste ne maîtrise pas nécessairement la langue de la
dépêche parfaitement, les sources d'erreurs lors de l'opération sont donc nombreuses. Aussi,
certains journalistes apprennent-ils à taper des télex afin de s'assurer que leur dépêche sera
transmise correctement.
Quand j'ai commencé, on avait des machines à écrire, on était assis et dans notre dos,
il y avait un banc de téléscripteurs, on tapait notre copie sur plusieurs carbones, on en
gardait une pour les archives, on donnait la première copie au télexiste qui lui
(souvent c'était des gens qui ne parlaient pas l'anglais) tapait directement et ça
partait. J'ai appris à taper des télex moi-même, car j'étais plus sûr de mon travail que
les télexistes du cru, et j'ai appris à lire une bande perforée.
166
À cette époque, la chaîne de production de l'information est longue et la conception de la
dépêche, laborieuse. « Moi quand j'ai commencé c'était les télex. Nous, on faisait les papiers
sur machine à écrire, puis elles étaient retapées sur machine à écrire par l'opérateur, on
perdait beaucoup de temps.» Les intermédiaires entre le journaliste de terrain et le client sont
nombreux, toutefois la majorité des journalistes semblaient apprécier ce travail d'équipe
qu'ils disent ressentir de moins en moins au sein de l'agence.
Pour nous, les techniques n'étaient pas les mêmes, lorsqu'un télex arrivait, il y avait
quelqu'un qui le portait au desk, vous la rencontriez, ensuite vous la donniez à
quelqu'un d'autre qui le relisait et vous apportiez la copie à l'opérateur, et il y avait les
sténos. On se connaissait tous, on se croisait en permanence. Maintenant chacun est
devant son écran : "Bonjour... à demain" : terminé, il n'y a plus d'employé de
rédaction.
167
Photo d'une salle de rédaction de l'AFP dans les années soixante-dix.195
2.2.2 La dépêche, produit de la collaboration entre le correspondant et le
rédacteur
Les journalistes du desk et ceux qui exercent sur le terrain mènent des activités différentes
mais complémentaires dans la production des dépêches. Au cours des trente premières années
de l'agence, la division du travail entre les journalistes qui y travaillent correspond assez bien
à la distinction faite par Jeremy Tunstall entre les gatherers et les processors. Les premiers
sont ceux qui collectent l'information; ils sont tournés vers les sources d'information et ils
sont engagés dans le travail peu routinier de recherche, de vérification, d'explication et de
commentaire. Les seconds sont ceux qui mettent en forme et présentent l'information; ils sont
tournés vers l'audience et ils sont affectés à des tâches bureaucratiques et répétitives. 196
195 Droits réservés, AFP.196 Tunstall, Jeremy, Journalists at work, Londres, Constable, 1971, 304 pages.
168
Jusqu'à l'informatisation et la régionalisation de l'agence, les desks de l'AFP sont tous situés
au siège de l'agence à Paris. Ils occupent une place de choix dans la conception de la dépêche,
puisqu'ils déterminent la forme définitive de la dépêche qui va être envoyée aux clients. Le
personnel journalistique à l'étranger est encore relativement peu nombreux, tandis que les
journalistes de desk, en grand nombre, s'affairent en permanence à la conception de la copie
dans les locaux parfois trop étroits de l'agence : «A la fin des années soixante-dix, on ne
savait pas où s'asseoir et il n 'y avait pas assez de chaises pour tout le monde. »
Les correspondants étrangers envoient leurs dépêches par télex, câble, téléphone et courrier.
Les dépêches, qui parviennent au siège dans un style télégraphique1 , doivent être mises en
forme par les journalistes du desk. Le style télégraphique occasionne parfois des problèmes de
compréhension pour les journalistes du desk chargés de retranscrire la dépêche.
On utilisait un langage télégraphique que l'on appelait le nègre, pour réduire le coût
des transmissions télégraphiques, on faisait sauter les articles et le participe passé ;
au lieu de dire machin est arrivé ou arriva, on écrivait arrived. Ça a donné lieu à de
célèbres angoisses à Paris au moment de la chute de Dien Bien Phu. Un de mes
collègues à Saigon avait envoyé un flash, il avait dit Dien Bien Phu tombé. On s'est
dit : merde, ça veut dire quoi en train de "tomber" ou "tombé" ?. Alors on a demandé
qu'il s'explique et il avait bien écrit, Dien Bien Phu tombed. On faisait ça
instinctivement.
Le journaliste du desk peut être amené à contacter le journaliste de terrain pour se faire
préciser certaines informations, ce qui occasionne une perte de temps considérable. Le
rédacteur du desk, chargé de mettre en forme les dépêches, notamment en les « dénégrifiant »,
peut également être amené à corriger le texte, à en modifier la taille, à le traduire voire à le
réécrire s'il le juge nécessaire. Même s'il n'est pas à l'origine du texte journalistique, le
journaliste du desk a autorité pour procéder à la mise en confonnité du texte avec les normes
197 Le prix du télégramme varie en fonction du nombre de mots; par conséquent les journalistes sontincités à faire court. Ils écrivent leurs dépêches dans un style télégraphique, en « nègre >>. Lesjournalistes suppriment notamment les articles, les relatifs, les pronoms personnels. On trouvera enannexe deux exemples de dépêches rédigées en nègre par les envoyés spéciaux avant qu'elles ne soientmises en forme par les journalistes du desk central à Paris.
169
de l'agence. Son travail de correction effectué, il porte la dépêche aux télexistes chargés de la
transmission vers les journaux.
On refaisait le papier de A à Z, c'était un vrai boulot. On avait un autre point de vue,
le papier était refait. Le travail de desk, il n 'existe plus, sauf quand il y a des
traductions, sinon ils coupent. On donnait ce petit vernis français ou européen qui
intéressait les rédactions étrangères, maintenant c'est « copier - coller ». Aujourd'hui
ils s'ennuient au desk, il n 'y a plus beaucoup de journalistes.
Le gatherer, sur le terrain, est relativement isolé; il ne mesure pas nécessairement les attentes
des clients et n'est pas en mesure de se positionner par rapport aux dépêches produites par les
autres agences. Par ailleurs, il n'a qu'une idée relative de la taille de dépêche susceptible de
convenir à son responsable de desk; c'est pourquoi les papiers peuvent atteindre une longueur
inadéquate. C'est donc au desk que revient la tâche d'adapter la copie en fonction des
desiderata des clients et des normes fixées par l'agence. La proximité physique de la rédaction
centrale, qui définit les normes des dépêches, contribue à ce que les journalistes du desk soient
particulièrement soucieux de les respecter. Les journalistes, éloignés de la rédaction centrale,
se préoccupent davantage de la transmission de leur copie, que du respect des normes
agencières, surtout qu'ils savent que leur copie sera, de toute façon, revue et corrigée par le
desk. Le journaliste du desk étant le dernier à intervenir sur la copie avant qu'elle ne soit
diffusée sur les fils de l'agence, c'est lui qui exerce finalement l'autorité sur la copie.
Section 2 : Transformations de la chaîne de production
2.1 À la conquête de nouvelles sources
Dans le cadre de la première configuration, les journalistes s'adressent avant tout aux sources
officielles. Mais, progressivement, le nombre et la diversité des acteurs sociaux (associations,
regroupements, entreprises, groupes de pressions, etc.) qui interviennent sur la place publique
pour infléchir les politiques publiques et qui sollicitent l'attention médiatique tendent à
croître. Sur la scène internationale, on voit apparaître de nouveaux acteurs qui vont constituer
170
d'importantes sources d'informations pour les journalistes des agences internationales,
comme les organisations non gouvernementales et les agences de presse régionales et locales
qui vont se développer notamment à la fin des années soixante-dix dans la foulée du débat sur
le Nouvel Ordre Mondial de l'Information et de la Communication.
En Afrique, où les gouvernements sont faibles et peu efficaces dans la "diffusion " des
informations et des visiteurs, le personnel des Nations Unies ou des organisations non
gouvernementales (ONG) constituent souvent des sources importantes - ils servent de
« fixeurs locaux » pour les journalistes parachutés.
Par ailleurs, les clients des agences internationales vont également diversifier leurs demandes.
Si l'information générale et politique demeure essentielle, d'autres thématiques (économie,
culture, science, religion, loisir, etc.) intéressent de plus en plus les clients des agences.
Bref, la diversification des acteurs et l'élargissement des contenus informationnels exigés par
les clients conduisent les journalistes à se lancer dans la conquête de nouvelles sources
d'information.
2.2 L'informatisation de l'agence modifie les conditions de la pratique journalistique :
redéfinition des tâches professionnelles et renforcement des normes rédactionnelles
L'AFP s'est engagée dans un processus d'informatisation entre octobre 1973 et juin 1976. En
1976, le bureau latino-américain est informatisé, suivi par les desks allemands et africains, le
desk économique et sportif, le desk France en 1978 et 1979. L'informatisation des desks
change les besoins en main d'œuvre de l'agence et entraîne une modification des fonctions
des salariés. Les secrétaires chargées de reproduire le texte doivent se reconvertir dans
d'autres fonctions. L'informatisation s'accompagne également du passage des majuscules aux
minuscules, les journalistes considèrent que cela exige un surcroît de travail, ils n'écrivent
)8 Hannerz, Ulf, Foreign News. Exploring the World of Foreign Correspondents, The University ofChicago Press, Chicago, 2004, page 135. « In Africa, where governments are weak and not tooefficient in handling either information or visitors, the staff of United Nations agencies orinternational non governmental organization (NGOs) often become very prominent sources - theymay already serve as the parachutists ' local fixer » (traduction réalisée par l'auteur).
171
plus les dépêches dans un seul format de caractère et cela ajoute un geste supplémentaire dans
la retranscription des dépêches. Les journalistes réclament un complément salarial, une prime
à la minuscule. Si l'informatisation a réduit le nombre d'intermédiaires entre le journaliste de
terrain et le client, il a également permis au journaliste de gagner du temps dans la rédaction
de sa dépêche.
- Moi j'ai démarré avec la machine à écrire où l'on transmettait encore la copie par
une espèce de bombe pneumatique à l'intérieur du bâtiment. On travaille mieux, plus
vite, on élimine un intermédiaire qui est l'opérateur du télétex, donc ça élimine une
source d'erreur. On a pas mal d'outils qui nous aident comme le correcteur
d'orthographe et puis on a une recherche de background très facile.
- Quand moi j'ai commencé à l'AFP, je me levais, j'allais dans un placard d'où je
sortais des gros cahiers, où je fouillais pendant dix minutes pour trouver la dépêche
précédente. Pour trouver le même sujet maintenant je tape un mot clé et l'ordinateur
me crache en 0,2 seconde toutes les dépêches sur le sujet sorties depuis six mois.
Ce gain de temps n'est pas toujours considéré comme un effet positif sur le travail du
journaliste. Certains considèrent qu'ils ne disposent plus du temps de la réflexion.
« L'informatisation a tout changé, ça a donné un défaut, on n 'avaitpas le temps de réfléchir.
Le temps de mettre le papier dans la machine à écrire, d'allumer sa cigarette, et de se dire
'voyons ma première phrase elle va être comme ci comme ça'. Aujourd'hui c'est copier-
coller, l'horreur! »
L'informatisation des desks va renforcer le contrôle rédactionnel exercé par le desk sur la
copie produite par les correspondants étrangers. Mais, en même temps, l'informatisation de la
production et les changements qu'elle entraîne au chapitre des instruments et des protocoles
de transmission de l'information vont nécessiter la définition et l'imposition de nouvelles
normes de production. C'est pourquoi la période de l'informatisation coïncide avec une
période d'intense production normative, comme en témoigne le gonflement du volume du
second manuel de l'agencier par rapport au premier.
172
L'informatisation touche plusieurs aspects de la production des dépêches : le nombre de
dépêches transmises par les réseaux de l'agence augmente considérablement; les conditions
de travail des journalistes changent substantiellement; les nonnes relatives à la taille,
l'écriture et le routage des dépêches sont modifiées.199 Alors qu'autrefois le journaliste de
terrain se contentait de dicter sa dépêche à un opérateur, avec l'informatisation, les bureaux à
l'étranger disposent de consoles informatiques, de sorte que le journaliste procède lui-même à
la saisie, au découpage et à la mise en forme de la dépêche.
Un découpage et une présentation corrects sont absolument nécessaires à la rapidité
de traitement et de distribution de l'information. C'est donc une erreur fondamentale,
pour un agencier, que de s'imaginer qu 'il a « gagné du temps » en adressant au siège
de l'AFP des dépêches conçues à la hâte, mal découpées et à la présentation
défectueuse. Non seulement il n 'a pas gagné de temps, mais au contraire, il en fera
perdre, au stade du traitement par les desks, bien au-delà des minutes
supplémentaires qu 'aurait réclamées une copie plus conforme.
Les journalistes du desk, qui reçoivent les dépêches, disposent désormais des outils
informatiques qui leur facilitent la relecture et correction de la copie (notamment par l'emploi
des fonctions « couper », « copier » et « coller »). L'informatisation conditionne également la
mise en page de la dépêche. Si autrefois, les agenciers rédigeaient et envoyaient leurs
dépêches en continu, au début des années quatre-vingt, les consoles utilisées par les
journalistes de l'agence disposent d'un écran qui ne peut contenir que 22 lignes comportant
chacune 80 caractères. Le découpage de la dépêche en feuillets de 200 mots est indispensable
pour que chaque feuillet puisse apparaître dans son intégralité sur l'écran de la console. Enfin,
l'introduction des outils informatiques conduit l'agence à adopter un codage de la dépêche qui
199 Un chapitre du Manuel de l'agencier est exclusivement consacré à l'informatique au sein del'agence.200 AFP, Manuel de l'agencier, 1982, page 44.
173
soit harmonisé avec les consoles informatiques de leurs clients.201 Aussi les journalistes
doivent-il appréhender un nouveau mode de qualification de la dépêche.
Section 3 - Multiplication des sources et diminution du nombre d'artisans de ladépêche.
3.1 Les sources : un rapport aux sources transformé, sources multiples, multiformes
3.1.1 Accès aux sources transformé
Les modalités d'accès aux sources par les journalistes des agences internationales varient d'un
pays à l'autre. Certains pays disposent de médias locaux fiables et susceptibles d'être repris
comme source d'information par les journalistes. Dans les pays où les médias locaux sont peu
fiables, les journalistes doivent plutôt recourir à des sources personnelles, ce qui les amène à
constituer des réseaux d'informateurs et à œuvrer davantage sur le terrain. Cela était
particulièrement vrai dans le cadre de la première configuration, aujourd'hui l'extension des
réseaux d'information en continu et le développement d'Internet pallient les médias locaux
jugés peu fiables. Deux situations bien différentes qu'évoque ici une journaliste :
On est dans un monde sur-médiatisé où dans la plupart des pays, les médias locaux
crachent de l'information. Quand j'étais en Allemagne au début des années quatre-
vingt-dix - les médias y sont très riches et très fiables - donc on faisait beaucoup de
digestion d'information locale, très peu de sources directes, on recyclait les médias
locaux. En Russie, je suis arrivée en 1996, les médias locaux n 'étaient pas fiables, une
des fiertés du bureau c 'était de ne pas utiliser les médias locaux mais les sources
personnelles.
201 Les agences américaines et européennes ont adopté plusieurs conventions au sein de l'AmericanNewspaper Publishers Association (ANPA) et de Y International Press Télécommunications Council(IPTC) afin que la dépêche informatisée puisse être accessible à tous les clients.
174
Dans le tableau suivant, nous présentons deux types d'environnements médiatiques possibles
et dans lesquels le journaliste agit différemment avec les sources. Dans le cas des pays
développés, la concurrence entre les médias est intense; pour se différencier de leurs
concurrents, les journalistes proposent aux clients un traitement de plus en plus spécialisé et
local. La présence généralisée de services de communication force les journalistes à établir
des rapports indirects avec ses sources.
Les enjeux locaux des pays en voie de développement, surtout s'ils ne présentent pas un fort
potentiel économique n'intéressent guère les pays développés. Les médias sont encore
relativement peu nombreux dans ces pays; l'équipement technique est partiel et la
professionnalisation des sources peu avancée. Les journalistes établissent donc des rapports
plus directs, même personnels avec leurs sources.
Pays Développés
Pays en voie de
développement
Importance, pour les
pays développés, des
enjeux locaux.
Grande importance
Faible importance
Médias et
concurrence
médiatique
Médias
nombreux et
concurrence forte
Médias peu
nombreux et
concurrence
faible
Rapport aux sources
d'information
Les journalistes ont recours à
des sources indirectes et aux
services de communication
Les journalistes ont recours à
des sources directes, de
première main, et établissent
avec elles des rapports
personnels
3.1.2 La professionnalisation des sources
L'hyper concurrence caractérise non seulement le marché de l'offre médiatique, mais aussi le
marché de l'offre d'information par les sources en ce sens que la concurrence est de plus en
175
plus vive entre les sources et entre les « événements » dont elles se font les promoteurs et
qu'elles voudraient que les médias traitent. Cette situation a conduit depuis une vingtaine
d'années à un mouvement de professionnalisation des sources, c'est-à-dire à une prise en
charge de la communication des acteurs sociaux par des professionnels dont le mandat est de
faire en sorte que la couverture médiatique des événements ou des informations qui
concernent leur organisation soit conforme à leurs intérêts. Cela implique un travail
d'« encadrement » des journalistes par les services de communication et, par conséquent, une
perte d'autonomie des journalistes. L'accès aux acteurs des événements et aux informations
est de plus en plus contrôlé. Les journalistes entretiennent donc des rapports de moins en
moins personnels et directs avec les sources, et traitent volontairement ou parfois à
contrecœur avec des spécialistes de la communication aux médias. En 1989, Jean-François
Têtu et Maurice Mouillaud constataient que « Les grandes institutions publiques, privées ou
para-publiques tendent de plus en plus à se constituer en agences qui envoient leurs
informations aux médias, et par suite à revendiquer le statut de sources. »2 À cette occasion,
les journalistes peuvent ressentir une frustration de ne pas avoir accès directement aux
sources. « C'est énervant, on a toujours l'impression de ne pas avoir accès aux vrais gens, il
y a une espèce de barrière, on a finalement très très peu accès à la véritable information, il
faut toujours se battre, passer par des moyens détournés ». Ils ont le sentiment que les
services de communication rendent leur travail plus difficile : « Les sources se sont
dévalorisées, il y a tellement de porte-parole, de hiérarchisation de l'information, de la
communication. Eux ils veulent informer comme ils veulent et quelquefois l'info est ailleurs. »
Interagissant de moins en moins souvent avec les sources, les journalistes considèrent que les
services de communication appauvrissent l'information.
Vous avez moins de contacts directs avec vos interlocuteurs. Je trouve que c 'est
dangereux parce que vous ratez des opportunités. Quand vous êtes en direct avec la
personne vous pouvez apprendre des trucs annexes en parlant de sujets différents.
Maintenant vous ne créez plus de rapports personnels. Ça rend le travail beaucoup
plus aride.
202 Mouillaud, Maurice et Têtu, Jean François, Le journal quotidien, P.U.L., Lyon, 1989, page 131,
176
Afin de contrôler l'information et orienter le travail des journalistes, les services de
communication mettent en place différentes stratégies de séduction. L'une d'entre elles
consiste notamment à alimenter en permanence les journalistes et à être toujours disponibles
si ceux-ci en viennent à les contacter. « En Allemagne, on avait cette impression agréable
d'avoir constamment un interlocuteur disponible à n'importe quelle heure, d'avoir toujours
une phrase à écrire, et avec le droit de parler, mais il faut admettre qu 'on était piégé par
cela; il faut bien admettre que l'on était pieds et poings liés entre les mains de ces gens-là. »
Comme tous les acteurs sociaux qui en ont les moyens, ont recours à des services de
communication et à leurs stratégies, les journalistes sont submergés d'information et sont de
plus en plus confinés à une fonction de tri.
A Londres, on utilise les communiqués, les écrans de données brutes fournies par les
agences spécialisées dans l'information économique, des fils de communiqués. Les
think tanks, tous ces instituts de réflexion sont très puissants et témoignent d'une
grande qualité et d'un grand professionnalisme. Chaque entreprise a une grosse
équipe de communication qui sait de quoi elle parle. Chaque association, chaque
lobby peut vous aiguiller vers un expert qui va vous parler exactement de ce que vous
voulez savoir. Les universités sont à même de vous fournir des professeurs.
Leur travail consiste de moins en moins à rechercher et collecter de l'information et de plus
en plus à la recevoir et en faire le tri.
Les services de communication alimentent également les journalistes avant l'événement de
manière à influer sur leur « lecture » des événements et des situations. Les journalistes « de
plus en plus ne disposent, comme matière pour effectuer leur travail, que d'un discours
extérieur préparé à cet effet. »204 Les sources se sont professionnalisées au point de fournir
03 C'est ce que l'on peut appeler un effet de «framing » ( on peut se référer à ce propos aux travauxsuivants : Gitlin, Todd, The Whole World is Watching, Berkeley: University of California Press, 1980,352 pages et Braham, Peter, "How the Media Report Race," In , M. Gurevitch, T. Bennet, J. Curranand J. Woollacott, eds., Culture, Society and the Media (London and New York: Methuen, 1982), pp.275-279. Les services de communication fournissent en quelque sorte un « cadrage » de l'informationqu'ils diffusent auprès des journalistes.204 Rebillard, Franck, « La presse multimédia. Une première expérience de diversification de la presseécrite sur cédérom et sur le web », Réseaux, n°101, 2000, p. 167.
177
aux journalistes des articles « clé en main ». Elles produisent souvent en avance des dossiers
finement rédigés, dans lesquels le journaliste dispose de tous les éléments nécessaires à la
rédaction de ses articles. En résumé les services de communication vont jusqu'à se substituer
au journaliste en lui proposant des articles « prêts à publier ». L'objectif de ces services est
que le journaliste, sous une forte pression temporelle, choisisse d'utiliser le dossier qui lui est
fourni sans recourir à d'autres sources :
Les journalistes sont comme tous les êtres humains, ils sont fainéants. L'attaché de
presse qui vous amène un dossier magnifique tout fait, avec un article tout fait, que
vous le vouliez ou non, vous allez l'utiliser, sauf si c'est votre dossier depuis six mois et
que vous le connaissez à fond.
3.1.3 Internet comme source d'information
L'arrivée d'Internet a modifié le travail des journalistes, notamment au niveau de la collecte de
l'information et du rapport des journalistes à leurs sources. Internet constitue un outil de
recherche et d'investigation pour les journalistes lorsqu'ils rédigent leurs dépêches, et
notamment les dépêches d'analyse et les dossiers.
- Ça nous facilite le travail, notamment pour nos papiers d'analyse ; Internet nous
ouvre des portes. Ainsi, par exemple si je dois faire un papier sur le pays basque, je
récupère une masse d'informations qui me permet d'avoir du background. C'est un
usage quotidien,
- L'énorme changement c'est Internet. A l'étranger ça a changé notre façon de
travailler, en bien, notamment pour nos papiers d'analyse. Avant, quand on avait une
question précise, on avait affaire à un service de presse qui nous répondait quand il
avait le temps; là avec Internet vous avez la réponse très vite.
Grâce à Internet, les dépêches se trouvent alors mieux documentées, plus analytiques. En
outre, les journalistes peuvent assister à des conférences de presse depuis leur poste de travail,
178
ce qui facilite la rédaction de leurs dépêches. « J'en ai suivi des conférences de presse par
Internet avec des codes. Les entreprises communiquent à l'avance ces codes, et tu te
connectes à l'heure dite, tu assistes à la conférence comme si tu y étais, sauf que là ça ne
t'oblige pas à te déplacer et du coup tu écris ta dépêche plus rapidement.»
Internet permet également aux journalistes de se différencier de leurs concurrents en affinant
l'angle de leurs dépêches. Les journalistes visitent les sites des médias de presse écrite, des
grandes chaînes d'information en continu et des agences de presse concurrentes
quotidiennement afin de prendre connaissance du traitement qu'ils opèrent des événements. Ils
sont ensuite à même de proposer un angle différent et de s'assurer de nouveaux clients.
Avant, on était dépendant c/'Alerte et Analyse pour savoir ce que faisait la
concurrence, à Alerte et Analyse, ils n'ont pas le temps de voir dans chaque bureau ce
que le concurrent a fait. Maintenant on va sur Yahoo infos, on va voir ce qu'a sorti la
concurrence, l'angle choisi, ou alors on va sur le site du Monde, de la BBC, où il y a
un bataillon de journalistes qui actualisent l'info en permanence et ça permet de voir
comment eux, voient l'info.
Par ailleurs, Internet a changé de manière substantielle les rapports des journalistes à leurs
sources. Autrefois, les journalistes devaient se contenter d'un nombre restreint de sources par
manque de temps, et donc s'adressaient souvent aux mêmes sources par habitude et par souci
de rapidité. Internet a rendu accessible et visible un grand nombre de sources. Les journalistes
sont donc enclins à croiser une multitude de sources, et à en diversifier l'origine. Cela
contribue à améliorer la qualité et l'exhaustivité de l'information disponible dans les dépêches.
En effet, Internet donne accès à une très grande diversité de sources et, éventuellement de
points de vue, dont les points de vue de ceux qui contestent les discours officiels. Internet
permet donc aux journalistes de s'affranchir dans une certaine mesure des contraintes que les
sources, notamment les sources professionnelles, cherchent à leur imposer. Les professionnels
de la communication notamment, ont su saisir Internet comme un outil privilégié pour avoir
accès aux journalistes. Internet constitue aujourd'hui un formidable espace d'investissement
des institutions. Toutefois, en multipliant le nombre de sources accessibles, Internet diminue
leur état de dépendance aux sources. «L'énorme changement c'est Internet. A l'étranger ça a
179
changé notre façon de travailler en bien, parce que même à l'époque de Washington, on était
dépendant, enfin on finissait par obtenir les infos mais c'était beaucoup plus laborieux. »
Si la seconde génération des journalistes étudiée montre quelques réticences à utiliser Internet
comme source d'information, la jeune génération de journalistes est enthousiaste et considère
qu'Internet représente un gain de temps considérable dans le travail quotidien. «Les sites
Internet, on se dit que c'est pas sérieux, mais ils [rédacteurs Internet] négligent aussi l'idée
que toute information de ce type [les informations diffusées sur Internet] va pouvoir être
utilisée par d'autres agences. C'est plutôt quelque chose qui devrait aider une agence, trouver
de meilleurs sujets ». Internet fait donc l'objet d'évaluations différentes selon les générations.
Si la jeune génération considère que les informations recueillies sur Internet sont fiables, les
journalistes plus anciens, habitués à traiter avec des sources directes et peu enclins à utiliser
les réseaux pour collecter leurs informations soulignent le peu de fiabilité des informations
recueillies par Internet :
-Internet nous pose des problèmes déontologiques. C'est très riche, c'est une
encyclopédie pour des renseignements de fond. Mais autant l'encyclopédie Larousse,
on peut s'y fier, autant Internet, il faut faire attention,
-Internet, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations c'est comme si vous aviez un
communiqué sans en-tête avec l'annonce d'un attaché de presse qui dit qu 'il y a eu un
attentat qui a fait quatorze morts. On doit multiplier les vérifications
Par ailleurs, la facilité et la rapidité avec lesquelles le journaliste peut recueillir les
informations par Internet peuvent le conduire à s'épargner une recherche d'information
supplémentaire en croisant ses sources et à utiliser les seules données recueillies par internet.
« Internet, c 'est comme les attachés de presse en pire, vous trouvez de tout, mais ce n 'est pas
contrôlable.»
180
3.1.4 Les chaînes d'information en continu : alerte et sources des journalistes
Le développement de la télévision et plus particulièrement des chaînes d'information en
continu a eu un impact aussi considérable sur le travail des agenciers que l'arrivée
d'Internet. Non seulement les grandes chaînes de télévision constituent-elles désormais une
nouvelle et importante source d'information pour les agenciers, mais leur présence sur
l'échiquier de l'information internationale tend à modifier les règles du jeu de la concurrence
entre les agences et les médias qui diffusent de l'information à l'échelle planétaire. De plus, la
présence sur le terrain des journalistes qui travaillent pour ces chaînes perturbe
considérablement les relations entre les agenciers et les sources locales.
Tous les bureaux des agences que nous avons visités disposent de plusieurs postes de
télévision qui diffusent en permanence les programmes de ces chaînes. La salle de rédaction
du bureau du Caire photographiée ci-dessous compte deux postes de télévision, auquel
s'ajoute un autre poste installé dans le bureau du directeur, les trois postes diffusent les
chaînes d'information régionales arabes, Al Arabiya, Al Jazeera et la chaîne BBC News, ce
pour un effectif de six journalistes. Leur présence dénote que la télévision constitue
aujourd'hui un outil incontournable pour l'agencier. Allumer l'ordinateur et le poste de
télévision sont les premiers gestes qu'effectue le journaliste lorsqu'il arrive au bureau. À la
fois clients et concurrents, les chaînes d'information en continu font l'objet d'une surveillance
de tous les instants de la part des agenciers afin qu'aucun événement ne leur échappe.
181
Bureau de l'AFP au Caire, mars 2005.
La présence des chaînes d'information en continu facilite l'accès à l'information et permet
aux correspondants de suivre l'actualité internationale en temps réel, ou presque, y compris
celle qui concerne le pays où ils sont en poste. Cet accès à une information médiatisée par les
chaînes de télévision a cependant un effet pervers : la présence sur le terrain des journalistes
de la télévision nuit à l'accès direct des agenciers aux sources locales, et plus particulièrement
aux acteurs qui « font l'événement ». En effet, sur le terrain, les correspondants étrangers
d'agence tout comme les journalistes de presse écrite, rencontrent de plus en plus de
difficultés pour avoir accès aux sources, celles-ci préférant de plus en plus transiger avec les
journalistes de la télévision, surtout les représentants des grandes chaînes. Ces dernières
offrent, par rapport à la presse écrite, deux avantages décisifs : de larges auditoires à l'échelle
internationale et la force des images. C'est pourquoi les informateurs préfèrent de plus en plus
s'adresser en priorité à une chaîne de télévision internationale plutôt qu'à un média écrit ou à
des journalistes d'agence. Certes, une grande partie de l'information que traitent les
journalistes provient de grandes institutions; cette information a un caractère officiel et est
généralement disponible à tous les journalistes, simultanément; mais dès que l'on quitte le
domaine de l'information institutionnelle et officielle pour entrer dans celui de la course aux
exclusivités, alors les avantages que détiennent les grandes chaînes de télévision deviennent
décisifs.
182
Ainsi, une journaliste chargée de couvrir le conflit palestinien relate ses difficultés pour
approcher la population : « J'arrive sur le terrain comme journaliste, on me demande : ' tu es
de telle chaîne? Tu leur réponds que 'non 'je ne travaille pas pour une chaîne de télévision '
et ils te disent: 'Bah! Alors ça ne m'intéresse pas de te parler'. Je suis anodine».
Contrairement à d'autres agences telles Associated Press205 ou Reuters qui disposent de leurs
propres services d'informations télévisées, la branche audiovisuelle de l'AFP, encore peu
développée, n'en est qu'au stade de l'expérimentation en ce qui concerne la couverture à
l'étranger; aussi ne peut-elle rivaliser avec les chaînes de télévision ou de la branche
audiovisuelle d'Associated Press. Sur le terrain, les journalistes employés par des médias
audiovisuels partent perdants dans la course aux témoins et aux sources qu'ils mènent avec les
journalistes des autres médias. Les chaînes d'information en continu garantissent aux sources
une grande visibilité (par l'image et par la parole), planétaire et immédiate, garantie que
l'agence de presse ne peut offrir.
Ça arrive souvent qu 'Al Jazeera annonce des choses avant tout le monde, c 'est un très
gros problème qui se pose aux agences, car de plus en plus de gens ont besoin
d'images et ils se disent : si je donne mon info à l'agence, je n 'ai pas l'image, si je la
donne à Al Jazeera, j'ai l'image. Depuis vingt ans, on a de plus en plus de difficultés à
interviewer en agence, ils préfèrent voir leur bobine à la télé, indique un directeur de
bureau. En conséquence, les chaînes d'information en continu sont souvent les
premières à diffuser l'information., comme le confirme ce correspondant étranger aux
États-Unis :
CNN est en train de devenir une espèce d'agence de presse télévisuelle. CNN a ainsi
sorti des tas d'infos en avance sur les trois agences. Ils sont avant tout le monde et
partout. C 'est CNN qui a annoncé la mort de Sœur Teresa et nous, on a dû annoncer
la mort de Mère Teresa en citant CNN. C 'est nos clients, mais ça devient des
concurrents.
35 En 1994, Associated Press lance APTV, agence mondiale d'informations audiovisuelles. En 1999,APTV et sa filiale Sport, SNTV, avaient 330 abonnés dans le monde. En 1998, APTV acquiert WTN{Worldwilde Télévision News) et devient la nouvelle société, AP Télévision News (APTN).
183
En disposant d'un accès privilégié aux sources, les chaînes d'information en continu ont
progressivement pris le pas sur les agences de presse dans la construction de l'agenda
médiatique international. Les agences de presse subissent aujourd'hui l'influence des chaînes
d'information en continu qui, en accord avec les sources, définissent désormais le calendrier
des événements et la hiérarchie des sujets. « Elles [les chaînes d'information en continu] ont
tendance à nous damer le pion, à jouer le rôle qu 'on jouait nous, c 'est-à-dire à être les
initiateurs d'information. A l'étranger, j'ai souvent eu l'impression que CNN menait la
danse ». La couverture de l'AFP s'établit de plus en plus en fonction de celle des chaînes
d'information en continu. « La télévision vingt-quatre heures sur vingt-quatre a changé la
nature de notre travail, le choix des sujets à couvrir n 'est plus le même. »
Face à la concurrence que leur livrent sur le terrain leurs collègues des chaînes d'information
en continu, les journalistes de l'AFP ont toujours la possibilité d'établir des relations étroites
et solides avec des sources privilégiées, notamment des experts et des observateurs, des
sources qui ne cherchent pas à tout prix à apparaître sur un écran de télévision et qui sont en
mesure de fournir soit des informations de fond, du « background », de l'analyse, soit des
éléments de pittoresque, de la « couleur », du « vécu ». Les agenciers peuvent donc laisser les
journalistes des chaînes d'information en continu effectuer le travail de terrain, et ensuite,
grâce à la veille médiatique, d'utiliser les chaînes d'information en continu comme source.
« Quand j'étais à Washington, j'étais au desk, on surveillait CNN et CBS en permanence.
Pour CNN, si c 'est une breaking news, on n 'a pas le temps de confirmer tout de suite, alors
on fait un urgent à partir de CNN, ensuite on fait un lead et les reporters prennent ensuite le
relais. »
Ainsi, l'AFP a-t-elle tendance à laisser les scoops aux chaînes d'information en continu (qui
n'ont l'exclusivité du scoop que quelques minutes, le temps que l'agence reprenne
l'information) et à chercher plutôt à se distinguer par la validité de ses informations, par des
mises en contexte, par l'analyse et par la « couleur » que peuvent leur fournir leurs sources
privilégiées et exclusives. Bref, l'agence se met, dans une certaine mesure, à la remorque des
grandes chaînes de télévision, mais elle cherche à s'en distinguer en donnant à ses dépêches
une valeur ajoutée. Concrètement, lorsque des chaînes, comme la BBC, CNN ou Al Jazeera,
diffusent une nouvelle sur un événement ou un sujet qui n'a pas été traité par les journalistes
de l'AFP, alors ceux-ci rédigent immédiatement une dépêche, quelle que soit la valeur
184
informationnelle qu'ils donnent à la nouvelle, en essayant de lui donner un angle différent ou
en ajoutant des éléments complémentaires inédits.
Le mode de production et de diffusion de l'information des chaînes d'information en continu
influe sur celui des agenciers. « Dans les informations télévisées, l'emphase sur la vitesse lie
de plus en plus des journalistes à la technologie, et contraint les journalistes des agences de
presse à surveiller la couverture télévisuelle. L'apparente réalité et la large diffusion des
images télévisées intensifient la pression éditoriale sur les journalistes d'agence qui doivent
faire correspondre leurs informations aux informations télévisées. »206 En effet, les chaînes
d'information en continu misent sur l'information en direct, en temps réel, et en font en
quelque sorte leur marque de commerce. Alors qu'autrefois l'agence devait transmettre
l'information rapidement, maintenant elle est en concurrence avec un média dont le credo
n'est pas la rapidité mais l'instantanéité. Par ailleurs, la télévision devient le média dominant;
par la force des images et par sa large diffusion, la télévision tend à devenir le média de
référence. Par conséquent une information crédible est une information qui correspond à ce
que la télévision montre et peut montrer.
La pression des chaînes d'information en continu contribue notamment à développer une
logique d'urgence207 toujours plus importante. Les agences de presse, sous la pression de la
concurrence, mènent une surenchère à l'urgence (« très souvent on urgente parce que la
compétition urgente ») qui s'est accentuée au point que les fils des agences connaissent un
surcroît de dépêches urgentes rendant difficile le choix des clients. Comme nous le verrons au
prochain chapitre, la classification des urgents avait été initiée pour faciliter la hiérarchisation
des informations et permettre au client d'effectuer sa propre sélection parmi les dépêches,
mais l'effet pervers est qu'en multipliant les urgences, il n'y a plus d'urgence.
206 Boyd Barrett, Boyd, O., Rantanen Terhi, 0, « News Agency Foreign Correspondents ». InTunstall, J., Media Occupation and Professions, A Reader, Oxford University Press, New York, 2005,p. 139 : «In télévision news, the emphasis on speed increasingly lies reporters to the technology, anddes wire service reporters to their offices monitoring télévision coverage. The "apparent " reality andwide diffusion of télévision news images intensifies editorial pressure on wire service reporters tomatch the télévision stories » (traduction réalisée par l'auteur).207 La question de la gestion de l'urgence dans les entreprises de presse a été traitée par RozenblattPatrick, « L'urgence au quotidien », Réseaux n° 69, Cnet, Paris, 1995, page 74.
185
La stratégie de l'agence qui consiste à reprendre en la complétant l'information diffusée par
les chaînes d'information en continu n'est pas sans poser des problèmes. Dans quelle mesure
les journalistes peuvent-ils se fier aux informations diffusées par les concurrents ? Les
agenciers que nous avons rencontrés font preuve d'une grande réticence à utiliser les chaînes
d'information en continu comme sources, bien que la rédaction en chef elle - même les
encourage à le faire lorsqu'ils ne disposent pas de leurs propres sources.
En ayant en tête toutes les précautions nécessaires, nous devons utiliser davantage les
images de télévision. Le service Alerte et Analyse est équipé pour fournir par notes
des éléments de couleur et des citations reprises de télévisions. Autant de matériel que
nous devons utiliser quand nous manquons de sources directes, et ceci jusqu 'à ce que
les correspondants soient pleinement opérationnels20
La stratégie des journalistes de l'agence consiste à utiliser les chaînes d'information surtout
comme des « alertes », ce qui leur permet, dans un premier temps, de diffuser rapidement
l'information sur leurs fils en citant la chaîne comme source, de manière à se prémunir contre
les critiques si l'information s'avère fausse. Puis, dans un second temps, ils vont chercher à
vérifier l'information diffusée par les chaînes auprès de sources complémentaires, de manière
à reprendre l'information à leur propre compte sans citer la chaîne de télévision et,
éventuellement, en la complétant. Les agenciers préfèrent citer le média qui a diffusé
l'information, même s'il s'agit d'un concurrent, plutôt que de se risquer à donner une
information erronée sous leur propre nom.
En effet, utiliser une information diffusée par un autre média n'est pas sans risque. Lorsque le
journaliste reprend une déclaration diffusée simultanément par une chaîne d'information en
continu, il réalise un gain de temps considérable, mais l'information diffusée par les chaînes
d'information en continu peut se révéler fausse. Les journalistes se retrouvent face à un choix
cornélien : diffuser l'information de la chaîne d'information en continu au risque que
l'information soit inexacte, ou prendre le temps de la vérifier et se faire dépasser par les
agences concurrentes. La décision revient alors au directeur de bureau :
AFP, Rapport de la réunion des rédactions en chef régionales, réseau intranet - ASAP, 2005.
186
Si CNN annonce quelque chose, on se sent obligé de vérifier nous-mêmes avant de
sortir cette information. Ils [les journalistes des chaînes d'information en continu] ne
sont pas du tout à l'abri de l'erreur. Au moment du 11 septembre, Alerte et Analyse a
produit un message disant : 'CNN dit que des péniches transportent des cadavres '.
J'étais à New York, j'ai dit tant qu'on n 'a pas vérifié on ne le dit pas, on ne donne que
ce que l'on a vérifié. Nous, on n'a jamais donné de faux bilans lors du 11 septembre
2001.
Les grandes chaînes d'information continue ont un tel impact à l'échelle internationale,
qu'une rumeur diffusée par elles devra être couverte par l'agence car, du fait même de sa
large diffusion et de son impact réel ou potentiel, la rumeur devient une nouvelle
incontournable.
// se peut qu 'il y ait une rumeur qui est parfaitement improbable. Avant qu 'on puisse
vérifier et démentir l'information, celle-ci est sortie, c 'est sur la place publique et ça
joue sur le cours du dollar, bref ça génère une réaction réelle. On est donc parfois
obligé de tenir compte des fausses rumeurs dans la couverture de l'information.
Quoi qu'il en soit, on constate que, dans un contexte où la vive concurrence dans le système
médiatique, l'accélération de la vitesse de circulation des informations et l'impact des images
sont autant de facteurs qui semblent favoriser les chaînes télévisées d'information continue,
une des manières par lesquelles l'AFP cherche à se distinguer consiste à offrir à ses clients
une certaine garantie quant à la validité des informations qu'elle diffuse.
187
3.2 Un journalisme pris entre mimétisme et différenciation
Les activités de veille des concurrents directs (les autres agences de presse) ou indirects (les
chaînes d'information en continu) et les activités de vérification constituent une part
importante de l'activité professionnelle du correspondant étranger de l'agence. La course à la
surenchère informationnelle peut même conduire les journalistes à créer « artificiellement »
l'événement en lui donnant une importance qu'il n'aurait pas eue autrement. Ainsi, le 9 mars
2005, le bureau du Caire reçoit une note de leur service Alerte et Analyse leur indiquant que
l'agence Reuters a diffusé une dépêche portant sur de nouvelles découvertes sur les
mésaventures de l'archéologue qui a découvert la tombe de Toutankhamon. Bien qu'il n'y ait
aucun élément nouveau, les journalistes se doivent de produire un papier sur ce sujet.2 Le
directeur du bureau évoque alors la situation en ces termes : « L 'information en elle-même
n 'avait aucun intérêt, comme on était un peu en retard, on a pris un autre angle car la red
chef de Paris voulait quelque chose à vendre. On a fait un papier magazine, ils estimaient
qu'il fallait reprendre le papier, ça fait grand public. »
L'objectif de l'agence étant de ne pas se laisser dépasser, elle suit au plus près la couverture
des chaînes d'information en continu. Ce mouvement de mimétisme conduit à une
uniformisation des contenus diffusés dans le monde. Pierre Bourdieu parlait à ce propos d'une
« circulation circulaire de l'information ». Dominique Marchetti approfondit cette analyse'
en soulignant que le mouvement de mimétisme prend sa source dans les titres les plus proches
des pôles commerciaux. Les chaînes d'information en continu et Internet se constituant
comme les acteurs les plus proches du pôle commercial, ils sont le plus souvent à l'origine du
mouvement.
209 Dépêche AFP, 9 mars 2005, «La malédiction de Toutankhamon poursuit l'archéologue qui l'adécouvert » (Papier d'angle), annexe A-16.
10 Marchetti Dominique, « Contribution à une sociologie des évolutions du champ journalistique »,Thèse sociologie, EHESS, 1998.
188
L'innovation technologique qui permet d'avoir accès via les réseaux satellite et Internet aux
fils des autres agences de presse et aux programmes des chaînes internationales d'information
continue, conduit le journaliste à rédiger « l'oreille collée au poste ».
Les conditions techniques de production permettent aux journalistes de savoir en
temps réel ou presque comment les concurrents couvrent les événements en cours, ils
ont aussi la possibilité de savoir rapidement et précisément comment le public réagit à
ces messages, aux leurs comme à ceux des autres concurrents. Les journalistes se
trouvent alors engagés dans un processus d'interactivité et de réflexivité sans
précédent dans l'histoire et qui permet dorénavant aux producteurs de messages
d'ajuster rapidement leur message à ceux des concurrents et aux réactions du
public2'1
Si les médias ont toujours constitué une source d'information pour les journalistes
{«personne n 'écrit V actualité du jour sur une page blanche. Chacun, en somme, retouche une
page en partie déjà écrite par d'autres »212), les modalités de la veille concurrentielle qui
s'établit désormais en temps réel, encouragent autant le mimétisme que la distinction. Non
seulement les journalistes doivent s'assurer qu'ils traitent tous les événements couverts par
leurs concurrents, mais ils doivent également produire de l'innovation afin de retenir le client.
Le contexte hyper concurrentiel ainsi que la rapidité avec laquelle les journalistes tendent à
reproduire les choix rédactionnels et les stratégies de leurs concurrents, conduisent l'agence et
ses journalistes à se renouveler toujours davantage. Comme nous l'avons vu dans la seconde
partie, les agenciers tentent de se distinguer des chaînes d'information en continu en
produisant des dépêches d'analyse, des mises en perspective de l'événement qui exigent une
temporalité plus longue que celle de la chaîne d'information en continu qui fournit une
couverture immédiate de l'événement. Les journalistes peuvent également se distinguer sur la
mise en forme de l'information : «Le souci de ne pas offrir une information lacunaire incite
211 Brin, Colette, de Bonville, Jean et Charron, Jean, Nature et transformation du journalisme. Théorieet recherches empiriques, les Presses de l'Université Laval, Québec, 2005, chapitre 8: « Lejournalisme et le marché : de la concurrence à l'hyperconcurrence», pp.273-274.212 Cornu, Daniel , Journalisme et vérité, Pour une éthique de l'information, Genève, Labor et fides,1994, page 309.
189
chaque média à tenter le pari constant de raconter tout ce que les autres disent et d'offrir, en
plus, des informations, des éclairages, des reportages qui n 'appartiennent qu 'à lui seul. »21
Le jeu concurrentiel entre les agences se joue sur la mise en forme de l'information. C'est
ainsi que l'agence propose au client un vast<
d'analyse constitue à cet égard une illustration.
ainsi que l'agence propose au client un vaste choix de types de dépêches214, la dépêche
3.3 Les relations entre le correspondant étranger et le desk
L'introduction de l'informatisation a sensiblement modifié la composition de la main d'œuvre
de l'Agence France Presse. Entre 1952 et 2000, la proportion d'employés de presse sur
l'ensemble des employés a diminué de moitié, passant de 25 % à 13 % alors que la proportion
de journalistes a connu une croissance importante, passant de 40 à 59 %. En somme, le
nombre d'intermédiaires entre le journaliste de terrain et le client a considérablement diminué.
Le journaliste agit encore et toujours sous le contrôle de son desk, mais pour le reste il est le
seul concepteur de sa copie.
Le développement des nouvelles technologies, notamment le courrier électronique et le
téléphone portable ont modifié le rapport entre les journalistes sur le terrain et les rédacteurs
en chef. Le journaliste d'autrefois jouissait, par rapport au desk, d'une relative autonomie
dans la mesure où il était difficile à joindre et surtout parce que ses choix de couverture
étaient difficilement contestables par le desk puisqu'il disposait d'une connaissance du terrain
et des événements auquel les cadres du desk n'avaient pas accès. Ces conditions n'existent
plus. Le journaliste d'aujourd'hui est en contact quasi permanent avec le desk d'abord parce
que son travail est de plus en plus sédentaire et aussi parce que le portable permet de le
rejoindre là où il se trouve. Mais surtout, grâce aux chaînes d'information en continu, à
Internet, et aux dépêches des agences concurrentes, le desk dispose aujourd'hui d'une
connaissance du terrain et des événements parfois supérieure à celle que peut avoir le
213 Cornu, Daniel, op.cit, page 309.214 Ce thème ayant été largement abordé au cours du chapitre précédent, nous invitons le lecteur à s'yreporter.
190
journaliste lui-même et qui lui permet de téléguider, en quelque sorte, les faits et gestes de son
correspondant sur le terrain. Nous aborderons plus longuement cette question dans le chapitre
suivant où il sera question notamment les outils de communication entre les journalistes sur le
terrain et les différents acteurs de l'agence.
Pour le moment, nous allons souligner quelques changements dans le rôle joué par le desk qui
sont en lien avec la régionalisation et la décentralisation de la production. Depuis 19852L>,
l'AFP s'est engagée dans un processus de régionalisation de sa couverture et a ainsi
décentralisé en partie son système production de l'information, en déléguant à des bureaux
régionaux le contrôle de la couverture de certaines aires géographiques. L'AFP comporte
quatre desks régionaux : le desk Europe-Afrique, localisé à Paris, qui comporte les services
administratifs, techniques et commerciaux généraux, la rédaction générale et le service de
veille Alerte et Analyse; le desk Amérique, localisé à Washington; le desk Asie-Pacifique,
localisé à Hong Kong, et le desk Moyen-Orient, situé à Nicosie.
Tous les abonnés de l'agence ne reçoivent pas toutes les dépêches produites par l'AFP.
L'agence a découpé sa production en plusieurs fils, un fil désignant un ensemble de dépêches
regroupées sur des critères thématiques, géographiques ou linguistiques. Le travail du desk
régional consiste à regrouper les dépêches en fonction de l'intérêt qu'elles présentent pour les
différents groupes d'abonnés. Le desk dispose d'une grande connaissance de la clientèle et de
la concurrence, et peut, en outre, commander aux agenciers du bureau local, des papiers
spécifiques pour compléter une couverture que le chef du Je?/: juge insuffisante par exemple,
ou encore pour diffuser une analyse d'un événement sous plusieurs angles.
Les progrès techniques ont conduit le correspondant étranger et les bureaux locaux à être
davantage responsables de leur copie. Le rôle des journalistes du desk a sensiblement évolué;
comme on l'a vu, il consiste de moins en moins à effectuer à une correction des dépêches et
de plus en plus à veiller à la bonne composition du fil, en évitant notamment une
surabondance de dépêches qui nuirait à l'usage des clients, et à offrir une diversité de
15 En 1985, l'AFP crée trois centres régionaux de production et de diffusion (Hong Kong, Nicosie àChypre et Washington), en 1987 le centre régional de Nicosie est inauguré, le desk arabe du Caire esttransféré à Nicosie. En 1997, l'AFP ouvre son régional hispanophone de Montevideo.
191
traitement de l'événement. Il est également l'interface entre les clients locaux et régionaux et
les différents bureaux locaux de la région qu'il supervise. Le bureau régional est au service de
la clientèle, il peut également procéder au démarchage de nouveaux clients, faire connaître les
nouveaux services de l'agence à la clientèle. Si le journaliste est davantage tourné vers les
informateurs et les événements, le desk est orienté vers la clientèle, ce qui explique les
tensions ou les conflits entre les bureaux locaux et le bureau régional dont ils dépendent.
La régionalisation des desks a complexifié la hiérarchie au sein de l'agence, les niveaux de
responsabilités s'étant multipliés. Les journalistes qui ont débuté avant la régionalisation de
l'agence considèrent que la régionalisation du contrôle des dépêches a permis de «.gagner en
découpage de la dépêche et en précision ».
On est organisé en région, ce qui est très pratique parce que l'on connaît notre région,
ce n'est pas une grande rédaction en chef centrale qui est censée s'occuper de la
planète entière, on en vient à connaître chaque journaliste de la région, qui il ou elle
est, comment il va réagir, comment on peut lui demander, le facteur humain est très
important.
Au cours de ce chapitre, nous avons établi que la chaîne de production de l'information avait
connu des transformations importantes depuis 1945. Le nombre de sources à la disposition
des journalistes s'est considérablement accru, la division du travail au sein de l'agence et les
fonctions au sein de l'agence ont été redéfinies. L'évolution des techniques, des transmissions
et des communications n'est pas étrangère à ces transformations comme nous allons le voir
dans le chapitre suivant.
192
-CHAPITRE 8- TECHNIQUES, TRANSMISSIONS ETCOMMUNICATIONS
L'histoire des agences de presse est intimement liée à celle des techniques :
télégraphe, téléphone, radiotélégraphie, télex, télécopieur, plus récemment
communication par satellite et informatique. Le progrès technique a largement façonné
les pratiques des correspondants étrangers.
Dans ce chapitre, nous verrons qu'au début de la période à l'étude, soit dans les années
1940 à 1960, les techniques de transmission sont rudimentaires, peu performantes et
peu fiables216. Aussi, le quotidien des correspondants étrangers est-il rythmé par la
recherche de moyens de transmission et par la transmission elle-même. La technique
limite la taille de la copie; en revanche, elle conditionne peu l'écriture de la dépêche,
qui demeure relativement libre. Enfin, les difficultés de transmission et de
communication entre le siège et le terrain conduisent le journaliste à agir dans un
relatif isolement par rapport à sa rédaction.
Plus tard, au cours des années soixante-dix et quatre-vingt, la capacité des dispositifs
de transmission et de communication va s'améliorer considérablement, bien que les
équipements de transmission et de rédaction, désormais portables, demeurent encore
relativement contraignants. Les journalistes acquièrent une certaine autonomie, qui les
conduit parfois à se sentir isolés de leurs confrères.
216 La vitesse de transmission est de 50 bauds soit 60 mots par minute, chaque lettre correspondant àcinq moments ou impulsions électriques.
193
Dans les années quatre-vingt-dix et deux mille l'innovation technique s'accélère et
contribue à transformer profondément les pratiques. Le développement des satellites
permet la mise en place des chaînes d'information continue. L'avènement du réseau
Internet, qui rend l'information très largement disponible et qui accroît sa vitesse de
circulation, contribue également à modifier radicalement les conditions de la pratique
des agenciers.
Section 1 - Les transmissions au temps de la première configuration : autonomieet polyvalence du correspondant
1.1 Un journaliste expert en transmissions
Jusqu'à l'apparition des liaisons par satellite et des réseaux informatiques, transmettre une
dépêche constitue un véritable défi pour le correspondant étranger. Le temps imparti à la
transmission est largement supérieur au temps imparti à la rédaction. Les outils de
transmission sont incertains et peu sûrs, aussi les journalistes consacrent-ils une large part de
leur temps à s'assurer qu'ils pourront transmettre leur copie.
En fonction de leur situation géographique et de l'état de l'équipement technique dans le pays
où ils se trouvent, les journalistes doivent choisir le moyen le plus fiable parmi ceux à leur
disposition : téléscripteur, radio téléscripteur, télégramme à des bureaux plus importants qui le
retransmettent à Paris, télex dans les pays équipés, téléphone et communications
télégraphiques. Toutefois, le journaliste ne dispose pas toujours d'un tel choix et il arrive
même qu'il ne dispose d'aucun moyen de transmission à l'endroit où il se trouve. Cette
situation est fréquente dans les zones géographiques isolées et difficiles. Le correspondant
doit alors faire preuve de débrouillardise et d'inventivité.
On avait un problème de transmission, tout était un problème. Quand vous pensez
qu'au Vietnam, jusqu'en 1973, on n'avait pas de télex, ce qui est insensé. On
transmettait par ondes radio, on avait des émissions radio de telle heure à telle heure
dans la journée, et après il y avait un blanc. Si l'émission radio se terminait et qu'on
avait un papier en cours ou un truc important, on pouvait la prolonger mais, c'était
194
mal capté, alors Paris nous envoyait : ' Mal capté, tout brouillé', il fallait prendre la
bande perforée qu'on envoyait par émission radio, aller au télex international public
pour faire partir la bande. C'était complètement dingue, alors que toutes les autres
agences avaient des télex depuis belle lurette. 2n
Le journaliste doit se faire technicien et bricoleur et apprendre à maîtriser ces outils de
transmission : « J'ai vécu avec le télex pendant 40 ans à une vitesse de plus en plus
rapide. Je savais le démonter, c'était une bande perforée, deux trous en haut, trois
trous en bas. »
Le problème est décuplé dans les zones de conflits armés puisque les moyens de
transmission représentent une cible prioritaire pour les belligérants. Les moyens de
transmission réduits à néant, cela limite les risques d'information pour un camp ou
pour un autre. Un correspondant étranger qui a longtemps assuré la couverture de
certains pays d'Afrique pour le compte de l'AFP : « Parfois, je partais dans des
régions où je ne savais pas si j'allais pouvoir transmettre l'information. Il m'est arrivé
de ne pas pouvoir donner d'information pendant une semaine car le nouveau pouvoir
politique en place avait coupé tous les systèmes de communication. » Les journalistes
doivent parfois prendre des risques pour transmettre leur copie à la rédaction en chef
centrale. Les agenciers qui ont connu ces situations ont tous des prouesses à raconter à
ce sujet. Par exemple :
Quand j'étais au Congo, au Katanga, l'ONU commençait par bombarder la
poste dans le but d'empêcher les communications. Il fallait faire partir quand
même la copie. Pour cela, il fallait emmener la copie en Rhodésie, qui était à
peu près à 200 kilomètres, par des routes qui étaient plus des pistes que des
routes d'ailleurs, et c'était parfois très dangereux. Quelquefois aussi, on allait
porter la copie en Rhodésie par avion. On trouvait aussi d'autres systèmes, des
fois on confiait des trucs à des télégraphistes amateurs qui envoyaient ça en
morse (...) Moi, j'avais découvert par hasard que les Belges avaient une espèce
de poste semi-clandestin, j'envoyais des nouvelles par leur poste. J'allais en
217 L'AFP parvient à augmenter sa vitesse de transmission à partir des années 1977-1978, la vitesse detransmission croît de 50 à 300 bauds.
195
douce là-bas, pas très loin de l'hôtel. On organisait aussi des systèmes de pool
qui emmenaient la copie de tout le monde à la poste.
Les problèmes de transmission peuvent également être liés à la censure exercée par les
autorités locales dans certains pays ou encore par la combinaison de tous ces facteurs :
conflits, censure et moyens de transmission. « En Corée, il fallait passer par la censure,
ensuite on se disputait le téléphone pour appeler Tokyo, il y avait souvent un seul téléphone
pour tout le monde, on prenait son tour.» C'est ainsi qu'une ancienne journaliste en poste à
Moscou pendant la guerre froide relate ses difficultés à transmettre l'information dues
notamment au contrôle, par la censure, de la copie à destination de l'étranger. « Certes, on
avait des problèmes de transmission, mais parfois quand il y avait quelque chose d'important,
hop ça ne marchait plus, on ne savait pas pourquoi ...du moins officiellement! »
L'exigence de rapidité imprègne de manière déterminante la pratique journalistique. Les
correspondants à l'étranger ne font pas exception, cependant, au cours de la première période,
les nombreuses difficultés de transmission qu'ils rencontrent et leur dépendance à l'état des
réseaux de transmission limitent leur capacité de faire vite. Par conséquent, ils n'ont qu'une
faible influence sur la course au temps à laquelle se livrent, par ailleurs, les agences.
1.2 Le relatif isolement du correspondant étranger
Le correspondant de la première période paraît, si on le compare à celui d'aujourd'hui comme
un travailleur plutôt solitaire. Quand il est sur le terrain - et il le fréquente plus assidûment à
cette époque - les difficultés de communication l'isolent parfois de ses supérieurs et ses
confrères concurrents qui sont, comparativement à aujourd'hui, moins nombreux.
196
1.2.1 Isolement par rapport à la concurrence et à la rédaction centrale
Au sortir de la guerre, les correspondants étrangers disséminés dans le monde sont, en effet,
bien moins nombreux qu'aujourd'hui. Le journaliste n'est donc pas systématiquement entouré
de confrères; contrairement à aujourd'hui, le «journalisme de meute » (packjournalism) est
l'exception plutôt que la règle. Lorsque le journaliste est envoyé dans un lieu où se côtoient
un certain nombre de journalistes, les relations qui s'établissent sont plutôt amicales. Pour
autant, ils ne s'informent pas les uns et les autres de leur couverture. Lorsque le journaliste
rédige sa copie, il n'a pas toujours l'occasion de prendre connaissance précédemment du
traitement accordé par son concurrent au même événement. Si la communication entre
concurrents existait à l'époque, elle était soumise aux aléas des circonstances, des affectations
et des affinités qui pouvaient s'établir entre des journalistes, elle n'avait pas de commune
mesure avec la surveillance systématique et organisée telle qu'elle existe aujourd'hui. Par
ailleurs, les transmissions étant difficiles et coûteuses, la rédaction centrale n'a pas le loisir
d'informer simultanément et de façon permanente le correspondant étranger de la couverture
effectuée par ses concurrents. Le siège transmet à ses correspondants, quand il le peut, la
couverture des concurrents mais sans exercer une grande pression sur les journalistes, «Le
siège se contentait de nous donner la concurrence, ils étaient très gentils. On se sentait
totalement indépendants. »
Ce que les correspondants ont fréquemment noté, particulièrement s'ils étaient dans le
métier depuis longtemps, c'est que la révolution technologique avait changé
considérablement leur relation avec la maison mère. Dans le passé il était difficile de
mettre la main sur une ligne téléphonique, et les télex n'étaient pas des moyens
efficaces pour communiquer de manière rapide et solide (...) en conséquence les
rédacteurs avaient peu d'espoir d'avoir des contacts rapides et fréquents.
18 Hannerz, Ulf, Foreign News, Exploring the World of Foreign Correspondents, The University ofChicago Press, Chicago, 2004, page 149 : «What correspondentsfrequently notedespecially ifthey hadbeen in business for a long time, was that the technological révolution had changea their contact withthe office at home a great deal. The past it could be difficult to get hold of a téléphone Une, and télexmachines were not particularly effective means of communicating intricate meanings quickly andsecurely (...) Consequently the expectations of editors for quick and fréquent contacts were at modestlevel » (traduction réalisée par l'auteur)
197
Le journaliste n'est informé de la couverture de ses concurrents que lorsque la rédaction juge
qu'il a manqué une information ou bien lorsqu'il est le seul à avoir transmis une information
essentielle. Être seul sur une information est un cas difficile à gérer par l'agence, la crédibilité
du journaliste et de l'agence pouvant être remise en cause. Le journaliste subit alors peu de
contraintes de la part de son desk, il ne se fie alors qu'à lui-même, « On travaillait à l'aveugle,
sans savoir ce qui était sorti dans le reste du monde ». Cet isolement est ressenti de manière
positive par le journaliste, car il rédige ses papiers sans subir l'influence de ses confrères, ni
les directives de la rédaction en chef centrale. « Plus on était dans le brouillard, plus on se
croyait le centre du monde, et c'était une bonne chose car on écrivait le papier comme si on
était le centre du monde ». Ce journaliste indique qu'il appréciait de pouvoir exercer sans
avoir été contraint de quelque manière que ce soit, il appréciait de pouvoir rédiger ses
dépêches sans subir l'influence d'un confrère ou d'une direction. Son affirmation est d'autant
plus forte, qu'aujourd'hui il est influencé par la copie de ses concurrents dont il prend
connaissance en même temps qu'il rédige son papier, et que l'écriture de sa dépêche est
fortement orientée par sa rédaction en chef. Toutefois, lorsque l'isolement perdure, le
journaliste éprouve aussi une grande frustration à rédiger des papiers qu'il ne peut pas faire
parvenir à sa rédaction.
Sur le terrain, le journaliste est autonome, la rédaction de sa copie se fait dans une relative
indépendance à la fois par rapport au desk et par rapport aux concurrents. L'information
diffusée par les concurrents a donc peu d'influence, parfois aucune, sur la manière dont
l'agencier de l'AFP couvre les événements tout simplement parce que celui-ci n'est pas en
mesure de savoir ce que font les concurrents. Il subit peu de pression de la part de sa rédaction
en chef pendant qu'il rédige sa copie. Comme la rédaction en chef ne dispose pas de moyens
pour connaître l'actualité et le terrain du journaliste, celui-ci peut choisir plus librement les
sujets à traiter et la manière de le faire. Enfin, comme les difficultés de transmission valent
également pour les messages que la rédaction en chef centrale envoie au correspondant
étranger, celui-ci le journaliste n'est informé des choix et de la performance des concurrents
qu'a posteriori. Bref, si la technique impose au journaliste des contraintes parfois lourdes, elle
lui procure tout de même un avantage, celui d'une relative autonomie professionnelle.
198
1.2.2 Un rédacteur multilingue
Homme à tout faire de l'information, l'agencier de cette époque est non seulement journaliste
et technicien en télécommunication, il est aussi traducteur. Comme nous l'avons vu
précédemment, l'AFP doit, pour répondre aux besoins de ses clients disséminés un peu
partout dans le monde et tenter de conquérir de nouveaux marchés, diffuser ses dépêches en
plusieurs langues. Aussi les services de traduction de l'agence, qui logent à la rédaction
centrale, constituent-ils un organe essentiel pour l'organisation. Cependant, traduire demande
du temps; or, dans la course contre la montre à laquelle participent les agences internationales,
le temps est compté. Comme l'agence ne dispose pas des moyens financiers pour placer des
rédacteurs de différentes nationalités dans l'ensemble de ses bureaux situés à l'étranger, les
journalistes de l'AFP, en grande majorité des francophones polyglottes, sont amenés à rédiger
leur copie en plusieurs langues. « II y a quarante ans, une partie de la copie en Inde était fait
en anglais. C'est moi qui l'écrivais en anglais avec plus ou moins de talent, mais j'écrivais
aussi en espagnol. »
Rédiger sa copie dans une langue étrangère permet au journaliste d'atteindre directement et
plus rapidement la clientèle de l'agence, sans passer par le service de traduction de la
rédaction centrale. Il arrive même que le correspondant étranger rédige sa copie en anglais ou
dans la langue du pays où il se trouve afin de permettre à la censure, le cas échéant, de mener
l'examen la copie le plus rapidement. « // m'est arrivé dans certains endroits de travailler en
anglais, parfois pour faciliter la censure et que ça aille plus vite ». Ainsi le journaliste peut
espérer battre la concurrence. De tels comportements, qui dénotent un souci constant de faire
vite, montrent que, même si, à cette époque, les agenciers jouissent d'une relative autonomie,
ils ont incorporé les contraintes et les nonnes qu'impose le jeu concurrentiel auquel participe
leur organisation et ils s'y conforment volontiers.
1.3 Incidences de la technique sur la copie
À cette période, l'activité de rédaction et l'activité de transmission sont deux activités
dissociées dans la pratique journalistique, le journaliste n'étant pas toujours responsable de la
199
transmission de la copie, tâche qui revient dans les bureaux à des opérateurs techniques. En
cela, la division des tâches journalistiques est plus prégnante dans les années soixante-dix
qu'à l'heure actuelle, où le journaliste où la rédaction et la transmission se font sans difficulté
et par le même individu. Bien que constituant deux activités dissociées, la technique
caractérisée par la fragilité et le coût des outils de transmissions, conditionne la rédaction de
la copie tant du point de vue de l'écriture que de la taille de la copie.
Comme ça coûtait très cher, on avait droit de transmettre de 100 à 150 mots ma-xi-
mum / , ( . . . ) Lorsqu 'on partait en Libye, on prenait avec nous de l'argent liquide. On
connaissait la valeur du mot, on veillait à ce que tout soit condensé dans l'essentiel,
parce que si on partait pour une semaine on ne pouvait pas se permettre de
retranscrire en entier un entretien, sinon on était à sec le lendemain.
Pour les agenciers d'aujourd'hui, la transmission de la copie ne constitue pas, de manière
générale, un objet de préoccupation; le plus souvent la transmission s'effectue par un clic de
souris. La situation des journalistes de la première période était tout autre, eux qui devaient
souvent consacrer une grande partie de leur temps et leur énergie aux activités de
transmission. Le temps consacré à la rédaction de leur dépêche était souvent, en comparaison,
très court. Parfois le journaliste rédigeait sa copie alors qu'il attendait la communication ou
qu'il faisait la queue pour avoir accès au seul moyen de transmission existant que se
disputaient tous les journalistes. « On travaillait par téléphone quand il n 'y avait pas de télex.
Il nous arrivait à tous de demander la communication avant d'avoir écrit une ligne, et de
rédiger la dépêche quand on avait quelqu'un au bout du fil ». Par ailleurs, comme la
technique était peu fiable, le journaliste transmettait les faits essentiels, il ne rédigeait pas
plusieurs types de papiers sur un même événement comme c'est aujourd'hui le cas : « Avant,
quand tu avais informé de l'essentiel c'était fini, maintenant non, il faut revenir, alimenter,
alimenter, parce que l'on a différents services, différents deadlines, et il faut toujours que ce
soit actualisé. »
À cette époque, l'exigence concernant la rédaction des dépêches est donc moins forte
qu'aujourd'hui, l'écriture est plus libre. Par ailleurs, compte tenu des contraintes de
transmission, le journaliste dispose de plus de temps pour « penser » son prochain papier dès
200
lors qu'il a envoyé sa copie. Les contraintes de transmission sont telles que le desk s'attend à
recevoir des informations dans un style parfois approximatif plutôt qu'une copie bien léchée.
Les correspondants étrangers savent dès lors qu'ils envoient leur texte, que celui-ci va faire
l'objet d'un examen minutieux de la part du desk et d'une réécriture si nécessaire. Compte
tenu du peu de temps qui leur est imparti pour rédiger et de la nécessité d'économiser les
mots, l'écriture des dépêches est souvent peu soignée. D'ailleurs, à cette époque, le style
d'écriture des dépêches est relativement peu normalisé. « On écrivait nos dépêches
instinctivement ».
Section 2- Transformations des rapports entre le correspondant et le desk et desmodalités de la concurrence
2.1 Des ressources multiples à la disposition du correspondant
À la fin des années soixante, le coût des transmissions diminue sensiblement, et l'usage du
télex (qui permet une transmission de la copie sur des lignes téléphoniques rapides) se
généralise. Les correspondants sont donc en mesure d'adresser leur copie au desk central sans
passer par l'étape de l'écriture « en nègre ». Toutefois, les transmissions sont encore peu
fiables et l'usage du télex semble encore très fastidieux pour les correspondants étrangers,
- Les changements techniques ont été considérables. Je me revois encore à Téhéran
avec un télex aveugle disposé sur des caisses en bois. On tapait sur un télex, on voyait
des bandes à trous, on devait repérer nos erreurs,
- À l'époque on travaillait avec des télex qui marchaient à 50 bauds; il fallait que je
tape sur une vieille machine Remington, que je le donne à un opérateur. S'il y avait
des tempêtes de sable, il fallait le refaire la nuit, c'était très archaïque. En Jordanie,
pour communiquer avec le reste du monde, il nous arrivait de partir d'Amman en taxi
au prix fort, (le bureau de l'AFP avait été bombardé), jusqu 'au bureau de Damas (16
heures aller).
201
Au cours des années soixante-dix, l'AFP s'appuie sur différents systèmes de transmission : le
câble téléphonique, la radio, le radio téléscripteur (960 000 mots par jour219 sont transmis par
radio téléscripteur en 1979), et les satellites dont la première liaison est réalisée en 1971. Cinq
ans plus tard, en 1976, l'AFP dispose de dix-huit liaisons satellitaires220 dans le monde. C'est
ainsi qu'en 1979, l'AFP transmet 1 100 000 mots par jour via les réseaux satellitaires.
Dans les années soixante-dix, les journalistes deviennent plus mobiles. Ils peuvent utiliser les
premières consoles portables, plus pratiques mais encore peu conviviales. « Les consoles
portables, c'était des petites consoles, vous ne voyiez pas combien il y avait de mots, vous ne
voyiez pas si votre lead faisait quatre lignes, vous travailliez en aveugle. L'avantage c'est que
les transmissions passaient toujours. Pour transmettre, il fallait une ligne téléphonique, il
fallait se brancher sur une prise téléphonique, dans un endroit téléphonique, on ne pouvait
pas consulter le retour. Alors que maintenant c'est un monde de différence, vous tapez le truc,
avec le téléphone satellitaire, vous consultez ce qui revient, TOUT a changé. ».
Les liaisons par satellite permettent aux correspondants de transmettre à partir d'endroits
isolés géographiquement. Toutefois, encore là, les premiers outils de transmission par satellite
sont eux aussi contraignants et peu fiables. « En Somalie, on ouvrait la valise satellitaire, on
déployait le grand parapluie. On se plaçait sur le toit de la maison qu'on louait. La valise
satellitaire pesait plus de huit kilos, c'était lourd à transporter, après c'est devenu quatre
kilos. Le téléphone satellitaire, ça a tout changé. » Auparavant, pour transmettre leurs
dépêches, les journalistes se rendaient tous au même endroit, utilisaient les mêmes outils, tels
la poste, le téléphone de l'hôtel. Ces contraintes techniques créaient, par la force des choses,
des lieux d'échange. Mais à partir du moment où l'agencier a pu utiliser des outils de
transmission portables, il a été davantage isolé de ses confrères.
Enfin dans les années quatre-vingt-dix et deux mille, les ordinateurs portables se généralisent,
les journalistes disposent de téléphone portable qui leur permet de communiquer et de
1 Boyd Barrett, Oliver, Palmer, Michael, Le trafic des nouvelles, les agences mondialesd'information, éd. Alain Moreau, Paris, 1981, page 529.220 Cinq pour l'Asie (4 bilatérales), deux en Amérique du Nord (unilatérales), neuf en AmériqueLatine, et deux en Afrique. In Boyd Barrett, Oliver et Palmer, Michael, Le trafic des nouvelles, lesagences mondiales d'information, éd. Alain Moreau, Paris, 1981, page 528.
202
transmettre leurs dépêches depuis n'importe quel lieu géographique. Le téléphone portable est
un outil essentiel au journaliste. Un des premiers gestes effectués par le correspondant
lorsqu'il arrive au bureau le matin est de charger son téléphone portable afin de s'assurer qu'il
pourra être joignable lorsqu'il partira en reportage. Enfin Internet constitue un nouvel outil de
recherche d'informations, de diffusion des dépêches.
Ces nouveaux outils de transmission et de communication transforment les règles de la
production de l'information. Les producteurs et diffuseurs d'information se multiplient, la
concurrence s'accroît et revêt de nouvelles formes, elle n'est plus le fait d'agences de presse
comme l'AFP mais de chaînes d'information en continu ou de portails internet. Face à cette
intensification de la concurrence, l'agence exige une forte disponibilité de la part de ses
correspondants et a les moyens de cette exigence grâce aux innovations techniques. Ainsi, les
journalistes doivent être en mesure de réagir si un événement de grande importance survient.
Dans certains bureaux comme celui du Caire par exemple, les journalistes sont équipés d'une
console AFP à leur domicile, qui leur permet non seulement de surveiller l'actualité mais
aussi de se mobiliser si l'actualité l'exige.
On dispose d'une console installée chez soi, directement reliée au bureau. Je peux
appeler Mona [une journaliste locale du bureau] à onze heures du soir pour lui dire :
"regardes il y a eu une information très importante". Les journalistes peuvent
travailler chez eux, ils ont un petit bureau exactement configuré comme ici. C'est
surtout des moyens pour communiquer la nuit, les congés, ou quand on est surbooké
ici.
Par ailleurs, l'accroissement de la concurrence associé aux avancées des techniques de
transmission ont renforcé l'exigence de l'agence en matière d'urgence et de volume de
dépêches. Le téléphone portable est l'un des outils qui va permettre au directeur de bureau
d'orienter le journaliste dans son travail, de lui commander des papiers spécifiques en
fonction des besoins exprimés par les clients et de la ligne de couverture qu'il aura établie. Le
journaliste se sent de moins en moins maître de ses mouvements, il obéit aux exigences que
lui fixe son chef de bureau ou bien sa rédaction régionale et il est de moins en moins libre
dans le choix et le traitement des sujets. Si le téléphone portable permet une meilleure
coordination entre le bureau et les journalistes sur le terrain; il est jugé trop astreignant par
certains journalistes. « Moi j'ai un fantasme de journaliste ; c'est de revenir à une époque où
203
pour transmettre il n'y a pas d'autre moyen que le téléphone fixe, et où le reste du temps si tu
n'es pas près du téléphone fixe; il y a personne qui t'emmerde, tu fais ce que tu veux. »
2.2 Journalistes sous le contrôle du desk
2.2.1 Le service Alerte et Analyse : journalistes sous surveillance
Avec l'apparition de nouveaux médias, les sources et les concurrents des agences de presse se
sont multipliés. L'Agence France Presse a donc mis en place en 1995, un service de veille
concurrentielle appelé Alerte et Analyse. Ce service a deux fonctions principales : d'une part,
il surveille les concurrents et alerte les agenciers le cas échéant, d'autre part il analyse la
performance des agenciers pour vérifier leur conformité à celle des concurrents, parmi
lesquelles les agences de presse internationales et les chaînes d'information en continu font
l'objet d'une attention toute particulière. Alerte et Analyse envoie les notes d'alerte aux
rédactions en chef régionales, qui les répercutent auprès des bureaux locaux concernés.
La concurrence est une contrainte lourde et un important facteur de stress pour les
journalistes; Alerte et Analyse est un dispositif organisationnel qui incarne ce facteur de stress
puisqu'il tend à faire de la concurrence une préoccupation constante dans la vie quotidienne
des agenciers. Plus encore, l'existence de ce dispositif repose sur deux postulats détestables
du point de vue des journalistes : un premier postulat selon lequel les journalistes de l'AFP
sont susceptibles de rater un événement que les concurrents, eux, n'auraient pas raté,
autrement dit, qu'ils sont potentiellement incompétents, et un deuxième postulat selon lequel
les concurrents constituent la référence, autrement dit quand les informations des concurrents
diffèrent de celle de l'AFP, ce sont les concurrents qui, a priori, ont raison, de sorte que les
agenciers de l'AFP doivent se justifier. On comprend alors que les interventions & Alerte et
Analyse puissent indisposer certains journalistes. Nous nous proposons d'évoquer
successivement les deux types d'interventions : les « call backs » et les notes d'impact et de
pointage.
204
2.2.1.1 Les call backs : évaluation de la veille concurrentielle exécutée par
les journalistes
Les call backs désignent des notes traitant des «ratages»221 de l'AFP, c'est-à-dire des
événements qui n'ont pas été couverts par l'agence mais qui l'ont été par les autres médias.
Alerte et Analyse, qui établit une surveillance permanente de la concurrence, est chargée de
« sermonner » le bureau en question et de le sommer de donner des explications pour justifier
ce manquement dans la couverture. Ils sont diversement accueillis par les journalistes de
l'agence. Si certains journalistes reconnaissent l'utilité d'un tel dispositif, la majorité des
journalistes interrogés considèrent que les notes ajoutent un facteur de stress supplémentaire
aux journalistes, «Le service Alerte et Analyse est très critique, il dit qu'on est toujours en
retard. Ça peut être sanglant, on n 'a qu 'une envie, c 'est de les enfermer dans une chambre
froide ». Ils jugent par ailleurs qu'elles sont très souvent inutiles, notamment lorsqu'elles
signalent des informations diffusées par des chaînes locales sur lesquelles les journalistes sont
branchés en permanence.
- Quand on était à Londres, on suivait en permanence Sky News, pourtant Alerte et
Analyse se croyait obligé à chaque fois qu'il y avait une breaking news de nous
envoyer une note nous disant : 'Sky News annonce ceci, cela '. La plupart du temps
quand ils nous envoient des trucs, On le sait déjà, donc ça nous sert à rien et
concrètement ça nous énerve,
- Alerte et Analyse, c'est quoi ? Ah oui, on le reçoit sur le fil note. Parfois tu te
demandes si ils lisent le fil de l'AFP avant de regarder la concurrence.
La multiplication des concurrents et l'apparition de médias autres que les agences spécialisées
dans la diffusion en continu d'information conduisent l'agence à exiger une réactivité toujours
plus importante. Les journalistes sont sollicités en permanence par la concurrence. S'ils
manquent une information, ils sont sommés de s'expliquer auprès de la rédaction dont ils
221 Le terme « ratage » est celui employé par le directeur du service Alerte et Analyse dans un état deslieux de la couverture du conflit irakien en avril 2003.
205
dépendent. En effet, Alerte et Analyse se contente de transmettre l'information diffusée par la
concurrence, elle ne produit pas de contre-enquête. Elle prend pour référence, la concurrence,
c'est aux journalistes du bureau local de se justifier si l'information qu'ils diffusent, diffère de
celles des concurrents.
Non seulement il faut faire face à l'information mais il faut faire face également à ce
que donne la concurrence qui parfois est faux, qu'il faut vérifier et démentir. Il faut
parfois se battre avec la rédaction en chef pour dire que c 'est vrai qu 'ils [les
concurrents] ont donné ça, mais que nous, on estime que ça ne vaut rien, que ce n 'est
pas le bon angle, que ce n 'est pas aussi caricatural que ça, etc.
Durant l'enquête de terrain, nous avons été témoin de vifs échanges entre les journalistes du
bureau du Caire et le bureau régional suite à une information diffusée par la concurrence. Le
bureau du Caire a rédigé une dépêche dans laquelle les journalistes indiquent que soixante-dix
membres des « Frères Musulmans » avaient été arrêtés la veille. Le bureau régional situé à
Nicosie (Chypre) a été informé que Reuters a diffusé une dépêche où on dit que c'est deux
cent trente membres des Frères Musulmans qui ont été arrêtés. Le bureau régional envoie
alors une note au bureau du Caire pour avoir des explications : « NICOSIE - 29/03/05 - 1110-
concurrence score aujourd'hui pratiquement partout avec comme angle 'Brotherhood says
over 230 arrested in Egypt ', info que sauf erreur nous n 'avons pas eue. Preneurs d'un follow-
up sur la nervosité apparente des autorités à l'égard des mouvements de contestation inédits
en Egypte ». L'échange entre les journalistes présents au bureau lors de la réception de la note
à"Alerte et Analyse illustre les tensions entre journalistes de terrain et hiérarchie, relatives à la
pression de la concurrence et aux interventions d'Alerte et Analyse que les journalistes jugent
le plus souvent intempestives et inappropriées.
206
Bureau du Caire, 29 mars 2005
La journaliste 1 entre dans le bureau : II y a une note de Y. V. [directeur du bureau
régional] tu veux quej 'y réponde ou tu le fais ?
Le directeur du bureau : - Non je m 'en occupe, c 'est quoi ?
Journaliste 1 : Reuters a donné qu 'il y avait 230 frères musulmans qui avaient été
arrêtés. Je viens d'en parler avec M. et L., et c'est absolument pas vrai ! Bien sûr
qu 'on l'a pas lu [la dépêche de Reuters], elle est pas vraie.
Le directeur du bureau : Ce n 'est pas la peine de rentrer en polémique avec ça, on va
juste expliquer à Y. V. [le directeur du bureau régional] que nous, on a une centaine
d'arrestations. Officiellement il y en 70 qui ont été retenus. Eux, ils utilisent je ne sais
pas quelle source pas identifiable.
Le directeur du bureau du Caire rédige une note à l'intention du directeur du bureau
régional et formule à haute voix le texte à mesure qu'il l'écrit : Ils n 'ont eu que 83
personnes en détention. Nous, nous avons donné 50 arrestations d'une façon
préventive samedi et 50 pendant la manifestation c 'est-à-dire 100 au total. Finalement
16 ont été relâchés et 23 ont été placés en garde à vue.
Journaliste 2 : il [le bureau régional] n 'a pas du tout le droit défaire cette note. Nous,
au lieu de faire le truc facile : 'les autorités ont dit ..." on a fait un papier pour
expliquer ce qui se passe vraiment dans le pays, on a donné un papier qui a suscité
tout un débat, et il nous dit que Reuters score partout II J'ai pas vu où ils scorent
partout, c 'est deux reprises, nous aussi nous sommes repris quand même !
En s'adressant au directeur du bureau régional : - Là, tu dois l'appeler. C 'est quoi son
numéro ?
Le directeur du bureau du Caire appelle alors le directeur du bureau régional à
Nicosie :
- Allô, salut Y. V., ça va. Bon, écoutes, je t'ai répondu à ta petite note, nous on a les
sources identifiées des Frères Musulmans et non pas les conneries genre Reuters
« Sources say ». Nous avons 83 arrestations, nous, nous avions parlé de 50
207
arrestations préventives dans notre copie de samedi, plus une cinquantaine
d'arrestations pendant la manifestation. Nous, nous pensons être sur les bons chiffres,
tu vois.
Le directeur du bureau du Caire retourne dans la salle de rédaction pour rendre compte
de sa communication avec le responsable du directeur régional : Reuters nous fait une
surenchère (...) Il faut pas que le desk régional se panique dès que Reuters donne ça,
dès qu 'ils ont un call back. Ils commencent à faire de la surenchère.
Plus tard dans la journée, devant le moniteur, le chef du bureau informe les
journalistes présents qu'ils ont reçu les félicitations du bureau régional pour leur
couverture.
2.2.1.2 Notes d'impact et pointages : évaluation des performances
commerciales des journalistes
Alerte et Analyse occupe également une fonction d'étude d'impact. Le service effectue en
effet une évaluation de la performance de l'agence en faisant le décompte des dépêches, celles
de l'AFP et celles des agences concurrentes, reprises par les clients. Ainsi, la rédaction en
chef centrale, située au siège, reçoit ces données deux fois par jour, quant aux bureaux, ils les
reçoivent quotidiennement. Pour chaque événement de la journée couvert par les journalistes
du bureau, la note d'impact précise les ventes réalisées par chaque agence : le nombre de
papiers, leur nature, leur taille et les photos. Les journalistes prennent donc connaissance
quotidiennement de leurs résultats commerciaux et de leur position par rapport à la
concurrence. Alerte et Analyse, en mesurant jour après jour la performance commerciale des
bureaux, incorpore à la pratique quotidienne des agenciers les préoccupations et le stress liés à
la pression concurrentielle. La finalité commerciale de la dépêche leur est ainsi constamment
rappelée et leur apparaît de manière particulièrement aiguë.
2.2.2 L'innovation technologique transforme les modalités de la concurrence.
En situation de concurrence, les journalistes ont naturellement tendance à surveiller l'action
de leurs concurrents afin d'y ajuster leur propre action. La conformité de leur action à celle
208
des concurrents rassure le desk, au point de constituer, à leurs yeux, un gage de qualité et
conforte les journalistes dans leur choix. Mais, en même temps, ceux-ci surveillent les
concurrents afin de pouvoir s'en distinguer à la marge et créer ainsi, par des éléments inédits,
une valeur ajoutée. Il y a là une règle générale à laquelle les journalistes des années cinquante
ne font pas exception. Cependant, nous verrons dans cette section que l'innovation
technologique a transformé les modalités du jeu de la concurrence et du mimétisme. Les
journalistes disposent en effet d'outils techniques qui leur permettent de prendre connaissance
de la copie des agences à chaque seconde, et l'agence elle-même a mis en place un service qui
s'assure du travail de veille des journalistes, de sorte que l'ajustement à la concurrence
s'effectue sur une base continue et en temps réel.
2.2.2.1 Une veille concurrentielle permanente
L'Agence France Presse fait face à une concurrence plus forte et plus difficile à cerner, que
durant les décennies d'après-guerre. À cette époque, la concurrence bien qu'importante
provenait exclusivement d'un nombre limité de concurrents clairement identifiables : les
agences de presse internationales, Reuters, AP, UPI et dans une moindre mesure TASS. Les
pratiques et les politiques des concurrents étaient connues et l'AFP pouvait établir ses propres
politiques en conséquence. Aujourd'hui, la concurrence s'est élargie à d'autres médias, qui ne
fournissent pas strictement le même service que les agences de presse, mais qui ont une
influence déterminante sur la production de l'agence; ce sont les chaînes d'information en
continu, les agences spécialisées ainsi que les services d'information accessibles par Internet,
y compris les très nombreux sites des grands quotidiens, partout dans le monde222. Cette
concurrence, protéiforme, vient de partout; elle est plus difficile à cerner et à prévoir et, en
conséquence, il est plus difficile dorénavant pour l'AFP de s'y adapter.
Les chaînes d'information en continu telles CNN, la BBC et les services d'information par
Internet comme Yahoo sont des clients de l'AFP. Au-delà de l'abonnement aux fils de
2 Au cours de séances d'observation menées au sein du desk étranger du quotidien françaisLibération durant les années 2005 et 2006, nous avons constaté que dès leur arrivée au bureau, lesjournalistes consultaient d'abord les dépêches d'agence, puis se rendaient sur les sites du quotidien« Le Monde ».
209
l'agence, CNN a signé en novembre 2005 un accord avec l'AFP pour diffuser les images
produites par le service vidéo de l'agence de presse via son service CNN ImageSource.223
2.2.2 Un journalisme réflexif imprégné par la logique d'urgence
La réactivité des journalistes à l'événement est également évaluée par Alerte et Analyse à
partir de pointages qui mesurent la rapidité de mise sur les fils d'information majeure, les
breaking news, par l'AFP et par ses concurrents. Les pointages viennent rappeler combien les
journalistes de l'agence sont soumis à une implacable logique d'urgence. Cette logique de
l'urgence, qui était déjà très présente dans les années cinquante, revêt aujourd'hui un
caractère différent en raison de la rapidité des outils techniques de transmission et surtout par
la multiplicité des concurrents qui utilisent ces techniques et qui sont tous susceptibles de
dépasser en vitesse les journalistes de l'agence.
Dans ces conditions, la production de l'agence se caractérise par une accélération du
traitement de l'information (il faut diffuser l'information, même incomplète, le plus
rapidement possible) et par une multiplication des dépêches classées urgentes. L'expansion de
l'information télévisée (qui tient non seulement aux développements des réseaux de
télévision, mais aussi à la place qu'y prend l'information) et particulièrement des réseaux
d'information continue compte pour beaucoup dans cet effet d'accélération. La direction de
l'AFP justifie en effet la rapidité d'exécution et l'accroissement des urgents comme une
réponse à la demande des clients, notamment les chaînes de télévision qui, par un bandeau
déroulant à l'écran, informent leurs téléspectateurs sur une base continue : «Nous devons
fournir une couverture en continu (runningj avec de fréquents bulletins et urgents qui servent
aux bandeaux déroulant de nos clients télé, plutôt que d'attendre des développements pour les
incorporer dans des leads. »224 Les grands médias, les journaux inclus, disposent de plus en
plus d'un site Internet dans lequel l'information est constamment mise à jour, notamment par
des manchettes qui leur sont fournies par les agences.
23 CNN ImageSource exploite les archives vidéo de CNN et de ses affiliés, qu'elle commercialise dansle monde auprès de chaînes de télévision, de sociétés de production (documentaires notamment) etd'universités.224 ASAP, annexe B-9.
210
Une copie jugée urgente peut être diffusée et codée à différents niveaux de priorité (PI, P2 et
P3) ce qui permet de l'identifier rapidement au sein d'un fil et de la trier automatiquement par
les logiciels. Il existe six types de dépêches pouvant être urgentées : le « flash » (PI, priorité
qui interrompt les transmissions en cours pour le diffuser immédiatement), le « bulletin »
(P2), P« actu » (P2), l'« urgent » (P2), le « premier lead » (P3), le « factuel court » (P3). Le
journaliste peut aussi utiliser une commande U (pour Urgence) qui accélère la vitesse de
transmission aux clients sans changer le niveau de priorité d'une dépêche.225 Après avoir
spécifié le genre de la dépêche parmi les six existantes, le journaliste ajoute deux ou trois
sonnettes qui retentiront lorsque la dépêche parviendra dans les différents bureaux de l'agence
et qui les avertit de la réception d'une dépêche urgente.
La logique de l'urgence incarnée par Alerte et Analyse conduit les journalistes à multiplier les
urgents et même à en abuser. On observe en effet une tendance - que les journalistes encore
en activité que nous avons rencontrés ont tous reconnu - à sur-urgenter les dépêches diffusées
sur les fils. Les journalistes, qui craignent d'être pris de vitesse par les concurrents et
éventuellement de subir la réprobation de leurs supérieurs, ont tendance à marquer du sceau
de l'urgence des informations qui pourraient ou devraient ne pas l'être. Cette tendance à sur-
urgenter l'information tient aussi pour une bonne part à l'ambiguïté qui entoure la notion
d'urgence et qui fait qu'il n'est pas toujours facile pour les journalistes de déterminer ce qui
est urgent, de ce qui ne l'est pas. La définition du papier urgent donné dans l'édition de 2004
du Manuel de l'agencier laisse en effet une grande place à l'interprétation :
« Un urgent peut marquer :
- une information inattendue, susceptible de devenir dominante de l'actualité (gros fait
divers, démission d'une personnalité, déclaration surprise, etc.) même si on ne mesure pas
nécessairement tout de suite son ampleur et sa signification (par exemple, une explosion
rapportée par des témoins).
•).>.:, AFP, Manuel de l'agencier, 2004, pp. 21-26.
211
- une information attendue dans le cadre d'un événement largement couvert par l'AFP
(jugement dans un procès, ouverture des travaux d'une réunion internationale, premières
citations d'un discours important, nomination prévue d'un haut responsable).
- Une information qui donne une nouvelle dimension à une dominante dont l'AFP a déjà
largement rendu compte dans la journée ou les jours précédents (inculpation,
rebondissement dans une crise gouvernementale, nouveau bilan d'une catastrophe).
-. Une information qui mérite d'être mise en valeur par son caractère nouveau,
spectaculaire, original (phrase percutante d'un homme politique, décision inattendue,
d'une personnalité, etc.)
Une information déjà connue mais redite dans un contexte différent par une personnalité
de premier plan. »
Évaluer le niveau de priorité de diffusion à donner à une information est d'autant plus
arbitraire que, s'agissant d'une urgence, le journaliste ne dispose pas, par définition, du temps
nécessaire pour prendre le pouls de l'information mondiale avant de déterminer le degré
d'urgence qu'il va accorder à sa dépêche. De plus, l'évaluation de l'urgence est aussi
fortement influencée par l'actualité de l'aire géographique que couvre chaque journaliste. Ce
qui peut paraître urgent et prioritaire d'un point de vue local ne l'est pas nécessairement d'un
point de vue global. Pour illustrer cette tendance à sur-urgenter, une journaliste nous désigne,
au cours d'un entretien, son moniteur couvert de dépêches surlignées en rouge (indiquant
ainsi le niveau d'urgence PI). Ces dépêches traitaient toutes de la même actualité : la
poursuite du procès de Michael Jackson mais aucune ne mentionnait de nouveaux éléments
d'information. Ces dépêches pouvaient à la rigueur être considérées comme urgentes par les
clients américains (et encore !) mais sans doute pas par le reste du monde.
Urgenter une information est aussi un moyen pour l'agence et pour ses journalistes de mettre
leurs informations en valeur et de rechercher une plus grande visibilité auprès des clients.
Mais c'est une arme à double tranchant susceptible de produire des résultats contraires aux
buts visés. En effet si les journalistes de l'agence urgentent à l'excès, alors le système de
226 AFP, Manuel de l'agencier, 2004, page 24.
212
différenciation des dépêches en fonction de leur degré d'urgence devient inefficace. L'abus
des urgences banalise la notion même d'urgence, de sorte que quand tout est urgent, plus rien
ne l'est.
La surenchère à l'urgence au sein de l'agence annihile le système de hiérarchisation et de
priorité des dépêches en fonction de leur urgence. C'est ainsi que certains des journalistes que
nous avons observés sont amenés à ne plus tenir compte de cette échelle. Par exemple, le
directeur du bureau du Caire contourne tout simplement le dispositif en bloquant les sonneries
que produit l'arrivée d'un urgent sur le fil. Si les journalistes de l'agence le font, il est bien
possible que des clients en fassent tout autant.
Au cours de ce chapitre, nous avons constaté à quel point les transformations techniques
influent sur les pratiques des correspondants étrangers. Les innovations techniques n'ont pas
seulement facilité la pratique quotidienne des correspondants, elles ont eu un impact sur la
façon dont ils se perçoivent, à la fois journaliste et technicien, sur leur situation par rapport au
siège (d'un isolement relatif dans les années quarante à un contact permanent au vingt et
unième siècle), de leur approche du métier (journaliste de terrain se sentant parfois isolé du
reste du monde, le journaliste est aujourd'hui un individu surveillé par sa rédaction et qui
surveille la copie de ses concurrents). Les conditions matérielles constituent donc un facteur
explicatif important dans les transformations des pratiques des agenciers.
213
-CHAPITRE 9- IDENTITE PROFESSIONNELLE
Au cours de ce chapitre, nous souhaitons analyser l'évolution de l'identité professionnelle du
correspondant étranger de l'Agence France Presse. Bien que nous ayons présenté le concept
d'identité professionnelle, précisons que nous entendons analyser ici, non pas l'identité du
journaliste telle qu'il est ressenti par le public, ni même la manière dont les journalistes se
constituent en groupe professionnel. Nous entendons aborder ici l'identité journalistique du
point de vue de l'individu et des rapports avec sa pratique professionnelle quotidienne, en
abordant successivement, sa formation, son engagement et son rapport à l'entreprise de presse
qu'il emploie et enfin la conception qu'il se fait de son métier et la valeur qu'il accorde à
l'information.
Section 1 - Les journalistes entrés entre 1945 et 1960
Les journalistes de la première génération qui intègrent l'agence sont des hommes lettrés qui
conçoivent leur rôle professionnel comme capital pour le fonctionnement démocratique de
leur société, un rôle quoi requiert de leur part un profond engagement.
1.1 Formation
Les journalistes qui intègrent l'agence au lendemain de la guerre proviennent d'horizons
divers et n'ont pas reçu de formation spécialisée en journalisme. Plusieurs de ceux qui sont
embauchés à cette époque au sein de l'Agence France Presse se destinent à des carrières
diplomatiques, mais celles-ci ont été contrariées par l'avènement du conflit mondial. Nombre
d'entre eux ont poursuivi des études supérieures, en lettres notamment.
214
D'autres, destinés avant la guerre à des postes dans l'administration française et qui ont exercé
pendant la guerre des fonctions dans la presse, ont consciemment renoncé à des postes dans
l'administration française pour se tourner vers le journalisme. A cet égard, le parcours de ce
journaliste est exemplaire.
J'ai démarré d'une matière absolument incongrue, je me suis blessé pendant la
libération de Bordeaux et donc j'ai été rapatrié sur Lyon. Je voulais rejoindre l'armée
des Alpes, mais on m 'a dit : « on va vous mettre à la censure militaire ». Alors, tous
les soirs, on faisait la tournée des grands ducs de tous les organes de presse, dont
l'AFP naissante. Les instructions étaient très simples : ne pas dire qu'il y avait du
brouillard sur l'aéroport. J'ai été libéré en 1946, j'ai passé l'ENA et j'ai été troisième
admissible, on m'a envoyé à l'académie de droit international de La Haye, mais
finalement j'ai préféré me tourner vers le journalisme et je suis rentré à l'agence en
1948 au desk étranger.
Enfin, parmi les journalistes qui intègrent l'agence en 1944, certains sont également des
anciens journalistes de l'agence Havas, ce qui leur procure certains privilèges, parmi lesquels,
celui de choisir leur affectation et d'avoir accès à des postes de rédacteur en chef ou de chef de
service. Les jeunes journalistes les surnomment les « barons ».
La formation que reçoivent ces journalistes à leur arrivée à l'agence est des plus sommaires.
On les installe à un bureau et ils disposent de peu de temps pour apprendre à rédiger leurs
dépêches, en observant et en imitant les pratiques de leurs confrères. Rapidement, la sanction
tombe : l'agence les emploie ou les renvoie : « On m'a mis tout seul au travail pendant une
journée, et ensuite on m'a dit que ça allait ». Les journalistes qui désirent intégrer l'agence en
1944 et les années subséquentes ont suivi pour bon nombre d'entre eux des études supérieures
et ils ont développé un goût particulier pour la littérature et l'écriture ; aussi leur style
d'écriture convient-il aux exigences du style d'écriture journalistique de cette période, qui
s'apparente au style littéraire.
Enfin, le primat du factuel, que nous avons évoqué dans la seconde partie, favorise leur
recrutement. En effet, la retranscription fidèle des faits exige une mobilisation relative de
215
compétences spécifiques d'analyse, de mise en forme, compétences que doivent
impérativement maîtriser les nouveaux entrants aujourd'hui. L'écriture journalistique de
l'époque était moins distinctive, moins codifiée que celle d'aujourd'hui, de sorte qu'un
« amateur » lettré pouvait aisément la maîtriser.
1.2 Un engagement professionnel profond
1.2.1 Attachement et engagement professionnels
Les journalistes qui entrent à l'agence à cette période, n'ont pas suivi de formation spécifique
à la pratique du journalisme ; aussi ont-ils le sentiment que leur statut tient moins au métier
qu'ils exercent qu'à l'entreprise de presse qui les emploie. Par conséquent, leur identité
professionnelle est avant tout définie par rapport à l'AFP et leur attachement à celle-ci est
extrêmement fort.
- C'est une maison qu'on ne quittait pas. Jean Marin considérait qu'en dehors de
l'agence il n'y a pas de salut. On entrait dans l'agence pour la plus grande gloire de
Dieu. On ne se posait même pas la question, c'était une manière de vivre plus qu'un
métier.
- Un ancien journaliste ajoute : «L'identification à l'entreprise n'est plus du tout la
même, en plus avant c'était notre maison, maintenant ce n'est même plus notre maison,
on a vendu le bâtiment. »
Les anciens journalistes estiment qu'ils avaient un engagement professionnel sans commune
mesure avec celui de la jeune génération. L'engagement des journalistes pour l'agence se
traduit également par leur consentement sans condition aux affectations à l'étranger. En effet,
à cette époque, les correspondants sont envoyés à l'étranger sur décision de la rédaction
centrale lorsqu'il dispose du statut siège ; ils ont peu d'emprise sur le choix de la destination
et ils doivent partir sur-le-champ quand on le leur demande. Aujourd'hui, la liste des postes
216
vacants circule dans tous les desks, les journalistes qui le souhaitent peuvent se porter
candidat et c'est la rédaction en chef centrale qui effectue le choix final.
Pendant les vingt premières années de l'agence, un journaliste peut difficilement refuser ou
contester une affectation. En revanche, les affectations visent de longues périodes en
comparaison d'aujourd'hui; à cette époque, la loi de la rotation de poste en poste tous les deux
à quatre ans n'est, pas encore appliquée.227 Les journalistes ayant peu d'influence sur leur
destination, il arrive qu'ils soient insatisfaits de leur affectation et mettent alors en place des
stratégies de contournement qui aboutissent presque toujours à la même sanction de la part de
la rédaction en chef: un séjour à «la grande nuit ».228 «J'aurais pu rester toute ma vie en
Australie, mais j'ai invoqué des raisons parfaitement fictives pour rentrer à Paris. J'ai été
sanctionné, j'ai fait quelques mois de punition à la grande nuit », Cette stratégie est répandue
et typique de l'époque.
Toutefois, parmi les correspondants étrangers de l'agence, quelques-uns uns ont le privilège
de choisir leur affectation. Les « barons », ces anciens journalistes d'Havas, devaient à leur
carrière passée la possibilité de se réserver certains bureaux. Un ancien journaliste indique
que « les barons de l'AFP étaient des gens qui avaient été chez Havas. Les barons étaient en
fait propriétaires de leur charge, ils ne pouvaient pas être déplacés sans leur propre accord,
et s'ils cédaient leurs charges, ça se négociait ». Un autre journaliste ajoute : « Les barons,
anciens d'Havas, détenaient les grands bureaux, c 'était des espèces de fiefs. Les barons se
considéraient un peu comme l'égal de l'ambassadeur. Ça, on ne s'en rend pas compte
aujourd'hui ».
Nous pouvons en conclure que les journalistes de cette génération font preuve d'un
engagement professionnel et personnel particulièrement forts. Les vies personnelle et
professionnelle sont d'ailleurs imbriquées. « Les journalistes faisaient ce que l'on leur
7 Ce journaliste témoigne de la soumission dont les agenciers devaient faire preuve face auxaffectations décidées par la hiérarchie : « Le PDG Maurice Nègre, qui ne plaisantait pas du tout avecla discipline - il avait été déporté à Bunchewald et il n'était pas question de contester ses décisions - aconvoqué le directeur du service diplomatique, mon supérieur hiérarchique, et lui a dit à la fin del'entretien : "Monsieur L. doit être lundi à Washington, ce sera tout". C'était comme ça que ça sepassait à l'époque. Je peux vous dire, que le lundi suivant j'étais à Washington ».
28 La "grande nuit" désigne le service chargé d'effectuer la veille nocturne de l'actualité et de rédigerles dépêches en conséquence. C'est un service peu apprécié par les journalistes, pour les contrainteshoraires mais également par le service qu'ils jugent «peu intéressant » et «pas dynamique ».
217
demandait de faire, il y avait une adhésion totale entre le travail et la vie personnelle, ça ne
faisait qu 'un ». Nous avons constaté au cours de notre enquête que parmi la plus ancienne
génération de journalistes, la proportion de célibataires était plus importante en comparaison
des deux générations suivantes; cela laisse à penser que les conditions de vie étaient
difficilement compatibles avec une vie de famille229. Toutefois, il ne se posait pas comme
aujourd'hui la question de la démission du conjoint pour suivre le correspondant étranger
comme nous le verrons dans la section suivante, les femmes de cette époque étant peu
nombreuses à avoir accès au marché du travail. Le milieu journalistique ne fait pas exception;
les femmes journalistes y sont très peu nombreuses; le métier de correspondant étranger est
alors considéré alors comme un métier dangereux et exigeant qui ne peut convenir à la gent
féminine. Une journaliste qui a couvert bon nombre de conflits armés sur plusieurs continents,
évoque les difficultés qu'elle a rencontrées pour pouvoir être envoyée à l'étranger.
A l'époque il n'y avait pas de femmes à la production, moi je suis restée deux ans et
demi à la rédaction, au siège et j'ai posé ma candidature au Vietnam. Là-bas, on y
envoyait des journalistes expérimentés. La première fois, que j'ai posé ma
candidature, ils [les chefs de rédaction] ont ri et ils l'ont mise à la poubelle. Puis j'ai
reposé ma candidature et le PDG de l'époque, Jean Marin, a décidé tout seul, contre
l'avis du reste des chefs de m'y envoyer. Une situation qui perdurera durant les
décennies suivantes230.
!9 La direction des relations sociales et relations humaines de l'AFP a engagé depuis 2002 une sériede mesures pour améliorer les conditions de vie des familles des collaborateurs-statut du siège- del'AFP qui partent travailler à l'étranger afin que les difficultés liées à toute expatriation ne constituentplus un frein au départ à l'étranger des agenciers. La prise en charge des frais de scolarité des enfantsd'expatriés, la formation linguistique du conjoint avant le départ, la prise en charge pendant le séjourd'une activité non professionnelle pour le conjoint qui ne travaille pas ainsi qu'une augmentation de laprime d'installation comptent parmi les différentes mesures engagées.230 L'accès des femmes aux postes de journaliste reste aujourd'hui encore problématique. Le 20 mai2005, les femmes journalistes de l'agence ont fondé un collectif pour dénoncer «l'inégalité salariale etles disparités d'évolution de carrière entre les hommes et les femmes »_à l'agence et lancent unepétition qui est signée par 251 femmes journalistes et 86 journalistes masculins. Dans un portrait del'expatrié type réalisé par l'AFP en novembre 2001, sur 190 expatriés, on comptait seulement 40femmes soit 21% du total des journalistes expatriés. Seules deux femmes occupent le poste dedirecteur de bureau à l'étranger en 2006 (Lisbonne et Kinshasa). Le nouveau PDG de l'Agence FrancePresse, Pierre Louette, vient de nommer deux journalistes, Michèle Leridon et Marielle Eudes, à ladirection de la rédaction.
218
Enfin, l'attachement à l'agence dont font preuve les journalistes qui exercent dans les années
cinquante et soixante, est également lié à l'anonymat qui prévaut durant plusieurs décennies à
l'AFP conférant à l'agencier d'être totalement identifié à son entreprise. En effet, après la
Seconde Guerre mondiale, les dépêches de l'agence ne sont pas signées, les initiales ne sont
pas toujours mentionnées en bas de la dépêche.
Paul Louis Bret qui fut directeur de l'agence entre 1950 et 1954, estimait que l'agencier était
le « bénédictin de l'immédiat qui ne saurait attendre de son devoir anonyme que la
satisfaction de l'avoir accompli »231. Le journalisme d'agence dans les années cinquante et
soixante valorise l'anonymat; ce qui est mis en valeur, ce n'est pas le journaliste dans son
individualité, mais l'entreprise, le collectif des agenciers. Cette collectivisation de l'instance
énonciative tend à renforcer l'identification du journaliste à l'agence. «A l'époque, 90 %
c'était l'anonymat total, on parle de l'AFP, donc il faut aimer ça, il ne faut pas avoir envie de
faire une carrière phénoménale », « Quand j'ai commencé, le PDG était Jean Marin, c 'est le
PDG historique. On n 'était pas aussi nombreux, on n 'avait pas de problèmes existentiels et
pratiquement personne ne signait ». On peut même dire que le journaliste retire une certaine
fierté à entretenir cet anonymat; il a le sentiment d'exercer son métier de manière
désintéressée, de servir son entreprise et ses lecteurs.
Toutefois, précisons que si la plupart des dépêches ne sont pas signées, la règle de l'anonymat
est levée pour les reportages exceptionnels, notamment ceux rédigés par « les grandes
plumes » de l'AFP, pour les scoops ou encore lorsqu'un journaliste est employé ou prêté à
une rédaction de média écrit ou radiophonique.
La typologie de journalistes que propose Stephen Hess232 est éclairante pour notre propos car
elle est fondée non pas sur le statut ou la fonction occupée dans le média, mais sur le caractère
et les motivations du journaliste. Parmi les différents types de journalistes qu'il identifie, le
231 Huteau, Jean et Ullman, Bernard, AFP, une histoire de l'Agence France-Presse, 1944-1990, RobertLaffont, Paris, 1992 , page 79.
12 Stephen Hess établit une typologie des journalistes américains chargés de couvrir l'informationinternationale, en distinguant six catégories: « the spouse»: l'épouse, « the adventurex » :l'aventurier, « the expert-»: l'expert, «theflinger» qui recherche l'aventure à court terme, « theidéologue » décrit comme un sympathisant de la cause du pays qu'il couvre et « the résident », natifdu pays et qui travaille dans un journal local (Hess, Stephen, International News and ForeignCorrespondents, Brooking, 1996, chapitre 6).
219
profil du journaliste aventurier rend bien compte de la situation des journalistes de cette
génération. Le journaliste aventurier est défini par Hess comme un journaliste qui développe
une conception romantique et ambitieuse de son métier, il a choisi cette orientation
professionnelle pour satisfaire son goût du voyage mais aussi et surtout pour vivre des
expériences, ressentir des sensations fortes. En effet, les journalistes de cette génération ont
confirmé les propos de Stephen Hess ; un journaliste à qui nous demandions s'il avait choisi
ce métier pour satisfaire un goût pour le voyage, alla jusqu'à nous répondre: « C'est pas tant
pour les voyages, moi ce que j'aime c 'est être là où ça se passe, être là où ça saute ». En
comparaison des deux générations suivantes, les correspondants étrangers de cette génération
avaient un goût du risque particulièrement prononcé, ils étaient envoyés sur des zones de
conflits pendant de longues périodes, leur santé en était d'autant plus fragilisé.
1.2.2 Un état de santé fragilisé
Exercer le métier de correspondant étranger comporte de nombreux risques pour la santé et
même pour la vie du journaliste. Les journalistes qui couvrent des zones de conflits où
certaines factions peuvent attenter à leur vie. Tous les journalistes que nous avons rencontrés,
quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent, évoquent cet aspect de leur métier.
Un correspondant étranger de l'agence en poste en Algérie témoigne : « J'ai échappé à trois
attentats. Je suis arrivé en poste à Alger, quelques jours plus tard le bureau avait brûlé(...).
La deuxième fois, j'ai failli être assassiné en allant au bureau. On avait toujours le danger
dans la tête, il ne fallait pas avoir de protection, c'était la meilleure façon de se faire repérer.
La troisième fois, alors que mes enfants, ma femme et moi dormions, un homme s'était
introduit au domicile familial pour nous tuer. »
Les risques du métier peuvent conduire certains journalistes à mettre fin prématurément à
leur carrière. En effet l'exercice ininterrompu de leur activité professionnelle et les conditions
dans lesquelles ils exercent leur métier peut fragiliser considérablement leur état de santé. «Le
stress psychologique inhérent à la quête permanente et la rédaction sous pression de
nouvelles dans un contexte où les événements se succèdent constamment, peut épuiser une
personne, surtout quand la tâche consiste à témoigner personnellement de désastres et de
220
situations violentes. »2 Les conséquences peuvent être alors particulièrement lourdes comme
en témoigne cette ancienne correspondante étrangère qui a couvert de nombreux conflits
parmi lesquels, la guerre du Vietnam. « J'étais complètement saturée, j'avais une carrière un
peu agitée, et c'est épuisant de se battre tout le temps (...) j'ai fait l'étranger pourri (la
journaliste fait référence aux lieux de conflits armés), je ne regrette rien du tout, mais c'est
usant. Huit ans après, je me suis tapée un cancer, une dépression très très hard. »
Quoi qu'il en soit, les anciens correspondants retirent une certaine fierté à avoir su braver les
difficultés et à avoir survécu aux situations dangereuses. Aussi portent-ils un regard critique
sur l'engagement professionnel de leurs contemporains, qu'ils considèrent plus «frileux»,
moins enclins à couvrir des zones de conflit pendant de longues périodes. Ainsi ce
correspondant à la retraite :
A l'époque, on était envoyé à l'étranger pour un an minimum sur les conflits armés.
Aujourd'hui, on les envoie pour un mois en Irak et ils font la gueule (...). Les
mentalités ont changé. La guerre du Vietnam était plus dure qu 'en Irak, on était sur le
front en permanence, personne ne rentrait entier. On y est resté un an et on était
content car cela permettait de suivre les événements beaucoup mieux. Quand il y a eu
la guerre au Liban, les jeunes ne voulaient pas rester parce que, eux, ils considéraient
que c'était fatigant. Les jeunes de maintenant, c'est mes heures?, mes
R.T.T. [réduction du temps de travail]? Je pars à quelle heure ?
Il faut préciser que si les journalistes sont envoyés aujourd'hui pour de plus courtes périodes
sur des zones de conflits, cela ne tient pas uniquement à la frilosité des candidats au départ;
l'agence dispose en effet d'une main d'œuvre suffisante pour remplacer régulièrement les
correspondants étrangers sur les zones de conflits et s'assurer ainsi qu'ils pourront continuer
de « servir » l'agence à leur retour.
!3 Hannerz, Ulf, Foreign News, Exploring the World of Fofeign Correspondents, The University ofChicago Press, Chicago, 2004, page 99 : « The continuous psychological stress of going on and ongathering news and getting one 's writing done at a fast pace, in a setting where things keephappening, can wear a person down-especially when news works turns into a matter of personallywitnessing violence and disaster » (traduction réalisée par l'auteur).
221
Mais la santé des journalistes à cette époque n'est pas seulement mise à mal à l'étranger, elle
l'est également chez certains journalistes du siège, mais pour d'autres raisons. Lorsque les
correspondants étrangers reviennent au siège, certains d'entre eux intègrent le service
diplomatique; or le style de vie « parisien » de ces journalistes n'est pas toujours de tout repos
non plus et conduit bon nombre de ces journalistes dans les années soixante et soixante-dix à
mettre fin prématurément à leur carrière :
J'arrive au service diplomatique après avoir fait la Libye, le Liban, la Jordanie. Au
service diplomatique, il y avait Jean Mauriac à cette époque. Bref, on va au
Vaudeville [un restaurant de la Place de la Bourse], il y avait quatre ou cinq des
grandes signatures, Jean Vincent, Boni, Leleu et on commande : entrecôte bordelaise
pour chacun et huit bouteilles de bordeaux. C'était tous les vendredi comme ça. A ce
rythme, sans parler des cigarettes, on est peu à avoir tenu le coup.
1.2.3 Une fidélité à l'agence au-delà de la mobilité du journaliste inter média
L'obtention d'un emploi est relativement aisée pour un journaliste dans les années cinquante
et soixante. C'est d'autant plus facile pour les journalistes qui exercent au sein de l'AFP car
ils bénéficient d'une reconnaissance certaine au sein des médias. L'AFP est en effet
considérée comme la meilleure école de journalisme. Si une bonne part de journalistes restent
fidèles à l'AFP, certains quittent l'agence pour exercer dans d'autres médias sans pour autant
se départir de leur attachement à l'agence; parmi eux, Claude Imbert, ancien correspondant de
l'AFP, est actuellement directeur de la rédaction de l'hebdomadaire français « Le Point »,
Bernard Ullman qui fut l'un des piliers du service diplomatique de l'agence, quitta l'AFP pour
devenir grand reporter au sein de « l'Express ». Lors de notre entretien, celui-ci confie :
J'étais directeur du bureau de Washington et quand je suis rentré à Paris, je n'ai pas
obtenu le poste que j'aurais voulu avoir. J'avais des amis qui étaient à l'Express,
j'avais envie de changer de manière de travailler. La première différence majeure
c'est que dans une agence ça ne s'arrête jamais, alors qu'à l'Express, je pouvais
respirer, il y a une différence de rythme qui est énorme.
222
Les journalistes quittent l'agence pour différents motifs. Si certains journalistes,
comme Bernard Ullman, quittent l'AFP pour exercer leur métier dans des conditions
qu'ils jugent plus confortables et sous une pression temporelle moins forte; d'autres
quittent l'agence parce qu'ils n'ont pas obtenu le poste qu'ils souhaitent à leur retour
de l'étranger. Enfin certains journalistes veulent explorer d'autres formes de
journalisme, moins anonymes, plus éditorialisantes. «J'ai quitté l'AFP parce que
j'avais tout fait. Je n'avais plus grand chose à inventer, j'ai même travaillé pour des
journaux espagnols, je suis allé au Matin de Paris, à l'Express, j'ai fait pas mal
d'autres maisons pour pouvoir enfin donner mon avis. » Ces départs sont volontaires;
l'agence ne se sépare pas de ses journalistes, sauf faute professionnelle
particulièrement importante. Par ailleurs, il n'est pas rare que l'agence octroie aux
journalistes qui souhaitent partir, la possibilité de réintégrer éventuellement l'agence
par la suite, s'ils le désirent. «A l'AFP, on n'est pas viré, on s'en va. Si vous êtes virés
de l'AFP, mais c'est un événement mondial. Je ne me souviens pas d'avoir vu
quelqu'un de viré. Il y en a certains qui sont partis, mais pas mal d'entre eux sont
revenus. »
Si les journalistes des années cinquante et soixante concevaient leur métier comme un
engagement total, ils réprouvent la manière dont les jeunes journalistes conçoivent leur
métier :
Aujourd'hui on ne compte plus les individus qui pratiquent le journalisme sans
s'identifier à cette profession ou sans avoir décidé de lui consacrer pleinement leur
vie et le meilleur d'eux-mêmes. C'est, pour certains, une sorte de hobby, qu'ils
peuvent abandonner à tout moment pour faire autre chose. De nombreux journalistes
actuels pourraient travailler demain dans une agence de publicité et devenir, après-
demain, agents de change. 234
234 Ryszard, Kapuscinski, « Les médias reflètent-ils la réalité du monde ? Censures nouvelles, subtilesmanipulations », Le Monde Diplomatique, août 1999, page 8.
223
Ce témoignage souligne le fossé générationnel qui sépare la plus ancienne génération et la
génération des nouveaux entrants; les premiers considèrent qu'ils ne partagent pas la même
conception du métier ni le même investissement. Toutefois la critique qu'exprime cette
génération de journalistes est à nuancer. Les jeunes journalistes exercent dans un contexte
radicalement différent de celui des journalistes les plus anciens. Le contexte économique est
difficile, le marché du travail est fragilisé235 et le contexte concurrentiel s'est accru. Par
conséquent, les journalistes développent une conception plus pragmatique de leur métier; ils
sont davantage individualistes et leur identification à leur entreprise, bien qu'importante, est
dictée par une logique de survie professionnelle.
1.3 Conception de l'information et du rôle professionnel : L'information comprise
comme bien public et journalisme magister
Dans les années cinquante et soixante, bien qu'il ressente l'importance de la concurrence et la
nécessité d'être le premier à diffuser l'information pour être repris par les clients, le
correspondant étranger refuse de se considérer comme un agent commercial de l'agence dans
les pays qu'il couvre. « C'était affreux, on avait un rôle commercial, j'essayais de dire à nos
présidents successifs : "Désolé, mais je ne suis pas un commerçant, je ne sais pas vanter ma
marchandise". On m'a dit que ça faisait partie du métier. »
Quoi qu'il en soit, les journalistes et les clients que, bon gré mal gré, ils doivent courtiser,
semblent s'entendre sur le fait que le choix des sujets à couvrir doivent être établi en fonction
de l'intérêt public. L'information est conçue alors comme un bien public, et l'exercice
journalistique comme un service public au service de citoyens. « C'est la première agence
historiquement. Elle a donné naissance au modèle, et en plus dans sa renaissance, c'est un
outil au service de la presse. Ça apporte une diversité, vous participez à quelque chose de
grand, vous participez aux valeurs démocratiques, à la pluralité de l'information. »
Le statut semi-public de l'agence renforce le sentiment qu'ont les journalistes d'exercer un
service public auprès d'usagers citoyens et non de simples clients consommateurs.
235 Accardo, Alain, Abou, Georges, Journalistes précaires, Le Mascaret, Bordeaux, 1998, 411 pages.
224
Les journalistes de l'ancienne génération apparentent leur métier à un service rendu à la
population; aussi affichent-ils une position de magistère vis-à-vis du public. Ils se sentent
investis d'un savoir supérieur, spécifique, qui leur confère une autorité professionnelle, celle
de déterminer ce qui est important et dont le public doit être informé. Il s'agissait en somme
de dire au public à quoi et comment il doit penser. Un journaliste confirme : « Le journaliste,
lui, sait et le public doit avaler ce qu 'il lui donne », un autre journaliste ajoute : « On était une
élite et on décidait de ce que le public devait apprécier ».
Il faut dire que les journalistes qui exercent à l'agence après la guerre sont des gens lettrés qui
détiennent, pour la plupart, un diplôme d'études supérieures et qui se considèrent comme
appartenant à l'élite intellectuelle, voire politique, de la France. Quant au public en général,
auquel les dépêches sont finalement destinées, il dispose de peu de sources d'information et il
n'a donc que peu de moyens de savoir ce qui se passe dans le monde; aussi se soumet-il
d'autant plus à la parole des journalistes. Dans ces conditions, les journalistes de la première
période donnent volontiers à leur pratique une visée éducative ou, en tout, cas, qui transcende
la stricte fonction de collecte et de transmission de nouvelles. « De mon temps, j'avais pour
principe qu 'il faut apprendre quelque chose au lecteur, il ne s'agit pas seulement de
l'amuser. S'il est de droite, il faut lui dire que tout n'est pas mauvais dans la gauche et
inversement ».
Cette fonction de l'information attribue au journaliste le soin de pondérer et d'évaluer les
informations et les événements, tâches que le public est supposé ne pas être en mesure de
réaliser par lui-même. Les journalistes ont alors le sentiment d'avoir une grande influence sur
le public et sur la lecture qu'il fera des événements. Certains anciens correspondants étrangers
nous ont d'ailleurs confié avoir le sentiment d'exercer une fonction proche de celle de
l'enseignant, et même de regretter de ne pas avoir eu l'occasion d'embrasser une carrière
d'enseignant.
225
Section 2 - Les journalistes entrés à l'agence entre 1960 et 1980
La génération intermédiaire des journalistes est particulièrement pertinente à étudier en regard
de leur adaptation aux changements de l'environnement médiatique qu'elle va subir de plein
fouet. Les conditions dans lesquelles ces journalistes exercent au début de leur carrière, vont
se modifier en profondeur au fil des changements techniques et économiques et exiger une
réévaluation de leur conception professionnelle.
2.1 Une formation universitaire et diversifiée
Les journalistes interviewés qui intègrent l'agence à la fin des années soixante et dans les
années soixante-dix ont tous mené des études universitaires notamment dans le domaine des
sciences sociales et des humanités. Comme leurs prédécesseurs entrés à l'agence après la
guerre, la grande majorité d'entre eux n'ont pas suivi de formation journalistique formelle
dans une école de journalisme, celle-ci ne constituant pas encore un passage obligatoire pour
intégrer les grands médias nationaux. Les journalistes de cette époque semblent avoir une
conception moins professionnelle, moins technicienne, plus intuitive, plus « romantique »,
plus littéraire du journalisme, une conception qui s'accommode bien de l'absence de
formation spécifique. «Aujourd'hui les journalistes sont techniquement meilleurs, mais ils
ont moins d'histoire personnelle. Quand je suis rentré à l'AFP, la plupart des gens n'avait pas
fait d'école de journalisme. Tout le monde avait fait sciences po, sciences éco, histoire. Il y
avait encore une forme de romantisme, d'idéologie. On avait des positions politiques,
idéologiques, on voulait changer le monde. Cette génération était très différente de la
génération d'avant ». En revanche, les journalistes embauchés à cette époque reçoivent de
l'agence un complément de formation technique plus élaboré que celui qu'ont reçu leurs
prédécesseurs. En effet, au fur et à mesure de l'informatisation des desks et des
transformations des outils de transmission, les services techniques vont devoir former les
journalistes.
Les journalistes de cette génération ont suivi des parcours pré professionnels et des formations
variées, les conditions de leur entrée à l'agence peuvent être très différentes. A cette époque,
226
faire du journalisme n'est pas, comme c'est le cas aujourd'hui, le produit d'un choix de
carrière longuement mûri, ni l'aboutissement d'un long parcours de formation qui, pour les
jeunes apprentis d'aujourd'hui, s'apparente à une course d'obstacles. Ainsi un journaliste
affirme : « J'ai commencé le journalisme presque par hasard. J'étais dans des structures
publiques de planification économique et financière (...) je suis passé à l'Économie comme
ça, j'avais des contacts et le premier contact était au service économique ». D'autres
journalistes intègrent l'agence en « statut siège » pour « services rendus » comme
correspondant local, à l'image de cette journaliste diplômée de l'École Normale Supérieure
qui a intégré l'Agence France Presse grâce à sa couverture de la guerre du Liban :
J'ai démarré à Beyrouth en 1977, à l'époque ils avaient besoin de quelqu'un pour les
écoutes, le monitoring. J'étais au bureau régional pour le monde arabe, ce pendant six
mois. Puis l'activité au Liban s'est bousculée et les gens qui étaient aux écoutes ont été
déplacés à la rédaction. Sur le terrain, je couvrais les réfugiés qui partaient pendant
la guerre. C'était un boulot comme un autre, je suis devenue par hasard journaliste
parce que j'ai vécu au Liban. J'étais recrutée locale, et après l'invasion de 1982, le
PDG a trouvé que l'on avait tellement bien travaillé, qu 'il nous a dit qu 'on pouvait
venir en France.
Toutefois, l'arrivée des journalistes locaux comme journalistes statut-siège se font parfois
dans des conditions difficiles. Certains journalistes voient leur statut revu à la baisse, ils sont
parfois considérés comme des débutants et doivent « faire leurs preuves » auprès de la
rédaction en chef centrale. Le siège ne fait pas toujours grand cas de l'expérience de terrain
acquise par les journalistes employés en statut local dans des bureaux étrangers.
En 1978, Jean Marin est venu à Beyrouth où je travaillais. Il a dû aimer mon travail
parce qu 'un peu plus tard, on me demande de venir à Paris. A ma grande surprise, la
personne que je rencontre me dit : « je ne sais pas si vous allez pouvoir fonctionner
dans les mêmes conditions que Beyrouth, vous allez faire un stage, vous allez faire un
test et après on verra. » On m'a mis stagiaire au desk Moyen-Orient alors que ça
faisait des années que je travaillais sans compter à l'étranger.
227
Les journalistes de cette génération exercent aux côtés des plus jeunes et ont donc une
certaine légitimité pour porter un jugement sur la jeune génération. S'ils reconnaissent que les
journalistes entrés à l'agence au cours des quinze dernières années ont reçu une formation
technique solide, ils jugent qu'ils manquent cruellement de culture, « Les jeunes, ils manquent
d'histoires, ils n 'ont pas assez vécu... ils sont pauvres côté culture, alors qu'on est confronté,
surtout à l'étranger à des situations qui demandent un minimum de culture ». En outre, ils
considèrent que les jeunes journalistes sont « formatés », « Quand je vois des jeunes
aujourd'hui qui ont entre 28 et 35 ans, j'ai l'impression de voir des clones, ils sont formatés.
A notre époque, on recrutait beaucoup, on entrait à l'AFP sans forcément avoir fait de
formation, c'était des personnalités ».
Alors que les journalistes entrés dans les années soixante-dix ont été formés par les plus
anciens, les jeunes journalistes, eux, intègrent l'agence après avoir suivi une formation longue
et substantielle (formation universitaire ou passage par un Institut d'Etudes Politiques puis
suivi d'un cursus dans une école de journalisme) au métier, comme nous le verrons dans la
section suivante. Les journalistes ressentent une certaine frustration de ne pouvoir « former »
les jeunes, comme eux-mêmes ont été formés.
-L'aspect qui me gêne, c'est le manque de variété dans le recrutement, il y a des jeunes
qui ont la grosse tête et qui exigent tout de suite ceci ou cela, que l'on trouvait moins il
y a une vingtaine d'années parce que l'on entrait dans le métier de façon plus modeste,
on entrait dans le métier pour apprendre. Maintenant, on se retrouve avec des gens
qui estiment avoir déjà tout appris, ce qui se comprend quand on voit ce qu'on leur
demande, on leur demande d'avoir fait Bac+5, d'être forcément jeune, de parler
plusieurs langues couramment. Nous, on apprenait graduellement.
- Aujourd'hui ce sont des jeunes imbus d'eux-mêmes. Les anciens devraient former les
jeunes, mais les jeunes ne veulent pas partir à l'étranger, ils veulent des postes
pépères, faire 8h00-12h00, 14h00-18h00.
228
2.2 Un engagement évolutif : de la fusion à la position de retrait
Lorsque les journalistes intègrent l'agence au cours des années soixante-dix et le début des
années quatre-vingt, ils développent rapidement un fort attachement à l'AFP, qui coïncide
avec un engagement vis-à-vis de leur entreprise particulièrement important. En effet, cette
génération arrive à une période où l'agence procède à une réorganisation de ses services due
notamment à l'informatisation des desks et à la régionalisation des desks étrangers. L'agence
sollicite les services de ces journalistes, qui occuperont, pour certains d'entre eux, des postes
d'encadrement et à responsabilités au siège de l'agence (directeur de la rédaction en chef
central, directeur ou directeur adjoint de desk, directeur du desk anglophone etc.) relativement
rapidement.
Plusieurs journalistes de cette génération participent à la création d'agences d'information
dans les anciennes colonies, les pays en voie de développement, et plus tard dans les anciens
pays satellites de l'Union Soviétique. Les journalistes participent à la création de ces agences
dans le cadre de politique de coopération, parfois même ils sont « prêtés » pendant une année,
comme l'un des journalistes que nous avons rencontrés.
J'ai été détaché de l'AFP pendant un an, j'étais chargé de réformer l'agence polonaise
de presse, car je suis d'origine polonaise. Le nouveau Premier Ministre polonais me
connaissait personnellement, je l'ai connu à Rome quand il allait voir le pape et donc
il m'a demandé de l'aider à reformer le système d'information polonais. Donc pendant
un an, j'ai travaillé à cela, ce qui était un bon défi car c'était une institution très
communiste, complètement bureaucratisée, sclérosée. J'ai porté la lumière
occidentale.
Cela leur donne le sentiment de participer au mouvement de démocratisation de l'information
dans le monde, et nourrit l'engagement professionnel qu'ils ont vis-à-vis de leur métier. Les
journalistes s'impliquent également dans la vie de l'agence de multiples manières. Plusieurs
d'entre eux participent à des missions visant à modifier le statut de l'agence, d'autres dirigent
des missions d'expérimentation de nouvelles activités pour le compte de l'AFP. Ainsi un
journaliste que nous avons rencontré, a participé au développement d'un pôle d'informations
économiques pour le Moyen-Orient. Toutefois, nombre des projets internes à l'agence
229
auxquels ont participé ces journalistes n'aboutissent pas ; ils ressentent alors une vive
déception et considèrent que l'Agence France Presse fait preuve d'inertie et d'incapacité à
innover.
- J'avais abandonné la fonction de journaliste et j'occupais des fonctions de direction
économiques et financières pour développer un pôle d'informations économiques pour
le Moyen-Orient, au Caire. Je m'en suis occupé, jusqu'à ce que l'AFP manque
d'argent de manière périodique, cyclique, et congénitale et considère qu'elle n'avait
plus d'argent pour financer sa part qui était majoritaire. Plus tard, j'ai retravaillé sur
un autre projet, là encore la direction n'a pas voulu non plus s'engager sur ce truc là.
- Le développement commercial pour qu'il soit réel, il faudrait que l'AFP ne se vive
plus comme une entreprise qui vit des subsides de l'Etat et qui est confirmé dans son
irresponsabilité même de ne faire aucun effort.
Suite à l'échec de ces projets, une partie de ces journalistes vont occuper alors une position de
retrait vis-à-vis de l'agence considérant qu'ils ont une influence toute relative sur l'évolution
de leur entreprise de presse. Les journalistes de cette génération nous apparaissent comme des
journalistes désillusionnés, ils ont une vision beaucoup moins passionnée du métier qu'à leurs
débuts, moins idéalisée. Cette désillusion est à mettre en relation avec les transformations du
rôle professionnel du journaliste comme nous le verrons dans la partie suivante. En effet, les
journalistes qui avaient développé une conception « politisée »236 de leur métier, considérant à
l'image de leurs prédécesseurs qu'ils répondaient à une mission de service public, vont devoir
s'adapter à des exigences davantage économiques et commerciales que politiques, des
exigences dictées par l'intensification de la concurrence, et répercutées par la direction de
l'agence. Ces journalistes insatisfaits, vont s'investir dans des activités journalistiques ou
littéraires parallèles qui les satisfont davantage237. S'ils restent attachés et fidèles à l'AFP,
236 Cette conception « politisée » fera l'objet de la section suivante.237 Nombreux sont les journalistes de l'AFP qui publient des ouvrages parallèlement à leur professionde correspondant étranger : Jean-Pierre Campagne a publié « Kao, le désordre des hommes »,« Dépêches de Somalie », « Né la nuit », « Le Papillon dans l'oreille de l'éléphant », JacquesCharmelot a publié « L'ombre de Bagdad », René Naba a publié « Guerre des ondes - guerre desreligions ; la bataille hertzienne dans le ciel méditerranéen », Claude Wauthier a publié « L'Afriquedes Africains : inventaire de la négritude », Mario Vargas Llosa a quitté l'AFP pour se consacrer à
230
c'est, premièrement, en souvenir de la période, que certains qualifient d'« âge d'or », ou cours
de laquelle ils avaient le sentiment d'avoir une influence sur le cours des événements et sur
l'opinion publique, et, deuxièmement, en raison de la précarité qui touche l'ensemble de la
profession et qui limite la mobilité professionnelle. 23
2.3 Une conception de l'information en mutation et une conception professionnelle
politisée
Les journalistes qui intègrent l'agence au cours des années soixante-dix vont associer à la
conception de service public qui était celle de leurs aînés, une conception « politisée » de
l'information, non pas au sens partisan du terme, mais au sens où les journalistes conçoivent
que, par leur pratique, ils peuvent sensibiliser le public à certains enjeux et éventuellement,
contribuer à changer le monde. Ils estiment que, face aux grands enjeux qui secouent la
société de cette époque, le journaliste doit prendre parti.
- À l'époque, on avait l'impression qu'à travers l'AFP, on pouvait peut-être changer
quelque chose. Ce qui était privilégié c'était la recherche d'un moyen de faire parvenir
un message, pas de façon grossière comme celle que l'on pouvait trouver dans les
journaux de partis comme l'Humanité,
- À travers l'AFP, on pouvait faire passer un certain nombre de messages, ces
messages-là c'était des messages de la gauche, des messages centrés vers des
problèmes de décolonisation, pour en finir avec les pays sous domination, en finir
avec les bases militaires. C'était la fin de la guerre du Vietnam, toutes les
conséquences de la reconversion économique de la France; c'était les années
Pompidou; les années d'industrialisation en France, l'extension du prolétariat. A
l'époque c'était pas vu tellement sous le côté revenus et salaires mais sur l'aspect des
l'écriture, il a publié de nombreux romans parmi lesquels : « Le Paradis un peu plus loin », « La villeet les chiens » etc.238 Le désengagement de cette génération de journalistes peut être associé à l'accélération desdifférenciations identitaires que souligne Sainsaulieu In Sainsaulieu, Renaud, Sociologie del'entreprise, Paris, Presses de la FNSP et Dalloz, Paris, 1997, 2ème édition, 476 pages, les identités detype fusionnel sont en déclin.
231
conditions de travail : ça tournait beaucoup autour de questions de ce type : comment
avoir un travail humanisé ?
- On n'avait pas l'impression de servir un camp, le camp socialiste contre le camp
capitaliste, mais on avait l'impression de servir le camp de l'humain, on était
évidemment à la fin des trente glorieuses, mai 68 était passée par-là.
Au cours des années quatre-vingt, une conception commerciale du rôle du journaliste
va se substituer progressivement à la conception « politisée » des années soixante-dix,
sous l'impulsion de la crise économique vécue par l'agence. À cette période, l'agence
est confrontée à une intensification de la concurrence et à des difficultés financières
sans précédent. «L'AFP connaît en 1982 de sérieux ennuis. Les déficits des deux
dernières années s'élèvent à 31.5 millions de francs et si l'on ajoute des besoins
nouveaux pour 1983, c'est 84,52 millions de francs qu'elle doit trouver, plus de dix
pour cent du chiffre d'affaires. »239 Ces difficultés vont conduire l'agence à revoir ses
objectifs. Afin d'assainir la situation économique de l'agence, Henri Pigeat, PDG de
l'AFP de 1979 à 1986 souhaite redéfinir le rôle de l'agence, notamment en
abandonnant les velléités «d'agence mondiale d'information». Le 8 juillet 1986,
Henri Pigeat présente son plan de redressement qui comprend le licenciement de trois
cents personnes.
8 juillet 1986. Jamais l'agence n'a été soumise à un tel traitement de choc. Trois
cents suppressions d'emplois; soit quinze pour cent du personnel, une décentralisation
qui enverra loin de Paris les desks étrangers, la suppression des services magazine,
écoutes et contrôle. (...) Le plan de restructuration approuvé par le conseil
d'administration, est exposé devant soixante personnes, la hiérarchie de la maison,
par Henri Pigeat240.
39 Huteau, Jean, Ullman, Bernard, AFP, Une histoire de l'Agence France Presse : 1944-1990, RobertLaffont, Paris, 1992, page 428.240 Huteau, Jean, Ullman, Bernard, AFP, Une histoire de l'Agence France Presse : 1944-1990, RobertLaffont, Paris, 1992, page 448.
232
S'ensuivent quatre jours de grève totale de protestation du 11 au 19 juillet 1986, puis huit
jours de grève du 11 au 18 décembre 1986 qui aboutiront à la démission du PDG. Les
journalistes subissent de plein fouet les difficultés financières de l'agence qui, si elles ne sont
pas nouvelles, vont se traduire pour la première fois par le départ d'une partie des salariés de
l'agence.
Ces difficultés vont aboutir à une redéfinition des objectifs de l'agence. Les journalistes sont
fermement incités à exercer un rôle de commercial et cela se traduit notamment par le refus de
distribuer les fils de l'agence aux clients « mauvais payeurs ». En 1989, le Président Directeur
Général de l'AFP, Jean-Louis Guillaud affirme : « Les directeurs de bureaux à l'étranger, qui
sont environ soixante-dix, sont à la fois des producteurs d'information et des responsables
commerciaux. Nous les motivons dans ce sens, en n 'acceptant plus notamment que l'AFP
puisse être distribuée gratuitement à des gens qui ne paient plus leur facture »241. Cela induit
aussi que les clients qui usaient de leurs relations diplomatiques pour continuer de recevoir les
fils malgré leurs dettes ne pourront plus agir de la sorte. Cela nous semble être un élément
particulièrement significatif du passage d'un fonctionnement «politique» de l'agence à un
fonctionnement davantage « commercial ».
Quand j'étais directeur du bureau, à Alger, pendant plusieurs années, les abonnés ne
payaient pas et quand l'AFP les contactait pour se faire payer, ils contactaient
l'Elysée et leurs dettes étaient effacées. Moi, je suis allé les voir en leur disant : «il va
falloir que ça change un peu ce type de rapports, c'est l'AFP, pas l'État français »,
c 'est une confusion contre laquelle on essaie de lutter. Si c 'était le cas il y a encore
une dizaine d'années, aujourd'hui, ça a totalement changé, quand on ne nous paie
pas, on coupe. Quand l'affaire se corse, on coupe. Je viens de couper le service pour
le journal Payra. Pour beaucoup, la dépense de l'AFP n 'est pas une dépense
obligatoire, élémentaire, prioritaire.
Aujourd'hui, la dimension commerciale fait partie intégrante de la formation des journalistes,
ainsi le journaliste, nommé directeur d'un bureau à l'étranger suit, avant son départ, une
24lCharon, Jean-Marie, "L'AFP peut-elle être gérée comme une entreprise?", Mediaspouvoirs, octobre1989, pp. 131-139.
233
préparation de cinq jours, où une journée est consacrée exclusivement au développement
commercial du bureau
Tous les journalistes entrés dans l'agence au cours des années soixante-dix n'ont pas accepté
cette évolution de la conception de l'information et du rôle de l'agence vers un pôle
commercial. Ce sont ceux-là qui rejettent par exemple la création d'un fil people ou qui
critiquent la conception professionnelle de la nouvelle génération de journalistes. En effet, les
journalistes entrés à l'agence au cours des dix dernières années adhèrent à une conception de
leur rôle qui intègre la dimension commerciale. Le fossé creusé entre la nouvelle génération
de journalistes et la génération précédente est d'autant plus important que la direction de
l'Agence France Presse semble ne pas savoir comment gérer la carrière de ses journalistes
entrés à l'agence au cours des années soixante-dix. « Aujourd'hui on dit qu 'ily a trop de vieux
à l'AFP. Bah peut-être, mais la question ce n'est pas qu'il y ait trop de vieux, c'est que les
vieux soient utilisés avec un minimum de dynamisme. » Parmi les journalistes que nous avons
rencontrés, bon nombre des agenciers appartenant à cette génération, sont insatisfaits de leur
poste actuel. Certains ayant occupé autrefois des postes de directeur de bureau étranger,
occupent aujourd'hui des postes peu valorisants, plusieurs sont déjà passés par le service de la
« grande nuit », bon nombre d'entre eux voient leur candidature pour des postes à l'étranger
systématiquement refusée. Un de ces journalistes résume ainsi la situation : « On veut couper
les liens intergénérationnels, on ne facilite pas les liens entre les commerçants et les
journalistes, entre les jeunes et les vieux ». L'affirmation de ce journaliste est fort
significative: pour lui les «vieux» agenciers sont des journalistes et les «jeunes», des
commerçants. Bien qu'excessive, cette affirmation rend assez bien compte de la situation
actuelle, même si nous avons également rencontré des journalistes qui exercent la fonction de
directeur de bureau ou de correspondant étranger et qui sont satisfaits de leurs affectations.
242 AFP, document interne : « Diriger un bureau à l'étranger ».
234
Section 3 - Les journalistes entrés à l'agence entre 1990 et 2006
3.1 L'école de journalisme, voie d'excellence
La population journalistique française s'est considérablement accrue au cours des dernières
décennies, ses effectifs ont été multipliés par trois entre 1960 et 2000. Par ailleurs, la nature et
le niveau de la formation ont considérablement évolué, notamment avec le développement des
écoles de journalisme. En 2006, la France compte quatorze écoles de journalisme243
reconnues par la profession (c'est-à-dire par la Commission nationale paritaire de l'emploi des
journalistes, le CNPEJ) et dont sortent chaque année 400 diplômés. Par ailleurs, les candidats
à cette profession n'ont jamais été aussi nombreux, ce qui place les entreprises de presse en
position de force. Celles-ci sont en mesure d'exiger de la part des journalistes postulants des
formations toujours plus longues, plus spécifiques et plus adaptées à leurs besoins. La
multiplication des candidats au poste de journaliste conduit à une « intensification de la
concurrence entre les nouveaux entrants »244. Les journalistes français formés « sur le tas »
sont donc de moins en moins nombreux. Quant à l'AFP, elle recrute quasi exclusivement des
journalistes issus des écoles de journalisme245. L'enquête de Dominique Marchetti et Denis
Ruellan fait apparaître le poids croissant des élèves issus des trois principales écoles de
journalisme dans les grandes rédactions nationales françaises. «Le recrutement s'est
fortement homogénéisé socialement et le passage par un Institut d'Études Politiques, puis une
école de journalisme est devenue une voie royale d'accès aux rédactions les plus
réputées. »
Le parcours typique d'un journaliste embauché en statut siège par l'AFP aujourd'hui est le
suivant : il a suivi des études universitaires ou dans un Institut d'Études Politiques pendant
243 ESJ, CFJ, CUEJ, IUT de Bordeaux, CELSA, IPJ, IFP, IUT de Tours, EJCM, École de journalismede Toulouse, Institut de la communication et des médias à Grenoble et IUT de Lannion.244 Ruellan Denis, Marchetti Dominique, ibidem, page 13. On peut également se reporter au rapportsuivant : Devillard, V., Lafosse, V., Leteinturier, C et alii, Journalistes au pluriel. Sociologie d'ungroupe professionnel à l'aube de l'an 2000, La Documentation française, Paris, 2001.
5 Seuls les journalistes recrutés en local échappent parfois à cette contrainte. Toutefois, laconcurrence qui sévit entre les postulants au statut siège de l'AFP, conduit certains jeunes journalistesissus d'une école de journalisme, à postuler en local, en espérant ensuite obtenir le statut siège parpromotion interne.246 Marchetti, Dominique, "La sociologie et l'actualité médiatique", Polis, vol. 5, n°, 1998, pp. 74-82.
235
trois ans, puis il a passé le concours d'une école de journalisme, a effectué trois ans d'études
au sein de cette école et enfin a passé un concours pour intégrer l'agence. Le concours réussi,
le journaliste est engagé en contrat à durée déterminée pour une période allant de six mois à
deux ans. À l'issue de cette période, si l'expérience s'est avérée concluante, il accède au statut
« siège » tant convoité247. Les journalistes postulant à l'AFP sont particulièrement nombreux,
notamment en raison de la précarisation qui touche la population journalistique mais
également en raison du prestige qu'il y a à travailler pour une agence mondiale. Dans
l'imaginaire collectif des jeunes entrants, l'AFP représente une garantie d'emploi à partir du
moment où l'on dispose du statut siège, ce qui constitue un élément non négligeable si l'on
considère la crise économique et financière que connaît la presse écrite générale248.
Je suis entrée à l'AFP car c'est une maison qui m'a toujours fait rêver, c'est l'agence,
le média qui propose le plus d'expériences à l'étranger. J'ai jamais envisagé de
travailler pour un autre média. C'est un média magique, je suis profondément attirée
par la correspondance étrangère; l'AFP, c'est la plus belle carte à jouer pour y
arriver.
Par ailleurs, les conditions du marché de l'emploi des journalistes contribuent à une
précarisation du statut de journaliste. La concurrence qui prévaut entre des prétendants
nombreux pour des postes rares crée une pression à la baisse sur les conditions de travail.
C'est ainsi que les postes disponibles correspondent de plus en plus à des emplois à la pige ou
en contrat à durée déterminée, et auxquels on ne peut accéder que par la voie d'un concours à
l'entrée des entreprises de presse. Alain Accardo, qui a consacré un ouvrage à ce
phénomène souligne la présence grandissante d'une population de journalistes alternant piges
et périodes de chômage. Si « les pigistes représentent 8.5 % de la population française en
17 Hormis deux journalistes de nationalité étrangère, tous les journalistes de la jeune génération quiont été interrogés ont suivi ce cheminement.M8Le quotidien Libération a procédé au début de l'année 2006 à un plan social visant à supprimer 52emplois, le quotidien français France Soir a procédé à un plan social qui le conduit à conserverseulement dix journalistes de l'ancienne rédaction pour constituer une nouvelle formule.249 Accardo Alain, Journalistes précaires, Le Mascaret, Bordeaux, 1998, 411 pages.
236
1975, ils sont 14.7 % en 1990, et dépassent 40 % des titulaires de la carte professionnelle en
1999»250
3.2 Un engagement et un attachement dictés par des intérêts personnels
Les jeunes journalistes adoptent un comportement plus individualiste que les journalistes plus
âgés. Cela se traduit notamment par le fait qu'ils signent leurs papiers beaucoup plus
fréquemment que leurs aînés. En effet, depuis le début des années quatre-vingt, les dépêches
signées se multiplient et tendent à devenir la norme, notamment pour les dépêches hors
factuelles. Les journalistes justifient le développement de la signature comme une exigence
des clients. Ceux-ci auraient ainsi le sentiment d'établir un rapport personnalisé avec les
agenciers. La signature constituerait également un gain de temps non négligeable pour les
secrétaires de rédaction qui pourraient choisir plus rapidement s'ils prennent ou non la
dépêche en fonction de la signature. Le journaliste d'une entreprise de presse choisira plus
facilement une dépêche dont l'auteur lui est connu, dont il connaît la qualité de travail. Par
ailleurs, les journaux préfèrent publier des textes signés qui, croient-ils, auraient plus de
valeur aux yeux des lecteurs que des textes d'agence non signés. La signature personnalise
dans une certaine mesure la relation avec le lecteur. Toutefois, il nous apparaît que le
développement des signatures coïncide avec un individualisme de plus en plus prégnant au
sein des rédactions de l'agence. Il témoigne d'une volonté de s'affirmer dans son
individualité, mais également d'un fort besoin de reconnaissance dont les journalistes des
générations précédentes semblaient pouvoir se passer.
Face à la multiplication des dépêches signées, la direction par le biais du manuel de l'agencier
rappelle sévèrement aux journalistes qu'ils doivent respecter la règle de l'anonymat :
(...) le correspondant d'agence est un 'anonyme'. Sa signature est, celle, collective, de
l'AFP. Tous dans une même mesure et dans une égale confiance, contribuent à cette
signature. Tous sont également responsables de son prestige comme des critiques
50 Neveu Erik, Sociologie du journalisme, coll. Repères, la Découverte, Paris, 2001, page 25.
237
qu 'elle peut attirer. Il doit donc être entendu qu 'il n 'existe fondamentalement qu 'une
vraie signature, qui est : Agence France-Presse251.
Si l'agence tient à l'anonymat, à l'encontre, semble-t-il, de la volonté de ses journalistes, c'est
sans doute qu'elle espère ainsi consolider l'image qu'elle renvoie à ses clients : l'information
est le produit d'un effort collectif, de l'ensemble des journalistes de l'AFP. Par ailleurs, cela
contribue à maintenir les liens entre les différents salariés de l'entreprise qui participent sans
distinction (extérieure) aux activités de l'AFP.
Outre la marque d'individualisation que constitue la signature des dépêches, les journalistes
de la jeune génération font preuve d'un engagement moindre dans la vie de l'entreprise, ce
que les anciens ne manquent pas de leur reprocher. Lors des crises internes notamment,
récurrentes au sein de l'AFP, les journalistes les plus anciens ressentent avec acuité cette
différence entre les jeunes journalistes et les plus anciens. « Au moment des grèves lors de la
possible privatisation de l'agence, le fossé entre les jeunes et le reste des journalistes était
particulièrement fort. Les jeunes, ils s'en foutaient, ils avaient un job et c 'est ce qui
comptait. » Cette conception individualiste du métier n'entre pas en contradiction avec le fort
attachement dont font preuve les jeunes journalistes à l'égard de l'AFP. Cet attachement est
surtout défensif et s'inscrit dans un contexte économique de plus en plus précaire.
Dans un tel contexte, les journalistes de la jeune génération sont amenés à « mettre entre
parenthèses » leur vie personnelle ou leur vie de famille, le temps que dure leur affectation à
l'étranger. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui que l'accès des femmes à l'emploi s'est
généralisé et que celles-ci ne font pas toujours le choix de renoncer à leurs carrières pour
suivre leurs maris. «Le principal inconvénient de travailler à l'étranger, c'est le côté
personnel, familial, c 'est très très lourd. Ma femme ne travaille pas parce que je suis à l'AFP.
Elle a renoncé à sa carrière en partant du principe que la mienne était plus intéressante.» Il
arrive que les deux conjoints exercent à l'AFP mais cela complique d'autant plus la vie
personnelle du journaliste. À l'AFP, les deux membres d'un couple n'obtiennent jamais la
même affectation. La direction refuse que deux conjoints exercent dans le même bureau,
considérant que cela pourrait entraîner des difficultés de gestion des relations humaines au
sein du bureau. En conséquence, l'un des deux conjoints doit donc renoncer à exercer
251 AFP, Manuel de l'Agencier, 1982, page 162.
238
momentanément son métier et retrouve à son retour au sein de l'agence un poste qu'il n'a pas
choisi, son ancien poste ayant été affecté à un autre journaliste. Le retour au siège, passage
obligatoire, est donc souvent mal vécu par les journalistes. Parmi ceux que nous avons
interrogés, deux couples ont fait des choix différents. Dans le premier cas, la femme a accepté
de laisser son poste pour suivre son mari nommé directeur de bureau à l'étranger, mais elle
réalise alors des piges pour la presse écrite et notamment le quotidien Libération. Dans le
second cas, la femme du journaliste nommé directeur du bureau choisi de conserver son poste
au siège où elle vient d'obtenir un poste au service religion, plutôt que de suivre son conjoint
au Caire, le couple sera alors séparé durant quatre ans.252
3. 3 Une conception commerciale et individualiste du métier
La génération la plus jeune développe une conception sensiblement différente de
l'information, où la dimension marchande est prédominante. Leurs pratiques sont rythmées
par celles de la concurrence, leurs dépêches analysées, et leurs activités surveillées. Le niveau
de concurrence est tel que le journaliste recherche de manière permanente à se distinguer de
ses concurrents.
Comme nous l'avons précisé dans les sections précédentes, les journalistes qui exercent dans
les années cinquante et soixante développent une conception de leur rôle professionnel en
termes de « magistère ». Ils exercent une forme d'autorité sur leurs clients qui les conduit à
décider du contenu et de la forme des dépêches. Toutefois dans les années quatre-vingt et
quatre-vingt-dix, l'intensification de la concurrence et l'extension de l'offre informationnelle
disponible grâce à de nouveaux médias, parmi lesquels Internet et les chaînes d'information
en continu, vont modifier considérablement les rapports entre les journalistes et les clients. Le
rapport de force s'inverse, les clients « imposent » leur choix aux journalistes. Même si, dans
les années cinquante et soixante, l'agence se préoccupait de ses clients et était portée par
l'intérêt d'accroître et de fidéliser sa clientèle, les journalistes de cette époque, dans la
conception qu'ils se faisaient de leur rôle professionnel et dans leur pratique quotidienne se
sentaient peu concernés par ces préoccupations. Les journalistes de la jeune génération, quant
à eux, ont une conscience aiguë du caractère commercial de leur profession. « La politique, ça
avait trop de place avant. On a des clients à servir. Je pense que l'on a aussi une vocation
52 Parmi les journalistes que nous avons interrogés, nous n'avons pas rencontré de cas où un conjointa suivi sa conjointe affectée à l'étranger.
239
économique, une agence d'information est là avant tout pour informer avant de se préoccuper
d'une logique économique, mais que ça ne fait pas de mal d'avoir une logique économique et
de vous dire qu'on va servir nos clients ; qu 'ils vont payer pour ça et qu'ils ont des besoins en
particulier, et si on peut le faire, faisons-le. »
Contrairement aux journalistes des deux générations précédentes qui ont très souvent évoqué
la dépêche en des termes de « bien public » ou préfèrent évoquer les destinataires en termes
« d'usagers » plutôt que de « clients », l'attention des jeunes journalistes est davantage
focalisée sur les intérêts des clients-médias voire des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs.
- Il y a des thématiques qui nous rattrapent, qui sont dans l'air du temps. Je pense que
nous avons davantage le souci de vendre que la génération qui a débuté dans les
années soixante-dix. Pas de vendre directement, mais nous avons le souci de produire
une information qui va trouver des lecteurs, qui va répondre à un intérêt. Fatalement
on s'adapte aussi à des sujets qui sont dans l'air du temps, à des modes (...)
- On est dans une crise du lectorat sans précédent, donc il faut s'adapter aux besoins
des gens. Je pense profondément que ce n'est pas galvauder l'information, je crois
qu'il n'y a pas moins de noblesse à faire un papier très concret sur le fait qu'un
scooter ou un 4/4 ça pollue dans les rues, que d'expliquer le protocole de Kyoto. Ils
sont sur le même plan.
Dans la couverture de situations intéressant l'ensemble de la planète, comme dans cet
exemple du protocole de Kyoto, les journalistes cherchent à adopter le point de vue de
l'individu lecteur de manière à rattacher un événement à dimension globale à des
préoccupations locales, à dimension humaine, et ainsi accroître l'intérêt du public. Ainsi nous
sommes en mesure d'affirmer que la conception informationnelle que développe les
journalistes de cette génération peut être qualifiée de pragmatique.
Au cours de ce chapitre, nous avons constaté qu'à chaque génération de journalistes étudiée,
correspondait une identité professionnelle spécifique. Au regard de l'évolution du métier de
correspondant étranger, la génération intermédiaire étudiée (les journalistes âgés aujourd'hui
240
d'une cinquantaine d'années) cristallise les tensions induites par un changement de
configuration.
241
CONCLUSION
Cette thèse répond à un double objectif, d'une part identifier les pratiques et l'identité
journalistiques des correspondants étrangers de l'AFP et leur évolution entre 1945 et 2005 ;
d'autre part démontrer que ces changements participent d'un mouvement global de
transformation de l'environnement médiatique et du fonctionnement des entreprises de presse.
Pour ce faire, nous avons établi un réseau d'hypothèses par le biais d'idéal types. Pour valider
ces hypothèses, nous avons conjugué trois techniques d'observation : des entretiens avec des
correspondants étrangers de l'AFP, un stage observation participante du bureau du Caire et
une analyse documentaire de dépêches et de documents internes de l'agence. Au terme de ces
observations, nous avons pu établir un certain nombre de correspondances, mais aussi des
écarts, entre les idéal types et la réalité sociale que nous avons recensés dans les tableaux
situés au terme de la conclusion.
Notre cadre d'analyse s'articulait sur trois niveaux : l'environnement médiatique mondial
(niveau macro sociologique), l'entreprise de presse (niveau meso sociologique), la pratique
journalistique et l'identité professionnelle (niveau micro sociologique). Au niveau macro
sociologique, nous avons établi que l'environnement médiatique mondial avait connu des
mutations importantes entre le début et la fin de notre période d'analyse. Lors de la première
configuration, l'environnement médiatique mondial se caractérisait par un nombre restreint de
joueurs, auquel correspondait une offre d'information relativement limitée. Par ailleurs, la
concurrence était circonscrite à un nombre limité d'acteurs ayant un fonctionnement
relativement similaire à l'agence. Enfin les techniques de transmission étaient peu fiables,
laborieuses et limitées. Puis progressivement, au cours des années soixante-dix et quatre-
vingt, l'environnement médiatique mondial a évolué au point qu'il revêt une réalité bien
différente. L'environnement médiatique mondial se caractérise aujourd'hui par un grand
nombre de joueurs et une offre d'information surabondante. Les concurrents de l'AFP sont
multiples et n'ont pas tous le même statut (chaîne d'information, agence de presse, firme de
242
communication) ou la même fonction (diffusion d'informations générales, spécialisées,
analyse ou information factuelle etc.)- En outre les innovations techniques permettent
désormais une transmission des informations quasi simultanée, sûre et dont le volume est
illimité. Conformément à notre hypothèse de départ, il nous est apparu que les tensions entre
les acteurs de l'environnement médiatique mondial s'établissaient au début de la période
d'étude sur des règles de nature essentiellement politiques et commerciales. Au terme de la
période d'étude, les relations entre les acteurs s'établissent selon un fonctionnement quasi-
exclusivement commercial.
Au niveau meso sociologique, nous avons établi que malgré les relations étroites qu'elle
entretient avec l'État français et son héritage historique, l'Agence France Presse a suivi les
transformations de l'environnement médiatique mondial, passant progressivement d'une
logique publique à une logique commerciale ; ce passage se traduit notamment par le
désengagement progressif de l'État Français dans le financement de l'agence.
Enfin, au niveau micro sociologique, les changements se sont opérés sur trois plans : le texte
journalistique, les pratiques journalistiques et l'identité professionnelle des journalistes.
Au chapitre du texte journalistique, la reconfiguration a donné lieu à de nouvelles orientations
de la dépêche. Les impératifs commerciaux et l'accroissement de la concurrence exigent que
l'agence propose un éventail élargi de ses contenus, laissant une grande place aux textes à
dominantes sociétale et divertissante. Par ailleurs, pour conserver voire élargir sa clientèle,
l'agence doit être en mesure de fournir une offre adaptée à chaque demande. Dans ce
contexte, fragmentation et hyper caractérisation des textes semblent être les deux mots
d'ordres de l'AFP. Enfin, l'agence subit une concurrence toujours plus vive de la part des
médias audiovisuels et d'Internet qui fournissent une information essentiellement factuelle et
dont l'agence cherche à se distinguer en multipliant les dépêches analytiques.
Au chapitre des pratiques journalistiques, nous avons souligné dans notre recherche combien
le contexte d'hyper concurrence conjugué aux innovations techniques ont modifié
substantiellement le cadre d'exercice du métier de journaliste. Que ce soit au sein de
l'entreprise de presse ou au sein de l'environnement médiatique, les acteurs entretiennent des
rapports d'interdépendance d'une intensité sans précédent. En conséquence, le regard du
journaliste se tourne autant vers l'événement que vers ses concurrents et le traitement qu'ils
243
en feront. Il surveille tout autant qu'il fait l'objet lui-même d'une surveillance accrue de la
part de sa hiérarchie. Le journaliste s'inscrit au quotidien dans une logique de défis : conquête
permanente de sa clientèle, distinction et dépassement de ses concurrents, diversité du
traitement de l'événement et recherche perpétuelle de l'approbation de sa hiérarchie. Autant
d'éléments qui témoignent de la prééminence de la logique commerciale sur la logique
informationnelle.
L'analyse des identités successives empruntées par les correspondants étrangers de l'Agence
France Presse peut, a priori, sembler être l'élément le plus spécifique à notre objet d'étude.
Pourtant, cette étude de trois générations de journalistes nous est apparue particulièrement
instructive sur la manière dont les journalistes pensaient et vivaient leur métier hier et
comment ils l'abordent aujourd'hui. La génération intermédiaire, les journalistes âgés
aujourd'hui de quarante-cinq à cinquante-cinq ans, nous semble particulièrement intéressante
à cet égard. « Tiraillés » entre deux conceptions divergentes du métier, le malaise de certains
d'entre eux témoignent de la radicalité des changements survenus dans la pratique du
journalisme.
Notre capacité à décrire et expliquer les transformations de l'environnement médiatique
mondial est limitée par le peu de travaux qui y sont consacrés. Si les débats sur le Nouvel
Ordre mondial de l'Information et de la Communication à la fin des années soixante-dix
avaient généré la publication d'un nombre conséquent de travaux sur le fonctionnement de
l'environnement médiatique mondial, les études dans ce domaine sont aujourd'hui trop peu
nombreuses. Il apparaît donc urgent d'initier de nouvelles recherches au niveau macro
sociologique pour expliquer le fonctionnement du système médiatique mondial et par là-
même disposer d'une meilleure compréhension des changements dont les entreprises de
presse et les pratiques journalistiques sont l'objet.
244
Configuration A
Reconfiguration
Configuration B
LES PRATIQUES JOURNALISTIQUESIDEAL TYPE
Autonomie par rapport audesk
Relative autonomie parrapport aux concurrentsEvaluation sporadique dela copieUne course contre le tempsralentie par la fragilité destechniques de transmissionRapports directs avec lessourcesLe journaliste est expertJournalisme événementiel
Autonomie et desk
ConcurrenceEvaluation de la copieRapport au temps
Rapport aux sourcesSous le contrôle du deskRéflexivité
Evaluation rationalisée dela copieMultiples sourcesJournalisme situationnelLe règne de l'urgenceRapports indirects avec lessourcesRecours aux experts
REALITE OBSERVEESi les correspondants étrangers disposent d'une certaine liberté d'action vis à vis du desk, la conception de la dépêche ne peut se fairesans l'aide du desk : l'opérateur technique constitue un acteur incontournable et le journaliste du desk détermine la conception finale dela copie.Les journalistes ne disposent pas comme aujourd'hui d'outils permettant une surveillance de ses concurrents, par ailleurs lescorrespondants étrangers étaient moins nombreux qu'aujourd'hui.La copie ne fait pas l'objet d'une évaluation rationnelle et organisée. Chaque journaliste du desk procède à sa propre évaluation desdépêches qu'il reçoit.La fragilité des transmissions ralentie la transmission, par ailleurs elle conduit les journalistes à devenir un véritable expert techniquepour parvenir malgré tout à transmettre ses dépêches.
Journalistes de terrain, ils établissent un contact direct avec les sources.
Le journaliste en tant que témoin de l'événement se positionne en expert.Les journalistes produisent uniquement des dépêches ayant un événement pour point de départ.Les journalistes sont multilingues, ils rédigent les dépêches en plusieurs langues.Le téléphone portable et le satellite facilitent le travail du journaliste sur le terrain, mais ils le rendent joignable et « contrôlable » par sahiérarchie.Les agences régionales ainsi que les chaînes d'information en continu constituent de nouveaux concurrents.L'évaluation de la copie reste encore peu organisée.Les techniques de transmission s'étant considérablement améliorées, les journalistes doivent produire de plus en plus rapidement ungrand nombre de dépèches, ils doivent faire face à la couverture « en direct » des premières chaînes d'information en continu.Apparition de nouvelles sources (ONG, acteurs sociaux) que les journalistes doivent prendre en compte.Les journalistes sont en contact permanent avec leur hiérarchie.Les journalistes mènent simultanément à la rédaction de leurs dépêches, une veille de leurs concurrents, les conduisant à être partagésentre les imiter et s'en distinguer.Les journalistes sont sous la surveillance d'un nouveau dispositif: Alerte et Analyse qui veille à la correspondance entre les dépêches del'AFP et celles des autres agences, mais évaluent également leur performance commerciale.Les sources se sont multipliées et professionnalisées.Les journalistes procèdent à l'analyse et à la contextualisation des faits.Accélération du traitement de l'information, multiplication des dépêches urgentes.Les modalités d'accès se sont considérablement modifiés
Le développement du journalisme situationnel conduit au recours croissant aux experts.
245
Configuration A
Reconfiguration
Configuration B
L IDENTITE JOURNALISTIQUEIDEAL TYPE
Journalisme masculinFormation et culture générale,littéraire et politique
Mobilité des journalistes entreplusieurs médias
Journaliste indépendant du siège
MixitéFormationMobilité
Indépendance vis à vis du siège
Journalisme mixteFormation professionnelle ettechnique spécialiséeFidélité à l'agence motivéenotamment par la précarisation dela professionJournaliste sous surveillance
REALITE OBSERVEELes correspondants étrangers sont effectivement exclusivement de sexe masculin.Parmi les journalistes rencontrés, certains ont suivi une formation universitaire élevée et disposent ainsi d'une culture générale,littéraire et politique, mais d'autres journalistes n'ont pas nécessairement eu accès à une telle formation, certains d'entre euxobtiennent une intégration quasi automatique au sein de l'AFP due à leur activité au sein d'Havas.Certains journalistes font le choix de quitter l'AFP pour d'autres aventures professionnelles, le marché de l'emploiparticulièrement dynamique favorise cette mobilité. Pour autant, bon nombre de journalistes qui ont débuté à l'AFP, y font touteleur carrière. Certains journalistes qui ont quitté la maison AFP, y reviennent après quelques années passées dans un autre média.Les journalistes que nous avons rencontrés évoquent la grande autonomie dont ils disposent dans leur pratique quotidienne àl'étranger. Toutefois, quant à leur affectation à l'étranger, ils se plient au bon vouloir de la direction,Les journalistes conçoivent l'information comme un bien public et exercent une fonction de magister auprès de leurs lecteurs.Quelques femmes ont accès à des postes de correspondants à l'étranger.Nombre des journalistes ont mené des études universitaires dans le domaine des sciences sociales et des humanités.Les correspondants étrangers sont fidèles à l'AFP, mais la crise économique que traverse l'AFP au milieu des années quatre-vingtconduit certains à quitter l'agence contre leur volonté.Le développement des satellites rend le journaliste davantage dépendant du siège.Les journalistes développent une conception professionnelle politisée de leur métier.Seul 20% des journalistes expatriés de l'AFP sont des femmes.Les journalistes reçoivent effectivement une formation professionnelle et technique spécialisée dispensée par les écoles dejournalisme.Si la précarisation de la profession a une incidence sur la fidélité dont font preuve les journalistes à l'égard de l'AFP, lesjournalistes de la configuration B se caractérisent par la conception individualiste de leur métier. Face à de nouvelles opportunitésd'emploi, ils quitteront l'agence.Les journalistes font l'objet d'une double surveillance : celle du siège, via le service Alerte et Analyse, et celle du bureau régionaldont ils dépendent.Les journalistes développent une conception commerciale et individualiste de leur métier.
246
Configuration A
Reconfiguration
Configuration B
LA DEPECHE JOURNALISTIQUEIDEAL TYPE
Ecriture personnalisée et peunormaliséeRègne du factuel
Faible éventail des thématiques :l'information politique etgénérale sérieuse est privilégiéeFaible distinction entre lesdépêchesTaille des dépèches peunormaliséeEcritureLes dépêchesThématiques
Distinction entre les dépêchesTaille des dépêchesEcriture fortement normalisée
Faits et contexte associés dansune même dépêcheLarge éventail des thématiques :thématiques variées.Forte distinction entre lesdépêchesTaille limitée des dépêches
REALITE OBSERVEE
Le journaliste agit discursivement dans la dépêche.
Le factuel est le genre par excellence, il coïncide avec le journalisme événementiel caractéristique du journalisme de laconfiguration A.Un traitement prioritaire est réservé au fait politique dans les dépêches de l'agence.
L'hypothèse est confirmée. L'agence opère une distinction sommaire entre les dépêches : les journalistes distinguent les factuelset les features.La taille des dépêches connaît des variations importantes d'un journaliste à l'autre, pouvant atteindre douze feuillets pour certainsreportages.L'écriture devient un enjeu commercial, le style d'écriture se neutralise pour en faciliter l'adaptation par le client.Au factuel, s'ajoute un type de dépêche plus analytique.La crise des institutions que connaît la société conduit à une mise à distance de la chose politique et se traduit par un nouvel intérêtpour d'autres thématiques.Le nombre de dépêches hors factuels augmentent (passant de 3 en 1971 à 17 en 1982).L'informatisation de l'agence au cours des années soixante-dix contribue à la normalisation de la taille des dépêches.Le style anglo-saxon est adopté et l'écriture agencière est plus agressive. Par ailleurs, l'AFP opère une spécialisation linguistiquede ses journalistes. Enfin, contrairement à notre hypothèse de départ, la signature des dépêches s'accroît considérablement.Les factuels coïncident avec les dépêches d'analyse. L'accroissement des analyses coïncident avec le développement dujournalisme situationnel, caractéristique du journalisme de la configuration B.Développement de nouvelles thématiques : information sociétale (life style, information fonctionnelle), information divertissanteet Insolites.La couverture est fragmentée et donne lieu à une multiplication des formats de dépêches. (l'AFP comptabilise 42 types dedépêches hors factuels en 2004).L'explosion du volume des dépêches conduit l'agence à limiter la taille des dépêches.
247
BIBLIOGRAPHIE THÉMATIQUE
Méthodologie
ARBORIO Anne-Marie et FOURNIER Pierre, L'enquête et ses méthodes ; l'observationdirecte, Nathan Université, collection Sciences Sociales 128, Paris,1999, 127 pages.
DE SINGLY François, L'enquête et ses méthodes : le questionnaire, Nathan Université,collection Sociologie, 128, Paris, 1998, 126 pages.
BEAUD Stéphane et WEBER Florence, Guide de l'enquête de terrain. Produire et analyserdes données ethnographiques, Ed. La Découverte, Paris, 1998, 356 pages.
BECKER Howard, Écrire les sciences sociales, Economica, coll. Méthodes des sciencessociales, Paris, 2004, 180 pages.
BECKER Howard, Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciencessociales, lere éd. 1998, Paris, La Découverte, coll. « Guides Repères », 2002, 352 pages.
Sociologie
Ouvrages
BOUDON Raymond, BOURRICAUD François, Dictionnaire critique de la sociologie,Quadrige, Paris, 2002, 736 pages.
CHAUVEL Louis, Le destin des générations. Structure sociale et cohortes en France auvingtième siècle, Paris, PUF, 1998, 301 pages.
CROZIER Michel, FRIEDBERG Erhard, L'acteur et le système : les contraintes de l'actioncollective, éditions du Seuil, Paris, 1977, 500 pages.
248
CORCUFF Philippe, Les nouvelles sociologies : constructions de la réalité sociale, ArmandColin, coll. 128, Paris, 2004, 128 pages.
DUBAR, Claude, La socialisation : construction des identités sociale et professionnelle,Paris, Armand Colin, 2e éd. revue, 1998, 276 pages.
DUBAR Claude, TRIPIER Pierre, Sociologie des professions, Armand Colin, Paris, 1999,279 pages.
ELIAS Norbert, Qu 'est ce que la sociologie, éditions de l'Aube, Paris, 1991, 222 pages.
ELIAS Norbert, La société des individus, Pocket, coll. Sciences Humaines, Paris, 1998, 301pages.
GITLIN Todd, The Whole World is Watching, Berkeley: University of California Press, 1980,352 pages.
HEINICH Nathalie, La sociologie de Norbert Elias, Repères, la Découverte, Paris, 1997, 121pages.
SAINSAULIEU Renaud, Sociologie de l'entreprise, Paris, Presses de la FNSP et Dalloz,Paris, 1997, 2ème édition, 476 pages.
WEBER Max, « L'objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales », inEssais sur la théorie de la science, Pion / Presses Pocket, coll. « Agora », n° 116, Paris, 1992.
• Articles scientifiques
ATTIAS-DONFUT Claudine, « Rapports de générations et parcours de vie », Enquêtenuméro 5, Biographie et cycle de vie.
Disponible sur : http://enquete.revues.org/document82.html (consulté le 12.01.06).
Globalisation et globalisation de l'information
• Ouvrages
249
CHAR Antoine, La guerre mondiale de l'information, Presses de l'université du Québec,Québec, 1999, 168 pages.
CORDELLIER Serge et alii, La Mondialisation au-delà des mythes, La Découverte, Essais,Paris, 2000, 177 pages.
HELD David, MAC GREW Anthony, GOLDBLATT David, PERRATON Jonathan, GlobalTransformations, Politics, Economies and Culture, Stanford, Londres, 1999, 539 pages.
HIRST Paul, THOMPSON Graham, Globalization in Question, Cambridge, Polity Press,Londres, 1996, 336 pages.
GERSHON Richard, The Transnational Media Corporations, Global Messages and FreeMarket Compétition, Mahwah, LEA publishers, 1997, 220 pages.
LAIDI Zaiki, Le temps mondial, éditions Complexe, 1997.
LAIDI Zaki, Un monde prive de sens, Fayard, 1994.
LAIDI Zaki, Malaise dans la mondialisation,\991
LEVY Pierre, World philosophie, Odile Jacob, Paris, 2000, 220 pages.
MATTELART Armand, La Communication-monde, La Découverte, Paris, 1999, 2èmeédition, 356 pages.
MATTELART Armand, La Mondialisation de la communication, PUF, « Que sais-je ? »n°3181, 3ème édition mise à jour, Paris, 2002, 128 pages.
MATTELART Armand, Histoire de l'utopie planétaire, La Découverte, Paris, 1999, 423pages.
MICHALET Charles-Albert, Qu 'est que la mondialisation ?, La Découverte, Cahiers Libres,Paris, 2002, 210 pages.
• Articles scientifiques
GIDDENS Anthony, entretien, Sciences Humaines n°84, juin 1998, page 39.
250
MARTIN et al., « The Sociology of Globalization : Theoretical and MethodologicalReflections », International Sociology, n°21, pp. 499-521, 2006.
MOWLANA Hamid, "Global Communication in Transition", Communication Abstracts,vol.21,n°2, 1998.
• Articles de presse
MATTELART Armand, « Nouvelles utopies, grandes inquiétudes. Une éternelle promesse :les paradis de la communication », Le Monde Diplomatique, novembre 1995, pp. 4-5.
Sociologie et Histoire du journalisme
• Ouvrages
RIEFFEL Rémy et WATINE Thierry (dir.), Les mutations du journalisme en France et auQuébec, Paris, éditions Panthéon-Assas, 2002, 319 pages.
ACCARDO Alain, ABOU Georges, Journalistes précaires, Le Mascaret, Bordeaux, 1998,411 pages.
BELISLE Claire, BIANCHI Jean, JOURDAN Robert, Pratiques Médiatiques, 50 mots clés,CNRS Communication, Paris, 1999, 428 pages.
BOHERE G., Profession journaliste, étude sur la condition du journaliste en tant quetravailleur, BIT, Genève, 1984, 180 pages.
BRIN Colette, CHARRON Jean, DE BONVILLE Jean (sous la direction de), Nature ettransformation du journalisme, Théorie et recherches empiriques, les Presses de l'UniversitéLaval, Québec, 2005, 454 pages.
CHEPESIUK Ron, HOWELL Harvey, LEE Edward, Raising Hell, Straight Talk withInvestigative Journalists, Mac Farland, Jefferson, 1997, 181 pages.
CHARON Jean-Marie, Cartes de presse, enquête sur les journalistes, Au vif Stock, 1993, 265pages.
251
CHARRON Jean, La production de l'actualité : une analyse stratégique des relations entre lapresse parlementaire et les autorités politiques au Québec, Montréal, Boréal, 1994, 446pages.
CORNU Daniel, Journalisme et vérité, Pour une éthique de l'information, Genève, Labor etFides, 1994, 510 pages.
DELPORTE Christian, Histoire du journalisme et des journalistes en France, Paris, PUF,Que sais-je, 1995, 128 pages.
DELPORTE Christian, Les journalistes en France, 1880-1950: naissance et constructiond'une profession, collection le Seuil, Paris, janvier 1999, 450 pages.
DEVILLARD Valérie, LAFOSSE Marie-Françoise, LETEINTURIER Christine, RIEFFELRémy, Les journalistes français à l'aube de l'an 2000. Profils et parcours, Paris, Éd. PanthéonAssas, 2001, 169 pages.
DUVAL Julien, Critique de la raison journalistique, les transformations de la presseéconomique en France, Le Seuil, Paris, 2004, 366 pages.
DEVILLARD Valérie, LAFOSSE Marie Françoise, LETEINTURIER Christine,MARHUENDA Jean-Pierre, RIEFFEL Rémy, MORIN Claire, MOSTEFAOUI Bel Kacem etSOING Isabelle, Les Journalistes français en 1990 : radiographie d'une profession, LaDocumentation Française, Paris, 1991, 130 pages.
LEMIEUX Cyril, Mauvaise Presse, une sociologie du travail journalistique et de sescritiques, éditions Métailié, Paris, 2000, 467 pages.
LEVEQUE Sandrine, Les journalistes sociaux. Histoire et sociologie d'une spécialitéjournalistique, Rennes, Presses de l'université de Rennes, 2000, 234 pages.
LAVOINNE Yves, « Le journalisme saisi par la communication », In MARTIN M. (dir.),Histoire et médias. Journalisme et journalistes français, 1950-1990. Actes du colloque deNanterre, Paris, Albin Michel, 1991, 304 pages.
MCMANUS John, Market Driven Journalism : Let the Citizen Beware?, Sage, California,1994.
MARTIN Marc (dir.), Histoire et médias. Journalisme et journalistes français, 1950-1990.Actes du colloque de Nanterre, Paris, Albin Michel, 1991, 304 pages.
252
MARTIN Marc, Les grands reporters, les débuts du journalisme moderne, Audibert, Paris,2005, 394 pages.
MATHIEN Michel, le système médiatique, le journalisme et son environnement, Paris,Hachette Université, 1989, 318 pages.
MATHIEN Michel, Les journalistes et le système médiatique, Hachette UniversitéCommunication, 1992, 367 pages.
MATHIEN Michel, Les journalistes, Que sais-je, P.U.F., Paris, juillet 1995, 126 pages.
MOUILLAUD, Michel, TETU, Jean-François., Le journal quotidien, P.U.L., Lyon, 1989, 204pages.
MULHMANN Géraldine, Une histoire politique du journalisme, Le Monde, PUF, Paris,2004, 247 pages.
NEVEU Erik, Sociologie du journalisme, collection Repères, Paris, 2001, 123 pages.
NEVEU Erik, RIEFFEL Remy, RUELLAN Denis, « Journalistes spécialisés », Réseauxn°l 11, Paris, 2002, 293 pages.
PRITCHARD David, SAUVAGEAU Florian, Les journalistes canadiens, un portrait de finde siècle, Québec, Presses de l'Université Laval, 1999, 144 pages.
RIEFFEL Rémy L'élite des journalistes, les hérauts de l'information, PUF, Paris, 1984, 220pages.
RIEFFEL Rémy, La tribu des clercs, les intellectuels de la cinquième république, Calmann-Lévy, Paris, 1993, 692 pages.
RIEFFEL Rémy, Sociologie des médias, Ellipses Infocom, Paris, 2002, 176 pages.
RUELLAN Denis, Le professionnalisme du flou : identité et savoir-faire des journalistesfrançais, Grenoble, Presse Universitaire de Grenoble, 1993, 240 pages.
253
RUELLAN Denis, Les "pros" du journalisme, de l'état au statut la construction d'un espaceprofessionnel, Presses Universitaires de Rennes, 1997, 170 pages.
RUELLAN Denis, MARCHETTI Dominique, Devenir journalistes, sociologie de l'entrée surle marché du travail, la Documentation Française, Paris, 2001, 165 pages.
TUNSTALL Jeremy, Journalists at Work, Londres, Constable, 1971, 304 pages.
TUNSTALL Jeremy, Media Occupations and Professions, a reader, Oxford, 2005, 310pages.
CHARON Jean-Marie, MERCIER Arnaud (coord.), « Les journalistes ont-ils encore dupouvoir », Hermès n°35, CNRS Éditions, Paris, 2003, 340 pages.
• Articles scientifiques :
BLANCHOT Fabien et PADIOLEAU Jean-Gustave, « Une économie politique du travailjournalistique » in « Les journalistes ont-ils encore du pouvoir ? » coordonné par Jean-MarieCharon et Arnaud Mercier, Hermès n° 35, 2003, 340 pages.
BARNHUST Kevin, MUTZ C. Diana, « American Journalism and the Décline in Event-Centered Reporting", Journal of Communication, Al A, 1997, pp. 27-53.
BERKOVITZ Dan, ALLEN Craig, BEESON Diana, « Exploring Newsroom Views AboutConsultants In Local TV : The Effect of Work Rôle and Socialization", Journal ofBrodcasting and Electronic Media, vol 40, 1996, pp.447-459.
CHALABY, Jean K., « Journalism Studies in an Era of Transition in Public", What isJournalism Studies, Journalism, 2000, pp. 33-39.
CHARRON, Jean, DE BONVILLE, Jean, « Le paradigme du journalisme de communication :essai de définition, Communication. Vol. 17, no 2 (1996b), pp. 51-97.
DUVAL, Julien, «Concessions et conversions à l'économie. Le journalisme économique enFrance depuis les années 80 », Actes de la recherche en sciences sociales, n°131-132, mars2000, pp. 56-75
HUFFMAN Suzanne, « Live news reporting: Professional judgment or technologicalpressure? A national survey of télévision news directors and senior reporters", Journal ofBroadcasting & Electronic Media; Washington, Fall 1999, volume:43 Issue 4, pp.492-505.
254
LOCHARD Guy, « Genres rédactionnels et appréhension de l'événement médiatique ? Versun déclin des « modes configurants » ? », Réseaux n°76, Cnet, 1996, pp. 83-102.
McMANUS John H., « A market-based model of news production », Communication Theory,vol.5,n°4, 1995, pp.301-338.
MARCHETTI Dominique, « La fin d'un Monde, les transformations du traitement de lapolitique étrangère dans les chaînes de télévision françaises grand public » in, ARNAUDLionel, GUILLONNET Louis, Les Frontières du politique, enquête sur les processus depolitisation et de dépolitisation, Res Publica, Paris, 2005, pp. 49-77.
MATHIEN Michel, « Le journalisme de communication, critique d'un paradigme spéculatifde la représentation du journalisme professionnel», Quaderni n°45, Paris, automne 2001,pp.105-135.
MC QUAIL Denis, « Research into Political Communication and the Current Crisis of Mediaand Democracy », Revue de l'Institut de Sociologie, Université libre de Bruxelles, 1995,n°l/2, pp. 47-57.
PELISSIER Nicolas, Les mutations du journalisme à l'heure des nouveaux réseauxnumériques, AFRI, 2001 publication en ligne. Disponible sur : <http://www ;afri-ct.org/article.php3 ?id_article=202#bas> (consulté le 24.05.2005).
RIEFFEL Rémy, « Les journalistes français : image et présentation de soi », Médiascope n°l,mars 1992, pp. 64-73.
RIEFFEL Rémy, « Pour une approche sociologique des journalistes de télévision »,Sociologie du travail, vol.35, n°4, 1993, pp. 373-387.
RIEFFEL Rémy, « Vers un journalisme mobile et polyvalent », Quaderni, n°44, automne2001,pp.153-169.
RIUTORT Philippe, « Grandir l'événement : l'art et la manière de l'éditorialiste », Réseauxn°76, CNET - 1996, pp. 61-82.
RIUTORT, Philippe, « Le journalisme au service de l'économie. Les conditions d'émergencede l'information économique en France depuis les années 50", Actes de la recherche ensciences sociales, n°131/132,2000, pp. 41-55.
ROZENBLATT Patrick, «L'urgence au quotidien », Réseaux n° 69, Cnet ,1995, page 74.
255
RUELLAN Denis, « Groupes professionnels et marché du travail du journalisme » inRéseaux, n°81, 1997, pp. 135-151.
RUELLAN Denis, « Contrer les évidences de l'identité journalistique ", Polis (GRAPS-Cameroun), n° 5, 1998.
RUELLAN Denis, « Expansion ou dilution du journalisme ? », Les Enjeux de l'information etde la communication, http://www.u-grenoble3.fr/lesjenjeux, 2005, 10 pages.
SCHLESINGER Philip, « Repenser la sociologie du journalisme - les stratégies de la sourced'information et les limites du média-centrisme », Réseaux n° 51, 1992, pp. 75-98.
VEDEL Thierry, PELISSIER Nicolas, « Les mutations obligées », les Cahiers duJournalisme, Lille, 1998, page 56.
WATINE Thierry, « Journalistes : une profession en quête d'utilité sociale », Les Cahiers duJournalisme n° 2, Lille, décembre 1996, 396 pages.
• Thèses :
BAISNEE Olivier, La production de l'actualité communautaire. Éléments d'une sociologiecomparée du corps de presse accrédité auprès de l'Union européenne (France, Grande-Bretagne), Rennes, thèse de science politique sous la direction d'Erik Neveu, UniversitéRennes 1,2003.
LETTIERI Carmella, « Formes et acteurs des débats contemporains. Les tribunes publiéesdans la presse quotidienne en Italie et en France », thèse, université Paris II, 2002.
MARCHETTI P., Contribution à une sociologie des évolutions du champ journalistique,thèse de sociologie, EHESS, Paris, 1998.
• Communications :
CHARRON Jean, de BONVILLE Jean, « Le paradigme journalistique : usage et utilité duconcept», Communication, CIFSIC Bucarest, 2003. Disponible sur:<http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/index.php?halsid=e367411f73e0ce591c888c9c60ea3156&view_this_doc=sic_00000790&version=l> (consulté le 15.10.2003).
256
CHARRON Jean, « Parler de soi en faisant parler les autres. Identité journalistique etdiscours rapporté ». In_RIEFFEL, Rémy et WATINE, Thierry. Les mutations du journalismeen France et au Québec. Paris: Éditions Panthéon Assas. 2000b, pp. 83-117.
Sociologie des journalistes internationaux
• Ouvrages
ASSELINE, Pierre, DAMPENON Philippe, De nos envoyés spéciaux, Simoens, Paris, 1977.
CHAILLOU Alain, La lésion étrangère, le roman vrai d'un correspondant de télévision,éditions Alias Etc, Paris, 2002, 316 pages.
HANNERZ Ulf, Foreign News, Exploring the World of Foreign Correspondents, TheUniversity of Chicago Press, Chicago, 2004, 273 pages.
HESS Stephen, International News and Foreign Correspondents, Brookings Institution,Washington D.C., 1996, 209 pages.
HOHENBERG John. Foreign Correspondence: The Great Reporters and Their Times,SecondEdition. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1995, 363 pages.
KNIGHTLEY Philip, The first casualty : the war correspondent as hero, propagandist, andmyth maker from the Crimea to Vietnam, London : A. Deutsch, 1955, 465 pages.
MERRIL John C, Global Journalism : Survey of International Communication, third édition,New York, Longman, 1995, 414 pages.
PEDELTY Mark, War Stories, The Culture of Foreign Correspondents, Routledge, 1995, 254pages.
ROSENBLUM, Mort, Coups and Earthquakes, Harper and Row, New York, 1979, 223pages.
• Articles scientifiques :
257
HAMILTON M.V,, JENNER E., « The New Foreign Correspondence", Foreign Affairs, sept-oct 2003.
HAMILTON John Maxwell, JENNER, Eric, « Redefining Foreign Correspondence »,Journalism, London, Thousans Oaks, vol.5(3), 2004, pp. 301-321.
MONTALBANO W.D., « Reinventing Foreign Correspondence", Niemans Reports, Spring1994.
VIALLET Claude, « Faut-il se débarrasser du correspondant à l'étranger?", Médiaspouvoirs,Paris, juin 1993, pages 117-123.
WEAVER David, WILLNAT Lars, « Through their Eyes, the work of foreign correspondentin the United States", Journalism, vol.44, Thousand Oaks, Sage, Londres, 2003, pp. 403-422.
Agences de presse et agenciers
• Ouvrages :
AFP, Cent cinquante ans d'agence de presse, Arrêt sur l'Image, Centre Georges Pompidou,Paris, 1986, 95 pages.
BAUDELOT Philippe, Les agences de presse en France, SJTI, Paris, La Documentationfrançaise, 1991, 106 pages.
BOYD BARRETT Oliver, PALMER Michael, Le trafic des nouvelles, les agences mondialesd'information, ed. Alain Moreau, Paris, 1981, 712 pages.
BOYD BARRETT Oliver, The International News Agencies, Constable, Londres, 1980, 284
pages.
BOYD BARRETT Oliver, International Communication and Globalization : Contradictions
and Directions, In MOHAMMADI Ali, (ed) International Communication and Globalization,
Londres, Sage, 1997, pp. 11-26.
BOYD BARRETT, Oliver, RANTANEN Terhi, The Globalization of News, SagePublications, 1998, 230 pages.
258
CONSO Catherine, Les agences de presse dans le monde, Eurostaf, collection Analyses deSecteur, Paris, 1989, 168 pages.
FREDERIX Pierre, Un siècle de chasse aux nouvelles de l'Agence d'information Havas àl'Agence France Presse (1835-1957), Flammarion, Paris, 1959, 446 pages.
HUTEAU Jean, ULLMAN Bernard, AFP : une histoire de l'Agence France Presse (1944-1990), Robert Laffont, Paris, 1992, 570 pages.
LEFEBURE Antoine, Havas, les arcanes du pouvoir, Paris, Grasset, 1992, 408 pages.
MATHIEN Michel, CONSO Catherine, Les agences de presse internationales, Paris, PUF,collection Que-sais-je ?, 1997, 128 pages.
PALMER Michael, Des petits journaux aux grandes agences, Aubier, Paris, 1983, 352 pages.
PALMER Michael, «De l'office français d'information (OFI ) à l'AFP », In DELPORTE,Christian et MARECHAL, Denis (sous la direction de), Les médias et la libération enEurope, 1945-2005, éditions INA - l'Harmattan, Paris, 2006, 498 pages.
PIGEAT Henri, Les agences de presse, institutions du passé ou médias d'avenir, Paris, lesEtudes de la documentation française, 1997, 130 pages.
READ Donald , The Power of News. The History of Reuters, Oxford University Press,Oxford, 1992, 480 pages.
TESSELIN Basile, AFP : les chemins du journaliste, éd. JP Taillandier, Paris, 1994, 255pages.
WHITE Patrick, Le village CNN, la crise des agences de presse, Presses universitaires deMontréal, Montréal, 1997, 192 pages.
• Articles scientifiques
BOYD BARRETT Oliver, « Doing News Agency Research », Media Asia, vol 27, n°l, 2000.
BOYD BARRETT Oliver, « National and International News Agencies, Issues of Crisis andRealignment », Gazette, vol.62(l): 5-18, London, Sage Publications, Thousand Oaks andNew Delhi, february 2000.
259
HARNETT Richard M., FERGUSON Billy G., « Down to the Wires, Unipress: United PressInternational Covering the 20th Century », AJR, august-september 2003.
KINGSTON Meredith, « Réduire à l'événement, la couverture de sujets irlandais parl'Agence France Presse », Réseaux n°75, Paris, janvier 1996.
LAGNEAU Éric, « Le style agencier et ses déclinaisons thématiques, l'exemple desjournalistes de l'Agence France Presse », Réseaux n°l 11, 2002.
MATHIEN Michel, « L'Agence France Presse, un vecteur reconnu des relationsinternationales en France », in Annuaire Français des relations internationales (AFRI),éditions Bruylant, Bruxelles, 2000.
MATLOFF Judith, « Can Reuters Recover? The Vénérable Agency Needs A New Strategyfor Success », Columbia Journalism Review, juillet-août 2003.
PALMER Michael, « L'information agencée », Réseaux n° 75, Paris, janvier 1996.
TUPPER Patricio, « Quarante ans après, IPS : une offre information internationale horsnormes », in Annuaire Français des relations internationales (AFRI), éditions Bruylant,Bruxelles, 2005, vol VI, pp.990-1010.
• Mémoires :
CARRE Laurent, L'AFP face aux réseaux électroniques, DESS Gestion desTélécommunications, de la télématique et de la télévision, université Paris Dauphine, Paris,1996.
MONT ANE Jade, L'Agence France-Presse (1944-1957), La recherche d'une libertéd'information, Maîtrise d'Histoire, Université Paris X-Nanterre, 1999, 96 pages.
MONT ANE Jade, « / 'agencier, un métier en mutation face au multimédia, l'exemple del'AFP », mémoire DESS, CELSA, Université Paris IV Sorbonne, 2000.
Archives :
260
ARCHIVES NATIONALES, AFP 1944-1957 : 9 AR 2 à 86.
• Rapports
UNESCO, Rapport final, Atelier sur les agences de presse à l'heure d'Internet, Amman,Jordanie, 28-31 janvier 2001, 80 pages.
SENAT, Rapport sur la proposition de loi de M. Louis de BROISSIA modifiant la loi n° 57-32du 10 janvier 1957 portant statut de /'Agence France-Presse, Paris, séance du 7 juin 2000.Disponible sur : <http://www.senat.fr/rap/199-387/199-387mono.html> (consulté le12.10.2001).
SENAT, Projet de loi de finances pour 2005 : Médias ; Louis de BROISSIA, fait au nom de lacommission des affaires culturelles, déposé le 25 novembre 2004. Disponible sur :<http://www.senat.fr/rap/a04-075-10/a04-075-10.html> (consulté le 15.10.2005).
• Articles de presse
LOUETTE Pierre, « L'AFP ne perdra pas d'argent en 2006 », Le Figaro, 19 juin 2006.
VEILLETET Pierre, «Claude Imbert, l'homme qui a fait Le Point », Médias, n°2, 2005.
• Documents internes :
AFP, Marin Jean, le manuel de l'agencier, Paris, 1971.
AFP, le manuel de l'agencier, Paris, 1982.
AFP, le manuel de Vagencier, Paris, 2004.
Information internationale et internationalisation de l'information
• Ouvrages :
ALBERT Pierre et LETEINTURIER Christine, Les médias dans le monde : Enjeuxinternationaux et diversités nationales, Paris, Ellipse, 1999, 160 pages.
BOYD BARRETT Oliver, THUSSU Dayan Kishan, Counter-Flow in Global News , London,
John Libbey, 1992, 154 pages.
261
CURRAN James, GUREVITCH Michael, Mass Media and Society, éd. Arnold, third édition,2000, 408 pages.
FENBY Jonathan, The International News Services, Schocken Books, New York , 1986, 275pages.
HACHTEN William A., The World News Prism, Changing Media of InternationalCommunication, Iowa State University Press, fourth édition, 1996, 220 pages.
HJARVARD Stig, News in a Globalized Society, Gothenburg, Sweden, 2001, 236 pages.
MARTHOZ Jean-Paul, Et maintenant, le monde en bref. Politique étrangère, journalismeglobal et libertés, Bruxelles, GRIP-éditions Complexe, 1999, 310 pages.
MATTELART Armand et Michèle, Histoire des théories de la communication, Paris, Ladécouverte, collection Repères, 1997, 123 pages.
MATTELART Armand, Histoire de l'utopie planétaire, de la cité prophétique à la sociétéglobale, la Découverte, 1999, 422 pages.
PALMER Michael, Quels mots pour le dire ? Correspondants de guerre, journalistes ethistoriens face aux conflits yougoslaves, Paris, coll. l'Harmattan, 2003, 232 pages.
PIGEAT Henri, Le nouveau désordre mondial de l'information, Hachette, Paris 1987, Paris,Hachette, 236 pages.
SEMPRINI Andréa, CNN et la mondialisation de l'imaginaire, collection CNRS etCommunication, Paris, octobre 2000, 187 pages.
SREBERNY-MOHAMMADI A, «The Global and the Local in InternationalCommunications». In CURRAN James et GUREVITCH Michael(eds), Mass Media andSociety , London, Edward Arnold, 4ème édition, 2005, 400 pages.
TUDESQ Jean, Les médias, acteurs de la vie internationale, éditions Apogée, Rennes, 1997,180 pages.
TUNSTALL Jeremy, PALMER Michael, Media Moguls, Routledge, 1991, 258 pages.
262
• Articles scientifiques :
ARCQUEMBOURG Jocelyne, «L'événement en direct et en continu», Réseaux n°76, 1996,Paris, pp.31-45.
AUSCHITZKY N. et OCCHIMINUTI R., «Modernisation et internationalisation galopantesl'industrie de l'information », Médiaspouvoirs, n°2, 1er trimestre 1998.
BAISNEE Olivier, MARCHETTI, Dominique, «L'économie de l'information en continu. Apropos des conditions de production dans les chaînes d'information en continu en général et àEuronews en particulier », Réseaux, n° 114, 2002, pp. 181-214.
BAISNEE Olivier, MARCHETTI Dominique, « Euronews, un laboratoire de la production del'information « européenne » », Culture et Conflits, n°38-39, 2000, pp. 121-152.
BOYD BARRETT Oliver, et RANTANEN Terhi, The Globalization of News, London,Thousand Oaks, Sage Publications, 1998, 230 pages.
CHANG T.K. et al, "Factors Gatekeepers'Sélection of Foreign News : A National Survey ofNewspaper Editors», Journalism Quaterly, vol.69, n°3, 1992.
COHEN Yoel, « Foreign press corps as an indicator of international news interest», Gazette,n°56, 1995, pp 89-100.
HADAR Léon, « Covering the New World Disorder », Columbia Journalism Review,july/august 1994.
HOGE James F., « Foreign News : Who gives a dam? », Columbia Journalism Review, nov-dec 1997.
LAVILLE Camille, «Le traitement de l'actualité internationale: avenir ...et mirages del'information planétaire », Les promesses et les pièges de l'information internationale, LesCahiers du journalisme, n°12, Québec, automne 2003, pp.32-40.
PALMER Michael, « News : ephemera, data, artefacts and...quality control - Iraq now andthen », Journalism, London, Thousand Oaks CA and New Delhi, 2003, vol 4 (4) : pp.459-476.
263
PALMER Michael, « Agencer l'urgence en Irak », in CHARON, Jean-Marie et MERCIER,Arnaud (sous la direction de), Armes de communication massive, information en Irak 1991-2003, CNRS, Paris, 2004, pp. 122-127 pages.
POTTER Deborah, « Local News, from 600 Miles Away , "Centralcasting" saves money butcould impair coverage », AJR, avril 2003.
SEPLOW S., « State of The American Newspaper, G.A.s for the World », AJR, October-November2003.
• Articles de presse :
KAPUSCINSKY Ryzard, « Les médias reflètent-ils la réalité du monde », Le MondeDiplomatique, août 1999, pp. 8-9.
• Articles scientifiques :
DE BURTLESS Gary, et al., « Glophobia : Confronting Fears about Open Trade », HumanResources Abstracts,vo\34, n°4, 1999.
MATTELART Armand, « Communiquer à l'ère des réseaux : Vers une globalisation »,Communication, Technologie, Société Hermès, Réseaux vol. 18, n°100, Paris, 2000.
• Articles de presse :
MATTELART Armand, « Dangereux effets de la globalisation des réseaux, les nouveauxscénarios de la communication mondiale », le Monde Diplomatique, août 1995, pp. 24-25.
• Communications :
KRAIDY M., « The Global, the Local, and the Hybrid: A Native Ethnography ofGlocalization Critical Studies in Mass Communication »; Annandale; décembre 1999; CSMC: a publication of the Speech Communication Association, Volume: 16 Issue 4.
• Thèse :
LAMBERT Stéphane, « Les télécommunications internationales et l'État occidental », Thèse,Institut d'Études Politiques, Paris, 2004, 304 pages.
Autres
264
Ouvrages :
DEFLEUR H. Margaret, Computer Assisted Investigative Reporting, Mahwah, LEA, 1997,248 pages.
DJUSPSUND G, Carlson T., Trivial Stories and Fancy Pictures, Suède, 2001.
HOWARD Tumber, News, a Reader, Oxford University Press, 1999, 428 pages.
LOCHARD Guy, « Genres rédactionnels et appréhension de l'événement médiatique? Versun déclin « des modes configurants » », Réseaux n°76, Cnet, 1996, pp.83-102.
MCMANUS J.H., Market Driven Journalism : Let the Citizens Beware ?, Beverly Hills,Sage, 1995.
Articles scientifiques :
AGOSTINI Angelo, « Le journalisme au défi d'Internet », Le Monde Diplomatique, octobre1997, pp. 26-27.
BRAHAM Peter, "How the Media Report Race," In , M. Gurevitch, T. Bennet, J. Curran andJ. Woollacott, eds., Culture, Society and the Media (London and New York: Methuen, 1982),pp. 275-279.
BRANTS, K., «Who's afraid of infotainment? » European Journal of communication 30 (3),315-336, 1998.
REBILLARD Franck, « La presse multimédia. Une première expérience de diversification dela presse écrite sur cédérom et sur le web », Réseaux, n°101, 2000, pp. 141-171.
• Rapports :
MEDIA DAY, http://.jolo.jmk.su.se/students/global04/mediaday, mai 2004.
265
Conseil Économique et Social, rapport de Michel Muller, Garantir le pluralisme et
l'indépendance de la presse quotidienne pour assurer son avenir, Paris, 22 juin 2005, 189
pages.
Articles de périodiques :
LAIME Marc, « les Journaux face à la concurrence d'Internet, Nouveaux barbares del'information en ligne », Le Monde Diplomatique, juillet 1999, page 24.
PSENNY Daniel, « Al Jazira annonce le lancement d'une chaîne en langue anglaise en2006 », Le Monde, 20 mai 2005, p.30.
ROUSSEL Claude, L'Echo de la presse et de la publicité, 17 novembre 1975.
• Ressources électroniques :
The Project for Excellence in Journalism "Changing Définitions of News", 6 mars 1998.http://www.journalism.org/resources/research/reports/definitions/default.asp
266
BIBLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE
ACCARDO Alain, ABOU Georges, Journalistes précaires, Le Mascaret, Bordeaux, 1998,411 pages.
AFP, Cent cinquante ans d'agence de presse, Arrêt sur l'Image, Centre Georges Pompidou,Paris, 1986,95 pages.
AFP, Marin Jean, le manuel de l'agencier, Paris, 1971.
AFP, le manuel de l'agencier, Paris, 1982.
AFP, le manuel de l'agencier, Paris, 2004.
AGOSTINI Angelo, « Le journalisme au défi d'Internet », Le Monde Diplomatique, octobre1997, pp.26-27.
ALBERT Pierre et LETEINTURIER Christine, Les médias dans le monde : Enjeuxinternationaux et diversités nationales, Paris, Ellipse, 1999, 160 pages.
ARBORIO Anne-Marie et FOURNIER Pierre, L'enquête et ses méthodes; l'observationdirecte, Nathan Université, collection Sciences Sociales 128, Paris, 1999, 127 pages.
ARCHIVES NATIONALES, AFP 1944-1957 : .9 AR 2 à 86.
ARCQUEMBOURG Jocelyne, «L'événement en direct et en continu», Réseaux n°76, 1996,Paris, pp.31-45.
ASSELINE, Pierre, DAMPENON Philippe, De nos envoyés spéciaux, Simoens, Paris, 1977.
ATTIAS-DONFUT Claudine, «La génération, un produit de l'imaginaire social», inL'identité, l'individu, le groupe, la société, coordonnée par Jean-Claude Ruano-Borbalan,éditions Sciences Humaines, Auxerre, novembre 1999, page 157
ATTIAS-DONFUT Claudine, « Rapports de générations et parcours de vie », Enquêtenuméro 5, Biographie et cycle de vie. Disponible sur :http://enquete.revues.org/document82.html (consulté le 12.01.06).
AUSCHITZKY N. et OCCHIMINUTI R., «Modernisation et internationalisation galopantes :l'industrie de l'information », Médiaspouvoirs, n°2, 1er trimestre 1998.
BAISNEE Olivier, La production de l'actualité communautaire. Eléments d'une sociologiecomparée du corps de presse accrédité auprès de l'Union européenne (France, Grande-Bretagne), Rennes, thèse de science politique sous la direction d'Erik Neveu, UniversitéRennes 1,2003.
BAISNEE Olivier, MARCHETTI, Dominique, « L'économie de l'information en continu. Apropos des conditions de production dans les chaînes d'information en continu en général et àEuronews en particulier », Réseaux, n° 114, 2002, pp. 181-214.
BAISNEE Olivier, MARCHETTI Dominique, « Euronews, un laboratoire de la production del'information « européenne » », Culture et Conflits, n°38-39, 2000, pp. 121-152.
BARNHUST Kevin, MUTZ C. Diana, « American Journalism and the Décline in Event-Centered Reporting", Journal of Communication, Al A, 1997, pp. 27-53.
267
BAUDELOT Philippe, Les agences de presse en France, SJTI, Paris, La Documentationfrançaise, 1991, 106 pages.
BEAUD Stéphane et WEBER Florence, Guide de l'enquête de terrain. Produire et analyserdes données ethnographiques, Ed. La Découverte, Paris, 1998, 356 pages.
BECKER Howard, Écrire les sciences sociales, Economica, coll. Méthodes des sciencessociales, Paris, 2004, 180 pages.
BECKER Howard, Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciencessociales, lere éd. 1998, Paris, La Découverte, coll. « Guides Repères », 2002, 352 pages.
BELISLE Claire, BIANCHI Jean, JOURDAN Robert, Pratiques Médiatiques, 50 mots clés,CNRS Communication, Paris, 1999, 428 pages.
BERKOVITZ Dan, ALLEN Craig, BEESON Diana, « Exploring Newsroom Views AboutConsultants In Local TV : The Effect of Work Rôle and Socialization", Journal ofBrodcasting and Electronic Media, vol 40, 1996, pp.447-459
BLANCHOT Fabien et PADIOLEAU Jean-Gustave, « Une économie politique du travailjournalistique » in « Les journalistes ont-ils encore du pouvoir ? » coordonné par Jean-MarieCharon et Arnaud Mercier, Hermès n° 35, 2003, 340 pages.
BOHERE G., Profession journaliste, étude sur la condition du journaliste en tant quetravailleur, BIT, Genève, 1984, 180 pages.
BOUDON Raymond, BOURRICAUD François, Dictionnaire critique de la sociologie,Quadrige, Paris, 2002, 736 pages.
BOYD BARRETT Oliver, PALMER Michael, Le trafic des nouvelles, les agences mondialesd'information, éd. Alain Moreau, Paris, 1981, 712 pages.
BOYD BARRETT Oliver, et RANTANEN Terhi, The Globalization of News, London,Thousand Oaks, Sage Publications, 1998, 230 pages.
BOYD BARRETT Oliver, The International News Agencies, Constable, Londres, 1980, 284
pages.
BOYD BARRETT Oliver, « Doing News Agency Research », Media Asia, vol 27, n°l, 2000.
BOYD BARRETT Oliver, « National and International News Agencies, Issues of Crisis andRealignment », Gazette, vol.62(l): 5-18, London, Sage Publications, Thousand Oaks andNew Delhi, february 2000.
BOYD BARRETT Oliver, International Communication and Globalization : Contradictions
and Directions, In MOHAMMADI Ali, (ed) International Communication and Globalization,
Londres, Sage, 1997, pp. 11-26.
BOYD BARRETT Oliver, THUSSU Dayan Kishan, Counter-Flow in Global News , London,
JohnLibbey, 1992, 154 pages.
BOYD BARRETT, Oliver, RANTANEN Terhi, The Globalization of News, SagePublications, 1998, 230 pages.
BRAHAM Peter, "How the Media Report Race," In , M. Gurevitch, T. Bennet, J. Curran andJ. Woollacott, eds., Culture, Society and the Media (London and New York: Methuen, 1982),pp. 275-279.
268
BRANTS, K., «Who's afraid of infotainment? » European Journal of communication 30 (3),315-336, 1998.
BRIN Colette, CHARRON Jean, DE BONVILLE Jean (sous la direction de), Nature ettransformation du journalisme, Théorie et recherches empiriques, les Presses de l'UniversitéLaval, Québec, 2005, 454 pages.
CARRE Laurent, L'AFP face aux réseaux électroniques, DESS Gestion desTélécommunications, de la télématique et de la télévision, université Paris Dauphine, Paris,1996.
CHAILLOU Alain, La lésion étrangère, le roman vrai d'un correspondant de télévision,éditions Alias Etc, Paris, 2002, 316 pages.
CHALABY, Jean K., « Journalism Studies in an Era of Transition in Public", What isJournalism Studies, Journalism, 2000, pp. 33-39.
CHANG T.K. et al, "Factors Gatekeepers'Selection of Foreign News : A National Survey ofNewspaper Editors», Journalism Quaterly, vol.69, n°3, 1992.
CHAR Antoine, La guerre mondiale de l'information, Presses de l'université du Québec,Québec, 1999, 168 pages.
CHARON Jean-Marie, Cartes de presse, enquête sur les journalistes, Au vif Stock, 1993, 265pages.
CHARON Jean-Marie, MERCIER Arnaud (coord.), « Les journalistes ont-ils encore dupouvoir », Hermès n°35, CNRS Éditions, Paris, 2003, 340 pages.
CHARRON Jean, La production de l'actualité : une analyse stratégique des relations entre lapresse parlementaire et les autorités politiques au Québec, Montréal, Boréal, 1994, 446pages.
CHARRON, Jean, DE BONVILLE, Jean, « Le paradigme du journalisme de communication :essai de définition, Communication. Vol. 17, no 2 (1996b), pp. 51-97.
CHARRON Jean, de BONVILLE Jean, « Le paradigme journalistique : usage et utilité duconcept», Communication, CIFSIC Bucarest, 2003. Disponible sur:<http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/index.php?halsid=e367411f73e0ce591c888c9c60ea3156&viewthis_doc=sic_00000790&version=l> (consulté le 15.10.2003).
CHARRON Jean, « Parler de soi en faisant parler les autres. Identité journalistique et discoursrapporté ». In RIEFFEL, Rémy et WATINE, Thierry. Les mutations du journalisme en Franceet au Québec. Paris: Éditions Panthéon Assas. 2000b, pp. 83-117.
CHAUVEL Louis, Le destin des générations. Structure sociale et cohortes en France auvingtième siècle, Paris, PUF, 1998, 301 pages.
CHEPESIUK Ron, HOWELL Harvey, LEE Edward, Raising Hell, Straight Talk withInvestigative Journalists, Mac Farland, Jefferson, 1997, 181 pages.
COHEN Yoel, « Foreign press corps as an indicator of international news interest», Gazette,n°56, 1995, pp 89-100.
Conseil Économique et Social, rapport de Michel Muller, Garantir le pluralisme etl'indépendance de la presse quotidienne pour assurer son avenir, Paris, 22 juin 2005, 189pages.
CONSO Catherine, Les agences de presse dans le monde, Eurostaf, collection Analyses deSecteur, Paris, 1989, 168 pages.
269
CORCUFF Philippe, Les nouvelles sociologies : constructions de la réalité sociale, ArmandColin, coll. 128, Paris, 2004, 128 pages.
CORDELLIER Serge et alii, La Mondialisation au-delà des mythes, La Découverte, Essais,Paris, 2000, 177 pages.
CORNU Daniel, Journalisme et vérité, Pour une éthique de l'information, Genève, Labor etFides, 1994, 510 pages.
CROZIER Michel, FRIEDBERG Erhard, L'acteur et le système : les contraintes de l'actioncollective, éditions du Seuil, Paris, 1977, 500 pages.
CURRAN James, GUREVITCH Michael, Mass Media and Society, éd. Arnold, third édition,2000, 408 pages.
DE SINGLY François, L'enquête et ses méthodes : le questionnaire, Nathan Université,collection Sociologie, 128, Paris, 1998, 126 pages.
DE BURTLESS Gary, et al., « Glophobia : Confronting Fears about Open Trade », HumanResources Abstracts,vo\34, n°4, 1999.
DEFLEUR H. Margaret, Computer Assisted Investigative Reporting, Mahwah, LEA, 1997,248 pages.
DELPORTE Christian, Histoire du journalisme et des journalistes en France, Paris, PUF,Que sais-je, 1995, 128 pages.
DELPORTE Christian, Les journalistes en France, 1880-1950: naissance et constructiond'une profession, collection le Seuil, Paris, janvier 1999, 450 pages.DEMERS, François, « Impacts des nouvelles technologies de l'information et de lacommunication (NTIC): Déstructuration (et restructuration?) du journalisme », Technologiesde l'information et Société. Vol. 8. No 1, pp. 55-70.
DEVILLARD Valérie, LAFOSSE Marie-Françoise, LETEINTURIER Christine, RIEFFELRémy, Les journalistes français à l'aube de l'an 2000. Profils et parcours, Paris, Éd. PanthéonAssas, 2001, 169 pages.
DEVILLARD Valérie, LAFOSSE Marie Françoise, LETEINTURIER Christine,MARHUENDA Jean-Pierre, RIEFFEL Rémy, MORIN Claire, MOSTEFAOUI Bel Kacem etSOING Isabelle, Les Journalistes français en 1990 : radiographie d'une profession, LaDocumentation Française, Paris, 1991, 130 pages.
DJUSPSUND G, Carlson T., Trivial Stories and Fancy Pictures, Suède, 2001.
DUBAR, Claude, La socialisation : construction des identités sociale et professionnelle,Paris, Armand Colin, 2e éd. revue, 1998, 276 pages.
DUBAR Claude, TRIPIER Pierre, Sociologie des professions, Armand Colin, Paris, 1999,279 pages.
DUVAL, Julien, « Concessions et conversions à l'économie. Le journalisme économique enFrance depuis les années 80 », Actes de la recherche en sciences sociales, n°131-132, mars2000,pp.56-75
DUVAL Julien, Critique de la raison journalistique, les transformations de la presseéconomique en France, Le Seuil, Paris, 2004, 366 pages.
ELIAS Norbert, Qu 'est ce que la sociologie, éditions de l'Aube, Paris, 1991, 222 pages.
270
ELIAS Norbert, La société des individus, Pocket, coll. Sciences Humaines, Paris, 1998, 301pages.
FENBY Jonathan, The International News Services, Schocken Books, New York , 1986, 275pages.
FREDERIX Pierre, Un siècle de chasse aux nouvelles de l'Agence d'information Havas àl'Agence France Presse (1835-1957), Flammarion, Paris, 1959, 446 pages.
GERSHON Richard, The Transnational Media Corporations, Global Messages and FreeMarket Compétition, Mahwah, LEA publishers, 1997, 220 pages.
GIDDENS Anthony, entretien, Sciences Humaines n°84, juin 1998, page 39.
GITLIN Todd, The Whole World is Watching, Berkeley: University of California Press, 1980,352 pages.
HACHTEN William A., The World News Prism, Changing Media of InternationalCommunication, Iowa State University Press, fourth édition, 1996, 220 pages.
HADAR Léon, « Covering the New World Disorder », Columbia Journalism Review,july/august 1994.
HAMILTON M.V., JENNER E., « The New Foreign Correspondence", Foreign Affairs, sept-oct2003.
HAMILTON John Maxwell, JENNER, Eric, « Redefining Foreign Correspondence »,Journalism, London, Thousans Oaks, vol.5(3), 2004, pp. 301-321.
HANNERZ Ulf, Foreign News, Exploring the World of Foreign Correspondents, TheUniversity of Chicago Press, Chicago, 2004, 273 pages.
HARNETT Richard M., FERGUSON Billy G., « Down to the Wires, Unipress: United PressInternational Covering the 20th Century », AJR, august-september 2003.
HEINICH Nathalie, La sociologie de Norbert Elias, Repères, la Découverte, Paris, 1997, 121pages.
HELD David, MAC GREW Anthony, GOLDBLATT David, PERRATON Jonathan, GlobalTransformations, Politics, Economies and Culture, Stanford, Londres, 1999, 539 pages.
HESS Stephen, International News and Foreign Correspondents, Brookings Institution,Washington D.C., 1996, 209 pages.
HJARVARD Stig, News in a Globalized Society, Gothenburg, Sweden, 2001, 236 pages.
HIRST Paul, THOMPSON Graham, Globalization in Question, Cambridge, Polity Press,Londres, 1996, 336 pages.
HOGE James F., « Foreign News : Who gives a dam? », Columbia Journalism Review, nov-dec 1997.
HOHENBERG John. Foreign Correspondence: The Great Reporters and Their Times,Second Edition. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1995, 363 pages.
HOWARD Tumber, News, a Reader, Oxford University Press, 1999, 428 pages.
HUFFMAN Suzanne, « Live news reporting: Professional judgment or technologicalpressure? A national survey of télévision news directors and senior reporters", Journal ofBroadcasting & Electronic Media; Washington, Fall 1999, volume:43 Issue 4, pp.492-505.
271
HUTEAU Jean, ULLMAN Bernard, AFP : une histoire de l'Agence France Presse (1944-1990), Robert Laffont, Paris, 1992, 570 pages.
KAPUSCINSKY Ryzard, « Les médias reflètent-ils la réalité du monde », Le MondeDiplomatique, août 1999, pp. 8-9.
KINGSTON Meredith, « Réduire à l'événement, la couverture de sujets irlandais parl'Agence France Presse », Réseaux n°75, Paris, janvier 1996.
KNIGHTLEY Philip, The first casualty : the war correspondent as hero, propagandist, andmyth maker from the Crimea to Vietnam, London : A. Deutsch, 1955, 465 pages.
KRAIDY M., « The Global, the Local, and the Hybrid: A Native Ethnography ofGlocalization Critical Studies in Mass Communication »; Annandale; décembre 1999; CSMC: a publication of the Speech Communication Association, Volume: 16 Issue 4.
LAGNEAU Eric, « Le style agencier et ses déclinaisons thématiques, l'exemple desjournalistes de l'Agence France Presse », Réseaux n°l 11, 2002.
LAIDI Zaiki, Le temps mondial, éditions Complexe, 1997.
LAIDI Zaki, Un monde prive de sens, Fayard, 1994.
LAIDI Zaki, Malaise dans la mondialisation,1997'.
LAIME Marc, « les Journaux face à la concurrence d'Internet, Nouveaux barbares del'information en ligne », Le Monde Diplomatique, juillet 1999, page 24.
LAMBERT Stéphane, « Les télécommunications internationales et l'État occidental », Thèse,Institut d'Études Politiques, Paris, 2004, 304 pages.
LA VILLE Camille, «Le traitement de l'actualité internationale: avenir ...et mirages del'information planétaire», Les promesses et les pièges de l'information internationale, LesCahiers du journalisme, n°12, Québec, automne 2003, pp.32-40.
LAVOINNE Yves, « Le journalisme saisi par la communication », In MARTIN M. (dir.),Histoire et médias. Journalisme et journalistes français, 1950-1990. Actes du colloque deNanterre, Paris, Albin Michel, 1991, 304 pages.
LEFEBURE Antoine, Havas, les arcanes du pouvoir, Paris, Grasset, 1992, 408 pages.
LEMIEUX Cyril, Mauvaise Presse, une sociologie du travail journalistique et de sescritiques, éditions Métailié, Paris, 2000, 467 pages.
LETTIERI Carmella, « Formes et acteurs des débats contemporains. Les tribunes publiéesdans la presse quotidienne en Italie et en France », thèse, université Paris II, 2002.
LEVEQUE Sandrine, Les journalistes sociaux. Histoire et sociologie d'une spécialitéjournalistique, Rennes, Presses de l'université de Rennes, 2000, 234 pages.
LEVY Pierre, World philosophie, Odile Jacob, Paris, 2000, 220 pages.
LOCHARD Guy, « Genres rédactionnels et appréhension de l'événement médiatique ? Versun déclin des « modes configurants » ? », Réseaux n°76, Cnet, 1996, pp. 83-102.
LOUETTE Pierre, « L'AFP ne perdra pas d'argent en 2006 », Le Figaro, 19 juin 2006.
MARCHETTI Dominique, « La fin d'un Monde, les transformations du traitement de lapolitique étrangère dans les chaînes de télévision françaises grand public » in, ARNAUDLionel, GUILLONNET Louis, Les Frontières du politique, enquête sur les processus depolitisation et de dépolitisation, Res Publica, Paris, 2005, pp. 49-77.
272
MARCHETTI P., Contribution à une sociologie des évolutions du champ journalistique,thèse de sociologie, EHESS, Paris, 1998.
MARTHOZ Jean-Paul, Et maintenant, le monde en bref. Politique étrangère, journalismeglobal et libertés, Bruxelles, GRIP-éditions Complexe, 1999, 310 pages.
MATTELART Armand et Michèle, Histoire des théories de la communication, Paris, Ladécouverte, collection Repères, 1997, 123 pages.
MATTELART Armand, Histoire de l'utopie planétaire, de la cité prophétique à la sociétéglobale, la Découverte, 1999, 422 pages.
MARTIN Marc (dir.), Histoire et médias. Journalisme et journalistes français, 1950-1990.Actes du colloque de Nanterre, Paris, Albin Michel, 1991, 304 pages.
MARTIN Marc, Les grands reporters, les débuts du journalisme moderne, Audibert, Paris,2005, 394 pages.
MARTIN et al., « The Sociology of Globalization : Theoretical and MethodologicalReflections », International Sociology, n°21, pp. 499-521, 2006.
MATHIEN Michel, le système médiatique, le journalisme et son environnement, Paris,Hachette Université, 1989, 3 18 pages.
MATHIEN Michel, Les journalistes et le système médiatique, Hachette UniversitéCommunication, 1992, 367 pages.
MATHIEN Michel, « L'Agence France Presse, un vecteur reconnu des relationsinternationales en France », in Annuaire Français des relations internationales (AFRI),éditions Bruylant, Bruxelles, 2000.
MATHIEN Michel, Les journalistes, Que sais-je, P.U.F., Paris, juillet 1995, 126 pages.
MATHIEN Michel, CONSO Catherine, Les agences de presse internationales, Paris, PUF,collection Que - sais-je ?, 1997, 128 pages.
MATHIEN Michel, « Le journalisme de communication, critique d'un paradigme spéculatifde la représentation du journalisme professionnel», Quaderni n°45, Paris, automne 2001,pp.105-135.
MATLOFF Judith, « Can Reuters Recover? The Vénérable Agency Needs A New Strategyfor Success », Columbia Journalism Review, juillet-août 2003.
MATTELART Armand, La Communication-monde, La Découverte, Paris, 1999, 2èmeédition, 356 pages.
MATTELART Armand, La Mondialisation de la communication, PUF, « Que sais-je ? »n°3181, 3ème édition mise à jour, Paris, 2002, 128 pages.
MATTELART Armand, « Communiquer à l'ère des réseaux : Vers une globalisation »,Communication, Technologie, Société Hermès, Réseaux vol. 18, n°100, Paris, 2000.
MATTELART Armand, « Dangereux effets de la globalisation des réseaux, les nouveauxscénarios de la communication mondiale », le Monde Diplomatique, août 1995, pp. 24-25.
MATTELART Armand, Histoire de l'utopie planétaire, La Découverte, Paris, 1999, 423pages.
MATTELART Armand, « Nouvelles utopies, grandes inquiétudes. Une éternelle promesse :les paradis de la communication », Le Monde Diplomatique, novembre 1995, pp. 4-5.
273
MCMANUS John, Market Driven Journalism : Let the Citizen Beware?, Sage, California,1994.
MCMANUS John H., « A market-based model .of news production », CommunicationTheory, vol.5, n°4, 1995, pp.301-338.
MC QUAIL Denis, « Research into Political Communication and the Current Crisis of Mediaand Democracy », Revue de l'Institut de Sociologie, Université libre de Bruxelles, 1995,n°l/2, pp. 47-57.
MEDIA DAY, http://jolo.jmk.su.se/students/global04/mediaday, mai 2004.
MERRIL John C, Global Journalism : Survey of International Communication, third édition,New York, Longman, 1995, 414 pages.
MICHALET Charles-Albert, Qu 'est que la mondialisation ?, La Découverte, Cahiers Libres,Paris, 2002, 210 pages.
MONTALBANO W.D., « Reinventing Foreign Correspondence", Niemans Reports, Spring1994.
MONTANE Jade, L'Agence France-Presse (1944-1957), La recherche d'une libertéd'information, Maîtrise d'Histoire, Université Paris X-Nanterre, 1999, 96 pages.
MONTANE Jade, « l'agencier, un métier en mutation face au multimédia, l'exemple del'AFP », mémoire DESS, CELSA, Université Paris IV Sorbonne, 2000.
MOUILLAUD, Michel, TETU, Jean-François., Le journal quotidien, P.U.L., Lyon, 1989, 204pages.
MOWLANA Hamid, "Global Communication in Transition", Communication Abstracts,vol.21,n°2, 1998.
MULHMANN Géraldine, Une histoire politique du journalisme, Le Monde, PUF, Paris,2004, 247 pages.
NEVEU Erik, Sociologie du journalisme, collection Repères, Paris, 2001, 123 pages.
NEVEU Erik, RIEFFEL Rémy, RUELLAN Denis, «Journalistes spécialisés», Réseauxn°l 11, Paris, 2002, 293 pages.
PALMER Michael, Des petits journaux aux grandes agences, Aubier, Paris, 1983, 352 pages.
PALMER Michael, « L'information agencée », Réseaux n° 75, Paris, janvier 1996.
PALMER Michael, « News : ephemera, data, artefacts and...quality control - Iraq now andthen », Journalism, London, Thousand Oaks CA and New Delhi, 2003, vol 4 (4) : pp.459-476.
PALMER Michael, « Agencer l'urgence en Irak », in CHARON, Jean-Marie et MERCIER,Arnaud (sous la direction de), Armes de communication massive, information en Irak 1991-2003, CNRS, Paris, 2004, pp. 122-127 pages.
PALMER Michael, «De l'office français d'information (OFI ) à l'AFP », In DELPORTE,Christian et MARECHAL, Denis (sous la direction de), Les médias et la libération enEurope, 1945-2005, éditions INA - l'Harmattan, Paris, 2006, 498 pages.
PALMER Michael, Quels mots pour le dire ? Correspondants de guerre, journalistes ethistoriens face aux conflits yougoslaves, Paris, coll. l'Harmattan, 2003, 232 pages.
PEDELTY Mark, War Stories, The Culture of Foreign Correspondents, Routledge, 1995, 254pages.
274
PELISSIER Nicolas, Les mutations du journalisme à l'heure des nouveaux réseauxnumériques, AFRI, 2001 publication en ligne. Disponible sur: <http://www ;afri-ct.org/article.php3 ?id_article=202#bas> (consulté le 24.05.2005).
PIGEAT Henri, Le nouveau désordre mondial de l'information, Hachette, Paris 1987, Paris,Hachette, 236 pages.
PIGEAT Henri, Les agences de presse, institutions du passé ou médias d'avenir, Paris, lesEtudes de la documentation française, 1997, 130 pages.
POTTER Deborah, « Local News, from 600 Miles Away , "Centralcasting" saves money butcould impair coverage », AJR, avril 2003.
PRITCHARD David, SAUVAGEAU Florian, Les journalistes canadiens, un portrait de finde siècle, Québec, Presses de l'Université Laval, 1999, 144 pages.
PSENNY Daniel, « Al Jazira annonce le lancement d'une chaîne en langue anglaise en2006 », Le Monde, 20 mai 2005, p.30.
READ Donald , The Power of News. The History of Reuters, Oxford University Press,Oxford, 1992, 480 pages.
REBILLARD Franck, « La presse multimédia. Une première expérience de diversification dela presse écrite sur cédérom et sur le web », Réseaux, n°101, 2000, pp. 141-171.
RIEFFEL Rémy et WATINE Thierry (dir.), Les mutations du journalisme en France et auQuébec, Paris, éditions Panthéon-Assas, 2002, 319 pages.
RIEFFEL Rémy L'élite des journalistes, les hérauts de l'information, PUF, Paris, 1984, 220pages.
RIEFFEL Rémy, La tribu des clercs, les intellectuels de la cinquième république, Calmann-Lévy, Paris, 1993, 692 pages.
RIEFFEL Rémy, Sociologie des médias, Ellipses Infocom, Paris, 2002, 176 pages.
RIEFFEL Rémy, « Les journalistes français : image et présentation de soi », Médiascope n°l,mars 1992, pp. 64-73.
RIEFFEL Rémy, « Pour une approche sociologique des journalistes de télévision »,Sociologie du travail, vol.35, n°4, 1993, pp. 373-387.
RIEFFEL Rémy, « Vers un journalisme mobile et polyvalent », Quaderni, n°44, automne2001,pp.153-169.
RIUTORT Philippe, « Grandir l'événement : l'art et la manière de l'éditorialiste », Réseauxn°76, CNET- 1996, pp. 61-82.
RIUTORT, Philippe, « Le journalisme au service de l'économie. Les conditions d'émergencede l'information économique en France depuis les années 50", Actes de la recherche ensciences sociales, n°131/132,2000, pp. 41-55.
ROSENBLUM, Mort, Coups and Earthquakes, Harper and Row, New York, 1979, 223pages.
ROUSSEL Claude, L'Echo de la presse et de la publicité, 17 novembre 1975.
ROZENBLATT Patrick, «L'urgence au quotidien », Réseaux n° 69, Cnet ,1995, page 74.
RUELLAN Denis, Le professionnalisme du flou : identité et savoir-faire des journalistesfrançais, Grenoble, Presse Universitaire de Grenoble, 1993, 240 pages.
275
RUELLAN Denis, Les "pros " du journalisme, de l'état au statut la construction d'un espaceprofessionnel, Presses Universitaires de Rennes, 1997, 170 pages.
RUELLAN Denis, MARCHETTI Dominique, Devenir journalistes, sociologie de l'entrée surle marché du travail, la Documentation Française, Paris, 2001, 165 pages.
RUELLAN Denis, « Groupes professionnels et marché du travail du journalisme » inRéseaux, n°81, 1997, pp. 135-151.
RUELLAN Denis, «Contrer les évidences de l'identité journalistique", Polis (GRAPS-Cameroun), n° 5, 1998.
RUELLAN Denis, « Expansion ou dilution du journalisme ? », Les Enjeux de l'information etde la communication, http://www.u-grenoble3.fr/les_enjeux, 2005, 10 pages.
SAINSAULIEU Renaud, Sociologie de l'entreprise, Paris, Presses de la FNSP et Dalloz,Paris, 1997, 2ème édition, 476 pages.
SCHLESINGER Philip, « Repenser la sociologie du journalisme - les stratégies de la sourced'information et les limites du média-centrisme », Réseaux n° 51, 1992, pp. 75-98.
SEMPRINI Andréa, CNN et la mondialisation de l'imaginaire, collection CNRS etCommunication, Paris, octobre 2000, 187 pages.
SENAT, Rapport sur la proposition de loi de M. Louis de BROISSIA modifiant la loi n° 57-32du 10 janvier 1957 portant statut de /'Agence France-Presse, Paris, séance du 7 juin 2000.Disponible sur : <http://www.senat.fr/rap/199-387/199-387mono.html> (consulté le12.10.2001).
SENAT, Projet de loi de finances pour 2005 : Médias ; Louis de BROISSIA, fait au nom de lacommission des affaires culturelles, déposé le 25 novembre 2004. Disponible sur :<http://www.senat.fr/rap/a04-075-10/a04-075-10.html> (consulté le 15.10.2005).
SEPLOW S., « State of The American Newspaper, G.A.s for the World », AJR, October-November 2003.
SREBERNY-MOHAMMADI A., «The Global and the Local in InternationalCommunications». In CURRAN James et GUREVITCH Michael(eds), Mass Media andSociety , London, Edward Arnold, 4ème édition, 2005, 400 pages.
TESSELIN Basile, AFP : les chemins du journaliste, éd. JP Taillandier, Paris, 1994, 255pages.
The Project for Excellence in Journalism "Changing Définitions of News", 6 mars 1998.http://www.journalism.org/resources/research/reports/definitions/default.asp
TUDESQ Jean, Les médias, acteurs de la vie internationale, éditions Apogée, Rennes, 1997,180 pages.
TUNSTALL Jeremy, PALMER Michael, Media Moguls, Routledge, 1991, 258 pages.
TUNSTALL Jeremy, Journalists at Work, Londres, Constable, 1971, 304 pages.
TUNSTALL Jeremy, Media Occupations and Professions, a reader, Oxford, 2005, 310pages.
TUPPER Patricio, « Quarante ans après, IPS : une offre information internationale horsnormes », in Annuaire Français des relations internationales (AFRI), éditions Bruylant,Bruxelles, 2005, vol VI, pp.990-1010.
276
UNESCO, Rapport final, Atelier sur les agences de presse à l'heure d'Internet, Amman,Jordanie, 28-31 janvier 2001, 80 pages.
VEDEL Thierry, PELISSIER Nicolas, « Les mutations obligées », les Cahiers duJournalisme, Lille, 1998, page 56.
VEILLETET Pierre, «Claude Imbert, l'homme qui a fait Le Point », Médias, n°2, 2005.
VIALLET Claude, « Faut-il se débarrasser du correspondant à l'étranger?", Médiaspouvoirs,Paris, juin 1993, pages 117-123.
WATINE Thierry, « Journalistes : une profession en quête d'utilité sociale », Les Cahiers duJournalisme n° 2, Lille, décembre 1996, 396 pages.
WEAVER David, WILLNAT Lars, « Through their Eyes, the work of foreign correspondentin the United States", Journalism, vol.44, Thousand Oaks, Sage, Londres, 2003, pp. 403-422.
WEBER Max, « L'objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales », inEssais sur la théorie de la science, Pion / Presses Pocket, coll. « Agora », n° 116, Paris, 1992.
WHITE Patrick, Le village CNN, la crise des agences de presse, Presses universitaires deMontréal, Montréal, 1997, 192 pages.
277
LISTE DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS
Figure 1 : tableau descriptif de l'idéal-type de l'environnement médiatique
Figure 2 : tableau descriptif de l'idéal-type de l'Agence France Presse
Figure 3 : tableau descriptif de l'idéal-type des pratiques journalistiques
Figure 4 : tableau descriptif de l'idéal-type de la dépêche
Figure 5 : tableau descriptif de l'idéal-type de l'identité professionnelle journalistique
Figure 6 : tableau descriptif des profils de journalistes interrogés.
Figure 7 : tableau représentant les objectifs fixés par l'État dans le contrat d'objectifs et de
moyens 2003-2007 (en millions d'euros)
Figure 8 : dépêche AFP, Insolite : Charlie, l'un des perroquets de Winston Churchill, fête
cette année ses 104 ans et continue de maudire Adolf Hitler et les nazis, comme le lui avait
appris son maître. Londres, 19.01.04
Figure 9 : tableau représentant les différents types de dépêches définis par les manuels de
l'agencier.
Figure 10 : tableau de la couverture anticipée par l'AFP, du lancement de la navette spatiale
américaine le 7 juillet 2005.
Figure 11 : extrait de la dépêche AFP, « Phnom Penh est vide, le Cambodge se purifie, des
millions de khmers ont faire retour aux rizières », Jean Jacques Cazaux, 8 mai 1975.
Figure 12 : extrait de la dépêche AFP, « témoignage, Pékin », René Flipo, 13 septembre
1976.
Figure 13 : dépêche AFP en arabe, « Les frères musulmans en Egypte réclament l'annulation
de la Loi d'urgence », Le Caire, 27 mars 2005, 16h34.
Figure 14 : dépêche AFP en français, « Egypte : manifestation des Frères musulmans pour la
levée de l'état d'urgence », Le Caire, 27 mars 2005, 15h30.
Figure 15 : dépêche AFP, « Egypt-Islamist, RPT265 Egypt's Muslim Brotherhood holds pro-reform
rallies despites arrests», Le Caire, 27 mars 2005, 14h48.
278
Figure 16 : photographie de la rencontre entre un ministre français et le président égyptien
Hosni Moubarak, AFP, Le Caire, 2005.
Figure 17 : photographie de la salle de rédaction de l'AFP dans les années soixante-dix.
Figure 18 : tableau représentant les rapports entre les journalistes et les sources.
Figure 19 : photographie de la salle de rédaction du bureau de l'AFP au Caire, mars 2005.
279
ANNEXES
Annexes A - dépêches AFP
• 1.Dépêche d'Alger, Agence Française d'Information, 6-11 août 1943.
• 2.« Allocution du général de Gaulle », AFP, 4 juillet 1944
• 3.« Paris pendant le discours du général de Gaulle », AFP, 12 septembre 1944.
• 4.« Le dîner offert par le maréchal Staline au général de Gaulle », 11 décembre 1944.
• 5.Communiqué portant sur l'écoute AFP de l'Agence Chine Nouvelle, 8 mai 1948.
• 6.Flash décès de Staline, 6 mars 1953.
• 7.« Comment la nouvelle de la port de Staline fut diffusée par l'AFP », 6 mars 1953.
• 8.Flash et bulletin décès du Général de Gaulle, 10 novembre 1970
• 9.Flash, « Mao est mort », AFP, 9 septembre 1976
• 10. Témoignage, René Flipo, Pékin, 13 septembre 1976.
• II.«L'adieu à la Chine », Georges Biannic, 18 septembre 1976.
• 12. « Egypt's Muslim Brotherhood holds pro-reform rallies despite arrests », 27 mars
2005,14h48.
• 13. « L'opposition a franchi les lignes rouges et le pouvoir se durcit », papier retour,
Hassen Zenati, 31 mars 2005.
• 14. Dossier, Portrait, « Eileen, le roc, commandant de bord de Discovery », 8 juillet
2005.
• 15 Insolite : "Vous êtes bien réveillés », 16 juillet 2005, 04hl6.
• 16. Dépêche, La malédiction de Toutankhamon poursuit l'archéologue, 09 mars 2005
280
Annexes B - notes et rapports et documents internes.
• 1.Statut de l'Agence
• 2.Note Impact, Contrôle de la presse internationale, 29 mars 2005.
• 3 .Notes Nicosie-Le Caire, 29 mars 2005, 11 h 10.
• 4.Prévisions Sport, 19 juillet 2005.
• 5.Organigramme des filiales de l'AFP.
• 6. Manuel de l'Agencier, Récapitulatif des attributs, page 69, 2004.
• 7. Audit de l'AFP, automne 2003.
• 8. AFP, Rédaction en chef: notes rédactionnelles, Informations «people»,
12/01/2000, ASAP.
• 9. AFP, Rapport, « Les priorités rédactionnelles de l'agence », 2000.
• 10. AFP, Communiqué : du collectif Femmes de l'AFP, 22 août 2005.
• 11. Communiqué du syndicat SNJ- AFP - vendredi 9 juillet 2004 : « Franco-anglo :
Quelle "égalité des chances" ? ».
Annexes C - Outils de recherche
• 1 .Formulaire de consentement
• 2.Guide d'entretien
• 3.Énoncés à qualifier
281
1. Dépêche d'Alger, Agence Française d'Information, 6-11 août 1943
I^-J: T.,.\r;; :.-\j c-cr YEUX FORJLATÉGN1
H A;:.i?J ^ - J L ! . . Ï : PF.Ï*0RF. MESURE VOLONTE
-NT AD FOLS INDIV IS ; } H '<S^-Tî TRAVAILLEURS AD !...!-
M'iuN ET . T N ^ V A T I O N H I V L O T . •;:T -••' "ïcVT AjfgS? OJE ÈN-
r£D SPECIAL AÊENCF. r.S--,.Cr- '.F-1 >JF VOYAGE InARUC RESUME
^RESSiuNS VISITE GAULLF 5TOf ^'XL.TÇ VwYAGE DvN/VA
^SiON'TOUS HARgCalKS PrENPFiF F .TrLf^ENT CUN'SCIEMCE :
/ t U î L NATIONAL VIR6 CuHfhff jD^; CETTE HEURE: -SEftt FSEMIFfiE
iE FERrODE GLJhiFtyf ; Vi.ftt SI CiiACuN- VEUT MODELER SON EFFORT
i EXEMPLE GAULLE" ET TOUS CEUX •>.;! C^BATTEINT CU RESÎSTfKn*
.«P EN EFFET VfflG GÂUUS CACHA fïULJLDJÊNT iMPUFfTANCE TACTE
FFSTe AŒOHRtJH ET é>«CC-UPS Vf HXIGE TOUS FfiA?€AiS
TRAVAIL FT SACRIFIC f U?i';i;.CT^ 3Tvr EVOLUAIT UONSEULEVENT
TÏCiPAT-iON GUERRE SAUà AliTHCS L lH iT tS i ' E CELLES POUVANT
<R DF AFèîFHF^ MAIS ï.HCkM. FPOF^Û TENACE LABEUR DE
JVATIQN ^ Y S CFSTADI^F AU PRrj^i ! :- PLAN Bt i N M ^ î i â f ' V T " ' O 'V
F A2Œ PROPOS C U U ^ Ï C e f T i J A»JTyf%-|TE ET NOTABLES UNE
VILLES VISSTFS V-fRG 6&bU£ î f ô i î T M T SUR HAUTE CtW-
IWJ FRANÇAIS DulVOifT AVOÎH Dt ITT AT STOP DAUTREFART
> GUNFHENŒ P?€SSF VI RG S-L! -tClTl?D' EXPRIMER R J / N T V Ù E
EPURATION AiFCCAiSï Vî-fïC ^- -? ' .F PHOCLAF!Â!T AVEC RiRCE
£Ci CTAïT AFFAIRE T U T FT sNJf*F*fii 3JPSTI0N ELEVANT
£R3uNNE$ > XÊTl
N ETAT AGI-SSANT, MAIS Ali-SCÎ rTAT ^SFuiVSABL^ V
LE DOtff HECOiT Ain"Of?îTÇ STv? FOi^VUE MILITA IRE HT
MMENT FNSA QUALITE P ' - rSHi^T r .^ îT1 - DFFfTNSfe NA
GAULLE PRENAIT COwT^CT .W'-C T".ajS «vFFÏCiELS E . C m ^ j r
Sv, STTCF £f» MEME TR' i -8 '1;!L " " ( : ; / ^ \ i l SES VUtS FOGR
3AW1SATION AflFCE VîSG IL RFVTNM.X Slifî SENS MCHfclîATI X:E DE MESUR REGEHj^lfF FRISE CJ^îTE LIBERATIONHtuivfn DEUX T-anX^NS Fv«TPS= FRANÇAISES SOUS COMP&NDEMB
i £W 14551
282
BHP^BSft2. « Allocution du général de Gaulle », AFP, 4 juillet 1944
S Si? ^ ^ E IBÉ ^
NCE FRANCE-PRESSE AGENCE^FRANCE-PRESSE A G E N C E ' F R A N C E ^ P R E S S E AGE
F R A N 0 E N°' !434 JUILLET2U.30
NOTE POLR MM. LES R.£DACT'r-LR3 cJi CHEF
, Nous vous COMMUNIQUONS c | - n£ssous L£ T : X J - : D ' U M EALLOCUTION DU GENERAL De G/AULLK, QUI Uc. PEUT CÏÏZ ENAUCUN OAS PUBLIÉE OU DIFFUSÉE ftVAI^T &.. H- 'US £3 -Pti MATlLS 5 JUILLtT,
r MJ\j J^JU i ,v :' De LA ÎAÊPUBIL| Qilé rtvH^^/i j o c y /. rï\uiuuf*ijANGLAIS, À L.* R A » 1 O ? L'^.LLOOUT|ON S'JlVrtNTÊ.A L ! GGOAS !OHï ) f L'" iNDtCPENDENCE D.AY t
11 HdMMcS ET FEM;»lt2 DrS ET A TS~ UN IS , 'VOUS Ytr^Z AVEC
• Jo i î -ET F IERTÉ VOTRE JOUI DC -L ' [NDEp£fJDANo.H., Vous ,»yez
Rrtioou ft'tTRe JOYEUX ET FtîRa*
PAR V C T K E COL'RAGt ET PAI"Î VOTR£ EFFORT^ VOUS i.ViZ
•~COtfT?. [BUE À ' B , , T T R E L'ALLiMAGNEf ,-CNNEMl ;•: n i LrEUSOP£r ET, .«•
PA;1, LÀJ. À -SAUVE,-; LA LISEUTE DU MONDE»
. • DEMAJN; VOUS POURREZ VOUS GLortiKIER D ' A V O I H Joue
L.-: PREMIER ,-:ÔL.£ DANS LA DÉFAITE OU JAPON, EHMËMI S~: L ' À S Î Ï :
Ht, (À SUlVRt,.», -AwF.P.)
nrr.nuu •*-
\;RiS I PARIS — 13. PLACE D£ LA BOURSE — PARIS i PARIS — 13 PI.ACR DP [.A
283
^ s j E AGENCE FRANCE-PRESSE AGENC|_FRANCE-PRESSE AGENCE
F R A N 0 E. ti° 147 Cl43)A- JUILLET21 H,45
.PARIS - L'ALLOCUTION DU GÉNÉRAL DE GAULLE, (DEUX)
11 SACHEZ- QUE NUL PLUS- QU> LA FRANCC NE se RÉJOUIT
DE VOS SUCCÈS;, MOUS SOMMÉS DE VIEUX AMÎSC JAMAIS NOS DEUX
PAYS NE SE S.ONT COMBATTUS.
NOUS ETIONS 'AVEC VOUS DÈS LES COMMENCEMENTS. NOUS
AVONS VU NAITRE VOTRE FO-RCE.. NOUS L'AVONS VUE 8RANDJR.
QUAKB VOUS TTES VCNUS UNE PREMIERE FOIS. AU SECCUP.S DC LA
V I E I L L E EUROPE, MOUS VENONS DE LA VOIR SE DÉPLOYER SUR
-LES CHAMPS DE BATAILLE X TOUT JAMAIS MÉMORABLES J:E CETTE
GUERRE. TOUJOURS ET- CETTE F O I S ENCORE» NOUS» FRANÇAI?» ET
vous ,• AMERICA INS, AVONS SERVI LE MÊME iDEAL.
NOUS CÇUéSrtûNS DONC AVEC VOUS, COMME VOUS , L i •-.'O'JR
DE L* jNBEPEMbÂNCE, VOTRE TETE. Plli'l SS | OWS-NOUS LE OELEBRltt*
tMstMBLE LONGTEMPS» COMME AUJOURD'HUI-, DANS UN;: JUSTE •
G L C ( r : £ ACQUISE EN COMMUN,'
(A. F. P.)
284
3.« Paris pendant le discours du général de Gaulle », AFP, 12 septembre 1944.
- AGENCE TRANCMSE/GE -PRESSE : -
F R A N C E
\2 $£?.T£MBRr 1 9 4 4 « PAJÛE 1 ( 7
PARIS, FENDANT .LE DISCOURS DU 6EtyEft&L,J% .GAULLE.
PARtS, \2 3tT*T«MBKe - Aux PR lOKVfPfeUK C ARKErCHJRS ,SUR U S PRINCIPALES PLACCS DE PARIS, LA FOULC =S;ESTRASSEMBLÉE DE BONNE HEURE AUTOUR DES HMJT,§~ AKLOÎJRS QUIVONT DIFFUSER LA PAROLE J)U ÛHfcF JJU QQUVIERN -«ENT r iBGVI-iOJRt- O£ LA RÉBPUBLlQUt.
DAMS LE BRILLANT SOLEIL, O'IST UNE FCTED^NTEN-DRE AU GRAND JOUR LA V04X S! SOUVtNT CÇaJV-tRTC Pm LC3BROUILLAGES ALLfM/NDS OU VtCHY5£Q*S* LA OU I L ¥ A DEUXSEM INES RETENTISiAttîsiT LES COUPS D£ £ m .
Po-a LA PREMIER* POIS DEPUIS SON AKKS,VÉG ^UR L£5OL Ht LA PATRIE LIBÈRÊ.C, LE PRÉSIDENT nu OOUVERN MÏ.MT.PROVISOIRE I); LA SEFUBLiQUE, PARLE À. LA N.'TiuN FRANC'-'t SEPAR LA VOIX DES ONCES
DANS ce MOS£SÏG I N T É R I E U R , o i ^ TANT BE r o t s P E N -DANT L'OCCUPATION AL-L6MANOE , ON SC-RCUNS&AiT POWR ÉCOU-TER LA RADIO DE LONDRES^ EN METTANT LA ÏOÈJAiJTC feON A OUVERT TR-tS GRANfc L.CS ÉOOGTES t "«'lîST V ' ÎWtE ' " ("aANÔt QUJ VA-SCf A*at •£WT£MSŒL
16 HEURES î f i . F / I T BEAU, LE C i E L C & T 8-LSU, MAISON A rCKM'£ LES FENÊTRES AFIN nU1 AUOWti-mU-tT 13E X~A RU£NE COUiP.e L A VOIX m. .t1 ORATEUR a
E ^ ^ à mm MQU« /PiARTIENT AUX F . F . t ET SA SOEU1V» QU-AIORZE At^S. ONr*A pPEï C !E&T UNE VOt&lNEÎ -%IE N f A| PAS DE POSTE.,ALORSrS'è ••O'JS VOULEZ BIEN Mt HiKM-ETTRE D'ÉCO-UT-tR--G&M(vH: rOTRE-r o t . : , QUAND o^3 E N T E N D A I T LQNBRE.SU—...
- MAIS. BtEK VOLONTIERS***LE PÊRr" TOURNE LES BOUTDNS^ LA . U f i H W -5'Jx>LAi REJMAOtQUE BKtLLE D r UN ÉCLAT A«R3V * T Î M V V J O I X DUL * o e i L MAOtQUE BKtLLE D r UN ÉCLAT A«R3V * T Î M V V J O I X DU
SFiAKER SE FAIT EWTCNCR& :- VOUS ALLEZ ENT( NCRE--LE GENÉRAL.»£ G A « L L £ , PRÉ"
5 1DENT DU OOUVERNCMCNT PROV^OIRE'DC LA REPUBLIQUEFRANÇAISE., . , . •
ET U> VOIX BIEN O J M H U Ï RETEKTlT^ -NON PtiJS PAR CES-bUS l-f, M>.NCK6, M**S-D« TOUT F4JtES, -DU' Pj^U-4S.JÛt " H ^ I L L O T ,lies BORDS AlANrr&'SC-u SEIHE; .
DAl à L£ DECOR FAMtMSa* UN D-É5OR -MOD£ST£ IMc.lb 4iENFR ••;.'' i s 7 s ' ELÈVÎ; J./> VOÀK éwEReS'Que w ^ i ^ yo-is pf.N-:o-,\ •• L£S MEURES cSOÉBBCi,.^ VERSÉ tU"UD£J08-DC& tF: ANC' tS L't5-POP;-, EW LA aRANseua^ï1 X,A PÉRHftM3Ë-&£ -JK)Sfi£ P / ' « S .
IVM'SMrENART» a_E-GCIsi£KALÏ.^5T W * T 1/ • iwARSE JLU- 1 SELUI SUCCÈDE»
285
- &GEMCE TR.ftttCAlSE.TE PRESSE -
V K A M C E
12 ScPTiMBRe 1944 « P A E E ! 2 0 (117)
PARIS, PENSANT LE DISCOURS DU GENERAL-PE GAULLE...(DEUX)AUX ABORD J Ù T A L M S ~ " B E CHA* LiSjT
C'EST LE SILENCE, MAINTENANT., "MAIS UN SILENCE LOURDDE SENE,, DE SIGNIF ICATION» LE GÉNÉRAL
LES FRANÇAIS SAVENT POURQUOI/DE: GAULLE VIENT OEPARLER, • T CETTE VOIX QUI NE S 'TST J / W 1 S F A I T ENTÏNOREEN VAIN NrA PANS EN VA | H CONVIÉ LA N A J I Q N À "L1 ÉCOUTER UNEFOIS ENCORE ! LA FRANCE DOIT VIVRE , in |BAIT-ELLE NAGUERE,OR, NE VICNT-eLLE PAS CE SORTIR Xi£ SON SÉPULCRE ?
Le PALAIS JDC UHAILLOT OÙ RÉSONNE .DEPUIS ,PLUS D'UNEHEURi LA VOIX CH'UDE DO G ENÉRAL BE G^OLtE, «ST £N FETE. ETPOINT S.UlXMfNT LU. GRAiD THÉÂTRE/DE LA PLACE DU TROCADERO,SES AÔ.JUji»; --U* AVENUE KLEBER^ JLrAVf MIE-Otl PRÉSIDENT vi|LSONr
LE ' -CHAMPS D E • MARS» W . ' [S A U S M LE cotu« ME.HE DC LA C I T É ,SES VASTES ARTÈRES ,0U DES HAUTS 1-/' RLEUlRS -REPANDENT V PA-SOLc Vta.<«MTt yu'Hif-R CN3C3RE LES FRAW^tSt L 'ORilLLF Tt NJÛUEÀ Lf.URS RAHIOST, D I &TTWU3/-1 « HT SI MAL A TRAVCKS Lt BROUILLAGE*
UNE FcuLc «owBRfUse-, a ï s 14 HEURES* se T ^ M A I T SURLES FTOIpAISONS QUl^BORDENT LE VASTE ÎViFbCt, A 15 H 4 5 ,0U;".KO' DÉBOUCHANT DE U'AVCMUE DC To ; J O , 1 / VOITURE DU GENE-RAL DE GAULLE S'IMMOBILISE DEVANT LES PERSO N Ni Ll TES Vk FSEN-TZ% UW' LONfiUR OVATION SALUE L£ SAUVEUR DE LA P^T f lE . LESckis 2£ " V ive D E G A U L L I : " "V ive CA FRANGE" FL&fNi u t T O U -TES PARTS* LA MUSIQUE CES G A K D U M S DE LA P A I X j o u e . .U uiAK£.tiLLA|SE. LE QENÉR'lL-DE GAULLE -GAGNE ALO«S
LA GRANDE 8ALLC OU IL VA PKOMONCt* SON DISCOURS.iVAINTÏNANT» -LA FOULE. OBSEfiV£ UM -SILT^CE IWP«ES I ON-
NANTàUS COÊ.URS BATTENT A L'UNJS&OM DE LA MEME ARDt-UK PA-TRtO'JiQUE. LXS APPLAU»iaatMt^T6 QUI ÉCLATENT DANS LA SAL-LE Iwï'fsE SONT REFK&, D|PASSFS £N I NT£ M-S1 TÉ PAR LA FOULE,À L ' E X T É R I E U R . QUAND, A 16 P 4 5 , .Lt GÉNÉRAL ABORDE S/> P É -RORAISON, Sfc.N DCS YEUX SE .SONT- EMBUÉS .306 XARMES «
A J7 HEURES, LE GfWÉRAt DE G;>UU--E «SÛASNE 6A V O i -TURS, TANDIS QUET DANS UN tLAN CONTtWU A "SKANB PEt \E , LAFOULE LUI TÉMO|«Nt SA RfeCONNA ISà ft.NO£ £ T 4 O *
Sous.m TOUR. EIFEEI
LONQTCMPt AVANT .t-fHi"URr. D.C t.A" *E.T*A*iaM| SS ION O£ LACÉRÉMONIE, r ÙC PETITS GROUPES SE FORMENT AUTOUR IiH hAUTS-fARLEURS PLAGES, LES UNS, Lt LONG ;;» PI L4£«S DE LA ToURÈ!F r SL, DrAUTRÊS -, OANS CÇi D0SW£T3 DU CHAMP DE WKSiGP/23H55 G'.*F<P-.J ( À SUIVRE. . , )
286
F R A N C E :
12 SEPTEM3RE 1944 - **(1Ç 122
MDWT L£ DISCOURS DU GENERAL DE GAULLE. . . (TRO
DÈS :LES PREMIÈRES PAROLES, LA FOULE SE PRECIPITE.
\20)
UN INSTANT, PLUSIEURS MILL IERS D£ PERSONNES SONT RA&SOJHBUÉCS, SUR LE PONT D ' I É M A , SOUS U ÎOUR E - l r r E L » UANS LESJARDINS DU UHAMP DE iVARS ET 0 ANS L£S HUES AVO t£
LORSQUE L'HYMNE NATIONAL 8ETENT If, AMERtCA I N S ,GLAtS ET FRANÇAIS SE LÈVENT a 'UN Mtlv.fc ZLm ET RESTDEBOUT JUSQU'A LA F f N 0C L/ kEJRAHSMfS&IO». PENDANT CETEMPS, LA. CIRCULAT ION EST ARRÊTÉE ET LES SILENCES, ENTRECHAQUE PHRA&Z DES Û«*TEOWS, NE SONT THOUBLÉjS QUE PAR L£SBRUITS DES AViONS QUI FONT UM CARROUSEL AU-i)ESSUt DE UFOULE ET DU LÉG£ND/ iRE ASCENSEUR DE L^ TOUR, QUf S 'EST
S , E N M A K G H E B . •'
LE ÛFNEK/.L D E i-iAULLe PAKLE MA I N T I M A N T • UN S I L E N C ERELÎGtrUX &£ R»ÎTfTAND!S QUf RETCWISSCNT CES PARO-" Q EST AtôftS «U£ SCR/' REMPORTÉE LA QfsAWDE VIO-'DE Li, h<ANc£^;rl UN TDMNÊRKCI>'Ari-fcAUOisaeMCNrs M A R -
QUE LA FIN OUCfSCCURS. ET G 'EST L* ^iAfiSE|LL/.!SE êU'i TOUS,gPmCSfMSWT EN CHOEUR, ON2S DANS UNE MEWE COMMUNION !)Z
PtNSÉE ET D'ESPËSâNCC.• BLA,CC-Q,£ . -L 'OPÉRA
LES
Le COEUR X»C P.ARtS --Î LXS G«AWCSCÎNC ET.L'OP-ER/U k ^
EIVTREOÙ KKS H
UNE FOULE. iMMCNSE A ENVAHI U PLACELAONT ÉTÉET LrOW OONTCMPU:, SPtCTAcLE c.UC t ' O N N ' ' V M T P/'-S VUPOJS \959V P£ SUPERBES EMBARRAS DE VOITURES.
AU--Û'cSéUS DES BALCONS, : i£S DRAPEAUX '>LL|ÉS FLOTTENTLCS 0Gt-tr*aw CES NATIONS UNIES POUR.-LA L IBÉRATION : LAFR/NO£» tes E T / ' T S - U M I S , LA UR/,6UDe~*3R£T/\aM£, LAL/. roiXiOMS, LrU.R.S,,S*
ET LA VOIX DU S£I1£RSL DE GAULLE RETEINTJT^ LES SYL-. ._ . . * M/fiTCLEJVT . i r StLENCC, PU S S C ' « « T H L A i«Afi-
SCÎLLMSC" QUj LUI SUCCEDE:. LA FOULg £COUTtr TETE NUE #
L£Â
L/ lv.Ai»El.t|Wt_f C'EST SUR L*" COTÉ ÛRGfT DEQU'rST Dïr rUSÉr LA PAROI* DU P«é&loeNT OU GOUVrr>NCMENT
tSOêRt DE LA RCr w'EST (.£ »RfCi)£KLLEA«£NT-» ENTHOU-
eux f ( GP/23H57
287
FRANÇAISE DE PRESSE -
F-ft A N C SL12 SCPTCMflRE J944 - PAGE. 123(129.)
.PENDANT LE. DISCOURS DU G B E R M PC G / l l L L E , . - . . ( Q U A T R E )
i\ L'HÔTE! DE VILLE
LA PLACE D r. L'HÔTEL DE VILLE EST MOJAC. DE M^NDE.LES LABOR) ruses POPULATIONS DE ee QUARTIER COMMERCIALSONT VENUES EN rOULE ACCOMPAGNEES POUft LA PLUPART DEUt.LKS EKF'ANTS DONT LA PRÉSENCE SOUS \X CIEL MAGNIFIQUE,DONNE À L'e.NCFCNN€PL/>GE DE GRÈVE UNC PHYS.IONDMIE DO-
SIX HAUTS-PARLEURS. SONT F IX tS SUM L t i . RÉVCitBCK£3 »UN PEU AVANT 16 HÊURtS LA-VOtX EHJ SPEAICEU S£ FAIT EN-TENDRE- ÉLLt EST COUVERTE BRUSQUEMENT WK i £ 5 LONGUESOVATIONS QUI SALUENT AU FALA | S E€ G H A I L I Î O T , L ' A ^ I V Ê ECU G ENÉRA1 D ï ÛA i l lX t * UNE "tv^RSÏfLLA 1SET! ÉCOUTÉE TcTENUt PA« L 'ASS. | .STANCE' , . S€ FA l T • EWSUI TE ENTENDRE . CHACUNOBSERVE U*l-RE&PCCTWEUX.JSJLCN0E< CEPÊNDAMT QUE s'ÊLtVENTLES ACCENTS DE NOTRE HYMNE NATIONAL,»
L A VCIX DEPUIS LONGTEMPS POPULAIRE -DU CHEF DU GOU-VE^NVMFNT PROVISOIRE RETtNTlT ENFIN DOW't NANT LA MULTI -TUDE* '.NRTINCnV M€NT L FO'JLC TOUT À L'ueURE DtàPFKBÉESC SCKHE AUTOUh DtS HAOTS-PAftLCURS AFIN DE Kï PAS PER~D.x£ UN MOT VCA P / m û l K DU PRES4 DÎ.NT DU -tiOUVESN-;ME NTPiîOVISOlKE*
De LA REPU5-L.|QU.E À LA B A S T I L L E
LE DISCOURS DU G QNERViL -»E -ÛJjJLLt r ATTIRÉ DE TftksNCMUKLUX AUtJTeUaû CUTOUR- DES DIFFUSEURS -INSTALLÉS PL.ACEDt t.A RÉPUBLIQUE ET PLACE DE LA ÛAST |.U.C.
L..ES ChtELOTS Pï.OFITSNT DE U CtSCONSTANCE CT PRO-POSENT LA PHOTO DU S éUÉBALEHÈ Grl iLbt ET D£S INSIGNES^ / T k l O t l -UES QUI, BfMTOT FLEIMISSENT .TOUTCS LES dOU-TONNSÈRES.
Dfes QUE LEi. PRCMKiW QRÉSI LvEMENTS Sf FONT fNTCHDRE.LE SILENCE S rÉTA8i.»T* DES BOUTIQUES, DV TOUTES LES HUESJAILLISSENT LES ÉCHOS DES, POSTES D£ RAD!O. a
D;vNS LE SlL iNCEf LA VO <X BU -GÉNÉRAI. «EfENT IT/CHAQUEP.*SSA«i£ EMCaVAKTClïE-S aHAVOS CRÉPITENT ACCOMPAGNANT CEUXDES AU3S'-'ftff:5 DU fV.i-AfcS -BE UHA.tl.LOT •
LA PLACE DC U. ÔAS-TH-I-E OU BAT Lt COEVR OU PAf.i&vPc-PULALR£. .CCOUTC U V O I X - D Ê CCLUj Wf
GP 23FIN JX NOTRE SERVICE DU 12 $F.?TEy,BËË 1944.
288
4.« Le dîner offert par le maréchal Staline au général de Gaulle », 11 décembre 1944.
RA^gjjftfcSSE AGENCE FRANCE-PRESSE AGENCE FRAKjCE-piESSE AGEN
C i K -, niI [ DÉ CE K, 3 R F. 19 ;
3 rLGO
LE DINER OFFERT ?~ÏR II ...AFfc i-iAL dfAL1N£ AU GiTCftÀJE GAULLE
A»' f.OSCOU, 9 DÉCEMÔRE
DEPÊCHE RETARDÉS. tN TRANSMISSION
( DE L 'ENVOYÉ S P É C I A L DE L ' r . F - P » GERAUD JOUVE:)
S A ^ E O ) S O I R À 2u H . 3 0 / LA v cl TU RE J U GÉNÉRAL
SE GAUU-E FRANCHISSAIT LA PORTE B O R O V I T S K I QUI DttMrlEA C C E S AU KREWLJN*
LE PRÉSIDENT JU ao*VEïsN£'ENf PR.OVJSOI.RE otLA RcPUBLIQUE ET S A SUITE (.RAVISSENT LA feMPE elT S A R R t î ED E V A N T LS: ' ' P A L A I S I T A L I E N " C O N S T R U I T P A R Ï , ' I C O L A S I ; : R :r-TQUI ^ t R T AUJOURD'HUI •/.: Ll EU DE -P-ÉUMlOf) AU SoV I ETS U P R I L H Ê »
LE GÉNÉRAL DE GAULLE» APRÈS S'ÊTRE: DÉBARASSÉDE SON MÀNÏEAU, MONTE L ' E S C A L I E R D E HARBRE HONUIÙENTALTENDU D 'UN TAP|,S ROUGE ET A U SOMMET DU^U.EL »E DÉTACHEUNE TOILE REPRÉSENTANT U* BATAILLE D ' I k T Y C H - DES :
O F F I C I E R S DC LA OAR2E i>U KRÊrîLlM tN GRAND UNI FORME t
FONT LA HAf E* ^MPRÈS AVOl R TF-AV£f<SÉ LA S A L L E DES S EANCEÎS3U Savi /T SUPRÊME TOUTE' LAMBRISSÉE DE NOYER DU JAUÇASEVLE GÉNÉRAL DE JAJULLE PASSE PAR LA SALLE J A T H E R I N Ë OÙDOIT HTTRE SEi.Vl UN ^ÎNER D'UNE SOIXANTAINE D ï COUVERTSET St. <XZU0 .y DANS UN SALON ATTENANT OU 1 L E STREÇU PAR L3&:COUIM! SSAI P S DU PEUPLE BERlA y Ml'KOYANyKAGANOVI ToH , LE MARECHAL \/T9R0CH I L9V Ct DE IMOMBr.ïUSESAUTRES PERSONNALITÉS»
Q.ES P R É S E N T A T I O N S S ONT A P El ?:E AOH ZVEESQ U E L L E MARÉCHAL S T A L I N E , ACCOMPA«Nî D E -i• ' . . OLOT«V. ,F A I T SON E N T R É E - I I . PORTE UN UNî FORME B E I G E AVEC UNPAHTALON X B A M J Î E S ROUGES ET BOTTES M O L L E S - COMME UNI QUE.D ECO Ftft»T I ON r I L A ÉPINGLE. CELLE DES HÉROS DU T R A V A I LS O C l A U S T E *
Q U E L Q U E S ;.i M S T A M T s P L U S TAfp» I L CONV.UI S A I TL E G E N É R A J , DE: G A U L L E A LA T A B L E D R E S S É E D A N S LA P I K EV O I S I N E OÙ CHACUU P H J T P L A C E » L A ' S A L L E - Ï A T H L I O N E OUE S T D O N N É L E D Î N E R E S T D É C O R É E pi T E N T U R Z S D E S O I EBLWOHE TENDUES LNT RE D ' 1 !«'• Ï.NSCS PILASTRES DE PORPHYREVERT ET D £ LUSTRES i) ' UN ÉBLOUI S SAUT CfUSTtVLDE ROCHE*
A SU1
iMTFnniTC cn i i r
289
II II.E-PRES&E AGENCE fRAh^PJREjSE^ENCE>RANCE-PRESSE A * 5 E N C T F 5
E T R A N G E R M* 17 (15)_ — | ] DÉCEMBRE !944
4 H
LE D.I-ÎJER-OFFERT PAR LE MARECHAL STALINE AU GENERAL
DES LES PREMIERS Z A K O U S M S , SOMPTUEUSEMENT SERVES XLA RUSSE, ivî. MOLOTOV SE LÈVE POUR POSTER.UN TOAST AU ÛÉNÉ-•AL DE. GAULLE. LE CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA
REPUBLIQUE FRANÇAISE PORTE X SON TOUR UN TOAST AU WIABE-OHAL. S T A L I N E ET À L ' AU I T I É }•'•>. ANC3-SÛV1 ET JQUE, SUCCESSIVE-MENT, M , MOLOTOV BOIT À M . BIDAULT ET OE DERNIER AUMARECHAL S T A L I N E . FOI. Î-.'SOLOTOV PO?TE ENCORE UN TOAST TRESCORDIAL X NOTRE REPRÉSENTANT IV* G A1"* EAU QUI REPOND ENSALUANT LE MFTPECHAL S T A L I N E ET M , MÙLOTOV, CE DERNIER LÈVESON VE-RE X LA SANTÉ DE • L 1 AMBASSADEUR AMÉRICAIN A.VERILLHARRIMAN ET DU CHARGE D ' A F F A I R E BRITANNIQUE BALFQUR,P U I S , EN FRANÇAIS , I L CÉLÈBRE LA RESURRECTION DE LAFRANCE : "PHÉNIX RENAISSANT DE SES OEN-DRES ! ' .J
I L EST D ' A I L L E U R S À NOTER QURAU COURS DU PF.PASF
UN SEUL DES CONVIVES EMPLOIERA UNE AUTRE LANGUE QUE LEP J S S E ou LE FRANÇAIS. CE SERA L'AMBASSADEUR HARRIMAN QUIPORTERA SES.TOASTS EN ANGLAIS, POUR LES ENTENDRE ENSUITEgTnr TRADUITS EN RUSSE ET EN FRANÇAIS.
[VIENT LE TOUR DU GÉNÉRAL JulN^AUQUEL M. N'tOLOTOV RENBHOmMAGE, L E GÉNÉRAL RÉPOND EN 3UV ANT X LA FRATERNITÉ DESARMEES FRANÇAISE ET RUSSE.
LE MARÉCHAL S T A L I N E APPELLE ALOPS L E ^ É N É P A L D'ARMÉE•VITONOV, SOUS CHEF DU GRAND ET AT-MAJOR S O V I E T I Q U E . F A J —S ANT ENSEMBLE L E TOUR COMPLET DE LA .SALLE, JLS VIENNENTCHOQUE^ LEURS VERRES CONTRE CELUI DU GÉNÉRAL JUI-I»»
SUIVENT ENSUITE DIVERS TOASTS; DU MARÉCHAL S T A L I N EET DE i.., iviûLOTOV, AUX CHEFS DES NAT jbfJS UNIES.
LE REPAS, MAGNIFIQUEMENT ORDONNÉ,.SE POURSUIT QUEL-QUE TEMPS, PUIS LE MARÉCHAL S T A L I N E SE LEVÉ ET DURANT PLUSDE D!X MINUTES , PORTE ENCORE DIVERS TOASTS. I L TERMINEEN SALUANT LE GPAN'D WAREOH AL D ' ART ILi-ERl E VORO MOV "iit'lr 'uUFFA, D J T - I L , LES ALLEMANDS SOUS LE FEU DE SES OANONS 'aLE 1V''A»ECHAL S T A L I N E REND AUSSI UN PA-TicuLles HOMMAGE AUMARÉCHAL DE L ' A I R tovîKov, " L ' AVLÀT |ON,^ D | T - I L , REPRÉSENTELA DEUXIEME. FOROE DE CHOC DE NOTRE ARMÉE11»>.L«G CA.F.P-) X SUIVRE.,.
'TE. SAUF ACCOFIO * UTILISATION INTEROITE SAUF ACCORD * UTILISATION INTERDITE SAUF ACCORD * UTILISATION I
P A R I S J P A R I S - - ! 3 . P L A C E D E L A R O H R S F _ P A P K S P A D I C ,•> ™ « r - r ^ r , » „ « „ « ,
290
t £ FRANCS-PRESSE AGENCE FRANCE-PRESSE AGENCE H
T R A M S [ R M* 18(17)I I DEOEMBrE 1944
4 H 25". 1 1 ^ QFFtTT PAR LJ
Le MARÉCHAL 30 I T ENCO°É X LA S A N I É DU Lf EUOT,£Ï\IANT
GENOML lAKOVLEVr LE CE.LÈaP.Ë GOrlSTSUCTEU-, ïÇ
I Én» COMME LE PP.ÉGlSS LE ÎV lV^OHALj PEM--LE'JSS V I CTOI ->ES
LE GEIMEPAL DE GAULLE SE LÈIVf ALO^S AVEC LE MA-RÉCHAL STt .LI f iE i-'OUP SALUËP LE CO!IST ''UCT EU H I A K O V L E V »0'EGT X G.E ;>K3MENT QUE SE DECOULE UNE- ScfeWË DES ^LUSP.EMA^UAiLES : LE MARECHAL STALI.JE PO "TE LA SA'IVÉ DULIEUTENANT COLONEL POUYADE, 00 »« A NID «NT L ' ESOADT i L L E
" H " Éir. ET DÉCLARE
!tÀ L'APM'ÈPE, MOT»Ë COMMANDEMENT FAIT LE PLUS
GRAND ELOGE UE VOS HOMMES, MAIS AU FROTJT QÙ OM EST•iU'AiJOO-'a? P-L'JS...'î,ÉVÈ''E> ON N 'EST PAS. MU IMS ÇLOGlEUX POURLES MEM3RES DE VOTRE ESCADRILLE , ÛELLË-C I NE FOPMF.ACTUELLEMENT QU'TJH RÉGIMENT, MA 1 Ï J E BOI .= AUJOURD'HUI
À L A Q 1 V I S 1 0 . ' "I-IOPMA^BIE11 ET X SON QHEF» LE COLONELFOUYADE". LE IVA:-;E.CHAL MARCHE ALO^S VE^.S CE DEP:J :E^ ETTOUS S)'EUX., O^OISANT LEJ-.S 3 ' - :AS X LÀ "MODE t 'USSE,BOIVENT Ei'-! SEMBLE*
LE L IEUTENANT COLONEL POOYADE PE'PON" C ' E S T GFAOE X L ' A X É E FOUGE QUE L ' E S
E" PEUT SE TPCUVE' AUJOU'VD'HÇ.U EII 'A
ALLEMAND,1
•10 El'! ASSURANTOADS'LLE
EN TEF1? STOIfîE
V I E N T ENGO?C UM TOAST PE: IVI. IVIO-L©TOV AUX G?ANT)ESPUISSANCES-, X L A FRANCE» X LA••G" IÀNDE--B~E'I'AGNE, AUXU V S J A . , X L ' U . ^ V S . S . , , - A LA ViCTOlPE OOwWUNÊ ET X LAPUINE DE L'.V-LEwiAaNE.. Pu I S LE f.'iASEÔH AL STÀL i HE CELEBRELE RQUÉ JOUÉ PAR LES TA'JKS DA>iS OETTE GUE^."E ET 30ITX i_A SANTE DU G.-ÎM.-I-D MARECHAL 3ES TRQUPES 3Lhl3ÉES
AYANT A I H S I SUC0ESSIVEMFJ4T C E l É B R É L ' A RL ' A V I A T I O M ET LES T A N K S , LE MARÉCHAL REtO HOi'..iiAQM I N I S T R E BES OQMWJNIOATJONS LAZARE'KAG^NOV '.VOH ,
X
I L L E R I E ,QE AU
^ 1IGP f\C®
A QUI» - D l T - l L y llES A«Î'M.ES A°PlVENT X TEMPS AU F'-'OiMT11, ETX DIVERS MEMBRES DU COMITÉ U E LA DÉFENSE : AU M I ' TDE L'ARMEMENT VAMI-K0FY AU MTNIST^E DES MUNIT IONSVAIOUSOHTOHEF, & I F I N I I PO^TE UN TSAST PAELTICULÎ
AMiCAL X L ' A ^ I P A L DE L-A FLOT TE ' KOUZETS'OVJ
IAL.G . ( A » F « F « ) X STJTVRE,.' .
:IOITE SAUF accORÛ * UTILISATION IWTèRDITE SAUF àCCORD * Uïli-ISATIOM lOTEPiDITÊ SAUF ttCCOBO UTILISA
31 LA BOURSE — PARIS I PARIS — 13. PLACE DE LA BOURSE - PARIS I PARIS - - 13. I
291
sa jpg1#-
i i . , i , . ;
FRANCE-PRESSE AGENCE FRANCE-PRESSE AGENCE FR
E T R A N G E R M PÉCEMOTE 19444 H 43
O E T T E t O M G U E S É R I E D E T O A S T S SE T E R M I N E SUS UNHOMMAGE RENDU AU G É N É R A L 3&E G A U L L E PAR h . ! v . uU ;TOV r.S O U H A I T E " Q U E l_ ' AM I T I É F«* ANCO—fiOV I ET I QUE S O I T F O f i T EET S O L I D E DANS. L r I N T É R Ê T DES DEUX P E U P L E S ET P O U " ?JS. ER L ' ENME'.w\ J COMMUN " -,
ON SO^T DF; T A B L E POU*? REPASSER AU SALÛM D EROCOCO OÙ L E CAFÉ EST SEP V I PAR P E T I T E S T A B L E S ,LE MARECHAL. S T A L I N E CONDUIT SES HÔTES DA-JS L ADE OLNÉMA P R I V É E DU KREMLIN OU SERA MONTRÉ UNTANT DE 1933 : "SI DEMAIN O ' ±t A i TCE F I L M , TKtè:s RÉALISTE». MONTRE LEGUE"*RE D'AGRESSION DÉCLENCHÉE CONTRE L ; U » R x ^TERMINANT PAS LA DESTRUCTION DE L f A«RES5EU :
LA GUE" <ï E «•iîÉSOUL.EME.T
-STYLEPU I S
SALLEF I L M Dfr-
ET S E
A M I N U I T , LE GENERAL DE GAULLE Q U I T T E LA SALLEACCOMPAGNÉ DE M* B IDAULT ET JOE SES C O L U B O I A Ï E ' J R S I MM É~Dl ATS, DEPENDANT OU ' UNE COMÉDIE M U S I C A L " X ' C O f D E AU F I L M .PENDANT LE LO •••IG ENTRACTE, LE MARÉCHAL S T A L I N E S - 'ENTRE-T I E N T Tnès CORDIALEMENT AVEC LE L I EUT EHAN T COLO.'-JELP O U Y A D E , | L L U I DEMANDE DES P R é c l E Î O N S SUR L 'E.M-'LO iT I Q U E DE L ' A V J A T I O N ET F A I T PREUVE EN L A M AT i Ê "> E D ENAlSSANOES SURPRENANTES*
T A C -COM-
L E S F R A N Ç A I S NON RITT e.vu-s PAR L E S POURPARLERS D I P L O -M A T I Q U E S FONT CERCLE AUTOU'1 DU MARÉCHAL QUI S r ENT H ET | ENT•AVEO EUX SUS UN TON FAMILIER ET AVEC LA NUA'JOEQUI LUI EST PROPRE.
SE AP?'.!OCHA N T VI i M A PO R £ ! L L E « L E M A ~< tCH ALS LEUR ANNONCE QUEFRAN'JO-SOVi ET IQUEPLAIS A NT E AL LUS ! ON
'ASS1STANOEO.\! A S S I S T E
_E V I S AG E
AUXAÀ
A 2 H 30 ENVIRON, \" . !\J.OLOTOVOH AL L U I G L I S S E QUELQUES >v1OTS A L 'SE TOURNANT ALORS VERS LES pRANÇAlLEVA £TRË SIGNÉE. Puis, FAISANT UNETRAVAUX A«DUS DES DIPLOMATES^ I L CO?IV 1 E L
PEPP.EMDRE PLACE DANS LA SALLE DE O[NÉMA,UN DESSIN ANIMÉ AU COUR? DUQUEL APPARAITD'HITLER ET OÙ LES RÉGIMES FASCISTES FONT L'OBJET D'UNEAMUSANTE SATIRE.
L 'ARRIVÉE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À MOSCOU SE D É R O U . L EENSUITE SUR L ' ECRAN ET LA REPRÉSENTATION SE TERMINE PARUN FJLM OÙ L ' O N PEUT VOIR LES TROUPES RUSSES ENTRANTX BUCAREST ET X S O F I A . E N F I N , X 4 H BU M A T I N , W. [VOLOTOVV I E N T A V E R T I R L E fv 'ARÉOHAL QUE L E T E X T E DE L 'ACCORD ESTPRÊT ET T O U S DE'J>£ Q U I T T E N T L A S A L L E APRES A V O I R P R I SOONOÉ DE LEURS HOTES» (k>\-»P^)hi>. I l'y.
292
5. Communiqué portant sur l'écoute AFP de l'Agence Chine Nouvelle, 8 mai 1948.
1 1 2 '• ' B'•'-..,.. 3 2 ~
COMMUNIQUE V IETMINH
PAR I S . 8 MAI ( A F P ) .
L'AGENCE CH!NE NOUVELLE, CAPTEE A PARIS, DANS SON EMISSIONEN ..ANGLAIS, DIFFUSE LE -COMMUN I QUE SU IVANT DE L'AGENCE D'INFORMATIONDU VIETMJ.NH:
' . "LA-PRISE DE DIEN BIEN PHU A ETE. ANNONCEE PAR UN PORTE-PAROLE DU HAUT -COMMANDEMENT DE L'ArRMEE POPULA I RE V I ETNÂMI ENNEA 8 "HEURES DU MATIN.
" D A ' N S LA NUIT DU 6 MAI LES FORCES. POPULA 1RES.. VIETNAM IENNESONT DECLENCHE UNE OFFENSIVE GENERALE CONTRE LE REDUIT. FORT IF IE •FRANÇAIS DE DIEN BIEN PHU, APRES UNE NUIT ET UNE JOURNEE DE COM-BATS, LES TROUPES DE L'ARMEE POPULAIRE-VIETNAMIENNE ONT TOTALEMENTMIS HORS DE COMBAT (COMPLETLY PUT OUT OF ACTION) LES FORCESFRANÇAISES CHARGEES DE LA DEFE-NSE DU SECTEUR DE COMMANDEMENT DEMÙONGTHAN A. 17 HEURES, LE " 7 MA I A 22 HEURES, LE MEME JOUR,LES FORCES. DE L'ARMEE POPULA IRE VIETNAMIENNE ONT COMPLETEMENTANNIHILE (KWOCKED OUT) LES TROUPES FRANC.IASES DANS LE SECTEURSUD A HONGCUM..
" L E S PERTES-SUBIES. PAR LES TROUPES FRANÇAISES DEPUISLE DÉBUT DE L 'OFFENSIVE DE L'ARMEE POPULAIRE CONTRE DIEN BIENPBBCLENCHEE IL Y A PRES DE DEUX MOIS, S'ELEVENT A 17 B A T A I L -LONS D'-1NFÀNTER ! E- DONT ,7 BATA I LLOfsiS DE PARA.CHUT ISTES., 3 BATA Î L - 'iONSr D 'ART ILLERIE ET PLUSIEURS UNITES DU GENIE (SAPEURS). AUCOURS DE LA MEME PERIODE," LA DCA DE L'ARMEE ROPULAIRE VIETNA-MIENNE". A ABATTU OU DETRUI-'T.ÀU -SOL, AU TOTAL, 51 AVIONS FRANÇAIS '* : ,•AFP(A .D) . 1 8 H 4 0 . .
293
6. Flash décès de Staline, 6 mars 1953.
G- _J x<2 à . 1 1
en.
fi 2.
dio CG ïvpSCDU annonce STALES ISCEIiA,
radio de UOSOOU
b euro l o c a l c> (
ST^LBE
on..
294
7. « Comment la nouvelle de la mort de Staline fut diffusée par l'AFP », 6 mars 1953.
g B A M 0 E58. 6 mais
20 H*4O
LA. N0UV3C1B D E M . M3BT 333 STAIiIMEDIFFUSEE PAB
d) PARIS 6 IÎEÏS (li.P.P.)
Pour répondre aux questions qui noussont posées par divers a bonnes en. Fratice et à 1*étranger, voici l e s ' oonditions dans lesquelles
'&.• ]?«P» a 4iffusé t la première dQ toutes lûs^s jno ndial o Sj l a nouvelle do la mort de
1° TJno pormanencQ do ^spéoialiatea dG la-langue ÏUSSQ a t dos questionssoviétiques, é ta i t assurée sans interruption à l 'éooute dos émissions radiophoriiques do MOSCOUet à. .la survoillartco des émissions do l'Agoncd O .SSen "hall* ot on morse.
avait été préparée2° "Une "bande par^foréo /oontonant l e
flasli in i t i a l -"Staline est mortrt) en nombres 'd'exem
plaires suffisant pour desservir nos ,abonn-.es.du monde entier, journaux et agenoes.
3° Auprès des t ro is écouteurs aurusse, se tenaient on permanence doux x-édactaurschargés de transmettra immédiatement lo signal'aux différents postes de transmission.
4° C 'es t a i n s i quo moins dQ 5après que la rcldio 40 Mosoou oût annoncé ^dans l ecommuniqué d ic té pour l a pressa des Républiques.Soviét iques l o t p x t e du communiqué" annonçant 1 Gdécès do STJVDBIE, l e flas^L é t a i t lâché o tdistribué»
5° Gr-ûco à des appels téléphoniquesoonstamment ronouvolésr" IQ corr espondant de l'A.î1. p.à MOSCOU put nous- -fournir, rapidement dos infor-mations personnelles. Mais l a Radio l ' ava i t battusur la nouvGllo è
295
8. Flash et bulletin décès du Général de Gaulle, 10 novembre 1970
AFP-O 53
& J U - E T | H DECSS DE GAULLE . . . U t !
œLOMBEY LES DEUX EGLISES 10 HCVES:::\IE (AJFP)LE GENERAL DE GAULLE EST 1Î0RT L i M O I SOIR », SOM D O M t C l L E
A V) HEURC3 3 a .
ÎULL ÏT i : , DE OA.ULLE -si « -,j
C»L0:";3EY LES DEUX EGLISEI1 'J'UilE CH13E C.'."
296
: - s. j . .. • <. *
9. Flash, « Mao est mort », AFP, 9 septembre 1976
r**f • A o i i- PL, r\ O ri 5~i"xir£j "2xwT_rc^j L-M V
HONG KONG'-MAO EST MORT (OFFICIEL)
AFF . CR 10«05 ++++
. . . /FP AFP-085
H O N G K D M G - -. '•'MAO EST MORT
10.09' ++++
1FP-Ô85 ,•*. FLASH — s
HONG' KONG -MAO. EST HORT (OFFrClEL).£K^r ï^ :^
AFP . ' -V 1CUQ9
297
10. Témoignage, René Flipo, Pékin, 13 septembre 1976.
M\0
-•'•.'.,••:••:::•:. T E M O Ï G N A G E " M f H R M J
[ P E K I N , 13 SEPTEMBRE (AFP) (PAR RENE FLIPO) I h ' ^ .'
J ' A i VU LA DEPOUl.LLE MORTELLE DEMAO TSETOUNG ET, -COMME BEAUCOIPDE CHINOIS AUTOUR DE MOI , J ' A i EU BEAUCOUP DE MAL A RETENU? MES -LARMES-, D'AUTRES QUI S'ETAIENT DOMINES JUSQUE LA. ONT SOUDAINEMENTETE BRlSËS-PAR LA DOULEUR DEVANT LE CATAFALQUE. SUR LEQUEL REPOSE,DANS UN BAIN DE.LUMIERE JAUNE DIFFUSE,' LE CORPS DE MAO ÎSETOUNG, .
JE ME SU lS -JO lNT AVEC MON EPOUSE ET LE PERSONNEL DE NOTRE BUREWA PEKIN A UNE_F|LE,DE CENTAINES DE PERSONNES GRAVI SSANT-A PAS LENTSBQUARANTE MARCHES-DE GRAN IT BLEU MENANT A-L'IMPOSANTE ENTREE DU-CONGRES NATIONAL POPULAIRE (ASSEMBLEE CHINOISE) SUR LA PLACE TIENAN MEN, ' • . • ' . , ' . . . . . . . . . . .._
. LA JOURNEE DE LUNDI A ETE CELLE OU LES ETRANGERS RESIDANT OURE TROUVANT-.A PEK IN . ONT.. ETE AUROTlSES A RENDRE UN DERNIER-HOMMAGEAU PRESIDENT MAO EN ALLANT S' INCLINER SUR SA DEPOUILLE.
...AU CENTRE DE LA .FAÇADE DU CONGRES,.. UN PORTRAlT-EN. COULEUR DUPRESIDENT MAO, BORDE DE CREPE NOIR,-EST LEGEREMENT INCLINE-VERS LES. l«LL l£RS DE PERSONNES QUI S'AVANCENT'ETE-BASSE. LE Ct EL. EST GRIS-BLE!EN. CETTE FIN-' DE JOURNEE.DE SEPTEMBRE, DU MEME GRIS QUE.LE GRANIT •DES BATIMENT. - - , - > • - . . •
- CHACUN PORTE UN BRASSARD NOIR AU BRAS ET UN CHRYSANTHEME DEPAPIER BLANC AU REVERS DE LA-VESTE. SUR PLUSIEURS TABLES DI SPO SES-JANS LE-HALL -D'ENTREE, DES..LIVRES DE CONDOLEANCES AUX-BO.RDURES-NOI RESONT MAINTENUS OUVERTS PAR DE" LOURDES-REGLES DE CUIVRÉ, AU HAUT DELA PORTE QUI MENE A LA CHAPELLE ARDENTE, UN SEUL SLOGAN BLANC SURFOND-NOIR DECLARE EN.GRANDS IDEOGRAMMES, .s "RESTONS FIDELES AUXDERNIERES VOLONTES DU PRESIDENT MAO TSETOUNG"POUR MENER JUSQU'AUBOUT LA CAUSE DE LA REVOLUTION PROLETAR.I E.NNE' ' . 'SUIVRA AFP/JLD ' . 1 & . 3 1 ++++ . . . .
298
-TEMOIGNAGE . . . . J, (DEUX) / V <
,U FOND" DE LA SAULE, UN AUTRE SLOGAN I N D Ï Q U E S "HONORONS AVECULEUR EXTREME L A. MEMO IfiË-DU PRESIDENT .' - • ":
.ETOUNG ..NOTRE. GRAND DIRIGEANT ET NOTRE GRAND EDUCATEUR''.JE SLOGAN,-UN PORTRAIT NOlR ET BLANC DU PRESIDENT,- DOMINE-. .iND CERCUEIL DE VERRE DANS LEQUEl REPOSE LA DEPOUILLE MORTELLE..E CORPS-.. REVETU D'UNE VAREUSE GR I S*=-BLEU, - E-ST -RETOUVESTA LA-POITRINE D'UN DRAPEAU DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS FRAPPEFAUCILLE. ET DU MARTEAU OR SUR FOND ROUGE. DES SOLDATS EN ARME
IT-UNE. GARDE D'HONNEUR DE PART ET D'AUTRE DU CATAFALQE TENDUIRAP BLANC. _.. ... •.' . . •Olp-RES-DES PERSONNALITES ET DES REPRESENTANTS DES MASSES QUI-.AIENT PRES DU CORPS POUR ASSURER UNE VEILLEE PERMANENTE, DES -NES DE-CHINOIS ET D'ETRANGERS QUI PAR GROUPES DE DIX DÉFILENTJESSE,-S' INCLINENT PROFONDEMENT DEVANT LE CERVUEIL. . •',-..V L'ENTREE, QUELQUES D lR I GEANTS ACCUEILLENT EN LEUR SERRANT LALES-CHÎNO1S ET-LES ETRANGERS. LUND I SO ! R, - L E MARECHAL +1SU
S- CHIEN. VICE-PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE POP-ULAIRÊ ETAO KUAN HUA, MINISTRE DES AFFAIRES.ETRANGERES, SE TROUVAIENTEUX. . ' -
1'APPROCHANT DU CATAFALQUE, DU MEME-PAS LENT QUE CELUI "DESS J'ENTENDAIS DE PLUS EN PLUS NETTEMENT, AU DESSUS.-D'UNE MARQ3
SE DIFFUSEE EN PERM ANEHCE. PAR HAUT-PARLEURS. LE-BRUIT DES -)TS ETPAHFOTS DE VER 1 TABLES'HURLEMENTS. CEUX-CI COUVRAIENT)T LA MUSl QUE. . . . • .\ AFP/JLD 1652
PEKIN -TEMOIGNAGE . „ . „ . » , < . TROIS
AU PÏED DÛ C A T A F A L Q ' J E T LE V rs ÏTEUR.PEUT APERCEVOIR L E ^ V I S A G E _...DE MAO DANS LA LUMIERE DiFFUSE, I L EST DE COULEUR .BR0NZE r LES TRAIT-:SONT P L E I N S . . LES LEVRES LEGEREMENT ENTROUVERTES-ET iMMOBlLS.S ATOUT JAMAIS». RARES SONT LES ETRANGERS QUI ONT PU- VOIR' LE V! SAGEDU PRESIDENT DE SON VIVANT» - - • •• ". - " - . , - . _
C'T£ST;-A CE MOMENT QUE MO iM INTERPRETE, QUI S 'ETA iT -DOM i NEJUSQUE LA^-FOND EN-LARMES ET PLEURE PENDANT DE'LONGS INSTANTS».CHACUN QUITTE EN SUITE-L A-SALLE.. SILENCIEUSEMENT, .EN PROIE A U N EEMOTION D I F F I C I L E Â-D tSSIPER, -EN.PASSANT DERRIERE DES CENTAINESDE COURONNES MORTUAIRES APPORTEES PAR TOUTES LES PERSONNALITESfc.T LES GRÀANDS ORGANISMES DE L ' E T A T . - • . _ . . : • . . . ' . .
. LA CEREMONIE DURE C|NQ MINUTES, MAIS CES MINUTES COMPTENT:"FLLES.FOURNISSENT UN BOULEVERSANT TEMOIGNAGE DU.RESPECT ET DE L 'AMOlSANS BORNE DONT MAO EST L 'OBJET DE LA PART DE 800 MILL IONS DE .C H I N O I S . . , , _ - • . • • - ' • ' .-. . . . - . •
- . .DANS UN COÎN-DE LA-SALLE, PRES/DE LA SORTIE, WANG HAI--JUNG, LANIECE DU PRESIDENT, SE TIENT DEBOUT, SEULE, LES YEUX PERDUS VERS LECO'RPS DU GRAND LEADER, . •- , ."" . _ ._.
•DEHORS, LA-'NUIT COMMENCE A -TOMBER. • DES MlLL IERSDE CHiNOIS : ETD'ETRANGERS ATTENDENT, SOUS LES DRAPEAUX EN BERNE, DE PENETRER ALEUR TOUR .DANS LA CHAPELLE AKDENTE. " • ' •
. CE CEREMONUL SE POURSUIVRA JUSQU'AU 17 SEPTEMBRE. LE 18'DANS L 'APRES-MIDI , L'ELOGE FUNEBfiE 5ERA PRONONCE SUR LA PLACE TIENW MEN DEVANT DES-CENTAINES-DE MILLIERS DE PERSON-NES ET DIFFUSEDANS LE MONDE ENTIER, LA POPULATION'-CHINOISE TOUT ENTIERE OBSERVERAALORS.3 MINUTES DE SILENCE TANDIS QUE TOUTES LES SIRENES DU PAYSMUGIRONT EN SIGNE DE.TRISTESSE ET DE DEUIL. .AFP. AL E1657 .. . • . . •
299
11. « L'adieu à la Chine », Georges Biannic, 18 septembre 1976.
M AÇ
L'ADIEU DE LA CHINE. •
EK1N, 18. SEPTEMBRE (AEP) ( PAR GEORGES B1 ANN1 C) - ' T ^ _ _L'ADIEU DE LA CHINE A MAO TSE-TOUNG.A ETE DIGNE ET SIMPLE,
BOULEVERSANT. ' •" - - - • -. ,1F HF T9.HI1 VF, SEUL ETRANGER. AU MILIEU DE-QUELQUES Ml L L ! ERS
DE CHINOIS SUR LE PARVTS DE LA GRANDE GARE CENTRALE DE PÉKIN. QUANDTROIS HEURES -SONNENT A.LA GRANDE HORLOGE. .. .
. DEPUIS DIX MINUTES. DEJA, TOUT LE MONDE EST AU GARDE A VOUS,LES BRAS LE LONG' DU CORPS, SACS DE VOYAGE A TERRE, REGARD FIXESUR LE PORTRAIT GEANT DE MAO, BORDE..DE CREPE..NOIR ET DE RUB AN-SJAUNES I F S COULEURS DE DEUIL. LE SILENCE EST TOTAL, LA VIE FIGEE.LA V | L L r p A R j L y . S E E | i • . . . _. ... .
--'.AU TROISIEME COUP, LES .SI RENES DES LOCOMOTIVES SE METTENTA MUGIR, STRIDENTES, ROMPANT LE SILENCE QUI S'ETAI T !NSTALLEINTERMINABLEMENT, SIMULTANEMENT, S'ELEVENT LES ACCENTS D'UN- HYMNECHINOIS D'UNE TRISTESSE INFINIE DES HAUTS PARLEURS BORDANT LA-PLACE. • . • • ' . - . .SUIVRA AFR MH 11.32++++
KP-147TM A O - - - • : •• •PEKIN " L 'A IDIOJDE LA CHS NE. . . . . , . „ . . , . . . . , (DEUX)
MLA'MEME SECONDE, TOUTE L'ASSISTANCE B.ttïsSE LATETE, DE JEUNES P AYSANNES.-PORTANT- DES BEBES SUR LE DOS, DE IEUXSOLDATS DE Li.ARMEE .POPULAl RE DE LIBERATION, DES PAYSANS HABILLES DENOIR A L'ANCIENNE, DES- OUVRIERS EN BLEUS DES ADOLESCENTS, DES JEUNES FILLES, "BRASSARD NOIR ET CHRYSANTHEME BLANC, BADGES DE MAO SURLA POITRINE, DES ENFANTS DIRIGENT LEUR. REGARD VERS LE SOL.
AUTOUR DE M û l , TOUT LE MONDE SE.MET A PLEUKER. SILENCIEUSEMENT,SANS GESTE ET .CRIS DE DESESPOIR, DANS UNE DIGNITE TOTALE. ..L31NST AN-EST SAISISSANT, L'EMOTION INTENSE. ON NE SE.SENT-PLUS ETRANGER/ ONPARTAGE LA DOULEUR D'UN-PEUPLE, ON NE PEUT RETENIR. SES LARMES, . , .
-QUAND. TOUTES LES SIRENES'DES LOCOMOTIVES DANS;LA GARE, DES.USINES DE-PEKIN SE SONT TUS, BEAUCOUP RESTENT ENCORE UN MOMENT LATETE INCLINEE. , •
CERTAINS SECHENT LEURS LARMES. D'AUTRES LEVENT UN REGARD PERDUVERS L£ PORTRAIT DU "GRAND/EDUCATEUR".
OUI..MAO EST BIEN M O R T . . . .AFP 11 .35 ++++
BIEN LIRE EN TITRE
300
12. « Egypt's Muslim Brotherhood holdspro-reform rallies despite arrests »,27 mars 2005, 14h48.
3 RLQ67 PAR 0270 EAA I EMI 270305-14h48 wO412Egypt-lslamist" RPT265Egypt's Muslim Brotherhood holds pro-reform rallies despite arrestsATTENTION -INCORPORATES -arrest séries IIICAIRO, March 27 (AFP) -Several thousand members of the banned Muslim Brotherhood tookpart in three démonstrations in Cairo Sunday, calling for constitutional reforms and the lifting ofrestrictive emergency laws.The main démonstration, consisting of 1 ,000 people according to authorities and 3,000 accordingto organisers, took place on the central Ramses Square after tight security measures prevent~dthem getting to parliament.The two other gatherings, involving 200 to 300 people each, took place in the central Bab el-Lukand Sayyeda Zeinab districts, authorities said.Street démonstrations are banned in Egypt thanks to emergency laws that hâve been in place sinceprésident Anwar al-Sadat's assassination in 1981."End the state of emergency," demonstrators shouted, calling also for "opposition to Americaninterférence" in Egyptian affairs and "more constitution al reforms".Last month, US Président George W. Bush used his State of the Union address to call fordémocratie reforms in Egypt."The great and proud nation of Egypt, which showed the way toward peace in the Middle East,can now show the way toward democracy in the Middle East," Bush said.Brotherhood leader Mohammed Mahdi Akef called for the démonstration last week during a pressconférence on constitutional reforms put forward by Président Hosni Mubarak that will, in theory,allowa degree of choice for voters in presidential élections due to be held later this year.Mubarak is currently serving his fourth uncontested term as président.Several thousand police were deployed around government buildings in the capital as weil as theUS and British embassies.Egyptian security forces on Saturday arrested around 50 Brotherhood members ahead of thedémonstrations.High-ranking members of the organisation were among th ose arrested in five districts in andaround Cairo."Thèse détentions are aimed at intimidating us into cancelling the démonstration planned for todaybut we are determined to hold it," a Brotherhood officiai told AFP .Egyptian security forces regularly detain members of the generally tolerated Brotherhood, whichconstitutes the main opposition to Mubarak's ruling National Démocratie Party, although membersare required to sit in parliament as independents.Ir-hz/cjolkir
301
13. « L'opposition a franchi les lignes rouges et le pouvoir se durcit », papier retour,Hassen Zenati, 31 mars 2005.
Egypte-politique-élection-opposition,PREVL'opposition a franchi les lignes rouges et le pouvoir se durcit (PAPIER RETOUR)par Hassen ZENATI
LE CAIRE, 31 mars (AFP) - L'opposition a franchi pour la première fois les lignesrouges établies tacitement avec le régime, en s'attaquant directement au chef de l'état,mais le pouvoir a montré qu'il disposait d'une force de dissuasion policière pour prévenirles manifestations.
Les brigades anti-émeutes casquées, munis de boucliers et de matraques ont étédéployées massivement à deux reprises au centre du caire cette semaine, dimanche pourfaire avorter un projet de manifestation des frères musulmans et mercredi pour empêcherun rassemblement du mouvement populaire pour le changement "kefaya" (ca suffit).
Les deux mouvements voulaient faire entendre leur voix pour plus de réformespolitiques devant l'assemblée du peuple, qui débat d'un amendement à la constitutioninstaurant pour la première fois l'élection du président de la république au suffrageuniversel direct et secret parmi plusieurs candidats.
Les manifestations de rue sont interdites en egypte depuis l'instauration de l'étatd'urgence à la suite de l'assassinat du président Anouar El-Sadate par des islamistes en1981.
Pour les autorités, il s'agit de contenir une constestation politique confinée jusque-làdans les locaux des partis, mais qui tente de déborder vers la rue et n'hésite plus à s'enprendre directement au chef de l'état.
Depuis décembre, des slogans hostiles au chef de l'état ont été scandés publiquementpar des manifestants en diverses occasions, alors qu'il bénéficiait jusque là d'un statutprivilégié.
Les opposants adressaient leurs critiques aux collaborateurs du chef de l'état ou auxministre, véritables fusibles de la présidence.
"Assez", "non, à un cinquième mandat", "non à Moubarak, à son parti et à son fils","Moubarak la faillite, qu'as tu fait de notre argent?", "locataire du palais ourouba(Moubarak), nous sommes exténués, ça suffit", faisaient partie des slogans desprotestataires.
Georges Isaac, principal animateur de Kefaya, a affirmé à l'afp que "l'intervention enforce de la police prouve la peur du gouvernement devant l'éveil du peuple égyptien, quidemande une démocratie réelle et non amputée".
Abdelhalim Kandil, directeur de la rédaction d'AI-Arabi, souligne que cette"contestation politique se déroule sur un terrain social très chaud", marqué notammentpar une montée en flèche des prix et du chômage.
Dans un communiqué à l'AFP, le guide suprême des frères musulmans MohammedMehdi Akef a "regretté" que "Le Caire verrouillé, fut tranformé en caserne", pourempêcher les manifestations et assuré que la confrérie "ne renoncera pas à sesrevendications".
"Je sens que le climat est ouvert, que le gouvernement est de plus en plus faible et quele peuple est en train de se débarrasser de sa peur", souligne la féministe Nawal Saadaoui,qui a annoncé son intention d'être candidate à la présidence de la république.
302
L'opposition est encouragée par les premiers frémissements du "printempsdémocratique" en Irak, en Palestine et au Liban.
Le vice-guide suprême des frères musulmans Mohammed Habib a reconnu que lespressions américaines en faveur de réformes politiques au proche-orient "bénéficient àtoute l'opposition" égyptienne.
Elle craint que les députés, appartenant en majorité au parti national démocrate (PND -au pouvoir), ne limitent la portée de la réforme constitutionnelle en multpiliant lesobstacles devant les candidats indépendants à la présidence face au président Moubarak.
M. Moubarak, 76 ans, n'a pas encore annoncé son intention de briguer un cinquièmemandat, mais le secrétaire national du PND Safouet el-Chérif a affirmé mercredi que leparti majoritaire "tenait à présenter sa candidature".
L'opposition demande aussi la levée de l'état d'urgence afin d'assurer la liberté duscrutin, la réduction des pouvoirs du chef de l'état et la limitation à quatre ans de la duréedu mandat présidentiel, qui ne serait plus renouvelable qu'une seule fois.
hz/
303
14. Dossier, Portrait, « Eileen, le roc, commandant de bord de Discovety », 8 juillet 2005.
3 TID70 ETR EAF.PEP.ELU c EMI 080705-09h28 WO673
usA-espace-navette-iss,PREV"Eileen, le roc", commandant de bord de Discovery
(DOSSIER,PORTRAIT)Par Jean-Louis SANTINI
WASHINGTON, 8 j u i l 2005 (AFP) - Eileen Col "lins, 48 ans, p i lote detalent aux nerfs d'acier, qui commandera Discovery pour la reprise de;vols prévue le 13 j u i l l e t , est la plus célèbre des astronautesaméricains en ac t i v i té , pour être la première et seule femme à avoircommandé une navette spatiale.
De t a i l l e moyenne (1.65 m), plutôt menue, cheveux auburn portéscourts, e l le pensait d'abord devenir professeur de mathématiques maissa passion de l ' av ia t ion , née en regardant voler des planeurs pendantsa peti te enfance, la mène à l 'A i r Force Academy.
"Enfant, cela m'a vraiment inspiré et je me disais qu'un jourj 'aura is la possib i l i té de fa i re la même chose", se souvient-elle dan;un entretien publié sur le si te de la Nasa.
Aujourd'hui e l le affiche 6.280 heures de vol sur 30 types d'avionset plus de 537 heures dans l'espace en t ro is missions à bord d'unenavette.
Elle obtient son brevet de pi lote en 1979, sur la base de 1'us AirForce de vance (oklahoma, sud), dans la première promotion à accepterdes femmes.
Eileen col l ins est ensuite instructr ice de vol sur les jetsd'entraînement T-38 avant d'être transférée en Californie sur la basede Travis où e l le a rencontré son mari, aujourd'hui p i lote chez DeltaAir l ines. C'est à Travis qu'el le apprend à pi loter le C-141, énormeavion de transport m i l i t a i re .
En 1986, e l le est acceptée à l'académie américaine de l ' a i r pourdevenir en 1989 une des rares femmes pilotes d'essai. Parallèlement,el le décroche une maîtrise de mathématiques appliquées, à laprestigieuse université de Stanford (Californie, ouest).
En 1990, e l le est sélectionnée par la Nasa et rejoint le club trèssélect des futurs astronautes. Elle est à la fois la seule femme etseule pi lote d'essai de cette promotion, avec 22 hommes.
Ces qual i f icat ions uniques la destinent à devenir la première femmeà pi loter une navette en 1995.
Modeste et déterminée, Eileen Collins suscite l 'admiration et lerespect de ses pairs. En 1999, son calme face à une situationd i f f i c i l e lors de son premier vol comme commandant de bord de lanavette Columbia, lu i vaut le surnom "d'Eileen, le roc" décerné parson co-pi lote, Jeff Ashby.
Elle doit fa i re face a la panne de deux ordinateurs de bord pendantle lancement. Les ordinateurs de secours prennent le relais mais unefu i te d'hydrogène menace d'empêcher Columbia d'atteindre son orbi te,ce qui imposerait un atterrissage d'urgence. Son sang f ro id garantitla réussite de la mission.
"Je n'ai pas de nerf, pas d'émotion et ne ressens pas de tension( . . . ) , j ' a i un vaisseau spatial de deux mil l iards de dollars entre lesmains et je ne pense à rien d'autre". Ainsi répond-elle à la questiond'un journal iste l ' interrogeant sur la pression entourant la reprisedes vols de navettes lors d'une récente conférence de presse aucentre spatial Johnson de Houston (Texas, sud).
Dans un entretien publié par la Nasa, el le confie avoir peu detemps pour les l o i s i r s au cours de l'année d'entraînement intensi f quiprécède une mission, précisant qu'el le t rava i l le encore à la maisonaprès sa journée au centre spatial Johnson.
"J'aime passer du temps avec ma famil le, c'est très important pourmoi", d i t - e l l e cependant. Elle a deux enfants de 9 et 4 ans.
"A une autre époque de ma vie j 'adorais fa i re des choses un peufol les comme des virées à moto à travers 1'oklahoma, p i lo ter toutessortes d'avions, --pas de la Nasa - - et a l ler dans les salonsaériens", a joute-el le.
"Je suis une sorte d'exploratrice passionnée ( . . . ) et je pensequ ' i l est très important pour l'humanité de voyager au-delà de laTerre et de poursuivre l 'exploration de notre univers ( . . . . ) unenthousiasme que j 'aimerais transmettre aux plus jeunes générations",d i t Eileen Collins qui est prête à fa i re renouer l'Amérique avecl'espace, près de deux ans et demi après l 'accident de Columbia.
304
15. Insolite : "Vous êtes bien réveillés », 16 juillet 2005, 04hl6.
4 AKN35 FRA FAF.PHA-WD GU EMI 160705-04hl6 WÛ202
AFP-MATlN-i nsoli te"VOUS ETES BIEN REVEILLES"
TOKYO, 16 j u i l 2005 (AFP) - Le fondateur d'une secte japonaise quiprétendait détecter les maladies de ses adeptes en l isant dans laplante de leurs pieds a été condamné à douze ans de prison, vendredipar un tribunal de Tokyo, pour s'être enrichi grassement au moyen decette pratique.
Teruyoshi Fukunaga, 60 ans, a été reconnu coupable d'avoir escroqué31 victimes pour un montant total de 149 mill ions de yens (1,1 mi l l iond'euros).
Lors de leur adhésion à la secte Ho-no-Hana Sanpogyo, les adeptessubissaient un examen minutieux de la plante de leurs pieds, au termeduquel i l s se voyaient diagnostiquer des maladies graves te l les que lecancer.
Affolés, i l s déboursaient alors d'importantes sommes d'argent pourassister à des "séminaires" censés les guérir.
La secte comptait plusieurs mi l l iers d'adeptes au Japon,principalement des femmes au foyer.
" i l a assouvi ses désirs cupides au nom de la re l ig ion" , a commentéen rendant la sentence le juge Tsutomu Aoyagi, relevant que le gouroulecteur de pieds, qui prétendait aussi entendre des voix divines,menait un grand t ra in de vie et habitait dans un appartement de luxe.
mis/roc/cm
305
16. Dépêche, La malédiction de Toutankhamonpoursuit l'archéologue, 09 mars 2005
3QXW06PAR 0232 MOA Al EMI 090305-18h26 W0677
Egypte-archéologie, PREVLa malédiction de Toutankhamon poursuit l'archéologue qui l'a découvert (PAIER D'ANGLE)par Ryad Abou AWAD
LE CAIRE, 9 mars (AFP) - La mort de Toutankhamon reste un mystère pour les experts qui viennentd'ausculter à nouveau sa momie, mais sa malédiction continue à poursuivre l'archéologue britanniqueHoward Carter, qui avait mis au jour la sépulture royale en 1922.
"L'unique et véritable malédiction des Pharaons est la cupidité et la convoitise de Howard Carter",a déclaré à l'AFP Sabri Abdelaziz, chef du département des antiquités pharaoniques au Conseilsupérieur des antiquités égyptiennes (CSAE). Il a imputé à Carter la responsabilité d'avoir abîmé lamomie royale lors de sa découverte.
Après avoir consacré dix ans de sa vie dans la Vallée des Rois, près de Louxor (Haute-Egypte) àvider la tombe de Toutankhamon de son fabuleux trésor, Carter est mort en 1939 dans des circonstance:mystérieuses.
La légende populaire attribue sa mort à la "malédiction des pharaons", qui frapperait tous ceux quiont ouvert leurs tombes.
L'archéologue égyptien accuse Carter d'avoir "pillé" la tombe de Toutankhamon, d'avoir employé desbarres de fer chauffées à blanc pour arracher le fameux masque d'or mortuaire, actuellement exposé auMusée du Caire, et d'avoir maltraité sa momie, qui présente diverses fractures.
Un scanner effectué ces dernières semaines sur la momie de Toutankhamon a révélé que l'enfant-roin'était pas mort assassiné, mais les chercheurs n'ont toujours pas réussi à percer le secret de sondécès à 19 ans, selon le secrétaire général du CSAE, Zahi Hawass.
"Les scientifiques n'ont trouvé aucune preuve que Toutankhamon a été assassiné, ni qu'il a étéfrappé à la tête, ni qu'il a été tué", a-t-il indiqué mardi dans un communiqué.
Lors de sa découverte, le pharaon était enseveli dans trois cercueils gigognes, dont un en ormassif, qui doit être restauré. Après l'avoir passée au scanner, les experts avaient décidé deconserver la momie dans sa tombe de la Vallée des Rois, en équipant néanmoins le sarcophaged'instruments de contrôle de la température et de l'humidité afin de prévenir de nouvellesdégradations.
Les chercheurs, dont des Egyptiens et des Européens, ont affirmé qu'une fracture à la jambe gauchedu roi n'aurait pas pu causer sa mort, même si elle avait été infectée.
Le sarcophage de Toutankhamon, qui a régné dix ans sur l'Egypte il y a 3.300 ans et qui estconsidéré comme le 12e pharaon de la XVIIIe dynastie d'Egypte, a été ouvert quatre fois depuis sadécouverte en 1922 par Howard Carter: en 1925 par l'archéologue britannique, puis en 1969 et en 1986pour des examens aux rayons X, enfin en 2005 pour un scanner.
Lors de ce dernier examen, le plus poussé de tous, une équipe de radiologues a réalisé la premièreimage numérique de synthèse du visage déjeune roi. Pour la première fois, on a ainsi pu tracer lestraits du visage du pharaon avec une grande précision, selon M. Abdelaziz.
Les 17.000 clichés examinés "prouvent que Touthankhamon n'a pas été assassiné et que les fracturesapparentes sur la momie sont d'abord de la responsabilité de Carter et ensuite de celle desembaumeurs", selon le rapport d'expertise.
Le rapport récuse aussi bien la thèse de l'empoisonnement que celle de son assassinat par un coup àla tête. "Les deux hyptohèses sont fausses", souligne-t-il.
Les experts imputent aux embaumeurs les fractures constatées sur la momie au bas du fémur etajoutent que "de telles fractures n'auraient pas pu causer la mort du pharaon, qui était jeune etvigoureux, bénéficiait d'un excellent suivi médical et n'avait souffert ni de malnutrition, ni demaladies chroniques".
La thèse de l'assassinat de Touthankhamon a été fondée sur le fait qu'il a été le dernier pharaonde sa dynastie. Il a été remplacé après sa mort, pendant quatre ans, par le grand prêtre Aye, puis parle chef militaire Horemheb, qui, après 26 ans de règne, cédera le pouvoir à son vizir Ramsès,fondateur de la XIXeme dynastie.
ra/hz/tq
306
Annexes B - notes et rapports et documents internes.
1. Statut de l'Agence France Presse 10 janvier 1957
LOI N° 57-32 DU 10 JANVIER 1957 portant statut de l'Agence France-Presse.(Journal officiel du 11 janvier 1957)Après avis de l'Assemblée de l'Union française,L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,L'Assemblée nationale a adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er.Il est créé, sous le nom d' « Agence France-Presse », un organisme autonome doté de la personnalitécivile et dont le fonctionnement est assuré suivant les règles commerciales.
Cet organisme a pour objet :
1° De rechercher, tant en France et dans l'ensemble de l'Union française qu'à l'étranger, les élémentsd'une information complète et objective ;2° De mettre contre paiement cette information à la disposition des usagers.
Article 2.
L'activité de l'Agence France-Presse est soumise aux obligations fondamentales suivantes :
1° L'Agence France-Presse ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou deconsidérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information ; elle ne doit, enaucune circonstance, passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politiqueou économique ;
2° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action etparfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et sansinterruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance ;
3° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, assurer l'existence d'unréseau d'établissements lui conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnementmondial.
Article 3.Il est institué un conseil supérieur chargé de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2.
Article 4.
Ce conseil supérieur est composé comme suit :
Un membre du Conseil d'État en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'État, président, avec voix prépondérante ;Un magistrat en activité ou honoraire de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de laditeCour ;Deux représentants des directeurs d'entreprises de publications de journaux quotidiens désignés par les
307
organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisationsest appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53 -287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pourson application ;Un journaliste professionnel désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives ;Un représentant de la radiodiffusion-télévision française désigné dans les conditions fixées par lerèglement d'administration publique prévu à l'article 17 de la présente loi ;Deux membres choisis par les autres membres du conseil supérieur, l'un parmi les personnalités ayantexercé outre-mer de hautes fonctions administratives, l'autre parmi les personnalités ayant exercé àl'étranger une haute fonction représentative de la France.Les membres du conseil supérieur sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.Toutefois, le mandat des membres du premier conseil supérieur ne prend fin qu'à l'expiration d'unepériode de quatre années.Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a étédésigné. Lorsque le mandat d'un membre prend fin, pour quelque cause que ce soit, avant son termenormal, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membresdu conseil.Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur et les conditions dans lesquelles il sera fait faceà ses dépenses sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 17 de laprésente loi.
Article 5.Le conseil supérieur peut être saisi par un usager ou une organisation professionnelle de presse, ou,dans les conditions prévues à l'article 12, par la commission financière, de tout fait de nature àconstituer une infraction aux obligations énoncées à l'article 2.Le conseil supérieur apprécie, dans un délai de trois mois, si le fait dont il est saisi constitue uneinfraction aux obligations de l'article 2.Dans l'affirmative, il adresse toutes observations ou injonctions utiles au conseil d'administration et auprésident directeur général.Si le fait incriminé résulte d'une décision du conseil d'administration, il peut en suspendre l'exécutionet demander à celui-ci de procéder à une seconde délibération qui doit être prise dans un délai d'unmois ; la décision mise en cause ne peut être maintenue qu'à une majorité de douze voix.Si le fait incriminé résulte d'une faute grave du président directeur général, le conseil supérieurprononce, après avis du conseil d'administration délibérant hors la présence du président directeurgénéral, la cessation de fonction de ce dernier.Le conseil est saisi au début de chaque année par le président directeur général d'un rapport retraçantl'activité de l'Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l'article 2.
Article 6L'agence France-Presse est administrée par un conseil d'administration présidé par le président
directeur général de l'agence.-
Article 7.Le conseil d'administration comprend en plus du président :
1° Huit représentants des directeurs d'entreprises françaises de publication de journaux quotidiensdésignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentativedesdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi nc 53-287 du 7 avril 1953 etpar les textes pris pour son application ;
2° Deux représentants de la radiodiffusion-télévision françaises désignés dans les conditions fixées parle règlement d'administration publique prévu à l'article 17 de la présente loi ;
3° Trois représentants des services publics usagers de l'agence désignés dans les mêmes conditions etrespectivement par le président du conseil, le ministre des affaires étrangères et le ministre des
308
finances et des affaires économiques ;
4° Deux représentants du personnel de l'agence, soit :
Un journaliste professionnel élu par l'assemblée des journalistes professionnels de nationalitéfrançaise appartenant au personnel de rédaction de l'agence ;
Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents denationalité française de ces catégories.Le conseil élit, à la majorité des voix, un vice-président, choisi parmi ceux de ses membres quireprésentent les directeurs d'entreprises de publication. Le président directeur général ne prend paspart au vote.La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Leur mandat estrenouvelable. Toutefois il peut être mis fin, à tout moment, au mandat des représentants des servicespublics par le président du conseil ou le ministre dont ils relèvent.Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a étédésigné.En cas de cessation de fonction d'un membre pour quelque cause que ce soit, la durée du mandat deson successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.Les dispositions des articles 6 et 8 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants etadministrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdictionet la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société sont applicables aux membres du conseild'administration.
Article 8.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administrationde l'agence.Le président directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution des délibérations duconseil d'administration, de la direction de l'ensemble des services de l'agence et de la représentationde celle-ci.Le vice-président assiste ou remplace le président directeur général dans ses missions dereprésentation. En cas d'empêchement du président directeur général, il est suppléé à la présidence duconseil d'administration par le vice-président ou, à défaut, par un administrateur choisi par le conseild'administration dans son sein. Les autres attributions du président directeur général sont, dans lemême cas, exercées par les directeurs ou chefs de service de l'agence ayant reçu à cet effet délégationdu président directeur général avec l'accord du conseil d'administration.Les pouvoirs respectifs du conseil d'administration et du président directeur général sont précisés parle règlement d'administration publique prévu à l'article 17 de la présente loi.Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au président directeur général.
Article 9.Le statut du personnel de l'agence est arrêté par le conseil d'administration sur la proposition duprésident directeur général et après avis de la commission financière.Il est déterminé par référence aux conventions collectives qui régissent les personnels des entreprisesde presse.
Article 10.Le président directeur général est désigné dans les trois mois de la vacance du poste par le conseild'administration en dehors de ses membres pour une période de trois ans renouvelable. La premièredésignation a lieu dans les mêmes conditions, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi.Cette nomination doit être acquise par douze voix au moins.Si aucun nom ne réunit ce nombre de voix après trois tours de scrutin auxquels il est procédé dans lesconditions fixées par le règlement d'administration publique, le conseil supérieur propose au conseil
309
d'administration deux candidats ; celui de ces candidats qui obtient le plus de voix est élu présidentdirecteur général.La cessation des fonctions du président directeur général peut être décidée par le conseild'administration pour faute lourde de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour acteincompatible avec l'accomplissement de sa mission. Cette décision doit être acquise hors la présencedu président directeur général et par douze voix au moins.En cas de rejet d'une proposition tendant à l'application de l'alinéa précédent ou lorsqu'il n'a pas étépossible de réunir douze membres du conseil d'administration au cours de deux séances convoquées àquinze jours d'intervalle pour se prononcer sur une telle proposition, une réclamation peut êtreprésentée par trois membres au moins du conseil d'administration au conseil supérieur qui statue.
Article 11.Le président directeur général est civilement responsable envers l'Agence France-Presse des fauteslourdes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions. Sa responsabilité peut être mise encause par le président de la commission financière prévue à l'article 12 ci-après, exerçantjudiciairement à cette fin les actions de l'Agence France-Presse.
Article 12.Il est institué une commission financière de l'Agence France-Presse.Cette commission comprend deux membres de la cour des comptes désignés par le premier présidentdont l'un préside la commission et un expert désigné par le ministre des finances.La commission financière est saisie de l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses. Elleexamine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.Dans la négative, elle renvoie l'état au président directeur général qui provoque une nouvelledélibération du conseil d'administration en vue de la réalisation de cet équilibre.La commission financière est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financièrede l'Agence France-Presse.Elle dispose de tous pouvoirs d'investigation tant sur pièce que sur place. Elle adresse, tant auprésident directeur général qu'au conseil d'administration, toutes observations utiles sur la gestionfinancière.Si la commission financière constate que, malgré ses observations, le conseil d'administration n'a paspris toutes mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de l'agence, elle peut demander,après accord du conseil supérieur, la nomination d'un administrateur provisoire qui est désigné à larequête du président de la commission par le président du tribunal de commerce : il est alors procédé,dans le délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d'administration dans les conditionsfixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 17 de la présente loi.
La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès l'installation du nouveau conseil.La commission financière apure les comptes de l'Agence France-Presse.Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l'Agence France-Presse au conseild'administration, qui le porte à la connaissance du conseil supérieur.Elle peut attirer l'attention du conseil supérieur sur les faits constatés par elle et de nature à constituerune méconnaissance des obligations définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 13.Les ressources de l'Agence France-Presse sont constituées par le produit de la vente des documents etservices d'information à ses clients et par le revenu de ses biens.Les conditions de vente aux services publics de l'État sont déterminées par une convention entre l'Étatet l'Agence France-Presse ; cette convention fixe le nombre et le taux des abonnements souscrits parlesdits services, sur la base des tarifs appliqués aux entreprises de presse françaises.Elle peut être révisée en cas de variation du taux de conversion applicable aux taxes télégraphiques etradiotélégraphiques internationales.
Article 14.L'Agence France-Presse ne peut être dissoute que par une loi.
310
En cas de cessation des paiements constatée par le tribunal de commerce sur demande, soit du conseild'administration, soit de la commission financière, soit de créanciers, le Gouvernement doit saisir,dans le délai d'un mois, le Parlement d'un projet de loi tendant, soit à fixer les conditions danslesquelles l'Agence France-Presse pourra poursuivre son activité, soit à prononcer la dissolution del'agence et la liquidation de ses biens. Il peut être pourvu par décret en Conseil d' État àl'administration provisoire de l'Agence France-Presse jusqu'à l'intervention de la loi.
Article 15.Le tribunal de commerce peut prononcer à rencontre du président directeur général et des autresmembres du conseil d'administration les déchéances prévues à l'article 10 du décret du 8 août 1935portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de labanqueroute.
Article 16.L'ordonnance du 30 septembre 1944 portant création à titre provisoire de l'Agence France-Presse estabrogée.
Les locaux, installations, outillages et autres éléments d'actif mis à la disposition de cette agence parl'article 2 de l'ordonnance du 30 septembre 1944 ou acquis depuis par elle sont mis gratuitement à ladisposition de l'organisme créé par la présente loi, pour une durée de trois ans, renouvelable par décreten conseil des ministres, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le sort desdits biens par unedisposition législative.En ce qui concerne les immeubles en voie de construction destinés à l'Agence France-Presse, uneconvention entre l'Etat et la nouvelle agence réglera les conditions dans lesquelles ils pourront êtremis à la disposition de celle-ci ou lui être transférés.L'Agence France-Presse est, en outre, substituée d'une façon générale dans les droits et obligations del'organisme créé par l'ordonnance du 30 septembre 1944.Le transfert éventuel des biens et droits susvisés ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.Tous actes et conventions intervenant pour l'application du présent article sont exonérés du timbreainsi que des droits d'enregistrement et d'hypothèque.
Article 17.Un règlement d'administration publique fixera les conditions d'application de la présente loi.La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 janvier 1957.
René COTY.Par le Président de la République.Le président du conseil des ministres,GUY MOLLET.Le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice,FRANÇOIS MITTERRAND.Le ministre des affaires étrangères,CHRISTIAN PINEAU.Le ministre des affaires économiques et financières,PAUL RAMADIER.
Le ministre des affaires sociales,Ministre de la France d'outre-mer par intérim,ALBERT GAZIER.Le ministre des affaires sociales,ALBERT GAZIER.
311
DECRET N° 57-281 DU 9 MARS 1957
Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957portant statut de l'Agence France-Presse (1).(Journal officiel du 10 mars 1957,rectificatif J.O. du 20 mars 1957.)
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de l'information, du ministred'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre desaffaires économiques et financières, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des affairessociales, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget, Vu la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse, et notamment son article 17 auxtermes duquel « un règlement d'administration publique fixera les conditions d'application de laprésente loi » ;Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1ERConseil supérieur de l'Agence France-Presse.
Article 1er.La liste des membres du conseil supérieur de l'Agence France-Presse, désignés dans les conditionsfixées par l'article 4 de la loi du 10 janvier 1957, est publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.
Article 2.(Décret n° 65-616 du 22 juillet 1965, art. 1er). - « L'Office de radiodiffusion-télévision française estreprésenté au conseil supérieur par le président de son conseil d'administration ».
(1) Modifié par le décret n° 65-616 du 22 juillet 1965 (Journal officiel du 28 juillet 1965).
Article 3.Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si quatre aumoins de ses membres assistent à la séance.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du présidentest prépondérante.Le conseil supérieur établit son règlement intérieur qui peut notamment instituer une procédure devote à bulletin secret. Toutefois, en cas de partage des voix, le président fera connaître le sens de sonvote dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Les membres du conseil supérieur sonttenus au secret du vote.
Article 4.En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil supérieur peut délibérer sous laprésidence du magistrat désigné par la Cour de cassation qui a alors voix prépondérante.
Article 5.Le secrétaire général du conseil supérieur est choisi parmi les membres des juridictions de l'ordreadministratif ou de l'ordre judiciaire.
312
Le secrétaire général et les agents mis à sa disposition sont désignés par le président du conseilsupérieur.
Article 6.Les affaires soumises au conseil supérieur font l'objet d'un rapport. Le conseil supérieur désigne lesrapporteurs parmi ses membres ou, à titre exceptionnel, parmi les membres des juridictions de l'ordreadministratif ou de l'ordre judiciaire.Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil supérieur assistent avec voix consultative auxséances au cours desquelles leur rapport est discuté.
Article 7.Les dépenses du conseil supérieur sont à la charge de l'Agence France-Presse. Elles comprennent :Les indemnités ou vacations allouées au président, aux membres du conseil, aux rapporteurs, ausecrétaire général et aux agents du secrétariat, telles qu'elles sont fixées par arrêté du ministre chargédu budget ;Les indemnités pour frais de déplacement, telles qu'elles sont fixées pour le personnel de l'Etat dugroupe I ; Les dépenses de fonctionnement administratif et de matériel. L'état prévisionnel desdépenses est arrêté, pour chaque exercice, par le conseil supérieur, après avis de la commissionfinancière. Les états d'indemnités, de frais et de vacations sont certifiés exacts par le président duconseil supérieur et les dépenses correspondantes sont engagées par le président directeur général del'Agence France-Presse dans la limite des crédits ouverts par l'état prévisionnel.
CHAPITRE IIConseil d'administrationArticle 8.Les administrateurs doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits civils et politiques etn'avoir encouru aucune peine afflictive ou infamante.Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou au mandat duquel il est misfin par l'autorité qui l'a désigné doit être remplacé dans les trois mois.
Article 9.(Décret n° 65-616 du 22 juillet 1965, art. 2). - « Le ministre chargé de l'information nomme lesreprésentants de l'Office de radiodiffusion-télévision française au conseil d'administration del'Agence France-Presse sur proposition conjointe du président du conseil d'administration de l'officeet de son directeur général ».
Article 10.Le président du conseil des ministres, le ministre des affaires étrangères et le ministre des affaireséconomiques et financières choisissent leur représentant parmi les fonctionnaires, en activité deservice, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur civil de deuxième classe,ayant au moins trente ans d'âge ou huit ans de service et appartenant soit aux administrations placéessous leur autorité, soit aux grands corps de l'Etat.
Article 11.Pour l'élection de ses représentants, l'ensemble du personnel de l'Agence France-Presse, denationalité française, employé à temps complet depuis six mois au moins avant la date des élections,est réparti en deux collèges élisant chacun parmi ses membres un représentant et comprenant, lepremier, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle, le second, les agents des autrescatégories de personnel.Le vote a lieu par correspondance à bulletin secret au scrutin à un tour.Une décision du président directeur général de l'Agence France-Presse, soumise à l'approbation duconseil supérieur, fixe la date et l'organisation des élections.
Article 12.
313
Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article 12 de la loi du 10 janvier 1957, l'administrateurprovisoire fait procéder aux élections des représentants du personnel de l'agence et provoque ladésignation des autres membres du conseil d'administration.
Article 13.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'exige lefonctionnement de l'agence. Le président doit le convoquer si la demande en est faite par le quart aumoins de ses membres ou par le président de la commission financière.Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Aucun membrene peut toutefois disposer de plus d'une voix en sus de la sienne.La présence de huit membres au moins est nécessaire pour que le conseil d'administration puissedélibérer valablement. Si cette condition n'est pas remplie, le conseil d'administration est convoqué ànouveau dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours ni supérieur à dix jours. Dans cetteseconde réunion, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des présents, mais elles nepeuvent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première réunion.Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous, les délibérations sont prises à la majorité desmembres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par leprésident et par le secrétaire désigné par le conseil.
Article 14.Le conseil d'administration et investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'AgenceFrance-Presse, agir au nom de cette dernière, accomplir ou autoriser tous actes et opérations relatifs àson objet.Il a notamment les pouvoirs énumérés aux alinéas suivants qui sont énonciatifs et non limitatifs :1 ° Désignation du président directeur général et du vice-président ; fixation du statut du personneldans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 10 janvier 1957 ; nomination et révocation desdirecteurs de l'agence sur proposition du président directeur général ;2° Etablissement des états annuels de prévision des recettes et des dépenses, de l'inventaire, du bilan,du compte profits et pertes ;3° Fixation et modification des conditions générales de prestation des services d'information et devente et d'achat des documents, compte tenu, notamment, des dispositions prévues à l'article 13,alinéas 2 et 3, de la loi du 10 janvier 1957 ;4° Prises de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères constituées ou à constituer,dans le cadre de l'objet de l'agence et de ses obligations fondamentales ;5° Autorisation de prêts, avances, emprunts ;6° Etablissement de bureaux ou succursales partout où il est jugé nécessaire, et accomplissement desformalités requises par la législation des pays dans lesquels l'agence est appelée à exercer son activité
1° Achats, ventes, locations, échanges et aliénations de biens, meubles et immeubles, ainsi que retraits,transferts, conversions et aliénations de valeurs mobilières, inscription de toutes garanties mobilièresou immobilières sur les biens de l'agence ;8° Passation de tous contrats, traités et marchés ; exercice de toutes actions devant toutes juridictions,tant en demandant qu'en défendant, sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi du 10 janvier1957 ; autorisation de toutes transactions, compromis, désistements.Le conseil d'administration peut donner au président directeur général délégation permanente outemporaire pour exercer certains de ses pouvoirs, à l'exception de ceux visés aux 1° à 4° ci-dessus. Ence qui concerne les opérations visées au 5°, la délégation ne peut être donnée que pour des sommesinférieures au maximum fixé par décision du conseil d'administration approuvée par la commissionfinancière.Les décisions du conseil d'administration et du président directeur général, qui comportentengagement de dépenses, ne peuvent être prises que dans la limite des crédits correspondant auxdépenses de l'espèce prévues dans les états de prévision.
314
Article 15.Toute convention entre l'Agence France-Presse et l'un de ses administrateurs, soit directement ouindirectement, soit par personne interposée, doit être préalablement autorisée par le conseild'administration.Il en est de même pour les conventions entre l'Agence France-Presse et une autre entreprise si l'un desadministrateurs de l'agence est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur del'entreprise. L'administrateur se trouvant dans l'un des cas ainsi prévus est tenu d'en faire ladéclaration au conseil d'administration.Les conventions visées aux alinéas précédents doivent être approuvées par la commission financière.Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur lesopérations de l'Agence France-Presse avec ses clients.Il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprèsde l'Agence France-Presse, de se faire consentir par elle un découvert en.compte courant ouautrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
CHAPITRE IIIPrésident directeur général.Article 16.Le président directeur général est désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 10janvier 1957 par un vote à bulletin secret.Pour l'élection du président directeur général, le conseil d'administration se réunit à la diligence etsous la présidence de son doyen d'âge.Si au premier tour de scrutin aucun nom ne réunit les douze voix requises, il est procédé à un secondet, s'il y a lieu, à un troisième tour. Après chaque scrutin, le conseil d'administration décide que lescrutin suivant aura lieu immédiatement ou dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq jours.Dans les huit jours du troisième tour de scrutin négatif, le conseil supérieur propose au conseild'administration deux candidats. Il est alors procédé à l'élection du président directeur général à lamajorité relative des membres présents ou représentés.
Article 17.Le président directeur général assure, sous sa responsabilité, la direction générale de l'Agence France-Presse et représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Ilexerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par ce dernier. Il dirige l'ensemble des services del'agence. Il nomme et révoque les agents et propose au conseil d'administration la nomination ou larévocation des directeurs, dans les conditions prévues par le statut du personnel. Il dispose de lasignature sociale.Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, consentir des délégations de signature aux directeursou chefs de service de l'agence, pour les actes de la gestion courante.En cas d'absence ou d'empêchement du président directeur général, ses attributions sont exercées,dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 janvier 1957. Si leprésident est dans l'incapacité temporaire de donner délégation aux directeurs ou chefs de service del'agence, le conseil d'administration peut y procéder d'office.
CHAPITRE IVCommission financière.Article 18.La commission financière se réunit sur la convocation de son président. Si le président est empêché, ilest remplacé par l'autre membre de la commission appartenant à la Cour des comptes. La commissionfinancière ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres assistent à la séance. En cas departage, la voix du président est prépondérante.Des magistrats de la cour des comptes ou des experts comptables peuvent être adjoints à lacommission en qualité de rapporteurs.Un ou plusieurs agents du service juridique et technique de l'information sont, pour les travaux de
315
secrétariat, mis à la disposition du président de la commission financière.
Article 19.La commission financière établit son règlement intérieur qui précise notamment les conditions danslesquelles il est procédé à la vérification générale permanente de la gestion financière et à l'apurementdes comptes et donné aux administrateurs quitus de leur gestion.Article 20.Les dépenses de fonctionnement de la commission financière sont à la charge de l'Agence France-Presse.Elles comprennent Les indemnités ou vacations allouées au président, aux membres de la commission,aux rapporteurs et aux agents du secrétariat fixées dans les formes prévues à l'article 7 ci-dessus ;Les indemnités de déplacement telles qu'elles sont fixées pour le personnel de l'Etat du groupe I ;Les dépenses de fonctionnement administratif et de matériel.
CHAPITRE VGestion financière.Article 21.Les états de prévision de recettes et de dépenses sont établis pour la période allant du 1er janvier au31 décembre de chaque année. Les recettes, appréciées à partir des rentrées de l'exercice précédent,doivent permettre de couvrir les dépenses d'exploitation et d'équipement pour l'exercice, auxquelless'ajoute éventuellement le déficit de l'année précédente.Les états de prévision établis par le conseil d'administration sont transmis à la commission financièreau plus tard le 15 novembre précédant l'ouverture de l'exercice. La commission examine si ces étatsassurent un équilibre réel des recettes et des dépenses et dans la négative renvoie les états au présidentdirecteur général avant le 1er décembre. La nouvelle délibération du conseil d'administration doitintervenir dans les quinze jours qui suivent la réception par le président directeur général desobservations de la commission financière.Si au cours de l'exercice, il apparaît à la commission financière que l'équilibre entre les recettes et lesdépenses réalisé dans les états de prévision est rompu, elle peut demander au président directeurgénéral de convoquer le conseil d'administration, qui doit se réunir dans les quinze jours de cettedemande et prendre toutes mesures nécessaires.
Article 22.L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont établis et transmis à la commissionfinancière dans les six mois de la clôture de l'exercice.La commission financière se prononce dans l'année qui suit la clôture de l'exercice.
CHAPITRE VIDispositions transitoires.Article 23.Pour la constitution du premier conseil d'administration, un arrêté du ministre chargé de l'informationorganisera les élections des représentants du personnel de l'Agence France-Presse dans les conditionsprévues aux deux premiers alinéas de l'article 11 ci-dessus.
Article 24.Le premier exercice financier de l'Agence France-Presse comprendra le temps écoulé depuis ladésignation du président directeur général jusqu'au 31 décembre 1957.
Article 25.Le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, le ministre des affaires étrangères, leministre des affaires économiques et financières, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre desaffaires sociales, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de l'information, le secrétaire
316
d'Etat aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.
Fait à paris, le 9 mars 1957.GUY MOLLET.Par le président du conseil des ministres :Le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice,FRANÇOIS MITTERRAND.Le ministre des affaires étrangères,CHRISTIAN PINEAULe ministre des affaires économiques et financières,PAUL RAMADIER.Le ministre de la France d'outre-mer,GASTON DEFERRE.Le ministre des affaires sociales,ALBERT GAZIER.Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de l'information,GERARD JACQUET.Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,JEAN MASSON.Le secrétaire d'Etat au budget,JEAN FILIPPI.
DECRET N° 65-616 DU 22 JUILLET 1965
Modifiant le décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pourl'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse.
(Journal officiel du 28 juillet 1965.)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'information, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre desaffaires étrangères, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail ;
Vu la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse ;
Vu le décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'applicationde la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1er.
(Modifie l'article 2 du décret n° 57-281 du 9 mars 1957.)
317
Article 2.
(Modifie l'article 9 du décret n° 57-281 du 9 mars 1957.)
Article 3.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des financeset des affaires économiques, le ministre du travail, le ministre de l'information et le secrétaire d'Etat,au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publiéau Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 1965.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Premier ministre :Le ministre de l'information,ALAIN PEYREFFITTE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,JEAN FOYER.
Le ministre des affaires étrangères,MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du travail,GILBERT GRANDVAL.
Le secrétaire d'Etat au budget,ROBERT BOULIN.
PREMIER MINISTRE
DECRET N° 75-215 DU 4 AVRIL1 1975modifiant le décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pourl'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse.
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse.Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision ;Vu le décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'applicationde la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse, modifié par le décret n°65-616 du 22 juillet 1965;Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu.
Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 9 mars 1957 susvisé, modifié par l'article 1er du décret du 22 juillet1965 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
318
Article 2.
Le représentant du service public national de la radiodiffusion-télévision française au conseil supérieurde l'Agence France-Presse est nommé par le Premier ministre ou le ministre délégué à cet effet parmiles personnalités hautement qualifiées en matière de radiodiffusion et de télévision.
Art. 2. - L'article 9 du décret du 9 mars 1957 susvisé, modifié par l'article 2 du décret du 22 juillet1965 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 9.
Le Premier ministre ou le ministre délégué à cet effet nomme les représentants du service publicnational de la radiodiffusion-télévision française au conseil d'administration de l'Agence France-Presse après consultation des présidents des sociétés nationales de programme.
Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 1975.
JACQUES CHIRAC
319
2. Note Impact, Contrôle de la presse internationale, 29 mars 2005.
NOTE-IMPACT
Mardi 29 Mars 2005
CONTROLE DE LA PRESSE INTERNATIONALE
ASIE-SEISME
—En français : 3 AFP. 5 panachages AFP/concurrence.—En anglais : 7 AFP, 1 RTR. 2 panachages AFP/concurrence. 1 panachage concurrence.—En allemand : 2 panachages AFP/concurrence. 2 panachages concurrence.
RUSSIE-KIRGHIZSTAN
—En français : 1 AFP, 1 AP. 1 panachage AFP/concurrence.—En anglais : 8 AFP, 8 AP, 8 RTR. 2 panachages AFP/concurrence. 2 panachagesconcurrence.—En espagnol (reprises de la veille) : 1 AP. 1 panachage AFP/concurrence. 1 panachageconcurrence.—En allemand : 1 AFP, 1 DPA.
PROCHE-ORIENT
—En français : 3 AFP. 1 panachage AFP/concurrence.—En anglais : 13 AFP, 7 AP, 7 RTR. 1 panachage AFP/concurrence. 1 panachageconcurrence.—En espagnol (reprises de la veille) : 3 AFP, 2 EFE. 2 panachages AFP/concurrence. 1panachage concurrence.—En allemand : 1 AP. 1 panachage concurrence.
VATICAN-PAPE-SANTE
—En français : 4 AFP. 1 panachage AFP/concurrence.—En anglais : 6 RTR, 2 AFP, 2 AP.
320
—En espagnol (reprises de la veille) : 4 AFP, 1 AP. 1 panachage AFP/concurrence. 2panachages concurrence.—En allemand : 1 panachage concurrence.
NOTE-IMPACT
CONTROLE DE LA PRESSE INTERNATIONALE
=DETAILS=
ASIE-SEISME
—En français :
—Papiers de 300 à 500 mots :
- AFP/trois mois après le tsunami, alerte autour de l'Océan Indien/1 à Libreville ; unnouveau tremblement de terre sème la panique en Asie du Sud-Est/1 dans le Figaro.
—Papiers de moins de 300 mots :
- AFP/1 à Bruxelles.
—Panachages AFP/concurrence à La Haye (AFP/RTR : l'Indonésie à nouveau frappépar un séisme), Bruxelles (RTR/AP/AFP : un nouveau séisme crée la panique, AFP/AP :un nouveau séisme ravage l'île de Nias), Genève (AP/AFP : un violent séisme sème lapanique en Asie) et Athènes (AP/AFP : la terreur resurgit).
—Correspondances dans Libération (l'Indonésie tremble encore).
—En anglais :
—Papiers de 500 mots et plus :
- AFP/tsunami fears sweep across Asia/1 à Jobourg ; in Aceh, men prépare for lifewithout women/1 à Kuala Lumpur.
- AP/battered Aceh relives tsunami nightmare/1 à Jobourg ; major quake causes panic/1à Kuala Lumpur ; massive quake kills 300/1 dans Jordan Times à Amman.
—Papiers de moins de 300 mots :
321
- AFP/2 à Dubai.- RTR/1 à Dubai.
—Panachages AFP/concurrence à New Delhi (AFP/RTR : quake off Sumatra trigerstsunami fears) et Dubai (AFP/RTR : Asia on tsunami alert after Indonesia quake).
—Panachage concurrence à Hong Kong (RTR/AP : quake triggers fear across région).
—Agences non identifiées à Islamabad (massive quake sparks tsunami panic).
—Correspondances à Stockholm (new strong quake créâtes panic in South-East Asia)et dans l'IHT (big asian triggers panic, but no tsunami).
—En allemand :
—Panachages AFP/concurrence dans Berliner Zeitung (DPA/AP/AFP : la paniqueaprès l'alarme au tsunami) et Tagesspiegel (AFP/AP/DPA : panique après un nouveau razde marée en Asie du Sud-Est).
—Panachages concurrence à Vienne (RTR/DPA : new quake hits Sumatra) et dans laFAZ (DPA/AP : un nouveau raz de marée touche la région de Sumatra).
RUSSIE-KIRGHIZSTAN
—En français :
—Papiers de 500 mots et plus :
- AP/les vainqueurs affirment leur pouvoir/1 à Bruxelles.
—Papiers de 300 à 500 mots :
- AFP/le parlement confirme la nomination du premier minister intérimaire/1 àBruxelles.
—Panachage AFP/concurrence à La Haye (AFP/AP/RTR : Bakiev accepte le parlementen Kirghizstan).
—Correspondances dans le Figaro (Roza Otounbaïeva, le troisième homme de larévolution kirghize) et Libération (la révolution prend des allures de coup d'état).
—En anglais :
322
—Papiers de 500 mots et plus :
- AFP/Kyrgyz coup news filters through/1 à Hong Kong ; papier Coleman/revolt leavescountry région gasping/1 dans Jordan Times à Amman ; Uighurs hope for tolérance afterbazaar attack/1 à Dubai.
- AP/parliament vie for power after overthrow of leader/1 dans Jordan Times à Amman.- RTR/Akayev is still président-speaker, Kirghizstan plunges into deeper crisis/2 à
Islamabad.
—Papiers de 300 à 500 mots :
- AFP/mob orders Uighurs to go back to China/1 à Bangkok ; new news is good newsfor résidents/1 à Hong Kong ; was it the power of people or Kung fu ?/l à Dubai.
- RTR/asian state in turmoil/1 à Jobourg ; Bakiyev heads state for now/2 à Bangkok ;instigator of kyrgyz coup named as intérim PM/1 à Hong Kong ; new leader installée inKirghizstan/1 dans PIHT.
- AP/Bakiyev throws his weight behind new Kurgyz parliament, Kirghizstan rivalrycould allow ousted leader to regain power, new parliament légal, conflicts could giveAkayev foothold, radical islamism may be on rise amid political turmoil in Kirghizstan/5à Tokyo ; 2 parliaments vie for power in Kirghizstan/1 à Manille.
—Papiers de moins de 300 mots :
- AFP/1 à Manille, 1 à Kuala Lumpur.- AP/1 à Singapour.- RTR/1 à Dubai.
—Panachages AFP/concurrence à Tokyo (RTR/AP/AFP : new leader tries to endrivalry in Kirghizstan) et Dubai (AFP/RTR : Kyrgyz parliament cèdes power).
—Panachages concurrence à Sydney (AP/Times : leader moves to end Kyrgyz powerstruggle, RTR/AP : power wtruggle rages after people's révolution).
—Agences non identifiées à Taipeh (Kirghizstan's intérim leader backs newparliament).
—Correspondances à Stockholm (parliament agrées on new leader), Moscou (power inKirghizstan transfers to parliament elected by Akayev).
—En espagnol (reprises de la veille) :
—Papiers de 500 mots et plus :
- AP/se complica situacion en Kirghizstan/1 à Caracas.
323
—Panachage AFP/concurrence à Sao Paulo (RTR/DPA/AFP : dos disputan el poder etKirghizstan).
—Panachage concurrence à Caracas (ANSA/DPA : se complica situacion enKirghizstan).
—En allemand :
—Papiers de 300 à 500 mots :
- AFP/Akayev calls for end to reprisais against his followers/1 à Vienne.
—Papiers de moins de 300 mots :
- DPA/1 à Vienne.
PROCHE-ORIENT
—En français :
—Papiers de 300 à 500 mots :
- AFP/référendum sur le plan de retrait de Gaza : la Knesset contre, début du compte àrebours/1 à Abidjan ; Ariel Sharon franchit l'obstacle dressé par son propre parti, leréférendum contre le retrait de Gaza rejeté/2 à Genève.
—Panachage AFP/concurrence à Athènes (AP/AFP : les colons menacent de guerrecivile).
—Agences non identifiées dans le Figaro (plus aucun obstacle parlementaire au retraitde Gaza).
—En anglais :
—Papiers de 500 mots et plus :
- AFP/israeli MPs reject référendum proposai, Erakat calls for immédiate talks withIsrael/2 à Islamabad.
- AP/referendum over Gaza pullout rejected/1 à Tokyo.
—Papiers de 300 à 500 mots :
324
- AFP/damning report expected on Jérusalem land affair/1 à Beyrouth ; Israël vows tokeep biggest West Bank settlements/1 à Jobourg ; Gaza référendum plan shot down/1 àNew Delhi ; largest settlements will stay, Sharon says/1 à Bangkok ; Hamas ready to joinPLO say top leader, Palestinians seek resumption ot ties with Israel/2 à Dubai.
- RTR/Israel to defer withdrawal from 3rd West Bank town, Mourinho lends supportfor Mideast peace project/2 à Tokyo ; PLO may accept islamic Jihad, Hamas in its fold/1à Dubai.
- AP/soccer teams mix it up to promote Mideast peace/1 à Tokyo.
—Papiers de moins de 300 mots :
- AFP/1 à Stockholm, 1 à Jobourg, 1 à Hong Kong, 2 à Dubai.- RTR/1 à Singapour, 1 à Tokyo, 1 à Djakarta, 1 à Sydney.- AP/1 à Tokyo, 1 à Djakarta, 2 à Dubai, 1 dans l'IHT.
—Panachage AFP/concurrence à Beyrouth (AP/AFP : Palestinians urge immédiatepolitical négociations).
—Panachage concurrence à Dubai (AP/RTR : référendum on Gaza rejected).
—Correspondances à Moscou (none will any longer prevent sharov separating fromPalestinians) et dans Jordan Times à Amman (Knesset rejects pullout référendum).
—En espagnol (reprises de la veille) :
—Papiers de 500 mots et plus :
- EFE/Israelies y Palestinos unidos por la inusica/1 à Bogota.
—Papiers de 300 à 500 mots :
- AFP/Sharon asesta rêves a opositores a retirada de Gaza/1 à Caracas ; logra Sharonopositor/1 à Mexico.
—Papiers de moins de 300 mots :
- AFP/1 à Mexico.- EFE/1 à San José.
—Panachages AFP/concurrence à Sao Paulo (RTR/EFE/AFP : Sharon mantienemayoria y garantiza el retiro de Gaza) et Mexico (DPA/AFP : retrasa Israël la entrega deKalkiliya).
—Panachage concurrence à Sao Paulo (DPA/EFE : contrabando de armas lleva a Israëla postergar la entrega de ciudad).
325
T, , .
—En allemand :
—Papiers de 500 mots et plus :
- AP/Sharon seul à la tête du gouvernement/1 dans Tagesspiegel.
—Panachage concurrence dans la FAZ (DPA/AP : le parlement israélien s'oppose auréférendum sur le retrait de Gaza).
VATICAN-PAPE-SANTE
—En français :
—Papiers de 500 mots et plus :
- AFP/Jean Paul II trahi par son corps/1 à Genève.
—Papiers de 300 à 500 mots :
- AFP/le Pape rate complètement la fête de Pâques/1 à Bruxelles ; l'Eglise dans ledésarroi/1 à Genève.
—Papiers de moins de 300 mots :
- AFP/1 à Abidjan.
—Panachage AFP/concurrence à La Haye (AFP/AP/RTR : le Pape essaie de parler en
vain).
—En anglais :
—Papiers de 300 à 500 mots :- AFP/dramatic papal appearance raises concerns for Roman Catholic church/1 dans
Jordan Times à Amman ; Pope's health raises concerns for Catholic Church/l à Dubai.- RTR/Pope skips Easter blessing/1 à Islamabad.
—Papiers de moins de 300 mots :
- RTR/1 à Jobourg, 1 à Bangkok, 1 à Sydney, 1 à Hong Kong, 1 à Dubai.- AP/1 à Kuala Lumpur, 1 dans l'IHT.
—En espagnol (reprises de la veille) :
326
—Papiers de 500 mots et plus :
- AFP/bendicion sin palabras del Papa a sus fieles/1 à Bogota ; Papa da una bendicion;ilenciosa/l à Caracas ; el Papa no pronuncia la bendicion Urbi et Orbi por su precariaialud/1 à Asuncion.
—Papiers de 300 à 500 mots :
- AFP/dramatica aparicional Papa al cierre de la Semana Santa/1 à San José.
—Papiers de moins de 300 mots :
-AP/1 à Bogota.
—Panachage AFP/concurrence à Caracas (ANSA/DPA/AFP/EFE : el Papa impartio eniilencio la bendicion Urbi et Orbi).
—Panachages concurrence à Sao Paulo (AP/RTR/Times : bendicion del Papa-onmueve a la multitud) et Mexico (RTR/DPA : bendicion Urbi et Orbi en el Vaticano).
—Agences non identifiées à Quito (el Papa reaparecio pero su salud no ha mejorado).
—Correspondances à Santiago (silencioso, Papa conmovio al mundo).
—En allemand :
—Panachage concurrence dans Tagesspiegel (AP/DPA : le Pape reste muet).
-ALA
327
3. Notes Nicosie-Le Caire, 29 mars 2005, l lhlO.
note-LeCaire
NICOSIE - 29/03/05 - 1110 - attn hz/jmm: concurrence score aujourd'hui pratiquementpartout avec comme angle 'Brotherhood says over 230 arrested in Egypt', info que sauferreur n'avons pas eue. preneurs d'un follow-up sur la nervosité apparente des autorités àl'égard de ces mouvements de contestation inédits en Egypte, amts. Pad
328
4. Prévisions Sport, 19 juillet 2005.
3 ATD49 SPO FAF.NOT-NS.SPO S EMI 1907O5-10hl5 W0385
Prévisions-SportsA l'attention des rédactions
PARIS, 19 juil (AFP) - Prévisions Sports du MARDI 19 JUILLET
Cycli sme-ProTour-TDF-PRPAU
Tour de France - L'étape de mercredi Pau-RevelPRESENTATION 250 mots 15h00
Cycli sme-ProTour-TDF-MGPAU
Tour de France -MAGAZINE 5/600 mots 17h00
Cycli sme-ProTour-TDF-ECPAU
Tour de France - La gazetteECHOS 300 mots 17h00
Cyclisme-ProTour-TDF-CR-DC-MG-CO-ENPAU
Tour de France 2005 - 16e étape Mourenx - Pau, 180,5 kmCOMPTE RENDU 5/600 mots 18h30DECLARATIONS (vainqueur, maillot jaune, principaux acteurs)PORTRAIT du vainqueur 400 mots 19n00COMMENTAIRE 7/800 mots 20h00ENCADRE: les décisions officielles 20h00=(PHOTOS)=
Cycli sme-TDF-ProTour-Sport-MGPARIS
Tour de France - Saunier Duval , ou comment rentabil iser le Tour deFrance
Parrainer une équipe du Tour de France cycl iste, en 2005, permetaussi d'exploiter au maximum la notoriété de l'épreuve en termed'image, de marketing et de motivation interne, comme le montrel'exemple du chauffagiste Saunier Duval, pour sa premièreparticipation à la Grande Boucle.
MAGAZINE 600 mots TRANSMIS
FOOt-FRA-Ll-MGPARIS
Ligue 1 - Les t ro i s promus - Le Mans, Nancy et Troyes - vont devoirbata i l le r pour conserver leur place parmi l ' é l i t e avec des entraîneursqui n'ont jamais exercé en L l . Le handicap n 'es t - i l pas trop lourd ?
MAGAZINE 500 mots 14h00
FOOt-FRA-Ll-ENNANCY
ENCADRE: fiche de Nancy llhOO
FOOt-FRA-Ll-ENTROYES
ENCADRE: fiche de Troyes llhOO
FOOt-FRA-Ll-ENLE MANS
ENCADRE: fiche sur Le Mans llhOO
Natati on-MOND-CRMONTREAL
Mondiaux-2005 - Natation synchroniséeCOMPTE RENDU 300 mots 21h00, COMPTE RENDU ACTUALISE 4/600 mots
(nuit)=(PHOTOS)=
Natation-MOND-CRMONTREAL
329
5. Organigramme des filiales de l'AFP
AsiaSporI(en .cille)
ABN (infos
Agence France Presse(AFP)
Agence France Presse Ltd(AFP Ltd)
rabc)
DPA / AFX FranceAFX
BPL/AFXinformation{en veille)
AFP GmbHinfos en allemand
CompanyNew)
Diffusion
SID GmbH &KG
sports en allemandCosmos GmbHorganis. événements
sportifs
SIDBeteiligungs
Mccom GmbH
Fininfoinfos
linmclirai
67V. 1
i .i|'i[u .
99.1% | 50%
SidopiaSARL
33%
33.6 V.
iFilcas
Holding
Inédit
92.56%
330
6. Récapitulatif des attributs, Manuel de l'Agencier, 2004, page 69.
> Récapitulatif des attributs
HTTA1BUTE
Papier Je présentation
Lever de tiAe.iu
Papier général
Syntk&se
Synthèse i \\('ui.u riju<
Papier cf'éelajifagc
Papier d'ar«aiy*e
Papkr d'angle
Papier bilan
Compte- rendti
(Compte- rendu d'audience
Principaux points
Vc.itiariin
SntcrvU-w
Trois q<ie*riotu
Reportage
Récit
Bio (btographic)
Bia-longtic
biu portrait
Portrait
i'jitadrc
Viche de lecture
Mciie tccknitjuc
Magazine
filmCWm.otogk
tn bref
Rcroe Je presse
NOMME DE MOTS
600
3/400
600
600
6O0
600
600
600
600
600
600
600
40O i 800
Fii fonction du tœi<-
4/600
•il 50t.)
60;»
2/3Û0
300
4/600
4/600
6i)0
500
3/350
4/6O0
600
600
5/600
600
6/700
600
ANNOKCt
sj
g
M1
Rventucflcment
s'
-1
F,\cntucllemcn(
StSHt
Evei;rue;icrnent
F.veatucHrnienî
Eventurllcmcirt
EventucUcîtient
V
331
7. Audit des clients français de l'AFP, 2003.
Rappel général
Les résultats du sondage réalisé à l'automne 2003 par la rédaction en chef auprès desabonnés français (sept quotidiens PQR, les quotidiens parisiens, TF1, France 2 et France 3,
-trois radios), sont toujours d'actualité et doivent continuer à guider notre réflexion sur lecontenu de la copie.
Les attentes exprimées s'organisaient autour de quatre grands thèmes :
1/ Décryptage de l'infoL'essentiel, c'est la pédagogie, la clarté. Les clients veulent des encadrés, des fichestechniques, des chronos, et des papiers rédigés pour un lecteur "grand public", répondantaux questions: que faut-il comprendre? Ca change quoi dans la vie quotidienne?
Agnès Molinier (France 2) : « Nous avons surtout besoin de chronos, de dossiers, depapiers de background, quitte à repasser plusieurs fois les mêmes dès qu'un événementimportant survient. Il faut pouvoir mettre en perspective, ne pas avoir le nez sur l'événementsi on veut le rendre lisible »La Provence : >< L'info est de plus en plus compliquée, il faut la décrypter. Au niveau del'écriture, il faut viser le grand public et traduire la langue de bois des sources. La partiescience est bonne justement parce que vous faites cet effort de vulgarisation ».Chantai Danon (Le Progrès de Lyon) : « Nous apprécions tout ce qui est éclairage etanalyse, nous avons besoin de papiers qui donnent des repères, des mises enperspective. »
2/ "Sociétal"Dans la même veine, les abonnés apprécient que les sujets institutionnels ou d'actu soientdéclinés sur le mode "sociétal". Un constat assez général est que l'AFP est encore faibledans les secteurs qui touchent au "life style", qu'ils relèvent de la consommation, desnouveaux modes de vie, des nouvelles relations familiales, etc..
3/ Info sur les réglonsOn note également une demande d'info régionale accrue.Ouest-France : « A l'avenir, il me semble que la vie politique des régions devra être mieuxprise en compte. »Le Figaro : « L'AFP pourrait donner plus d'info des régions, nous sommes preneurs depapiers transversaux à l'occasion des élections locales»
4/ AnticipationLes journaux, rejoignant en cela certains services des télévisions, travaillent de plus en plusà J-2, préparent des pages froides sur des dossiers (style: l'événement de Libé). Ilsapprécient nos efforts d'anticipation, nos dossiers d'avant-papiers diffusés suffisamment àl'avance. Pour un événement classique, nous devons systématiquement diffuser l'avant-papier l'avant-veille, puis repasser un papier balai la veille et, si nécessaire, un lever derideau.
332
8. Rédaction en chef : notes rédactionnelles, Informations people12 janvier 2000, ASAP.
REDACTION EN CHEF : NOTES REDACTIONNELLES> Notes rédactionnelles permanentesT Informations "people"
Du 12/01/2000
PARIS, 12/01/99 - 1525 - Voici quelques principes rédactionnels concernant les informations "people", dontcertains clients sont friands.SUJETS: les personnalités de la scène, des arts, du sport, des médias, les "rayais", mais sans oublier leschefs des grandes entreprises et les dirigeants politiques, selon la nature des informations les concernant. Lessujets sont vastes: projets, déclarations, naissances, unions ou ruptures (sans tomber dans le graveleux), etc..VOLUME: faire court. Les clients radios cherchent des brèves pour alléger leurs journaux, la presse écrite desbrèves pour boucher les trous dans des maquettes de plus en plus rigides. Bien sûr, des infos de type peoplepeuvent parfois être développées et donner lieu à des papiers plus longs.SOURCES: le fait qu'il s'agisse de sujets légers ne signifie en rien qu'il faille prendre des libertés avec lesrègles d'agence. Les mêmes règles de fiabilité, de respect de la vie privée et de vigilance sur la diffamationdoivent s'appliquer.La source doit être identifiée, a fortiori s'il s'agit d'un autre média. Il n'est pas toujours possible d'obtenir desconfirmations. C'est vous, dans les bureaux, qui connaissez le crédit à apporter aux pages "people" de tel outel journal.En tout état de cause, il est préférable d'obtenir des infos originales.ECRITURE: il faut la soigner. Elle doit être vive : le "people" se satisfait mal des rapports de police.PHOTO : autant que possible, envoyer la nouvelle en lien avec le service photo de manière à founir aussi uneillustration au client.RAPPEL: le slug "people" doit figurer dans chaque dépêche, éventuellement décliné avec un autre mot-clé(par exemple USA-presse-people).Merci adresser toute question sur le traitement d'une information "people" à la rédaction en chef et au chef duservice Société, Frédéric Bichon.Amts. redchef Iba
333
9. AFP, Rapport, « Les priorités rédactionnelles de l'agence », 2000.
PARIS -22106100 -1600 -Voici une évaluation par la redchef des progrès accomplis depuis l'andernier dans la mise en oeuvre des priorités rédactionnelles de l'agence, et quelques pistes pourapprofondir le travail.
1/RENFORCER NOTRE CREDIBILITEA/ Les efforts de l'AFP pour améliorer l'intérêt, la précision et l'exactitude de ses informations sontfructueux et ont été remarqués par des clients, y compris les plus exigeants (cf récents commentairesdu New York Timesconsultables sur l'intranet). Nous devons poursuivre dans cette voie. Le document sur les sources -quidoit être remis à tout nouvel arrivant, en même temps que le manuel de l'agencier —est généralementbien suivi par les producteurs et les desks.Nous devons trouver une source identifiée, autant que possible. Nous devons rester très vigilants quantà l'utilisation de sources de seconde main et nous assurer que les citations que nous reproduisons sontcomplètes (phrases entières) et rigoureusement exactes.B/11 y a encore beaucoup à faire pour publier une copie propre. Trop de fautes d'orthographe et fautesde frappe se retrouvent sur le fil, avec des anglicismes en français et des gallicismes en anglais. Larelecture dans les bureaux et services, avant que la copie soit envoyée aux desks, doit être la règle. Lesdesks, surcharges, doivent absolument recevoir une copie propre des producteurs (a fortiori si la copieest urgente).Les desks de leur côté, outre l'indispensable relecture sur le fond, doivent s'assurer de la qualitéformelle de la copie servie aux clients et, le cas échéant, renvoyer au producteur une dépêche malrédigée.C/ Pour analyser notre couverture, la redchef travaille étroitement avec le service alerte et analyse àParis et en coordination avec les responsables rédactionnels des régions. Elle étudie en permanencenotre production et celle de la concurrence, de même que des sites internet de nouvelles. Les leçons àtirer, qui sont relevées dans les notes rédactionnelles régulières (consultables sur fil note et surintranet), sont appliquées dès que possible.D/ Sur l'harmonisation de la copie, il reste des efforts à faire entre le français, l'anglais et l'espagnol.Des différences d'angle peuvent bien sûr être nécessaires dans des dépêches destinées à des régions etdes
abonnés différents. Néanmoins, nous avons encore trop de divergences factuelles entre certaines
dépêches, y compris dans des urgents. De même, pour une histoire mondiale, l'angle principal doit être
traité de façon similaire dans les différentes langues.
Lorsqu'un desk conteste l'angle retenu par un producteur, la redchef régionale ou centrale doitimmédiatement être alertée pour que la couverture puisse être réexaminée et que le papier puisse le caséchéant être remanié par le producteur lui-même.Les responsables rédactionnels régionaux ont un rôle important à jouer sur ce plan, en suivant la copiedans toutes les langues et pas seulement dans la langue principale de leur région.
2/AMELIORER LES CONTENUS
AI Des progrès ont été accomplis pour servir aux clients des papiers principaux plus régulièrement sur
les dominantes mondiales ou régionales du jour. Il faut commencer le plus tôt possible dans lajournée
(pour les grands événements attendus, envoyer un overnighter la veille au soir). En français comme en
espagnol, nous sommes souvent lents à réactualiser les papiers principaux après un développement
334
majeur. Nous devons aussi soigner l'écriture. Les grands développements méritent une écriture
attentive, pour battre la concurrence qui s'efforce systématiquement de produire une copie bien écrite
sur les dominantes du jour.
Chaque fois que cela est possible, nous devons détacher un éditeur expérimenté pour relire les papiersprincipaux. Un bon papier journée n'est pas simplement un copié-collé d'histoires précédentes et dontle volume gonfle à chaque nouveau développement. Il doit être bien construit et soigneusement réécrit.
335
Producteu-s et deeos doivent veiller à ce que les nouveau* dêvelunjuinmits soient traites en factuel séparéayant d"ê!re in;orporé« dans un nouveau papier général. Ceci est important non seulement pour CB-tainsclients mais aussi oour les desks d'autres langues qui peuvent travailler avec votre copie. Sauf dans descirconstances temporaires al particulières, Ica journalistes ce l'AFP ne travaillant pas pour un seul servies delangue, mais pour toute l'AFP.
R' Un événement majeur doit être traité avec un bullotrt. même si l'événement éUil aiteneu. Simultanément,nous devons veiller ô ne pas avoir trop d'urgents consécutifs sur une même histoire, peur éviter unemultiplication d'urgents sur le fil. En cas de doute, rous conseillons de toujours privilégier la priorité supérieure(envoyez tn bulletin si vous tôGiiez entre un fcullotin et un urgent, un urgent si vuts hésitai entie ur P3 Bt unutgent).
d Nous réservons sncore tiop eouvent un traitement institutionnel aux avènements Institutionnels qui, avecun peu d'imagination, peurra ent être couverts de façon plus vivante. Par exenpie, II faut éviter fe focalifior tecouverture d'ure jojrnès électorale sur les conditions météo et les modalités du vote, pour n'arriver qu'aidixième paragraphe aux enjeux du ocmtin et aux candidats,N'oublons jamais la phrase expliquant pourquoi l'événement dani nous partons est digne d'être relaté. Ergénéral, elle dot être placée 1res lautdans la dépê;he.
D/ Nous devons veiller a bien anticiper les couvertures, en repérant où les troubles se profitent et en envoyantà 'emps les renforts nécessaires texte et p-ratoSi un événement majeur eurviont cane p'ivotïir, i- ne faut pas perdre oe temps et ~ voir comment cefâ vaévoluer ", mais dépêcher sans délai una équipe texte et photo II est très rare qu'une équipe revenne lesmains vicies. A finverse, si nous arrivons trop tard sur les lieux, il est difficile de rattraper le temps pejdu. SI unbureau n'a pas de moyens à ea diepooition, il doit contacter Immédiatement la iBjcIiHf régionale. En cas debesoin, des renforts peuvent aussi être envoyés de Paris.Nous avons eu aussi des exemples récents de bureaux fermant prématurément alors que des événementsimportants eo déroulaient dane leur zona do couverture. Dans u i tel oass, ta t'umfcu doit consulter la r6och©frégionale ou centrale avant de fermer.
E/ Los différente types de papiers à di'fuser sur une histoire mpûi tanlu sont connus. A part le papier principalet les différents angles qui peuvent être développés, un bureau couvrant un événement important dot sficoordonner aves la redehef pour que soient diffusés à ternis les pertraiis, ctironologiôs, îdies techniquas,papiers coUeur, anaysca et aynthâaes téactiorvs.
Quelle que soit la langue de travail, la longueur des papiers doit êTe au maximum de 600 mots pour tespapiers principaux, sauf oour des èvèiements mondiauK d'ampleur exceptionnelle. Les angles st reportagespeuvent avantageuGomctt ôtre limités à -400/500 mots. M est à iniiiaiquer que les impératifs du multimBdianous obligeit è être sncore plus esneis (sur un site wab. une histoire en 400 mots est déjà longue). Les rieskspejvent renvoyer un papier trop long au producteur, pou- rééDritute.Lss titres doivont ôtre oourta et préci3.
F/ Nous produi&sns de plus en plus de dépêches sur des sujets internet/santéfeocièté, mais la demande descliente sroit onooro plu3 vite. Malgré de gros efforts fournis par las bureaux si services, notre couverture del'imemet et de la haute technologie reste souvent insuffisante, avec fréquemment de grcs écarts anire régionset langues ce production. Pour faite face, il convient d'abord de renforcer notre réBeau, en mettant l'accent surune an^ôliorcitlon do la production au* CtcHs-Untà, uù iiuus sommes faibles Bn anglais.
G/Agendas : la région Europe a lancé l'an derner sur les fils un agenda quotidien qui fournit un excelent outilde travail pour l'AF!*1 commo pour ses clients. Il audiait l'étendre sous forma puoliable a l'Afrique et aux autresrégions qui ne le font pas encore.
H/ Plan3 de couverture : chaque bureau ou seivice couvrant un événement important doit envoyer â l'avanceà sa rédaetbn en chef régionale un plan de couverture détaillé. Copie peut aussi Mm p.nvnyée â la redehefcentrale-.Si ^événement est sifBsamenl impuTtait, te plan de couvertu'6 peut être diffuse sur le fS pour les clients, afinde leur expliquer ce cu'Hs peuvent attendre de l'AFP. Ne oas hésiter à snfrar flans las d^ails pour dire si rwiis
336
prévoyons bullstins ou urgents, à quefle heure nous prévoyons las Iftarts prinapaux et las reportages, etc.. Ala fin de la note, if Envient de mettre une plrase expliquait que ce plan de couvertue peut êire modifié enfonction do3 avènement».
» DEVELOPPER IA COORDINATION
La coopération est étroite entre la redehef centrale, les régions et le technique, e( la ooordination texte-photoest en train d'être renforcé*, la réclacliwn t?n chef â Parts organise des oontérenœs audio quotidiennes avecHong Kong, Neosifl, Washirtgton e! Morteviceo. est en contact parmanant avec l'Euraf et a une rencontrequotidienne avec les chofs das services de production parisiens.La noTiinotion d'un coordinateur écottonique International a aide a améliorer la coordination Les serviceséconomiques doivent identifier et produire des papiers grand public sur i«»s Avénarrenfe principaux pour les filogénéraux.
4/ AMELIORER LE RESEAU
Des progrès doivenl être faits pour améliorer le recrutement. En partiraifer, les affichages dos poetoo de statutrégional devraient être plus largement connus. La formation des nouvelles recrues doit être renforcée,
5/ECHOS DES CLIENTS
La redehel, les rédacteurs an coef régionaux et les chefs d« bureaux sont on contact régulier avec lesclients. Nous recueillons régulièrement dos réactions. Certaines sont disponibles sur l'intranet. Ladistribution doit cependant être améliorée,
6/CONSOLIDER LA REGIONALISATION
Los structuras rédactionnelles régionales (redchèf-réglonn-biifeauxj fonctionnent d'une manièregénérale correctement, avec un dialogue fréquent. Cependant, il y a encore des occasions où lesbureaux, voire la radchwf, court-clrcuitent les rédacteurs en chef régionaux sur des questionstouchant aux couvertures. Ceci ne peut pas subsister Sauf bien sûr en cae d'urgence, Ica seulscontacts directs court-circuitatv. une rocchef régionale doivent être limités à des questions routinièresd'un de&K k un producteur sur une dépêche, qui ne changeraient pas fondamentelemont la substancede l'histoire.Lea envoyés spéciaux doiv&nt prendre contact immédiatement (si possible avant leur départ) avec lebureau et le rédacteur en chat régional. Lors de la mission, le contact doit être maintenu enpermanence, y compris au moment de "ri
EWrt-BA/RecfchBf 22/06/00
Priorités rédactionnelles:CR des réunions des 30/09 et (Jl'io 1999
Voici une liste de six priorités qui ont été abordées au cours des réunions rédactionnelles organiséespar la direction de l'information et la rédaction en chef centrale les 30709 et 01/10 à Parts. Lesresponsables rédactionnels dn I'a0enc« sont appelée à «ouvrer à doa améliorations dans cesdomaines, Nous passerons en revue les progrès après six mois.
1/ Ronforeer fa crédtoilité
-L'exactitude de nos informations doit être la priorité des priorités, d'autant plus que l'AFP estparfois critiquée pour sa crédibilité. Cet impératif d'exactitude doit aller de pair avec l'exigencede rapidité (qui ne doit pas être confondue avec la précipitation). L'AFP tire d'abord et vérifie ensuite:
337
c'est la réputation à laquelle nous devons tordre le cou dans les mois qui viennent, en interne et enexterne.-Pour cela, il faut respecter les règles rédactionnelles et développer sans cesse les garde-fous. Enassurant une relecture systématique de la copie dans les services et les bureaux et en la matérialisantpar des initiales. En vérifiant et en faisant vérifier plutôt deux fois qu'une (quand nous diffusons uneinfo en citant un autre média, passer systématiquement un lead dès que la vérification aura pu êtrefaite). S'assurer que les infos sont correctement et rigoureusement sourcées. Bannir en particulierl'utilisation clandestine des sources secondaires. Inciter les correspondants à cultiver les sources et àconnaître leurs dossiers. Au desk, vérifier que les titres correspondent aux leads, que les leads sontétayés par des citations complètes et exactes et que 2 et 2 font 4. Veiller dès la production à ce qu'unecopie propre soit rédigée et servie aux clients, sans faute d'orthographe ni erreur grammaticale ni fautede frappe.-Développer l'analyse de nos couvertures à chaud et a posteriori. Veiller au suivi des erreurs qui noussont imputables, des ratages importants ou des retards significatifs. S'assurer que les enseignementssont bien tirés au niveau régional et, dans le cas où ces enseignements ont une valeur plus universelle,les faire connaître aux autres régions. A l'inverse, mettre aussi en relief nos succès.-Harmoniser nos fils. Faire attention à parler sur le même ton dans les différentes langues. Couvrir ladominante du jour en plusieurs langues.
2/ Améliorer les contenus-Privilégier la qualité sur la quantité. Réfléchir à ce que nous faisons, pourquoi, comment et pour qui.Faire plus court (factuels de 200 mots maxi, papiers de 600 mots maxi, voire moins). Toujours sortiren factuel les informations importantes avant de les intégrer dans un lead ou round-up. Rechercher lemeilleur angle. S'efforcer systématiquement et sans attendre d'expliquer l'événement et de le situerdans son contexte. Ecrire pour le lecteur et non pas pour la source. S'interroger sur la nécessité desmissions, la taille et la composition des équipes de couverture.-Donner la priorité au papier principal (trunk story). Il doit être complet et soigné. Il doit être bien écritet ne pas se contenter d'être un simple collage d'informations précédentes. Il doit être régulièrementactualisé.-Confectionner un service moins institutionnel. De même, couvrir de façon moins institutionnelle lessujets institutionnels. Développer les couvertures société, vie quotidienne, vie pratique, people, éco,sport, sciences et technologie. Faire plus d'interviews, de portraits, de reportages couleurs. Faire plusde papiers mondiaux.-Mieux anticiper. Développer les agendas. Signaler les événements méritant une couverture.Expliquer le cas échéant pourquoi ils sont importants. Dès que cela sera possible, mettre les agendassur Intranet. Les prévisions d'événements sportifs doivent figurer aux agendas hebdo et mensuels, aumême titre que les autres événements. Prendre l'habitude de faire des programmes de couverture pourles grands événements.-Améliorer la qualité de nos analyses servies aux clients. Constituer dans chaque région un réseaud'experts susceptibles d'être consultés et de s'exprimer sur les grands sujets d'actualité. Faire attentionà la qualité des experts.
3/ Développer la coordination-Renforcer les liens entre le texte, la photo et le technique et rechercher les synergies, au niveaurégional mais aussi dans chaque bureau. Harmoniser les slugs (nécessité pour le multimédia). Faireattention aux légendes photo.-Améliorer la coordination économique internationale. Mieux assurer les préparations de couvertureet le suivi'de la copie dans ce domaine. Idem pour l'information sportive internationale.-Penser multimédia. Image, infographie, voire son. Etre très vigilant sur la présentation de la copie et
338
4/ Améliorer la qualité du réseau
- Redoubler d'exigences on matière d'embauché.- Œuvrer à la formation permanente en région. Organiser des stages régionaux,
5/ Mieux connaître les attentes des clients
- Travailler plus étroitement avoc les services commerciaux, en région, dans chaque bureau. Organiserune coordination de façon à ce que les remarques des clients soient transmises aux responsablesrédactionnels concernés. Veiller atnssl à ce quo le» bonne» questions eolant pcsoea aux clisnts- Pour las régions ; rédiger un mémo mensuel pour la rédaction en chef centrale sur lesattentesibesoins/remarquos des clionts Ne pas hésiter à faire remonter entre-temps d'évontuaiiesremarques sur la couverture d'événements importants. Sollioitor cas remarques auprès <t«s clientsCultiver tes relations avec les médias locaux.
6/ Consolider la réoionalisatlon
- Développer la communication aveu te centre et ôntre régions. Faire urve nota cfuotldienno (styletél^orafihiqus) sur les questions de couverture. Aussi sur les envoyés spéciaux.- Etre flexibles : favoriser le recours aux mini d8sks et à la validation directe pour les grand*événements.- Les «nvnyés spéciaux d'uns région dans une autre région doivent veiller à prendre contactImmédiatement avec la rédaction en chef régionale et à transmettre leur copio aux desks régionaux. Lacopie des envoyés spéciaux doit passer par la région (veiller au respect systématique du vacte-mRMimdp l'onvnyA spécial).- En cas de déplacement d'une personnalité, chaque région (chaque bureau) doil veiller à Informer lesresponsables rédactionnels de l'endroit où elle se rend en envoyant une nota de quelques lignesdonnant IRA datas du voyage, un minimum de background sur l'importance du déplacement et dessuggestion» pour la couverture souhaitée.
339
10. Communiqué du collectif Femmes de l'AFP, 22 août 2005
COLLECTIP FEMMES ; PETITIONt> Les propositions du collectif fommes pour {'égalité professfonnelfo à l'AFPr Ce texte a été adopté à fa suite d'un voto pat- o-rnall : 146 voix pour, 12 contre et (J
abstentions
Ou î2«je;aoos
Fortes (l'une pétition signée à ce jour par 551 tommes journalistes de l'AFP et 86 de leurs collègues masculinspour dénoncer les inégoSiiès salariale» <?t tes dt^perilés d'évolution de carrière entre tes hommes ni leslemmes à l'Agence, los femmes journalistes ont décidé la création d'un Collectif femmes. Ce collectif aIdentifié une première aérlo de revendications en matière d'égalité professionnelle qu'il souhaita faire avancerà l'AFP, on coopération étroite avec les syndicats et la commission ad hoc du Comité ci"entrepose, «ans lecadre do négociations sur l'égalité professionnelle tel las que prévues pai la loi Ces revendications sont tessuivantes
1) obtenir de la direction de l'AFP qu'elle complète le» statistiques fournies depuis quelque» années surl*égalftè professionnelte nommes-femmes pat dos cttffres plus pertinente pour FAFP, Pour un rééquilibragesalarial, il est indispensable cfavoir communication de tous les salaires versés à l'étranger tant auxcollaborateurs ayant l© statut du siège» qu'aux locaux ou régionaux (et pas uniquement lias salaires derô(éfenci» parisiens retenus pour les journalistes ayant te statut du siège), ceux versés aux 25 grandsdirecteur!*, ainsi que le nombre de femmes figurant dans les 10 plus hauts salaires de l'agença (ce derniorchiffre est d'ores et déjà prévu p<3r la Joi mais non fourni â l'AFP)
2) un enuagemeul de la direction à mener une politique résolument volontariste en favour des famines. Cettepolitique), appelée à devenir un plan d'action à long terme, davra se traduire pat des résultats concrets e\quantiflables dont la direction devra rendre compte régulièrement devant te Comité d'entreprise. Les mesuresBouhatttws sont de deux ordres
- un rééquilibrage» hommes-femmes dans les postes do direollan/managernenl de l'agence. Le collectif aitterrtffiè quelque 130 postes à responsabilité au sein de l'agence tient tes femmes journalistes •sentglobalement exclues: iî s'agit d'unis vingtaine de directmirs parisiôns, cinq directeur régionaux Asie, AmrtOCd,Amsud, Proche Orient et Euraf, 12 rédacteurs en chef d Paris (central, France, photo centrale, photo Franceet photo Euraf, gmbh, afx et cinq rédacteurs en chef régionaux). t4 chefs de services, 16 chefs de des*. 3chefs de reportage. 4 responsables photo régionaux, 51 directeurs de bureaux fl l'étranger ayant le statut dusiège et 7 directeurs cfe bureaux de province.
Après le retour d'ici à la fin do l'été de plusieurs directrices de bureau à l'étranger nommées en 2001 et lesprises de fonction des deux femmes nommées depuis dêcamfcce, il n'y aura plus yu.e deux femmes directricesda bureaux étrangers (Lisbonne? et Kinshasa), trois femmes dlroclrices de bureaux d© province (Mais&ille,Bordeaux et StrashourQ), deux femmes chefs de service (social et vidéo), 3 femmes chefs de- desk et douxdirectrices (Paota Messaria et Anne Tavard). soit 13 femmes au total, cet qui «présent» à peine 10% despostes à responsabilité! (nous avons volontairement écarts les adjoints ainsi que tus directeurs de bureaux àalalut local, en l'absence d'Informations précises à leur sujet). Dans la mesure où les fammos de statut dusiiège représentent un tiers dos jourraJ&fës ayant plus de 20 ans d'ancienneté, il devrait y avou unequarantaine de femmes au total dans lee 130 postes à responsabilité retonus pour rétablir la situation, co quieit loin d'ëtra le cas.Pour faire ssutpr te plafond ae. verre et offrit des parcours professionnels similaires aux hommes et auxfemmes, lo collectif demande la mise en place négociée d'un calendrier d'application des objeclils fia part desfemmes occupant des pontes de direction devant augmenter gradueltennant pour passer à 20 % fin ZOOtî es30% fin ?008), assorti d'un suivi trimestriel pour taire le point de la situation avec la direction.
Le coli«ct»f exige égalâmes! ia p(us grande transparence dans tes nominations, qui jusqu'à présent étaientdécidées par un comité do rédaction entièrement masculin, dans la plus grande opacité, selon des critères âgéométrie variable, souvent définis ou redéfinis on fonction du candidat pressenti (et de fait choisi) bien avantrafficfaage d" poste. Le collectif ©sttrne que la multiplication des postes "fennés* ces dernière» années aconstitua un sérieux frein à la carrière professionnelle des fcmmiia journalistes al demandé qu'à l'avenir lesprofilfe recherchés pour tel ou tel poste (compétence linguistique notamment) soient définis êe maniera préciseet constante et qu'ils soient bien évidemment respectés. Le collectif considère en outre que la fin de l'arbitraireprofitera à tous les journalistes de l'AFPl! demanfle la nasse en p!sce d'un mécanisme da dmeussi-oo systématique avec un représentant de la dhacîian
340
nsultation des pages rage i or
avant et après les nominations, afin d'attirer l'attention sur les candidatures féminines et pour obtenir par lasuite des explications sur les choix effectués,
- des rattrapages salariaux par le biais des primes et promotions pour toutes celles qui ont le statut du siège etpar le biais des salaires pour les collaboratrices locales ou régionales. Le collectif tient à cet égard à rappelerque le mouvement concerne ces dernières au même titre que les journalistes de statut du siège.En ce qui concerne les journalistes ayant le statut du siège, le plan de carrière automatique jusqu'à la 4èmecatégorie, négocié par les syndicats, a permis de gommer les disparités les plus criantes en début de carrière,mais la situation se dégrade rapidement ensuite. D'après les chiffres fournis par la direction, les femmes sontsur-représentées dans les 4ème et 5ème catégories et sous-représentées dans les 7è et 8è catégories (62femmes et 76 hommes étaient à la 4ème catégorie, 86 femmes et 138 hommes à la 5ème ; 20 femmes et 77hommes à la 6ème, 2 femmes et 67 hommes à la 7ème et 1 femme et 32 hommes à la 8ème au 31 décembre2003, selon les derniers chiffres fournis par la direction,)Compte tenu de la situation, le collectif demande immédiatement un 2ème rattrapage dans les primes etpromotions 2005 en faveur des femmes. Les rattrapages devront se poursuivre au cours des prochainesannées jusqu'à ce que l'égalité professionnelle soit véritablement respectée.
3) relancer le dialogue avec la DRH sur les conditions de la mobilité et de l'expatriation à l'AFP, avec lacréation d'un comité ad hoc élargi (réunissant des journalistes hommes et femmes, la direction et lessyndicats) pour discuter de ces questions de mobilité/expatriation dans l'optique de la signature d'un accordspécifique avec la direction sur ce thème.Les discussions auront pour but de mettre à plat tous les problèmes qui se posent aux collaborateurs mutés àl'étranger ou en province. Bien que le sujet concerne tout autant les collaborateurs masculins, les nombreuxtémoignages recensés par le collectif ont souligné qu'il s'agissait d'un vrai sujet de préoccupation parmi lesfemmes journalistes qui sont de plus en plus nombreuses à postuler en province ou à l'étranger. Parmi lesprincipales demandes figurent :- la transparence dans la négociation des contrats à l'étranger avec le respect de grilles de salaires précises,tenant notamment compte des catégories et dès conditions familiales. Les grilles doivent être largementdiffusées, y compris sur ASAP et fournies avant qu'un candidat ne postule et non après, comme c'est le casaujourd'hui.- des aides spécifiques pour le conjoint e.t pour les enfants, selon leur âge, également définies selon unbarème précis, en tenant compte des conditions propres à chaque pays.Il pourrait s'agir de frais de gardepour les enfants en bas âge ou d'un dédommagement ou de frais d'études pour un conjoint qui suit sa familleexpatriée, mais également d'aides en cas de séparation des couples pour amortir les frais de double domicileet de déplacement.
- assistance de l'AFP à Paris et à l'étranger pour aider à obtenir des titres de séjour ou de travail pour lesconjoints- suppression de la règle non écrite qui empêche les couples de partir ensemble en poste ou de travaillerdans le même service.- prévoir un maximum de temps (six mois) entre la date de la nomination et la prise de fonction pour donner letemps au conjoint de prendre ses dispositions.
341
11. Communiqué du syndicat SNJ- AFP,vendredi 9 juillet 2004
Franco-anglo : Quelle "égalité des chances" ?
Le sort de la couverture francophone de l'Asie, symboliquement illustrée par la nominationd'un directeur anglophone dans un bureau important de la région, provoque un débat et unecertaine émotion au sein de la rédaction. Plusieurs textes (CGT, SDJ) y ont fait référence etune "pétition" impulsée par un groupe de journalistes anglophones occupant des postes-clé àtravers le monde a été lancée sous le titre "Non à la discrimination - l'égalité des chancespour tous à l'AFP".
Au total, 65 journalistes travaillant en anglais, un peu plus du quart des 237journalistes anglophones, toutes catégories confondues, que compte l'agence ont signé,rejoints par trois francophones.
Voici quelques extraits, traduits par nos soins puisque leurs auteurs n'ont pas jugé bond'en diffuser une version en français :
"Non à la discrimination - l'égalité des chances pour tous à l'AFP""Nous souhaitons exprimer notre déception suite à la polémique dirigée contre le service enanglais par certains de nos collègues français à cause d'une nomination récente. Larhétorique employée a été sur certains points insultante, souhaitant faire des anglophones descitoyens de deuxième zone à l'intérieur de l'AFP et suggérant que nous ne devrions être riend'autre qu'un service de traduction..."
"Nous avons travaillé dur et depuis longtemps pour être des partenaires égaux à l'intérieur del'AFP, et cela nous attriste de voir que des préjugés désuets et profonds ont la peau dure.Mais la question soulevée est beaucoup plus large. Est-ce que l'AFP va cautionner des appelsà une discrimination pure et simple sur le lieu de travail? L'avenir de l'AFP concerne tous lesservices au même degré, et nous serions favorables à un débat sur le rôle du service anglaisdans ce contexte. Mais nous avons besoin d'être assurés que nous ne subirons pas dediscrimination simplement à cause de notre langue de travail."
342
Il semble étrange de voir des journalistes anglophones s'inquiéter collectivement d'uneprétendue discrimination, alors que le service en anglais est celui dont l'avenir paraît leplus prometteur au sein de l'agence, autant en termes de clientèle qu'en termes depossibilités de carrière pour ses journalistes.
De plus, ce n'est pas tous les jours qu'un groupe important de salariés en appelle à ladirection - et à elle seule - contre un texte d'une organisation syndicale.
Malgré tout, ce texte, après ceux de la SDJ et de la CGT - c'est surtout ce dernier qui aprovoqué l'ire de certains anglophones - ouvre un débat essentiel. Voire deux : l'un surle statut de ce qu'on a l'habitude d'appeler les "services de langue", et notamment duservice anglais, et l'autre sur la sempiternelle question des nominations à l'AFP.
Nominations au mérite ou copinage ?
Le texte demande "que tous les postes et les promotions [soient] accordés sur la seulebase du mérite". On ne peut qu'être d'accord ; c'est d'ailleurs une revendicationconstante des syndicats à l'AFP depuis des années. La tâche n'est évidemment passimple et les syndicats s'interdisent les jugements de compétence dans leur défense dessalariés.
Néanmoins, on ne peut ignorer et rester indifférent devant certaines habitudesfâcheuses qui se sont établies au fil des ans en la matière :
Par exemple, décourager les candidatures à certains postes. Du style "Oh, ce n'est pasla peine de postuler à ce poste car tout le monde sait que c'est machin qui va l'avoir".Ou plus direct et individuel, lorsqu'on demande gentiment à tel ou tel, dont lesqualifications pour un poste seraient difficiles à contourner, de ne pas se portercandidat afin qu'un favori puisse être nommé sans provoquer trop de vagues dans lamaison.
D'autres phénomènes connus peuvent créer l'impression qu'il existe au sein de l'agenceun clan "d'élus" qui circulent aisément dans des sphères protégées, s'épaulantmutuellement, s'attribuant des promotions et des postes et excluant de fait d'autrescandidats dont la seule faute est de ne pas faire partie du cercle magique. Les syndicatssont souvent amenés à dénoncer les nominations "de poste à poste", sans passage parParis ou un autre centre régional. Nous sommes obligés, hélas, de constater que lenouveau chef de bureau dont il est question passe directement d'un poste à un autre.
Quelles que soient les "discriminations" dont peuvent souffrir telle ou telle catégoriede journalistes à l'AFP, rien ne nous indique que les nominations chez les anglophonessoient exemptes des phénomènes de copinage que nous constatons ailleurs.
Nombre de francophones s'étonnent d'ailleurs de voir certains confrères anglophonespoursuivre des carrières fulgurantes après seulement un poste de production, voireuniquement une ou deux expériences de desk. Autant dire que si l'on devait un jourfaire une comparaison des plans de carrière en fonction de la langue de travail, onrisquerait de trouver que, si discrimination il y a, elle n'est pas du tout dans le sensdénoncé par la "pétition anglophone".
343
Suite à la publication du texte en question, le SNJ a posé la question suivante à laDirection, lors de la réunion "DPJ" du jeudi 8 juillet :
"Merci de nous donner vos réactions à la pétition lancée par un certain nombre dejournalistes anglophones. Merci également de nous confirmer que la récente nomination auposte d'un chef de bureau en Asie s'est faite sur des critères uniquement professionnels, etqu'en particulier la Direction n'a demandé à personne de ne pas se porter candidat à ceposte."
344
La direction a bien sûr démenti avoir demandé à qui que ce soit de renoncer à postuler.Le Directeur de l'Info a insisté en substance sur l'unicité de l'AFP et la richesse de son"multilinguisme" qui garantissait son identité.
Une entreprise française multilingue
L'anglais a un statut de "langue de référence" dans le monde d'aujourd'hui, qu'on leveuille ou non. A l'AFP, il y a 20 ans, l'ensemble de la copie publiée en anglais étaittraduite du français, à l'exception de celle fournie par un correspondant anglophone auservice économique. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres de la Direction, le nombrede journalistes travaillant pour l'étranger (toutes catégories, desks plus correspondants)sont les suivants : 274 francophones, 237 anglos, 81 hispanos, 35 arabophones et 15lusophones. Les germanophones sont comptés par ailleurs. .
Mais quelle que soit l'importance de telle ou telle langue dans le monde et dans lastratégie commerciale de l'agence, l'AFP reste, jusqu'à nouvel ordre, une entreprisefrançaise, et la seule agence de presse non anglo-saxonne dans le monde. Toutes lesdécisions concernant son développement sont prises par des Français, et le marchéfrancophone (l'État y compris) fournit environ les deux tiers de son chiffre d'affaires.Le poids spécifique du service francophone est donc déterminant au sein de l'AFP, etce n'est pas forcément faire preuve de nationalisme borné que de le constater.
On peut donc considérer comme légitime l'idée qu'un chef de bureau - c'est-à-direnotre représentant officiel dans un pays - doive, d'une manière ou une autre, refléterl'identité de l'agence. Il n'est donc pas aberrant qu'on exige de lui la connaissance dufrançais, comme on exige des francophones une connaissance de l'anglais. Maislorsqu'on entend un membre éminent de la rédaction affirmer que pour être chef debureau dans tel pays du Commonwealth il faut également savoir "parler cricket", onpeut se demander où l'on va.
Plus généralement, la maîtrise de la langue française doit être considérée comme unélément constitutif de l'identité de l'AFP et de la cohérence de sa copie, tout comme lalangue anglaise est indispensable pour des raisons pratiques. Si on peut comprendreque bon nombre d'employés locaux dans diverses régions du monde ne puissent pasapprendre le français, un niveau minimum est souhaitable pour l'ensemble desjournalistes statut siège et futur statut régional.
Le SNJ veille au respect des droits des salariés, sans distinction de race, sexe, statut,lieu ou langue de travail. A ce titre, nous nous préoccupons de la cohésion des salariésau sein de l'agence. C'est un point capital, non seulement pour l'entreprise maiségalement pour l'accomplissement de notre travail syndical.
Le texte publié par certains anglophones - adressé, comme nous l'avons déjà noté, à laseule Direction et rédigé dans une seule langue - confirme de manière éclatante quepour certains de nos collègues, l'AFP est vécue comme un conglomérat de"communautés", plutôt que comme un ensemble organique et indivisible. Sur le plansocial, cela peut, hélas, se comprendre. Le moins qu'on puisse dire est que l'AFPmanque d'outils de communication internes performants, ce qui fait que bon nombrede salariés se sentent isolés, ne connaissant que des relations de proximité.L'incapacité des directions successives à élaborer une politique linguistique cohérente,et l'embauche d'un nombre toujours plus important de journalistes qui ne parlent pas
345
un mot de français, notamment dans certaines régions, ne peuvent qu'encourager cettetendance au "communautarisme".
Sur le plan rédactionnel, et en ce qui concerne le service anglais en particulier, cecommunautarisme comporte un aspect encore plus troublant : l'idée assez répandueselon laquelle l'AFP devrait laisser se développer un service international en anglaisquasi autonome, et même laisser doucement péricliter le service en français au pointde faire de lui une simple agence "nationale". D'ailleurs on constate déjà, dans letravail de tous les jours, que le service anglais s'affranchit souvent de la rédaction enchef, passant ses propres notes de service sans réelle coordination. Sans parler des trèsnombreux papiers écrits en français et qui ne sont jamais publiés en anglais - et pastoujours faute de moyens.
Il va de soi que personne n'est en train de suggérer que le service anglais ne devraits'occuper que de l'adaptation en anglais de papiers écrits en français. Une telle idéeserait absurde et les chiffres le montrent. Nous savons également que ces problèmesexistent entre toutes les langues de travail de l'agence - bon nombre de papiers écritsen anglais ne sont pas utilisés en français, beaucoup de dépêches rédigées en espagnolne sont jamais traduites dans une quelconque autre langue, et ainsi de suite. La"traduction" et l'adaptation font forcément partie de notre mission, sous peine de voirl'agence perdre son unicité et donc son identité.
Une AFP qui ne serait qu'un assemblage de réseaux semi-autonomes par langue estinconcevable pour au moins deux raisons :
Premièrement, parce que cela impliquerait un gâchis énorme en termes de ressources.Plus notre agence deviendra multi langues, plus nous devons être amenés à exploiter, pour lebien du service dans son ensemble, les ressources fournies par tous les journalistestravaillant dans ces différentes langues.
Deuxièmement parce que la notion de "culture d'entreprise" a un sens, surtout pourune entreprise de presse. Sans entrer dans la question complexe de savoir s'il existe unespécificité du journalisme "à la française" par rapport à une hypothétique essence "anglo-saxonne", un journalisme qui fonctionne en vase clos à l'intérieur d'une culture ou d'unmilieu donné est forcément beaucoup moins riche qu'un travail qui résulte de multiplesconfrontations, d'échanges, et disons-le, de traductions.
346
Quant à l'idée selon laquelle l'anglais devrait devenir la langue de travail dominante del'agence au niveau international, elle se heurte à une objection bêtement pratique : onne voit pas au nom de quoi une Direction et un conseil d'administration français, sansparler des acteurs sociaux français, soutiendraient à terme une entreprise qui n'offriraitplus aucun débouché important à des francophones !La fourniture d'un servicemondial en langue française, fabriqué par des correspondants dans le monde entier,fait partie de la mission de base de l'AFP. Il n'est tout simplement pas acceptable devoir le réseau de correspondants francophones en Asie, par exemple se réduire commeune peau de chagrin, pour être remplacé par des services de traduction de la copieanglaise fonctionnant, tant bien que mal, à Paris.Or c'était ce problème-là, et non pas laseule nomination d'un chef de bureau anglophone, qui motivait les récents textes de laSociété des Journalistes et de la CGT journalistes. Détourner ce débat essentiel etjustifié pour en faire un casus belli à propos d'un seul poste relève de la mauvaise foi.
Pour en finir avec le communautarisme
L'AFP est la seule agence de presse mondiale à ne pas avoir l'anglais comme languematernelle. Le fait d'avoir de ce fait plus d'une seule "langue principale" devrait êtrepour elle une source de richesse.
Au moment où nous nous apprêtons à négocier un statut régional qui bénéficierasurtout aux journalistes travaillant dans les langues autres que le français, il est grandtemps de mettre fin aux phénomènes de ghettoïsation à l'AFP. Sur ce point, lesjournalistes anglophones pourraient jouer un rôle important, en comprenant qu'ils neforment pas une communauté à part. Il peut y avoir plus d'intérêts communs entre unCDD anglophone et un CDD francophone, hispanophone ou autre qu'entre ce mêmeCDD et un journaliste qui se trouve parler la même langue que lui, mais occupe unefonction tout autre ou a su s'adapter à une coterie de copains !
347
Annexes C - Outils de recherche
1. Formulaire de consentement
Les transformations du journalisme : le cas des journalistes de l'Agence France Presse
Cette recherche s'effectue dans le cadre du projet de doctorat de Mme Camille Laville sous la
direction de Messieurs Armand Mattelart (de l'Université de Paris 8) et Jean Charron (de
l'Université Laval, à Québec). La nature et les procédés de la recherche se définissent comme
suit :
La recherche a pour but d'étudier les changements des pratiques et de l'identité de
journalistes de l'Agence France Presse exerçant ou ayant exercé la profession de journaliste
à l'étranger.
1. Les entrevues réalisées dans le cadre de cette recherche visent à recueillir le point de
vue d'une cinquantaine de journalistes sur différents aspects de leur métier.
2. Les entrevues font l'objet d'un enregistrement audio et durent en moyenne une heure
trente minutes.
348
3. Chaque participant(e) peut mettre fin à l'entrevue en tout temps, sans avoir à fournir
de raison, ni à subir de préjudice quelconque.
4. Les propos recueillis lors de ces entrevues pourront être cités dans des rapports de
recherche ou des articles scientifiques produits par la chercheuse ; celle-ci s'engage
à respecter en tout temps l'anonymat des répondants. Les enregistrements audio
seront détruits à la fin du mémoire, et les verbatims conservés sous forme anonymisee.
Les données de cette recherche ne pourront être accessibles à d'autres chercheurs que
sous une forme anonyme.
5. Pour garantir la confidentialité des personnes interviewées, les mesures suivantes
sont prévues :
- Les noms des personnes n'apparaîtront sur aucun document ;
- Les personnes seront identifiées par un code ; seule la chercheuse aura accès à
la liste des noms correspondants aux codes.
- Les propos des journalistes ne seront jamais versés à leurs dossiers
d'employés.
6. Un résumé des résultats de la recherche pourra être transmis aux participantes qui en
feront la demande.
349
Toute question concernant le projet pourra être adressée à la chercheuse (Camille Laville, résidenceJean Sarrailh, ch 757, 39 avenue Georges Bernanos, 75231 Paris cedex 05).Toute plainte ou critiquepourra être adressée au Bureau de l'ombudsman de l'Université Laval à l'adresse suivante : PavillonAlphonse Desjardins, Bureau 3320, Renseignements- Secrétariat : 656-3081
Télécopieur : 656-3846Courriel : ombuds(a),ombuds.ulaval.ca
Je soussigné(e) consens librement à participer à la rechercheintitulée : «Analyse des changements des pratiques et de l'identité des journalistes au coursdes cinquante dernières années : le cas des journalistes de l'Agence France Presse exerçant àl'étranger ».
Signature du (de la) participant(e) Date
Signature du (de la ) chercheur(e) Date
No d'approbation 2004-196 du CERUL et date d'approbation : 21 octobre 2004.
350
2.Questionnaire
Entourez la réponse correspondante :
• Tout à faitd'accord
1
• Plutôtd'accord
2
•Plutôten désaccord
3
• Tout à faiten désaccord
4
- Le rôle de l'agencier consiste moins à collecter activement de l'information qu'à
sélectionner et traiter celle qu'on lui fait parvenir.
- Les grands réseaux de télévision et d'information continue auront tôt fait de remplacer lesagences de presse internationales.
1 2 3 4
- La formation par les écoles de journalisme permet une meilleure intégration d'un journalistelors de son entrée à l'AFP
1 2 3 4
- L'information est un produit commercial comme un autre.
1 2 3 4
- Le rôle d'une agence de presse comme l'AFP n'est pas différent aujourd'hui de ce qu'ilétait il y a trente ou quarante ans
1 2 3 4
351
- Les thématiques de société ont pris une place plus importante qu'autrefois dans les papiersd'agence
1 2 3 4
- Le travail d'un agencier en poste à l'étranger et celui d'un correspondant d'un autre média
sont tout à fait similaires.
1 2 3 4
- Aujourd'hui, du point de vue du journaliste intéresser et divertir compte autant qu'informer.
1 2 3 4
- Le correspondant agencier est davantage sédentaire qu'il y a 15 ou 20 ans.
1 2 3 4
- Le rôle de l'agencier est de rapporter les faits, c'est aux journalistes des médias qu'ilappartient de les commenter et de les expliquer.
1 2 3 4
- L'économie est devenue une thématique plus importante que la politique.
1 2 3 4
- La situation économique (salaire, sécurité d'emploi, statut) d'un correspondant étranger estplus précaire qu'il y a 15 ans.
1 2 3 4
- L'initiative personnelle du correspondant étranger agencier dans le choix des sujets estmoins importante aujourd'hui.
1 2 3 4
- Les agenciers traitent aujourd'hui d'une plus grande variété de sujets qu'autrefois.
1 2 3 4
- Je préfère travailler à l'AFP que dans une autre entreprise de presse.
1 2 3 4
- Il existe une forte solidarité entre les journalistes expérimentés et les nouveaux venus.
1 2 3 4
- Si on a exercé la fonction d'agencier, on peut exercer sans difficulté la fonction dejournaliste dans un autre média.
352