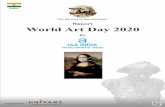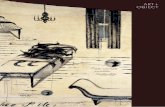L'AUTOMATISME SURREALISTE, Un art né de la révolte
Transcript of L'AUTOMATISME SURREALISTE, Un art né de la révolte
CHANTALE PILON
L'AUTOMATISME SURREALISTEUn art né de la révolte
Mémoire présenté
à la Faculté des études supérieures de l'Université Lavaldans le cadre du programme de maîtrise en Histoire de l'art
pour l'obtention du grade de maître es arts (M.A.)
DEPARTEMENT D'HISTOIRE DE L'ARTFACULTÉ DES LETTRES
UNIVERSITÉ LAVALQUÉBEC
2007
Chantale Pilon, 2007
RÉSUMÉ
Le surréalisme fondé par André Breton est traversé par une
résolution, celle de « changer la vie ». Ce dessein d'agir
sur les conditions sociales de l'existence est solidaire
d'une époque blessée par la Grande Guerre. Le conflit a
permis de mettre en lumière une imposture sociale qui
commanda, selon le regard du penseur, une révolution
mentale conjointe avec une révolution des mœurs. Désaliéner
l'homme, élargir ses horizons et partir à la conquête de la
vie réelle, voilà les visées qui animent le surréalisme de
1924. Nous avons tenté de saisir les ressorts qui ont amené
André Breton à contester, aussi radicalement, l'usage
occidental de la raison. Il s'agit de saisir les motifs qui
l'ont amené à instruire le procès d'une attitude en plaçant
sa foi dans l'automatisme.
II
Avant-propos
Je tiens d'abord à remercier mon directeur, monsieur
Elliott Moore, pour ses conseils avisés, son tact, sa
diligence. Milles reconnaissances pour m'avoir ouvert les
portes du Surréalisme. Et messieurs Marc Grignon et Louis
Lefrançois, pour leur présence bienveillante. Chers
Professeurs, pour ce que vous avez semé, voire même parfois
à votre insu, pour votre soutien, votre présence et votre
exemple, pour tous ces présents désintéressés qui
témoignent de votre noblesse, je tiens d'emblée à vous
remercier.
Merci aussi à ma famille et à mes amis qui m'ont appuyée
dans cette démarche et enfin, à ma fille Charlotte, dont le
sourire m'a si souvent inspiré le courage.
III
Table des matières
Résumé I
Avant-propos II
Table de s ma t i è r e s III
Introduction p. 1
1. André Breton catapulté dans l'abîme, le printemps
désolé d'un visionnaire p. 8
1.1. La conscription ou la déflagration du pouvoir p.9
1.2 Le fracas...Nantes 1915/août 1916 p. 11
1.2.1 Stupeur et désabusement p. 12
1.2.2 La poésie contre la déréliction p. 15
1.2.2.1 Arthur Rimbaud p. 16
1.2.2.2 Le nihilisme, entre Jacques Vaché et M. Teste...p.l9
1.2.2.3 Lier connaissance avec le
« lyrisme en personne » p.22
2. Saint-Dizier juillet à novembre 1916, la pagée entre
le réel et 1' éventuel p. 26
2.1 L'expérience psychiatrique ou les affres de la
folie p. 27
2.2 L'éclairement de la psychanalyse p. 34
2.3 Le désenchantement à l'égard du discours
psychiatrique p. 37
2.4 Le cas de Saint-Dizier et le tressautement de la
pensée p. 50
2.4.1 Su j e t p. 51
IV
2.4.2 Le Mal du temps : un patriotisme insane p. 53
2.4.3 La lueur crépusculaire d'un monde nouveau p.57
2.5 Le brasier de la guerre, l'embrasement du réel p.59
2.5.1 La guerre d'André Breton p. 59
2.5.2 La Chienlit p. 61
3. Le retour à Paris :De la radlcalîsatxon de la révolte
aux prémices de la quête. p. 69
3.1 Babinski et la médecine p. 69
3.1.2 Censure et trahison p. 71
3.2 Les rencontres de Philippe Soupault et de
Louis Aragon p. 7 4
3.3 Clore la Guerre au bras de la désespérance p.81
3.3.1 Littérature p. 82
3.3.2 L'acte de sédition envers l'attitude réaliste p.84
4. Les Champs Magnétiques p. 94
4 .1 Le faire p. 94
4.2 Le livre par lequel tout commence p. 112
5. Les linéaments du dessein p. 119
5.1 Au large du verbe p. 120
5.2 L'appas de la psychanalyse p. 126
5.3 L' émoi p .128
5 . 4 Les Médiums p. 130
5.5 Différences d'avec la théorie freudienne p. 131
5 . 6 Le narcissisme p. 132
5.7 La muse p. 133
V
5. 8 La surréalité p. 135
6. Les pierres d'achoppement p .139
6.1 Les écueils du psyché p. 139
6.1.1 L' inconscient p. 140
6.1.2 Désintégration, réintégration et rôle de la
conscience p. 141
6.1.3 Écriture infraliminaire ? p. 143
6.1.4 Ego p .144
6.2 Écriture automatique et déraison, une polémique avec
Antonin Artaud p .145
6.2.1 La schizophrénie et l'impuissance littéraire p.14 6
6.2.2 1924, l'automatisme au cœur du surréalisme, à nul
autre second p .151
7. L'horizon pictural de l'automatisme :André Masson, une
œuvre sous le sceau du Pandémonium. p. 158
7.1 Le kaléidoscope p. 159
7.2 Le renversement, de la désaffection à la
magnanimité p. 164
7.3 Les cendres de la guerre p. 168
7.3.1 Question de traumatisme ? p. 171
7.3.2 Considérations supplémentaire sur le
t rauma t i sme p .17 5
7.3.3 Un créateur tourmenté p. 178
8. Le retour d'un éclopé sur le chemin de la
création p. 184
8.1 L'époque des forêts p. 184
8.2 Le dessin automatique p. 191
8.3 Le faire automatique p. 200
VI
8.3.1 L'automatisme, une dictée inconsciente ? p.204
8.3.2 Mise en regard avec le phénomène élémentaire p.206
8.3.3 L'automatisme et le rêve p. 212
8.4 Les tableaux de sable (1927) p.216
8.5 Le désir de communication p. 221
8.6 Les traverses de l'automatisme pictural p.227
Conclusion : L'injonction d'André Masson p. 233
Table des Illustrations p.24 3
Bibliographie p. 24 7
INTRODUCTION
La définition que donne André Breton du mot
« surréalisme » dans le Manifeste du surréalisme de 1924
se lit comme suit :
: n.m. Automatisme psychique pur par lequelon se propose d'exprimer, soit verbalement,soit par écrit, soit de toute autremanière, le fonctionnement réel de lapensée. Dictée de la pensée, en l'absencede tout contrôle exercé par la raison, endehors de toute préoccupation esthétique oumorale.
ENCYCL.PHILOS, le surréalisme repose sur lacroyance à la réalité supérieure decertaines formes d'associations négligéesjusqu'à lui, à la toute-puissance du rêve,au jeu désintéressé de la pensée. Il tend àruiner définitivement tous les autresmécanismes psychiques et à se substituer àeux dans la résolution des principauxproblèmes de la vie »1
Cette définition, à formulation classique, a connu une
immense popularité, depuis sa première publication en
1924. Or, si nous la citons ici, c'est qu'elle possède,
à nos yeux, un triple intérêt.
Tout d'abord, elle est une définition du mouvement, et,
puisqu'elle est définition, elle s'efforce de présenter
l'ensemble des propositions qui donnent accès à la
compréhension de ce concept. Elle détermine la structure
sur laquelle André Breton érige sa théorie de
1 André Breton, Manifestes du surréalisme, p.36
l'expérience esthétique. Elle est l'aube qui ouvre
l'horizon du surréalisme.
Deuxièmement, André Breton y présente le surréalisme
comme un dispositif de connaissance qui se sert de la
production artistique pour accéder à une réalité
supérieure, à l'absolu, enfin, à cet état spirituel de
l'expérience qui ne comporte ni restriction, ni réserve,
ni limite.
Troisièmement, cette définition s'appuie principalement
sur l'automatisme. André Breton définit le surréalisme
en se référant directement à l'écriture automatique.
Cette recherche de l'action inconsciente, loin d'être
accessoire, devient l'un des principes cardinaux de
l'action surréaliste. Plus encore, elle est mère du
surréalisme. C'est à partir de cette découverte que
naitra le mouvement.
Dès lors, nous sommes à même de nous demander ce qui a
amené André Breton à privilégier l'automatisme et à
l'ériger au rang d'une stratégie dans sa lutte pour une
nouvelle epistemologie. André Breton émet la possibilité
que ce qu' il appelle « le peu de réalité », auquel il
estime confronter la société de son époque, soit soumis
à la critique par la capacité d'énonciation. Il se
penche alors sur le problème du langage, mais il le fait
en conjoignant des approches scientifiques et
littéraires. Consequemment, la découverte de
l'automatisme en 1919, par André Breton et Philippe
Soupault, se présente comme une irruption
épistémologique sans précédents. Elle redéfinit le monde
intérieur par la prise en compte de pouvoirs
insoupçonnés. Breton y voit une solution poétique
permettant de décontaminer la potentialité de l'être de
la déconfiture de la raison occidentale. Ce n'est donc
pas sous le coup de la fortune que Louis Aragon présente
Les Champs Magnétiques comme : « le moment où tourne
toute l'histoire de l'écriture, non point le livre par
quoi voulait Stéphane Mallarmé que finit le monde, mais
celui par quoi tout commence. »2 Aragon énonce en fait
très justement le résonnement inhérent à la découverte
de l'écriture automatique.
En l'occurrence, l'analyse que nous entendons mener
portera sur l'automatisme surréaliste. De son propre
aveu, André Breton désirait mettre « en jeu l'existence
terrestre en la chargeant cependant de tout ce qu'elle
comporte en deçà et au-delà des limites qu'on a coutume
de lui assigner »3. Cet énoncé pour le moins sonore a
capté notre attention. D'emblée, nous nous sommes
intéressés à ces « limites qu'on a coutume de lui
assigner ». Il semble, en effet, que le surréalisme soit
une réponse à l'assujettissement de l'être, en fait foi
le procès intenté contre l'attitude réaliste.
À cet égard, l'automatisme se présente comme un argument
permettant d'élargir le regard que l'homme porte sur son
existence. Dans la perspective ainsi tracée, il nous a
2 Bonnet, Marguerite, André Breton, naissance de 1'aventure surréaliste,p.1613 Breton, André, Manifestes du surréalisme, préface à la réimpression dumanifeste (1929)
4
paru nécessaire de bien saisir l'enveloppe que revêtait
l'assujettissement en question. Le premier objectif visé
s'articule donc autour de la localisation des éléments
constitutifs de la révolte à la source du surréalisme.
Il semble que cette révolte ait pour ressort la Grande
Guerre, laquelle est entendue en tant que conjonction
d'occurrences. Il s'agit donc du point de départ de
notre analyse. Ipso facto, notre recherche s'amorce avec
la conscription d'André Breton. Celle-ci se traduit
comme une prise de contrôle par le pouvoir qui plonge le
jeune homme dans une profonde stupeur. Cette stupeur
dissipée laisse André Breton avec un besoin
d'intelligibilité de haute volée. C'est une véritable
quête de sens qu'il entreprend à cette heure.
André Breton cherche à se distancier du réel désolé
émanant de cette belligérance. Pour ce faire, il
« demande secours aux poètes »4. Étudiant en médecine,
Breton rencontre aussi la folie, celle-là même qui
ignore les conventions . Déjetant d'emblée le
conformisme, elle impose une multitude de remises en
question du point de vue épistémologique, social et
existentiel. À cet égard, l'oracle freudien, tel que
présenté par Régis et Hesnard, lève le voile sur de
nouveaux horizons. André Breton l'entend comme une
perspective salutaire. En outre, la guerre entendue
comme conflit apparaît en elle-même comme un tourbillon,
une expérience qui outrepasse l'entendement.
4 André Breton, Entretiens : 1913-1952, p.30
Enfin, dès son retour à Paris, c'est l'homme formé que
rencontre André Breton. En l'occurrence, il est témoin
d'une triple expérience de manipulation du réel opérant
par la voie du patriotisme, de la censure et de
l'imposition du discours convenu. Il se dessine ainsi de
multiples rapports à ce que l'empire social prétend
comme réel et à ce qu'il fait de l'homme.
Devant faire face à cette intellection poignante, il
prend à tâche de découvrir « un faire » permettant de
reformuler le vivant et s'élance dans une quête
inexhaustible. C'est à ce moment que l'automatisme écrit
fait irruption dans sa vie. De notre humble avis,
l'étude de l'automatisme écrit repose principalement sur
la rédaction des Champs Magnétiques sous la plume
d'André Breton et Philippe Soupault. Il s'agit de la
première expérience effectuée en ce domaine, de la plus
concluante et de la plus déterminante.
Le produit de l'automatisme laisse sans voix ; il est
bercé par un mystère que l'on ne tentera pas ici
d'élucider. Autant dire que nous éviterons une critique
littéraire que nous ne serions d'ailleurs ni compétents
ni qualifiés pour jauger. Ce nonobstant, nous tenterons
de saisir les conditions de possibilités et les enjeux
de « ce faire ». Il s'agit de notre seconde visée.
Dès lors, si André Breton et Philippe Soupault ont
développé le processus de l'écriture automatique, c'est
André Masson qui tenta le premier d'établir la pratique
d'un automatisme visuel. Breton affirme d'ailleurs que :
« Personne n'a été plus loin que Masson dans
l'automatisme. »5 En dernière analyse, nous attacherons
donc notre regard sur la façon dont l'automatisme est
apparu dans le cheminement de l'artiste. Nous
envisagerons ses visées et la manière dont l'artiste
parvint à intégrer le procédé à « son faire ».
Il convient de remarquer que le rôle joué par
l'inconscient dans le processus créateur fait l'objet,
aujourd'hui, de nombreuses recherches tant dans le
domaine des sciences appliquées que dans le domaine des
sciences humaines. En font foi, par exemple, les
recherches entreprises par Mark Turner à l'université du
Maryland portant sur l'imagination et le cerveau,
l'invention du sens, la neuroscience cognitive de la
créativité ou, encore, par Jean-Pierre Changeux qui
aborde directement la question dans son ouvrage Raison
et plaisir.6
Or, malgré cet engouement, nous ne possédons que très
peu d'éléments de réponse sur les fonctions psychiques
de l'être. Dès lors, les recherches élaborées par André
Breton se présentent comme un « puissant explosif
mental », pour reprendre l'expression utilisée par
5 Michel Carrouges, André Breton et les données fondamentales dusurréalisme,p.96 M. Mark Turner, Série de leçons au Collège de France,http://markturner.org/cdf.html, 21 avril 2004
Michel Carrouges en 1950.7 Nous tenterons donc de saisir
les subtili tés d'un « faire » qui « (.. .) tend à opérer
dans le domaine du langage et des images, voire des
sensations, la plus fantastique des désintégrations en
chaîne »8 par la libération totale de l 'espri t et sa
portée.
7Michel Carrouges, André Breton et les données fondamentales dusurréalisme, p.1398 Idem.
1. André Breton catapulté dans l'abîme, le printempsdésolé d'un visionnaire
« La vie humaine ne seraitpas cette déception pourcertains si nous ne noussentions constamment enpuissance d'accomplir desactes au-dessus de nosforces. »9
André Breton
II s'est produit au cours des années 1914-1916 chez
André Breton un tournant qui l'a conduit à jeter un
regard nouveau sur les modes d'orchestration de notre
rapport au monde et sur la façon dont l'individu peut
gérer son existence à travers un système social
oppressant. Ce renversement plonge ses racines dans la
compromission de la France lors du conflit sanguinaire
que fut la Grande Guerre. Il s'appuie sur la commotion
provoquée par la prise de conscience du peu de
considération que le pouvoir social dominant attachait à
la vie humaine. Or, il semble que la première expression
substantielle de cette coercition soit, pour le jeune
homme qu'était alors André Breton, liée à l'épisode de
sa conscription. Celle-ci révèle et symbolise à la fois
le peu de pouvoir discrétionnaire que l'homme semble
avoir sur son existence. Notre but sera donc dans ce
premier chapitre de montrer en quoi cet événement joua
le rôle de déclencheur pour le processus de
' Ibidem, p. 10
transformation du regard qu'André Breton pose sur la vie
humaine.
1.1 La conscription ou la déflagration du pouvoir
II semble qu'André Breton se soit toujours, malgré
l'enthousiasme nationaliste environnant, exprimé en
désaccord avec l'implication française dans le premier
conflit mondial. Dans une lettre destinée à Lorient et à
Fraenkel daté du 3 août 1914, le jour de la déclaration
de guerre, Breton est clair à ce sujet :
Ici, j'assiste impuissant, au plus ridiculeenthousiasme belliqueux que j'ai connu(déclarations puérilement chauvines, confianceen soi-même, marseillaises d'ivrognes, etc.).L'arrivée des réservistes et territoriaux aprèsla mobilisation est fort comique. La moitié deshommes environ est ivre pour entrer à lacaserne. Je pourrais trop niaisementphilosopher. 10
André Breton manifeste ainsi sa hargne à l'égard de la
foule galvanisée. Le jeune homme témoigne, par cette
attitude, d'une indépendance perceptible à l'égard de la
propagande nationaliste qui a par ailleurs subjugué la
France entière. Certes, confondu, il mentionne son
sentiment d'impuissance. Cette évidence affirmée, il
convient de remarquer que le conseil de guerre le
mobilise six mois après. André Breton est conscrit en
février 1915. Il est alors âgé de dix-neuf ans. Chez
lui, la conscription provoque une véritable commotion.
Breton, qui percevait d'emblée l'absurdité de la guerre,
est sidéré. Mais cette émotion consumée fait place à un
0 Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance de 1'aventuresurréaliste, p.45
10
regard scrupuleusement interrogateur qui s'enracine dans
la révolte.
Breton, qui expliquera l'état des choses dans ses
entretiens de 1952, parlera de : « l'humeur de certains
jeunes gens dont j'étais, que la guerre de 1914 venait
d'arracher à toutes leurs aspirations pour les
précipiter dans un cloaque de sang, de sottise et
boue. »11 De toute évidence, il vit l'expérience de la
conscription comme une entrave, une dépossession des
libertés individuelles et de l'esprit discrétionnaire.
Breton parle bien « d'arracher » et de « précipiter ».
Les mots ont une force propre : « arracher », c'est
enlever de force, et « précipiter », c'est projeter à
partir d'un lieu élevé. Ainsi formulée par Breton,
l'expérience de la conscription se présente comme une
manœuvre disciplinaire. En effet, il s'agit d'une prise
de contrôle à bras-le-corps par le pouvoir. Il faut
entendre, par le choix des termes, la force et la
férocité du sentiment éprouvé. La destination visée est
« un cloaque de sang, de sottise et boue ». De ce point
de vue, l'obligation d'aller à la guerre prend la forme
d'un rappel par les autorités concernées à l'intention
du peuple d'un droit souverain de vie ou de mort. La
conscription se présente comme le pouvoir de disposer et
d'éprouver l'existence de chacun des membres d'une
population donnée. Les conditions d'exercice de ce
pouvoir reposent alors sur un unique critère, c'est-à-
dire la naissance en un lieu déterminé, l'appartenance
sociogeographique.
"André Breton, Entretiens : 1913-1952, p.29
11
II convient d'observer à ce moment qu'André Breton est
doublement heurté. En premier lieu, il est bouleversé
par la déclaration elle-même. Dans ses entretiens, il
parle de l'« explosion »12 de la guerre. En second lieu,
Breton se trouve heurté par la conscription qui emboite
rapidement le pas. La force de l'impact résultant de ces
deux secousses successives, l'une étant bien sûr la
conséquence de l'autre, éprouve durement le jeune homme.
Il plonge alors dans une profonde stupeur qui perdurera
quelques mois.
1.2 Le Fracas.Nantes 1915/août 1916
Devant faire face à l'inévitable fait de la guerre, que
peut-il faire sinon tenter d'y survivre ? André Breton
déclare dans ses Entretiens radiophoniques (1913-1952) :
Pour ma part, le premier moment de stupeurpassé quelques mois de « classes »d'artillerie je m'étais mis à promener unregard plus qu'interrogateur autour de moi.Tout près, au « cantonnement » même, les plussensibles s'étaient secrètement trouvé unrefuge... (...) Même plus ou moins voilés, lesdésastres du début, les sombres perspectives dela guerre de tranchées, l'issue incertaine duconflit entraînaient un état d'âme (il fautbien user de ces mots) où la résignationtrouvait difficilement place.13
Un déplacement s'opère ici. Par la mobilisation, le
conseil de guerre a arraché à André Breton le droit de
la gestion légitime de son existence. Le haut degré de
12 André Breton, Entretiens : 1913-1952, p. 26"ibidem, p.30
12
déstabilisation alors traversé le plonge dans un désert
affectif. Il écrit à Fraenkel, le 22 avril 1915 : « La
pensée s'émiette lamentablement sur le sol du terrain de
manœuvre. »14 Ce marasme émotionnel l'accompagne tout au
long de la période passée à Pontivy, de février à juin.
Visiblement, la léthargie cède graduellement la place à
un désir plus affirmé d'intelligibilité, qui se
manifeste par une quête de sens. La volonté est affichée
de « dominer la situation ».15 C'est dans cette
perspective que s'amorce son séjour à Nantes.
1.2.1 Stupeur et désabusement
Dans un premier temps, André Breton est affecté à
l'hôpital bénévole de l'ambulance municipale où il
occupe la fonction d'infirmier militaire. À Nantes, la
misère se révèle. Dans La Confession dédaigneuse, il
raconte :
Je traversais un des moments les plusdifficiles de ma vie, je commençais à voir queje ne ferais pas ce que je voulais. La guerredurait. L'hôpital auxiliaire 103 bisretentissait des cris du médecin traitant,charmant homme par ailleurs : « Dyspepsie,connais pas. Il y a deux maladies d'estomac :l'une, certaine, le cancer ; l'autre, douteuse,l'ulcère. Foutez-lui deux portions de viande etde la salade. Ça passera. Mon vieux, je vousferai crever, etc. »16
Soulignons, dans l'instant, que le contexte de l'hôpital
présente son intérêt propre. En raison de sa formation
médicale, André Breton effectue ce que l'on pourrait
Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance de 1'aventuresurréaliste, p.70l5André Breton, Entretiens : 1913-1952, p. 3016André Breton, Les Pas Perdus, p. 17
13
appeler un « trajet rétroactif » de la guerre. À de
rares exceptions près, le soldat d'infanterie commençait
par ses classes d'infanterie pour être dirigé vers le
front et, presque fatalement dans le contexte de la
Grande Guerre, aboutissait à l'hôpital militaire. André
Breton, pour sa part, connaît la guerre par les
résultats que lui renvoie le front. Prenons acte du fait
que la France sera l'un des pays le plus durement touché
par le conflit : 1,4 million d'hommes tués ou disparus,
soit environ 1.000 hommes par jour17. Les hôpitaux sont
remplis de soldats blessés. En l'occurrence, il y a les
blessés que nous pouvons classer en deux catégories
distinctes. D'une part, il y a les hommes atteints de
blessures mineures et donc aptes à se rétablir sans
conserver « trop de séquelles ». D'autre part les
mutilés, c'est-à-dire les hommes à la poitrine défoncée,
la colonne vertébrale brisée, la figure arrachée,
atteints de traumatismes crâniens, et encore. En outre,
il y a les malades. Pour l'essentiel, ce sont ceux qui
cèdent aux conditions de vie intolérables sur le front,
dans les tranchées, par exemple : le manque d'hygiène,
la fatigue, les conditions climatiques. Enfin, il y a
les troubles d'ordre psychiatrique. Principalement, il
s'agit de troubles nerveux provoqués par la surtension
et l'épuisement.
La peur se révèle être, pour ces combattants de la boue,
une farouche ennemie. Selon Ernest Hemingway, il
17Wikipédia, l'encyclopédie libre. Première Guerre Mondiale,http:litr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale#Le_bilan_catastrophique_d.27une_Europe_et_d.27un_monde_boulevers.C3.A9s, 21 avril2005.
14
s'agissait de « la Reine des Batailles ».18 Le peintre
André Masson, dans Mémoire du monde, nous expose la
façon dont se dessine cette peur sur le front, il
précise :
Cet effroi originel et unanime, il faut lemaîtriser, et, dans la plupart des cas,l'immémorial « baptême du feu » doit suffire.Mais dans cette grande peur jugulée se greffentdes peurs individuelles - brèves et presquetoujours maîtrisées elles aussi. Le sentimentde panique dont l'origine est souvent difficileà définir... Si on ne se rendait pas maître decette peur dans la peur, il n'y aurait plus decombattants ! Physiologiquement, cette peur,quand elle est persistante, se manifeste par undésordre urinaire bien connu, ou par un malaiseaux mêmes effets que le mal de mer : vertiges,nausées, faiblesse extrême. Ou par une crisenerveuse : le jeune soldat maudit son père etsa mère avant de sombrer dans le délire qu' ilfaut calmer... à coups de poing. »19
La peur gît dans le plus profond du cœur du soldat. En
fait, elle le parasite et, aidée par la consomption,
elle peut se transformer en une présence délétère. On
voit donc naturellement surgir une surabondance de
troubles nerveux de tous ordres. Il convient de
remarquer qu'André Breton travaille dans les coulisses
de l'horreur. Il rencontre, incontinent, la facette la
plus inadmissible du sacrifice. Conséquemment, le
quotidien du jeune homme se structure autour de cette
réalité.
André Masson, La mémoire du monde, p.6519 Ibidem, p. 66
15
Dans la perspective ainsi tracée, on conçoit
naturellement son désarroi. Son séjour est parsemé de
brefs moments de félicité, afférents notamment aux
retrouvailles avec Fraenkel, qui fleure son passage des
moments guillerets partagés au collège, et de la
rencontre du docteur Bonniot. Il s'agit d'un aide-major
affecté à l'hôpital temporaire numéro 25 qui témoigna de
la sympathie à l'endroit du jeune Breton. Ces épisodes
salutaires ont pour effet de lénifier le désespoir
éprouvé par André Breton. Ipso facto, il est loisible de
se demander si la recherche entamée par Breton procède
d'un besoin d'écarter une réalité essentiellement
morbide. Est-elle le fruit de la confrontation avec
cette misère scandaleuse ? Peut-être. Et cependant, il
semble qu'au cours de cette période se produit un
tournant qui l'amène à jeter un regard nouveau sur les
modes d'orchestration des représentations de ce qu'il
nomme « les contingences du monde phénoménal »20.
Considérant que l'une des premières injonctions du
surréalisme sera d'instituer un procès contre les
limites de l'attitude réaliste, il convient de nous y
arrêter.
1.2.2 La poésie contre la déréliction
André Breton confie, dans ses Entretiens, que sa
« première réaction cohérente » fut de « demander
secours aux poètes »21. Ce faisant, il détermine un
premier champ de recherche, soit celui du discours
0 Cité dans : Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance de1'aventure surréaliste, p.7021 André Breton, Entretiens : 1913-1952, p. 30
16
poétique comme savoir. C'est donc dans ce contexte
précis que se situe la véritable découverte de la poésie
d'Arthur Rimbaud, ainsi que les rencontres de Jacques
Vaché et de Guillaume Apollinaire.
1.2.2.1 Arthur Rimbaud
Arthur Rimbaud, par sa vie et son œuvre, polarise
l'attention du jeune Breton, qui précise dans ses
Entretiens radiophoniques (1913-1952) : « J'étais comme
sous le coup d'un envoûtement... ». Et, ajoute-t-il :
« Tout mon besoin de savoir était concentré, était
braqué sur Rimbaud »22. Il est significatif que Breton
parle d'envoûtement. En fait, l'investissement est tel
qu'André Breton parvient à juxtaposer le regard
rimbaldien au sien. Breton narre l'expérience :
L'assez long chemin qui me mène chaque après-midi, seul et à pied, de l'hôpital de la rue duBocage au beau parc de Procé, m'ouvre toutessortes d'échappées sur les sites mêmes desilluminations : ici, la maison du général dans« Enfances », là « ce pont de bois arqué »,plus loin certains mouvements très insolitesque Rimbaud a décrits : tout cela s'engouffraitdans une certaine boucle du petit cours d'eaubordant le parc, qui ne faisait qu'un avec « larivière de cassis »23.
Au cours de ces promenades, Breton s'enfuit. Il entre en
transe. Dans ses Entretiens radiophoniques, il parlera
d'un « état second »24 jamais égalé. Il ne s'agit plus
réellement de Nantes, de la guerre ou de sa
déflagration. L'action n'est plus là, mais grâce à la
! Ibidem, p.3023 Ibidem, p. 3624 Ibid.
17
poésie, quelque chose d'autre se manifeste, et dans un
même mouvement permet de creuser un écart avec le
« monde réel ». Imprégné de cette atmosphère, André
Breton interroge vivement les lettres à Delahaye en 1875
d'Arthur Rimbaud. Il observe dans ces lettres un état
transitif. Rimbaud fait son adieu définitif à la poésie
pour passer à une activité d'un tout autre ordre.
On peut penser que ces escapades rimbaldiennes
répondent, pour Breton, à une double nécessité : la
première est liée au besoin d'évincer une réalité
abrutissante, et la seconde renvoie à une quête de sens.
Dans les deux cas, la manœuvre opérée a pour objectif de
rendre supportable le réel. Il s'agit alors de faire
appel à la poésie, aidée de l'imagination, pour
métamorphoser la représentation. En l'occurrence, il
convient d'observer qu'André Breton utilise la poésie
non pas comme une fin, mais comme moyen pour transformer
un monde cristallisé, réifié, où uniformité et lassitude
vont de pair. Il combat l'engourdissement. Il cherche à
modifier le contexte pour doter les images d'une
signification autre. La poésie devient l'outil qui
permet de métamorphoser la mise en scène de
l'expérience, et par là, le récit de l'expérience elle-
même.
En février 1916, André Breton rédige un poème en prose
qu'il intitule « Âge ». Ce poème s'inscrit comme une
suite de « L'Aube » d'Arthur Rimbaud et figure dans
Mont-de-piété. Les premières phrases qui s'y donnent à
lire sont : « Aude, adieu. Je sors du bois hanté ;
18
j'affronte les routes, croix torrides. » Le jeune
Breton, armé de ses vingt ans, plonge dans la tourmente
et manifeste un désir d'aventures. À l'exemple de
Rimbaud, i l veut expérimenter par lui-même la recherche
de sensations nouvelles, singulières. Ce désir, s ' i l
était présent avant le conflit, prend un véritable
essor. Il n'est pas étonnant que l'on retrouve cette
notion révélée ic i .
Breton précise dans La Confession dédaigneuse: « Ceux
qui n'ont pas été mis au garde-à-vous ne savent pas ce
qu'est, à certains moments, l'envie de bouger les
talons. »26 II ajoute : « Écrire, penser, ne suffisaient
plus : i l fallait à tout prix se donner l ' i llusion du
mouvement, du bruit... »27 Ce désir de mouvement prendra,
après la guerre, l'aspect d'une véritable lutte contre
la matérialisation et l'immobilité. Autour de ce
principe s'articuleront toutes les notions propres à la
recherche de la vie dans la vie moderne.
Comme le précise Marguerite Bonnet dans André Breton et
la naissance de 1'aventure surréaliste : « Rimbaud
confirme en lui le désaccord avec le monde auquel
1'"enfant de colère" a su donner une expression
magnifique et violente - Nous ne sommes pas au monde. La
vraie vie est absente »28. La lecture d'Arthur Rimbaud
amène Breton à soulever des considérations qui seront
25André Breton, Âge cité dans Lire André Breton à Saint-Dizier, texte deNicolas Bersihand, Chronique d'un voyage,http://entretenir.free.fr/breton30.html, 21 avril 2005.26André Breton, Les Pas Perdus, p. 1827 Ibidem, p. 198 Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance de l'aventuresurréaliste, p.80
19
placées à la source du surréalisme. Il inaugure dans ce
poème sa réflexion portant les enjeux relatifs au
concept de « la confusion volontaire ». Ce concept met
en cause, au profit de la création poétique, la mise en
péril de sa raison. Ce questionnement l'accompagnera
tout au long de son séjour à Saint-Dizier. Il propose
aussi, dans ce poème, une remise en question des formes
classiques de la poésie.
Pour André Breton, tout se déroule comme si les procédés
traditionnellement appliqués à la poésie avaient
détourné la poésie de sa fonction initiale. Ce à quoi il
convient de prêter une attention particulière c'est
l'émergence d'une réflexion portant sur les enjeux
propres à la cristallisation du discours poétique.
1.2.2.2 Le Nihilisme, entre Jacques Vaché et M. Teste
En 1916, André Breton fait la rencontre de Jacques
Vaché. Il s'agit d'un patient, puis d'un ami, qui le
marquera à jamais. L'homme, d'à peine un an plus âgé
qu'André Breton, est alors alité pour une blessure au
mollet. Formé à l'École des beaux-arts sous la direction
de Luc-Livier Merson, Jacques Vaché tue le temps en
inventant des légendes singulières autour des paysages
qu'il peint ou dessine. Le jeune patient se révèle être
un jeune dandy, déjà quelque peu illustre, dont la
désinvolture et l'ironie le rendent inflexible aussi
bien aux conventions qu'aux démissions de la vie
sociale. Son style désaccordé et son humour corrosif
20
incarnent, aux yeux de Breton, « la désertion à
l ' intérieur de soi-même »29.
Cet homme marquant et inoubliable inspire au jeune André
Breton les prémisses morales de son Anthologie de
l'humour noir. Breton précise dans ses Entretiens
radiophoniques :
II eut très bien pu se donner pour le petit-fils de M. Teste, s ' i l n'avait eu une vue aussidésinvolte de la famille que du reste.L'« énormité » de ce qui se passait et, si l'onpeut dire, de ce qui se pensait communémentalors le mettait dans une aise extraordinaire.30
Il convient de s'arrêter sur le rapprochement effectué
avec le texte intitulé Monsieur Teste de Paul Valéry. La
figure de Monsieur Teste incarne l'homme placide.
Monsieur Teste est l'homme qui souffre en silence.
L'homme absent, l'homme qui ne s'étonne plus, celui-là
même qui couche froidement « son corps sec »31 dans « un
lit trop court »32 pour « faire la planche »33. Monsieur
Teste « fait le mort - »34.
L'illustration est spécifiquement employée par André
Breton pour mettre en relief le degré élevé de nihilisme
lucide de son ami. Une remarque s'impose ici , à savoir
que le comportement de Jacques Vaché est commandé par la
9 Étienne-Alain Hubert et Philippe Bernier, André Breton, p.330 André Breton, Entretiens : 1913-1952, p. 3331Paul Valéry, Monsieur Teste^ ci té dans Lire André Breton à Saint-Dizier, h t tp : / /entre tenir . f ree . f r /bre ton7.html , 21 avr i l 2005.32Idem.33Idem.34Idem.
21
Grande Guerre. André Breton précise, dans La Confession
dédaigneuse, que Jacques Vaché « ... comprenait que la
sentimentalité n'était plus de mise et que le souci même
de sa dignité (...) commandait de ne pas s'attendrir. »35
II faut donc entendre le nihilisme de Jacques Vaché
comme l'expression d'une attitude défensive. Dans ce
contexte, Monsieur Teste ne devient-il pas, plus
largement, l'incarnation du nihilisme de rigueur ? Plus
précisément, le nihilisme auquel sont réduit tous les
jeunes soldats à qui il ne reste plus d'autres endroits
où se réfugier que dans un « lit trop court »36 pour
« faire la planche »37, se taire et souffrir ?
En compagnie de Jacques Vaché, André Breton s'emploie à
se distancer de la tragédie qui accompagne son
quotidien. Ensemble, Vaché et Breton s'attaquent au
drame par le biais de la dérision. Ils s'arment de
lectures humoristiques sans lien avec le conflit. Ils se
servent de l'écriture pour résister à l'épidémie
nationaliste qui embrasse la guerre avec tant de
ferveur. À telle enseigne que Breton n'hésite pas à
déclarer : « Le temps, que j'ai passé avec lui à Nantes
en 1916, m'apparaît presque enchanté. »38 En
l'occurrence, après le dandysme et le nihilisme, 1'umour
(sans « h ») de Vaché se présente comme un supplétif
permettant de surpasser l'adversité. De par sa cautèle
face à la vanité des créateurs, Jacques Vaché inaugure
de multiples questionnements sur l'art et les
35 André Breton, Les Pas Perdus, p. 1836Paul Valéry, Monsieur Teste^ cité dans Lire André Breton à Saint-Dizier, http://entretenir.free.fr/breton7.html, 21 avril 2005.37 Idem.38 André Breton, Les Pas Perdus, p. 9
22
« pohètes » (avec un « h ») , comme il se plaît à les
désigner. Certes, son influence sera majeure. Le spectre
de Vaché accompagnera régulièrement Breton dans les
années 1918-1924, où les références directes à Jacques
Vaché se trouvent dans de multiples écrits de Breton,
par exemple : Les Pas perdus de 1924, Le Manifeste du
surréalisme (également de 1924), Littérature (Breton
publie les lettres de guerre de Vaché), etc.
1.2.2.3 Lier connaissance avec le « lyrisme en
personne »
En mai 1916, au cours d'une permission à Paris, André
Breton fait la connaissance de Guillaume Apollinaire.
Apollinaire, alors sous-lieutenant dans l'infanterie,
est hospitalisé pour avoir été heurté à la tempe par un
éclat d'obus en mars 1916. Breton, déjà conquis par
l'œuvre de l'auteur d'Alcools, avait auparavant
entretenu avec lui une vive correspondance. Mais il voit
Apollinaire pour la première fois au lendemain de sa
trépanation. La trépanation est une lourde opération
chirurgicale consistant à pratiquer une ouverture dans
la boîte crânienne. Apollinaire est donc très affaibli.
André Breton continuera à fréquenter assidûment
Guillaume Apollinaire jusqu'à la mort du dernier. Il le
décrit comme un homme d'une présence remarquable. « Le
lyrisme en personne », déclare-t-il, et ailleurs : « II
traînait sur ses pas le cortège d'Orphée ». Par le terme
de « lyrisme », il faut entendre un pouvoir de
déstabilisation permettant de réhabiliter tant le corps
23
que l'esprit. Apollinaire jouera, tout comme Jacques
Vaché, un rôle capital dans le cheminement intellectuel
du jeune Breton. Son influence était d'ailleurs directe.
La réinterprétation de la poésie effectuée par
Apollinaire captive André Breton, qui n'hésite pas à
déclarer que Guillaume Apollinaire est le :
« champion du poème-événement, c'est-à-direl'apôtre de cette conception qui exige de toutnouveau poème qu'il soit une refonte totale desmoyens de son auteur, qu'il coure son aventurepropre hors des chemins déjà tracés, au méprisdes gains réalisés antérieurement »39
Guillaume Apollinaire utilise ce moyen pour survivre à
la lourdeur de l'expérience guerrière. Au cours de cette
période, l'auteur de Calligrammes manifeste le désir
d'orienter ses recherches vers le sujet de l'enfance.
Il convient de remarquer que l'utilisation de la poésie
comme exutoire au contact d'une réalité navrante,
limitée et limitante, sera clairement énoncée par Breton
dans le manifeste de 1924. Il affirme ainsi :
L'homme propose et dispose. Il ne tientqu'à lui de s'appartenir tout entier,c'est-à-dire de maintenir à l'étatanarchique la bande chaque jour plusredoutable de ses désirs. La poésie le luienseigne. Elle porte en elle lacompensation parfaite des misères que nousendurons.40
39André Breton, Entretiens : 1913-1952, p.3140 André Breton, Manifestes du surréalisme, p.28
24
Apollinaire sera à l'origine de nombreuses rencontres
que fera Breton par la suite. C'est par Apollinaire
qu'il rencontre, par exemple, Pierre Reverdy, dont la
poésie l'émeut profondément. Il dira d'ailleurs, au
sujet de Reverdy :
Pour ma part, j'aimais et j'aime encore — oui,d'amour - cette poésie pratiquée à largescoupes dans ce qui nimbe la vie de tous lesjours, ce halo d'appréhensions et d'indicesqui flotte autour de nos impressions et de nosactes.41
La poésie de Reverdy ne manque pas de toucher et de
séduire André Breton dans sa façon de lever le voile sur
les parties obscures de l'existence humaine.
En somme, il semble s'orchestrer au cours de la période
passée dans la ville de Nantes un jeu encore indéfini
entre les réels objectifs et subjectif. Visiblement,
André Breton témoigne d'un désir légitime, voire
nécessaire, de dépasser « les contingences du monde
phénoménal »42. Ce désir est simultanément traversé d'un
besoin d'intelligibilité, si bien que l'imbrication de
ces deux motivations amène Breton à explorer les
mécanismes par le biais desquels l'expérience se met en
scène. Pour ce faire, il interroge la poésie, selon
Rimbaud et Apollinaire. Il est préoccupé par le marasme
du discours poétique. Au contact de Jacques Vaché, il
envisage le dandysme comme ascèse de création. L'homme
s'invente lui-même par la voie du nihilisme et de
41 ibidem, p. 342 Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance de l'aventuresurréaliste, p. 70
25
l'humour. On voit aussi émerger chez Breton dans une
forme encore embryonnaire des notions cardinales telles
que celles de l'imagination et du mouvement. Il s'agit
donc des premières voies d'exploration de la relation
unissant postulat et expérience.
26
2. Saint-Dizier juillet: à novembre 1916, la pagée entrele réel et de l'éventuel
Au début de l'été 1916, André Breton demande d'être
affecté au Centre neuro-psychiatrique de la Ile armée à
Saint-Dizier, où il veut travailler. Pour Breton, cette
affectation est signifiante. Il confie, dans une lettre
à Apollinaire datée du 15 août, son désir de « détourner
sa vie de son cours »43. Le jeune étudiant en médecine
choisit d'abandonner provisoirement la poésie afin de se
concentrer sur une découverte récente : la psychiatrie.
Le déplacement de son horizon de recherche peut paraître
considérable. En revanche, du point de vue de
l'orientation interne de la pensée de Breton, il n'est
pas certain qu'il y ait lieu de parler de renversement :
plutôt, il y a fort à présumer que Breton y poursuit
tout naturellement une réflexion déjà entreprise. Il
semble, de préférence, reconduire vers la science son
besoin de savoir et sa quête de sens. L'interrogation
sur la poésie a pour ressort la substitution des
procédés traditionnels de l'écriture pour permettre
l'introduction d'éléments fortuits. Mais cette
substitution a pour corrélat épistémologique la remise
en cause des représentations cristallisées de
l'expérience. Dès lors, il apparaît que cette conception
de la poésie, c'est-à-dire perçue comme outil de
constitution de la représentation permettant de modifier
l'émotion, puise à même le fonctionnement de la pensée.
Visiblement, malgré son désir de se détourner des
"Marguerite Bonnet, La rencontre d'André Breton avec la folie, Saint-Dizier, août/novembre, 1916, cité dans Lire André Breton à Saint-Dizier, http://entretenir.free.fr/breton3.html, 21 avril 2005.
27
préoccupations initiées par la poésie, André Breton ne
fait qu'approfondir sa réflexion en la réinscrivant dans
un champ de recherche médicale.
Dans ses Entretiens radiophoniques, il précise : « Le
séjour que j'ai fait en ce lieu et l'attention soutenue
que j'ai portée à ce qui s'y passe ont compté grandement
dans ma vie et ont eu sans doute une influence décisive
sur le déroulement de ma pensée »44. Nous sommes donc à
même de nous demander ce qui a fait « événement » dans
la vie de Breton au cours de son séjour en ces lieux.
2.1 L'expérience psychiatrique ou les affres de la
folie.
À Saint-Dizier, André Breton est l'assistant du docteur
Raoul Leroy, médecin-chef de Ville-Evrard qui dirige
alors le Centre neuro-psychiatrique. Il se lie d'amitié
avec lui.
Il s'investit passionnément dans ses études. Il lit avec
intérêt les traités de psychiatrie en vogue c'est-à-
dire : les ouvrages du Dr Régis, de Gilbert Ballet, de
Maurice de Fleury, de Magnan, de Charcot, de Constanza
Pascal et de Kraeplin. Il prête aussi attention aux
recherches neurologiques entreprises par Babinski. Il
discute chaque jour de ces nouvelles connaissances avec
le Dr Leroy. Dans sa lettre du 31 août 1916, il confie à
Fraenkel : « Leroy n'est pas fâché, de m'avoir. Il
oubliait d'être chef de centre neurologique. Charmant,
André Breton, Entretiens : 1913-1952, p. 36
28
familier, il se contente de ma société quelques heures
par soir et m'offre le thé chez lui »45. Il recopie
aussi plusieurs extraits de ses livres à l'intention de
Théodore Fraenkel dans une correspondance assidue. En
l'occurrence, il apparaît que les connaissances
théoriques de la psychiatrie d'André Breton sont bien
fondées.
Il convient ici de souligner l'attitude d'André Breton.
Paradoxalement, le jeune homme, qui souhaitait se
détourner de la poésie, présente les traités de santé
mentale avec la terminologie généralement réservée à la
littérature. Il qualifie le Précis de psychiatrie du
docteur Régis de « Faguet de la psychiatrie »,
1'Introduction à la médecine de 1'esprit de Maurice de
Fleury de « délicieux roman » et écrit carrément dans
une lettre à Fraenkel : « 0 poésie allemande, Freud et
Kraepelin !». La présence de cette absence est
étonnante. On peut penser que ce transfert, cette
reconduction de ses recherches dans le champ médical,
répond partiellement à un désir d'apaisement. Dans la
même lettre, André Breton confie : « Je tromperai,
j'espère, jusqu'à ces vestiges de la première heure, je
bannirai toute flamme guetteuse, je resterai aux mots
sûrs, qui ne compromettent pas. [•••] Démence précoce,
paranoïa, états crépusculaires. »46 II semble que Breton
a fini par trouver peu supportable l'emprise que la
poésie exerce sur lui et les égarements qui lui sont
45Marguerite Bonnet, La rencontre d'André Breton avec la folie, Saint-Dizier, août/novembre, 1916, cité dans Lire André Breton à Saint-Dizier, http://entretenir.free.fr/breton3.html, 21 avril 200546 Idem.
29
inhérents. Il a choisi - faible et ironique ruse — de se
jeter à corps perdu dans l'étude de la folie. De toute
évidence, rien n'y fera.
André Breton s'évalue constamment, car sa peur de
sombrer dans la folie est réelle et envahissante. Il
soulignera cette crainte à Fraenkel, qui l'accueille
d'abord avec sarcasme, comme en témoigne la note du 19
août laissé à son carnet : « Br. dans son hôpital de
fous s'émeut et s'épouvante de voir des aliénés plus
grands poètes que lui. »47 Lorsqu'il revoit Breton, il
est déconcerté : « Je suis passé par Saint-Dizier. [•••]
La transformation d'A.B. est effrayante. »48
André Breton se croit tour à tour atteint par diverses
pathologies, de la psychopathophobie à la disharmonie en
passant par les états lunatiques, tels que décrits par
Griesinger. Sa détresse est réelle comme le démontre
cette lettre :
Une crise intellectuelle très douloureuse brisemes forces. Elle est connue sous le nom depsychopathophobie ! Je me suis consacré un peutrop exclusivement ces derniers jours àl'examen des malades. C'est rouvrant lesIlluminations que j'ai pris peur. Ne trouvantplus « sacré » le désordre de l'esprit, jem'agitais sur l'aboutissement de la méthodelittéraire : faire venir sur quelque sujet demultiples idées, choisir entre cent images.L'originalité poétique y réside. « Ma santé futmenacée ; la terreur venait », dit Rimbaud. Jeviens de connaître le même ébranlement sous lecoup de ces nouveautés. Des phrases comme : ' Ma
47 Idem.48 Idem.
30
jeunesse, - M. Le Major - je viens d'absorberdu lait qui, j'espère, vous la fera paraîtreblanche' ou : « depuis vingt-trois mois, jeprostitue ma peau au canon de l'ennemi », nevoilà-t-il pas des images étonnantes, à deséchelons plus hauts que celles qui nousviendraient ? Cependant, je ne puis trouverpour cela d'admiration. L'anormité des crânes,les fameux prognathismes de ces gens s'yopposent. Je me borne à leur jalouser quelquesfonctions intellectuelles, parfois. Souventaussi, je me vante nos différences et à1'encontre de mon dessein poétique je tendsencore à m'éloigner d'eux. Comprends-tu, jecrains que cette dernière réaction exécute enmoi la poésie. . . Pardon si déjà « je ne saisplus parler ». Le sujet d'études me passionne.Enfin : je pourrai rire des psychologuesamateurs, en sachant bien plus qu'eux !—
Nous avons tenu à citer ce long passage, parce qu'il
contient des éléments déterminants qui influenceront
l'attitude de Breton face à la maladie mentale et à
l'écriture. Le point nodal tient au rapport entre folie
et poésie. Il précise : « Ne trouvant plus sacré le
désordre de l'esprit, je m'agitais sur l'aboutissement
de la méthode littéraire : faire venir sur quelque sujet
de multiples idées, choisir entre cent images. » En
désacralisant les désordres de l'esprit, André Breton se
débarrasse de l'essentiel du mythe entourant la folie.
Michel Foucault, qui a examiné les procédures
d'exclusion du discours, précisait dans L'ordre du
discours que : « Depuis le fond du Moyen Age le fou est
celui dont le discours ne peut pas circuler comme celui
des autres. »50 Selon Foucault, le rejet du discours du
49 ibid.0 Michel Foucault, L'ordre du discours, p.12
31
fou s'effectue à l'instar de deux principaux leitmotive.
D'une part, la parole du fou est balayée parce qu'elle
est perçue comme « nulle et non avenue »51. D'autre
part, paradoxalement, parce qu'on lui attribue quelques
pouvoirs divins. Dans les deux cas, elle ne peut être
entendue pour ce qu'elle est. André Breton, quant à lui,
n'aborde la folie ni pour la sacraliser ni pour la
rejeter. Il écoute les fous avec une attention
remarquable. Il reconnaît la valeur poétique du discours
qui surgit en l'absence de la censure consciente et,
contre toute attente, c'est à lui-même qu'il applique
ces notions. Il soulève à nouveau le concept de la
confusion volontaire. Ce concept se situe au croisement
de la raison et de la folie.
En outre, la présence de la poésie y est prépondérante.
Les phrases énoncées sont percutantes. Lorsqu'il écrit,
par exemple, « depuis vingt-trois mois, je prostitue ma
peau au canon de l'ennemi », le dégoût et les
contraintes évoquées concernant sa condition frappent de
plein fouet. Or, si ces « agitations » favorisent
l'émergence d'un propos riche et original, elles le
maintiennent aussi dans une situation de tension aux
extrêmes limites de la raison.
Au vrai, André Breton est effrayé par l'idée de basculer
dans la folie. Il exprime clairement sa souffrance tout
au long de cette lettre. Il parle d'une « crise
intellectuelle très douloureuse » puis, dans une
référence à Rimbaud, carrément de menace et de
51 Ibidem, p. 12
32
« terreur ». Le sentiment qu'il éprouve face à la folie
est alors à la fois défensif et admiratif. Breton dit
clairement qu'il se « borne à leur jalouser quelques
fonctions intellectuelles, parfois ». Parallèlement, il
ajoute : « Souvent aussi, je me vante nos différences ».
Conduit par la peur, le jeu d'attirance et de répulsion
propre à la fascination lui fait craindre un éventuel
« rejet » de la poésie. Sa crainte est proportionnelle à
l'attachement qu'il porte à cet art.
Il convient de remarquer que l'angoisse suscitée par le
spectre de la folie est une émotion substantielle et que
nous devons la considérer à juste titre. Elle encourage,
chez le jeune homme, une double attitude. Il confie :
« Le sujet d'étude me passionne. Enfin : je pourrai rire
des psychologues amateurs, en sachant bien plus
qu'eux ». Le point de départ est l'association aux
déchirements vécus par ses patients. Il en découle deux
conséquences majeures. D'une part, elle stimule la
curiosité et l'intérêt pour la recherche.
Instinctivement, André Breton cherche des réponses face
aux troubles qui habitent ses patients et aux troubles
qu'il soupçonne en lui-même. D'autre part, elle permet
l'empathie. Cette remise en question, cette autocritique
récurrente, mais surtout cette projection, engendrent
une grande sympathie et un réel respect envers ceux
qu'il cherche à soulager.
André Breton précisera, dans ses Entretiens
radiophoniques, en toutes lettres : « J'ai gardé, de mon
passage par le centre de Saint-Dizier, une vive
curiosité et un grand respect pour ce qu'il est convenu
33
d'appeler les égarements de l'esprit humain. »52 II
écrira encore sur cette question dans le Manifeste du
surréalisme de 1924 :
« ...je sais que j'apprivoiserais bien des soirscette jolie main qui, aux dernières pages deL'intelligence, de Taine, se livre à de curieuxméfaits. Les confidences des fous, je passeraima vie à les provoquer. Ce sont des gens d'unehonnêteté scrupuleuse, et dont l'innocence n'ad'égale que la mienne. Il fallut que Colombpartît avec des fous pour découvrir l'Amérique.Et voyez comme cette folie a pris corps etduré. »53
Lucide, il prendra aussi le soin de signaler dans ses
Entretiens radiophoniques, que « les égarements de
l'esprit humain » entraînent des « conditions de vie
intolérables. »54 Les commentaires que Breton émet
illustrent bien sa sympathie et son souci de l'autre.
André Breton ne se laisse pas décourager. Fasciné, il
persiste, malgré ses craintes. Il expose clairement ce
principe dans le Manifeste du surréalisme de 1924 : « Ce
n' est pas la crainte de la folie qui nous forcera à
laisser en berne le drapeau de l'imagination. »55. Il
fait preuve d'une grande vigilance, dissèque avec ardeur
la littérature psychiatrique qui est à sa portée et la
communique à ses amis. Il retranscrit fidèlement les
écrits et les dires de ses patients à l'intention de
Fraenkel dans une correspondance assidue. Aucune
52André Breton, Entretiens : 1913-1952, p. 383 André Breton, Manifestes du surréalisme, p. 1554André Breton, Entretiens : 1913-1952, p.3855André Breton, Manifestes du surréalisme, p.16
34
modification n'est apportée ni sur l'orthographe ni sur
les particularités de l'écriture.
2.2 L'éclairement de la psychanalyse
C'est lors de ce séjour à Saint-Dizier qu'André Breton
prend connaissance de la pensée de Sigmund Freud. Pour
appréhender les conceptions freudiennes, Breton dispose
de deux séries de textes : ceux du Précis de psychiatrie
du Dr Régis et ceux de La Psychanalyse, fruit de la
collaboration des docteurs Régis et Hesnard, publiés
chez Alcan en 1914. Malgré les efforts de Régis et
Hesnard, qui avaient aussi eu soin de lui consacrer un
article dans L'Encéphale en 1913, l'œuvre de Freud
demeure méconnue en France. Sa véritable introduction
dans le milieu intellectuel français aura lieu après la
guerre, en 1921, avec la traduction de certains de ses
ouvrages.
Comme l'indique Marguerite Bonnet dans son livre André
Breton et la naissance du surréalisme, le Docteur Régis
caractérise la psychanalyse en fonction de trois
principaux registres : 1) importance accordée à
l'inconscient, 2) la notion de complexes, 3) l'analyse
de leur nature. Cette analyse s'appuie sur trois
critères fondamentaux : a) la composante erotique, h) le
rôle des traumas affectifs issus de l'enfance, c) les
actions des forces inconscientes et du refoulement,
c'est-à-dire la « répression des complexes ».56
Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance du surréalisme, p.103
35
Le principe de refoulement est bien connu. Or, selon
l'état de santé psychologique de l'être, deux logiques
intégralement distinctes s'en dégagent. D'une part, chez
l'homme sain, le principe de refoulement se traduit par
les rêves, les tendances artistiques, etc. D'autre part,
chez la personne souffrante, il est à la source de la
névrose et de la psychose. Dès lors, l'intervention
thérapeutique consiste à démasquer les mécanismes à la
source de la folie. Il s'agit alors de les faire
basculer de l'inconscient au conscient. Le propos du
docteur Régis devient particulièrement confus lorsqu'il
aborde les notions de transfert, qu'il résume comme « un
sursaut émotif qu'éprouve également le
psychothérapeute. »57 II survole les diverses approches
thérapeutiques à la portée du médecin. Il déforme le
principe de la sublimation pour en faire un procédé de
réhabilitation moral et volontaire. Et, finalement, il
insiste sur les associations verbales au détriment du
rêve.
On sait que cette lecture orientée de Freud produit sur
Breton l'effet d'une révélation. Il s'emploie aussitôt à
en retranscrire les grandes lignes pour Fraenkel. Ce
dernier, bien que moins enthousiaste, ne tarde pourtant
pas à s'en laisser séduire. André Breton est déjà
sensibilisé aux discours et aux écrits de ses patients.
Par conséquent, un des éléments qui captent
naturellement son attention, dans la structure de la
théorie freudienne, est l'importance accordée à la
parole. Plus spécifiquement, la parole y est vue comme
57 Ibidem, p. 103
36
le point d'appui. C'est, d'une part, sur elle que se
fonde la relation médecin-patient et, d'autre part,
c'est sur elle que se construit le rapport de l'homme à
lui-même et à son environnement.
Le jeune étudiant, par son expérience d'application
directe, peut aussitôt alimenter sa réflexion. La
rencontre avec ce texte a des répercussions immédiates
sur la pratique psychiatrique de Breton. Plus tard, i l
précisera, dans ses entretiens radiophoniques :
C'est là - bien que ce fût encore très loind'avoir cours que j ' a i pu expérimenter surles malades les procédés d'investigation de lapsychanalyse, en particulier l'enregistrement,aux fins d'interprétation, des rêves et desassociations d'idées incontrôlées.58
Encouragé par l'approche freudienne décrite par Régis,
André Breton accordera maintenant une attention
spécifique aux rêves. Il confie, le 7 août, dans une
lettre à Paul Valéry : « Mon service entier revient à un
interrogatoire continu : avec qui la France est-elle en
guerre et à quoi rêvez-vous la nuit ? »59, soit deux
questions maîtresses qui l'accompagnent dans chacune de
ses visites.
Élément intéressant, Freud et Jung questionnent les
écrits de Goethe et de Shakespeare. La folie, éclairée
par la théorie psychanalytique telle que présentée par
Régis et Hesnard, contient potentiellement la clef de
:>8 André Breton, Entretiens : 1913-1952, p. 379 Marguerite Bonnet, La rencontre d'André Breton avec la folie, Saint-
Dizier, août/novembre, 1916, cité dans Lire André Breton à Saint-Dizier, http://entretenir.free.fr/breton3.html, 21 avril 2005.
37
voûte des problèmes posés par la poésie et, plus
généralement, par l'existence humaine. Il est difficile
de surestimer l'importance que la découverte de cette
origine littéraire de la psychanalyse a pu avoir pour
André Breton. Il est certain qu'elle lui a inspiré
l'idée qui l'amènera à effectuer des constructions
verbales déconcertantes puisées dans les sphères
obscures de l'inconscient. En effet, cette découverte
est à l'origine de l'élaboration d'un projet qui se
servira de l'écriture comme d'un outil permettant, grâce
à l'abandon de la censure consciente, de produire des
manuscrits dans lesquels seraient couchés des fragments
d'inconscient. La juxtaposition de son intérêt pour la
psychiatrie et la psychanalyse, source de multiples
questionnements déchirants, déborde inévitablement sur
sa perception de la poésie de Rimbaud, de Jarry et
d'autres poètes de la tradition symboliste.
2.3 Le Désenchantement à l'égard du discours
psychiatrique
La Première Guerre mondiale a engendré une destruction
inouïe. André Breton rencontre à Saint-Dizier, en marge
des innombrables souffrances physiques occasionnées par
le conflit, une souffrance d'un autre ordre, et qui
attire son attention : celle des âmes meurtries.
L'insalubrité, le spectacle des massacres, le défilé des
blessés et des malades, la peur, la fatigue, l'angoisse,
l'insomnie sont autant de facteurs qui encouragent
l'affluence des troubles psychologiques.
Au Centre neuro-psychiatrique de la Ile armée se trouve
un amalgame très diversifié de personnes et de
pathologies. D'emblée, on pouvait se demander si toutes
ces personnes étaient atteintes de troubles
psychiatriques réels. En outre, il était aussi légitime
de se demander si la guerre n'était pas un agent
producteur de la folie. Enfin, on pouvait aussi se
demander si la nécessité de « tenir en main » les troupes pour
éviter la dislocation de cette énorme machine n' entraînait pas
une opération de reconduction massive des dissidents
vers les centres psychiatriques.
André Breton dit : « Étaient dirigés sur ce centre les
évacués du front pour troubles mentaux (dont nombre de
délires aigus), d'autre part divers délinquants en
prévention de conseil de guerre pour lesquels un rapport
médical était demandé. »60 Le délinquant est celui qui
contrevient à une règle « impérative ». La notion de
« délinquance » est vaste et englobante. Elle est
souvent subsumée sous la notion de « différence ». Au
milieu des cas lourdement affectés, sont aussi envoyées
quelques « têtes fortes ». Le peintre André Masson sera
d'ailleurs l'une des victimes de cette catégorisation
arbitraire.
André Breton, dans le cours normal de l'accomplissement
de ses responsabilités, se voit confier la tâche de
rédiger des rapports d'expertise psychiatrique en
matière pénale. C'est donc en partie à lui que revient
la tâche d'évaluer le degré de folie des hommes. Dans le
"André Breton, Entretiens : 1913-1952, p.36
39
cadre du procès qui sera entamé contre l'attitude
réaliste, André Breton attaquera directement la
« rêverie scientifique si malséante »61. La défense des
intérêts de la folie s'inscrira dans le prolongement de
son argumentation. Or, pour mesurer la portée des
injonctions soulevées par Breton, il convient d'examiner
brièvement certains des enjeux du discours
psychiatrique.
La psychiatrie est la discipline médicale qui étudie
« les troubles de la pensée, de l'humeur ou du
comportement de l'être humain »62. Comme l'indique La
Revue canadienne de psychiatrie : « du point de vue
étymologique, le mot "psychiatre" vient du grec psukhê
ou psyché (l'âme) et iatros (médecin) : le médecin de
l'âme. » La psychiatrie, par son objet, se distingue des
autres parties de cet amalgame de savoirs et de
pratiques que nous réunissons constamment sous le terme
de médecine. Le président de La Revue canadienne de
psychiatrie précisait dans l'édition de décembre 2002 :
La psychiatrie est encore une disciplinemédicale riche en troubles et anomalies maispauvre en explications : Surtout en raison dela nature intrinsèque du domaine, le psychiatrene connaît pas grand-chose réellement de lafaçon dont les troubles qu'il peutdiagnostiquer découlent des élémentsfondamentaux de la vie physiques oupsychologiques. Malgré les énormes progrès desneurosciences, ces dernières ne peuventtoujours pas expliquer de quelle façon la
61André Breton, Manifestes du surréalisme, p.5962 D. Blake Woodside, MD, MSc, FRCPC, Revue Canadienne de Psychiatrie,http://www.cpa-apc.org/Publications/Archives/CJP/2002/december/presadd_f.asp, 21 mai2005
40
conscience jaillit du tissu cérébral. Commentles structures cérébrales produisent-elles lemoi, le je, et quel est le rapport entre lecerveau et ces entités ? Jusqu'à maintenant,aucun scientifique n'a pu relier cetteperception du je et le contrôle qu'il exerce àce que nous connaissons de la structure et dufonctionnement du cerveau. Une lacune disjointesectionne la voie de l'explication entre l'étatphysique et l'état psychologique. En ce moment,la discontinuité entre le cerveau et l'espritdoit être contournée en pratique cliniquecourante. 63
La « pauvreté en explications » de la psychiatrie en
1914-18 n'en était que plus grande. Par opposition aux
autres champs de la recherche médicale, la psychiatrie
doit faire face à l'absence d'un corps à autopsier.
Depuis la découverte de l'anatomie pathologique au début
du XIX ! siècle, il y a un fossé entre la psychiatrie et
les autres branches de la médecine. L'activité
diagnostique s'en voit fortement affectée.
Michel Foucault, dans les cours qu'il a prononcés entre
1973 et 1975 au Collège de France, cours publiés sous le
titre Le Pouvoir psychiatrique et Les Anormaux, a
analysé la constitution épistémologique du discours
psychiatrique et l'expertise médico-légale. Selon
Foucault, la découverte de l'anatomie pathologique avait
permis l'émergence d'un diagnostic différentiel en
donnant une visibilité aux signes distinctifs de chaque
maladie. Dans la médecine générale, l'activité
diagnostique consiste à déterminer avec un maximum de
précision, non pas la présence de la maladie, mais son
63 Idem.
41
type. Le diagnostic psychiatrique obéit à une autre
règle, plus fondamentale. Son objet est d'abord et avant
tout de déterminer si cette frayeur, si cette humeur, si
ce comportement relève du normal ou du pathologique. Il
est donc question de trancher entre la présence ou
l'absence de la folie. Foucault parle alors d'un
diagnostic absolu.
Placés devant une absence de corps et dans l'obligation
d'établir un diagnostic absolu, les psychiatres du XIXe
siècle tenteront d'établir une série d'épreuves
probantes. Michel Foucault précise : « L'épreuve
psychiatrique est donc l'épreuve que j'appellerai du
redoublement administrativo-médical : est-ce que l'on
peut retranscrire en termes de symptômes et en termes de
maladie ce qui a motivé la demande ? »64. Bref, pour
justifier les raisons d'un internement, il s'agit de
reformuler un certain nombre d'injonctions en une
maladie. L'analyse du vocabulaire d'une série
d'expertises psychiatriques témoigne éloquemment, par la
faiblesse du discours, de la manœuvre. Michel Foucault
cite quelques exemples de ce vocabulaire récurrent :
[...]« immaturité psychologique », « personnalitépeu structurée », « mauvaise appréciation duréel ». Tout ceci, ce sont des expressions quej'ai effectivement trouvées dans les expertisesen question :« profond déséquilibre affectif »,« sérieuses perturbations émotionnelles ».ouencore : « compensation »,« productionimaginaire », « manifestation d'un orgueilperverti », « jeu pervers », « érostratisme »,
6t Michel Foucault, Le Pouvoir Psychiatrique, cours au Collège deFrance, 1973-1974, p.270
42
« alcibiadisme », « donjuanisme »,« bovarysme », etc.65
Ces exemples concordent avec le discours tenu par
l'agence de santé publique du Canada qui parle, par
exemple, des psychoses en termes de « pensées
confuses », « croyances fausses ou irrationnelles » et
de « comportement bizarre »66.
Le président de La Revue canadienne de psychiatrie
souligne que « des points de vue idéologiques viennent
périodiquement dominer le paysage psychiatrique »67. On
voit clairement à quel point le discours est orienté. Ce
discours à forte coloration morale permet aux
psychiatres de construire un champ d'anomalies par le
cumul des conduites irrégulières d'un individu. Le champ
d'anomalie établi, le psychiatre se trouve sous
l'obligation de parler en termes déterministes.
Autrement dit, d'affirmer que telle personne était
destinée à commettre tel crime, en atteste la somme de
ses comportements anticonformistes observés depuis
1'enfance.
65 Michel Foucault, Les Anormaux, cours au Collège de France, 1974-1975,p.1566Agence de santé publique du Canada, Rapport sur les maladies mentalesau Canada, http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/miic-inmac/chap_3 f.html,21 mai 2005À cet effet, i l est intéressant d'examiner le tableau exposant lestypes de troubles de la personnalité voir : Agence de santé publique duCanada, Rapport sur les maladies mentales au Canada, http://www.phac-aspc.gc. ca/publicat/miic-mmac/chap_5_f.html, 21 mai 200567 D. Blake Woodside, MD, MSc, FRCPC, Revue Canadienne de Psychiatrie,http://www.cpa-apc.org/Publications/Archives/CJP/2002/december/presadd_f.asp, 21 mai2005
43
Certes, le psychiatre ne prend pas directement de
décision. Cependant, il fournit au juge la matière
justifiant l'inculpation ou la disculpation de l'accusé
avant la tombée du verdict. André Breton est conscient
de son rôle et des répercussions du pouvoir
psychiatrique sur la vie de ses patients. Il précise :
Les rapports médico-légaux, belles rédactionsdu type scolaire, ces rapports de la conclusiondesquels dépendent toutes les perspectives dela vie d'un homme, m'ont laissé sur unsentiment extrêmement critique de la notion deresponsabilité.68
Le pouvoir médico-légal face à la folie est un pouvoir
sur la liberté ou la détention d'un homme. Il s'agit
d'un pouvoir sur l'exclusion sociale, d'un pouvoir, à la
limite, de vie ou de mort. Il s'agit donc d'un pouvoir
magistral.
En 1914-1918, la justice militaire était encore sous l'influence du modèle de la Révolution.
Les condamnations et les exécutions r e v ê t a i e n t souvent un caractère aléatoire dont
quelques infortunés faisaient les frais. On fusillait facilement pour désertion ou des actes
de trahison, tel: «abandonné son pos te » . Prenons a c t e de ce
que l a c a t é g o r i e des « d é s e r t e u r s » comprenne a u s s i ceux
q u i , é t o u r d i s par l e s bombardements, aveuglés par l e s
gaz ou délirants, se perdaient.
Pour inciter les hommes à demeurer dans les rangs, il
fallait « des exemples ». Plusieurs auteurs témoignent
dans leurs œuvres de ces exécutions aléatoires.65 Le
68André Breton, Entretiens ; 1913-1952, p.3769 par exemple : Henri POULAILLE, Pain de soldat 1914-1917, GRASSET1937 ; Roland DORGELÈS, Les Croix de Bois, ALBIN MICHEL, 1919 ; HenriBARBUSSE, Le Feu, Journal d'une escouade, FLAMMARION, 1916 ; GÉNÉRAL
44
niveau de tension était élevé. Breton raconte dans La
Confession dédaigneuse: « ... le seul fait de polir des
bagues dans la tranchée, ou de tourner la tête, passait
à nos yeux pour une corruption. »70 Manifestement, en
période de guerre, le pouvoir médico-légal à l'égard de
la folie se résume surtout en un couperet qui tranche
entre la désertion et la maladie. Il est possible
d'éviter l'exécution, mais il est difficile d'éviter
l'enfermement. C'est le diagnostic psychiatrique qui
détermine le lieu de détention.
Le peintre André Masson, après avoir été grièvement
blessé sur le front a séjourné longuement dans les
hôpitaux de guerre « ceux où l'on triture les corps,
pour finir par ceux où l'on soigne les âmes »71. Il
relate son entrevue au Val-de-Grâce avec le professeur
Delmas, un psychiatre réputé de l'époque :
Le Médecin : Te jetant au-devant des rafales demitrailleuses ennemies, te rendais-tu compte quetu voulais te suicider ?
Masson : D'aucune manière. J'accomplissais unordre. Remettre à la nuit tombée une mission àaccomplir en plein jour était considéré par touscomme un refus d'obéissance.
Le Médecin : Votre camarade pourtant...
Masson : II avait choisi la désobéissance,pensant qu'entre deux situations il fallaitchoisir celle qui offrait le moindre danger :sortir de la tranchée équivalait à une véritable
E.-L. SPEARS, en liaison, 1914, cité par L'Intransigeant, du 20 mars1933 ; André Bach Fusillés pour l'exemple - 1914-1915 ; etc.70André Breton, Les Pas Perdus, p. 1971 André Masson, Le Vagabond du surréalisme, p.14
45
mise à mort consentie ; le conseil de guerre,lui, pouvait prononcer un verdict atténué. Pourmoi, choisir l'attente de la nuit, c'étaitchoisir le poteau d'exécution. Et mourir pourmourir, je préférais la première solution.
Le médecin : Comment jugez-vous le comportementprudent de votre camarade ?
Masson : Mon compagnon Dousdebès était l'hommele plus courageux qui soit. Et si vous medemandez maintenant quel est celui de nous deuxque vous devriez considérer comme un héros(c'était le langage de l'époque), je vousrépondrais : lui. En ne m'abandonnant pas, enchoisissant la mort immédiate avec moi, sonattitude morale était empreinte de vraiegrandeur. La mienne était celle de l'obéissancepassive dans la zone des combats.
Le médecin : Vous ne m'avez pas convaincu. Jedois vous rappeler vos fugues répétées, dès quevous avez eu la possibilité de sortir d'unhôpital (dans la psychiatrie classique, la fugueétait considérée comme un penchant au suicide).
Masson: En somme, vous considérez laparticipation à la guerre comme une volonté desuicide ?
Le médecin : Je vous interdis de prononcerencore un seul mot !
Il ne me tutoyait plus. Il était devenu dur,visage fermé, hostile. D'autres interrogatoirestournèrent aussi mal et je compris que je nem'en sortirais pas, si je continuais à fairepreuve de sincérité.72
Nous avons tenu à citer intégralement cet extrait, car
bon nombre d'éléments y sont mis en jeu. Foucault
explique, dans Le Pouvoir psychiatrique, que depuis
12 André Masson, La mémoire du monde, p. 93
46
Pinel, le « fou » est celui qui a « tort ». Le fou est
celui qui se trompe de réalité, celui-là même que la
démonstration ne convaincra pas. Dès lors, le pouvoir du
psychiatre devient un pouvoir tout à fait particulier.
Il s'agit très précisément d'un pouvoir de réalité,
c'est-à-dire la détention d'une réalité ontologiquement
supérieure à celle du fou.
La psychiatrie, de par son adhésion à la médecine et sa
reconnaissance comme savoir scientifique, se voit munie
d'un « pouvoir » imposant. D'une part, elle détient la
vérité de la réalité sur la folie. D'autre part, parce
qu'elle est science, elle est détentrice des critères
d'évaluation de cette vérité. Celle-ci ne peut être
remise en cause que par ses initiés.
L'une des visées de l'interrogatoire se traduit alors
par l'obtention de l'aveu du fou. Le fou doit « expier »
sa folie. L'interrogatoire a pour fonction de fixer
l'individu à son identité sociale et à la folie qu'on
lui attribue. C'est ce que tente de faire le docteur
Delmas, face au discours parfaitement lucide d'André
Masson. Il importe peu que le discours de Masson soit
vrai. Il s'agit de lui faire avouer qu'il est dans
l'erreur, et ce, par la force ou par la raison. La
première question posée par Delmas est frappante à cet
égard. Il demande à Masson : « Te jetant au-devant des
rafales de mitrailleuses ennemies, te rendais-tu compte
que tu voulais te suicider ? » Cette question implique
d'emblée une prise à parti, ce que l'on peut
caractériser comme une forme d'orientation donnée au
discours. Elle a pour but de piéger l'interlocuteur. La
47
construction est intéressante. Il précise bien « Te
jetant au-devant », « te rendais-tu compte que tu
voulais ». Ce faisant, il ne soulève pas le fondement de
l'action, mais demeure en surface. Il ne demande pas
« qu'est-ce qui t'as amené à... ? » La question s'appuie
sur une interprétation arbitraire considérée comme une
évidence affirmée. La troisième question manifeste
autant d'influence. Le professeur Delmas
demande : « Comment jugez-vous le comportement prudent
de votre camarade? » L'action effectuée par le camarade
de Masson est alors connotée favorablement. Cette
question correspond à dire : « Comment, vous qui êtes
visiblement dans l'erreur, jugez-vous le bon
comportement de votre ami? ». L'intérêt de cette
construction tient à la coloration introduite. La
quatrième réplique, c'est-à-dire la réponse du
psychiatre, est présentée de manière outrancierement
réductrice. D'une part, le verdict exclut toute
considération propre au fait énoncé. Il élimine par
exemple : l'ampleur du dilemme, la rapidité de décision,
les circonstances dans lesquelles le problème doit être
résolu, etc. D'autre part, il fait fi de toutes les
circonstances externes, telles : la peur d'un éventuel
retour sur le front, le malaise face à l'établissement
hospitalier, la relation avec le personnel soignant,
etc. Il étouffe l'argumentation d'André Masson. Le
docteur Delmas parait arc-bouté sur sa prérogative. Et,
finalement, devant la finesse du renversement qu'exécute
le jeune peintre, l'illustre professeur se braque,
devient intempestif et belliqueux.
48
II convient de remarquer l'imprégnation patriotique du
médecin. Il porte en cela la marque de son époque. Ses
considérations sont importantes, car il ne s'agit pas
d'une conversation banale entre individus égaux. Il
s'agit bel et bien de décider de l'avenir immédiat,
voire définitif, d'un être humain. C'est la vie d'un
jeune homme qui est en jeux. On pourrait comparer
l'évaluation psychiatrique à un procès. Conformément à
son déroulement, la sentence sera reportée, atténuée ou
aggravée, au même titre d'ailleurs que les conditions de
détention. André Masson souligne un autre épisode fort
intéressant de sa vie asilaire lors de cette période de
guerre. Il raconte :
II regarda mon dossier : qu'avez-vous à vousplaindre ? Réponse : dégoûté par lacivilisation occidentale, par le suicide del'Europe, je demande à partir aux Indes. Coupd'œil à droite, coup d'œil à gauche : deuxinfirmiers-déménageurs, ou forts des Halles,m'empoignent, et stimulé par le : « Attention,il est dangereux ! », traversent en courant unlong couloir ; celui des cabanons. - Me voilàenfermé dans une étroite cellule matelasséepourvue d'un judas.73
Le point nodal de cette citation tient au rapport entre
la folie et l'idée de danger. Faire du fou un dangereux
permet de justifier le pouvoir ou l'abus de pouvoir que
l'on exerce sur lui. Le fou est alors doublement
disqualifié. En plus d'être celui qui a tort, il devient
celui dont il faut se méfier. Ces méthodes cavalières
tentent de se justifier en présentant une visée
thérapeutique. L'utilisation de l'agression fut
/ •) André Masson, La mémoire du monde, p.94
49
particulièrement bien illustrée par Leuret dans le
Traitement moral de la folie de 1840. L'objectif y est
de contraindre suffisamment le fou pour qu'il ne
parvienne plus à se détourner de la réalité asilaire.
C'est donc une façon de l'obliger à pénétrer dans
« notre monde » en l'assiégeant de manœuvres
disciplinaires.
Face au démérite du discours psychiatrique, Breton
s'avise prestement du caractère subjectiviste de cette
discipline et de l'insuffisance des diagnostics
authentiques. Pour le jeune homme qui s'interroge sur la
façon et les raisons qui confèrent aux autorités le
pouvoir de disposer de la vie humaine, le constat est
confondant. C'est une réalité contre laquelle les
surréalistes s'élèveront avec vigueur. Dans le Manifeste
de 1924, André Breton dit clairement :
Reste la folie, « la folie qu'on enferme », a-t-on si bien dit. Celle-là ou 1' autre...Chacunsait, en effet, que ces fous ne doivent leurinternement qu'à un petit nombre d'acteslégalement répréhensibles (...) à l'inobservancede certaines règles, hors desquelles le genrese sent visé, ce que tout homme est payé poursavoir. 74
Notons que les tracts surréalistes sur le sujet
abonderont. Nous n'avons qu'à penser à la Lettre ouverte
aux médecins des asiles, à la folie éclairante de Nadja
ou à L'Éloge des fous : le cinquantenaire de 1'hystérie,
à titre d'exemple.
4André Breton, Manifestes du surréalisme, p. 15
50
2.4 Le Cas de Saint-Dizier et le tressautement de la
pensée
Dans sa correspondance du 15 août 1916 à Apollinaire, il
confie : « Rien ne me frappe tant que les
interprétations de ces fous. »75 L'un de ces patients
marquera particulièrement Breton. Il s'agit d'un jeune
soldat hospitalisé pour des troubles de comportement.
L'individu en question s'était démarqué par une témérité
prodigieuse et un courage sans bornes dans le théâtre
des opérations. En fait, comme ce patient l'a déclaré à
son médecin, la guerre n'avait été que simulacre, une
mise en scène phénoménale. Il ne courait, par
conséquent, aucun danger, aucun risque...
Cet exemple démontre un délire d'interprétation et une
négation totale de la réalité. Il s'agissait pour ce
patient de nier ce qui le niait, en détournant le statut
de la réalité de sa fonction initiale. L'opération ne
consiste donc pas à nier les faits, mais, très
précisément, de constituer une nouvelle représentation à
partir de l'interprétation des faits. Le neuropsychiatre
Boris Cyrulnik a identifié ce type de besoin dans son
article intitulé « Pour une Logique absurde », où il
précise qu'il s'agit de « finalement donner forme à un
besoin que nous connaissons tous : quand une situation
est folle, quand une violence est insensée, quand nous
ne sommes plus vivants sans être vraiment morts, il nous
75 Marguerite Bonnet, La rencontre d'André Breton avec la folie, Saint-Dizier, août/novembre, 1916, cité dans Lire André Breton à Saint-Dizier, http://entretenir.free.fr7breton3.html, 21 avril 2005.
51
faut une vision claire du monde pour transcender jusqu'à
l'absurde un réel insupportable. »76
Pour Breton (pour qui la Grande Guerre se présentait
comme une aberration de premier ordre), ce patient
« délire vrai ».7 L'idéalisme démontré par le patient
est assez puissant pour remettre en question le statut
de la réalité admise. Cette attitude, involontairement
choquante, offrait le germe nécessaire à la construction
de la pensée systématique du mouvement qu'allait mettre
sur pied Breton.
2.4.1 Sujet
André Breton, inspiré par les propos que tient ce
patient, écrit sa première véritable prose, un texte
intitulé Sujet qu'il dédicace à Jean Paulhan. Breton le
publiera dès son retour à Paris, en 1918, dans le numéro
d'avril de la revue Nord-Sud. Le titre de ce texte est
probablement déterminé par la recommandation que lui
fait Paul Valéry face à l'observation de ses
« détraqués »78, comme il les nomme. Dans une lettre
rédigée au cours des derniers jours du mois d'août, il
précise : « Mes amitiés, Breton, et si vous m'en croyez,
regardez bien vos sujets et, dans un loisir réservé
quotidien, notez aussi nettement que possible les
curiosités du jour. » Comme le précise Marguerite Bonnet
6 Boris Cyrulnik, Pour une Logique absurde, Psychologies. Corn,http://www.psychologies.fr/cfml/chroniqueur/c_chroniqueur.cfm?id=247 9&pleinepage=oui , 10 avril 20057 Jean-Bertrand Pontalis, les vases non communicants, cité dans LireAndré Breton à Saint-Dizier, http ://entretenir.free.fr/breton2.html,21 avril 2005.78André Breton, Sujet, cité dans Lire André Breton à Saint-Dizier,http://entretenir.free.fr/bretonl.html, 21 avril 2005.
52
dans son article intitulé « La Rencontre d'André Breton
avec la folie : Saint-Dizier, août/novembre 1916 »,
Breton reprend les propos de ce malade de Saint-Dizier à
1'instar des mécanismes de la paranoïa telle que définie
en 1899 par Kraepelin, c'est-à-dire comme un « système
délirant durable et impossible à ébranler, et qui
s'instaure avec une conservation complète de la clarté
et de l'ordre dans la pensée, le vouloir et
l'action. »79
Ce texte, comme le soulignera Paul Valéry dans sa lettre
du 7 mai 1918, est teinté de la filiation rimbaldienne.
Valéry ajoutera à propos de ce texte que : « c'est un
homme qui parle tout seul, à demi-voix, et ne tient des
propos ni pour quelqu'un ni pour soi-même... À quand ce
prosateur ? »80 Tour à tour, Breton fait jouer dans
Sujet la question de la folie, de la confusion
volontaire, du rêve et du réel devant l'épreuve décisive
que représentent l'irréalisme et le délire. Il amène
aussi son lecteur à réfléchir sur les thèmes de l'écoute
et le nationalisme. André Breton explique :
Naturellement, l'interrogatoire faisait toutpour amener cet homme à déclarer que les fraisdémesurés d'un tel spectacle ne pouvaient avoirpour objet que de l'éprouver personnellement,mais i l y tenait peu, me sembla-t-il. Sonargumentation plus riches etl'impossibilité de l'en faire démordre mefirent grande impression.81
"Marguerite Bonnet, La rencontre d'André Breton avec la folie, Saint-Dizier, août/novembre, 1916, cité dans Lire André Breton à Saint-Dizier, http://entretenir.free.fr/breton3.htmlt27, 21 avril 2005.
0 André Breton, Sujet, cité dans Lire André Breton à Saint-Dizier,http://entretenir.free.fr/bretonl.html, 21 avril 2005."André Breton, Entretiens : 1913-1952, p.37
53
Ironiquement, ce poème se termine par une
interrogation : « Que coûte-t-il de faire disparaître
peu à peu une compagnie ? » André Breton soulève un
double questionnement : celui de la valeur de la guerre
et de la valeur de la vie humaine.
2.4.2 Le Mal du temps : un patriotisme insane
II est important de garder à l'esprit le mal du temps.
Nous sommes à une époque où les conseils de guerre
s'affairent à endoctriner les masses pour suppléer aux
blessés et aux morts que la guerre lui renvoie par
milliers et par centaines de milliers. En France, chaque
famille payait un lourd tribut à la guerre. Pour ceux
qui, depuis la sécurité de leur bureau, commandent
aveuglément cette saignée, la vie humaine vaut peu. Nous
assistons à une hiérarchisation protéiforme. En premier
lieu, il y a la hiérarchisation entre individus. Selon
des critères préétablis (âge, état de santé, etc.), le
pouvoir d'État choisit des hommes pour les envoyer à
l'abattoir. En deuxième lieu, il y a une hiérarchisation
des classes sociales, où les mieux nantis sont épargnés.
Finalement, il y a une hiérarchisation dans le rapport
de supériorité de la patrie sur la vie humaine.
Pour l'heure, on voit clairement qu'il ne s'agit plus de
se battre pour défendre les enfants, il s'agit de les
sacrifier dans l'intérêt de la patrie. La question de
l'endoctrinement des enfants est d'ailleurs fascinante.
Nonobstant, pour l'objet de notre propos actuel nous
effectuerons un survol afin de mettre en relief certains
54
fondements de la révolte et du dégoût de Breton face au
patriotisme. De notre avis, l'endoctrinement de
l'enfance constitue le point de consécration de
l'infiltration dans l'ensemble des strates sociales d'un
processus de manipulation des esprits.
La France est en guerre, et le conseil de guerre veille
à la prolifération de cette humeur guerrière. On tente
par de multiples moyens de racoler les Français, même
aux plus petits d'entre eux. L'univers infantile
n'échappe pas à l'épidémie, et le conseil de guerre
n'hésite pas à violer leur innocence. Les fabricants de
jouets, les auteurs de contes pour enfants et les
maîtres d'école deviennent de précieux complices du
pouvoir. En 1915, le territoire de l'enfance est déjà
depuis un certain temps assiégé. L'annonce du dirigeant
d'une grande maison industrielle de commerce de jouets
saisit par Léo Clarétie dans Les Jouets, en 18 93, donne
clairement le ton : « Dès que le bébé peut articuler
quelques mots, il s'explique aussitôt avec toute la
lucidité d'une conviction innée : aux filles, il faut
une poupée ; aux garçons, un fusil, un dada, un
tambour. »82 Léo Clarétie, renchérissant ce propos,
proclame :
II est bon que l'enfance se prépare, s'habitueen se jouant à l'idée des mâles exercices, etfavorise les instincts valeureux de notrerace ; il est bon que l'adolescent ait étéformé dès les premières années au respect et aubesoin de la force physique pour qu'il prenne
82Jean-Baptiste Leroux, Le nationalisme au lycée, cité dans Lire AndréBreton à Saint-Dizier http://entretenir.free.fr/breton33.html, 20 mai2005
55
son rang dans ces vaillantes sociétés où lesport athlétique devient un devoir national.83
La plupart des jeux d'enfant sont dès lors reconvertis
en jeux de guerre éveillant la fibre nationaliste.
En 1890, le Manuel des exercices physiques à l'usage des
écoles primaires, de Désiré Séhé et G. Strehly, comporte
des ajouts éloquents. On y suggère des jeux comme Le
massacre à la riposte, dont voici la description :
Le sort désigne l'ordre dans lequel les élèvesdoivent jouer. Le dernier de la série va secoller au mur, il est victime. Les autres, àtour de rôle, le visent avec une balle, en seplaçant à la raie qui est préalablement tracéeà quelques mètres de la muraille. Ce sont lesmassacreurs. Si le massacreur manque son coup,il se colle au mur à côté de sa victime : s'ilréussit, celle-ci a le droit de ramasser laballe et de tâcher de l'atteindre en lepoursuivant jusqu'à la raie. La victime quiatteint un massacreur est délivrée et remplacéepar lui. Si le massacreur n'a pas été touché,il reprend place à la queue des massacreurs.84
Difficile de rester insensible à ce qui est ici « mis en
jeu ». Le hasard détermine une victime. Celle-ci sera
acculée contre un mur pour être assaillie de balles. Les
maîtres impulsent les enfants à se délecter du
« massacre ». On recommande dans les manuels scolaires
d'exalter la propension aux jeux de domination.
83Jean-Baptiste Leroux, Le nationalisme au lycée, cité dans Lire AndréBreton à Saint-Dizier http://entretenir.free.fr/breton33.html, 20 mai2005.84Ibid.
56
Le député Paul Bert, futur ministre de l'Instruction
publique et auteur du Manuel de gymnastique et des
exercices militaires, affirme pour sa part en 1881
que : « dans tout citoyen il doit y avoir un soldat
toujours prêt ».8; Et, le 6 juillet de l'année suivante,
on inaugure en France la politique « des bataillons
scolaires »86. Cette politique stipule que les écoles
primaires et secondaires recensant un minimum de deux
cents élèves âgés de douze ans auront le pouvoir
d'infliger des exercices militaires à ces étudiants au
cours de leur séjour en ces lieux.
Dans cette foulée, tout le programme scolaire est
réorienté. On enseigne la guerre à l'école : des cartes
du front sont exposées pour subjuguer les enfants et
l'histoire de la France est reformulée pour servir les
fins patriotiques. La géographie, le français et les
mathématiques deviennent aussi des prétextes pour la
direction de l'esprit. En 1915, le n° 6 de la Revue
pédagogique exhorte les maîtres à poser des problèmes à
saveur militaire aux enfants comme, par exemple :
Un cuirassé poursuit un paquebot. À 10 heuresdu matin, il en est séparé par une distance de14 kilomètres. Le cuirassé file 15 noeuds et lepaquebot 34 6 1/3 mètres par minute. Après uneheure de classe, le cuirassé augmente savitesse de 4km/h. Trouver à quelle heure lecuirassé lance son premier obus sur lepaquebot, en supposant qu'il ouvre le feu à unedistance de 1800 mètres.87
B 5Idem.86 Idem.87 Jean-Baptiste Leroux, Le nationalisme au lycée, cité dans Lire AndréBreton à Saint-Dizier http://entretenir.free.fr/breton41.html, 21 mai2005.
57
La campagne de propagande s'étend sur la France comme
une nappe qui recouvre chacune des sphères de la vie
sociale. Comme le démontrent ces exemples, l'univers de
l'enfance est en tous points inféodé à la raison d'État.
Monsieur Teste l'énonçait si bien : « toute la terre est
marquée (...) Reste mon lit. »88 Pour Breton, fort de tout
cela, il en ressort un fait incontournable : la
véritable folie, celle que l'on doit condamner, ne se
trouve pas nécessairement dans les asiles !
2.4.3 La Lueur crépusculaire d'un Nouveau Monde
Dans son article « Les Vases non communicants », Jean-
Bertrand Pontalis précise que l'expérience d'André
Breton à Saint-Dizier est à elle seule le reflet du
surréalisme, car elle manifeste le surréel en dénonçant
l'emprise du réel. On peut légitimement se demander
quelle attitude est la plus contestable :
•l'attitude d'un jeune homme cultivé qui, confronté à une
expérience irrecevable pour l'esprit, décide de nier une
réalité dite objective, ou
• l'attitude d'une société qui, en proie à une folie
guerrière, réifie sa raison afin d'en faire un outil de
destruction massive ?
L'auteur souligne que :
88Paul Valéry, Monsieur Teste^ cité dans Lire André Breton à Saint-Dizier, http://entretenir.free.fr/breton7.html, 21 avril 2005.
58
En ce temps fécond, Breton rencontre donc latriple expérience de la folie, de la guerre etde l'idéalisme à l'état pur, « sauvage ».L'important est que cette expérience soitconjointe : elle détermine une positionmilitante et collective. Il s'agit de fairefront au réel par le détournement de safonction : réponse nécessairement marquée dedéfi.89
Jean-Bertrand Pontalis ajoute que l'opération consiste à
muer la réalité en un simulacre qui destitue « les
pouvoirs qu'elle s'arroge au nom de l'évidence
fonctionnelle. On peut presque parler d'un devoir
d'insoumission à l'égard d'un principe de réalité qui
prétend faire loi. »90
André Breton puise aux sources de la folie sa conception
de la réalité supérieure du discours inconscient. Le cas
de Saint-Dizier présente tous les éléments nécessaires à
l'élaboration de sa réflexion sur Le Peu de réalité.
Dès lors, la rencontre directe avec la folie, la passion
dévorante pour l'analyse freudienne et la pratique de la
psychiatrie ébranlent fortement André Breton. Sagace, il
craint que ces découvertes ne modifient le regard qu'il
pose sur la poésie moderne. Les risques d'effectuer une
lecture psychopathologique de textes qui lui sont chers,
comme ceux, par exemple, de Rimbaud ou de Jarry, ne sont
pas exclus. Il confia cette inquiétude à
Apollinaire : « Mon tort est, instinctivement, de
89Jean-Bertrand Pontalis, les vases non communicants, cité dans LireAndré Breton à Saint-Dizier,_http ://entretenir.free.fr/breton2.html,21 avril 2005.90Ibid.
59
soumettre l'artiste à épreuve analogue. De pareil examen
je doute que Rimbaud sorte indemne (Une Saison en
Enfer) , et je regarde avec effroi ce qui va sombrer de
moi avec lui. »91 Or, cette crainte mourra sur le front.
2.5 Le Brasier de la guerre, l'embrasement du réel et du
surréel
La guerre, en tant que conjonction d'occurrences, se
révèle une expérience où la liaison avec le réel
s'orchestre de maintes façons. La spoliation des
libertés individuelles par la conscription postule que
le libre arbitre est forgé de vaines chimères. La folie
subvertit la réalité telle qu'entendue rituellement. Le
patriotisme débile édicté une reformulation des acquis.
Dans cette foulée s'inscrit le fait guerrier en tant que
tel. Dans sa disconvenance avec l'anticipé, la guerre se
déploie comme scénique. Il s'agit donc pour l'heure
d'examiner la guerre d'André Breton.
2.5.1 La Guerre d'André Breton
À la fin du mois de novembre de cette tumultueuse année,
André Breton est affecté à un groupe de brancardiers. Il
y retrouve Fraenkel. Le plaisir des retrouvailles sera
bref, puisque les deux jeunes hommes sont aussitôt
propulsés en plein cœur du carnage, dans l'offensive de
la Meuse. L'horreur est partout. Ce qui peut donner le
plus aisément accès à la guerre d'André Breton, ce sont
les Carnets de guerre de Théodore Fraenkel, qui
"'•"•Marguerite Bonnet, La rencontre d'André Breton avec la folie, Salnt-Dizier, août/novembre, 1916, cité dans Lire André Breton à Saint-Dizier,http://entretenir.free.fr/breton3.html, 21 avril 2005.
60
combattait à ses côtés. Fraenkel décrit très justement
les événements, sans complaisance. Dans sa note du 21
décembre, il raconte :
Toujours en lignes, et non lavés depuis unesemaine. Des obus ont éclaté autour de moi ; lesifflement qui grandit à toute vitesse,s'approche et devient formidable, c'est lamenace, le coup qu'on voit tomber. Puis, c'estle fracas formidable, puis la pluie des éclatset des pierres comme les gouttes de l'arbreaprès la pluie. Je m'occupai surtout desprisonniers allemands, pauvres diables. Depuisl'attaque, défilé interminable des pieds gelés.On attend la relève. Une nuit que les pénicheschargées de l'évacuation se trouvèrent arrêtéespar un bombardement, les blessés affluèrent auposte qui fut tôt rempli ; on dut poser leslourds brancards dans l'escalier de la cave,sur le seuil, et même, finalement, en dehors,sur la route, fleuve de boue. La pluie tombait,la nuit était complète... Les blessés restèrentlà des heures. En passant, on les heurtait dupied ; les gémissements, les plaintes, lesappels de toutes parts, les gens quidemandaient à boire, ceux qui voulaient qu'onles emportât, ceux qui peu à peu fermaient lesyeux et mouraient dans la boue. On ne voyaitrien, on n'entendait que ces plaintes monter.Il y avait aussi le dépôt mortuaire dans unegrange effondrée, où l'on alignait, la nuitvenue, des cadavres que les rats et les versdisséquaient, des débris fangeux de corps etd'uniformes dans des toiles de tente. Horreurconventionnelle achevée.
Nous voyons bien qu'il ne suffit d'énoncer le mot
« guerre » pour en entendre la teneur. La guerre
2 Marguerite Bonnet, La rencontre d'André Breton avec la folie, Saint-Dizler, août/novembre, 1916, cité dans Lire André Breton à Saint-Dizier, http://entretenir.free.fr/breton3.html, 21 avril 2005.
61
appartient au domaine de 1'infigurable pour quiconque ne
l'a pas éprouvé. Lorsque nous parlons de la guerre
d'André Breton, de celle dans laquelle il est propulsé,
celle qui lui inspirera dégoût, rage et révolte, de quoi
parlons-nous, sinon du cumul de ces événements
vertigineux et chaotiques ? Nous parlons de cette
tornade d'inexprimable misère qui, naturellement,
étourdit. Nous parlons du froid et de l'insalubrité.
Nous parlons des sifflements assourdissants et des
bruits de tonnerre causés par une pluie d'obus. Nous
parlons d'une impuissance écrasante face à
l'impossibilité de porter secours. Nous parlons de
l'accumulation de blessés et de cadavres d'hommes
souvent à peine pubères et des « vieux de trente
ans »93. Nous parlons de la vermine qui n'est pas
dégoûtée de dévorer ces corps à peine refroidis. Nous
parlons de l'urgence qui empêche de les honorer. Nous
parlons de l'« horreur conventionnelle » qui outrepasse
l'entendement et qui, par conséquent, hébète. Enfin,
nous parlons de ce désastre-là ! Dès lors que reste-t-
il ? Il reste à « faire la planche » comme monsieur
Teste. André Breton se réfugie dans la poésie pour ne
pas perdre pied.
2.5.2 La Chienlit
Pour André Breton, la guerre n'est pas l'affaire des
soldats. André Masson décrit deux épisodes singuliers
qui illustrent bien cette perspective. L'un des deux se
déroule sur la Somme en novembre 1916. Il s'agit d'une
période marquée par le déluge. Les terres sont inondées,
André Masson, La mémoire du monde, p. 67
62
les hommes ont « de l'eau jusqu'aux genoux ».94 Soldats
français et Allemands sont vis-à-vis. Il est impossible
de se battre dans ces circonstances. Masson dit :
L'un d'eux, impavide, sort pour s'emparer d'uneplanche qu'il vient d'apercevoir entre lesondulantes lignes. Mon voisin, un nomméLoiseau, « soldat modèle », le met en joue.J'abats son arme, un autre l'engueule, untroisième - sage - dit : « Ils sont commenous. »95
Cette semaine-là, rapporte Masson, c'est le déluge qui
tua « 75 pour 100 » de ses frères d'armes. Dans le
prolongement de cette idée, Masson énonce une rencontre
avec un soldat allemand blessé dans une tranchée. Masson
précise : « Arrivé devant lui, qui involontairement me
bouchait le passage, je crie : "Toi, tu descends, moi je
monte", tout en le plaquant sur la paroi de l'étroit
couloir. »96 Confondant nos préjugés, les deux hommes ne
tentent pas de s'entretuer. En effet, la question
soulevée relève de l'obstruction du chemin.
Dans ces combats aberrants, les soldats, de part et
d'autre, sont pris en otage par le pouvoir. Pour André
Breton, la guerre est un effroyable chienlit médiatique
et gouvernemental. Les médias et les autorités concernés
hypnotisent les foules pour conduire la jeunesse « dans
un cloaque de sang, de sottise et boue »97. André Breton
énonce clairement cette position dans Arcane 17
lorsqu'il précise : « II faudra commencer par enlever à
94 Ibidem, p. 6295 Ibidem, p. 72ne96 Ibidem, p. 7497André Breton, Entretiens : 1913-1952, p.29
63
la guerre ses titres de noblesse. Et ici qu'on me
comprenne : il y a dans le cadre abominable de la guerre
beaucoup de grandeur déployée. »98
Au front, les combattants se trouvent « aux premières
loges du théâtre de la guerre »". Le peintre André
Masson, qui était soldat dans l'infanterie, déploiera ce
concept de la guerre théâtre auquel il fut très attaché.
Pour beaucoup de soldats comme lui, le front concrétise
les propos mis en jeu par le cas de Saint-Dizier. Ici,
il est question de la guerre comme la superposition de
scènes insolites. Situé à vingt mille lieues du conflit,
le lecteur ressent de l'impudeur à lire à ces récits et
l'ami à les entendre. Cette indécence tient
particulièrement au nouveau sens que prend le « normal »
dans le quotidien de ces jeunes gens hébétés. C'est là
que le sommet de l'horreur se dévoile. Masson dit:
Certains, n'ayant eu aucune expérience de laguerre, se sont moqués des récits de soldatsdécrivant ceux de leurs frères qui tuésétaient restés dans l'attitude de la vie. Je medemande ce qu'ils auraient éprouvé devant cespectacle. Sans doute, la même chose : unfrisson qui ne ressemblait à aucune des « peursdans la peur ».100
Il décrit l'un de ces exemples : « un soldat couché sur
le ventre et dressé sur ses coudes, la tête levée et la
bouche ouverte toute grande dans ce que je croyais
l'appel au secours d'un blessé. (...) Ce soldat au cri
8 André Masson, La mémoire du monde, p. 7099 Ibidem, p. 7 3100 Ibidem, p. 68
64
figé était un bel homme encore jeune... ». Et, il
précise :
Autant les tués restés dans l'attitude de lavie donnaient une secousse aux plus durs,autant des membres dispersés causaient peud'émotion. Une jambe dans une botte n'était pasplus effrayante que les débris qui jonchaientles champs de bataille après quelques moisd'offensive. Ils devenaient objets, au mêmetitre que les débris de barbelés... La premièrefois que j'aperçus des soldats tués : deuxbrancardiers et le blessé qu'ils transportaientme parurent autant de mannequins.101
Il y a là, pourrait-on dire, une affirmation de la
primauté de la surprise face à la désaffection. Dans la
perspective nouvelle ainsi dépeinte, l'apathie de
monsieur Teste ne résiste pas à la stupeur de la
rencontre avec l'élément insolite. Lorsque l'on ne
ressent plus le non-sens prend tout son sens ! Dans ce
qu'André Masson qualifie d'une « vie indigne d'un
animal », ce qui crée l'effroi c'est l'élément
esthétique insolite. On ne s'étonne guère de
l'« horreur », elle est « conventionnelle ». On s'étonne
du beau ou de l'inopportun. C'est précisément ici que
l'univers de la représentation désaffecté, construit
aussi solidement que le délire du fou, bascule. C'est
ici que le discours poétique émeut et que l'image de la
toile s'empare du regard et s'imprègne dans la pensée.
Il n'existe pas de « défense » contre la surprise. C'est
peut-être par la voie de la surprise que s'opèrent
finalement les passages « capables de bousculer
LOI Ibidem, p.70
65
l'Histoire, de rompre l'enchaînement dérisoire des
faits ».102
Compte tenu de ces considérations, il nous apparaît que
l'expérience guerrière et médicale d'André Breton est à
la source de la révolte qui permit l'élaboration du
mouvement surréaliste. Prétendre que le surréalisme
n'est qu'une réaction au fait de guerre serait une
manière outrancierement réductrice de clore, plutôt que
d'analyser, le sujet. Il est hors de doute qu'André
Breton s'interroge sur l'évidence et sur la raison
d'être du présent. Et il est vrai que le surréalisme
réagit avec vigueur contre l'esprit de son temps et le
consensus pour une guerre perçue comme un abrutissement.
Cette réaction est une inscription de plus sur le mur de
la révolte ; une façon de s'opposer à l'irrémédiable et
1' insensé...
Empiriquement, la guerre se présente comme l'étincelle
qui permet la juxtaposition d'expériences et qui
détermine une position militante. André Breton est situé
très précisément au croisement de l'expérience et de la
convention. À cette heure, il rencontre et cumule les
indices qui alimenteront sa réflexion. La stupeur semble
être un premier moteur d'action, c'est-à-dire, plus
précisément, le combat mené contre l'indifférence perçue
comme un concept fade, comme une relation entre objets,
un vide, une neutralité, une étrangeté située entre la
haine et l'amour. Il précisera dans le Manifeste du
surréalisme : « Je veux que l'on se taise lorsque l'on
Révolution Surréaliste, numéro 5, octobre 1925
66
cesse de ressentir. »103 Cette phrase, loin d'être une
simple formule rhétorique, semble révéler un principe
qu'il se fixe, soit celui de fonder 1'epistemologie sur
le sentiment et de sentir inépuisablement. Est-ce la
réponse au nihilisme imposé pendant trop d'années face
au carnage ? C'est possible. Mais il ne faut pas omettre
l'importance du discours convenu qui endort les masses
et qui s'inscrit, aux yeux de Breton, comme le symptôme
endémique d'une société. Arthur Rimbaud soulève l'idée
que les procédés classiques de l'écriture étouffent
l'émotion. La notion du patriotisme apparaît comme un
somnifère de la pensée. Il s'agit de constituer une
représentation parfaitement lisse et cohérente, c'est-à-
dire une réalité convaincante. Le patriotisme devient un
refuge. Il permet de réunir sous une idée pour mieux
écraser le témoignage opposé. Il doit être de l'ordre de
l'évidence. Cette évidence affirmée engendre l'union, et
l'union permet de bien vivre ensemble. Il rassure et
apporte le réconfort « d'avoir raison ». Dès lors, tout
est possible ! C'est sans remords que l'on peut imposer
à toute une génération « une vie indigne d'un animal ».
On a raison de tuer et de mourir, sans jamais que ces
« évidences » ne soient remises en question. Le concept
de patriotisme engourdit l'esprit sous le joug de
l'évidence. Pour ne pas ébranler l'évidence, le
patriotisme choisit de ne pas parler des blessés
abandonnés plusieurs jours durant sur le champ de
bataille. Des soldats défigurés qui ne mourront pas et
de ceux, paniquant, qu'on assomme pour leur sauver la
vie. Le patriotisme qui nie la pluie, la boue, la
103André Breton, Manifestes du surréalisme, p.18
67
compagnie des rats et la carapace de poux. Enfin, le
patriotisme qui reformule le monde.
À cette intersection entre le convenu et l'expérience,
on note aussi l'existence du front. La guerre de
tranchées se vit comme une fiction tant elle outrepasse
l'entendement. La psychiatrie se présente comme le
discours permettant de désamorcer la réalité du fou pour
lui imposer la conception solennelle du réel. André
Breton rencontre aussi la folie qui secoue. Le fou qui
ne croit pas le monde tel qu'il est, qui l'invente
autrement et qui ne s'en laisse pas distraire. La folie
qui résiste a l'horreur, celle qui ne se laisse pas
miner. La folie qui fait éclater, en toute innocence,
les incohérences de la raison et d'une société
criminelle.
En outre l'écriture, le pacte avec l'écriture suit
Breton comme une ombre en tout temps. Lorsqu'il songe à
abandonner la poésie, il s'emploie à retranscrire
fidèlement, aberrations incluses, le discours de ses
« fous ». Les fous récitent et Breton tend une oreille
qui se démarque par sa sincérité. C'est auprès de la
poésie, de la lecture et de l'écriture qu'il trouve du
réconfort et qu'il cherche aussi des éléments de
réponse.
Enfin, c'est la découverte de la psychanalyse et des
travaux de Sigmund Freud qui tracent la voie. Avec la
psychanalyse, il se dote d'un instrument théorique qui
lui permettra de décréter que la réalité est ailleurs.
André Breton, entouré de Vaché, d'Apollinaire, de
68
Valéry, de Freud et de Rimbaud, tisse en ces temps
guerriers l'étoffe dans laquelle le surréalisme sera
taillé.
69
3. Le retour à Paris :
De la radicallsatlon de la révolte aux prémices de la
quête
3.1 Babinski et la médecine
Au retour du front, soit en janvier 1917, Breton est
affecté au Centre neurologique de l'hôpital de la Pitié.
Il œuvre alors dans le service du docteur Babinski à qui
i l voue « une admiration bizarre, et comme d'ordinaire,
bruyante ».104 Ce neurologue d'origine polonaise fut le
bras droit du célèbre docteur Jean-Martin Charcot avec
qui i l a entretenu un rapport de type père et f i ls , qui
s'apparente au modèle original de l'enseignement
hippocratique. Charcot a aussi formé tous les grands
neurologues et psychiatres français et étrangers dont le
plus célèbre de ses étudiants, en 1885, fut Sigmund
Freud. Après la mort de Charcot, Babinski a poursuivi
les recherches de son maître sur l 'hystérie.
Le docteur Babinski s'affaira à démontrer l'absence
d'atteinte neurologique dans l'hystérie. Sa plus
importante découverte portera sur le réflexe du bord
externe de la plante du pied. Le « signe de Babinski » permet de
dépister une lésion du système nerveux central ou de la moelle
épinière. Breton précise au sujet de Babinski :
« Je m'honore toujours de la sympathie qu'ilm'a montrée-1'eût-elle égaré jusqu'à me prédire
104Marguerite Bonnet, La rencontre d'André Breton avec la folie, Saint-Dizier, août/'novembre, 1916, cité dans Lire André Breton à Saint-Dizier, http://entretenir.free.fr/breton3.html, 21 avril 2005
71
psychiatrie. Ces considérations démontrent qu'André
Breton approfondit ses connaissances face à la folie, au
discours psychiatrique et à la médecine.
3.1.2 Censure et trahison
Ce retour à Paris n'est pas sans ébranler le jeune
écrivain. Il précise dans ses Entretiens
radiophoniques :
Ah ! pour moi, c'était depuis longtemps lagrande dérive : pas de compromis possible avecun monde auquel une si atroce mésaventuren'avait rien appris ; dans ces conditions,pourquoi distraire une parcelle de temps et dedisponibilité en faveur de ce qui ne me motivepas de ma propre impulsion ? (...) Toujours est-ilque tout ce à quoi d'autres que moim'incitaient, je le tenais pour une duperie,pour un leurre. La censure de la guerre avaitété vigilante (...)Ce qu'il est convenu d'appelerla « conscience sociale » parmi nous n'existaitpas.107
Il est hors de doute qu'André Breton se sent trahi par
sa société. Il parle bien de leurre, de duperie, c'est-
à-dire d'être abusé par de fausses représentations, de
faux discours. La censure s'inscrit comme une injonction
supplémentaire. Elle joue un triple rôle social de
soutien au pouvoir. En premier lieu, la censure trie le
discours. Elle étouffe le témoignage opposé et donc crée
un effet de vérité par l'absence du discours contraire.
Elle contribue à lisser la représentation et permettre
une démonstration convaincante. Elle procure donc un
pouvoir d'affirmation. En second lieu, elle apaise les
esprits par la négation du drame. C'est une façon de
107 André Breton, Entretiens : 1913-1952, p.45
72
dire : « On ne s'est pas trompé, il n'est rien arrivé,
on n'a donc rien à se reprocher. » Elle disculpe l'élu
au banc des accusés par l'annihilation des faits. Elle
séduit en éliminant la confrontation. Et finalement, les
esprits amadoués sont réconfortés par la
déculpabilisation. Tous trouvent leur compte dans ce
réconfort.
À vingt mille lieues du drame, nous éprouvons de la
répulsion et de l'écœurement à lire les récits de
guerre. En deçà de ce recul, on peut penser que le
discours est totalement irrecevable. Le docteur Boris
Cyrulnik traduit très justement cette mesure sociale en
disant : « Ce négationnisme signifiait : « Crevez, votre
souffrance nous importune. » 10E André Breton,
parfaitement lucide, dit : « Les pouvoirs d'alors se
montraient soucieux de ménager une transition entre le
genre de vie que la guerre nous avait fait connaître et
celui que le retour à la vie civile nous réservait.
Cette précaution n'avait rien de superflu. »109 Au
certain, les lendemains de la guerre sont médiocres. La
France est ruinée et confrontée à un grave problème
démographique. Breton ajoute :
On revenait de la guerre, c'est entendu, maisce dont on ne revenait pas, c'est de ce qu'onappelait alors le « bourrage de crâne » qui,d'êtres ne demandant qu'à vivre et à de raresexceptions près à s'entendre avec leurssemblables, avait fait, durant quatre années,des êtres hagards et forcenés, non seulementcorvéables, mais pouvant être décimés à merci.
108
109 André Breton, Entretiens : 1913-1952, p. 55Boris Cyrulnik, Un merveilleux Malheur, p.128
73
Certains de ces pauvres gens louchaient, bienentendu, vers ceux qui leur avaient donné de sibonnes raisons d'aller se battre.110
Devant ces faux discours, ce « bourrage de crâne » pour
reprendre l'expression de Breton, 1'infatuation du
discours scientifique ne sort pas indemne. Breton
affirmera à cet effet : « Nous n'acceptons pas davantage
de voir humilier l'art devant la science. » U 1
Au sujet de la « rêverie scientifique »112, il dira
aussi : « Le matériel dont il faut bien qu' il
s'embarrasse ne m'en impose pas non plus : ses tubes de
verre ou mes plumes métalliques... Quant à sa méthode, je
la donne pour ce qu'elle vaut la mienne. »113 Et, dans
une référence directe à Babinski :
J'ai vu à l'œuvre l'inventeur du réflexe cutanéplantaire ; il manipulait sans trêve sessujets, c'était tout autre chose qu'un« examen » qu'il pratiquait, il était clairqu'il ne s'en fiait plus à aucun plan. De-cide-là, il formulait une remarque,lointainement, sans pour cela poser sonépingle, et tandis que son marteau couraittoujours. Le traitement des malades, il enlaissait à d'autres les tâches futiles. Ilétait tout à cette fièvre sacrée. 114
Fort de tout cela, le point nodal qui est soulevé c'est
celui de la doctrine qui endort l'esprit. La doctrine,
c'est une théorie qui est spoliée de sa fonction de
110 André Breton, Entretiens ; 1913-1952, p. 55111 Ibidem, p. 4 9112 André Breton, Manifestes du surréalisme, p. 59113 Ibidem, p. 59114 Ibidem, p. 59
74
stimuler la réflexion. Il s'agit d'un discours fermé qui
s'explique constamment par une autoréférence.
Boris Cyrulnik raconte que : « Paul Valéry disait que
deux grands dangers menacent l'homme, le désordre et
l'ordre »115. Quoi qu'il en soit, c'est très exactement
ce qui est en jeu : l'ordre qui engourdit devant le
désordre chaotique. Et Breton sera très clair à ce
sujet, dans La Confession dédaigneuse, il déclare :
Jusqu'à nouvel ordre tout ce qui peut retarderle classement des êtres, des idées, en un motentretenir l'équivoque, a mon approbation. Monplus grand désir est de pouvoir longtempsprendre à mon compte l'admirable phrase deLautréamont : « Depuis l'imprononçable jour dema naissance, j'ai voué aux planches somnifèresune haine irréconciliable. »116
André Breton parle d'« équivoque » donc, de méfiance, de
critique, de résistance, de soupçons. Dans la
perspective ainsi tracée, il ne s'agit pas de rejet en
bloc. Il s'agit d'une perte de la naïveté, de ne pas
être dupe à l'égard de ce qui est présenté, de se méfier
des illusions sociales. En l'occurrence, la méfiance
suppose un mouvement de la pensée. C'est donc dans ce
contexte tout à fait précis que se situe la
réintroduction de Breton à Paris, le retour à la poésie
et la rencontre de Soupault et d'Aragon.
3.2 Les rencontres de Philippe Soupault et de Louis Aragon
5 Boris Cyrulnik, Edgard Morin, Dialogue sur la nature humaine, p. 476André Breton, Les Pas Perdus, p. 17
75
À Paris, Breton fréquente assidûment Guillaume
Apollinaire et Reverdy qui dirige la revue Nord-Sud.
C'est par l'intermédiaire de ces derniers qu'il fait la
rencontre de Philippe Soupault. Jeune poète, homme
agréable et diplomate, il partage avec André Breton une
grande admiration pour Apollinaire et Rimbaud.
Contrastant en ce point avec Breton, Soupault répondit
tardivement à l'émoi poétique. Comme le souligne très
justement Marguerite Bonnet dans son ouvrage André
Breton et la naissance de lfaventure surréaliste :
«... il attribue au vertige où le plonge unvoyage à Londres au début de l'été 1914 lanaissance en lui de l'état poétique, mais ilfaudra une seconde Visitation survenue sur unlit d'hôpital à Paris en février 1917 pour lechanger en acte, le premier poème. »117
Ce premier contact avec la poésie à Londres explique
peut-être l'attrait éprouva pour la littérature
anglaise. Or, son érudition moins exhaustive que Breton,
se présente comme un avantage dans le parcours de
Soupault. Elle lui permet une plus grande liberté.
Philippe Soupault n'a pas à se déprendre de la tradition
littéraire. Pour Breton, la poésie de Soupault témoigne
du présent. Elle est rafraîchissante et naturelle, tout
comme l'attitude du jeune homme qui l'accueille en tout
temps et en tous lieux où elle se présente.
Au début de l'automne 1917, c'est dans une chambrée du
Val-de-Grâce qu'il aperçoit, pour la première fois,
Louis Aragon. L'auteur du Paysan de Paris, faisant part
117 Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance de 1'aventuresurréaliste, p.124
76
de sa première impression sur André Breton,
précise : « Le voisin d'en face avait une façon assez
cérémonieuse de parler, une politesse légèrement
affectée, qui avait des airs de protestation contre
l'atmosphère à la caserne. »118 Comme nous le dit André
Breton dans ses entretiens radiophoniques, le véritable
contact entre les deux hommes s'établit, peu de temps
après, à la librairie d'Adrienne Monnier nommée « La
Maison des amis des Livres » alors située sur la rue de
l'Odéon. Il s'agissait là d'un point de rencontre où
s'échangeaient beaucoup d'idées. Un endroit
incontournable pour quiconque aimait la poésie. En
outre, madame Monnier ne manquait pas d'encourager la
jeunesse. Notons qu'Aragon était alors très complice
avec elle et fréquentait assidûment sa librairie.
André Breton dans ses entretiens radiophoniques relate
l'expérience de cette rencontre avec Aragon : « en
sortant de là, nous avions fait route ensemble vers le
Val-de-Grâce, où nous étions tous les deux astreints à
des obligations militaires, alternant avec des cours de
médecine à l'usage de l'armée. »119 Les deux jeunes gens
sont enchantés de leur rencontre et une véritable chimie
s'opère entre eux. Aragon explique : « ... il ne me reste
guère qu'une sorte de couleur exaltée de ce moment de
magie, un écho de notre interminable conversation
cantonnée sur ce boulevard sans fin remonté,
redescendu. »120 L'enthousiasme dont ils font preuve est
116 Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance de l'aventuresurréaliste, p.119119 André Breton, Entretiens : 1913-1952, p.41120 Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance de l'aventuresurréaliste, p.119
77
d'autant plus compréhensible. En cette période de fin de
guerre, les jeunes gens préoccupés par la poésie et ses
problématiques se raréfient.
En la personne d'Aragon, Breton découvre un autre
écrivain qui partage ses intérêts culturels et surtout
sa passion pour Arthur Rimbaud. Fidèle à son habitude,
Breton informe immédiatement Fraenkel de cette
prodigieuse rencontre. La lettre, datée du 7 octobre, en
témoigne : « II s'est si bien souvenu de L'Alchimie du
verbe, hier matin devant La Samaritaine ! Il faut
l'entendre sur l'esthétique commerciale. Son éloquence a
la couleur de celle de « Mouvement ».121 Cette passion
partagée pour l'œuvre d'Arthur Rimbaud, par Soupault et
Aragon, fait événement pour le jeune Breton. Il convient
de remarquer que certains de ses amis les plus chers,
tels que Apollinaire, Valéry et Vaché, étaient loin de
partager son enivrement pour Rimbaud. Breton dira
d'ailleurs, dans ses Entretiens radiophoniques, au sujet
d'Aragon : « Nul n'aura été plus habile détecteur de
l'insolite sous toutes ses formes ; nul n'aura été porté
à des rêveries si grisantes sur une sorte de vie dérobée
de la ville... »122
En ces temps troublés, il s'érige ainsi autour d'André
Breton un réseau très effervescent d'échanges
littéraires. Breton découvre la poésie d'Isidore Ducasse
(lequel signait ses œuvres avec le pseudonyme du Comte
de Lautréamont) qui le frappe par sa perception noire et
occulte de la vie moderne, ainsi que par le procès qu'il
121 Ibidem, p. 120122 André Breton, Entretiens : 1913-1952, p. 44
78
mène vis-à-vis de l'écriture. Pour ce faire, Lautréamont
met en pratique le processus de la négation systématique
et s'affaire à détourner des maximes moralistes. La
rencontre avec les écrits de Lautréamont se fait par le
biais du livre Les Chants de Maldoror. C'est Louis
Aragon qui les découvre, par inadvertance, dans un vieux
numéro de la revue de Paul Fort intitulée alors Vers et
Prose, à la librairie d'Adrienne Monnier. À ce moment,
mobilisés au même hôpital, Breton et Aragon se portent
régulièrement volontaires pour effectuer la garde de
nuit. Loin d'être le témoignage d'une grande dévotion à
leurs tâches, cette période, fort propice à
l'inspiration de l'émotion poétique, devient pour eux un
moment bien désigné pour se lire de vive voix des
passages du livre de Lautréamont. Les lieux créent le
décor et c'est sur un arrière-fond de hurlements, de
larmes et de terreur que s'effectue leur rencontre avec
ce texte.
Au cours de cette période, ses nouvelles recherches
portent principalement sur le lyrisme et sur l'idée
moderne de la vie. André Breton explique :
J'entends à ce moment, par lyrisme, ce quiconstitue un dépassement en quelque sortespasmodique de l'expression contrôlée. Je mepersuade que ce dépassement, pour être obtenu,ne peut résulter que d'un afflux émotionnelconsidérable et qu'il est aussi le seulgénérateur d'émotion profonde en retour c'estlà le mystère l'émotion induite différera dutout au tout de l'émotion inductrice. Il y auraeu transmutation.
123 André Breton, Entretiens : 1913-1952, p.49
79
Et, il présente ainsi la modernité :
ce qu'alors entre nous nous appelons« moderne », sans nous dissimuler ce que cettenotion même a d'instable (...) il y va del'affranchissement total à l'égard aussi biendes modes de pensée que d'expressionpréétablies, en vue de la promotion nécessairede façon de sentir et de dire qui soientspécifiquement nouvelles et dont la quêteimplique, par définition, le maximumd' aventure.124
Or, ce à quoi il convient de prêter attention c'est que
ces deux notions puisent directement à la même source.
Elles s'articulent toutes deux autour des idées de
liberté, de métamorphose, de mouvement, d'émotion. La
façon dont il développe et présente ces notions mérite
aussi que l'on s'y attarde un peu. Elles sont toutes
marquées par de grandes ouvertures. Il s'agit de
constructions très éthérées qui laissent à l'auteur un
maximum de latitude. Breton navigue, il semble
littéralement incapable d'énoncer clairement son idée.
Serait-ce la peur d'enfermer le concept ? On peut le
penser. Paradoxalement, l'effort déployé dans le premier
Manifeste du surréalisme pour définir de façon presque
encyclopédique le surréalisme porte à croire que Breton
témoigne ici d'indécision. Dans la perspective ainsi
tracée, l'exemple de lyrisme le plus révélateur aux yeux
de Breton semble l'exubérance des « Beau comme » dans
les Chants de Maldoror du Comte de Lautréamont : « Beau
comme la rencontre fortuite, sur une table de
dissection, d'une machine à coudre et d'un
parapluie. »12! II semble que, à l'image d'Isidore
124 Ibidem, p. 4 2125 André Breton, Entretiens : 1913-1952, p. 449
80
Ducasse, Breton cherche à délivrer le discours poétique
des règles qui organisent sa circulation. Ducasse
utilise l'écart des termes pour déstabiliser et faire
ressortir les virtualités inexprimées du discours
poétique. On se joue des règles pour provoquer
l'émotion. L'écriture prend alors fonction d'outil vers
une quête qui outrepasse de beaucoup les considérations
propres au style.
Cette quête semble plonger ses racines dans la recherche
d'une façon d'être humain, d'aborder la vie pour
s'affranchir de toutes formes d'aliénation. Lorsque
Breton parle de cette période, il énonce le « climat »
du local où Reverdy les reçoit, de l'ambiance du
« pigeonnier » d'Apollinaire, la « mobilité d'esprit »
d'Aragon, l'attitude de Soupault, l'attitude aussi de
Gide dans Paludes ou Prométhée mal enchaîné. Ce sont
des considérations portant sur une façon d'être dans le
monde. Quoi qu'il en soit, il en ressort un fait
indéniable : André Breton témoigne davantage de ce qu'il
ne veut pas que de ce qu'il veut. D'entrée de jeu, il y
a des choix. Breton refuse le contrôle, il rejette le
convenu et cherche à s'éloigner du connu. La visée est
déterminée par la notion de métamorphose. La voie pour y
parvenir, c'est la force de l'émotion. Ce qu'il reste à
définir c'est la méthode et la précision de l'objectif.
André Breton assoit sa position à la croisée des
chemins. Dans ses Entretiens, il dit : « Peut-être
attendais-je une sorte de miracle • de miracle seulement
pour moi de nature à m'engager dans une voie qui ne
126 Ibidem, p . 42-47
81
fut que la mienne. » Breton cherche, les indices
s'accumulent, reste la révélation.
3.3 Clore la Guerre au bras de la désespérance
En septembre 1918, de retour d'un bref séjour au Centre
d'instruction de Noailles, André Breton rentre à Paris.
Il s'installe dans une chambre de l'hôtel des Grands
Hommes, place du Panthéon. Pour Breton, la fin de la
guerre est marquée par les décès successifs de Guillaume
Apollinaire et de Jacques Vaché. Apollinaire cède à la
grippe espagnole la veille de l'armistice et Jacques
Vaché meurt d'une façon suspecte en janvier 1919. Breton
interprète cette mort comme un suicide. Pour lui, c'est
probablement le dernier acte d'éclat commis par Jacques
Vaché. Les réponses de Breton à un questionnaire de Max
Jacob que Marguerite Bonnet cite dans son ouvrage
témoignent bien de son état d'âme du moment :
Son occupation favorite ? la méditation. Letrait principal de son caractère ? - Le doute.Les défauts qu' il hait le plus ?l'insensibilité et l'esclavage. Sa plus grandepeine ? la perte d'un être cher. Son étatd'esprit actuel ? le deuil. Son ambition ?devenir l'anarchiste parfait.12'
L'un de ses sujets de méditation sera un commentaire
écrit par Pierre Reverdy, publié dans par le numéro du
mois de mars 1918 de la revue Nord-Sud:
L'image est une création pure de l'esprit. Ellene peut naître d'une comparaison, mais durapprochement de deux réalités plus ou moins
127 Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance de 1'aventuresurréaliste, p.148
82
éloignées. Plus les rapports des deux réalitésrapprochées seront lointains et justes, plusl'image sera forte - plus elle aura depuissance émotive et de réalité poétique...etc.128
Cet énoncé poursuit en substance les considérations
soulevées par les textes du Comte de Lautréamont. André
Breton est alors encore tout habité par l'idée de
trouver la « recette »129 du lyrisme.
3.3.1 Littérature
Déçus des publications en vigueur, Breton, Aragon et
Soupault envisagent de créer leur propre revue
littéraire. En fait, ils souhaitent présenter une
publication qui répondrait, comme le dira plus tard
Aragon, au :
besoin qu'[ils] ressentaient] de [se] mêler àune vie réelle, comme celle des soirées deParis, où règne une sorte de grand airnocturne, éclairage violent des cafés bordésde trottoirs, où tout le monde est admis sanspasseport. 13°
Déjà, dans cette description de leur expérience, on voit
poindre le désir de rendre accessible la poésie à tout
un chacun. Cette poésie, ils la voulaient empreinte de
la « vraie vie », marquée de ce qui deviendra les
espaces surréalistes. L'influence de Rimbaud et de
l'importance qu'il accorde à la ville, dans sa poésie,
s'y fait déjà sentir. Or, le projet ne pourra avoir lieu
avant le début du mois de mars 1919, au moment où
128 André Breton, Les manifestes du surréalisme, p. 31129 Ibidem, p. 30130 Mark Polizzotti, André Breton, p .108
83
Breton, Soupault et Aragon fondent la revue Littérature
(intitulée comme telle, faute de nom plus accrocheur,
sur une suggestion donnée par Paul Valéry). Ce titre,
qui doit trancher avec une couverture jaune vif, porte,
bien sûr, à l'ironie. Breton expliquera que s'ils ont
décidé d'utiliser ce titre « c'est par antiphrase ». Or,
dans cette optique sarcastique, « Verlaine n'a plus
aucune part. »131
La revue bénéficie d'un bon accueil dans l'univers
littéraire, compte tenu de la disparition en octobre
1918 de Nord-Sud, la revue parisienne de Pierre Reverdy,
et de l'arrêt temporaire de la Nouvelle Revue
française.Littérature est ainsi perçue à l'époque comme
la seule publication permettant de mettre en lumière des
œuvres récentes. Breton, Aragon et Soupault sont vite
considérés, par ci et par là, comme de dignes
successeurs des grands représentants de la poésie
française. Certains aspects de ce succès horripilent
d'ailleurs profondément Breton. À la fin du mois de
mars, Aragon, qui est posté en Alsace, est de passage à
Paris lors d'une permission. Au cours d'une promenade au
jardin des Tuileries, lui et Breton font le constat. Les
deux poètes, en discutant du contenu du deuxième numéro
de la revue Littérature, furent frappés d'effroi !
Aragon raconte l'événement :
Nous étions accueillis comme les successeurs,les héritiers, par nos aînés. (...) Une carrièrecomme une autre. C'était déjà entendu.Merde.132
131 ibidem, p. 110132 Mark Polizzotti, André Breton, p .111
84
Devant cet état de réception générale qui les dégoûte,
les deux hommes en viennent à la conclusion que leur
seule solution de rechange est de découvrir les attentes
de leurs lecteurs, afin de pouvoir les contrer. Leur
but : être catalogués comme de grands infréquentables...
La rancoeur ressentie face à l'institution littéraire
trouvait son origine dans l'indignation éprouvée lorsque
les deux poètes ont constaté que les figures marquantes
de ce milieu joignaient leur force à l'effort de la
guerre. Avec ses chroniques de propagande matinale
pendant les quatre années de la guerre, Barrés figurait
au premier rang des traîtres. Dada se chargera bientôt
de faire son « procès ». Ce constat est combiné avec la
vanité prépondérante d'un univers où les membres s'auto-
glorifient de l'ajout d'un nouveau roman à leurs
productions. Ces ajouts n'ont d'ailleurs souvent pour
but que de mousser la gloire aussi éphémère qu'illusoire
de ces « pohètes », comme les appelait, avec son ironie
caractéristique, Jacques Vaché. La juxtaposition de ces
éléments provoque un véritable sentiment d'horreur chez
ces jeunes révolutionnaires.
3.3.2 L'acte de sédition envers l'attitude réaliste
Pour mieux comprendre la portée de cette injonction, il
convient d'examiner le phénomène qui sévit sur la
France. André Breton précise dans ses Entretiens
radiophoniques :
85
Tenez compte du fait que durant le printemps etl'été 1919 qui voient paraître les six premiersnuméros de Littérature, nous sommes loin d'êtrelibres de nos mouvements : je ne seraidémobilisé qu'en septembre et Aragon quelquesmois plus tard. (...) l'inévitable conciliabuledes soldats de retour du front avait eu vitepour effet d'exalter rétrospectivement lessujets de colère : sentiment de l'inutilité dusacrifice de tant de vies, grand « compte àrégler » avec l'arrière dont le fameux esprit« jusqu'au-boutiste » était allé si longtempsde pair avec un affairisme dépourvu descrupule, brisement d'innombrables foyers,extrême médiocrité du lendemain. L'enivrementde la victoire militaire avait fait long feu...On ne pouvait les empêcher de confronter leursexpériences, de juxtaposer leurs informationsparticulières que la censure avait tenu àl'abri de toute communication de quelquesenvergures, non plus que de découvrir l'ampleurdes ravages de la guerre, la passivité sanslimites qu'elle avait mise en œuvre et, quandcette passivité avait tenté de se secouer,l'affreuse rigueur de la répression qui s'enétait suivi. Les pouvoirs dont je parlaisbravant l'extrême impopularité du temps de laguerre n'eurent aucune peine à se maintenir,quitte à promouvoir, comme exutoire à larévolte intérieure qui menaçait de faire tached'huile, un cérémonial d'une sombre misère,prévoyant l'inauguration ininterrompue de cesmonuments aux morts qui subsistent de nos jourscomme témoins d'un âge de vandalisme et leculte rendu, à Paris, place de l'Étoile, au« soldat inconnu »...133
Devant faire face à l'inévitable échec de la mesure de
censure sociale, les autorités investissent dans un
processus de valorisation. On rend hommage à tous les
soldats, valeureux inconnus, morts dans l'anonymat et
ayant bravement donné leur vie pour sauver la Patrie.
3André Breton, Entretiens ; 1913-1952, p.55
86
Une façon bien maigre de remercier les familles pour le
massacre de leurs enfants. Il s'agit de l'implantation
du mythe du héros.
Ce nouveau registre de discours converge vers une
nouvelle signification donnée à ce « cloaque de sang, de
sottise et boue134 ». Il repose sur l'établissement d'un
nouveau rapport à l'homme du peuple qui permet à la
puissance bureaucratique de bétonner son pouvoir. Le
héros inconnu, c'est celui qui émeut les foules, celui
qui rend fier d'être français, celui qui justifie
l'action. Ce discours permet donc une réactivation du
pouvoir de domination sur le peuple. Il s'agit d'un
séduisant traquenard permettant de piéger les dissidents
par la diffusion fine d'une autre forme de censure.
L'opération alors entreprise consiste à parler
constamment du désastre. Or, de quelle façon en parle-t-
on ? D'une seule. On construit une version romantique
des faits avec le minimum de portions de réel pour être
crédible. Cette version plait aux masses et les
réconforte. De telle sorte que la populace n'acceptera
d'entendre que cette unique version à l'instar de
quelques variations. Il s'ensuit une annihilation
supplémentaire du discours vrai, celui qui choque
profondément l'auditeur et conduit à la révolte. À un
détail près qui a son importance et tient au fait que
c'est le peuple qui la commande. Conséquemment, par le
processus de séduction c'est, plus perversement, une
censure à l'interne qui s'impose. Le mythe du héros
134 Ibidem, p. 29
87
fournit un exemple permettant aussi d'illustrer l'une
des injonctions de Breton envers l'attitude réaliste.
André Breton s'insurge en parlant de l'« intraitable
manie qui consiste à ramener l'inconnu au connu »135.
L'expérience de la guerre telle qu'elle s'est déroulée
pour ces très jeunes soldats est de l'ordre de
1'infigurable. Elle outrepasse l'entendement par le
renversement des règles d'orchestration du réel connu.
Masson le soulignait. Les soldats hébétés par l'ampleur
de l'horreur ne s'émouvaient plus devant les restes
humains qui ornaient les terres labourées par les éclats
obus. Ils étaient, par contre, frappés de frayeur devant
l'esthétique du jeune soldat mort dans une position de
vivant.
À l'évidence, l'attitude réaliste rejette 1'infigurable.
Elle fixe des repères qui s'enracinent dans le commun
et, autour de ces repères, elle brode la représentation.
C'est ainsi que les soldats qui épanchent le frisson
éprouvé devant ces morts provoquent trivialement le
rire. André Breton le dit tout net dans le Premier
Manifeste du Surréalisme :
Par contre, l'attitude réaliste, inspirée dupositivisme, de saint Thomas à Anatole deFrance, m'a bien l'air hostile à tout essorintellectuel et moral. Je l'ai en horreur, carelle est faite de médiocrité, de haine et deplate suffisance. C'est elle qui engendreaujourd'hui ces livres ridicules, ces piècesinsultantes. Elle se fortifie sans cesse dansles journaux et fait échec à la science, à
135 André Breton, Les manifestes du surréalisme, p.19
88
l'art, en s'appliquant à flatter l'opinion dansses goûts les plus bas ; la clarté confinant àla sottise, la vie des chiens. L'activité desmeilleurs esprits s'en ressent ; la loi dumoindre effort finit par s'imposer à eux commeaux autres. 136
Dans le prolongement de ce processus réducteur s'inscrit
le discours sur la déchéance de la puissance de
l'imagination avec lequel André Breton entame le Premier
Manifeste. Il s'agit d'une injonction majeure contre
l'attitude réaliste, c'est-à-dire le rejet systématique
de l'inconnu, de 1'infigurable. L'imagination est alors
perçue comme la faculté que possède l'esprit de former
des images d'objets inusités, de faire des combinaisons
nouvelles d'idées, et notamment, de se représenter des
situations possibles, mais non connues.
Pour André Breton, la sécheresse de l'imagination donne
soif d'émoi et l'acte d'écrire se doit d'avoir une
fonction autre. Il ne peut être réduit au piètre emploi
littéraire. La poésie, telle que Breton la conçoit,
devient « une solution particulière du problème de notre
vie »137. La vie est ici perçue comme cette attitude
fataliste qui contraint les hommes à prendre pour seule
vérité cette vision médiocre de la réalité. Elle se
traduit par la notion de l'indifférence. Dans le premier
Manifeste il précise : « C'est vivre et cesser de vivre
qui sont des solutions imaginaires. L'existence est
ailleurs. »13 La conception de la vie doit donc être
entendue non pas comme « être biologiquement vivant »,
mais « goûter l'existence ». Pour Breton, le langage
136 André Breton, Les manifestes du surréalisme, p.16137 Mark Polizzotti, André Breton, p .112138 André Breton, Manifestes du surréalisme, p.60
89
offre la possibilité de métamorphoser la représentation,
le sens et la portée de l'existence humaine. L'esprit en
est le moteur d'action et la poésie, un des principaux
outils permettant la révolution sociale.
Pour raffiner et exalter cet outil, il est impératif que
le poète sache étendre la portée de sa poésie. Il se
doit de la démocratiser en la sortant du monde des
initiés complaisants dans lequel elle baigne. Il s'agit,
dans les mots de Lautréamont, de créer une poésie faite,
« non par un, mais par tous ». L'objectif recherché est
de lui donner un impact aussi large et efficace que
celui de la publicité. Aragon précise à ce sujet qu'à
cette période, lorsqu'ils écrivaient un poème, une
question les hantait :
Est-ce que ce poème tiendrait le coup si on enfaisait une affiche, est-ce que les gens, dansla rue, srarrêteraient pour le lire ?139
La publicité est non seulement construite de façon à
atteindre la masse, afin de modifier son comportement
relativement au marché, mais elle possède la capacité de
revigorer le langage en insérant dans l'inconscient
collectif certains syntagmes figés de la langue de tous
les jours, qu'elle dépoussière et reformule.
Breton s'intéresse alors à la réclame, suivant l'exemple
de Dada et répondant à l'appel du défunt Apollinaire,
qui déclare : « Rivalise donc poète avec les étiquettes
139 Idem.
90
des parfumeurs »140. Il publie donc dans Littérature le
poème Corset-Mystère, un collage. En intégrant des
sections de publicité et des phrases toutes faites,
Breton fait déjà preuve de l'influence à la fois des
« poèmes-conversations » et des calligrammes
d'Apollinaire et des phrases détournées de Lautréamont.
Sa correspondance avec Sami Rosenstock, mieux connue
sous le nom de Tristan Tzara, auteur des manifestes de
Dada, encourage ses appréhensions quant à la conception
officielle de l'écriture lorsqu'il déclare dans une de
ses lettres :
Si l'on écrit, ce n'est qu'un refuge : de tout« point de vue ». Je n'écris pas par métier.(...) On écrit aussi parce qu'il n'y a pas assezd'hommes nouveaux, par habitude...141.
Cet énoncé amène Breton à publier quelques mois sa
célèbre enquête : « Pourquoi écrivez-vous ? ».
L'objectif alors poursuivi par les auteurs est de
dénoncer la cambrure à laquelle se livre l'univers
littéraire et d'en piéger la vanité. Les réponses sont
publiées « par ordre de médiocrité »142. Parmi toutes les
réponses reçues, deux ont pourtant tranché par leur
justesse et leur intérêt, soit celle de Paul Valéry, qui
répond très ironiquement : « Par faiblesse », et celle
de Knut Hamsun, qui déclare : « J'écris pour abréger le
temps ».
La combinaison de ces multiples éléments plonge Breton
dans une véritable quête de sens. Quelle est la fonction
140 Étienne-Alain Hubert et Philippe Bernier, André Breton, p.4141 ibidem, p. 4142 André Breton, Entretiens : 1913-1952, p. 61
91
profonde de l'écriture poétique ? Quelles limites la
sépare de la vie réelle ? Est-il bon de maintenir ces
limites ? Où se forment les images ? La recherche des
réponses à ces questions le pousse à éplucher des
sources de données hétéroclites, passant de l'étude des
propos rapportés des malades psychiatriques de l'Hôpital
Saint-Dizier à celle du langage publicitaire, en passant
par les réflexions sur le lyrisme de Reverdy. Ces
diverses pistes le dirigent vers l'hypothèse voulant que
les images ne soient pas issues d'une construction
rationnelle et consciente, mais bien d'un élément
universel à l'esprit humain.
En outre, André Breton demeure fasciné par les phrases
stupéfiantes qui lui sont « données » au cours des
périodes de demi-sommeil. Le phénomène capte son
intérêt. L'une de ces phrases : « II y a un homme coupé
en deux par la fenêtre »143 retient particulièrement son
attention par son « caractère organique »144 et son style
singulier. Il explique :
« À n'en pas douter, il s'agissait du simpleredressement dans l'espace d'un homme qui setient penché à la fenêtre. Mais cette fenêtreayant suivi le déplacement de l'homme, je merendis compte que j'avais affaire à une imaged'un type assez rare et je n'eus d'autre idéeque de l'incorporer à mon matériel deconstruction poétique. »145
143 André Breton, Manifestes du surréalisme, p.31144 Ibidem, p. 31145 Ibidem, p. 32
92
Pour Breton, ces phrases insanes ne sont certainement
pas dépourvues de signification. L'esprit donne l'image,
il n'y a qu'à tendre la main. Dès lors, à travers cet
énoncé, ce sont les considérations soulevées par Reverdy
dans Nord-Sud qui sont mises en lumière. Ce constat
guide la réflexion de Breton dans une direction bien
précise : celle de la présence intrinsèque de la poésie
en chaque être.
Breton trouve un soutien à cette hypothèse en comparant
son expérience à deux phénomènes, selon lui, afférents.
Il s'agit des expériences respectives de Knut Hamsun et
de Giorgio De Chirico. En effet, il semble que Knut
Hamsun profitait des troubles hallucinatoires causés par
la carence alimentaire pour écrire. Et, selon les dires
d'Apollinaire, Giorgio De Chirico aurait produit ses
premières œuvres en proie à des troubles cénesthésiques.
Fondamentalement, il s'agit de situations où la
privation et l'agression corporelle tendent à amplifier
le processus de création en obéissant à un instinct
vital. Fort de son expérience médicale, Breton voit se
dessiner un triangle « création, écriture et pulsions ».
Cette réflexion est encouragée par le concept de
l'association libre mise au point par Sigmund Freud.
Dès cet instant s'opère un renversement. Il semble que
ces apparitions, qu'au départ il se contentait de noter,
il cherche maintenant à les provoquer. L'auteur
raconte :
Tout occupé que j'étais encore de Freud àcette époque et familiarisé avec ses méthodes
93
d'examen que j'avais eu quelque peu l'occasionde pratiquer sur des malades pendant laguerre, je résolus d'obtenir de moi ce quel'on cherche obtenir d'eux, soit unmonologue de débit aussi rapide que possible,sur lequel 1'esprit critique du sujet ne fasseporter aucun jugement, qui ne s'embarrasse,par la suite, d'aucune réticence, et qui soitaussi exactement que possible la penséeparlée.1*6
Ce désir affirmé, i l s'agit de poser le problème de la
méthode qui permettra d 'uti l iser le langage comme un
outil permettant de sonder l'univers inconscient.
146 Mark Polizzott i , André Breton, p .120
95
contient l'idée d'une force passionnée, naturelle,
invisible, insaisissable bien que saisissante. Et,
d'autre part, il fait référence aux enseignements du
« grand magnétiseur »14 que fut, pour eux, Isidore
Ducasse, le Comte de Lautréamont.
On peut se demander quelles furent les motivations qui
amenèrent André Breton à choisir de tenter l'expérience
de l'écriture automatique en compagnie de Philippe
Soupault. Au-delà des circonstances c'est-à-dire de la
disponibilité de celui-ci, il semble que ce choix soit
dicté par une double motivation. La première tiendrait à
la qualité de la relation que Breton entretient avec le
jeune homme. En la personne de Philippe Soupault, Breton
trouvait un ami cher, curieux, aventurier, partageant sa
fascination pour la psychanalyse. La seconde relève du
fait que Philippe Soupault, par opposition à Aragon par
exemple, paraît suffisamment détaché de sa production
écrite pour oser l'expérience.
L'aventure débuta par de nombreuses lectures, suivies de
longues discussions sur la psychologie et l'esthétique.
Ces discussions répondent à une fonction de nécessité.
Elles ont pour but de permettre l'enfantement des
caractéristiques fondamentales du projet et le choix des
techniques qui seront préconisées. La méthode de Breton
et de Soupault se donne la tâche de renverser la méthode
classique de production littéraire. Celle-ci s'appuie
sur la pensée comme le moteur qui impose à l'œuvre sa
structure. Dans le processus d'une création automatique,
Mil Danièle Rousselier, p.3
96
il s'agira de privilégier une démarche inverse.
L'objectif poursuivi consiste alors à construire le
texte avant que l'intention de l'auteur n'intervienne. À
travers cette inscription, le signe aura précédé le
sens. Il s'agit donc de délivrer l'énoncé de la censure
consciente qui en surveille la justesse. De toute
évidence, ce qui est en jeu, c'est une manipulation de
la conscience qui a une tâche stratégique : déstabiliser
le destinataire afin d'amener le lecteur par la voie de
l'étonnement vers l'émerveillement. De là suivent trois
conséquences.
1.- L'art d'écrire automatiquement devrait permettre de
démocratiser l'écriture. Il a pour fonction de démontrer
que tous ont, enfouis au plus profond de leur être, le
pouvoir de créer.
2.-Il devrait permettre aux auteurs une meilleure
connaissance d'eux-mêmes.
3.- La réintégration et la mise au jour du discours
rendu muet par la conscience devrait permettre de jeter
un regard insolite sur le visible.
Or, l'affaire n'est pas simple ! Breton est tout à fait
conscient que l'élaboration d'un tel processus
d'écriture allait susciter de vives réactions quant à la
valeur intrinsèque de l'expérience. Aussi devait-il se
fixer un protocole d'action lui permettant de lui
attribuer un certain crédit. Pour ce faire, il établit
quelques règles permettant d'encadrer l'expérience.
Elles sont les suivantes : a) les auteurs se donnent une
semaine pour couvrir des pages de phrases, en se
désintéressant de la qualité littéraire du résultat ; b)
97
il ne doit y avoir ni réflexions, ni corrections ; c)
les auteurs doivent éliminer toute influence directe
extérieure ; d) l'arrêt de rédaction est déterminé par
l'écoulement du temps alloué.
Les auteurs s'intéressent à la liaison unissant la
pensée et la parole en se donnant comme support
l'écriture. Dans cette visée, la rapidité de rédaction
devient une notion cardinale à considérer. Guidés par un
louable souci de rigueur méthodologique, Breton et
Soupault se sont fixé des repères. Il s'agit d'éléments
de mesure qui devaient servir à évaluer la vélocité,
effectuer des comparaisons et tirer de plus justes
conclusions. Pour ce faire, ils ont élaboré une échelle
de gradation. Cette échelle va comme suit : V ' équivaut
à une cadence d'écriture nettement supérieure au rythme
de rédaction usuelle, V ' réfère à une vitesse d'un rang
plus élevé que la précédente et V ' ' se rapporte à la
prestesse la plus accrue possible. Pour atteindre cette
vitesse, les auteurs doivent recourir à certaines
abréviations.
Il est clair que le souci d'expérimenter divers degrés
de vitesse a précisément pour fonction d'établir un lien
direct entre la pensée, la parole et la rédaction. André
Breton, dans le Manifeste du surréalisme de 1924, fait
part de ce constat face à l'expérience automatique. Pour
lui, la rapidité de la pensée correspond à celle de la
parole. Dès lors, on peut penser qu'elle s'accorde avec
« la plume qui court »149. En 1930, il spécifie :
Cité dans : Mark Polizzotti, André Breton, p .123
98
Peut-être ne fera-t-on jamais plusconcrètement, plus dramatiquement saisir lepassage du sujet à l'objet, qui est à1'origine de toute la préoccupation artistiquemoderne.150.
En fait, ces diverses techniques permettent aux auteurs
de mesurer la force de l'étincelle et de parvenir à
créer une relation comparable à la symbiose. Pour
parvenir à ce but, les auteurs plongent l'expérience
dans le secret le plus total. Cet état de
confidentialité est impératif. Il est relié à la nature
de l'expérience qui commande aux sujets une véritable
déprise mentale.
Il convient aussi de souligner que deux endroits sont
déterminés pour le déroulement de cette expérience. Elle
aura lieu dans un bureau d'administration militaire et
la chambre occupée par André Breton à l'hôtel des Grands
Hommes. Ils rédigent ainsi séparément trois des huit
chapitres prévus. Les résultats sont lus et comparés
chaque soir. Or, il arrive que certains paragraphes
soient interchangés et échangés par les deux auteurs
puis découpés et collés.
Pour la rédaction d'autres chapitres, Breton et Soupault
décident de s'asseoir face à face à une table, et ils
rédigent en alternance. Le texte s'exécute alors à la
façon d'un dialogue. L'un d'eux rédige quelques phrases,
il les lit ou les laisse entrevoir à son vis-à-vis.
150 ibid.
100
celui « qui vient de mettre au jour le filon
précieux »152.
Cette force magnétique, dont ils sont les instaurateurs
semble se diffuser jusqu'à envahir les lieux. Les
auteurs s'investissent avec sérieux dans l'expérience et
rédigeant, de façon soutenue, pendant huit à dix heures
par jour. L'épuisement devient, pour l'heure, une carte
maîtresse. Il a pour fonction d'intensifier la tombée
dans le gouffre de l'inconscient. À certains moments,
lorsque la rapidité d'écriture atteignait ses plus hauts
sommets, leur état de concentration était tel que les
hallucinations étaient imminentes. Or, cet extrait du
chapitre intitulé « Éclipse », en est un
exemple éloquent :
Suintement cathédrale vertébré supérieur.
Les derniers adeptes de ces théories prennentplace sur la colline devant les cafés quiferment.
Pneus pattes de velours...153
André Breton attribue à cette dernière phrase le
sentiment, un certain après-midi à la place de l'Étoile,
d'avoir été traqué « par des chats qui étaient peut-être
(mais je vous prie de me croire : seulement peut-être)
des autos. »154 Éclipse et Le pagure dit II forment les
deux textes qui furent rédigés à la vitesse la plus
élevée. Ces deux textes ont en commun d'être habités par
des considérations plus ténébreuses. Il ressort des
152 Ibidem, p .124153 ibidem, p. 125154 André Breton, Philippe Soupault, Les Champs Magnétiques, p.15
99
Celui-ci compose le plus rapidement possible la suite.
Cette manoeuvre a pour objet de produire un auteur à
deux têtes (pour reprendre l'expression d'Aragon) 151. Il
semble pourtant que ce faire ait connu quelques
infortunes, car dans la section intitulée « Barrières »,
il est possible de reconnaître la part attribuable à
André Breton. Il s'agit d'une part considérable, car
elle correspond à la rédaction quasi entière d'un
chapitre sur deux. En revanche, les autres chapitres
répondent presque parfaitement à cette définition.
Dans la pratique de l'automatisme, le sujet pénètre dans
un sentiment proche de celui de la somnolence. Cet état
crée une distance entre les auteurs et le monde
extérieur. Le sujet pénètre dans un univers éthéré, ce
qui a pour effet d'intensifier sa lucidité. Cette
sensation de plénitude est accompagnée d'un
engourdissement qui envahit tout le corps. Si l'activité
cesse à ce moment précis, le sujet se trouve
désorienté : ses jambes vacillent et son regard n'arrive
plus à se fixer, son corps et son esprit sont las... Or,
il paraît difficile de rompre avec cet état, même entre
les séances. Le cerveau demeure apaisé et flottant.
Corollairement, il semble que l'individu qui subit cette
sensation est, communément, enclin à la rechercher par
la suite... La pratique de l'automatisme surréaliste
semble s'accompagner d'un émoi profond. André Breton
compare cette sensation d'ivresse à celle éprouvée par
Mark Polizzotti, André Breton, p .122
101
phrases quelquefois très lourdes et empreintes du climat
funeste du dernier chapitre. On le perçoit dans cet
extrait :
Lorsque l'on retourne le dos à cette plaine,on aperçoit de vastes incendies. Lescraquements et les cris se perdent ; l'annoncesolitaire d'un clairon anime ces arbresmorts.155
Il est évident qu'en atteignant cette prestesse, la
question de l'intention s'évade d'elle-même. Dès lors,
cet extrait n'en devient que plus troublant. Il se
démarque tant par sa limpidité que par la charge émotive
qui en émerge. Il met en jeux un certain nombre de
remémorations liées à l'expérience guerrière et aux
plaies qui l'accompagnent. Visiblement, ces jeunes gens
sont tourmentés par la tragédie de fraîche date.
D'ailleurs, les références au sang et aux bourrèlements,
tout au long du recueil, le confirment.
On voit aussi surgir des images qui confondent
l'entendement, laissant le lecteur perplexe. Certes, ce
discours hiéroglyphique et sibyllin est porteur de sens.
Or, son interprétation demeure épineuse, et paraît
sporadiquement échapper à l'auteur lui-même. Les
formules qui émergent sont stupéfiantes. Les phrases,
qui semblent s'élever d'un horizon inconnu, s'animent
sous l'empire des pôles agissants.
On peut constater l'état des choses dans le texte
intitulé « La Glace sans tain » publié peu de temps
ibidem, p.20
102
après sa rédaction dans la revue Littérature. Il s'agit
là du chapitre qui fera office d'ouverture au recueil.
Ce texte énigmatique traite du désespoir. Son titre est
riche en références. La Glace sans tain fut, semble-t-
il, le premier titre alloué à une œuvre de Matisse et
rebaptisé par la suite La fenêtre bleue156.
Prosaïquement, une glace sans tain affère à l'idée de
ces « vitres-miroirs » qui voilent l'observateur tout en
dévoilant l'observé. Ce chapitre fut écrit à la vitesse
V selon l'échelle établie par les auteurs, c'est-à-dire
à la cadence la moins élevée. On remarque d'ailleurs que
cela lui permet de demeurer en relation avec le thème.
En fait foi l'extrait suivant :
Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommesque des animaux perpétuels. Nous courons dansles villes sans bruits et les affichesenchantées ne nous touchent plus. À quoi bonces grands enthousiasmes fragiles, ces sautsde joie desséchés ? Nous ne savons plus rienque les astres morts ; nos yeux tournent sansbut, sans espoir. Il n'y a plus que ces cafésoù nous nous réunissons pour boire cesboissons fraîches, ces alcools délayés et lestables sont plus poisseuses que ces trottoirsoù sont tombées nos ombres mortes de laveille. (...) Lorsque les grands oiseauxprennent leur vol, ils partent sans un cri etle ciel strié ne résonne plus de leur appel.Ils passent au-dessus des lacs, des maraisfertiles...157
Ce discours provoque, encore aujourd'hui, une sensation
d'ebahissement chez le lecteur. On y fait trembler
5 Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlyse dansl'expérience surréaliste, p.80157 André Breton, Philippe Soupault, Les Champs Magnétiques, p.21
103
l'univers de nos repères. Au vrai, le livre se présente
comme un prologue à l'aventure surréaliste. Il convient
de remarquer que les lieux, qui seront goûtés par
surréalistes, y sont déployés. Il suffit de songer à la
ville de Rimbaud, aux paysages exaltés et aux astres
dantesques d'André Masson, aux constellations dont se
saisira Miro. On y rencontre même cette « fenêtre
creusée dans la chair » que s'adjugera Dali.
Le caractère loufoque qui affleure épisodiquement de
cette écriture paraît encore en interloquer ses auteurs...
Selon les dires de Soupault, il semble qu'au-delà de la
surprise suscitée par la hardiesse des images, c'est
l'humour indélibéré et souvent insolite qui désamorçait
André Breton, provoquant l'euphorie. On voit de ce fait,
naître des phrases comme, par exemple :
La volonté de grandeur de Dieu le Père nedépasse pas 4810 mètres en France, altitudeprise au-dessus de la mer. 158
II est hors de doute que cette phrase caustique dénonce
un caractère afférant au burlesque. Au-delà de son
allégresse évidente, il convient de remarquer qu'à
l'image du reste du texte automatique cet énoncé est
bercé par le mystère. On devine sans efforts que les
moments passés au café La Source devaient prendre,
quelquefois, des allures de fête. Certes, les deux
hommes se découvrent une tendance à l'humour qui ne
gisait pas dans leur production consciente ou
« coutumière ».
158ibid.
104
Au vrai, le texte construit est hautement diapré
d'expériences qui ont trait à la vie de ses auteurs. On
y pressent leur désespoir, leurs préoccupations et leurs
influences. Dans un chapitre, écrit à moindre vitesse,
s'intitulant « Le pagure dit » on voit se profiler
l'influence exercée par Lautréamont. Ce crustacé hybride
semble directement issu de l'univers des Chants de
Maldoror. Il devient en quelque sorte l'« animal-totem »
de l'ouvrage tout entier. La lecture symbolique est
intéressante. Le pagure est cet animal aux pinces
rigides et au corps mou enfoui dans une coquille
étrangère. S'agit-il d'une métaphore représentant les
deux écrivains? On peut le penser. Dans cette visée,
l'animal évoquerait les auteurs, qui tentent de mettre
en lumière leur coquille c'est-à-dire la face cachée de
leur conscience. Suivant la même idée, un autre
parallèle s'effectue naturellement avec l'art d'écrire
automatiquement. Le parfum des « Chant Maldoror » se
fait aussi, sentir dans le chapitre intitulé : « En 80
jours ». Ce chapitre se rapproche du « roman » miniature
situé dans la dernière section de l'ouvrage.
Soulignons que dans ce procédé d'écriture, on ignore la
véritable fonction du langage. L'auteur se veut
inidentifiable. Dès lors, il devient tout aussi
impossible de déceler quelle section de l'esprit de
l'auteur est noircie sur le papier. Lorsque le travail
produit est le fruit d'une collectivité, on peut se
demander si les phrases transcrites doivent conserver
une individualité propre ou si elles peuvent être
interchangées. L'objet, la signification et le
105
destinataire sont tout aussi imprécis. À cet égard, il
paraît évident que le procédé automatique fait problème.
Le chapitre « Saison » fut, quant à lui, rédigé par
Breton seul et écrit à moindre vitesse. Il se présente
comme une épopée fiévreuse composée de fragments de
souvenirs du printemps d'André Breton. Le titre semble
s'inspirer du poème d'Arthur Rimbaud. On voit, dans ce
chapitre, surgir des éclats de joie qui s'articulent sur
un fond de lassitude et de déréliction. Il contient de
multiples énoncés teintés, entre autre, du séjour qu'il
passa, enfant, au domicile de son grand-père à Saint-
Brieuc en Bretagne. Ces extraits en font foi:
Le chromo du mur est une rêverie qui sereprésente toujours.
J'ai commencé à aimer les fontaines bleuesdevant lesquelles on se met à genoux. Quandl'eau n'est pas troublée (troubler l'eau nuit,paresser dans ce monde) on voit jaillir despierres les parcelles d'or qui fascinent lescrapauds. On m'explique les sacrificeshumains...159
Au dire de Breton, la première phrase est liée à une
image qui diaprait les murs de la chambre qu'il occupait
à cet endroit. Et le second extrait tire directement sa
source de l'atmosphère conservée de son séjour en ces
lieux. Or, l'intérêt cardinal de ces dévoilements tient
précisément au fait qu'André Breton n'était pas homme à
se livrer. Jamais, celui-ci faisait référence à sa
famille. En l'occurrence, le mode de production
automatique confère au texte des éclats de confidences
André Breton, Philippe Soupault, Les Champs Magnétiques, p.22
106
qui s'exhalent dans un climat pour le moins singulier.
Il convient de remarquer que Breton aura choisi de
rester avare de commentaires au sujet de ces extraits.
Ces confidences, on peut penser qu'il aurait souhaité
qu'elles fussent absentes du texte. Il consentit
pourtant à les conserver, acceptant d'emblée la part
d'inconfort lié à ce dévoilement.
Tels paraissent être les risques encourus par ces
plongeons dans le gouffre de l'esprit. En fait, si le
merveilleux est mis en lumière, certaines souffrances
cachées le sont aussi. Le pouvoir « intensificateur »,
permis par la sollicitation de l'inconscient,
s'actualise sur de multiples paliers. Les turpitudes de
la guerre, les frustrations et les déchirements
familiaux, le sentiment de désespoir éprouvé vis-à-vis
de la structure sociale, la perte de personnes chères,
jaillissent quelques fois sous forme de lourde tension.
Le dernier chapitre met en jeu les textes les plus
obscurs et les plus révélateurs du livre. Il importe de
portée attention au titre : « La fin de tout ». Ici se
révèlent les noirs desseins qui habitent les auteurs. Ce
chapitre est présenté sous l'épilogue :
ANDRÉ BRETON & PHILIPPE SOUPAULT.
BOIS & CHARBONS.
Cet épilogue rembruni est substantiel. André Breton et
Philippe Soupault y dévoilent leur désir, réel ou feint,
de disparaître dans l'anonymat. « Bois et Charbons »,
précisera Breton dans Commentaire de 1930, comme
« l'anonymat de ces petites boutiques pauvres, par
107
exemple. »160 Notons que ces mots, une fois épanchés,
continueront de hanter Breton. Ils réapparaîtront dans
Clair de terre en 1923 et dans Nadja cinq ans plus
tard. 161
L'ensemble du texte est rédigé dans un style altier qui
n'est pas étranger à Breton. Il se présente sous forme
de prospectus commercial. Pour Breton, l'expérience des
Champs magnétiques a l'effet d'un exutoire qui lui
permet un temps de canaliser la peine ressentie après la
perte de Vaché. Le texte lui est d'ailleurs dédié. Ce
fait comporte sa part d'intérêt. Dédier un livre aux
morts, c'est en quelque sorte accepter de leur survivre.
Cette dédicace paraît donc marquer un état transitif
dans le cheminement d'André Breton.
Le dernier acte de la pièce, « S'il vous plaît »,
demeura inédit jusqu'en 1966, année du décès de Breton.
Ce long silence semble ne rien devoir au hasard. Les
auteurs y laissent clairement sous-entendre le désir de
disparaître conjointement sur la scène. Alain Jouffroy
dit à ce sujet : « Les auteurs devaient finalement
monter sur scène, et armés d'un revolver chargé,
devaient jouer à la roulette russe devant les
spectateurs de la pièce. »16^ II convient d'observer que
cette scène rappelle étrangement les événements qui se
déroulèrent le 23 juin 1917, au Conservatoire Maubel.
Breton raconte que Jacques Vaché, pour protester contre
160 André Breton, Philippe Soupault, Les Champs Magnétiques, p.15161 Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlyse dans1'expérience surréaliste, p.87162 Ibidem, p. 85
108
le « scandale de la représentation »163, était entré dans
la salle, armé d'un revolver et menaçait d'assassiner
les spectateurs. Peut-on parler de filiation ? Nous
l'ignorons, mais la forte similitude laissera le lecteur
perplexe. Quoi qu'il en soit, la confiscation de cet
acte, par André Breton, suggère une attitude de type
défensif. On peut y voir celle d'homme qui, face à une
blessure poignante, choisit de la taire pour ne pas la
raviver.
L'expérience de la rédaction des Champs Magnétiques
devint rapidement éprouvante pour les auteurs. Il était
impératif que cela cesse. D'une part, l'épuisement
amenait leur esprit à osciller dangereusement. D'autre
part, à ce rythme, André Breton et Philippe Soupault
craignaient sincèrement d'être emportés dans le
tourbillon de la folie. Ainsi, lorsqu'il commença à se
sentir trop ébranlé, Breton conclut l'expérience.
L'aventure dura quinze jours et l'essentiel de la
rédaction fut complété en huit jours.
Aragon, de retour à Paris en juin 1919, fut le premier à
prendre connaissance du texte. La lecture eut lieu au
café La Source, boulevard Saint-Michel, lors d'un tête-
à-tête avec Breton. Aragon servit de baromètre. Ce choix
semble relever de la grande complicité qu'il partageait
avec les auteurs. Par sa connaissance évidente de leur
production écrite respective, Aragon devenait le plus
apte à évaluer l'unité des textes. Le constat fut
positif. Pour Aragon, l'expérience menée par ses
] 63'André Breton, Les pas perdus , p.20
109
camarades sembla des plus concluante. Selon le regard de
l'expert, la fusion s'était opérée. La symbiose était
d'une telle finesse qu'elle rendit la tentative de
départage excessivement complexe. Ce fait confirmé,
Aragon salua la création de l'auteur bicéphale.
Il est difficile de dater précisément chaque chapitre et
de distinguer avec exactitude quel texte appartient à
quel auteur. Dans un désir indéniable de fusion, Breton
et Soupault se sont employés à signer ensemble chaque
texte, même ceux à auteur unique. Or, la parution de
chaque chapitre devient une indication intéressante
quant à la datation limite de leur production.
Marguerite Bonnet, qui s'est penchée sur la question,
est parvenue à établir les listes suivantes :
Parutions dans la revue Littérature164
Titre Signature N° et datede LittératureUsine
La Glace sanstain
Saisons
Éclipses
Lune de miel
Hôtels
André Breton
André Breton etPhilippeSoupaultAndré Breton etPhilippeSoupaultAndré Breton etPhilippeSoupaultAndré Breton
PhilippeSoupault
7 septembre 1919
8 octobre 1919
9 novembre 1919
10 décembre 1919
11 janvier 1920
12 février 1920
11,-1 Bonnet, Marguerite, André Breton, p. 167
110
Parutions dans les revues du mouvement Dada165
TitreTerre de couleur
Règlements
Barrières(le cinquième etdernierdialogue)Trains
J'ai beaucoupconnu
Les sentimentssont gratuits
Détour par leciel
SignatureAndré Breton
PhilippeSoupaultAndré Breton etPhilippeSoupault
PhilippeSoupaultAndré Breton
PhilippeSoupault
André Breton
Revue et date391, no 21, mars1920391, no 21, mars1920DADAphone, 1mars 1920
DADAphone, 7mars 1920Z, no 1, mars1920
Z, no 1, mars1920
Proverbe, no 4,avril 1920
Nourris de ces considérations, on constate que ces
textes ne subissent pas réellement l'influence du
mouvement Dada. En fait, la plupart sont nettement
antérieurs à l'annexion des auteurs de la revue
Littérature au mouvement de Tzara. Pour Breton, il
s'agit là de la première œuvre typiquement surréaliste,
avant la concrétisation du mouvement. Dès juillet 1919,
Breton annonce à Sami Rosenstock166, un texte poétique
d'une centaine de pages. Ce point en soi démontre qu'à
ce moment la majeure partie du livre était complétée et
que les ajouts des textes à auteur unique furent insérés
par la suite. En l'occurrence, la paternité des textes
reste vaporeuse, même Louis Aragon est confondu. Or,
165 Ibidem, p. 168166 II s'agit du véritable nom de Tristan Tzara.
111
tout porte à croire que Breton a rédigé la première
section du « Pagure dit », « Saisons » et « Bois et
Charbon ». La deuxième partie du « Pagure » semble le
fruit du travail de Soupault. Les chapitres intitulés
« Les Gants Blancs » et « En 80 jours », bien qu'ils
aient été rédigés en alternance, sont majoritairement
issus de la plume de Philippe Soupault. Tandis que
« Glace sans tain », « Éclipses », « Barrière » et « Ne
bougeons plus » furent rédigés à tour de rôle avec des
enchevêtrements parfois très serrés.
Lors de la rédaction des Champs Magnétiques, un
déplacement d'accent s'opère. On constate un transfert
de tons entre les protagonistes. Certaines sections ou
certaines phrases empreintes de l'art d'écriture d'André
Breton appartiennent à Philippe Soupault, et l'inverse
est aussi perceptible. À l'image de « l'auteur à deux
têtes »167, les variations discernables semblent relever
davantage de l'état d'esprit des deux complices, au
moment de l'écriture, qu'à leurs styles respectifs. Les
similitudes, elles, sont grandes. Les plus frappantes se
situent au niveau de la construction du texte, de la
verve, de l'humour, de l'émotion, de la force des
images. Fait surprenant, la soudure est telle que les
labilités de l'écriture sont aussi indiscernables chez
les deux auteurs. Ce qui nous amène à constater que
l'entrelacement des voies se dissout pour culminer en un
produit homogène.
167 Mark Polizzotti, André Breton, p .122
113
Le désarroi de Breton est substantiel. Il est confirmé
par plusieurs textes de cette époque. Dans ses
Entretiens radiophoniques, il confie :
L'avenir est dénué pour moi de toutereprésentation. (...) Je tourne pendant desheures autour de la table de ma chambred'hôtel, je marche sans but dans Paris, jepasse des soirées seul sur un banc de la placedu Châtelet. Il ne me semble pas que jepoursuive une idée ou une solution : non, jesuis en proie à une sorte de fatalisme au jourle jour (...) Cela se fonde sur une indifférenceà peu près totale qui n'excepte que mes raresamis, c'est-à-dire ceux qui participent à queltitre au même trouble que moi ...169
André Breton refuse catégoriquement « l'assimilation
fonctionnelle qui caractérise les êtres vivants171 ». Or,
il n'entrevoit alors que peu d'issues. Dès lors, que
reste-t-il à faire, sinon errer? À cela s'ajoute le
décès de Jacques Vaché. Le jeune homme qui soutenait que
« l'art est une sottise »171 et « qui objectait à mourir
en temps de guerre »172, fût trouvé mort, à Nantes, peu
de temps après l'armistice. Il était alors âgé de vingt
trois ans. Vaché succomba à une surdose d'opium en
compagnie de quelques camarades. Il convient de
remarquer que les circonstances « réelles » entourant la
mort suspecte du jeune dandy ne sont pas déterminantes
pour notre propos. C'est le sens qu'elle prend dans la
démarche de l'écrivain qui importe ici. Breton
interprète ce décès comme un suicide. Il précise au
169 André Breton, Entretiens radiophoniques (1913-1952), p. 57170 André Breton, Les Pas Perdus, p. 7171 Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance de 1'aventureSurréaliste, p.93172 Ibidem,p. 189
114
sujet de Vaché dans La Confession dédaigneuse : « Sans
lui j'aurais peut-être été un poète ; il a déjoué en moi
ce complot de forces obscures qui mène à se croire
quelque chose d'aussi absurde qu'une vocation. »173 Pour
Breton, Vaché s'est élevé contre le contrôle social en
choisissant la mort. Ce « suicide » est donc perçu comme
un pied de nez au pouvoir, « une dernière fourberie
drôle »174. Et, dans la perspective ainsi tracée, c'est-
à-dire la mort utilisée comme moyen de résistance contre
l'assujettissement, ce décès le place devant une
impasse.
Dans cet extrait d'une lettre adressée à Tristan Tzara
le 12 juin 1919, Breton témoigne de son dilemme et de
son désarroi :
« La lutte est trop inégale, je vois plusieursmanières de succomber : 1° la mort(Lautréamont, Jacques Vaché); 2° le gâtismeinvolontaire : il arrive qu'on se prend ausérieux (Barrés, Gide, Picasso); 3° le gâtismevolontaire : réussite dans l'épicerie(Rimbaud), et les intoxications (Jarry, etc.).Mais vous, mon cher ami, comment sortirez-vous?Répondez-moi, de grâce, voyez-vous une autrefenêtre? (C est aussi pour moi quej'interroge.) »175
La peur de céder sous le poids de la « machine » sociale
est réelle et envahissante. Elle hante le jeune homme.
La « lutte est inégale », et l'avenir n'offre que
d'obscures perspectives. L'art est complaisant, le
173André Breton, Les Pas Perdus , p. 9""ibidem,p.24175 Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance de l'aventureSurréaliste,p.190
115
discours scientifique rodomont et le politique
méprisant.
Dans cette visée, la question de la mort semble
s'imposer avec de plus en plus d'autorité- II l'abordera
d'ailleurs sans réserve dans La Confession dédaigneuse,
où il expose très clairement son point de vue sur le
sujet en affirmant :
Se suicider, je ne le trouve légitime que dansun cas : n'ayant au monde d'autre défi à jeterque le désir, ne recevant de plus grand défique ma mort, je puis en venir à désirer lamort. Mais il ne saurait être question dem' abêtir...176
André Breton est sans équivoque. Il préfère mourir à
s'abêtir. Il est hors de doute que l'écrivain traverse
un moment de grand abattement. Ce sentiment prend
directement sa source dans le refus de l'abrutissement.
On peut penser que l'épisode précédant la rédaction des
Champs Magnétiques correspond au point culminant de cet
état de désespoir.
Breton paraît risquer le tout pour le tout. À l'image du
pacte passé avec Aragon, en rédigeant Les Champs
magnétiques, André Breton cherchait à réaliser un livre
périlleux et redoutable. Le péril ici encouru est celui
de la « folie », c'est-à-dire le risque de perdre ce
qu' il y a de plus précieux en soi : l'esprit
discrétionnaire. Et Breton sait, pour avoir constaté
l'état et les conditions de vie de ces fous, que l'enjeu
est grand. Pourtant, tel que nous l'avons vu, Breton dit
6André Breton, Les Pas Perdus ,p.8
116
clairement dans le Manifeste de 1924 : « ... comme si l'on
pouvait se tromper davantage. (....) Reste la folie, « la
folie qu'on enferme » a-t-on si bien dit. Celle-là ou
l'autre... »17 Entre la folie, l'assujettissement et la
mort, André Breton préfère visiblement risquer la folie.
L'écrivain part à la poursuite d'une intuition qu'il se
fait un devoir de confirmer. Les théories freudiennes
traduites par Régis et Hesnard, le discours du fou et
les phrases données dans les périodes de demi-sommeil
constituent un tissu d'éléments qui incitent Breton à
pousser l'expertise. La juxtaposition de ces éléments
esquisse un espoir. Or, nous pouvons nous demander de
quelle nature est cet espoir. André Breton précise dans
le Manifeste du Surréalisme de 1924 :
Si les profondeurs de notre esprit recèlentd'étranges forces capables d'augmenter cellesde la surface, ou de lutter victorieusementcontre elles, il y a tout intérêt à les capter,à les capter d'abord, pour les soumettreensuite, s'il y a lieu, au contrôle de notreraison.
De toute évidence, Breton espère trouver au plus profond
de lui-même des forces. La suite de l'extrait fait
problème et confond l'entendement. Son énoncé conduit le
lecteur dans un imbroglio. Cherche-t-il à amplifier les
forces à la surface ou à « lutter victorieusement contre
elles »? L'objectif est élusif, et la relation entre les
forces enfouies et celles qui reposent à la surface
demeure confuse. En outre, il semble que l'utilité de
177 André Breton, Manifestes du Surréalisme, p.15178 Ibidem, p.20
117
ces forces soit non définie par l'auteur. Ce nonobstant,
il est hors de doute qu'il s'agit d'extraire quelques
énergies de l'inconscient. André Breton tente de poser
un nouveau regard sur ce qu'il est convenu d'appeler
l'âme. Cette perception concerne la remise en cause de
la thèse soutenant l'unité de l'âme. Dès lors, il
introduit l'idée que cette âme « morcelée » comporterait
potentiellement « plusieurs consciences... »179. Une telle
position commande une modification intrinsèque de notre
rapport avec le monde.
L'auteur avoue s'appuyer sur une croyance. Dans le
premier Manifeste du Surréalisme, il dit tout net :
Je crois à la résolution future de ces deuxétats, en apparence si contradictoire, que sontle rêve et la réalité, en une sorte de réalitéabsolue, de surréalité, si l'on peut ainsidire. C'est à sa conquête que je vais, certainde n'y pas parvenir, mais trop insoucieux de mapropre mort pour ne pas supporter un peu lesjoies d'une telle possession. 180
Le terme de « résolution » tel qu'utilisé par Breton
comporte sa part d'ambiguïté. Il semble possible de
l'interpréter sous deux registres. D'une part, en tant
que l'opération permettant de résoudre un problème, une
difficulté. Dans cette visée, il s'agirait d'harmoniser
les tensions relatives à la cohabitation de « ces deux
états en apparence si contradictoires ». D'autre part,
en tant que la manœuvre permettant à un corps de se
résoudre, de se réduire. Selon cette perspective, il
179 Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance de l'aventureSurréaliste,p.195180 André Breton, Manifestes du Surréalisme, p.24
118
serait question de transformer le rêve et la réalité en
surréalité. Visiblement, André Breton demeure vague sur
le sujet. Il convient de remarquer que l'idée de la
« rencontre des opposés » réapparaît à nouveau. La
surréalité se veut-elle un univers stupéfiant
probablement. Or, malgré le rayonnement qui s'exhale des
« joies d'une telle possession », la démarche de Breton
s'inscrit dans un certain fatalisme. Il en ressort toute
la splendeur et la munificence du geste « inutile ».
On peut enfin se demander ce qui amena André Breton à
placer sa foi dans le discours poétique. Dans La
Confession dédaigneuse, il explique ce choix:
Après toutes les déceptions qu'elle m'a déjàinfligées, je tiens encore la poésie pour leterrain où ont le plus de chances de serésoudre les terribles difficultés de laconscience avec la confiance, chez un mêmeindividu. 181
Le choix de l'auteur paraît obéir à un processus
d'élimination. Autrement dit, Breton paraît choisir la
poésie « par défaut ». N'ayant pas trouvé de chemin plus
honorable pour parvenir à unifier la pensée, il s'en
remet à la poésie. L'auteur suggère alors de s'y
abandonner en toute confiance.
Ainsi instruit, on observe, avec la découverte de l'art
d'écrire automatique, un renversement majeur de
l'attitude d'André Breton. Les Champs Magnétiques
semblent, comme l'a très justement énoncé Louis Aragon :
181 André Breton, Les Pas Perdus, p. 15
119
« le moment à l'aube de ce siècle où tourne toute
l'histoire de l'écriture, non point le livre par quoi
voulait Stéphane Mallarmé que finît le monde, mais celui
par quoi tout commence. »182 Certaines idées sont mortes,
alors que d'autres sont nées, et il semble qu'André
Breton revit animé par cette nouvelle conviction,
soit qu'il existe « autre chose ». C'est cette
conviction qui lui permet de détourner le dilemme de vie
et de mort. Ce renversement l'autorise à affirmer, tel
que nous l'avons vu précédemment, à la fin du Manifeste
du Surréalisme de 1924 que : « C'est vivre et cesser de
vivre qui sont des solutions imaginaires. L'existence
est ailleurs. »183
182 Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance de J'aventureSurréaliste,p.16118.! André Breton, Manifestes du Surréalisme, p.60
120
5. Les linéaments du dessein
Dans les Pas Perdus, André Breton déclarait :
Je n'aime, bien entendu, que les chosesinaccomplies, je ne me propose rien tant que detrop embrasser. L'étreinte, la dominationseule, sont des leurres. Et c'est assez, pourl'instant, qu'une si jolie ombre danse au bordde la fenêtre par laquelle je vais recommencerchaque jour à me jeter.184
Le lecteur aura du mal à lire cette déclaration
sans afficher un sourire, touché en plein cœur par
l'optimisme d'André Breton. Il suffit « qu'une si
jolie ombre danse au bord de la fenêtre » pour
qu'il s'y jette empreint d'une suréminente
hardiesse. Avec les Champs Magnétiques c'est très
précisément ce que fait Breton. Percevant une jolie
ombre, il se jette par la fenêtre et il embrasse
très largement l'expérience du vivant-
Breton perçoit l'ombre de « quelque chose » qui
permettrait d'échapper à la censure consciente et
au contrôle social. Ce « quelque chose » devrait
concrétiser la trinité que constituent à ses yeux
l'amour, la « liberté, couleur d'homme »185 et la
vie transfigurée. L'espoir esquissé lui suffit. Dès
lors, il se lance dans l'aventure. Et justement, il
s'agit bien d'une aventure avec tout ce que cette
idée comporte de nouveauté, de risques,
d'incertitudes et de défis pour l'être humain. Armé
d'une lanterne, Breton plonge dans l'inconnu. Un
184 André Breton, Les Pas Perdus, p. 24185 Ferdinand Alquié, Philosophie du surréalisme, p.24
121
tel geste sous-tend que l'on nage dans l'ignorance.
C'est peut-être ce qui explique le côté très
vaporeux des explications auxquelles nous sommes
confrontés. La démarche d'André Breton est à la
fois intuitive et prudente à l'image de la grande
sagacité de l'homme qui l'élabore.
5.1 Au large du verbe
Breton recherche, avec la mise en place du procédé
d'écriture automatique, une solution poétique aux
problèmes reliés à l'existence. Il tente d'établir un
nouveau discours poétique basé sur l'instauration d'une
connotation plus juste du vocable. Pour ce faire, il
cherche à remonter à la source du langage. Pour lui, le
seul langage véritablement pur est celui qui émerge
directement des voies de l'inconscient.
Cette perception l'entraîne inéluctablement à mystifier
le langage. Il semble que, pour lui, c'est par le
langage que s'opère la révélation. Dans la perspective
ainsi tracée, c'est par la parole que s'incarne la
véritable pensée. Le langage se voit muni d'un pouvoir
d'énonciation qui outrepasse celui de la volonté
consciente. Et, les mots traduisent d'emblée une idée.
C'est d'ailleurs par eux que s'effectue l'architecture
de la pensée. André Breton précise :
« Mais je l'ai déjà dit, les mots, de par lanature que nous leur reconnaissons, méritent dejouer un rôle autrement décisif. Rien ne sertde les modifier puisque, tels qu'ils sont, ilsrépondent avec promptitude à notre appel. Il
122
suffit que notre critique porte sur les loisqui président à leur assemblage »186.
Pour Breton, tout processus de réflexion s'appuie sur
les mots. De fait, faute de mots, toute pensée cohérente
deviendrait impossible. On serait ainsi confronté au
chaos.
En l'occurrence, la pensée épurée par l'automatisme se
présente plus sonore. Le langage devient, sous la dictée
de l'inconscient, l'expression de la force brute, de la
matière première de l'esprit. À partir de là, on conçoit
que c'est par le langage que doit s'opérer la
restructuration du monde de la pensée. Breton explique :
« En matière de langage les poètes surréalistesn'ont été et ne demeurent épris de rien tantque de cette propriété des mots à s'assemblerpar chaînes singulières pour resplendir, etcela au moment où on les cherche le moins. Ilsn'ont tenu à rien tant qu'à ramener ces chaînesdes lieux obscurs où elles se forment pour leurfaire affronter la lumière du jour. Et ce quiles a requis dans ces groupements verbaux, cequi les a dissuadés d'y rien changer quand bienmême il leur arrivait de ne pas satisfaire aubesoin de sens de sens immédiat - ou deviolenter ce sens au grand effroi du lecteurordinaire, c'est que leur structure offrait cetaspect inéluctable de l'enchaînement musical,que les mots qui les composaient s'étaientdistribué selon des affinités inhabituelles,mais beaucoup plus profondes. »187
L'épuration du langage, la restitution de sa véritable
structure et de sa force imaginative instaure de
186 Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlyse dansl'expérience surréaliste, p.50187 Ibidem^ p.52
123
nouvelles avenues quant à la portée de son sens. La
phrase automatique qui se présente dans une syntaxe
correcte ouvre la porte à toute une multitude
d'interprétations. C'est par elle que s'opère la
transformation du sujet à l'objet. Or, pour conserver sa
valeur poétique, cette phrase doit aussi conserver une
part de mystère. Même si les psychanalystes
s'intéressent de très près au langage et utilisent des
procédés semblables, le but qu'ils tendent à rejoindre
est nettement différent. En fait, les psychanalystes
cherchent à découvrir le sens de l'énoncé par la
décortication du langage dans un but thérapeutique.
Breton, lui ne cherche pas à dépouiller la phrase de son
mystère. Son but n'est pas de découvrir quelle
frustration inconsciente a amené le scripteur à rédiger
tel texte poétique. Il s'intéresse à la synthèse du
rationnel et de l'onirique. En outre, il y a attente de
révélation.
Christian Vereecken précise dans son texte intitulé Le
surréalisme et le sens ou d'une certaine confusion du
parlêtre et du mot, que les mots se présentent comme les
index d'un au-delà du sens, qui ne serait pas de l'ordre
du non-sens mais du plein sens c'est-à-dire de
l'ineffable188. Le mot est donc dans l'expectative de son
complément. C'est cette réunion, cette fusion avec l'au-
delà du sens qui permettra la plénitude de l'être. Or,
il semble que cet abouchement relève de la surréalité. À
cet égard, Michel Leiris précisera, en 1938 dans
188Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlyse dans1'expérience surréaliste, p.19
124
Glossaire, j'y serre mes gloses, que : « Maintenant nous
sommes passés, sans aucun doute, dans le territoire de
la poésie, en ce lieu où le langage se transforme en
oracle ».
L'automatisme écrit se veut donc la transcription d'une
« dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle
exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation
esthétique ou morale »189. Ce versant de l'automatisme
soulève la question du grotesque. La distinction entre
la phrase produite automatiquement et celle qui est tout
simplement bête ou absurde devient complexe à établir.
Breton dans Légitime Défense en 1926 soulève la
question. Gérard Durozoi et Bernard Lecherbonnier,
relate ses propos et précisent que :
(...) jamais le travail sur les mots ne doit êtreabstrait, il doit avoir pour fonction dedélivrer une substance, sans la présence delaquelle ils ne feraient que jouergratuitement. Substance qu'il faut biendistinguer d'un quelconque message. Bretonparle de nécessité réalisée.190
Cet extrait fait problème. Deux notions surgissent
d'emblée, celle de « la substance » et de la
« gratuité ». Cette substance dont Breton parle, on
ignore sa véritable « nature ». L'auteur s'abstient de
définir clairement son essence. Considérant que Breton
se fait aventurier de l'inconscient, il est loisible de
penser qu'il en ignore lui-même la teneur. Il paraît
189 André Breton, Manifestes du Surréalisme, p.36190 Durozi, Gérard et Lecherbonnier, Bernard. André Breton, l'écrituresurréaliste, p. 20
125
tout aussi concevable que les réserves de Breton soient
liées au désir d'éviter le piège du dogmatisme. Ses
explications se font vacillantes. Il réfère tant au
freudisme qu'au marxisme en s'appuyant sur l'idée d'une
pulsion vitale. Parallèlement, la notion de gratuité
excite aussi la réflexion. L'art d'écrire
automatiquement présuppose que la phrase est donnée et
illogique.
Dès lors, si l'on attribue au mot une valeur innée,
peut-on parler de phrases absurdes ou plus pauvres ?
Chaque mot étant porteur de signification, nous ne
sommes pas placé dans l'obligation de reconnaître une
égale valeur à chacune de ces phrases énoncées
« gratuitement ». La phrase automatique de Breton,
contrairement aux mots en liberté de Marinetti, conserve
une syntaxe juste. C'est peut-être dans cette voie qu'il
faut chercher la distinction.
Tout se présente comme si chaque phrase offerte dans une
syntaxe correcte devait être porteuse de sens et
témoigner de la vie psychique de l'être. Les auteurs
expliquent : « Si la parole-pensée n'était pas
substantielle, elle dénoncerait dans le locuteur un
silence dramatique, une rupture dans la continuité de
l'être. Aussi parler, écouter sa parole parler, est-il
un acte vital, l'acte vital par excellence. »191 C'est
donc par la parole-pensée, libérée par l'automatisme,
que s'exprime la vie réelle ou surréelle. Sous le regard
de Breton, c'est par elle que semble se restituer la
191 ibid.
126
communication avec ce torrent intérieur qui permet
d'être et d'exister. Elle est liée à la vie psychique.
1/ importance qu'il place dans le signifiant ne nie pas
le signifié. Comme le font remarquer les auteurs : « La
substance qui l'emplit la légitime. »192
5.2 L'appas de la psychanalyse
La conception de l'écriture automatique, telle que
présentée par André Breton dans le Manifeste de 1924,
est commandée par une prise de position, une prise de
parti affirmant l'existence et la valeur de
l'inconscient. Elle est rattachée à une façon
d'envisager l'écriture comme vecteur d'un message
inconscient permettant une révélation. On peut aisément
se demander ce qui motive André Breton à établir une
telle hiérarchie. Pourquoi certaines formes
d'associations sont-elles supérieures à d'autres ?
Pourquoi le terrain de l'inconscient supplante-t-il le
fonctionnement rationnel de la pensée ? Cette perception
est en grande partie attribuable à la force d'attraction
des théories freudiennes et de la psychanalyse. Pour les
psychanalystes, la substance vitale du psychisme réside
dans l'inconscient. D'après Sigmund Freud : «II ne peut
y avoir de fait conscient sans stade antérieur
inconscient, tandis que l'inconscient peut se passer de
stade conscient et avoir cependant une valeur
psychique. L'inconscient est le psychique lui-même et
192 ibidem, p. 18
127
son essentielle réalité. »19' Ainsi, l'inconscient
s'arroge d'une certaine supériorité. Il est perçu comme
fondement de la conscience, mais plus encore, son
existence en dépend. La valeur intrinsèque de
l'inconscient ne peut, selon les dires de son fondateur,
être remise en cause puisque sans lui, il ne peut y
avoir de vie psychique. Freud précise : « L'inconscient
est pareil à un grand cercle qui enfermerait le
conscient comme un cercle plus petit. »194 De fait, il
détrône la conscience en réduisant considérablement sa
valeur. Pour lui, elle semble posséder autant de failles
que l'ensemble de nos sens. On comprend ainsi, qu'avec
ces théories en main, il devient parfaitement
envisageable que la vérité de l'esprit humain soit
enfouie dans le registre de l'inconscient. Cette
perspective offre ainsi une réalité ontologique
supérieure au registre de la conscience.
Une telle position ne peut qu'être intensifiée par
l'animosité que Breton éprouve face aux notions de
censure et de contrôle. Dans cette visée, il convient de
remarquer que, selon la théorie freudienne,
l'inconscient fonctionne un peu à la manière d'une
éponge. Il absorbe ainsi l'ensemble des informations
avec lesquelles il est mis en contact et les enregistre
de façon à constituer une prodigieuse banque de données.
Le travail de la conscience réside dans le tri et
l'assemblage rationnel de ces données. Pour diverses
raisons, certaines données sont acceptées et d'autres
193Sigmund Freud, L'interprétation des rêves, cité dans Lire André Bretonà Saint-Dizier, http ://entretenir.free.fr/breton5.html, 21 avril 2005194Ibidem
128
rejetées. Il peut arriver que, confrontés à une
incapacité de fonctionner avec une information qui
possède une charge émotive trop importante et par le
fait même intraitable, on l'écrase ou la rejette en
l'enfouissant dans le registre de l'inconscient. Il
s'agit de ce qu'on appelle dans la sphère
psychanalytique « le refoulement ». Il existe donc, au
même titre que la censure sociale, un processus de
censure de conscience.
5.2.1 L'émoi
Pour l'essentiel, la visée de Breton est d'accéder à la
révélation par le chemin de l'émoi. Dans la Clé des
Champs, il précise:
« J'ai toujours soutenu qu'un certain nombred'œuvres poétiques et autres valentessentiellement par le pouvoir qu'elles ontd'en appeler à une faculté autre quel'intelligence. La beauté exige qu'on jouissele plus souvent avant de comprendre et ellen'entretient avec la clarté que des rapportsfort distants et secondaires. Ce n'est pasqu'elle se rebelle contre toute élucidation,mais elle ne supporte cette élucidation qu'aposteriori et comme en dehors d'elle. Rien nesaurait lui être plus fatal que, sur-le-champ,de prendre une conscience nette des élémentsintellectuels et sensibles qu'elle met en œuvreet de vouloir, en se manifestant, rendreégalement manifestes toutes ses ressources »195.
Dans cette visée, l'homme, le poète, tente de découvrir
l'oracle de la vie inconsciente. Il devient donc
indirectement un prophète non pas qui élucide des
195 Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlyse dansl'expérience surréaliste, p.63
130
L'art d'écrire automatiquement, chez Breton met en jeu
des préoccupations qui relèvent davantage de la conquête
du merveilleux que de la production d'oeuvres
littéraires. Il s'agira pour le mouvement de constituer
un registre de méthodes d'investigations permettant
d'éclairer le gouffre de l'inconscient. C'est dans ce
cadre que s'inscrit l'automatisme.
5.2.2 Les Médiums
II est hors de doute qu'André Breton s'intéressera à
l'univers médiumnique. Il paraît toutefois important de
signaler que sous des aspects apparentés, les recherches
entreprises par Breton et ses camarades surréalistes
obéissent à une logique fondamentalement opposée. Dans
l'univers des médiums, on cherche à établir une
dislocation interne de l'homme. Il devient pour ainsi
dire, le réceptacle d'esprits extérieurs. Dans l'optique
surréaliste, la visée est contrastante. On tente plutôt
d'unifier l'homme sur de nouvelles bases c'est-à-dire de
le remettre en contact avec ses énergies intérieures. Il
s'agit de créer un nouvel équilibre par une imbrication
plus juste des fragments épars du moi. C'est le propre
de la quête surréaliste, la réunification dans une
synthèse simultanée des tensions internes pour atteindre
une globalité totalisante. Pour ce faire, la
connaissance de ce que constitue l'univers inconscient
est impérative, considérant qu'unifier l'inconnu est
chose impossible... Le contact avec le monde médiumnique
permet la prise de conscience du message subliminal.
Ainsi, Breton se désintéresse du spiritisme pour se
133
la mise en place de techniques d'exploration de
1'inconscient.
5.2.5 La muse
« C'est l'espoir ou le désespoir, écrit Éluard, qui
déterminera pour le rêveur éveillé - pour le poète
l'action de son imagination. »198 En énonçant, cette
nuance, Éluard se situe dans le prolongement de Breton.
On voit ici clairement établie une distinction entre
« l'espoir » et l'« imagination ». Selon la perspective
de Ferdinand Alquié, qui nous rapporte ces dires dans
son ouvrage La philosophie du Surréalisme, il s'agit de
détourner la contradiction séparant la réalité et ce
qu'elle pourrait être. De fait, l'espoir apparaît ici
comme un état passif relié au plat constat d'une
scission entre deux principes. Pour Breton, l'« homme
est soluble dans sa pensée »199. L'un des desseins
auxquels s'emploient les membres du mouvement
surréaliste est précisément la dissolution des
antinomies. Cette visée s'inscrit à juste titre sur le
mur de la révolte du surréalisme contre
l'assujettissement. Il s'agit de se braquer contre le
reductionnisme abusif qui consiste à penser le monde en
termes de catégories. Concevoir un monde bitonal exclut
d'emblée toutes colorations. Ce mode de pensée comporte
deux principaux dangers. D'une part, la catégorie tue la
réflexion à grands coups d'évidence. D'autre part,
définir ce qu'est une chose, renvoie, inéluctablement a
ce qu'elle n'est pas. À cet égard, l'exemple du débat
s'articulant autour de la « nature » humaine est
198 Ferdinand Aquié, Philosophie du surréalisme, p. 167199 André Breton, Manifestes du surréalisme, p.53
134
particulièrement illustratif. Il suffit de définir ce
qu'est un être humain pour être autorisé à répudier tous
ceux qui se distinguent des formes fixées par décision
unilatérale. Cette évidence affirmée, il nous sera
possible de constituer un génocide en toute quiétude.
L'expérience nous enseigne que rien n'est jamais clair
dans le vivant. Dans la perspective ainsi tracée, les
notions d'encastrement, de cloisonnement de la vie ne
peuvent qu'être mères de souffrances.
Pour André Breton, l'imagination a pour fonction de
permettre le rapprochement d'éléments en apparence
hétéroclites. Elle nous permet de jouer avec le sens que
l'on donne à la représentation. Il s'agit d'un
dispositif de résistance face aux « normes d'une raison
logicienne, souci de l'utile, censure morale. »20 ' Or, il
importe de souligner qu'une telle perception n'implique
pas une négation de la persistance de l'objet à
l'extérieur du moi. Il s'agirait là de basculer dans ce
que Breton appelle « l'erreur grandiose de Fichte »201.
Ferdinand Alquié précise très justement que la
philosophie surréaliste reconnaît d'emblée une : « ...
identité de nature entre la sensation et l'image,
existence propre de l'image, puissance d'actualisation
inhérente à l'image. »202 On comprend donc, là se
manifeste l'influence de Freud, que l'homme, animé par
le désir, a le pouvoir de reformuler le monde. C'est en
ce point précis que se révèle la liberté humaine.
L'imagination est perçue comme « la faculté libératrice
200 Ferdinand Aquié, Philosophie du surréalisme, p. 171201 Ibidem, p. 172202 Ibidem, p. 171
135
qui nous permet de passer du réel à l'image elle-
même » .
5.2.6 La surréalité
La difficulté interne du type de vision qu'élabore André
Breton, ainsi que de l'intérêt qu'elle suscite, tient à
l'interaction qu'il a entre ces trois notions : le
dogmatisme, la liberté et l'immanence.
Dans Philosophie du surréalisme, Ferdinand Alquié dit
que : « Toute conscience, cependant, vise un objet, se
définit par ce dont elle est conscience. »204 L'opération
proprement épistémologique consiste donc à fixer un
référant à la conscience esthétique. Nous saisissons que
Breton doit trouver une finalité à la vision esthétique
qu'il instaure à partir de l'automatisme. En
l'occurrence, il s'agit du surréel.
André Breton entend mettre en place une autre esthétique
qui vise la plénitude de l'homme, laquelle n'apparaît
possible que dans la synthèse des antinomies. Il ne
saurait souffrir d'aucun compromis relativement à la
liberté humaine qui relève, à ses yeux, du registre de
l'essentiel. Et, il rejette d'emblée tant les vérités
nouménales que les morales séraphiques. Dans la
perspective ainsi tracée, il est clair que le surréel ne
doit pas outrepasser la finalité de l'être humain
contenu dans sa nature même. Il doit impérativement lui
être conjoint. Parallèlement, Breton ne veut pas imposer
sa vérité ou convaincre de la justesse de ses idées. Ce
203 Ibidem, p. 182204 Ibidem, p. 198
137
égard, Ferdinand Alquié précise très justement
que : « l'absolu est précisément ce dont on ne peut
parler sans le rendre relatif au langage ». Dans cette
visée, le surréel peut conserver sa quintessence sans
être un noumène. Il est clair que l'absolu se présente
comme notion élusive. La surréalité n'est pas alors
explicitée en tant qu'objet mais figure au moins à
l'état implicite, comme un trait pertinent et
structurant qui, une fois mis à jour, donne tout son
sens et son relief à la conscience esthétique.
Pour comprendre ce qu'est la surréalité, il est
indispensable de se ressouvenir de l'importance qu'André
Breton accorde à la notion de mouvement. Nous savons que
Breton cherche à découvrir le « principe d'ordre et de
coordination d'instinct de la raison ». Il emprunte
beaucoup à Freud. Il est séduit par les notions de désir
et de pulsion. Il convient de souligner que ces notions
comportent d'emblée l'idée de mouvement. Selon cette
perception, le principe d'orchestration pourrait
difficilement répondre à un schème fixe. Breton se
concentre sur la poésie perçue non pas comme fin, mais
comme moyen. Tel qu'énoncé précédemment, il ne veut pas
être poète et remercie Jacques Vaché à cet égard. En
l'occurrence, être poète se présente comme un terme, une
finalité, un statut fixe. Breton veut vivre poétiquement
donc adopter une attitude poétique, être poétique. La
poésie, pour Breton, doit être empirique.
Et Ferdinand Alquié dit :
Si parfois, l'être aimé lui manquant, Bretonpasse « de l'être à l'essence », et tire de la
138
personne collective de la femme » « l'idée quetout n'est pas perdu », c'est toujours comme unpis-aller, et « faute pour l'esprit depossibilité de retour à l'être », lequel esttoujours tenu, il va sans dire, pour un êtreparticulier. 206
On voit donc clairement que le surréel est en l'homme.
Il danse avec l'être et l'essence. Il est fidèle à
l'expérience, et armé de l'imagination, permet à l'homme
de reformuler le monde à partir de la nature. C'est ce
qui permet à André Breton d'affirmer dans le Manifeste
de 1924 :
L'homme propose et dispose. Il ne tient qu'àlui de s'appartenir tout entier, c'est-à-direde maintenir à l'état anarchique la bandechaque jour plus redoutable de ses désirs. Lapoésie le lui enseigne. Elle porte en elle lacompensation parfaite des misères que nousendurons. Elle peut être une ordonnatrice,aussi, pour peu que sous le coup d'unedéception moins intime s'avise de la prendre autragique. Le temps vienne où elle décrète lafin de l'argent et rompe seule le pain du cielet de la terre! Il y aura encore des assembléessur les places publiques, et des mouvementsauxquels vous n'avez pas espéré prendre part.Adieu les sélections absurdes, les rêves degouffre, les rivalités, les longues patiences,la fuite des saisons, l'ordre artificiel desidées, la rampe du danger, le temps pour tout!Qu'on se donne seulement la peine de pratiquerla poésie.207
Fort de tout cela, la vision d'André Breton prend tout
son sens. Le ravissement opère et l'espoir naît.
206 Ibidem, p. 209207 André Breton, Manifestes du surréalisme, p. 28
136
qu'il veut c'est déstabilisé le sujet dormant et
confondu par le réel objectif afin d'y introduire une
perspective. Ainsi, le surréel doit donc autoriser la
déréalisation du réel objectif pour en légitimer la
reformulation.
En ce qui concerne la dialectique, on voit ici
clairement que l'affirmation d'un tel corrélat soulève
un embarras, lequel situe André Breton à la croisée des
chemins. Le piège c'est 1'objectivation. Et, il paraît
difficilement contournable. Alquié souligne le
paradoxe :
« Si, en effet pour définir la surréalité, nousvisons le surréel lui-même, nous seronsconduits à le transformer en objet, à parler delui comme d'une chose; nous n'éviterons plus,dès lors le dogmatisme, religieux ouhermétique. Si, au contraire, nous entreprenonsla description et l'étude de la seuleconscience du surréel, nous ne dépasserons pasle psychologisme : cette fois, c'est de laconscience que nous ferons une chose ou unobjet (...) . La richesse, le sens, le pouvoir derévélation inhérents à la consciencesurréaliste seront perdus. »205
II est clair que l'objectivation est un piège afférant
au discours dont le ressort est, de toute évidence, la
nécessité de signifiance. C'est en ce point précis que
se noue le problème qui l'occupe. Le stratagème utilisé
dans le premier Manifeste témoigne de la sagacité
d'André Breton. Car, toujours selon le professeur
français, c'est en définissant la surréalité comme
absolu que Breton parvient à éviter l'impasse. À cet
205 Ibidem, p. 200
139
6. Les pierres d'achoppement
6.1 Les écueils du psyché
La découverte de l'écriture automatique joue le rôle
d'un catalyseur dans la démarche d'André Breton. Son
utilisation est immédiate, donnant lieu à la rédaction
du recueil des Champs Magnétiques, publié la même année.
Pour Breton, elle est source de confiance et ouvre la
voie à l'établissement d'une nouvelle façon de penser le
monde. Breton précise :
«... durant des années, j'ai compté sur le débittorrentiel de l'écriture automatique pour lenettoyage définitif de l'écurie littéraire. Àcet égard, la volonté d'ouvrir toutes grandesles écluses restera sans nul doute l'idéegénératrice du surréalisme »208
De fait, la définition du surréalisme plonge ses racines
dans cette expérience et s'articule autour d'elle.
Breton est très attaché à l'écrire automatique et ce,
malgré ses performances, qui exception faite des Champs
Magnétiques, sont peu probantes. André Breton avouera en
1952 que : « L'histoire de l'écriture automatique dans
le surréalisme serait, je ne crains pas de le dire,
celle d'une infortune continue »209. Cette « infortune
continue »210 relève sans doute des multiples difficultés
liées à cet art d'écrire. Les phrases précédentes qui
sont transcrites, comment les ignorer ? De plus comment
faire le vide entre les séances afin de se présenter
208 Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlyse dans1'expérience surréaliste, p.38209 Ibidem, p. 37210 Ibidem, p. 37
140
l'esprit vierge des considérations passées et de
l'univers environnant ? Sans compter que le fait de se
couper de toutes censures demande un effort inhabituel
et astreignant. Et la valeur, comment la garantir
autrement qu'en la soumettant à l'évaluation
consciente ?
6.1.1 L'inconscient
Fondamentalement, il subsiste, à plus forte raison, des
problématiques liées à la source même du fonctionnement
mécanique de l'inconscient. Contrairement à la
conscience, dans l'univers inconscient, il est fort
difficile, pour diverses raisons, de suivre une
trajectoire continue.
D'abord, l'inconscient est riche d'images et d'idées. Il
s'agit d'une section de particulièrement effervescente.
Le poète est ainsi confronté à un bombardement d'idées.
Or, ces images et ces idées se superposent et
s'affrontent pour émerger au niveau conscient. De ce
fait, si intrinsèquement elles possèdent une structure
respective, il advient que leurs trajectoires
s'entrecoupent. Ce qui inévitablement provoque une
certaine confusion.
En certaines occasions, le flux verbal est entrecoupé
par des images qui surgissent. Cette contingence a pour
résultat de distraire le scripteur. Un double risque se
profile. Le premier est lié à l'interruption de la
transcription de l'idée qu'il poursuivait. Le second à
l'impossibilité de se réapproprier, sur l'instant, la
trajectoire.
141
Et finalement, ce ferraillement pour l'audience de la
conscience génère des variations de vitesse, de contenu,
de direction et de champ. On comprend donc que les
problématiques majeures dérivent de la surabondance de
son contenu qui gêne la transcription fidèle.
Il importe de remarquer que les sections de poème qui
surgissent se présentent sous forme de séquences
mentales. Et, bien qu'elles soient composées de phrases
distinctes, elles sont corrélatives au moment de la
transcription. Il semble que ces sections soient dotées
d'une forme d'articulation qui confond 1'entendement vu
le sujet de l'expérience. Ce qui donne à croire que le
collage de ces fragments est issu de la continuité d'une
même tension. Plus encore que le style, dans
l'occurrence des Champs magnétiques, ce qui importe
c'est le flux continu provoqué par la force
d'attraction.
6.1.2 Désintégration réintégration et rôle de la
conscience
De plus, l'écriture surréaliste possède une double
nature. D'une part, elle est une dictée mentale. D'autre
part, elle se confond avec un amalgame d'éléments
oniriques. On remarque la présence d'interactions entre
ces éléments.
Il convient d'observer que ce mode d'écriture s'effectue
dans des circonstances éprouvantes. Ces tensions sont
partiellement imputables à la double opération qui s'y
trouve engagée. Il s'agit de la désintégration et de la
142
réintégration. Ces deux opérations sont complémentaires
bien que l'on doive donner la primauté à la
réintégration. Il importe de souligner que la
désintégration n'est toutefois pas moins essentielle.
Elle paraît indispensable à un processus de
réintégration probante. En outre, elle a pour but de se
débarrasser de la pierre d'achoppement qui gêne le
courant et rend opaque l'illumination. On doit donc
déstabiliser le rôle originel de la conscience afin de
le repositionner. Elle n'est pas, comme on pourrait le
penser, l'étrangère qui intervient à rebours pour
manipuler les données recueillies. Elle est présente au
cours du processus et assure la justesse de la dictée.
André Breton ne renierait sans doute pas ce fait,
d'autant qu'il précise dans le Manifeste du surréalisme
en 1924 que si la première phrase est donnée, il est
assez difficile de se prononcer sur le cas de la
suivante. Michel Carrouges, attirant l'attention sur ce
fait, fait remarquer qu'elle relève sans doute d'une
collaboration entre notre activité consciente et
inconsciente. Cette interprétation tient au fait que la
transcription de la première phrase nécessite un minimum
de perception. La conscience se trouve alors placée
entre l'arbre et l'écorce. Elle n'est pas à l'intérieur,
la dictée automatique demeure le domaine du
subconscient. Elle n'est pas non plus située à
l'extérieur, à contempler de loin la scène. Elle devient
une présence, aux aguets, prête à intervenir si une
problématique survient. C'est une nouvelle coopération
qui s'instaure. La conscience se coupe de la vie
extérieure pour se concentrer sur l'activité intérieure.
143
6.1.3 Écriture infraiiminaire ?
Il serait utopique d'espérer exclure totalement la
conscience de l'art d'écrire. La distinction entre
l'écriture surréaliste et l'écriture conventionnelle
tient au repositionnent des fonctions du conscient et du
subconscient. L'écriture classique limite
considérablement le sujet dans sa capacité à puiser dans
le registre de l'inconscient. Les éléments qui en
surgissent sont soumis à un contrôle extérieur et il n'a
que peu de pouvoir discrétionnaire sur eux. L'écriture
automatique, elle, offre à 1'inconscient une place
prépondérante. Par contre, l'intervention de la
conscience est nécessaire, sans quoi il serait
impossible de déchiffrer la signification des signaux
envoyés. Le signifié doit inévitablement posséder un
signifiant, aussi irrationnel soit-il. À ce propos, il
est intéressant de noter que la phrase qui survient,
lors de cette dictée, n'est pas rationnelle dans sa
signification, mais elle l'est dans sa structure. De
plus, il est primordial de soulever cette nuance c'est-
à-dire que l'automatisme ne tient pas sa valeur de la
superposition de phrases sottement irrationnelles, mais
du fruit de la rencontre entre la conscience et le
subconscient. Pour être valable, elle doit donc être
authentique. On ne peut donc pas parler simplement d'une
banale opposition entre les deux formes d'écriture, la
formule traditionnelle consciente et celle de l'écriture
automatique mise au point par André Breton.
Le but prôné par celui-ci, dans cette action, est de
nous amener à établir un nouveau rapport de forces entre
144
ces deux éléments indissociables de l'esprit humain.
Ainsi, considérant ce fait, on comprend que cela
nécessite une toute nouvelle forme de concentration.
Comme elle n'est pas infuse, la mettre en place demande
au corps beaucoup d'énergie. Il est, dès lors,
compréhensible que le résultat ne soit pas incontinent
impeccable et que l'on doive répéter l'expérience pour
atteindre son objectif. Evidemment, cela présuppose que
l'on doit se replonger dans le même état d'esprit.
L'écriture automatique peut ainsi être perçue comme
l'expression d'une force inconsciente presque
omniprésente dans l'esprit humain. Tout comme le rêve,
il est envisageable qu'elle se répète ou se suive à la
manière d'un feuilleton télévisé.
La prise de conscience de ces problèmes est essentielle,
puisqu'elle met en lumière ce double constat, c'est-à-
dire que le subconscient fonctionne d'une manière
complexe et que, par conséquent, ses possibilités sont
multiples.
6.1.4 Ego
L'expérience de l'écriture automatique nous apprendra
que malgré le souci de son fondateur, que l'on ne peut
soustraire le poète de son ego... Ce trait est si
profondément ancré dans la nature de certains que, même
avec l'utilisation du procédé d'écriture surréaliste, la
compétition subsiste. Ainsi, on verra des discussions
naître sur telle production automatique plus
« considérable » que telles autres...
145
Breton, contrevenant à sa propre règle, cédera à la
tentation d'apporter des corrections aux textes. Or, sa
visée n'a jamais été de produire des textes automatiques
parfaits, mais de s'en rapprocher et de mettre en
lumière ses multiples possibilités. L'écriture
automatique est une expérience à la fois ambiguë et
ambivalente, à l'image de son sujet. Il va sans dire que
l'idée d'un automatisme parfait, dans la durée, demeure
totalement utopique. Or, Breton aura cherché, sans pour
autant sanctifier cette technique, à aller puiser, en
son sein, l'élan de sa poésie.
Comme le fait remarquer Mark Polizzotti dans son ouvrage
André Breton, pour Breton, les Champs magnétiques
avaient une portée bien plus vaste que la seule mise au
point d'un nouveau procédé d'écriture. Pour la première
fois dans l'histoire, on tentait « d'adapter une
attitude morale », et selon lui, « la seule possible »,
à un procédé d'écriture211.
6.2 Écriture automatique et déraison, une polémique avec
Artaud
Pour bien entendre la portée des conceptions d'André
Breton quant à l'automatisme, il importe maintenant de
souligner son rapport à celui d'Antonin Artaud. À bien
des égards, Artaud se présente comme l'antipode d'André
Breton. Malgré une affection et un respect incontestable
et réciproque, il est hors de doute que les deux hommes
abordent le monde dans des perspectives fondamentalement
211 Mark Polizzotti, André Breton, p .121
146
opposées. Le point névralgique de leur désaccord tient à
deux maux paradoxaux. L'auteur de Lâchez tout souffre
« de ce type humain formé » tandis que l'auteur du Pèse-
Nerfs est victime d'une conscience qui l'abandonne et le
propulse dans le néant.
6.2.1 La schizophrénie et l'impuissance littéraire.
Antonin Artaud est schizophrène. Chaque jour, il doit
combattre le chaos de son esprit. La maladie d'Artaud
apporte ici une perspective fort intéressante, car
Artaud habite le gouffre de l'inconscient. Les psychoses
sont des maladies caractérisées par la perte du contact
avec le réel. Plus précisément, la schizophrénie est une
psychose qui provoque une déstructuration du système de
la personnalité. De là suit une double conséquence :
l'incohérence mentale et l'incohérence des conduites. La
vie psychique perd son unité. Le délire se présente
comme un processus secondaire lié à la désintégration de
la vie psychique. Le schizophrène voit sa pensée se
replier sur elle-même. Dès lors, ce n'est plus des
échanges relationnels avec autrui qu'elle se nourrit,
mais des complexes inconscients. Selon l'Association des
psychiatres du Canada : « Le plus souvent, ceux qui
souffrent d'hallucinations entendent des voix qui
commentent leur comportement, les insultent ou leur
donnent des ordres. »212
212 Association canadienne de psychiatrie, La Schizophrénie,http://www.cpa-apc.org/MIAW/pamphlets/Schizophrenia fr.asp, lOjuin 2005
147
De toute évidence, cette confusion entraîne Artaud sur
des eaux plus cauchemardesques qu'édéniques. Dans une
sincérité déconcertante, il confit :
« Certes, je fais encore (mais pour combien detemps ?)ce que je veux de mes membres, maisvoilà longtemps que je ne commande plus à monesprit, et que mon inconscient tout entier mecommande avec des impulsions qui viennent dufond de mes rages nerveuses et dutourbillonnement de mon sang. Images presséeset rapides, et qui ne prononcent à mon espritque des mots de colère et de haine aveugle,mais qui passent comme des coups de couteau oudes éclairs dans un ciel engorgé »213.
Antonin Artaud révèle ici le drame de sa pensée
déchirée. L'une des expressions de cette psychose, et il
est clair à ce sujet, consiste en un torrent
ininterrompu d'idées inconséquentes. Devant faire face à
un tel fatras, il paraît évident qu'il ne saurait être
question pour lui de plaider en faveur de l'abandon de
la censure consciente. Bien au contraire, toute son
énergie est mobilisée dans l'unique dessein d'extirper
un peu de clarté de ce hourvari.
Pour écrire, Artaud doit parvenir à stabiliser
temporairement ses pensées. En l'occurrence, cette
manœuvre est nécessaire à la transcription de l'idée.
Sans cette ascèse, pour lui, rien n'est possible. Les
psychotiques éprouvent généralement une grande
difficulté à surmonter les traverses qui surviennent au
cours du processus de rédaction. L'art scriptural revêt
213 Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlyse dans1 'expérience surréaliste, p.40
148
alors une enveloppe cyclopéenne. Le neuropsychiatre,
psychanalyste, psychologue et éthologue français, Boris
Cyrulnik, explique que : « pour écrire un livre, il faut
planifier les idées, accumuler les notes et maîtriser le
réel. »214 Selon la perspective du psychotique, ces
considérations, loin d'être anodines, sont
astreignantes. Leur esprit est le lieu d'affrontement
belliqueux où les idées qui explosent dans toutes les
directions ont communément pour effet de les garrotter.
Sixte Marcos, dans son article Artaud intime : le vide
et 1 'essence, remarque chez Antonin Artaud que : «...
l'abordage du fait scriptural s'accomplit par le
ressassement infini d'un début échoué. »215 Et, Artaud
témoigne de ses difficultés dans la lettre du 5 juin
1923 adressée à Jacques Rivière :
Je souffre d'une effroyable maladie del'esprit. Ma pensée m'abandonne, à tous lesdegrés. Depuis le fait simple de la penséejusqu'au fait extérieur de sa matérialisationdans les mots. Mots, formes de phrases,directions intérieures de la pensée, réactionssimples de l'esprit, je suis à la poursuiteconstante de mon être intellectuel. Lors doncque je peux saisir une forme, si imparfaitesoit-elle, je la fixe, dans la crainte deperdre toute la pensée. Je suis au-dessous demoi-même, je le sais, j'en souffre, mais j'yconsens dans la peur de ne pas mourir tout àfait.216
214 Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, p. 179215 Sixte Marcos, II séminaire GRES - L'écriture fragmentaire : théorieset pratiques, Artaud intime : le vide et 1'essence, UniversitatAutônoma de Barcelona,http://webperso.mediom.qc.ca/~extrudex/articles/gfrag-marcos.html, 10juin 2005216 Antonin Artaud, Œuvres, p. 69
149
Artaud perçoit l'écriture comme une ressource dont la
fonction est de rendre visible son existence
intellectuelle. Autant que faire se peut, il entreprend
de constituer une preuve indélébile permettant de
démontrer, aux autres et à lui-même, qu'il est217. Pour
ce faire, il tente d'immortaliser ses éclats de pensée
« si imparfaite soit-elle ». Il n'aspire donc pas à
atteindre une qualité littéraire. Il est clair à ce
sujet. Il dit tout net : « Je suis au-dessous de moi-
même, je le sais, j'en souffre, mais j'y consens ». Il
faut entendre le poids et la portée de ce consentement.
Ici se révèle la modestie de la quête d'Artaud. C'est
pour recouvrer une partie perdue par l'effet de la
dissociation qu'il lutte. Il s'agit d'une stratégie de
confirmation et de réappropriation de soi. Antonin
Artaud ajoute : « II m'importe beaucoup que les quelques
manifestations d'existence spirituelle que j'ai pu me
donner à moi-même ne soient pas considérées comme
inexistantes par la faute des taches et des expressions
mal venues qui constellent. »218 Là est sans doute la
raison pour laquelle il cherche à se fixer des repères
extérieurs. Craignant d'être emporté dans le tourbillon
de la folie, Artaud s'emploie à laisser des empreintes
de sa pensée lucide pour en retrouver le chemin.
Il est hors de doute que l'écriture doit répondre à une
fonction de nécessité car Artaud s'acharne. Il affronte
les insuccès de cette pensée meurtrie avec un courage
herculéen. En fait foi cet extrait :
17 Au sens philosophique de l'existence.218 Antonin Artaud, Œuvres, p. 69
150
Eh bien ! C'est ma faiblesse à moi et monabsurdité de vouloir écrire à tout prix, etm'exprimer. Je suis un homme qui a beaucoupsouffert de l'esprit, et à ce titre j'ai ledroit de parler. Je sais comment ça se trafiquelà-dedans. J'ai accepté une fois pour toutes deme soumettre à mon infériorité. Et cependant,je ne suis pas bête. Je sais qu'il aurait àpenser plus loin que je ne pense, et peut-êtreautrement. (...) Dans une heure et demain peut-être j'aurai changé de pensée, mais cettepensée présente existe, je ne laisserai pas seperdre ma pensée.219
Il importe de remarquer qu'Artaud est bien déterminé à
lutter contre la fuite de sa pensée. Cette lutte a pour
corrélat la liaison qui unie le vide et la mort. Que
peut-il y avoir de pire que rien? Que reste-t-il
d'humain lorsque la pensée s'évade sinon un corps
automate ? Il semble que c'est précisément la
juxtaposition du désir de se sentir exister et
l'impuissance continue face a une écriture bigarrée,
chétive et forte qui l'amènera à s'intéresser au
mouvement d'André Breton. D'ailleurs, cette question
posée à Jacques Rivière est traversée par les
préoccupations du surréalisme. Elle va comme
suit : « Pensez-vous qu'on puisse reconnaître moins
d'authenticité littéraire et de pouvoir d'action à un
poème défectueux, mais semé de beautés fortes qu'à un
poème parfait mais sans grand retentissement
intérieur ? » Et, Paule Thévenin appuie cette hypothèse
en disant, dans son article L'automatisme en
question, que : « ... le surréalisme lui avait permis de
ne pas désespérer, en lui apprenant à ne plus chercher
219 Cité dans : Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlysedans l'expérience surréaliste, p.40
151
dans le travail de la pensée une continuité devenue
impossible. »220 Tout se déroule comme si la quête
entreprise par Artaud est à la source de l'attraction
éprouvée à l'endroit du surréalisme et la répulsion à
l'endroit de l'automatisme.
6.2.2 1924, l'automatisme au cœur du surréalisme, à nul
autre second.
Lorsque Antonin Artaud joint le mouvement surréaliste en
1924, il est hors de doute que l'automatisme polarise
l'attention de ses membres. Victime de cette pensée
desserrée qui l'abandonne, Artaud rencontre ses limites.
Il précise :
J'ai senti vraiment que vous rompiez autour demoi l'atmosphère, que vous faisiez le vide pourme permettre d'avancer, pour donner la placed'un espace impossible à ce qui en moi n'étaitencore qu'en puissance, à toute une germinationvirtuelle, et qui devait naitre, aspirée par laplace qui s'offrait. Je me suis mis souventdans cet état d'absurde impossible, pouressayer de faire naitre en moi de la pensée.Nous sommes quelques-uns à cette époque à avoirvoulu attenter aux choses, créer en nous desespaces à la vie, des espaces qui n'étaient paset ne semblaient pas devoir trouver place dansl'espace. 221
II faut entendre la frustration d'Antonin Artaud
concernant « cet état d'absurde impossible ». La formule
est éloquente. On voit clairement que l'automatisme ne
stimule pas sa poésie mais l'éteint. Sa pensée est
220Ibidem, p . 40
2 2 1 Antonin Artaud, Œuvres, p . 159
152
« aspirée » dans un trou noir. L'espace alloué par
l'automatisme dissous ses idées. Cet « état d'absurde
impossible » c'est-à-dire la décontraction de la censure
consciente originelle a pour effet de le rendre
aphasique, de l'hébéter. Et pour cause : la pensée
d'Artaud est déjà infléchie. De fait, c'est à un
« vide » que la poésie cède la place. Il s'agit d'un
vide mortel, un vide qui aliène son existence et
l ' incite à vouloir « créer » « des espaces à la vie ».
Comme le dit Sixte Marcos dans son article Artaud
intime : le vide et l'essence: « L'espace littéraire
tantalise en fait la personne d'Artaud vers un absolu
fautif »222.
Il apparaît évident qu'Artaud doit percevoir le
surréalisme sous un angle différent. On peut se demander
dans quelle direction est orienté ce regard? Dans le
Pèse-Nerfs, Antonin Artaud précise à ce sujet :
« Mais, je suis encore plus frappé de cetteinlassable, de cette météorique illusion, quinous souffle ces architectures déterminées,circonscrites, pensées, ces segments d'âmecristal l isée, comme s ' i l s étaient une grandepage plastique et en osmose avec tout le restede la réali té. Et, la surréalité est comme lerétrécissement de l'osmose, une espèce decommunication retournée. Loin que j ' y voie unamoindrissement du contrôle, j ' y vois aucontraire un contrôle plus grand, mais uncontrôle qui, au lieu d'agir se méfie, uncontrôle qui empêche les rencontres de la
222 Sixte Marcos, II séminaire GRES - L'écriture fragmentaire : théorieset pratiques, Artaud intime : le vide et l'essence, UniversitatAutônoma de Barcelona,http://webperso.mediom.qc.ca/~extrudex/articles/gfrag-marcos.html, 10juin 2005
153
réalité ordinaire et permet des rencontres plussubtiles et raréfiées, des rencontres aminciesjusqu'à la corde, qui prend feu et ne romptjamais. »223
En l'occurrence, c'était prévisible, mais le mot est
maintenant lâché : il s'agit du « rétrécissement de
l'osmose » pour « un contrôle plus grand ». Ce contrôle,
Artaud l'aborde en terme de vigilance. Contrairement à
André Breton qui place sa foi dans ses messages
inconscients, Antonin Artaud s'en méfie. La maladie dont
il souffre entraîne une distorsion de la pensée. Il est
confondu, abusé par ses perceptions. En outre, la
« révélation » à laquelle il aspire s'articule autour de
ce désir de cerner cette « météorique illusion » qui est
« en osmose avec tout le reste de la réalité ».
Autrement dit, il s'agit de départager le réel de
1'irréel.
Il importe de souligner cette distinction entre
l'approche d'André Breton et d'Antonin Artaud. Le
premier, tel qu'évoqué précédemment, souhaite remonter à
la source du langage pour y puiser de riches images
permettant de reformuler le monde et d'accroître la
liberté humaine. L'épuration du langage visée par Breton
doit avoir pour fonction de se dissoudre les antinomies.
Le second, cherche à atteindre « L'Ombilic des Limbes »
afin de découvrir une langue plus juste. En
l'occurrence, il s'agit d'accéder au « sentiment
central »224, immuable où se forme le vocable avant sa
contamination par l'osmose. Autrement dit, le dessein
223 Antonin Artaud, Œuvres, p. 159224 Ibidem, p. 69
154
d'Antonin Artaud est de repérer une voie permettant de
combattre la dissociation.
Pour réchapper de ce chienlit, Artaud doit s'imposer une
ascèse de vie serrée. Il confie :
« Cette douleur plantée en moi comme un coin,au centre de ma réalité la plus pure, à cetemplacement de la sensibilité où les deuxmondes du corps et de l'esprit se rejoignent,je me suis appris à m'en distraire par l'effetd'une fausse suggestion. L'espace de cetteminute que dure l'illumination d'un mensonge,je me fabrique une pensée d'évasion, je mejette sur une fausse piste indiquée par monsang. Je ferme les yeux de mon intelligence, etlaissant parler en moi l'informulé, je me donnel'illusion d'un système dont les termesm'échapperaient. Mais de cette minute d'erreuril me reste le sentiment d'avoir ravi àl'inconnu quelque chose de réel. Je crois à desconjurations spontanées. Sur les routes où monsang m'entraîne il ne se peut pas qu'un jour jene découvre une vérité. »225
Devant faire face à cette guerre sempiternelle que se
livre les fragments de son esprit, Artaud se dote de
stratagème pour déjouer sa propre pensée. Il s'agit là,
pour reprendre l'expression de Théodore Fraenkel, d'un
tout autre type d'« horreur conventionnelle ». L'esprit
d'Artaud est parasité par le mal. Il convient de
remarquer que, dans ces lignes, c'est la victoire d'un
homme qui est racontée. Celle d'un homme heureux
d'avoir, une « minute », « ravi à l'inconnu quelque
225Cité dans : Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlysedans 1 'expérience surréaliste, p.37
155
chose de réel ». Artaud tente de se réapproprier sa vie
« morceau par morceau ».
Une évidence frappe alors de plein fouet. Le sentiment,
éprouvé par André Breton, un certain après-midi, place
de l'Étoile, d'avoir été traqué « par des chats qui
étaient peut-être (mais je vous prie de me croire :
seulement peut-être) des autos »22 i l lustre la réalité
d'Antonin Artaud. Si André Breton peut jouer avec ses
états de conscience c'est qu'il est en pleine maîtrise
du réel ce qui n'est pas le cas d'Antonin Artaud.
Le réel auquel aspire Antonin Artaud a pour ressort
1'élucidation du langage. Ce processus d'élucidation a
pour corrélat la matérialisation du langage. Paule
Thévenin explique dans son article L'automatisme en
question que pour lui : « le Surréalisme ne peut pas se
borner à une recherche de faits exemplaires ou
miraculeux mais qu'il est avant tout un état d'esprit à
élucider et à rendre actif et si l'on peut dire objectif
et matérialisable »228.
Il convient de souligner que, tels qu'énoncés
précédemment, les poèmes automatiques se présentaient
sous forme de séquences mentales. Or, leur fonction
restait non définie. Parallèlement, on observe que le
6 Sixte Marcos, II séminaire GRES - L'écriture fragmentaire : théorieset pratiques, Artaud intime : le vide et l'essence, UniversitatAutônoma de Barcelona,http://webperso.mediom.qc.ca/~extrudex/articles/gfrag-marcos.html, 10juin 2005227 André Breton, Philippe Soupault, Les Champs Magnétiques, p.15228 Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlyse dans1'expérience surréaliste, p.46
156
Pèse-Nerfs et L'Ombilic des limbes sont construits comme
des assemblages de fragments. La démocratisation du
langage à laquelle aspire Artaud est traversée par les
jeux infinis de ces fragments d'égale valeur. De fait,
c'est la « qualité hétérogène »229 des fragments qui
devient le seul facteur limitatif d'intégration.
Nous savons que Breton tente d'extraire des segments
« inconscients » et que Artaud tente de capter des
pensées lucides. En outre, ne peut-on pas voir dans ces
deux exercices de contorsion de l 'esprit , inversés pour
chaque partie, une similitude traduite par la présence
de ces fragments ?
Un autre point intéressant se révèle dans l'idée de
passage du sujet à l'objet. Pour Breton, i l s'agit
d'extraire l'ego du poète du poème en présentant une
coulée inconsciente. Pour Artaud, i l s'agit de se
constituer comme existant par la mise au jour de ses
pensées. Dès lors, la notion de narcissisme devient
presque inextricable et tout à fait relative au point de
vue dans lequel se positionne l'observateur. Cette autre
vision s'appuie sur l'impossibilité de produire un objet
qui ne soit pas un commentaire de soi. On peut ainsi
percevoir cette objectivâtion comme la création d'un
délégué narcissique duquel on peut parler sans se sentir
confronté. De ce point vu, i l est possible de s'aimer
sans se culpabiliser du regard apologétique que l'on
9 Sixte Marcos, II séminaire GRES - L'écriture fragmentaire : théorieset pratiques, Artaud intime ; le vide et l'essence, UniversitatAutônoma de Barcelona,http://webperso.mediom.qc.ca/~extrudex/articles/gfrag-marcos.html, 10juin 2005
157
pose sur soi. Suivant cette visée, la démarche de Breton
est réduite à l'état de duperie.
Enfin, sans vouloir porter un jugement sur les thèses
soulevées par les auteurs, une évidence paraît
incontestable. Il semble que le discours automatique ne
peut pas être de l'ordre de l'inconscient. De toute
évidence, l'inconscient renvoie directement au néant. Il
est d'emblée réservé et purement accessible à celui qui
est en parfait contrôle du réel. Il ne s'agit donc pas
d'un processus à la portée de tous mais uniquement
réservé, limité, à ceux parfaitement disposés.
158
7. L'horizon pictural de l'automatisme :
André Masson, une œuvre sous le sceau du Pandémonlum
«(...) n'est-il pas plus ànotre portée d'aimer que decomprendre - pour moiautant que me le permettentmes perceptions obscures -les voies les plus bellespartent du cerveau pouraboutir au cœur ce seraitune consolation pour leséchecs de laconnaissance. »
André Masson
La guerre d'André Masson pourrait être abordée sous de
multiples angles. Nous en retiendrons trois. Le premier
concerne le paysage de la guerre c'est-à-dire la guerre
perçue comme registre d'images. Le deuxième touche aux
renversements, sur le plan humain, qu'elle induit. La
guerre est un facteur de conflagration des relations
face à autrui et à la nature perçue comme force de vie
et de mort. Le troisième envisage la guerre dans sa
dimension d'empire : la guerre est une expérience
indélébile, qui à de rares exceptions près, tenaille la
vie de ceux qui l'ont vécue. Il semble qu'elle a
subverti la vie du peintre. Nous tenterons de réfléchir
sur la forme que revêt cette influence.
2lC André Masson, Les années surréalistes : correspondance 1916-1942,
p. 14
159
Se dessinent ainsi trois rapports fondamentaux liés au
parcours du peintre concernant la création, le regard
projeté sur l'autre et sur la nature, et le moteur
d'action. Or, ce sont trois rapports au parcours de
l'artiste qu'une réflexion qui se veut rigoureuse peut
difficilement ignorer. André Masson déclarait, dans
Mémoire du monde, au sujet de son expérience guerrière :
« ... il me paraît fatal que certaines épreuveslaissent des empreintes dans le laboratoire dela création, celles-ci seraient-elles assezpuissantes pour transmuer en fêtes picturalesles massacres, comme le souhaitaient Delacroixet Baudelaire. »231
II convient donc de s'y arrêter.
7.1 Le kaléidoscope
L'expérience guerrière d'André Masson s'articule
différemment de celle d'André Breton. André Masson était
en Suisse au cours de l'été 1914. Issu d'un milieu
paysan, c'est l'obtention d'une bourse d'étude de
l'École nationale supérieure des beaux-arts qui lui
permit d'étudier l'art de la fresque en Italie. Masson
saisit l'occasion pour parcourir quelques musées
européens. N'étant pas au fait de l'actualité, c'est par
l'entremise de ses voisins qu'il apprit la nouvelle.
Plus attaché à l'Europe qu'à la France et malgré sa
détestation pour le fait guerrier, il choisit de ne pas
se « soustraire à cette épreuve »232. À ce sujet, Daniel
Henri Kahnweiler remarque très justement, dans un livre
1 André Masson, La mémoire du monde, p.56'32André Masson, Vagabond du surréalisme, p. 13
160
intitulé André Masson que le peintre ne s'abstrait
jamais des malheurs des temps tout comme il ne limite
jamais le champ assigné à son art233.
Il faut entendre cette décision comme un choix
personnel. Dès lors, il n'apparaît pas paradoxal qu'il
manifeste un grand respect envers son camarade de
classe, Maurice Loutreuil, qui choisit de fuir en
Sardaigne. Pour Masson, Loutreuil est demeuré fidèle à
ses convictions. C'est devant La lutte de Jacob avec
l'Ange d'Eugène Delacroix qu'André Masson se recueillit
avant d'être propulsé dans Le Pandémonium. Il était
alors âgé de 18 ans.
Il semble qu'André Masson adopte une attitude empreinte
de renoncement. On remarque que le jeune homme possédait
déjà une certaine maîtrise de son art à cette époque.
Dans la lettre de 5 octobre 1916 à Loutreuil, il parle
de l'art en terme d'idéal. En l'occurrence, il est peu
surprenant que Masson évoque la guerre en image. André
Masson ne renierait sans doute pas ce fait d'autant
qu' il aborde directement la question dans Mémoire du
monde. À cet égard, il précise : « Wells avait bien
compris qu'artiste, et me trouvant aux premières loges
du « théâtre de la guerre » (...) je devais voir davantage
que bien d'autres.»23
À l'évidence, c'est l'œil du peintre qui capte le
foisonnement d'images que le front lui renvoie.
3 Musée de Lyon, André Masson234André Masson, La mémoire du monde, p. 69
161
Plusieurs apophtegmes en témoignent. En font foi ces
extraits. Masson relate l'histoire d'un soldat abattu
par erreur en ces termes:
« L'énervement empêche d'obéir à l'ordre decesser le feu, et sur le soldat gisant nousépuisons nos cartouchières. Jusqu'à ce qu'unévénement imprévu mystérieux nous fassepresque tomber le fusil des mains. Jaillie ducadavre une aveuglante lumière vertepersistante brille à un mètre au-dessus ducorps. Enfin la nuit reprit ses droits. Et lebon sens : ce n'était qu'une fusée que lepatrouilleur malheureux détenait dans une deses poches, et sa montée déclenchée par une denos balles. »235
Suivant cette lignée, c'est en le comparant à « la
gueule du monstre »236 que Masson évoque les « bourbier
de la Somme »237 :
... je me traîne comme un animal englué. Je suisseul sur le ventre entre les trous d'obus, lescratères, les entonnoirs emplis de boue. (...) Jesuis enfoui jusqu'à mi-jambes et peu à peu,comme si j'étais tiré par les pieds du fond decette bouche. Effrayé à l'idée de périr, decette façon peu héroïque : j'eus assezd'énergie pour m'appuyer sur les lèvres du troude mine qui s'apprêtait à m'engloutir. Le démonde la boue fut un des pires de cette guerre auxmultiples pièges238.
Signalons, au passage, que cette expérience le plongea
dans un état léthargique qui dura deux jours. Au réveil,
235 André Masson, La mémoire du monde, p. 60236 Ibidem, p. 57237 Ibidem, p . 64
238Ibidem, p . 72
162
il était « à peu près amnésique »23 et sous l'effet du
soleil agissant, transformé en « statue de glaise
séchée». Enfin, c'est en effectuant un rapprochement
entre le soldat au « cri figé », que nous avons énoncé
précédemment, et « La lionne blessée du British Muséum »
qu'il évoque le mort à l'extérieur de vivant240.
Nous avons tenu à citer consécutivement ces quelques
extraits. Ils furent choisis presque aléatoirement parmi
l'impressionnante variété qui s'offrait à nous, pour
mettre en évidence un fait. Il paraît incontestable que
ces moments sont présentés à la façon de tableaux. André
Masson vit la guerre en images. Il est très sagace à cet
égard. Il décèle d'emblée l'esthétique qui, dans
l'horreur, transcende l'expérience. Tout se présente
comme si Masson découpait la guerre du regard. L'espace
ainsi présenté crée une perspective où sont mis en jeu
l'insolite et le mystérieux.
André Masson raconte ses expériences dans une honnêteté
scrupuleuse, exempte de complaisance. L'émotion
ressentie par le lecteur s'en voit décuplée. Il importe
de remarquer le regard analytique du peintre. Masson ne
cherche pas à expliquer les faits. Il semble, par
contre, chercher à élucider ce qui, dans chacun de ces
moments partagés avec « toute la piétaille de
l'histoire »241, était le facteur d'intensification de
l'émotion. L'objet de sa recherche s'articule autour de
239 Ibidem, p. 72240 Ibidem, p. 69241 Ibidem, p. 69
163
l'art de traduire l'émotion en image. Il est clair que
Masson souhaite témoigner. Or, ce témoignage n'est
possible que par la voie de l'image. La préoccupation
est donc soudée à l'esthétique.
On observe que certaines de ces images sont données et
ne demandent qu'à être saisies, comme ce soldat traversé
par « une aveuglante lumière verte ». D'autres sont le
fruit d'une composition par symbole. Sous l'oeil de
Masson, un sol devenu mouvant se métamorphose en la
gueule d'un monstre avalant l'homme absent. Ce type de
composition permet l'émergence de l'émotion. On voit
donc clairement que Masson puise, dans cette expérience
qui outrepasse l'entendement, les modalités de
construction d'une représentation picturale. Il est
loisible de penser que cette prédisposition est
amplifiée par la tension d'un réel dévasté. L'expérience
démontre que la vie précaire a couramment pour fille la
reconnaissance de l'esthétique dans le vivant.
Devant faire face à son désir et à son impuissance à
extérioriser son expérience de la guerre, il précise :
Je croyais l'avoir vécue à fond, l'avoirobservée d'un œil aigu, j'étais plein d'imagesà en éclater - la bande du film, dans moncerveau, semblait avoir des milliers dekilomètres mais lorsque je m'assis à matable, sur une chaise, sous un toit, une plumeà la main, alors les forêts et les villagesrasés, les tremblements de terre sous les feuxroulants, le magma de boue et de grandeur, depeur et d'héroïsme, de corps déchiquetés, decrainte de la mort et d'humour macabre tout
164
cela était - indiciblement - comme le délired'un autre monde242.
Cette confession est précisément traversée par la
préoccupation de rendre accessible 1'infigurable. Il y a
là une affirmation que la guerre est, pour lui, une
chambre noire où s'effectuent le traitement et le tirage
des images. Un double constat s'impose. Dans ce conflit,
Masson est observateur et victime. D'une part, il
observe le déroulement de ces manifestations
singulières. Il analyse la forme visuelle dans laquelle
elles s'incarnent. D'autre part, il s'associe à
l'adversité. Il prend part au processus de macération
des hommes. Il est donc imprégné par la charge émotive
liée à ces visions. Face à cette mortification, il goûte
les éléments qui parviennent à percer la désaffection
humaine. On peut penser que cette imprégnation exalte
l'analyse visuelle. Elle permet au peintre de discerner
les contrastes et de cerner les colorations
émotionnelles qui les traversent et les nouent.
7.2 Le renversement, de la désaffection à la magnanimité
André Masson précise dans Vagabond du Surréalisme que :
« C'est la guerre, en fait, qui m'a rapprochédes autres. Avant, je vivais complètement àpart. La guerre m'a précipité dans l'humushumain, m'a fait homme. C'est affreux à dire,mais c'est par elle que j'ai l'impressiond'être entrée dans la communauté de messemblables. Sans cet événement je n'aurais pasété soldat, je n'aurais pas eu de contact avec
242 Ibidem, p. 53
165
ces masses, — des masses très simples - puisquej'étais simple soldat. »243
D'un point de vue pratique, la violence de la guerre
soulève un paradoxe à l'égard des relations
interpersonnelles. D'une part, elle exalte l'intervalle
entre le moi et l'autre. La réserve face à l'engagement
amical a pour ressort l'énormité des pertes humaines. Il
s'agit d'un réflexe défensif qui permet de moins
souffrir. Parallèlement, la guerre constitue un moyen de
coercition. Nul ne peut survivre seul. Le soldat doit
s'en remettre à l'autre. Elle érige ainsi une relation
d'interdépendance avec l'anonyme par la voie de la
nécessitée du travail collectif. La guerre est donc le
lieu d'un renversement. Elle enfante une nouvelle
prénotion de l'Autre. Tout paraît donc concourir à la
mise en place d'une perception plus altruiste.
Masson est amené à poser un regard affable sur
l'humanité. On observe que ses propos à l'endroit de ses
semblables sont marqués de déférence. Dans Mémoire du
monde, il confie :
simplement, je rendrai compte d'uneexpérience partagée : celle des ilotes detranchées (j'étais l'un d'eux, au plus bas del'échelle). Je parlerai de la « prodigieusefatigue des soldats », des conséquencesinsolites de l'action, des effrayantes épaveshumaines abandonnées sur les champs debataille. Avant tout, la misère physique d'êtretrès humbles devenus hideux : couverts de bouedes pieds à la tête après une semaine, etsouvent davantage, de « séjour » en premièreligne. Éléments d'une brigade volante jetés
243 André Masson, Vagabond du surréalisme, p.15
166
dans le creuset, ne sachant pas ce que c'estqu'un abri et n'ayant pour tranchées que destrous d'obus parfois réunis avec la pelle à lamain, nous avions, selon la terminologiemilitaire, à « réorganiser le terrain »,parfois sous une pluie continuelle, incapablespour autant de nous laver de cette carapace deterre et de déjections, et manquant d'eau pourboire quand « les corvées de soupe » nerevenaient pas. Comme accompagnement, lepilonnage de l'artillerie et les alarmescontinuelles, celle de « l'alerte au gaz »n'étant pas la moins pénible. À tel point qu'unmouvement hors de ce cloaque pouvait passerpour une sorte de délivrance... »244
Nous avons tenu à citer ce long passage. Masson survole
la vie partagée avec ces « ilotes ». Il importe de
remarquer que ces moments d'horreur sont liés à la
modification du regard. Il paraît hors de doute que la
vie en plein cœur de ce désastre, artificiellement créé,
postule une symbiose. Tous sont pris en otage. Tous sont
vulnérables. Tous sont admissibles au rang de blessés ou
de cadavres abandonnés. Tous sont soumis à la peur et à
la fatigue. Tous sont potentiellement sujets aux
troubles nerveux. Tous sont devenus vomitifs. Et, il
semble que cette communauté d'exposition aux risques
soit à l'origine de ce regard. Cette réaffectation au
plus bas degré de l'expérience humaine, ce catapultage
massif dans « cette vie indigne d'un animal »245, exclu
un certain nombre de préjugés. L'humanité se dévoile
dans une impudique fragilité. Il est clair que, dans
cette expérience, beaucoup des travers humains qui
permettent la constitution des antinomies se dissolvent.
244 André Masson, La mémoire du inonde, p . 55
2 4 5 Ibidem, p . 69
167
II est loisible de penser qu'il s'agit de l'aube d'un
regard plus humain posé sur l'autre. Lorsque Masson
peindra en les abattoirs au début des années 1930, c'est
avec mansuétude qu'il présente l'animal sacrifié et avec
commisération qu'il illustre 1'équarrisseur. L'homme
semble y accomplir son devoir non pas alimenté par une
gourmandise sadique mais comme piégé par un système qui
le lui commande. Suivant cette visée, dans la série
Massacres de la même période, la violence ne semble pas
délibérée et préméditée. Les victimaires présentés
semblent attendris et leur position paraît précaire,
sujette à permutation. La violence n'est donc pas
délectée mais éprouvée. Elle se présente comme liée à la
condition humaine. Le peintre est sagace. S'opposant
ainsi au réductionnisme vilain, il s'affaire à démontrer
que rien n'est jamais clair dans le vivant. C'est la
labilité de l'homme qui est mise en évidence.
Tel que le précise André Masson, au cours de cette
période, il est un de ces « ilotes de tranchées ». La
guerre de Masson se déroule sur le terrain. De fait, on
observe que la relation qui se façonne entre l'homme et
la nature est aussi l'objet d'un renversement. Au cours
de ces temps guerriers, l'homme est en relation directe
avec les quatre éléments. Il est précarisé. La vie est
une question qui relève plus de la fortune que du
talent. Masson parle à cet effet de la « triade Chance,
Hasard, Absurdité »246. Le sol devenu mouvant, labouré
par les obus et les tranchées, est source de danger. La
246 Ibidem, p.7 9
168
pluie est interminable. Le soleil pétrifie les soldats
boueux. Le froid cause des engelures. L'être humain doit
faire face aux limites de son corps. Il voit ainsi
s'éployer la force brute d'une nature qui, envers et
malgré lui, reprend ses droits.
7.3 Les cendres de la guerre
Pour André Masson, l'un des épisodes les plus marquants
de cette guerre fut l'offensive du 16 avril 1917. Il
convient donc de s'y arrêter.
Il s'agit d'une bataille tristement célèbre. Suivant la
désaffectation du général Joffre, c'est le général
Nivelle qui prit le commandement des armées françaises.
Malgré les échecs consécutifs des offensives d'Artois,
de Champagne et dans la Somme, ce dernier se fixa pour
but de briser la résistance allemande sur le front de
l'Aisne. L'objectif de cette bataille était d'opérer une
percée décisive sur le Chemin des Dames en moins de deux
jours. Pour l'occasion, plus d'un million d'hommes sont
rassemblés sur la ligne de front de 40 kilomètres qui
séparaient Soissons et Reims. Les Français engagèrent,
pour la première fois depuis le début du conflit, des
chars d'assaut. Dès lors, on encourage les hommes à
fournir « un effort suprême »247. Nonobstant les efforts
déployés, les perspectives quant à l'issue du combat
demeurent sombres. Masson raconte :
« J'assiste, comme planton, à une réuniond'État-Major. Rapport de l'aviateur de la
247 Ibidem, p. 78
169
division : « Votre plan est de dépasser leChemin des Dames, d'atteindre le camp deSissionne. Une avance de 20 kilomètres ? Vousen ferez peut-être quatre. Vous vous buterez àla route 44 (route de Laon à Reims) et là, vousrecevrez des balles dans le ventre. Les brèchessont insuffisantes. La route a été puissammentfortifiée. »248
Les chars sollicités ne furent pas d'un grand secours.
Au premier jour de l'offensive, Masson les a tous vu
s'enflammer « comme des bols de punch », et les soldats
qui les conduisaient, brûler « comme des torches »249. La
mission dont fut chargé André Masson consistait à
atteindre un poste, près de la Tranchée des Walkyries
afin de dérouler un fil téléphonique. En l'occurrence,
il s'agissait d'une mission suicidaire. Masson fut
heurté dès qu'il sortit de la tranchée. Il raconte :
Trois pas, et ma poitrine, il me semble qu'elleéclate en même temps qu'un colossal coup depoing dans le dos (l'afflux du sang dans lespoumons) me redresse de tout mon corps. Unepoussée de mon camarade me plaque à terre et metraîne dans un tiroir d'obus tout proche, déjàoccupé par un mort allemand : « Je vaischercher les brancardiers. » Je savais qu'ilsne sortaient jamais avant la nuit. J'avaispeine à respirer. Douleur et suffocation, jepense : « Cette fois, c'est la fin. » Sentimentde bonheur jamais encore éprouvé. Je tourne matête vers le cadavre, sa tête pareille à celled'une momie, sous le grand casqueallemand : « Bientôt, je serai comme toi. »Mais je respire un peu mieux et parviens àsortir de mon trou, à ramper ventre à terre,suivi par le bruit d'abeille de balles. Enrafales. Et par miracle (un de plus) à tomber
248Ibidem, p.78
249 Ibidem, p.80
170
dans une tranchée où se trouvent deuxinfirmiers.250
Masson est aussitôt conduit dans un abri pour être
succinctement pansé. Considéré comme mort, une missive a
déjà été envoyée à ses proches. Les supérieurs concernés
se font repentants et avouent avoir pressuré de la
bravoure du jeune homme.
La nuit venue, des brancardiers ambitionnent de le
transporter. Surpris par une attaque ennemie, ils fuient
le laissant pour mort en plein cœur de la plaine.
« Normal, cela » dit-il, impavidement. André Masson est
demeuré couché sur le sol, observant le ciel illuminé
par ces funestes fusées rouges et vertes qui éclairaient
les cieux tels des feux d'artifices. Aspergé par des
éclats de terre et d'obus, la tête levée, le corps
immobilisé, Masson avait été confronté à son
impuissance. L'effroi avait fait place à une fièvre
grandissante, voisine du délire. Masson, a ce moment
précis, avait eu l'impression d'assister à une sinistre
fête donnée en son honneur. Cette scène insolite ne
cessera de le hanter.
La bataille dura finalement 10 jours. Elle enfanta
environ 30 000 morts et 100 000 blessés. Cet événement
marque la fin de la guerre de tranchée pour André Masson
et le début d'une longue période d'hospitalisation.
Masson s'extirpera des hôpitaux en 1918, il sera alors
âgé de 22 ans. En temps et en heure, la France renoncera
Z!,0 Ibidem, p.85
171
au jeune peintre, le laissant « réformé, pensionné et
chômeur »251.
7.3.1 Question de traumatisme?
Cette blessure nous l'aborderons sous l'éclairage des
recherches du docteur Boris Cyrulnik. Ce choix a pour
ressorts de multiples raisons dont voici les trois
principales : a) en l'occurrence, André Masson utilise
textuellement le terme de « traumatisme » dans Mémoire
du monde; b) Boris Cyrulnik s'est intéressé
particulièrement à la relation entre les traumatismes et
la création; c) sa théorie, qui semble correspondre à
l'état vécu par Masson, ouvre une voie de réflexion très
intéressante sur le parcours du peintre.
André Masson ne se serait sans doute pas opposé à ce
mode de lecture, d'autant moins du reste qu'il soulève
lui-même un désir inhérent dans le Vagabond du
surréalisme. Il précise au sujet de ses tableaux de
l'époque des forêts que : « II serait intéressant
d'analyser par quels procédés je suis passé des forêts
aux tombeaux et quelles sont les aspirations et les
conceptions qui peuvent déterminer les recherches dans
le domaine du subconscient. »252 II y a donc un désir
énoncé en toute lettre de considération du subconscient
conjoint à l'analyse de son oeuvre. Nous savons que
Masson interrogeait incessamment ses dessins pour y
découvrir des indices permettant de décrypter les
mystères de sa pensée. Ce désir est donc afférent chez
251André Masson, Vagabond du surréalisme, p.18252 Ibidem, p. 7 3
172
l'artiste à une autoanalyse itérative. Prenons enfin
acte que, pour l'artiste, il y a fusion entre l'art et
la vie. Cette évidence affirmée, il serait malvenu de
notre part d'effectuer un schisme que l'auteur se
refusait d'emblée.
Il importe toutefois de souligner qu'il ne saurait être
question de tenter une expertise psychologique de
l'esprit de Masson (nous ne sommes d'ailleurs ni
compétent ni qualifié pour en traiter). Il ne s'agit pas
non plus d'exposer les thèses du docteur Cyrulnik, ce
qui n'est pas l'objet de notre propos. Il s'agit
simplement de mettre en perspective certains éléments de
ces théories afin d'élargir notre regard sur le faire de
1'artiste.
D'emblée, la notion de traumatisme demande à être
définie. Selon le docteur Cyrulnik qui, lui-même, réfère
à la psychanalyste Anna Freud, la notion de traumatisme
obéit à deux règles directrices:
1- Les êtres demeurent forçat de leur passé c'est-à-dire
qu'ils sont durablement imprégnés des images de
l'horreur dont ils ont été victime.
2-En outre, l'individu doit être doublement heurtés. La
première blessure relève du réel. Il s'agit de l'acte
subi. Cette blessure doit avoir pour corrélat une
seconde d'ordre virtuel. Cette seconde blessure est liée
à la représentation c'est-à-dire au sens que l'individu
lui attribue et à la réception sociale à laquelle il
doit faire face.
173
Masson était à peine sorti de l'adolescence. Il traversa
trois années de guerres dans des conditions qui
outrepassent l'entendement pour être grièvement blessé
dans une mission suicide. Le séjour hospitalier de
Masson fut particulièrement éprouvant. Le point nodal de
cette expérience réside dans une entrevue avec un
médecin qui se démarqua par sa condescendance. De fait,
pour bien ancrer notre propos, il convient d'en
présenter le récit. Masson raconte :
Le médecin me déclara bientôt « bon pour laréforme ». Caserne de Clignancourt : quelquesdizaines de troufions dans une salle et surl'estrade le major responsable des réformes, etson aide. Mon tour arrive. Déshabillé jusqu'àmi-corps, livret militaire taché de toutessortes de maculatures à la main : « Lève tonbras plus haut ! » Ne pouvant rien faire deplus que le lever à angle droit, le majorm'empoigne le bras et de toutes ses forcesl'élève au niveau de ma tête. Il me déchire lacicatrice, je saigne comme un porc. Je luijette à la tête mon livret militaire tenu de lamain gauche et descends de l'estrade, les « eninstance de réforme » hurlant « Boucher,boucher... » Parcourant la cour à grands pas,torse nu et ensanglanté, devant la sentinelleébahie, je saute dans le tramway Montrouge-Garede l'est. Voyageurs détournant la tête, moipris d'une rage contenue décourageant toutgeste de leur part. Arrivée dans ma famille,près du Jardin de l'Observatoire. Stupeur desmiens devant ce témoignage de barbarie quin'était pas allemand... Je leur dis que je nebougerai pas, que je ne me coucherai pas,attendant l'inévitable maréchaussée. L'autoritése montra sous la forme d'un médecin-major etde deux « gorilles » (comme on dit maintenant).Je dis au médecin que « je ne me considéraisplus comme soldat », et criai ma résolution dene plus bouger. Empoigné par deux « forts desHalles » travestis en infirmiers, je fus
174
embarqué en voiture. Tout proche était le Val-de-Grâce. Capturé - mais c'était un révoltéinvétéré qu'ils avaient fait. Interrogé àl'entrée de l'hôpital à la superbe façade maisaux chambres nauséabondes - étant entrée enRévolte comme on en Religion je refusai dedonner mon identité, de signer quoi que cesoit. Et ce fut le commencement d'une épreuvemisérable et répugnante. La guerre n'avaitjamais eu cette laideur : l'indifférence dumédecin à qui je montrai l'exploit de sonconfrère, la brutalité facile des infirmiers,leurs ricanements.253
Une remarque s'impose. Il est hors de doute que ces
expériences sont délicates à traiter. Elles commandent
le plus grand respect. En l'occurrence, les reformuler
comme des anecdotes de parcours serait carrément trivial
et méprisant. On n'aborde pas la souffrance d'un être
humain comme une historiette. Cette position affirmée,
ajoutons enfin que, selon notre regard, un travail qui
se veut rigoureux implique aussi de les considérer avec
sérieux. André Masson précise : « La guerre n'avait
jamais eu cette laideur ». Les mots ont leur force
propre. Il faut entendre ce que dit Masson. Jamais : les
rats, les croûtes de poux, les blessés hurlants avec des
plaies infestées de larves, les cadavres sans mains ni
bouches, l'épuisement jusqu'au délire, la faim, le
froid, la peur jamais la guerre n'avait eu, pour
lui, cette laideur. Il faut entendre la bacchanale dans
la salle. Il importe de remarquer l'exposition vécue par
Masson sur l'estrade, puis au cours du trajet de tramway
traversé par le regard des voyageurs, détournant la
tête. Il faut entendre le regard des membres de sa
253 André Masson, La mémoire du monde, p.90
175
famille frappée de stupeur. Il faut enfin entendre ce
commentaire : « je ne me considérais plus comme soldat »
et, Masson crier sa résolution « de ne plus bouger ».
Un renversement s'opère ici. Jusque-là, Masson acceptait
son sort avec une sagesse stoïque. Et, ce n'est pas la
blessure résultant du front qui le dégoûta. Ce n'est pas
non plus le fait que le pouvoir l'eut pressurisé. Son
écœurement a pour ressort le mépris. Il parle de
« 1'indifférence », de « la brutalité facile », des
« ricanements ». Il est loisible de penser que ce sont
ces attitudes farouches et implacables qui ont qualifié
d'irrémissible l'expérience d'André Masson. Sans cet
événement, l'expérience guerrière de Masson eut été sans
doute très lourde, mais elle n'aurait peut-être pas
constitué un traumatisme tel qu'entendu par le docteur
Boris Cyrulnik.
7.3.2 Considérations -touchant: cette commotion
La guerre est une expérience insensée. André Masson doit
faire face à un trop « plein d'images à en éclater la
bande du film ». Ces images, il doit leur donner un
sens. Le neuropsychiatre précise : « Ce sont les repères
extérieurs qui donnent cohérence à l'enchaînement de nos
images intérieures. Sinon les souvenirs s'accumuleraient
sous forme d'images enchevêtrées où un sens aurait bien
du mal à s'introduire. »254 Le drame du non-sens se
dessine alors comme une accumulation d'images qui
hantent le sujet dès l'instant où il lui est impossible
25/ Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, p.21
176
d'en faire le récit. Il paraît utopique de penser
inféoder l'informulable, l'indéfinissable au même que
1'imprévisible.
Dans la perspective ainsi tracée, le réflexe qui sied à
la dévastation que créent ces affres est la dénégation.
Cette dénégation correspond à un vide psychique et ce
vide a souventefois pour corrélat le clivage de la
personnalité. Le prix de cette démarche équipolle à un
ersatz de vie. Ces moments indéfinissables s'empreignent
dans la mémoire sensorielle sans engendrer de souvenirs
précis dans la mémoire à long terme. Il en résulte une
sensation d'agitation indéfinie. Selon le docteur
Cyrulnik : « le pire stress, c'est l'absence de stress,
car le manque de vie avant la mort provoque un sentiment
désespérant de vide avant le vide »255. Cette forte
tension ne peut être maîtrisée que par l'attribution
d'un sens. Lorsque le sujet ne peut départir une
signification à ses plaies, il est soumis à une tension
colossale. Plus précisément, dans les cas de clivages,
on observe que la section informulée ou informulable de
la personnalité va se jouer du sujet. Cela a une
conséquence majeure : il s'en suit une variation
sibylline de l'humeur qui fréquente généralement
l'agressivité. Les joies intenses tout comme les moments
terrifiants sont exposés à être reconduits en violence.
En l'occurrence, ces périodes de paroxysmes sont mères
d'angoisses.
255Ibidem, p.36
177
La notion de traumatisme est aussi l iée à celle de la
mort. Boris Cyrulnik précise :
« Pour pouvoir parler de traumatisme i l faut"avoir été mort", pour reprendre l'expressionemployée par des écrivains comme Primo Levi,Jorge Semprun [rescapés des campsd'extermination nazis] ou la chanteuse Barbara[victime d'inceste de la part de son père],ainsi que par beaucoup de personnes avec quij ' a i t ravai l lé . Alors que dans l'épreuve, onsouffre, on se bagarre, on déprime, on est encolère, mais on se sent bien vivant et on f ini tpar surmonter les choses. »256
II y a donc résurrection. Le traumatisé est celui qui a
eu gain de cause sur la mort. En l'occurrence, i l s 'agit
d'un triomphe abscons. I l semble que le sujet s'explique
mal cette victoire hasardeuse. I l doit donc faire face à
un sentiment paradoxal imprimé d'autant de f ierté que de
culpabili té. Selon le professeur Cyrulnik, deux
besoins inhérents sont rattachés à la notion de
culpabilité : a) le besoin d'expiation, h) le besoin de
légitimation. Ces besoins permettent en quelque sorte au
ressortissant de se naturaliser. Le sujet se livre un
procès i té ra t i f sur la légitimité de son existence. I l
s 'agit alors de neutraliser la culpabilité par l 'action
et la générosité. On observe, en l'occurrence, une
propension chez le traumatisé à s'éprouver lui-même. I l
convient de souligner que cette culpabilité devient un
moteur d'action. Sur le sujet traumatisé s'exerce ainsi
une double contrainte, celle de l 'action et celle de
6 Anne Rapin, Ministère des affaires étrangères, Label France, leMagazine, II ne faut jamais réduire une personne à son trauma,Entretiens avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik,http://www.diplomatie.gouv.fr/label_france/FRANCE/IDEES/cyrulnik/page.html, février 2004
178
l'expression. L'individu est à la fois gouverné par le
besoin de s'exprimer pour vassaliser les affres de sa
pensée, mais cette vassalisation n'est possible que s'il
est au service de la totalité.
Selon le docteur Cyrulnik, « Le fait d'avoir un compte à
régler, une contrainte intérieure à exprimer sa tragédie
pousse à la créativité... »257. La culture incapable
d'entendre le récit contraint le blessé à la
métamorphose. Le neuropsychiatre précise que :
« C'est au contraire la perte, le l'absence et ledeuil qui contraignent le blessé à remplir ce videpar des représentations, sous peine d'éprouverl'angoisse de la mort, du rien, du zéro et del'infini. C'est dans ce vertige du vide provoqué parla perte que le symbole crée une représentation quivient à la place de l'objet perdu. »258
Suivant cette visée, l'art s'inscrit comme un mode
d'expression qui permet d'effectuer une double opération
salvatrice. D'une part, il permet d'exprimer le drame en
le rendant recevable. D'autre part, l'art permet de se
distancer du drame. On remarque, en outre, que l'art
exalte certains mécanismes de protection, soit :
« l'intellectualisation, la rêverie, la rationalisation
et la sublimation »259. Il est donc permis de penser que
cette réalité ait exhorté le peintre à s'investir dans
son art avec impétuosité. Masson exprime clairement
l'importance de cette expérience dans son faire.
7.3.3 Un créateur tourmenté
257 Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, p. 175258 Ibidem, p. 175259 Ibidem, p. 178
179
Au vrai, nous ignorons les modalités de la souffrance
éprouvée par André Masson et il n'est pas de notre
ressort d'en juger. Ce qui est évident, c'est que le
peintre vécut, après cette épreuve, accablé par une
tension interne très vive. Il en témoigne à plusieurs
reprises dans ses écrits et ses correspondances. Dans
Mémoire du monde, il dit :
À vingt ans, il a suffi de quelques semainesd'expérience guerrière pour que je passe d'uneémotivité excessive et tendre - à unebrutale insensibilité. Le rétablissement,après le sang versé, pour trouver un équilibreinstable, fut long et difficile. Salut ? Maisil n'y eut jamais de sécurité. Rien quesurvivance - menacée.260
Puis, dans une lettre à Gertrude Stein, il confit : « La
peinture comme toujours ne me donne pas
d'inquiétudes mais des tourments. » Le terme
« tourment » réapparaît dans les lettres adressées
respectivement à Kahnweiler, en août 1924 et, à Marcel
Jouhandeau, en septembre de la même année. Masson
parlera aussi d'« agitation » dans une lettre adressée à
Michel Leiris en octobre 1925. Il précise :
Encore une fois, si je mets au-dessus de toutmon amour de la révolution ce n'est pas quej'aspire à un pouvoir temporel quelconque,et de même si je peins, si je continue àpeindre je sais bien que là aussi jen'arriverai jamais à devenir un homme demétier -• cette peinture sera toujours le fruitde mon agitation, de mon impossibilité à
260 André Masson, La mémoire du monde, p.8
180
réaliser quoi que ce soit. Je crois encore quema vie absolue ne peut être que dans lacontemplation- et justement c'est cetteprédestination toujours contrariée= puisqu'ilme faut agir, qui fait de moi un agité . Quecette agitation cesse et je ne serais plusrévolutionnaire- et je ne peindrais plus - '
Dans cet extrait, le peintre met en relief le degré
élevé de corrélation entre l'anxiété, le salut et l'art
au sein de son faire. Masson précise : « cette peinture
sera toujours le fruit de mon agitation, de mon
impossibilité à réaliser quoi que ce soit ». On voit
clairement que l'artiste n'aspire pas à une réalisation
physique quelconque mais à atteindre un état d'être.
Déjetant en cela une tradition ancienne, Masson ne
focalise pas sur la préservation de l'œuvre. L'œuvre
perd sa fonction de finalité pour se voir confinée au
rang de procédé. Ce procédé doit permettre une ascension
de l'homme. Mais cette ascension n'a pas, pour visée le
bonheur ou le merveilleux. En effet, le propos de cette
ascension est le salut de l'être. Il convient de
souligner qu'André Masson se distingue en cela de l'une
des visées du surréalisme. Il énonce clairement que
c'est cette souffrance qui fait de lui un peintre et,
conséquemment, un révolutionnaire. Les deux états sont,
chez lui, conjoints. Le désespoir provoque ainsi la
fusion qui engendre l'action. Parallèlement, la fusion
de ces états sous-entend aussi que Masson ne sera jamais
en mesure de se consacrer qu'à une seule de ces
activités, et de même, d'en mener une à terme. On
261André Masson, Les années surréalistes : correspondance 1916-1942,
p.102
182
devienne une mort affectueuse et passionnée,criant sa haine pour un monde qui fait peserjusque sur la mort sa patte d'employé, je nepouvais plus douter que le sort et le tumulteinfini de la vie humaine ne soient ouverts àceux qui ne pouvaient plus exister comme desyeux crevés mais comme des voyants emportés parun rêve bouleversant qui ne peut pas leurappartenir » .
Georges Bataille souligne le caractère soudain du
renversement de l'attitude de Masson. Le peintre bascule
ici dans un moment de passion triste. Il est impossible
de ne pas entendre la rage éprouvée face à une société
qui réifie l'homme et le réduit à bien peu de choses.
L'étranglement de Masson y est inéluctable.
Quant à Masson, il confit à propos d'un différent avec
Breton que :
Les égarements que je pratiquais lui étaientabsolument étrangers. Ces dévergondagescomplets où l'on finit roué de coups dans unecellule de poste de police, tout cela n'étaitpas dans son caractère. Alors que j'y accordaismoi-même une importance particulière : sortirde soi, aller vers la bacchanale, vivre deschoses dangereuses, se donner à l'ivresse etarriver aux portes de la mort, voilà ce qui m'atoujours fasciné264.
On voit ici clairement affirmé le caractère pugnace,
offensif et déterminé de Masson. Il reste à savoir
pourquoi Masson accordait « une importance
particulière » à ces « dévergondages complets ». Selon
3 Jean-Paul Clébert, Les Lettres Nouvelles, Georges Bataille et AndréMasson, Mai 1971, p.74264 André Masson, Vagabond du surréalisme, p.80
183
la perspective que l'on se donne, les réponses seront
appelées à varier. L'influence nietzschéenne et la
valeur attribuée à l'esprit dionysiaque paraissent
irrécusables. L'influence de Georges Bataille, lui-même
transgresseur affiché, pourrait être mise en cause. Dans
cette mêlée, il est possible d'envisager une réaction
partielle aux cendres de la guerre. Il semble en effet
plausible que l'empreinte de cette expérience
traumatisante ait contribué à exalter la tonalité
poignante d'un art qui, selon les dires de l'artiste,
« pénètre souvent dans le domaine du tragique »265. Et,
la visée d'une réaction post-traumatique paraît
s'accorder avec le « devoir peindre » de l'artiste. Il
est indéniable que la guerre constitue l'une des clefs
de voûte du faire de l'artiste. À partir de ce moment,
c'est un commerce frénétique qu'André Masson entretient
avec l'art. L'expérience guerrière s'inscrit comme le
point de conflagration sur lequel s'étaye une nouvelle
relation à l'œuvre.
André Masson, Vagabond du surréalisme,p.64
184
8. Le retour d'un éclopé sur le chemin de la création
8.1 L'époque des forêts
C'est vers 1922, que Masson fait la rencontre du
marchand d'art Daniel Henri Kahnweiler, par l'entremise
de Max Jacob et Elie Lascaux. Dûment lié à celui-ci,
Kahnweiler commence à s'intéresser à la production
artistique d'André Masson et lui offre un contrat. En
fait, c'est seulement à partir de ce moment qu'André
Masson pu se consacrer pleinement à son art. De plus, le
contact avec Kahnweiler offre à Masson la possibilité de
se familiariser avec la production cubiste. Ainsi, c'est
lors d'une visite à la résidence du marchand, à
Boulogne-sur-Seine, que Masson vit pour la première fois
une collection d'œuvres cubistes. Kahnweiler possédait,
en effet, dans sa collection privée, des œuvres de
Picasso, de Braque, de Léger et de Juan Gris. Masson
sera profondément marqué par les productions des membres
de ce mouvement. Il qualifia les peintres cubistes de
piliers de l'art moderne.
Cette perception est compréhensible car ce sont les
peintres cubistes qui ont libéré la peinture de
l'illusionnisme et de l'imitation pure de la nature. Ils
ont érigé un système de codification qui permettait à la
nature de ne plus être imitée mais symbolisée. Pour
parvenir à un tel résultat, ils ont utilisé des formes
géométriques planes reconnaissant ainsi la surface
réelle du tableau. Ce faisant, ces peintres ont dû
185
réorienter le rôle de la peinture vers celui d'une
écriture plastique. Cependant, le problème de la
préservation de la structure de l'œuvre survint assez
tôt. Confrontés à la fragilité de certaines productions
de leurs prédécesseurs et encouragés par l'influence de
Paul Cézanne, ils durent prendre le parti d'abolir
certaines techniques de productions plus éphémères. Cela
les amena inéluctablement, vers un choix de sujets plus
limité. Notons que cette ère permettait aux hommes ce
type de considérations artistiques ; c'est-à-dire
qu'elle donnait lieu à l'élaboration d'une forme d'art
exempte de préoccupations d'ordre politiques et
sociales.
Il importe de remarquer qu'André Masson nourrit, à cette
heure, sa peinture d'un air du temps post cubiste mais
avec une nuance qui annonce le surréalisme. Masson
fréquente ainsi le cubisme mais en bravant certains
principes de cette idéologie artistique. Il y a très
visiblement des sentiments qui s'enchâssent dans le
développement de ses oeuvres d'après-guerre. Masson
s'autorise de sa sensibilité pour introduire des
émotions dans sa production. Il réchauffe ainsi
l'aridité du cubisme. C'est sans doute ce qui amena
l'illustre artiste espagnol, Pablo Picasso, à déclarer
par-devant les tableaux du jeune peintre : « il est
drôle, ce garçon ; il emprunte nos formes, mais il y met
des sentiments auxquels nous n'aurions jamais pensé »266.
Toutefois, il convient de souligner que si Masson
André Masson, Le Vagabond du Surréalisme, p.21
186
intègre à ses peintures l'influence des peintres
cubistes, ses dessins, eux, en semblent exempts.
À cette époque, le peintre, qui fréquente régulièrement
les bois de Meudon, commence à peindre ses « Forêts ».
Il incorpore à ses premiers paysages une double
influence, celles de Derain et celle des peintres
cubistes. En l'occurrence, ces influences ne sont pas
contradictoires. Masson dissolve les antinomies
relatives à ces oracles pour n'en retenir que
l'essentialite. Il semble que l'artiste enfante une
synthèse remarquable. Pour l'essentiel, ces forêts se
posent comme la transcription exaltée de paysages
existants. Georges Limbour, précise dans son article
André Masson et la nature, que :
(...)dans l'histoire de la peinture de notresiècle, le XXe, il n'y a qu'un homme qui aitéprouvé pour la nature un amour ardent,enivré, jusqu'au délire et l'extase, qui sesoit livré à elle et qui l'ait interrogée avecinquiétude et angoisse, qui ait voulu forcerses secrets et révéler ses mystères, et laposséder tout entière. Je crois pouvoiraffirmer que l'amour de Masson pour lapeinture se confond avec celui de la nature,qu'ils ne forment qu'une même dévorantepassion qui ne le lâche jamais un instant267.
Il faut entendre que l'auteur conçoit un amour in
extenso à la nature. Pour lui : « la nature est aussi
forces secrètes, violences invisibles, les germinations,
267 Georges Limbour, Les Temps Modernes, n° 60, André Masson et lanature, p.939
187
les métamorphoses, les bons et les tristes présages, la
mort, le sang, les merveilles de la nuit et les mauvais
rêves268.» Masson cherche à embrasser cette nature qui,
de toute évidence attache son esprit. Il semble que,
pour l'artiste, la nature soit entendue comme une
pulsion, une volonté de domination, au sens vitaliste du
terme. La nature est appréhendée comme une puissance de
création. Elle postule l'unité des dichotomies. Certes,
il s'agit d'une force énigmatique. Dans ses paysages,
Masson cherche à dénoncer la quintessence d'une nature
qui ne cesse de se voiler tout en se dévoilant.
On constate qu'André Masson imprègne ses paysages d'une
lourde charge émotive. Le peintre incorpore à cette
transcription fiévreuse un aspect onirique. Ces éléments
de merveilleux, paraissent surgir tout droit du
subconscient de l'artiste. Il convient de remarquer que
le surgissement du merveilleux diapré l'œuvre d'un
accent exotique voire légendaire. Ces éclats de
pittoresque, à la fois inopinés et inusuels, ont pour
effet d'ébahir le spectateur. L'oeuvre dérange ainsi la
galerie par sa singularité.
L'artiste mentionne d'ailleurs à propos de ces forêts
que :
Ce n'était déjà plus de la peinture rétinienne- selon l'expression de Duchamp : il y avait unnouvel élément extra-pictural qui s'est affirmélorsque, dans ces forêts ou ces paysages qu'onappelait autrefois marines, sont apparus lestombeaux. Dans ces tableaux les tombeaux sont
268 idem.
188
sur le bord des routes : dans les forêts, lesastres prennent des aspects que Bretonqualifiait de « louches » et dont Jouhandeauécrivait qu'ils étaient comme des soleilsallant se coucher dans les tombeaux269.
Sous tous leurs aspects les « forêts » sont transportées
par un horizon lyrique. Il convient de prêter attention
à la façon dont André Masson élabore et traite son
objet. L'artiste pare les astres d'une enveloppe
apocalyptiques. Ils se présentent comme de fâcheux,
voire comme de funestes et de tristes auspices. On
remarque que le peintre utilise, comme solution
picturale, une imagerie très proche de celle que
développeront certains surréalistes. Ce faire a pour
objet de mettre en scène l'équivoque. La tension qui
apparaît dans ces tableaux ne relève pas de la quiddité
des éléments qui enfantent l'image. En effet, le mésaise
tire son origine de la rencontre d'éléments provenant
d'univers opposés et, à première vue, incompatibles. Il
est clair que ce mésaise est exalté par la tension
lyrique contenue dans l'œuvre. À cet égard, il importe
de souligner que Masson se situe clairement dans le
prolongement de Chirico et du comte de Lautréamont. On
voit donc en quoi cette technique concorde avec une
certaine idée que Breton se faisait de la poésie.
André Masson ajoute que:
C'est en 1923 qu'ils apparaissent pour lapremière fois dans les forêts. L'un de cestableaux, « La route de Picardie » dont lepremier titre était « L' Allée des tombes », et
André Masson, Le Vagabond du Surréalisme, p.74
189
qui appartient à Raymond Queneau, est trèscertainement, en partie, un souvenir du frontfrançais lorsque les tombes commençaient très àl'arrière de ce front, au long des grandesroutes. Ces tombes étaient partout, avant mêmeque l'on entre dans le royaume de la mortreprésenté d'abord par la ligne de tir, puispar les premières tranchées et, enfin, par lelieu même du combat. Dans cette œuvre,l'obsession des tombes est inconsciente etinvolontaire, de même que ces soleilsinquiétants sont autant de réminiscences,d'angoisses, de sensations issues de mesexpériences de guerre, lorsque, constamment,nous interrogions le ciel : en effet, lesfusées qui le traversaient étaient autantd'éléments indicateurs. Apollinaire a très biencompris que ce côté féerique était en mêmetemps annonciateur de désastre astre -désastre. On retrouve dans cette toile, non pasun appel au subconscient, mais des traces desubconscient, ce qui a été rejeté au fond etqui resurgit. En effet, je n'ai jamais cherchéà exploiter volontairement mes expériences deguerre. (...) A l'époque où je faisais lesforêts, lorsque les premiers tombeaux sontapparus, je ne pensais pas du tout qu'ilsétaient issus de mes souvenirs de guerre, alorsque, maintenant, l'appel au subconscientapparaît plus nettement dans mes naturesmortes. 210
Les astres bilieux resurgissent dans l'œuvre du peintre.
Durant trois années de guerre, ils avaient été oracles
de désastres au moment que la survie des hommes était
liée à la vigilance du ciel. Masson énonce clairement
qu'il s'agissait là d'un talent essentiel pour déjouer
la fortune au cœur de cette configuration absurde. À
l'égal des astres, les tombeaux transsudent le vouloir
d'André Masson pour nourrir l'œuvre. De toute évidence,
270 Ibidem, p. 75
190
André Masson n'ambitionnait pas exploiter ses
expériences guerrières. L'artiste est catégorique à ce
sujet. Ces images de tombes qui longeaient les routes à
perte de vue affleurent dans l'œuvre de Masson envers et
malgré lui. Dès lors, tout porte à croire que
l'empreinte affreuse laissée par la guerre se joue de la
volonté de l'artiste. Prenons acte que la notion
d'horreur et d'angoisse qui s'exprime dans l'œuvre de
d'André Masson embrasse l'idée de la nature. Elle
rejoint la notion d'une désintégration nécessaire à la
transformation, à la réintégration de valeurs
salvatrices. On remarque aussi, que cette relation à
l'inconscient est encore involontaire. Faisant état de
la situation, le peintre déclare en toute lettre qu'on
retrouve dans cette toile « non pas un appel au
subconscient mais bien des traces de subconscient ». Il
va de soi que la violence de cette guerre dévastatrice
est l'une des clefs de voûte de l'œuvre de Masson. Sans
marquer l'épreuve, celui-ci la porte à son paroxysme en
transformant son signe.
Ce souvenir renvoie à la bataille du Chemin des Dames.
André Masson effectue un lien causal entre la présence
des trajectoires dans son œuvre et ce moment où il fut
propulsé dans l'abîme. Abandonné, impuissant, immobile,
ressouvenons-nous qu'il avaient observé ces fusées
sillonnait le ciel. Elles se présentaient comme des
trajectoires déchirant la voûte céleste. De fait, il
importe de remarquer que ces trajectoires exhumées se
retrouvent partout dans ses œuvres. En l'occurrence, on
191
observe qu'elles sont symbolisées par des lignes
organiques enchevêtrées qui sillonnent la toile.
8.2 Le dessin automatique
C'est vers la fin de l'année 1923 et au début de l'année
1924 que le peintre introduit dans son œuvre les dessins
automatiques. Selon le dire de l'artiste, cette voie
devait lui permettre de se délier du cubisme dont
l'apathie rendait toute communication « absolument
impossible »271. En outre, ce faire concourt à le
disjoindre d'un certain érotisme galant propre au 18e
siècle. Somme toute, l'artiste y voit la potentialité de
dépasser 1'érotisme japonais du 19e siècle. André Masson
précise d'ailleurs à cet égard :
Je m'étais aperçu que cette forme de graphismepour des dessins automatiques créait desallusions erotiques évidentes et pouvaitéventuellement mener à une peinture erotique,c'est-à-dire une peinture dont 1'érotismeserait vraiment le ressort primordial. Il nes'agirait plus alors de 1'érotismetraditionnel, mais de 1'érotisme d'Éros, prisdans le sens freudien de « pulsion de vie ».2
Au certain, l'art d'André Masson est porté par une vaste
dénotation erotique. Devant faire face au frelatage du
terme « érotisme », Masson ose, en l'occurrence, parler
littéralement de « sexualité lyrique, ou mystique »
La sexualité est ici entendue comme une fonction
cardinale. Chez l'artiste, il est clair que nous devons
« compter avec elle tout en essayant de la dépasser ; ne
271Ibidem, p . 65272Ibidem, p . 7 9273Ibidem, p . 93
192
jamais l'exclure, mais savoir la projeter dans
l'univers »274. Suivant cette idée, il est hors de doute
que le peintre y voit un champ de force où se
conjoignent « toutes les forces possibles de l'homme et
de la femme »275. Il convient de remarquer que l'intérêt
pour l'Éros freudien appartient au registre des
préoccupations surréalistes. À cette heure, Masson
rappelle que dans le Manifeste du surréalisme: « Breton
parlait de « l'arme à longue portée de l'instinct
sexuel »27 et il ajoute que, conformément à sa vision,
« s'il y a qualité esthétique, rien n'est malsain ni
obscène »277.
Ainsi, c'est à corps perdu qu'il se lance dans
l'expérience, excité par l'insatiable désir d'aller
toujours plus loin. Ces dessins, où les écheveaux de
branches deviennent des écheveaux de corps, conservent
un rythme similaire à celui des « forêts ». On y
retrouve un acquiescement vers un subconscient qui
semble vouloir s'affirmer de façon beaucoup plus
marquée. Le contenu devient, dès lors, plus symbolique.
C'est par cette voie que se déploient d'abord les traces
de l'inconscient du peintre au sein de son œuvre. Le
tableau intitulé « Les Quatre points cardinaux » et dont
le Musée National d'Art Moderne de Paris s'est fait
acquéreur, en est un bon exemple. Dans cette œuvre, les
points cardinaux sont présentés comme des embouquements
une variété élevée de paysages tant marins que
2 7 4 Ibidem, p . 94275 Ibidem, p. 94276 Ibidem, p. 97277 Idem.
193
terrestres. On note la très forte présence de mains
tendues vers le ciel. Celles-ci émergent de partout pour
faire des signes hiéroglyphiques. Au premier plan, on
voit naître une tête. André Masson la présente à
l'instar de succomber sous le poids d'une feuille
glissant doucement d'un arbre. Masson précise à ce sujet
que : « Le simple fait que je ne rejette pas ces images
est déjà, en soi, irrationnel »278.
De plus, le travail d'exploitation de la lumière,
effectué par André Masson, joue aussi un rôle important
dans les œuvres de 1922 à 1924. On le remarque
particulièrement dans des tableau comme, par exemple :
l'Homme à 1' orange, Les Points Cardinaux, Le cimetière,
l'Homme dans un intérieur, l'Homme tenant une corde et
Les Quatre éléments... Le travail d'exploitation de la
lumière diapré la valeur du contenu symbolique par la
voie de l'irisation. Il permet de créer des effets de
transparence dans l'utilisation de la couleur. Ainsi,
les jeux de lumière et de transparence fonctionnent
comme un miroir qui illumine la couleur. Cette
transparence vient dramatiser la portée énigmatique de
l'œuvre. De là tout un mouvement où les personnages, les
éléments ou les objets sont entraîné par un désir de
transfiguration. L'éclairage, le travail des couleurs
terre c'est-à-dire, les bruns, les beiges, les ocres, et
la prédominance des tons de blancs créent une forte
impression d'immatérialité. L'ambiance générale du
tableau devient ainsi vaporeuse et une présence semble
27 0 Ibidem, p.7 7
194
vouloir en émerger. Il importe de souligner que Masson
abandonne les facettes cristallines coutumes aux oeuvres
de Braque. René Passeron fait ressortir, dans son
ouvrage intitulé André Masson, que la transparence chez
Masson est ce qu'il appelle un « dévoilement voilé ». Il
précise ainsi, qu'elle cache ce qu'elle montre tout
comme parfois, elle le déforme ou l'irise279. Il importe
donc de remarquer que c'est par la voie de
l'exploitation de l'effet de transparence qu'André
Masson témoigne de la fragile frontière entre les mondes
visibles et invisibles.
Le tableau intitulé « Les Quatre Éléments » comporte
aussi un contenu symbolique très riche. Il s'agit d'une
œuvre qu'André Breton avait acquise lors de la première
exposition du peintre à la galerie Simon, de Daniel
Henri Kahnweiler, rue Astorg. Cette toile était destinée
aux locaux de la rue Fontaine. Ce tableau tranche
drastiquement avec ceux de cette époque et son acquéreur
le considérait comme précurseur du surréalisme. On
remarque ici, que les corps célestes et les corps
physiques sont abordés de façon analogue, de même que
les quatre éléments d'ailleurs. En ce sens, l'artiste
semble déférer à un désir d'adéquation. En outre, il y a
une fusion qui s'opère entre eux. Le corps de la femme
affleure du dessin d'une moulure. Il embrasse la flamme
pour se conjoindre dans un processus continu. Il
s'émancipe, se présente aux portes de la mort pour
renaître à nouveau. Au certain, l'artiste déconfit
l'évidence. On assiste à une anamorphose eurythmique.
279 René Passeron, André Masson, p.50
195
C'est par la voie du mouvement que la métamorphose
s'opère. Le rythme déforme ce que nous voyons. Il
convient de remarquer que cet instinct rythmique est
propre à Masson. De tout évidence, il faut suivre les
courbes. En l'occurrence, elles guident ainsi dans une
certaine direction notre perception de l'œuvre. Il
semble que les courbes soient les clefs de voûtes
révélant le faire permettant de s'enfoncer dans le rêve.
Ce tableau marque une transition dans le cheminement de
l'artiste. D'ailleurs, il convient de remarquer que
l'intérêt d'André Breton pour ce tableau est peu
surprenant. Il tient au fait que le peintre procède sur
deux plans. D'un côté, il intègre dans ses œuvres un
contenu onirique, et, de l'autre, il a très visiblement
de la part d'André Masson la préoccupation d'y
réintégrer sa pensée. Il est hors de doute que ce
tableau rejoignait ainsi très intimement l'esprit
surréaliste. En fait, c'est ce sentiment de proximité
qui meut André Breton à prendre langue avec le peintre.
Il fit parvenir un exemplaire dédicacé de « Clair de
terre » pour préluder à sa venue. Ce présage avait pour
objet de permettre au peintre de se familiariser avec
son œuvre.
La première rencontre avec Breton eu lieu en octobre
1924. Celui-ci se présenta à l'atelier du peintre.
Masson était alors installé dans un bâtiment situé au
fond d'une cour de la rue Blomet. Il avait pour voisin
le peintre Joan Miro. Autour d'eux, les poètes
196
proliféraient. On y retrouvait Georges Limbour, Michel
Leiris, Roland Tuai, Robert Desnos, Armand Salacrou et
Antonin Artaud. Il importe de souligner que la quasi
totalité des membres du « groupe de la rue Blomet » se
sont impliqués dans le mouvement surréaliste.
Le jeune peintre, lecteur de la revue « Littérature »,
voyait en André Breton un nouvel horizon. Pour André
Masson, André Breton se situait dans le prolongement de
Rimbaud et Mallarmé. D'emblée, un degré élevé de
complicité se révéla entre les deux hommes. Il est vrai
que leurs vaticinations sur l'art se conjoignaient. Le
point de litige eut pour ressort la haute opinion
d'André Masson à l'égard de Dostoïevski et Nietzsche.
Une autre dissonance tient au fait qu'André Breton
n'était pas homme à puiser dans le passé. Les
réalisations artistiques des siècles précédents le 19e
siècle, tant au niveau philosophique qu'artistique, ne
l'intéressaient que sommairement. André Masson percevait
les choses différemment. Sa fascination pour l'art
plonge ses racines dans l'enfance. Elle s'est édifiée
aux abords de peintres tels que Rubens, Jordens,
Brueghel, David, Delacroix, Ensor, Rops. De là, elle
s'est articulée autour des impressionnistes, Puvis de
Chavannes, Seurat, Uccello, Redon, Gustav Moreau, pour
n'en nommer que quelques uns.
Or, il est très remarquable de constater que, pour André
Masson, ces multiples connaissances ne constituaient pas
des fers. En effet, l'artiste entendait ce savoir comme
un gisement dans lequel il n'hésitait pas à puiser au
besoin. Il percevait les moyens élaborés par ses aînés
197
comme des étincelles exaltant 1'elucidation de problèmes
plastiques.
En un sens, Masson comptait que rendre opaque l'héritage
du passé équipollait à s'inventer une fable. À l'image
de Lautréamont, il percevait l'art comme issu de tous
les artistes. Sans compter que, selon son regard, la
façon dont le contact se crée avec ce médium influence
inévitablement notre perception. André Masson
considérait que l'on peut très bien admirer sans être
influencé et que l'inverse est aussi possible.
D'ailleurs, à ce sujet, l'auteur se réfère à cette
anecdote avec Picasso qui traduit bien sa pensée, il
raconte :
Lors d'une rencontre avec Picasso, Masson luidemanda si c'était vrai qu'il faisait chaquematin le tour des galeries, gardant l'après-midi et la nuit pour son travail ? » Picassolui avait simplement répondu : « Oui, je faisle tour des galeries. Je trouve toujoursquelque chose à apprendre chez les autres,même quand c'est mauvais. Il faudrait pouvoirreconstituer sa voix à ce moment-là, afin demontrer tout ce que sa merveilleuseintelligence sous-entendait par là.280
André Masson ne rejette donc aucune influence consciente
ou inconsciente. Masson avait aimé Delacroix pour
l'émotion qui émane de ses œuvres, Botticelli pour sa
ligne mouvante, Rubens pour ses couleurs éclatantes.
Autant d'éléments qui s'affirmeront dans son faire.
André Masson, Vagabond du surréalisme, p. 25
198
Dès lors, on réalise qu'au départ, l'acquiescement au
subconscient est chez l'artiste involontaire. La
rencontre avec André Breton et les amitiés acquises avec
Michel Leiris, Robert Desnos, Antonin Artaud et Raymond
Queneau concouraient à inscrire l'artiste dans la foulée
du mouvement surréaliste. Au certain, la définition que
formule Breton au sein du manifeste surréaliste exaltera
la quête déjà entamée du peintre. Ainsi dans son
travail, cette adhésion conjoint avec le développement
de l'automatisme. En l'occurrence, il est fort difficile
de dater avec précision l'aube de cette démarche,
d'autant que Masson demeura lui-même nébuleux à ce
sujet. Quoi qu'il en soit, il semble que les dessins
automatiques offrent à l'artiste la liberté de mettre en
lumière ses fantasmes inconscients, ceux-ci lui
serviront d'ailleurs de fil conducteur.
André Masson utilise donc d'abord une imagerie
symbolique pour intégrer sa pensée au sein de ses
œuvres. On pourrait pour mieux saisir la spécificité du
faire de l'artiste effectuer un bref parallèle avec
celui du peintre italien Giorgio de Chirico. Il semble
évident que nous rencontrons dans les œuvres pré-
surréalistes d'André Masson, la présence d'éléments
incongrus, irrationnels. Or, nous savons qu'il s'agit là
du fief de Giorgio de Chirico. En effet, le peintre
italien s'est distingué par la mise en scène de
populations fantastiques dans son faire. L'une des
particularités de ses œuvres se traduit par la froide
stupeur qui transsude ces populations. Cette impression
est exaltée par l'univers occulte érigé par l'artiste où
199
même le temps semble retenir son souffle. André Masson,
pour sa part, entend les choses autrement. Il introduit
dans ses toiles la présence de mouvement. La fixité y
est brisée par une des lignes qui crée une certaine
dynamique. Cette particularité lyrique pare l'oeuvre de
vitalité pour enfanter une peinture qui semble vouloir
s'éprendre d'elle-même. Certains surréalistes comme Max
Ernst ou Dali, par exemple, utiliseront des moyens
académiques afin de rendre la lecture de leurs œuvres
plus limpide. En préconisant de telles pratiques, ils se
distancient des préoccupations typiquement plastiques
pour se déplacer vers des problèmes relevant du registre
de la communication. Masson se distingue ardemment de
ceux-ci. Il ouvre son champ de production, y introduit
ses angoisses et ses questionnements. Il importe de
remarquer qu'André Masson utilise les moyens développés
par ses prédécesseurs afin de les soulever vers de
nouvelles visées. Or, Masson ne néglige en aucun cas la
recherche de solution plastique au profit d'une lecture
lumineuse de son œuvre. Daniel Henri Kahnweiler fait
d'ailleurs remarquer :
Certains buts du Surréalisme en peinture, queMasson avait d'ailleurs atteints avant sonadhésion, comme par exemple ce que l'on aappelé plus tard « la réunion d'objetshétéroclites » n'est nullement assemblagesaugrenu d'objets destinés à « bouleverser »(« la colombe dans le derrière du chef degare », comme le disait Picasso) mais bienrencontre poétique émouvante.281
281 Musée de Lyon, André Masson
200
Ainsi, Masson cherche à donner à son art une portée
infiniment plus vaste que le simple choc de la surprise.
Au-delà de l'étonnement, il y a l'émotion. Il faut
entendre cette émotion comme éprouvée. Il est loisible
de croire qu'elle est le miroitement des affres qui
poignaient l'artiste. Il s'agit d'un torrent, un raz-de-
marée qui s'impose par sa force prédominante et qui
emporte tout sur son passage. Elle se déchaîne extirpant
sa force de la ligne qui l'emporte avec elle. Elle se
renouvelle, incessamment pour s'afficher inéluctable et
désinvolte.
8 . 3 Le faire automatique
II est hors de doute que l'une des plus grandes
particularités d'André Masson sera l'enfantement d'une
méthode de production d'œuvre surréaliste. André Masson
outrepasse la simple dilatation de la recherche
afférente à l'élaboration d'une imagerie surréaliste. Au
certain, l'originalité de l'artiste tient à la mise au
point d'une méthode d'exploration directe de
l'inconscient. André Masson se donne pour tâche d'user
de la transcription simultanée comme outil afin de
déjouer l'emprise de la raison. Il est clair que cette
visée se présente comme le postulat sur lequel s'appuie
le façonnement de l'automatisme dessiné et pictural.
On voit donc en quoi le dessin automatique s'inscrit
dans le prolongement de l'écriture automatique. Celui-ci
est lié à la rapidité d'exécution. On comprend que le
201
dessin automatique doit s'effectuer sans aucun programme
conscient de représentation. Cette absence d'à priori
représente en soi la condition de possibilité sur
laquelle s'érige la substantification de l'œuvre.
Il convient de remarquer que ce faire s'applique assez
naturellement au dessin, sitôt qu'il est possible
d'admettre que le dessin sans objet préconçu peut
encore, dans une perspective artistique, détenir le
statut de dessin. Nonobstant, il importe de souligner
que la peinture est un médium qui semble lui résister.
En effet, la capricieuse préparation nécessaire à la
réalisation de la peinture à l'huile bride
considérablement le procédé automatiste. Ressouvenons-
nous que, d'emblée, ce faire est tenu de se poursuivre
avec une vélocité déterminée afin de parvenir à déjouer
l'intervention de la raison.
Ipso facto, la célérité devient une condition sine qua
non à la réalisation d'une œuvre automatique. Au vrai,
sans elle, il est impossible de délivrer le geste en
sorte que la main s'autonomise et autorise la survenue
de l'image. Il est clair que la main doit agir
librement. En l'occurrence, elle entreprend de coucher
frénétiquement un faisceau de linéaments sur le papier.
Cette course folle conduit à l'émergence de l'image. Il
convient de souligner que le dessin ne doit être
complété qu'après l'apparition de l'image sans quoi, on
est confronté à un amas de gribouillis dépourvu de
fondement et de sens apparent ou sous-jacent.
202
On remarque qu'il demeure dans les premiers dessins de
ce type une portion de lignes abstraites de laquelle
semble s'exhaler un élément reconnaissable. Or, ce
contingent de gribouillis subsistant contribue à exalter
la force de l'œuvre. La figure affranchie de la sorte
peut naître à n'importe quel endroit sur la feuille. En
outre, il est possible qu'elle s'éploie hors du cadre. À
cet égard, André Masson précise d'ailleurs :
Je pouvais faire le dessin ici, je pouvais lefaire là ; il s'arrête à un moment donné caril aurait continué sur la table. Je n'aid'ailleurs presque jamais donné de cadre à mesdessins. Il m'est arrivé d'ajouter plusieurspapiers les uns aux autres, mais j'ai trouvécela un peu superficiel, car il fallait collerles papiers, donc le geste était arrêté. Lesdessins faits sur les feuilles de papierajoutées étaient moins subconscients que surla première feuille. Il y avait euinterruption dans le mouvement. Aussi n'ai-jepas persévéré.282
Le support fait office d' « arène » où l'action se
déroule en l'absence de tout contrôle. Certes, le terme
arène, mise en scène pour la première fois à cet effet
par Harold Rosenberg, paraît tout indiqué. Pour Masson,
il s'agit de la locution la plus signifiante employé à
cet égard. Le peintre précise : « Je trouve ce mot très
juste. Le papier blanc, pour moi, est une arène, un lieu
où tout peut m'arriver, mais une arène sans
limites. »28 ' Nous savons qu'une arène est un espace
public ou se déroulent des combats. On remarque que ce
terme éloquent contient à lui seul le triangle
282 Ibidem, p. 84283 Idem.
203
« aventure, risque / danger et exposition ». Il est
possible de se demander quel empire exerce ces notions
dans le faire de l'artiste. Le haut degré d'exposition
semble relever de l'évidence puisque l'artiste est piégé
entre le soi et l'autre. D'une part, l'artiste s'expose
à l'autre qui perçoit le dessin et d'autre part,
l'artiste s'expose à ses fantasmes inconscients. En
élargissant le propos, il serait sans doute fascinant de
poser la question relative à l'entendement du risque
voire du danger pour l'artiste. En outre, soulignons que
la liaison unissant les termes arène et combat,
considérant qu'un combat se présente comme une lutte
contre l'adversité, exalte la question.
Il est à noter que si le dessin est effectué en marge de
toutes préoccupations esthétiques, il possède tout de
même une structure et se développe de façon très
articulé. Masson précise :
II existe un dessin maintenant au Muséed'Art Moderne de New York - « La Naissance desOiseaux » - qui a été exécuté très rapidementen laissant aller ma main, mais le titre nem'a été dicté par aucune réflexion. Un autre -également au Musée d'Art Moderne de New Yorkreprésente des torses d'hommes décapités dansdes sortes de cages, flottant dans l'espace etrayonnants comme des soleils. Dans ce dessin,il est évident qu'il n'y avait aucune idéepremière : comment concevoir une tellechose ?284
284 Ibidem, p. 81
204
L'aboutissant du dessin automatique est confondant. Or,
si Masson s'arme contre l'action consciente lors de la
production de l'œuvre automatique, il laisse son esprit
poétique intervenir pour la couronner d'un titre. Pour
l'essentiel, le titre semble jouer le rôle de balise. Il
guide ainsi dans une certaine direction notre perception
de l'œuvre à l'égard de ce que la construction de
l'image a inspiré à l'auteur. De fait, il exprime ce que
l'artiste en comprend.
8.3.1 L'automatisme, une dictée inconsciente ?
La quintessence de l'automatisme surréaliste relève du
renoncement à la censure consciente. En l'occurrence,
lorsque l'on dépeint le processus automatique, on est
souventefois appelé à s'exprimer en terme de dictée
inconsciente. Cependant, il est possible de se demander
s'il s'agit bien là d'un terme idoine. En fait, il
semble que cette expression demande quelques nuances. Le
peintre André Masson précise qu'à ses yeux, lorsqu'on va
très vite, le dessin est médiumnique, c'est-à-dire comme
dicté par l'inconscient.285 À ce dessein, on peut
soutenir l'idée d'une dictée, dès lors que les lignes ne
sont plus cherchées mais données par le subconscient.
Consequemment, le dessinateur inscrit sur la feuille de
papier ces lignes comme si elles lui étaient insufflées
par une voix extrinsèque. Il convient de constater que,
dans l'automatisme pictural tout comme dans
l'automatisme écrit, il y a la présence d'une structure.
L'analyse des Champs magnétiques, a clairement démontré
285 Idem.
205
que la phrase était donnée dans une syntaxe adéquate. De
même, dans l'automatisme pictural ou dessiné, l'image se
présente dans une forme articulée. En cela, la poésie,
la peinture et le dessin ont en commun qu'ils se
présentent comme des véhicules permettant la conduite du
message inconscient.
Suivant cette visée, il est intéressant de comparer le
phénomène à celui du médiumnisme tout particulièrement,
au cas de ces voyantes qui lisent dans les boules de
cristal. En l'occurrence, il semble que les images
affleurent au médium subséquemment à une immersion dans
l'état de passivité intellectuelle permettant une
réceptivité ad hoc. Ces visions, dont le propos est de
prophétiser l'avenir ou de relater le passé, ont pour
ressort l'intercession d'esprit extérieur. Le corps du
médium devient corollairement le réceptacle d'esprit
étranger. Dès lors, une distinction fondamentale
s'impose : dans le cas de l'automatisme surréaliste, il
n'y a pas d'intervention exogène. Le faire automatique
plonge ses racines dans les profondeurs inconscientes.
On comprend qu'il n'y a pas de génie flottant autour de
l'artiste mais l'émanation d'une force intérieure,
inconnue mais réelle. C'est donc le moi subconscient qui
dicte son message au moi conscient.
En outre, à l'instar du faire relatif à l'écriture
automatique, tel qu'élaboré par Breton, on cherche ici à
s'enfoncer aussi profondément que possible dans le
registre de l'inconscient. Masson précise à ce sujet :
206
J'imagine l'espace intérieur comme étant diviséen différentes couches : la couche la plusproche de la conscience est celle oùapparaissent les images qui sont déjà desimages que l'on peut noter et développer - jel'ai fait - et la couche la plus profonde estcelle de l'inconscient total : j'ignore alorsce qui va se produire. 286
On voit donc clairement qu'il s'agit ici de puiser la
dictée inconsciente la plus éloignée possible. Le but
tient à l'exploration des mécanismes afin d'entendre le
message subconscient. En l'occurrence, il va de soi que
ce faire est un processus d'exploration de soi qui
consiste en une remise en communication de l'être avec
lui-même.
8.3.2 Mise en regard avec le phénomène élémentaire
Nous savons que la mise en veilleuse de la raison
constitue la substantifique moelle du processus
automatique. Elle est gouvernée par la notion de
rapidité qui lui est conjointe. Son objet est
d'autoriser la transcription simultanée sur la feuille
de papier. Selon les dires de ses chantres, on remarque
que cette recherche de 1' « état limite » provoque, chez
le sujet, une sensation voisine de la transe hypnotique.
Ressouvenons-nous qu'elle fut aussi ressentie lors de la
première expérience d'écriture automatique effectuée par
André Breton et Philippe Soupault en 1919. Il importe de
286 Ibidem, p. 81
207
souligner que cet état, essentiel à la réalisation de
l'automatisme se rapproche dangereusement du phénomène
observé chez les psychotiques nommé en psychanalyse le
phénomène élémentaire. Comme le dit Pierre Vermeersch,
en 1992, dans son texte intitulé Le retour à la Ligne,
Du dessin automatique d'André Masson :
Pour un sujet, le retour du refoulé a lieu dansle registre du symbolique. Ce qui est rejeté dusymbolique, forclos, fait retour dans leregistre du réel. La manifestation la plusconnue de ce retour est l'hallucination. Laforclusion de l'un des signifiants constitutifsde la batterie initiale de l'inconscient, lesignifiant du Nom-du-Père, est l'unique causede la structure psychotique. Le terme dephénomène élémentaire s'applique aux retoursdans le réel afférant à cette structure287.
Ce phénomène qui permet de sortir de soi n'est
d'ailleurs pas sans stimuler certaines inquiétudes chez
les surréalistes qui l'ont pratiqué ; la crainte de
sombrer définitivement dans la folie n'étant pas exclue.
Or, la folie n'est pas un mal contagieux. L'esprit
semble selon cette théorie fonctionner de telle manière
que lorsqu'une image ou un symbole lui apparaît, il est
acheminé vers l'inconscient auquel il est confronté. Non
reconnu par celui-ci, il rebondit et retourne dans le
registre du réel. Ne pouvant pas subsister sans alliance
et, devant faire face à l'absence de signifié, il
produit fatalement une association erronée. Il semble
conséquemment que l'hallucination tire sa source de
cette conjonction malséante. Les psychanalystes ont
287Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlyse dans1'expérience surréaliste, p.94
208
remarqué que cette association inexacte engendre chez le
sujet une incapacité à distinguer le rêve de la réalité.
De toute évidence, pour eux, l'enfantement de
l'hallucination tient au fait que le sujet ne possède
plus de registre lui permettant d'effectuer un t r i
raisonnable. Dès lors, i l apparaît que le flou c'est-à-
dire l'absence de réfèrent, constitue l 'état le plus
insupportable des choses.
Dans le prolongement de cette idée, Georges Bataille a
très justement remarqué à ce propos que : « la réflexion
claire a toujours le possible pour objet. L'impossible,
au contraire, est un désordre, une aberration. C'est un
désordre qu'amènent seuls le désespoir et la passion... Un
désordre excessif auquel seule la folie condamne! »28 II
convient de souligner que Georges Bataille s'est
intéressé de très près à la recherche de l 'état limite,
le chaos, la folie et la quête dionysiaque. Selon les
dires du peintre André Masson, i l semble possible de
prétendre que, de tous les êtres qui ont gravité autour
du groupe des surréalistes, Georges Bataille fut le seul
authentique disciple du Marquis de Sade. Son faire
s'articule autour d'un érotisme provocant voire
choquant.
Michel Leiris et André Masson ont fait la connaissance
de Georges Bataille en 1924. Ce fut l'heure qui marqua
la naissance d'une confraternité profonde et durable.
288Emmanuel Tibloux , Georges Bataille, Association pour la diffusion dela pensée française. Ministère des affaires étrangères,http://www.adpf.asso.fr/adpf-publi/folio/textes/bataille.rtf, septembre2004
209
Certes, c'est en la compagnie de Georges Bataille que
Masson rencontra une repartie à l'exécration qu'il
éprouva face à l'oppression sociale. Or, suivant le
propos d'enfanter une pensée globale et totalisante
c'est-à-dire où rien ne serait laissé pour compte,
Georges Bataille a attaché son esprit à appréhender les
états limites et leurs impacts. Dans l'Expérience
intérieure, i l explique :
Ces moments d'intense communication que nousavons avec ce qui nous entoure- qu'il s'agissed'une rangée d'arbres, d'une salle ensoleillée-sont en eux-mêmes insaisissables. Nous n'enjouissons que dans la mesure où nouscommuniquons, où nous sommes perdus, si notreattention se concentre, nous cessons pourautant de communiquer. Nous cherchons àcomprendre, à capter le plaisir : i l nouséchappe. 2 8 9
Ainsi, comme le souligne Bataille, l'égarement devient
un élément fondamental de la recherche dithyrambique. Il
faut s'abandonner à l'expérience, lâcher prise pour
enfanter l'émotion. L'ouverture et la disponibilité sont
directement associées à l ' intensité de la révélation.
Sans quoi, la rencontre ne dépasse pas la superficie.
Conséquemment, i l devient impossible d'atteindre les
profondeurs inconscientes. L'expérimentateur doit donc
faire preuve de sincérité et d'audace pour se laisser
glisser vers les contrées inexplorées qui subsistent au-
delà de la frontière consciente.
89Emmanuel Tibloux , Georges Bataille, Association pour la diffusion dela pensée française, Ministère des affaires étrangères,http://www.adpf.asso.fr/adpf-publi/folio/textes/bataille.rtf, septembre2004
210
André Breton, en proie à de violentes périodes
d'insomnie fit état de l'empire de ces états limites
dans la création artistique. C'est d'ailleurs l'une de
ces expériences qui le poussa à se pencher sur le
questionnement générant sa théorie de l'écriture
automatique.
En outre, le phénomène élémentaire rencontre l'opération
automatique en ce lieu. En effet, dans le faire
automatique tout s'amorce par le gribouillis, geste pur,
où rien n'est reconnaissable. L'image surgit du chaos.
Elle emprunte alors l'enveloppe de la forme académique
afin de se rendre lisible mais demeure amputée à la
conscience. Cette amputation tient au fait qu'elle est
totalement irrationnelle (exemple : un cochon volant, un
arbre à main etc.).En l'occurence, le surgissement de
l'image, reconnaissable pour la raison dans l'usage de
ses signes, est, sommes toute, irrationnelle dans son
signifié. On remarque donc que l'image se présente
pareillement à une intention extérieure à la conscience.
Masson précise à ce sujet : « La fusion des éléments
hétérogènes mis en jeu par le peintre-poète s'accomplira
avec la rapidité fulgurante de la lumière. L'inconscient
et le conscient, l'intuition et l'entendement devront
opérer leur transmutation dans la sur-conscience, dans
la rayonnante unité. »29 ' On conçoit donc que cette image
est en attente de réminiscence, d'une réconciliation
avec la raison. En outre, comme cette réconciliation ne
.'"Kl Jean-Clarence Lambert, André Masson, p.50
211
s'opère ni dans l'inconscient ni dans le raisonnable,
cette réminiscence ou réconciliation ne sera possible
que dans la surréalité. C'est en ce lieu que le signifié
et le signifiant seront noué pour former un symbole. Il
s'agit, pour l'heure, de l'état d'union simultané du
signifiant et du signifié autorisant une plénitude dans
la symbiose.
Au vrai, Masson cherche désespérément depuis l'époque de
la grande guerre une paix intérieure. Il semble que
cette paix ne soit atteignable que dans la surréalité où
la symbiose des signifiés et des signifiants paraît
concevable. Il répute que la résolution des signifiés et
des signifiants fera cesser son agitation intérieure.
Cette visée a pour corrélat la métamorphose de la
fonction de l'art. En effet, l'art pour lui est spolié
de titre de finalité pour être reclassé au rang d'outil.
Cette inversion a une conséquence majeure, elle exclut
toutes préoccupations esthétiques. De toute évidence,
Masson ne cherche pas à agrémenter ses murs mais à
sauver son âme déjà fort blessée. En fait, pour
Masson, : « la seule justification d'une œuvre d'art est
de contribuer à l'élargissement de l'homme, à la
transmutation de toutes les valeurs, à la dénonciation
de l'hypocrisie sociale et religieuse »291. On voit donc
que le renversement de la visée de l'art n'a rien de
superfétatoire, elle met en place un nouveau concept de
l'art pensé comme une maïeutique permettant l'éclosion
de l'être. Il est clair que, pour André Masson, l'art
Ibidem, p.4
212
est un moyen permettant la transformation sociale. Il
amène la révolution des mœurs d'une société sanglante.
Dans ses correspondances avec Michel Leiris, en octobre
1925, Masson précise clairement qu'il n'aspire pas à une
réalisation physique quelconque mais à atteindre un état
d'être, un absolu. Un déplacement s'opère, il ne s'agit
plus de préserver une œuvre. Là est sans doute la raison
pour laquelle ses tableaux sont en perpétuelle
évolution ; ils sont vivants. Or, les vivants se
transforment inévitablement. L'objectif ici n'est pas de
réaliser quelque chose de physique mais d'atteindre un
état d'être, un absolu. Masson exprime clairement que le
seul moyen de vaincre son malaise physique et psychique
est d'accéder à cet état de symbiose. Il doit agir et il
est confronté à une traverse itérative relevant de la
nature de sa quête. Attendu que, cette finalité n'est
possible que dans la surréalité.
8.3.3 L'automatisme et le rêve
La dialectique de l'automatisme surréaliste est souvent
comparée au phénomène du songe au niveau de l'esprit.
Cependant, cette comparaison demande d'être étudiée. Le
rêve est un phénomène, encore aujourd'hui, énigmatique...
Le sujet est complexe et vaste. Cette évidence affirmée,
c'est avec prudence que nous nous y aventurons. Certes,
il s'agit ici de nous concentrer sur les quelques
éléments qui servent notre propos. Tout porte à croire
qu'il subsiste plusieurs cycles au sommeil, mais ceux-ci
sont contenus dans deux variétés principales soit : le
213
sommeil lent ou profond, et le rêve, ou sommeil
paradoxal. Un cycle complet dure environ quatre-vingt-
dix minutes. Au cours de cette période, nous passons dix
minutes à rêver. La période de rêve s'accentue
progressivement à chaque cycle. Lors du dernier cycle la
période de sommeil paradoxal atteindra près de cinquante
minutes. En l'occurrence, la période paradoxale
représente une période où l'activité cérébrale est très
intense. Les yeux oscillent rapidement et brusquement.
Le rythme cardiaque s'accélère et la tension artérielle
devient irrégulière. À ce moment très précis, il semble
que le cerveau abandonne temporairement ses fonctions
motrices. Il sécrète de la sérotonine, un inhibiteur
naturel, qui intervient afin de limiter le relais de
l'influx nerveux. Il se concentre alors sur des
fonctions purement intellectuelles. Il s'agit du moment
de la journée où le cerveau fonctionne le plus
activement. De fait, on conçoit que la temporalité du
rêve se présente comme une activité cérébrale intense et
continuelle dans une période déterminée. À ce dessein,
il est possible d'établir un certain rapprochement entre
la temporalité de l'écriture automatique et celle du
songe. Dans les deux cas, le processus est lié à la
durée de l'expérience. André Breton explique clairement
que, lors de la pratique de l'automatisme écrit, les
phrases se présentaient en suite continuelle jusqu'à la
levée de la séance. Les auteurs pouvaient dès lors
noircir du papier huit à dix heures durant. La fin des
chapitres des Champs magnétiques étaient reliées à la
fin du temps alloué, chaque jour, à l'expérience. Par
contre, la temporalité de l'automatisme, tel que
214
pratiqué par André Masson, se présente différemment. Les
étapes identifiées sont les suivantes :
1. la période réservée à l'inscription c'est-à-dire le
geste pur.
2. le surgissement ombrageux de l'image
3. la poursuite de l'image qui guide le dessinateur vers
ce que Masson nomme « cet académisme surréaliste » et
décrit comme « l'illustration laborieuse qui ne relève
plus de l'état de grâce »292
II importe de remarquer que l'action s'arrête avec la
notation de l'image. C'est elle qui met un point final à
l'expérience. Cette distinction permet de mettre en
lumière une différence fondamentale entre l'écriture
automatique et l'automatisme pictural. Dans
l'automatisme écrit, la phrase donnée va généralement
appartenir à un paragraphe puis à un chapitre. Elle
relève d'un processus de création et se rattache et
s'enrichissant d'un contexte. Une phrase exaltant la
portée de l'autre. Or, dans l'automatisme pictural,
l'image donnée est exhaustive.
Les psychanalystes, eux, présentent le rêve comme une
révélation saisissante du moi profond. Ils considèrent
que la matière y est dense, riche et bercée sous le
sceau du mystère. À leurs yeux, le sujet, pour la durée
de l'expérience, y est soumis à une forme d'éclatement
psychique. Pour eux, le rêve offre l'opportunité de
92Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlyse dans1'expérience surréaliste, p.94
215
saisir les fonctions inconscientes. À cet égard, il
rejoint le but du faire automatique. Ipso facto, on peut
dire que l'automatisme, tout comme le rêve pour les
psychanalystes, a pour fonction de saisir les richesses
voilées de l'inconscient. Ces fonctions symboliques se
présentent comme des informations cruciales autorisant
la saisie des mécanismes de la subconscience.
Dans les deux cas, c'est par l'image que passe
l'ensemble de la représentation mentale. Elle en est le
moteur. Toutefois, il convient de remarquer que les
vestiges du rêve donnent à croire qu'il se développe à
la façon d'un film ou mieux encore d'une vidéo clip. Les
images se succèdent, elles s'entrecoupent et se
transforment continuellement à une vitesse fulgurante.
Certes, dans le processus de l'automatisme chez Masson,
les éléments évoluent différemment. En effet, l'image
est d'abord dictée par la ligne, c'est elle qui
l'inféode et qui la guide. Il y a ensuite surgissement,
puis l'image est ensuite notée.
Or, pour mesurer la portée de cette distinction, il
importe de considérer l'état de tension dans lequel
l'esprit est placé au cours du faire l'automatique en
regard de celui du rêveur. Ainsi, dans le premier cas,
l'esprit s'astreint à une gymnastique mentale très
intense. Le rêve, lui, se présente comme un état où,
malgré la véhémence de l'activité mentale, il y a
recouvrement. En outre, cette réédification est
essentielle sans quoi le sujet peut développer des
216
formes variées de détresses mentales et émotionnelles.
Suivant cette visée, on voit ici clairement en quoi
l'automatisme se distingue d'un rêve éveillé.
En outre, selon le registre médical, le rêve constitue
le moment où le cerveau répertorie l'information qu'il
rencontre lors de la période d'éveil. Il s'agit là d'une
fonction essentielle. Elle est nécessaire à
l'apprentissage. Conséquemment, le rêveur ne crée rien,
il effectue plutôt banalement un inventaire. Il est très
remarquable de constater que cette corrélation postule
que le sujet privé de rêve sera substantiellement inapte
à apprendre.
Suivant ce mode de lecture, il est loisible de penser
que l'impression de suites obscures ou d'aventures
rocambolesques ressentie par le rêveur, est peut-être le
fruit de l'assemblage hétéroclite, voire saugrenu de
fragments de souvenirs issus de chaque période de rêve
en un tout. En s'appuyant sur cette conjecture, on
pourrait établir un liens entre le souvenir du rêve et
le résultat de l'image obtenue de façon automatique.
L'image donnée étant constituée d'éléments simples mais
assemblés de façon déconcertante et dont on ne semble
pas détenir la clef de compréhension.
8.4 Les tableaux de sable (1927)
217
La nécessité d'effectuer des tableaux automatiques
affleura aux yeux peintre lorsqu'il éprouva l'écart
entre ses œuvres peintes et dessinées. Pour l'essentiel,
le décalage s'articulait autour de la spontanéité et de
la rapidité d'exécution des oeuvres. Or, devant faire
face à l'impossibilité d'effectuer ces tableaux à
l'huile, Masson eu l'idée de produire des tableaux de
sable. Cette révélation survint vers la fin de l'année
1926, le début de l'année 1927. Lors de cette période,
la famille Masson était installée au bord de la mer à un
kilomètre de Sanary. La commotion survint lors d'une
promenade sur la plage. , En observant le sable,
l'artiste éprouva les multiples possibilités qu'offre
cet élément naturel... Il constata que le sable était
constitué de grains dissemblables. L'unicité des grains
de sable permettrait ainsi d'effectuer de multiples
combinaisons tant au niveau des variations de couleurs
qu'au niveau de l'éclat de ses reflet. Ipso facto, la
prolificité de cette matière lui parue considérable.
André Masson conçoit donc projeter le sable sur une
couche de colle pour produire l'apparition de la forme.
Pour l'artiste, cette apparition involontaire possède
une envergure réelle. L'intérêt de ce faire est
précisément, à ses yeux, liée à son aptitude à exalter
le dévoilement intérieur.
Initialement, le processus se présentait comme suit : il
s'agissait de faire alterner respectivement, sur une
toile, la projection d'une couche de colle et d'une
couche de sable. Le tableau prend vie avec l'automatisme
sous la dictée de l'inconscient. C'est ainsi que dans sa
218
première œuvre avec ce médium, l'artiste vit surgir
l'idée des poissons. Ils furent immédiatement dessinés.
Puis l'œuvre s'est transformée pour progressivement
devenir un combat de poissons. Cette première œuvre est
d'ailleurs marquée par des fragments de la toile qui
sont demeurés blancs. Ce faire se complique avec l'ajout
d'une contrainte : celle de couvrir le fond de la toile
de sable. Au sein de ces diverses couches, on voit
naître des reliefs. De toute évidence, ces reliefs
enfantent une forme. Le dessin devient plus sobre. On
remarque que la couleur s'esquive. L'oeuvre se révèle
alors presque monochrome diapré de fines nuances. Les
« Poissons dessinés sur le sable » du Musée de Berne en
sont un bon exemple. À ce propos l'artiste spécifie :
À travers les différentes couches qui formentle relief, il y a la suggestion très vague d'untorse masculin. Les dessins de poissons, eux,sont beaucoup plus définissables. C'est ce quim'a suggéré le titre. Les seuls éléments de lacouleur- un centième à peine du tableau ensurface- sont une flaque de rouge en bas et, enhaut à gauche, une tache couleur bleue. Tout lereste est monochrome, avec toute une variété de
29"î
nuances.
À l'instar des tableaux de l'époque de Sing, il importe
de remarquer que les tableaux de sables enfantés par
André Masson se distinguent par leur fini monochrome.
L'artiste souligne les formes par un trait bistre. Par
la voie de ce faire, Masson lyrise le mariage entre le
dessin et la beauté naturelle du matériel utilisé. Il
est hors de doute que toute l'œuvre de l'artiste est
2 53 André Masson, Vagabond du surréalisme, p . 85
219
portée par le désir de préserver voire de déployer le
faste de cet élément. Suivant une visée exploratoire, il
diapré la toile de couleur qu'il mélange au sable.
L' introduction de couleur met en reliefs les virtualités
inexprimées du médium. Tel que précisé dans l'extrait
précédent, les tableaux de sable postulent un travail à
plat. Il convient de souligner que cette technique
relève de la peinture asiatique. Pour l'essentiel, la
genèse de ce faire est liée à nature du médium utilisé.
En effet, il est hors de doute que les asiatiques, qui
ont exalté le travail de l'encre, furent tenus de
développer cette praxis. Nonobstant, si ce faire fut
consacré en Asie, il importe de remarquer qu'il rompt
audacieusement avec les traditions européennes.
André Masson s'évertue donc à ensevelir ses toiles de
sable. Cette étape consommée, il devint progressivement
possible pour l'artiste, de redresser le canevas avant
la survenue de l'image. L'intérêt de ce faire tient à
l'émergence de nouvelles latitudes. En effet, l'artiste
se dote ainsi d'un double recours et exalte
consequemment ses recherches. D'une part, le
redressement de l'œuvre permet à André Masson
d'ausculter les « flasques »294 qui affleurent sur la
toile. D'autre part, dès l'instant où la toile levée, de
poursuivre l'expérience en projetant de nouvelles
rafales de colle et de sable. Ipso facto, l'artiste
exalte le faire automatique par l'introduction de
nouvelles contingences.
294Ibidem, p . 86
220
1/ image ainsi localisée est aussitôt dénoncée par
l'artiste qui la souligne à l'aide d'un pinceau.
L'artiste mentionne que, malgré l'absence d'à priori,
les œuvres automatiques possèdent des structures
respectives. Il précise :
« Ce qui caractérise en grande partie lesdessins automatiques - et cela plaisaitbeaucoup à Breton - c'est le fait qu'ils ont unhaut et un bas. Quoique très souvent on lesexpose et on les reproduit à l'envers! Audépart, il n'y avait presque ni haut ni bas,mais inconsciemment, je m'arrêtais quand jevoyais que je ne pouvais pas aller plus loin,cela sans aucune idée compositionnelle. »295
Tel qu'énoncé, ce n'est qu'après le surgissement de
l'image que Masson s'arrête. Il s'agit pour lui d'un
moment de prédilection où le but semble atteint.
L'artiste semble alors confronté à une incapacité
d'outrepasser cette limite. Traditionnellement, Masson
introduisait, au sein de ses œuvres peintes, un espace
au centre destiné à faire naître une spontanéité presque
totale. Or, il convient de remarquer les tableaux de
sable créaient naturellement un champ magnétique
inhérent à la matière.
On voit clairement surgir de ces œuvres des éléments
figuratifs. À cet égard, il convient de remarquer que
l'artiste, for d'une vaste formation académique, était
295 Ibidem, p. 87
221
instinctivement porté vers le figuratif. Il paraît donc
peu surprenant de voir affleurer des éléments de
figuration dans ses productions. Soulignons que les
tableaux de sable octroyaient un avantage majeur sur le
canevas de papier. En effet, le fond recouvert de sable
prodiguait d'emblée une véritable énergie cinétique.
Cette énergie plonge ses racines dans la luxuriance
essentielle du médium et s'exalte par l'ondoiement du
sable sur la toile.
8.5 Le désir de communication
Suivant ce mode de lecture, il importe de s'intéresser
au désir de communication de l'artiste. En effet,
l'artiste qui produit une œuvre automatique cherche
inévitablement à établir une communication. Cette
communication est d'abord intérieure, c'est-à-dire
qu'elle s'érige entre le moi inconscient et le moi
conscient. Ce dialogue est essentiel à l'aboutissement
de l'œuvre. Si la communication intérieure ne s'établit
pas, c'est le chaos qui résulte. Nous avons constaté
que, pour se rendre lisible, l'image est contrainte
d'emprunter un vocabulaire académique, c'est-à-dire
qu'elle doit utiliser des enveloppes connues et
reconnaissables. Il est clair qu'elle s'ouvre à l'autre
en s'exposant. L'image étale son message sur une plus
vaste portée. Elle devient ainsi perceptible à l'artiste
mais aussi à tout observateur. Il faut entendre que
cette révélation personnelle devient donc, par le fait
même de son médium, interpersonnelle.
222
II convient d'observer que cette mise à nu, ce
dévoilement de l'inconscient, est particulièrement
troublant dans le cas des tableaux de sable, tel que
pratiqué par Masson. En effet, si l'automatisme écrit
est aussi un dévoilement, il demeure plus discret et sa
portée plus « limitée ». Cette distinction tient d'abord
au fait que l'écriture s'effectue sur une feuille de
papier. De toute évidence, celle-ci peut être pliée et
dissimulée dans les poches d'une veste ou d'un pantalon,
glissée sous une assiette ou encore chiffonnée pour
échapper au regard d'autrui. En outre, l'écriture
postule l'effort de la lecture, y jeter un simple regard
n'informe que peu sur son contenu. Cette lecture
présuppose, voire exige, une connaissance minimale de la
langue, puisque pour le profane ces signes ne portent
aucun sens, et la chaîne signifiante s'interrompt.
Or, l'image, tout comme la musique d'ailleurs, possède
une portée que l'on pourrait qualifier d'universelle.
Les formes pures, qu'elles soient dessinées ou peintes,
au même titre que l'œuvre musicale, sont accessibles à
quiconque possède la faculté de percevoir. La symbolique
dont elles sont chargées est culturelle. En ce sens,
l'image devient, dans son signifié, plus accessible que
ne l'est l'écrit. De plus, sa lecture est rapide et son
dévoilement simultané et total. Le manuscrit, lui, se
livre une phrase à la fois et il est impossible de
contrevenir à cette règle. Sans compter que le tableau
de sable, de par son canevas, ne peut évidemment pas
bénéficier de la même discrétion que l'écriture. Nous
concevons facilement que de vouloir glisser secrètement
223
un tableau sous son assiette relève du burlesque. Cette
évidence affirmée, il convient de constater que cette
pratique de l'automatisme exige de la part de l'artiste
une grande audace. André Masson dévoile ses fantasmes
inconscients dans ses œuvres avec la même intégrité et
la même ouverture désintéressée que celles avec
lesquelles Rembrandt dévoila son âme dans sa série
d'autoportraits. Successivement, tableau par tableau,
c'est une étincelle totale qui se révèle.
Au vrai, il semble qu'André Masson a toujours eu cette
volonté de communiquer. À propos de ces dessins, Jean-
Clarence Lambert, dans son livre intitulé André Masson,
dit : « On y entend il faudrait dire : on y voit -
cette Parole qui vit dans l'être même de l'artiste :
langage qui cherche sa voie vers l'œuvre par les formes
et les signes du graphisme noir et blanc. »29 À cet
égard, il importe de souligner qu'André Masson
questionnait constamment son art : en font foi les notes
manuscrites que nous retrouvons sur beaucoup de dessins.
Ces gloses s'éploient, passant de simples commentaires à
des textes poétiques. Il est hors de doute que les
écrits du peintre constituent des éléments référentiels
essentiels. L'œuvre de Masson se présente comme le
reflet, l'illustration de sa sensibilité lyrique. On y
découvre des traits impétueux, désinvoltes et
passionnés.
296 Jean-Clarence Lambert, André Masson, p.31
224
Jean-Clarence Lambert mentionne à cet égard qu'André
Masson obéit au désir de réduire l'écart entre image et
langage. Pour l'artiste, le verbe et l'image ne doivent
pas s'exclure mais se conjuguer. Il ajoute que, chez
André Masson, la figuration est liée à la nomination.25
En fait, il prend à tâche de trouver la symbiose entre
les deux, soit une parfaite interpénétration des
concepts. Prenons acte qu'André Masson ne s'autorise pas
de laisser prédominer l'une de ces considérations sur
l'autre. On voit clairement s'opérer dans le faire de
l'artiste une fusion entre la production et la
réflexion. Il y va de considérations psychiques,
sociales et artistiques. Certes, il y a une recherche de
la communication totale qui se traduit par l'intégration
de l'âme poétique dans la production plastique. À ce
sujet, Michel Leiris a très justement dit :
II est des peintres qui peignent sans penser,et c'est le cas de la plupart. Il en estd'autres qui pensent avant de peindre, et celavaut peut-être un peu mieux. Il en estquelques-uns enfin Masson se range parmiceux-là - qui peignent pour penser. La peintureest leur méthode de recherche, moyen d'être encontact plus étroit avec ce qui les entoure,façon d'atteindre à une conscience plus aiguëdes êtres et des choses, et de leur attribuerune signification.298
Et André Masson, pour sa part, énonce en toute
lettre cette fusion. Il précise que : « Toujours est-il
qu'à partir de ma vingtième année, c'était fini : je ne
297 Idem298Ibidem, p . 50
225
pouvais plus séparer l'idée de peindre de l'idée d'être
un homme et d'avoir par-là même une certaine
responsabilité. »299
Visiblement, aux yeux de l'artiste : penser, peindre,
communiquer et être un homme sont des actions qui
doivent s'effectuer simultanément. Une telle réflexion
révèle qu'André Masson entend l'homme comme un animal
social. Le fait d'exister et d'appartenir à une
communauté impose à l'être une responsabilité sur la
détermination de celle-ci. L'art devient, répétons-le,
le moyen d'action de l'artiste sur l'évolution mythique
de l'homme.
Or, nous avons vu précédemment que Masson soulignait sa
« prédestination toujours contrariée ». Il semble que ce
sentiment se soit poursuivi jusque dans la réception de
l'œuvre. Selon l'artiste, à la différence du mouvement
Dada identifié d'emblée comme outrecuidant, la France
des années 20 entendait le surréalisme en termes de
conscience morbide. Il précise : « Le fait d'admirer et
de populariser Freud, produisait sur le public bête la
majorité l'effet d'un électro-choc. »300 L'artiste
ajoute :
J'étais particulièrement considéré comme unmonsieur à soigner car on trouvait dans mespremiers tableaux beaucoup de personnagesdécapités. On m'accusait de mutiler les corps
9 André Masson, Le Vagabond du Surréalisme, p.15300ibidem, p. 67
226
dans le seul but d'offenser alors que, pourmoi, l'éclatement et la dispersion des corpscorrespondaient à une idée de réunion avecl'univers. Je passais, aux yeux du public, pourun destructeur sadique de l'homme. Lemalentendu était total.301
De tout évidence l'art de Masson était appréhendé comme
avilissant. Masson exprime clairement que pour lui, « la
dispersion des corps correspondaient à une idée de
réunion avec l'univers ». On voit clairement que la
visée de Masson devrait être embrassée comme un projet
complet et absolu. En effet, le peintre met en jeu
l'horreur comme tenant de la totalité. Ce qui peut
donner le plus aisément accès à ce concept, c'est le
commentaire de Georges Bataille à propos de l'apocalypse
de Saint-Sever, paru en 1929 dans la revue Documents.
Bataille y précise :
« Cependant, cette horreur n'est pas hurléesauvagement : tant bien que mal, des peintres,des poètes, d'ailleurs grossiers, l'exprimentavec une bonhomie provocante... En effet...l'horreur (ici) n'entraîne pas de complaisancepathologique et joue uniquement le rôle defumier dans la croissance végétale, fumierd'odeur suffocante sans doute, mais salubre à laplante... »302
II convient de souligner que cette interprétation
manifeste l'influence des concepts de décadence et de
commencement de Friedrich Nietzsche, pour qui ces choses
ne sont pas des éléments proprement contradictoires.
Plutôt, entre elles, il y a l'unité de la vie qui les
301 Idem, p. 67302 Jean-Paul Clébert, Les Lettres Nouvelles, Georges Bataille et AndréMasson, Mai 1971, p.61
227
réunit. Ces pseudo-antinomies y sont présentées selon
des points de vue distincts afférents à l'idée de
compensation. Par exemple, selon cette perspective, nous
pourrions soutenir que lorsque le corps est faible,
l'esprit se renforce et inversement. Conséquemment, la
vie devient l'unité des contraires.
Certes, André Masson parla ostensiblement de la
relation entre son œuvre et le public français. Masson
épanche le sentiment d'avoir été réputé pour un
« pestiféré », le « lépreux de l'Art français ».303 Ces
mots reflètent clairement l'adversité éprouvée. Au
regard de l'artiste, le brandon de discorde fut exalté
par l'apparente abjection de ses thèmes. En
l'occurrence, il est remarquable de constater que
cette infortune semble avoir joué le rôle de limon
dans le faire de l'artiste. Masson précise :
Le résultat de cette mise à l'écart par lepublic fut, pour moi, très positif. J'ai étéfortifié par la critique : l'acquiescementaurait signifié un affaiblissement, de mêmequ'une renommée universelle trop grandem'aurait certainement empêché d'aller jusqu'oùje désirais.304
En dépit des attentes, il est clair que cette
relation désolée avec le public a délivré le
peintre en l'affranchissant de la pression sociale.
8.6 Les traverses de l'automatisme pictural
303 André Masson, Le Vagabond du Surréalisme, p. 71-72Ibidem, p.68
228
L'automatisme de Masson survient naturellement. Il faut
entendre qu'il n'est pas le fruit d'une quelconque
provocation. Ce fait affirmé, il est clair que cette
pratique raréfie l'expérience. Dans la perspective ainsi
tracée, il devient corollairement impossible à Masson
d'être tous les jours surréaliste. Pour Masson, cette
expérience relève de l'état de grâce. Elle est
spontanée, fugace et momentanée. Le versant périssable
de l'expérience a trait au principe stipulant qu'elle
doit s'effectuer en l'absence de la raison.
Qui plus est, il faut considérer que l'automatisme se
présente comme la recherche désespérée d'une fusion
entre deux états qui semblent fondamentalement
contradictoire. Pierre Vermeersch, dans son article
intitulé « Le Retour à la ligne : du dessin automatique
d'André Masson », énonce clairement l'envergure de ce
paradoxe au niveau strictement plastique. L'auteur
précise :
D'une part, un espace qui n'est que l'écheveaude la ligne, effet synchronique du dépôt sur lafeuille de la succession de ces représentationsfragmentaires, disparues sitôt qu'apparues dansl'ouverture de leur inachèvement au regard del'artiste, faisant place les unes aux autresdans le défilé métonymique de son désir.D'autre part, l'espace géométral du tableauavec lequel le peintre doit composer, d'où saréférence implicite tant aux solutions ducubisme qu'a Chirico : tronçons de fût decolonnes et d'entablements ayant pour fonctiond'établir une conjonction entre ces deux
229
espaces de représentation, qui reste pour lemoins hétérogène au dispositif initial puisquenécessairement réfléchie305.
Il est loisible de penser que ces traverses ont
participé au désintéressement d'André Masson à l'égard
de l'automatisme. Au certain, la difficulté capitale du
procédé tient de l'absence de conscience qu'il
nécessite. Or, la présence de cette pierre d'achoppement
est relative à la probité de l'artiste.
En outre, il est clair que le désir d'autodétermination
du peintre et son besoin viscéral d'outrepasser les
limites de l'art constituent une légitimation à
l'échappée du mouvement et du processus qui l'autorise.
André Masson précise d'ailleurs clairement que :
II ne s'agissait pas pour moi de refaire lesforêts ou les natures mortes d'autrefois, maisl'insolite me pesait, je craignais de me figerdans une manière, un genre comme on disaitautrefois. Il y a bien des peintres, des« spécialistes », qui ne font que des marines...J'avais peur de devenir un spécialiste du rêveet de l'inconscient. C'est là une des causes dema rébellion contre le surréalisme. Ce n'étaispas un point final, car j'ai continué à fairedes dessins automatiques j'en ai d'ailleurstoujours fait, à toutes les époques, pourgarder encore un contact avec le monde dusubconscient. Mais, à cette époque-là, vers1931-32, je vivais alors à Grasse; ilm'arrivait de faire, de nouveau, non pas desnatures mortes, mais des paysages où lesrecherches d'ordre plastique
réapparaissaient.306
305 Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlyse dansl'expérience surréaliste, p.93306 André Masson, Le Vagabond du Surréalisme, p . 79
230
Les titres conférés au peintre, qu'il accepte au
demeurant avec gracieuseté, traduisent nommément
1'idiosyncrasie de celui-ci. De telle sorte que, face à
de jeunes surréalistes orthodoxes qui le qualifiaient de
« vieux renégat pantelant », il précise : « Ils avaient
parfaitement raison : je suis vieux, vis-à-vis
l'orthodoxie, je suis un renégat, et c'est dans ma
nature d'être à la fois exalté, émotif et
pantelant... ».3( André Chastel vient concurremment
préciser et résumer ces traits en soutenant qu'André
Masson est « le peintre des métamorphoses ». La formule
est éloquente. La métamorphose se présente comme un
changement radical de forme. Il convient donc de
l'entendre comme un essor exalté qui met abat les geôles
et ce, quelque en soit la nature. Surpassant le faire de
l'artiste, c'est une position idéologique infuse qui
s'affirme conformément à l'idée de métamorphose.
Il s'agit là, sans doute, de raisons pour lesquelles
André Masson précise qu'il croyait fermement que la
valeur primordiale ne serait jamais l'automatisme, mais
l'esprit dionysiaque. L'artiste dit tout net:
Au fond, je pensais, contrairement à Breton,que la valeur primordiale ne serait jamaisl'automatisme, mais l'esprit dionysiaque;l'automatisme peut très bien s'intégrer àl'esprit dionysiaque, qui correspond à unesorte d'état extatique et explosif permettantde sortir de soi, de donner libre cours à sesinstincts et par là, mener à l'automatisme.Mais, pour moi, le sentiment dionysiaque est
3 0 7 Ibidem, p . 54
231
plus permanent que l'automatisme, carl'automatisme est absence du conscient.3'
De toute évidence, les réserves de Masson plongent leurs
racines dans les principes de liberté et de fugacité et
s'articulent autour de l'attitude intègre du peintre. Il
est clair que l'esprit dionysiaque, défini en termes de
libération physique, d'ivresse, d'égarement et de
dévergondage, s'opposait d'emblée à l'ascèse d'André
Breton. Et le peintre spécifie très justement le point
nodal du problème inhérent au surréalisme et à
l'automatisme en disant :
En réalité, il y a peu d'automatisme dans lesurréalisme et, pourtant, sans cette méthode,le surréalisme n'aurait pas existé. Ladifficulté réside justement dans le fait savoirqu'elle est la part d'automatisme dans lavision surréaliste. Il m'est souvent arrivé denoter des fantasmes qui traversaient l'espritou de copier des rêves et là, il y aautomatisme évident. Les rêves avaient unegrande importance pour le surréalisme car ilséchappaient à tout contrôle de la raison.309
En somme, bien que cette activité soit à la source du
surréalisme, les expériences concluantes furent
rarissimes. Il convient de remarquer que l'une des
principales animadversions énoncée par les dissidents de
l'automatisme est corrélative au risque de n'effectuer
que des filiations insipides ou inessentiels et comme le
disait Hegel : « dont le contenu ne dépasse pas celui
308 Ib idem, p . 8 9
309 Idem.
232
qui est contenu dans les images »310. Ici se révèle, nous
y reviendrons, l'adversité de l'automatisme surréaliste
d'André Breton.
Enfin, Masson arrondit clairement sa position en
disant :
En conclusion, ce que l'automatisme a été pourmoi est difficile à préciser. Mais j'y aitoujours cru et j'y crois encore, comme à unétat de grâce. Ce qui est important surtout,c' est qu'il représentait une révolte contre latradition artistique et un moyen pour faire del'érotisme un art noble, c'est-à-dire unérotisme non pas réaliste, mais surréaliste. Etpuis, bien sûr, l'automatisme m'a délivré demon éducation cubiste.311
Au vrai, ce sont les préoccupations de Masson qui
transsudent son interprétation. Ici se révèle
concurremment le côté pulsionnel de l'artiste et sa
quête. On voit clairement affirmer le caractère émouvant
de l'artiste qui ne peut souffrir de fixité.
310Fabienne Hulak, Marguerite Bonnet, Folie et psychananlyse dansl'expérience surréaliste, p.93311André Masson, Le Vagabond du Surréalisme, p. 92
233
En Conclusion, l'injonction de Masson
Comme nous l'avons énoncé, André Masson soutenait
« contrairement à Breton, que la valeur primordiale ne
serait jamais l'automatisme », attendu que
« l'automatisme est absence du conscient ». Au vrai, ce
commentaire renvoie à une pluralité d'autres questions
dont la principale se dessine comme suit : Qu'elle fut
la véritable fonction de 1'automatisme dans le mouvement
surréaliste ? André Masson note à cet égard que :
Ce refus de l'automatisme comme dogme m'afinalement séparé de Breton. Je considéraisl'automatisme comme un moyen parmi d'autres.D'ailleurs, dès le début du surréalisme, jem'étais méfié de ce côté dogmatique et j'avaisfait part de mes craintes à Benjamin Péret quiallait également faire partie du groupe. Nousavons parlé du mouvement qui devait se fonderet je me souviens de lui avoir dit : « II nefaudrait pas que cela devienne un dogme. »Péret m'avait répondu : « Mais, justement, celane peut pas être un dogme. »312
En effet, la distinction entre automatisme et
surréalisme dans le manifeste de 1924 demeure absconse.
Breton définit d'emblée le surréalisme comme un
« automatisme psychique pur ». Ces termes sont si
conjoints qu'il est loisible de se demander si une
distinction est possible. En outre, André Breton décrit
dans le premier manifeste l'usage surréaliste du langage
en ces termes :
312André Masson, Le Vagabond du Surréalisme, p.90
234
Le langage a été donné à l'homme pour qu'il enfasse un usage surréaliste. (...) Parler, écrireune lettre n'offrent pour lui aucune difficultéréelle, pourvu que, ce faisant, il ne proposepas un but au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire pourvu qu'il se borne à s'entretenir (pourle plaisir de s'entretenir) avec quelqu'un. Iln'est pas anxieux des mots qui vont venir, nide la phrase qui suivra celle qu'il achève. Aune question très simple, il sera capable derépondre à brûle-pourpoint. En l'absence detics contractés au commerce des autres, il peutspontanément se prononcer sur un petit nombrede sujets; il n'a pas besoin pour cela de« tourner sept fois sa langue » ni de seformuler à l'avance quoi que ce soit. Qui a pului faire croire que cette faculté de premierjet n'est bonne qu'à le desservir lorsqu'il sepropose d'établir des rapports plus délicats?Il n'est rien sur quoi il devrait se refuser àparler, à écrire d'abondance. S'écouter, selire n'ont d'autre effet que de suspendrel'occulte, l'admirable secours. 313
Cette pratique témoigne d'un automatisme certain. Il
convient de remarquer que l'usage surréaliste du langage
présente beaucoup d'analogies avec l'usage qu'en font
les lobotomisés. C'est intéressant attendu que,
conformément aux dires du neurologue Boris Cyrulnik, les
lobotomisés vivent dans des successions de présent. Ils
n'ont cure ni du passé ni du futur. C'est ainsi qu'ils
se dérobent à la férule du temps.
Conséquemment, leur idiosyncrasie se voit transformée.
D'une part, il semble que, libérés de l'empire de la
conscience relative à un quelconque futur, les
lobotomisés sont tout aises. D'autre part, ils font face
à une incapacité de planification. Certes, cette
313 André Breton, Manifestes du surréalisme, p. 44
235
impéritie les rend instables. Ipso facto, ils sont
gouvernés par les stimulations de l'instant présent.
Selon les dires du neurochirurgien, il semble qu'ils
soient peu communicatifs. Leur discours est notamment
dépouillé. Boris Cyrulnik mentionne qu'ils répondent aux
questions posées par des phrases laconiques voire
monosyllabiques exemptes de ponctuation et conjonctions
de relation. Il est hors de doute que ces éléments ont
pour ressort la conscience du temps et s'articulent
autour de l'idée d'agir sur lui. Les lobotomisés, ne
prévoyant ni leurs discours ni leurs actions, ne s'en
gênent donc pas. Ils ne s'embarrasser plus de la
critique sociale attendu qu'ils sont dispensés du poids
relatif à la conscience du futur. Conséquemment, ils se
désintéressent du regard de l'autre.
En l'occurrence, on remarque que les « tics contractés
au commerce des autres » dont parle Breton sont produit
par « le travail émotionnel de la paroles »314. Ils sont
enfantés par la tension qui inféode l'être impulsé par
le désir d'énoncer une circonlocution et contrarié par
son incapacité à l'extérioriser. Le docteur Cyrulnik
précise que :
Le manque de mots nous crispe et nous contraintau détour verbal et gestuel. Tant que nous netrouvons pas la circonlocution adaptée, nousnous tapotons ou effectuons des gestes agacésde la bouche « Tsss, Tsss ». Ces petites auto-agressions manifestent notre tension intime.(...)0n ne peut comprendre cela que si l'onaccepte l'idée que nos phrases et nos récitsdonnent aux autres et à nous-mêmes une
Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, p.147
236
sensation d'identité cohérente, donc un codeclair d'action sur le monde.315
De toute évidence, les lobotomisés n'éprouvent pas ces
tensions internes. Au moment qu'ils omettent un mot, ils
se taisent sans affectation. On voit donc clairement que
la délivrance du temps dissous toute formes
d'étranglement sociale.
Il est loisible de penser qu'André Breton, au cours de
son passage au Centre neurologique de Saint-Dizier ou
dans le travail clinique aux côtés de Babinski, ait
rencontré des sujets de cette nature. Quoiqu'il en soit,
for de cet exemple, il convient de remarquer que la
libération du langage n'est actualisable que dans la
perte de l'autre. La libération totale du langage n'est
possible que dans l'exclusion du souci, de la
considération de l'autre et du temps. Et, cette liberté
est aussi un assujettissement car elle nous soumet à
l'instant présent. Dès lors, l'émoi ressenti n'est
possible qu'au moment où la conscience reprend ses
droits.
Suivant cette visée, il apparaît clairement qu'il ne
peut s'agir de l'objectif appété par l'auteur de L'amour
fou, celui-là même qui veut « que l'on se taise lorsque
l'on cesse de ressentir ». Dès lors, qu'en est-il
réellement ? Il est hors de doute qu'André Breton
souhaitait se délier du contrôle social et de
l'assujettissement qu'il postule. Il est aussi
indéniable que, chez André Breton, l'émotion joue un
315 Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, p.148
237
rôle capital. En l'occurrence, il est possible de se
demander s'il n'y aurait pas eu glissement entre la fin
et le moyen. La fin se présente comme la surréalité où
s'embrassent les antinomies et, où l'homme vit
poétiquement. Le « type humain formé » se dissolve pour
enfanter un nouvel homme, surréaliste, qui se crée lui-
même à chaque instant. Corollairement, cet homme
imprévisible disqualifie le pouvoir qui perd prise sur
lui. À cet égard, lorsque Benjamin Péret affirme à André
Masson : « Mais, justement, cela ne peut pas être un
dogme »316, il a parfaitement raison. La vie poétiquement
frappe d'ostracisme le dogme. Elle met à bas l'homme qui
récite son existence. L'objectif visé étant d'éployer la
liberté de l'homme. L'automatisme se devait être le
substrat du surréalisme autorisant l'ascension de
l'être.
André Masson mentionne à cet égard que les peintres du
surréalisme ne cherchait pas à « faire école ». Il
affirme :
Mais ni Miro' , ni Max Ernst, ni, à plus forteraison, Tanguy ou moi-même n'y pensions. Celaexplique que nos œuvres soient essentiellementdifférentes. L'important était d'affirmer d'unemanière affective ce que l'on avait de plusprofond en soi : les fantasmes, les désirs,tout ce qui était issu de l'espace intérieur.En ce qui me concerne, on peut dire que j'ai,par la suite, influencé la peinture américaine,mais chez aucun d'entre nous il n'y avait cettevolonté de faire école. Nous étions desindividualistes. Sur le plan idéologique, lesthéories politiques m'intéressaient surtoutles théories de Bakounine et Kropotine commeelles intéressaient Max Ernst dont la lecture
316André Masson, Le Vagabond du Surréalisme, p. 90
238
préférée était Max Turner. Miro' représentaitla neutralité absolue. Tanguy était nettementanarchisant. Dali, n'en parlons pas... C'étaittout et rien. Dali, c'est la synthèse de tout;le mariage du croissant et de la croix gammée.Il y a, chez lui, la croyance très nette que savision est géniale et que, partant, elle sesuffit à elle-même. Il a d'ailleurs écritConquête de l'irrationnel, mais cette idée deconquête ne vise pas à influencer les autres;elle tend, au contraire, à s'approprier soi-même. On trouve peut-être là le dénominateurcommun du surréalisme : l'acceptation, larecherche de tout ce qui est caché etgénéralement rejeté; d'une manière générale,tous les phénomènes de l'inconscient. Ainsil'individualisme pourrait être le caractèremême du surréalisme. 317
André Masson énonce clairement la disparité des membres
du groupe. En effet, le surréalisme accuse une absence
de caractéristiques maîtresses proprement picturale. Là
est sans doute la raison qui a amené André Breton a
parler, dans son ouvrage de 1928, du surréalisme et de
la peinture et non de peinture surréaliste. À l'instar
de la poésie, la peinture doit être un vecteur et non
pas une fin.
Il est remarquable qu'André Masson s'arrête sur l'idée
de « s'approprier soi-même ». Ressouvenons-nous que
cette idée est clairement énoncée par André Breton dans
le manifeste de 1924 alors qu'il écrit : « L'homme
propose et dispose. Il ne tient qu'a lui de
s'appartenir... »318. Suivant cette idée, la quête
entreprise par Antonin Artaud est d'un surréalisme
certain. L'individualisme, entendu comme une doctrine
317André Masson, Le Vagabond du Surréalisme, p29318 André Breton, Manifestes du surréalisme, p.28
239
qui voit dans l'individu la valeur suprême dans le
domaine politique, économique, social et moral visant à
développer les droits et les responsabilités des
individus, se présente comme le postulat du surréalisme.
Le surréaliste est celui qui, privément, puise en son
imagination les richesses nécessaires pour naître à la
vraie vie et reformuler le monde. La formule d'André
Masson unifie astucieusement les abîmes du mouvement
tout en préservant son essence et ses visées.
En l'occurrence, conformément aux multiples échecs que
l'automatisme à connus, l'allégeance d'André Breton
demeure abstruse. Il est loisible de penser que cette
foi en l'automatisme a pour ressort l'heure de sa
survenue dans sa biographie, c'est-à-dire en plein cœur
de l'adversité. Nous constatons que l'automatisme a pour
ainsi dire fait événement dans la vie de l'auteur. Si
André Masson était gouverné par un besoin de
métamorphose qui finit par le détourner de
l'automatisme, il semble que pour André Breton il fut
une planche de salut. Là est peut-être la raison pour
laquelle Breton s'y agriffa fermement. Ce nonobstant,
André Masson a bien raison de parler du surréalisme
comme « d'un de ces échecs tellement formidables qu'ils
en deviennent plus grands que certaines réussites ».
319 André Masson, Le Vagabond du Surréalisme, p.58
!W'* • •'•.'^•''v'r ••' • m^•W'W- ,i
fi-
/ . * •
àÉ
•4 • <mfai
••'-.:- • , ? £ # • '
• ; . * . - • . > / -
^ %
/ • • • •
<f
C - . ,•••-•
• if m V...V \ \ ... } r - | |
• * \ \
V.•-V.V-J,
I ' • * • - -
s. ••.- .••""V
• • ! . . ' • ! • • : . ' • " •
• • « • ' ; , ; . * . . • • - , ,
S .'
mmi»m0 • ^ ^r
249
TABLE DES ILLUSTRATIONS
1. André Breton au centre neurologique de Saint-Dizier,
juillet 1916.
2. André Masson, Paris, 1914
3. Carnet de Guerre d'André Masson, Mémoires du monde.
4. Forêt, 1923 (Aucune information trouvée)
5. The Cemetery. 1924 (Le cimetière) Oil on canvas, 116 x
89 cm. Musée de grenoble. Tiré du livre
ADES,Dawn. André Masson
6. Four Eléments. 1924. (Les quatres éléments) Oil
oncanvas, 73 x 60 cm. Musée National d'art Moderne,
Centre Georges Pompidou, Paris.
7. Cardinal Points. 1924. (Les points cardinaux) Oil on
canvas, 92 x 73 cm. Musée National d'Art Moderne,
Centre Georges Pompidou, Paris.
8. Battle of Fishes. 1926. (Combat de poissons) Sand,
gesso, oil and charcoal on canvas, 36.2 x 73 cm.
Collection, The Muséum of Modem Art, New York.
Purchase.
251
BIBLIOGRAPHIE
ADES,Dawn. André Ma sson. éditions Rizzoli, New York, 1994,
128 p.
ALQUIÉ, Ferdinand.Philosophie du surréalisme, éditions
Flammarion, Paris, 1977, 186 p.
ARTAUD, Antonin. Œuvres, Édition Gallimard, Paris, 2004,
1786 p.
BACH, André. Fusillés pour l'exemple - 1914-1915. éditions
Tallandier, Paris, 2003
BARBUSSE, Henri. Le Feu, Journal d'une escouade, éditions
FLAMMARION, Paris, 1933, 349 p.
BATAILLE,Georges. Œuvres Brèves, éditions Pauvert, 1981,
262p.
BATAILLE,Georges.L'expérience intérieure, éditions
Gallimard, Paris, 1978, 186 p.
252
BATAILLE, Georges. Le bleu du ciel, éditions Gallimard,
Paris, 1991, 215 p.
BATAILLE,Georges.La littérature et le mal, éditions
Gallimard, La Flèche, 1957, 201p.
BÉHAR,Henri. André Breton, le grand indésirable, éditions
Calmann-Lévy, 1990, 475 p.
BÉNÉZET,Mathieu. André Breton Rêveur définitif, éditions du
Rocher, 1996, 233p.
BÉNÉZET,Mathieu. André Breton, rêveur définitif, éditions
du Rocher, Monaco, 1996, 234 p.
BONNET,Marguerite. André Breton. Librairie José Corti,
Paris, 1975, 460p.
BONNET, Marguerite, André Breton : naissance de l'aventure
surréaliste, éditions Corti, Paris, 1975, 460 p.
BRETON,André. Entretiens -.1913-1952. éditions Gallimard,
1969, 312p.
253
BRETON,André. Les Pas Perdus, éditions Gallimard, Paris,
1990, 182 p.
BRETON, André. Manifestes du surréalisme, éditions
Gallimard, Paris,1985, 173 p.
BRETON,André, Soupault,Philippe. Les champs magnétiques.
éditions Gallimard, France, 1998, 178p.
CALLOIS,Roger. L'homme et le sacré, éditions Gallimard,
Paris, 1961, 254 p.
CALLOIS,Roger. Le mythe et l'homme, éditions Gallimard,
Paris, 1987, 188 p.
CARROUGES, Michel. André Breton et les données
fondamentales du surréalisme, éditions Gallimard, Paris,
1967. 376 p.
Centre de recherche sur le surréalisme, Les pensées d'André
Breton, éditions l'âge d'homme, 1988, 362 p.
CLÉBERT,Jean-Paul.« Georges Bataille et André Masson », in
Les Lettres Nouvelles, mai 1971, p. 57-80
254
CYRULNIK, Boris et MORIN, Edgar. Dialogue sur la nature
humaine. édition L'Aube, Collection Monde en cours. Série
Intervention, La Tour D'Aiguës 2004, 92 p.
CYRULNIK, Boris. Un merveilleux malheur, édition Odile
Jacob, : Paris,1999. 238 p.
DESCOULLAYES,Jean, LACHENAL,François. André Ma sson et son
univers. Maître imprimeur Louis Couchoud, Lausanne, 1947,
241p.
DORGELÈS, Roland. Les Croix de Bois, éditions ALBIN MICHEL,
Paris, 1931, 377 p.
DUROZOI,Gérard,LECHERBONNIER,Bernard. André Breton
1'écriture surréaliste. Éditions Larousse Université,
France, 1974, 255p.
Festival de Lyon. André Masson. Musée de Lyon, 1967, ( non
paginé )
FOUCAULT, Michel. Les Anormaux, cours au Collège de France,
1974-1975, éditions Gallimard, Paris, 1999, 351 p.
255
FOUCAULT, Michel. Le Pouvoir Psychiatrique, cours au
Collège de France, 1973-1974. éditions Gallimard, Paris,
2003, 416 p.
FOUCAULT, Michel. L'ordre du discours : leçon inaugurale au
Collège de France prononcée le 2 décembre 1970. éditions
Gallimard, Paris, 1983, 81 p
HAHN,Otto. André Masson. éditions Thames and Huston,
London, 1965, 77 p.
HOLLIER,Denis. Le collège de sociologie, éditions
Gallimard, Paris, 1995, 911 p.
HULAK, Fabienne et BONNET, Marguerite. Folie et
psychanalyse dans 1'expérience surréaliste, éditions
Z'éditions, Collection : Singleton, Nice, 1992, 207 p.
JOUHANDEAU,Marcel.« André Masson », in Nouvelle Revue
Française, no 25, Paris, 1925, p. 377-379
256
LAMBERT, Jean-Clarence. André Masson, éditions Filipacchi,
Paris, 1979. 71 p.
LIMBOUR,Georges.« André Masson et la nature »,in Les Temps
Modernes, no 61, Paris, 1950, p. 938-943
MARIEB N.,Elaine,LAURENDEAU Guy. Anatomie et physiologie
humaine. Les édition du renouveau pédagogique, Saint-
Laurent, 1992.
MASSON,André. Vagabond du surréalisme, éditions St-Germain-
des-Prés, Paris, 1975
MASSON,André. Mémoires du monde, éditions Albert Skira,
Genève, 1974, 172 p.
MASSON,André. Levaillant, Françoise. Les années
surréalistes : 1916-1942.éditions Manufacture, Paris, 1990,
514 p.
MASSON,André. Lambert, Jean-Clarence. André Masson.
éditions Filipacchi, Paris, 1979, 71 p.
257
MAURIAC,Claude. André Breton, éditions Bernard Grasset,
Paris, 327p.
MURAT,Michel. André Breton, éditions de l'Herne, Paris,
1998, 468 p.
PASSERON,René. André Masson. éditions Denoël, Belgique,
1975, 72p.
PICON,Gaétan. Le Surréalisme, éditions d'art Albert Skira,
1995, 216p.
POLIZOTTI,Mark. André Breton, édition Gallimard, Paris,
1999, 842 p.
POULAILLE, Henri, Pain de soldat, éditions Bernard Grasset,
Paris, 1937. 1 vol in-8, 496 pp.,
Révolution Surréaliste, éditions J.-M. Place, Paris, 1975.
numéro 5, octobre 1925
Revue littéraire mensuelle. « André Breton », mars, 1991,
Paris, 237 p.
258
RUBIN,William Stanley, Lanchner, Carolyn. André Masson.
éditions Muséum of Modem Art, New York, 1976, 232 p.
SEBBAG,Georges. L'imprononçable jour de ma naissance llndré
13reton. éditions Jean-Michel Place, Paris, 1988 ( non
paginé)
SURYA,Michel. Georges Bataille, choix de lettres, 1917-
1962. éditions Gallimard, Paris, 1997, 610 p.
VIELWAHR,André. Sous le signe des contradictions : André
Breton de 1913 à 1924. Librairie A.-G. Nizet, Paris, 1980,
149p.
VIRMAUX,Alain et Odette. André Breton, le pôle magnétique.
éditions Olbia, 1998, 153p.
VIRMAUX,Alain et Odette. André Breton, Qui êtes-vous ?.
éditions La manufacture, Lyon, 1987, 162 p.
2.2 Ressources Internet
259
Agence de santé publique du Canada, Rapport sur les
maladies mentales au Canada, http://www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/miic-mmac/chap_3_f.html, 21 mai 2005
André Breton, Sujet, cité dans Lire André Breton à Saint-
Dizier, http://entretenir.free.fr/bretonl.html, 21 avril
2005.
André Breton, Âge cité dans Lire André Breton à Saint-
Dizier, texte de Nicolas Bersihand, Chronique d'un voyage,
http://entretenir.free.fr/breton30.html, 21 avril 2005.
Anne Rapin, Ministère des affaires étrangères, Label
France, le Magazine, II ne faut jamais réduire une personne
à son trauma, Entretiens avec le neuropsychiatre Boris
Cyrulnik,
http://www.diplomatie.gouv.fr/label_france/FRANCE/IDEES/cyr
ulnik/page.html, février 2004
Association canadienne de psychiatrie, La Schizophrénie,
http://www.cpa-apc.org/MIAW/pamphlets/Schizophrenia_fr.asp,
lOjuin 2005
260
Boris Cyrulnik, Pour une Logique absurde, Psychologies.
Corn,, http: //www.psychologies. fr/cfml/chroniqueur/c_chroniqu
eur.cfm?id=247 9&pleinepage=oui , 10 avril 2005
D. Blake Woodside, MD, MSc, FRCPC, Revue Canadienne de
Psychiatrie, http://www.cpa-
apc.org/Publications/Archives/CJP/2002/december/presadd_f.a
sp, 21 mai 2005
Étienne-Alain Hubert et Philippe Bernier, « André Breton »,
http://www.France.diplomatie.fr/culture/France/biblio/folio
/breton/, mars 2001
Emmanuel Tibloux , Georges Bataille, Association pour la
diffusion de la pensée française, Ministère des affaires
étrangères, http://www.adpf.asso.fr/adpf-
publi/folio/textes/bataille.rtf, septembre 2004
Jean-Baptiste Leroux, Le nationnalisme au lycée, cité dans
Lire André Breton à Saint-Dizier,
http://entretenir.free.fr/breton33.html, 20 mai 2005
261
Jean-Bertrand Pontalis, les vases non communicants, cité
dans Lire André Breton à Saint-Dizier,
http ://entretenir.free.fr/breton2.html, 21 avril 2005.
Marguerite Bonnet, La rencontre d'André Breton avec la
folie, Saint-Dizier, août/novembre, 1916, cité dans Lire
André Breton à Saint-Dizier,
http://entretenir.free.fr/breton3.html, 21 avril 2005.
M. Mark Turner, Série de leçons au Collège de France,
http://markturner.org/cdf.html, 21 avril 2004
Paul Valéry, Monsieur Teste^ cité dans Lire André Breton à
Saint-Dizier, http://entretenir.free.fr/breton7.html, 21
avril 2005.
Patrick Clervoy et Maurice Corcos^ « Le surréalisme,
aiguillon de la psychiatrie dynamique », Perspectives-psy,
volume 40, numéro 1, janvier-février 2001, p.50-7,
http://!95.7.123.54/edk/archive/perspect/2001/1/50-
7.html, avril 2001
Sixte Marcos, II séminaire GRES - L'écriture fragmentaire :
théories et pratiques, Artaud intime : le vide et
262
1'essence, Universitat Autônoma de Barcelona,
http://webperso.mediom.qc.ca/~extrudex/articles/gfrag-
marcos.html, 10 juin 2005
Sigmund Freud, L'interprétation des rêves, cité dans Lire
André Breton à Saint-Dizier,
http ://entretenir.free.fr/breton5.html, 21 avril 2005
Wikipédia, l'encyclopédie libre, Première Guerre Mondiale,
http://fr.wikipédia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale#
Le_bilan_catastrophique_d.27une_Europe_et_d.27un_monde_boul
evers.C3.A9s, 21 avril 2005.