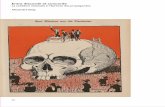Féminisme Et Droit International : Le « Féminisme De Gouvernance » À L’Épreuve Du «...
Transcript of Féminisme Et Droit International : Le « Féminisme De Gouvernance » À L’Épreuve Du «...
Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2636364
1
Féminisme et droit international : le « féminisme de gouvernance » à l’épreuve du « féminisme critique » Introduction : Retour sur un succès ........................................................................................................... 1 Le danger de la reproduction et du statu quo ........................................................................................ 6 Le danger de la mé-‐représentation et de la réinscription .............................................................. 12 Le danger de la cooptation et de l’instrumentalisation ................................................................... 18 Conclusion : Vers une transformation du droit international au contact du féminisme, et du féminisme au contact du droit international? ............................................................................... 22
Introduction : Retour sur un succès S’interroger sur la trajectoire du féminisme en droit international depuis une trentaine d’années est à bien des égards s’interroger sur la dialectique entre pouvoir et idées, changement et continuité. Avant tout, et même si l’on peut toujours discuter le détail, cette trajectoire est celle d’un remarquable succès. On est loin de l’époque où Hilary Charlesworth devait presque s’excuser (encore que de manière facétieuse) de « alienating Oscar »1. Il faut s’imaginer en effet une discipline traditionnellement andro-‐centrée, dont l’idée de genre ou même l’attention explicite au sexe est a priori bannie. Ce n’est pas un hasard si les théories féministes du droit international émergent à la relative marge du droit international historique – on pense ici au rôle qu’eurent certaines féministes australiennes (Hilary Charlesworth, Christine Chinkin, et Shelley Wright à qui on doit le premier article sur la question paru dans le AJIL)2, dans le bousculement de certaines catégories, si ce n’est de l’ordre établi, du droit international. Sans pour autant appartenir au cénacle, la pensée féministe a conquis un espace d’acceptabilité dans les conférences et les grandes revues de droit international. Non qu’il n’y ait pas de résistance : les approches féministes sont souvent, comme on le verra, acceptées pour être mieux cantonnées. Elles le sont, en outre, malgré leur profusion et formidable richesse. Et, il faut le dire, fait qui a son importance,
1 Hilary CHARLESWORTH, « Alienating Oscar-‐Feminist Analysis of International law », Stud. Transnat’l Legal Pol’y, 25, 1993, p. 1. 2 Hilary CHARLESWORTH, Christine CHINKIN et Shelley WRIGHT, « Feminist approaches to international law », American Journal of International Law, 1991, p. 613‑645.
Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2636364
2
relativement peu d’hommes, du moins au cœur de la profession, s’intéressent explicitement à la pensée féministe en droit international,3 quand ils ne lui sont pas sourdement hostiles. Bien entendu le faible intérêt que manifestent la grande majorité des juristes internationaux masculins à l’égard des conceptions féministes du droit international (et du droit en général), voire même le subtil dénigrement dont elles font l’objet, trahissent peut être paradoxalement, une reconnaissance de la pertinence des analyses féministes dans la dénonciation d’un système d’oppression : le déni, l’accusation de non-‐juridisme, le soupçon d’hystérie relèvent, à n’en point douter, d’une classique technique de domination masculine. De ce fait, la pensée féministe en droit international revêt donc parfois incontestablement l’aspect d’une sorte de ghetto doré4. Cependant, la stratégie consistant à investir dans le droit international et le saturer de références aux problèmes touchant les femmes, combinée à l’entrisme de ses lieux de pouvoir, est payée de réels dividendes (du moins selon ses propres critères qui sont, comme on le verra, relativement modestes)5. Il suffit de penser à la question des violences sexuelles en situation de conflit armé. Comme le veut un « narrative » désormais bien éprouvé en effet, le droit international s’était fortement désintéressé de la question. Les tribunaux de Nuremberg et surtout de Tokyo, alors même qu’ils avaient face à eux des épisodes de violence sexuelle de masse, firent preuve d’une remarquable capacité à regarder ailleurs. Au point d’ailleurs que la question de l’esclavage sexuel par la soldatesque japonaise pendant la Guerre deviendra une sorte d’abcès transitionnel, donnant même lieu à un effort de contre-‐justice sous la forme d’un tribunal des peuples
3 Sauf pour leur apporter la contradiction ce qui a du moins le mérite de les prendre au sérieux. Fernando R. TESON, « Feminism and international law: A reply », Va. J. Int’l L., 33, 1992, p. 647 ; Anthony D’AMATO, « Human Rights of Women: National and International Perspectives. Edited by Rebecca J. Cook. », AJIL, 89, 1995, p. 840‑852. Cette relative indifférence est parfois vérifiée y-‐compris chez les courants de pensée critique en droit international, encore que le phénomène soit moins accentué en Amérique du Nord qu’en Europe, et qu’existent incontestablement certains traits d’union. Juan AMAYA CASTRO, Feminism and International Law: Twenty Years after Charlesworth, Chinkin, and Wright, Rochester, NY, Social Science Research Network, 2011. C’est peut être finalement bien dans le « mainstream » progressiste du droit international que la réception a été la plus courtoise. Voir par exemple Aaron Xavier FELLMETH, « Feminism and International Law: Theory, Methodology, and Substantive Reform », Human Rights Quarterly, 22-‐3, 2000, p. 658‑733 ; Andrew BYRNES, « Women, Feminism and International Human Rights Law-‐-‐Methodological Myopia, Fundamental Flaws or Meaningful Marginalisation-‐-‐Some Current Issues », Australian Year Book of International Law, 12, 1989 1988, p. 205 ; Christopher C. JOYNER et George E. LITTLE, « It’s Not Nice to Fool Mother Nature-‐ The Mystique of Feminist Approaches to International Environmental Law », Boston University International Law Journal, 14, 1996, p. 223. On remarquera en outre qu’au sein des juristes internationalistes femmes, celles qui s’intéressent à la théorie féministe sont relativement peu nombreuses, et que certaines lui vouent même une franche hostilité. 4 La crainte que les « femmes » ne se retrouvent entre elles ou que les hommes se désintéressent de la question est significative dans la production d’anxiétés propres à la pensée féministe, encore que rarement explicitée. Voir tout de même Leila Nadya SADAT, « Avoiding the Creation of a Gender Ghetto in International Criminal Law », International Criminal Law Review, 11-‐3, 1 juillet 2011, p. 655‑662 ; Hilary CHARLESWORTH, « Talking to Ourselves? Feminist Scholarship in International Law », Feminist Perspectives on Contemporary International Law, 2011, p. 17‑32. D’où l’importance, d’ailleurs, de transgressions performatives comme celles qui font qu’un « homme » écrive sur la pensée féministe. Je ne suis pas sans être conscient à ce titre de ma propre subjectivité en tant qu’homme certes fortement influencé par les approches féministes mais moi-‐même produit de constructions de genre. Mon point de vue sera ici informé par une perspective non-‐essentialiste du sexe pour laquelle un dialogue sur la question de genre est une étape préliminaire à toute réforme en profondeur du droit international. La question des « hommes féministes » a fait l’objet d’amples développements théoriques en langue anglaise. Tom DIGBY, Men Doing Feminism, Routledge, 2013. Je note également que ce chapitre n’a pas de sens en dehors de mon inscription particulière à la charnière des mondes anglophones et francophones, et que je conçois ici mon rôle comme celui d’un passeur d’idées. 5 Il ne s’agit en effet pas de modifier en profondeur le droit intenrnational mais uniquement de le faire « honorer sa promesse égalitaire ». On parle par exemple de « rendre les femmes visibles », ce qui sera en effet de plus en plus chose faite. Berta Esperanza HERNANDEZ-‐TRUYOL, « Making Women Visible: Setting an Agenda for the Twenty-‐first Century », St. John’s Law Review, 69, 1995, p. 231.
3
spécifiquement consacré à la question6. En revanche, la prise en compte des violences sexuelles par les tribunaux pénaux internationaux contemporains, même s’il s’agit d’un effort à renouveler sans cesse, est presque unanimement saluée par la doctrine internationaliste. En outre, une grande partie des avancées des dernières 30 années concernent la meilleure intégration de la question des femmes au sein de la problématiques des droits humains7. Longtemps reléguées à des organes relativement isolés (Commission sur le statut des femmes par exemple) la question des droits des femmes est devenue de plus en plus centrale à l’activité d’organismes universels et régionaux de protection des droits humains. De même, un effort tout à fait significatif a été entrepris pour protéger les femmes de formes d’exploitation sexuelle transnationale8. Enfin, la question des femmes a gagné une place de choix dans l’architecture globale du maintien de la paix, comme en atteste l’attention soutenue du Conseil de sécurité, lequel a consacré pas moins de deux résolutions au sujet9. On doit bien constater l’omniprésence de la question des femmes dans le discours international, notamment onusien: toutes les organisations de la famille des Nations Unies, par exemple, jusqu’à la Banque Mondiale se sont fendues de programmes de « mainstreaming » centrés sur les droits des femmes10. Encore faut-‐il noter que ces évolutions ne sont pas tombées du ciel mais ont bien été conquises de haute lutte par les mouvements de femmes, notamment à partir de la Conférence de Pékin en 199311. Ce mouvement en apparence irrépressible prend parfois la forme d’une conquête de sanctuaires masculins lesquels semblent tomber les uns après les autres, dans un contexte où l’on ne compte plus les exemples de « féminisation » professionnelle. C’est ce que certaines comme Janet Haley ont appelé, avec une certaine malice (car elle sous-‐entend que le pouvoir était recherché comme tel), le « governance feminism » (et que d’autres, avec encore plus de mordant, ont
6 C. M. CHINKIN, « Women’s International Tribunal on Japanese Military Sexual Slavery », American Journal of International Law, 2001, p. 335‑341. 7 Charlotte BUNCH, « Women’s rights as human rights: Toward a re-‐vision of human rights », Human Rights Quarterly, 1990, p. 486‑498 ; Hilary CHARLESWORTH, « What are ‘women’s international human rights’? », Human rights of women: National and international perspectives, 58, 1994, p. 61. 8 David R. HODGE et Cynthia A. LIETZ, « The International Sexual Trafficking of Women and Children A Review of the Literature », Affilia, 22-‐2, 2007, p. 163‑174 ; M. DONNA, « The“ Natasha” trade: The transnational shadow market of trafficking in women », Journal of international Affairs, 53-‐2, 2000, p. 625‑651. 9 Susan WILLETT, « Introduction: Security Council Resolution 1325: assessing the impact on women, peace and security », International Peacekeeping, 17-‐2, 2010, p. 142‑158 ; Amy BARROW, « UN Security Council Resolutions 1325 and 1820: constructing gender in armed conflict and international humanitarian law », International Review of the Red Cross, 92-‐877, 2010, p. 221‑234. 10 Elissavet STAMATOPOULOU, « Women’s rights and the United Nations », in Julie PETERS et Andrea WOLPER (éd.), Women’s Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives, Psychology Press, 1995, . 11 Elisabeth FRIEDMAN, « Women’s human rights: The emergence of a movement », Women’s rights, human rights: International feminist perspectives, 1995, p. 18‑35 ; Jutta JOACHIM, « Framing issues and seizing opportunities: The UN, NGOs, and women’s rights », International Studies Quarterly, 47-‐2, 2003, p. 247‑274 ; Felicity HILL, Mikele ABOITIZ et Sara POEHLMAN-‐DOUMBOUYA, « Nongovernmental organizations’ role in the buildup and implementation of Security Council Resolution 1325 », Signs, 40-‐1, 2014.
4
appelé le « embedded feminism »12), un féminisme en apparence parvenu, ou du moins étroitement associé aux cercles du pouvoir, et confiant en sa vocation historique.13 Mais au moment même où le féminisme paraît dominant, un mouvement de reflux se manifeste, assez minoritaire il est vrai, par rapport à certains des risques que font courir pour le féminisme son engagement avec les structures du droit international. Quel est en effet le bilan du féminisme en droit international ? Quelle est au juste la différence entre critique féministe du droit international et défense des droits des femmes ? Et si le droit international n’avait pris en compte la question des femmes que pour mieux aseptiser la critique féministe ? On perçoit comme une sorte d’ « effroi » face au succès d’une pensée désormais normalisée et, en quelque sorte, présente à toutes les sauces dans la vulgate internationaliste. Il est loin d’être évident, notamment, que les structures du pouvoir aient retenu de la critique féministe ce qu’elle avait de plus novateur et même de radical14. Tout se passe en effet comme si, au bord du succès, le mouvement marquait un moment de recul et d’hésitation, comme si ce succès devait se payer d’un prix trop élevé, d’un prix à la limite difficilement supportable. Les manifestations de ce doute lancinant abondent dans une petite littérature principalement anglo-‐saxonne15 émanant de féministes en droit international de longue date, souvent largement impliquées dans certaines luttes féministes (mais aussi, il faut le souligner, LGBT et queer), et dont le désarroi prend parfois une tonalité toute personnelle. Diane Otto parle ainsi du « exile of inclusion »16, le sentiment doux-‐amer d’un « succès » qui engendrerait sa propre aliénation et appellerait, au minimum, à être éminemment problématisé. Ce chapitre s’intéressera surtout à ce mouvement de « retour critique féministe sur les théories féministes » que l’on décrit parfois aux Etats-‐Unis sous le vocable de « post-‐féminisme » ou « néo-‐féminisme »17 mais que l’on pourrait aussi qualifier de « féminisme révisionniste » (même si le label a été utilisé pour décrire des féministes conservatrices), « féminisme critique » ou « féminisme de troisième (ou quatrième) vague »18. Cette forme de féminisme, parcourue de multiples nuances et sensibilités par ailleurs, pourrait être décrite comme traduisant une volonté
12 Krista HUNT, « “Embedded feminism” and the War on Terror », En) Gendering the war on terror: War stories and camouflaged politics, 2006, p. 51‑71. 13 Janet HALLEY, Prabha KOTISWARAN, Hila SHAMIR et Chantal THOMAS, « From the international to the local in feminist legal responses to rape, prostitution/sex work, and sex trafficking: Four studies in contemporary governance feminism », Harv. JL & Gender, 29, 2006, p. 335. 14 Karen ENGLE, « International Human Rights and Feminisms: When Discourses Keep Meeting », in Doris BUSS et Ambreena S. MANJI (éd.), International Law: Modern Feminist Approaches, Oxford, Hart Publishing, 2005, p. 47. 15 On ne s’attardera pas sur les raisons qui font que cette sensibilité est sous-‐représentée en langue française si ce n’est pour relever le caractère encore naissant de l’approche féministe du droit et a fortiori du droit international d’une part, et le caractère dominant d’une approche féministe républicaine et égalitaire assez éloignée des considérations de la « politique identitaire » américaine. Pour des éléments d’éclaircissement on consultera Éléonore LEPINARD, « Malaise dans le concept », Cahiers du Genre, 39-‐2, 1 novembre 2005, p. 107‑135 ; Christine VERSCHUUR, Genre, postcolonialisme et diversité des mouvements de femmes, L’Harmattan; Genève, 2010 ; Elsa DORLIN, « L’Atlantique feministe. L’intersectionnalité en débat », Papeles del CEIC, 2-‐83, 2012, p. 1‑16. 16 D. OTTO, « Exile of Inclusion: Reflections on Gender Issues in International Law over the Last Decade, The », Melb. J. Int’l L., 10, 2009, p. 11. 17 Aya GRUBER, « Neo-‐Feminist Assessment of Rape and Domestic Violence Law Reform, A », Journal of Gender, Race & Justice, 15, 2012, p. 583. 18 On contraste souvent le féminisme de première vague (libéral, inclusif, tourné vers la sphère publique), au féminisme de seconde vague (critique, centré sur le biais structurel et la sphère privée), et éventuellement au féminisme de troisième vague (centré sur l’intersectionnalité, la critique raciale).
5
de se retourner en même temps contre les compromissions du féminisme libéral avec le pouvoir, contre l’essentialisme du féminisme culturel, et contre l’insistance absolue sur la subordination sexuelle du féminisme radical. Le champ de la contradiction peut paraître large, mais c’est peut être justement parce que ces trois grandes écoles du féminisme semblent balayer, jusque dans leurs contradictions, l’ensemble du champ féministe qu’elles excluent d’autant mieux une sensibilité critique autre19. Mouvement qui entend avant tout porter la contradiction, le post-‐féminisme se caractérise par sa propension à utiliser certains outils forgés par la pensée féministe elle-‐même contre la pensée féministe dominante. Formées à l’école de la post-‐modernité, du post-‐structuralisme et du scepticisme par rapport aux « grand narratives », ses théoriciennes mettent volontiers en avant la multiplicité des manières d’être femme et le rôle de la subjectivité dans la construction de l’identité. Leur approche est aussi le fruit d’un double débordement qui enrichit formidablement la problématique féministe tout en la minant quelque peu. D’une part, s’y adjoint une critique inspirée par le « black feminism »20 par exemple qui s’incarne et se renouvelle au niveau international dans une sensibilité tiers-‐mondiste elle-‐même déjà très aiguisée21, et qui met volontiers en avant la domination des écrits « blancs féministes » dans la production intellectuelle globale. Il est vrai que l’international est le lieu par excellence de la diversité et que l’idée d’un féminisme universel risque d’y être sérieusement mise à mal, même si par la même occasion les schèmes universalites du droit international constituent incontestablement un obstacle à une prise de conscience. D’autre part, la théorie féministe s’enrichit et est contestée, d’abord au contact d’une sensibilité LGBT puis des théories « queer » lesquelles commencent également à recevoir un certain écho en droit international22. L’influence cumulée de ces critiques est de problématiser la notion d’oppression et de déplacer l’attention d’une domination masculine intentionnelle et consciente vers un examen des structures – notamment juridiques, bien sûr – d’oppression. Comment expliquer l’apparition de cette sensibilité révisionniste au moment même où le mouvement semble atteindre certains de ses objectifs ? Sans doute en partie, comme on le verra, par le caractère malgré tout très partiel des résultats obtenus : on est bien
19 Nicola PRATT, « Reconceptualizing Gender, Reinscribing Racial–Sexual Boundaries in International Security: The Case of UN Security Council Resolution 1325 on “Women, Peace and Security” 1 », International Studies Quarterly, 57-‐4, 2013, p. 772‑783. 20 Hazel CARBY, « White woman listen! Black feminism and the boundaries of sisterhood », The Empire Writes Back: Theory and Practice in Postcolonial Literatures, 1982, p. 61‑86 ; Heidi Safia MIRZA, Black British feminism: A reader, Taylor & Francis, 1997. 21 On n’en concluera pas pour autant que féminisme critique et TWAIL sont solvables. Le TWAIL en tant que tel reste d’ailleurs un mouvement assez masculin même si l’apport des consoeurs féministes est souvent noté. James Thuo GATHII, « TWAIL: A Brief History of Its Origins, Its Decentralized Network, and a Tentative Bibliography », Trade, Law and Development, 3, 2011, p. 26.Sur la complexité des rapports entre les deux voir Dianne OTTO, « The Gastronomics of TWAIL’s Feminist Flavourings: Some Lunch-‐Time Offerings », International Community Law Review, 9-‐4, 2007, p. 345‑352. Pour une approche TWAIL d’une problématique féministe, voir Mosope FAGBONGBE, « The Future of Women’s Rights from a TWAIL Perspective », International Community Law Review, 10-‐4, 2008, p. 401‑409. 22 Dianne OTTO, « “ Taking a Break” from“ Normal”: Thinking Queer in the Context of International Law », JSTOR, 2007 ; Ralph WILDE, « Queering International Law », Am. Soc’y Int’l L. Proc, 101, 2007, p. 119 ; Doris E. BUSS, « Queering International Legal Authority », JSTOR, 2007 ; Anna CARLINE et Zoe PEARSON, « Complexity and Queer Theory Approaches to International Law and Feminist Politics: Perspectives on Trafficking », Canadian Journal of Women and the Law, 19-‐1, 2007, p. 73‑118 ; Aeyal M. GROSS, « Sex, Love, and Marriage: Questioning Gender and Sexuality Rights in International Law », Leiden Journal of International Law, 21-‐01, 2008, p. 235‑253.
6
loin, c’est le moins qu’on puisse dire, d’une abolition du patriarcat tel qu’il s’incarne dans les figures du droit international. Sans doute également en partie du fait du caractère intraitable de la pensée féministe par rapport à elle-‐même : les féministes internationalistes ont souvent été leurs meilleures critiques et le champ se caractérise par un foisonnement des tendances et des débats parfois violents, bien loin des discours feutrés du droit international. Peut-‐être enfin parce que la spécificité du féminisme dans le champ des approches du droit international a toujours été d’être une théorie à forte connotation normative et même politique, laquelle se donne un véritable objectif de changement. C’est pourquoi le féminisme est bien inévitablement en même temps une théorie et une pratique, un pensé et un vécu tant et si bien qu’on pourrait dire que l’engagement des féministes dans le monde est aussi un extraordinaire laboratoire en temps réel de leurs théories. Au risque, bien entendu, de déconvenues, là où le formalisme positiviste par exemple s’est toujours bien gardé du même investissement explicite dans le réel (ou dans la force créative de la théorie, d’ailleurs). On s’attellera dans ce chapitre à mettre en exergue plus spécifiquement trois dangers que l’on retrouve au cœur de ce féminisme désabusé ou en tous les cas ambivalent par rapport aux potentialités émancipatrices du droit international : le danger de la reproduction et du statu quo (I), le danger de la mé-‐representation et de la réinscription (II) et, enfin, le danger de la cooptation et de l’instrumentalisation (III). Ces trois dangers sont un des principaux ressort de la pensée féministe critique et permettent plus généralement de s’interroger sur le rapport entre théories critiques et droit international, sur la nature du pouvoir des idées et de l’exercice du pouvoir « tout court », et sur l’évolution du féminisme selon ses propres termes et en interaction avec les formes de la juridicité modernie. Ils contiennent des enseignements utiles pour le féminisme bien sûr mais aussi révélateurs pour tout mouvement aux aspirations émancipatrices mais qui se doit d’être attentif à ses effets pervers.
I. Le danger de la reproduction et du statu quo La pensée féministe internationaliste critique s’attelle tout d’abord à un apparent mystère : comment une pensée en apparence si influente semble-‐t-‐elle accoucher d’aussi peu de changements dans le monde réel ? Le « mainstreaming » en particulier, si en vogue aux Nations Unies, débouche souvent sur une absorption bureaucratique des tics langagiers du féminisme sans engagement plus profond avec ses thèmes de prédilection, lorsqu’il n’est pas franchement évité par les organes de protection des droits de l’homme23. D’autres sont préoccupées de ce que malgré deux décennies d’efforts jamais démentis pour aboutir à une meilleure prise en compte des violences sexuelles par les tribunaux pénaux internationaux, celle-‐ci demeure extrêmement parcellaire et les occasions manquées abondent, dans un contexte où « hyper-‐visibilité » et « invisibilité » de ces violences coexistent24. La « femme » est partout, mais elle ne serait en réalité nulle part, et certainement pas au cœur des préoccupations « sérieuses » des grands
23 Hilary CHARLESWORTH, « Not Waving but Drowning: Gender Mainstreaming and Human Rights in the United Nations », Harvard Human Rights Journal, 18, 2005, p. 1. 24 Doris E. BUSS, « Rethinking ‘rape as a weapon of war’ », Feminist legal studies, 17-‐2, 2009, p. 145‑163 ; Binaifer NOWROJEE, « Making the invisible war crime visible: post-‐conflict justice for Sierra Leone’s rape victims », Harv. Hum Rts. J., 18, 2005, p. 85.
7
notables du droit international. Le droit international condamne-‐t-‐il à rendre invisible tout ce qu’il ne rend pas visible ? A ce titre, l’étiquette apposée au « féminisme de gouvernance » est fortement contestée par celles qui considèrent que, de fait, la révolution est bien loin d’être achevée et qu’il est un peu fort de vouloir leur reprocher l’exercice d’un pouvoir qu’elles sont encore loin d’avoir atteint25. Tout porte en effet à penser que le changement idéologique demeure très peu traduit dans la réalité du terrain. Mais justement, s’agit-‐il de faire preuve d’encore plus de persistance dans le même sens afin d’achever une révolution à peine ébauchée, les pratiques devant immanquablement, à terme, s’aligner sur les discours ? Ou au contraire les féministes internationalistes se sont-‐elles trompées d’interlocuteur ou de cible, s’en seraient remettant à une forme de pensée magique où la promesse institutionnelle pour les libérales ou l’aspect sémantique du « identity politics » pour les radicales tiendrait lieu de politique? Il convient ici de lever d’emblée plusieurs équivoques entre « cause des femmes » ou « droits des femmes » d’une part, et théories féministes d’autre part. Remarquons tout d’abord que le combat pour la cause des femmes est relativement ancien et s’est longtemps, en apparence du moins, assez bien accommodé des modes de fonctionnement dominants du droit international. De la lutte contre la « traite des blanches » par la Société des Nations à la création de la Commission sur le statut des femmes et l’adoption en 1979 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination contre les femmes, la cause des femmes n’est pas exactement inconnue des sites du multilatéralisme international, même si de toute évidence elle ne leur est pas exactement centrale non plus. Les approches féministes du droit international, en tant qu’approche théoriques, sont en revanche de facture relativement récente (environ 1990), même à l’échelle de la pensée féministe, voire de son application au droit. Elles s’exposent donc au reproche de n’avoir rien inventé, d’arriver après la bataille, ou encore de pouvoir – et peut être devoir -‐ se fondre dans une série de cadres juridiques et institutionnels existants.26 C’est bien ainsi d’ailleurs que certaines et certains l’entendent, peut-‐être au risque de voir le mouvement s’essouffler assez vite, victime en quelque sorte de son succès. Car en effet une équivoque plus profonde que celle évoquée ci-‐dessus apparaît. Le combat en droit international pour ce que l’on appellera très généralement la « cause des femmes » n’est pas la même chose que les approches féministes du droit international. Il s’exerce même entre les deux une tension certaine. Le premier est marqué par une confiance réelle (ou en tous les cas nécessaire) dans la capacité réformatrice d’un droit international qui aurait plus ou moins accidentellement « omis » de traiter les questions d’égalité des sexes avec le sérieux qu’elles méritait et se mettrait sur le tard, quelque peu contrit, à rattraper le temps perdu tout en demeurant lui-‐même non réformé – ce que Adrian Howe a décrit comme « a touching faith that a gendered approcach can be simply added to the dominant masculinist one »27. Il a donc une tonalité fortement réformiste et historiquement optimiste. Les secondes, si elles sont 25 H. CHARLESWORTH, « Talking to Ourselves? Feminist Scholarship in International Law »..., op. cit. 26 Nathaniel A. BERMAN, « Power and Irony, or, International Law after the Apres-‐Guerre », in Emmanuelle JOUANNET, H. RUIZ-‐FABRI et J. M. SOREL (éd.), Regards d’une génération de juristes sur le droit international, Paris, Pedone, 2008, . 27 Adrian HOWE, « White Western Feminism Meets International Law: Challenges/Complicity, Erasures/Encounters », Australian Feminist Law Journal, 4, 1995, p. 63.
8
bien sûr toutes entières tournées vers l’amélioration du statut des femmes (encore que leur ambition s’étende souvent également à une meilleure prise en compte de la problématique de genre en général), sont avant tout une forme d’intervention théorique par rapport au droit international comme champ de connaissance et de pouvoir qui en met en exergue ses limitations et angles morts28. Parmi ces interventions théoriques, en outre, certaines sont relativement compatibles avec la simple défense des droits des femmes, c’est le cas notamment du féminisme libéral dit de « première génération ». En outre, le féminisme théorique a incontestablement forgé beaucoup des outils d’intervention du féminisme pratique depuis des décennies, au point que les deux se nourrissent mutuellement. Mais la majorité de la pensée féministe en droit international constitue bien une intervention critique dans la tradition des approches critiques du droit29: même si le sort des femmes demeure le point de mire, la mise en cause d’un droit international genré telle se veut beaucoup plus vaste et novatrice que le seul souci des « droits des femmes ». Au point d’ailleurs que la féministe « activiste » empruntant les chemins balisés du droit international et la féministe « critique » sceptique par rapport ces chemins comme autant d’impasses se retrouvent souvent en porte à faux. De fortes tensions existent entre un féminisme de l’action et un féminisme des idées, celui consistant à « penser utile » et celui consistant à « penser bien »30. Il convient bien sûr de ne pas se tromper sur l’économie de pouvoir entre elles, le féminisme de gouvernance demeurant largement le plus puissant, et étant capable, fort de son alliance objective avec une forme de pouvoir masculin, de faire des remontrances au « dilettantisme » des intellectuelles31, rejoignant ainsi presque certaines critiques du « mainstream »32 dans
28 Les féministes théoriciennes du droit international ont d’ailleurs à cœur que leur critique ne soit pas reléguée à l’idée d’une « meilleure prise en compte des femmes », ce qui relativiserait fortement la portée théorique de leur apport (ce projet pouvant de prime abord paraître tout à fait soluble dans un droit international inchangé). Voir par exemple Hilary CHARLESWORTH et Christine CHINKIN, The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis, Manchester, Oxford University Press, 2000. 29 A ce titre, l’un des enjeux est de savoir qui peut revendiquer l’étendard de la « critique » féministe au niveau international. Il y a une ambiguïté sur le sens du vocable « critique », notamment en langue française qui ne distingue pas « criticism » et « critique ». Voir par exemple Frédéric MEGRET, « International Criminal Justice: A Critical Research Agenda », in Christine SCHWOBEL (éd.), Critical Approaches to International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2014, . Il existe une vraie sensibilité au sujet de ce qui est labélisé comme relevant de l’un ou de l’autre. D’une certaine manière, tout féminisme est critique, ou du moins il l’est à ses débuts et dans la plupart des circonstances historiques où le féminisme a jailli. Mais le féminisme n’est pas nécessairement critique. Il peut par exempledevenir un mode de relations dominantes mettant en exergue la supériorité de certaines qualités féminines ; ou il peut plus plausiblement, comme on le verra dans ce chapitre, se prêter ou prêter son nom à des visées oppressives ou hégémoniques. 30 La controverse ayant parfois connu des sommets d’hostilité. Voir Martha NUSSBAUM, « The professor of parody », The New Republic, 22-‐2, 1999, p. 37‑45. La controverse est fréquemment reproduite au contact du droit international, discipline qui souvent conçue comme éminemment pas « pratique » par les juristes. Pour une réponse caractéristique de la sensibilité qui fait l’objet de ce chapitre, voir Ratna KAPUR, « Imperial parody », Feminist Theory, 2-‐1, 1 avril 2001, p. 79‑88. 31 M. NUSSBAUM, « The professor of parody »..., op. cit. Il est sans doute vrai que le féminisme liberal s’est senti particulièrement menacé par le féminisme critique au point de déclencher des réflexes de défense violents, à la mesure de la menace qu’est perçue comme faisant peser la critique (qui, elle-‐même, est parfois mordante). Pourtant, il est important de remarquer que le féminisme critique est une critique des structures, notamment discursives, et donc tend à se garder d’une analyse ad hominem (si j’ose dire) pour se concentrer sur la manière dont ce sont, par exemple, les “categories” de la pensée qui colonisent. 32 Voir par exemple, l’injonction par deux internationalistes masculins aux féministes de ne pas se perdre dans des quêtes par trop subjectives en rejoignant les « preneurs de décision ». B. SIMMA et A. L. PAULUS, « The Responsibility of Individuals for Human Rights Abuses in Internal Conflicts: A Positivist View », The American Journal of International Law, 93-‐2, 1999, p. 302‑316.
9
un troublant parallélisme de la disqualification. De fait, pour certaines féministes l’étalage des dissenssions entre « sœurs » serait, pour faire simple, ce qu’attend le patriarcat et il conviendrait de faire front par le biais d’une sorte de « complot du silence » théorique privilégiant l’action33 : ce serait a fortiori le cas dans un après 11 septembre où le fémisme est sollicité avec insistance et ne doit pas manquer une occasion historique de participer aux destinées du monde34. A ce titre, peut être convient-‐il de distinguer entre les progrès accomplis par la « cause des femmes », laquelle a incontestablement acquis une certaine centralité en droit international, et la pensée féministe comme telle, laquelle demeure d’une influence marginale. Hillary Charlesworth déplorait ainsi que si les féministes s’imaginent avoir une « conversation » avec le cœur de la discipline juridique internationale, cette conversation est « almost completely onesided » à tel point que « feminist scholarship is an optional extra, a decorative frill on the edge of the discipline »35. De fait, il demeure d’autant plus difficile d’adresser aux juristes internationaux une critique de leur machisme que la discipline se conforte dans une image d’elle même vertueuse et cosmopolite36 et d’autant qu’elle manifeste superficiellement des gestes de bienveillance à l’égard de la cause des femmes. C’est sans doute malgré tout dans le rapport entre le relatif insuccès de l’approche activiste réformiste et la relative marginalisation des approches critiques féministes que se joue un des ressorts de la pérennité du pouvoir masculin en droit international. Car le principal reproche adressé au féminisme « première génération », fortement ancré et investi dans le droit international, avait déjà été le danger (ou en tous cas la futilité) de « employ the master’s tools to dismantle the master’s house »37 ou, pour utiliser une expression encore plus acide, « add women and mix »38. Au risque de faire paraître la pensée féministe comme une sorte de vague plaidoyer pro domo féminin pour être mieux « prises en compte » par les hommes qui, en faisant fi des biais structurels, se condamne au sur-‐place. Au risque, en outre, comme le soulignent très tôt les féministes de « seconde génération », de reproduire certains des biais du droit que l’on conteste, biais fortement implicites mais presque invariablement andro-‐centrés. Il faut reconnaître que le dilemme est lancinant, car il ne semble laisser de place que pour une improbable action révolutionnaire. Moyennant quoi, en frappant à la porte du droit international, incontestablement, le féminisme en valide l’importance comme site de luttes de pouvoir symboliques et
33 A. HOWE, « White Western Feminism Meets International Law »..., op. cit., p. 69‑70. Heureusement des exemples de dialogue entre « activistes » et « intellectuelles » existent, même s’ils ne sont pas libres de ce genre d’accrochage. Carol COHN, Helen KINSELLA et Sheri GIBBINGS, « Women, Peace and Security Resolution 1325 », International Feminist Journal of Politics, 6-‐1, 2004, p. 130‑140. 34 Pour une critique voir Karen BECKMAN, « Feminism in the Time of Violence », in Elizabeth A. CASTELLI et Janet R. JAKOBSEN (éd.), Interventions: activists and academics respond to violence, 2004, . 35 Hilary CHARLESWORTH, « Feminist Travels in International Law », Pandora’s Box, 2013, p. 21‑25. 36 Ruth BUCHANAN et Sundhya PAHUJA, « Collaboration, cosmopolitanism and complicity », Nordic Journal of International Law, 71-‐2, 2002, p. 297‑324. 37 Diane OTTO, « Securing the gender legitimacy of the UN Security Council: prising gender from its historical moorings », in Hilary CHARLESWORTH et Jean-‐Marc COICAUD (éd.), Fault Lines of International Legitimacy, Cambridge University Press, 2010, p. 239. 38 Judith Gail GARDAM et Hilary CHARLESWORTH, « Protection of women in armed conflict », Human Rights Quarterly, 22-‐1, 2000, p. 148‑166.
10
réelles, mais aussi potentiellement comme idéal de régulation et de justice. Il vient donc en renforcer l’assise, alors que celle-‐ci est par ailleurs vigoureusement contestée par toute une tradition d’auteurs critiques39. Non pas que cette stratégie ne puisse pas être payante à l’intérieur de certaines limites, on l’a vu. On pourra par exemple contester, à l’intérieur même du paradigme du droit international, le fait que les questions de « statut des femmes » ne soient pas traitées comme des questions de droits mais de « policy » ; ou qu’elles soient traitées comme des questions de « droits des femmes » plutôt que de « droits humains »40. Mais quand bien même la victoire d’une reconnaissance des « droits des femmes » aura-‐t-‐elle été obtenue, n’aura-‐t-‐on pas par la même occasion renforcé la grammaire juridique des droits comme discours lui-‐même foncièrement problématique et limitatif41, a fortiori pour les femmes ? En définitive, les victoires symboliques de l’intégration dans le droit international, pour importantes qu’elles soient, demeurent éminemment problématiques si elles constituent l’ensemble du défi posé au droit international par le féminisme. Nombreuses en outre sont celles qui déplorent le décalage (croissant ?) entre présence sémantique de la question des femmes au cœur du droit international, et continuité des pratiques en leur défaveur. Tout se passe comme si le droit international disposait d’une remarquable capacité d’intégration des discours critiques mais que, sitôt absorbés, ces discours n’étaient que de très peu d’effet sur la réalité ; comme si, peut être, le prix de l’inclusion dans le discours internationaliste était d’abandonner les prétentions les plus radicales à réformer le système juridique international. En particulier, l’insistance sans plus sur la question de la participation des femmes dans les instances du droit international – aussi légitime qu’elle soit en tant que telle42 – pose la question de savoir, à quoi au juste il s’agit de participer ? S’agit-‐il de participer à des institutions et processus aux biais non-‐réformés au risque de faire du sur-‐place, ou à idéaliser la présence des femmes comme aboutissant nécessairement à un changement du droit 43? Et qui participera, étant entendu que la participation d’une femme n’est pas une garantie de féminisation ou même « féminismisation », sans parler du risque de cooptation d’une petite élite féministe globale ou du « outsourcing » opportuniste de certaines questions aux femmes44? 39 M. KOSKENNIEMI, The gentle civilizer of nations: the rise and fall of international law, 1870-‐1960, Cambridge Univ Pr, 2002. 40 A. S. FRASER, « Becoming Human: The Origins and Developments of Women’s Human Rights », Hum. Rts. Q., 21, 1999, p. 853. J’utilise à dessein et avec enthousiasme l’expression de « droits humains » en tant que néo-‐canadien, mais elle m’évoque le souvenir d’un moment un peu pénible lorsque, invité au Collège de France il y a quelques années pour présenter une allocution lors d’une conférence, et ayant utilisé l’expression, je fus repris par un collègue plus âgé qui m’expliqua de manière fort condescendante « qu’ici » on disait « droits de l’homme ». L’usage d’un argument d’autorité trahissait le fait que pas un seul instant il ne lui était apparu que mon geste (si peu) transgressif avait pu manifester un positionnement politique. 41 Frédéric MEGRET, « Where Does the Critique of International Human Rights Stand? An Exploration in 18 Vignettes », in New Approaches to International Law, Springer, 2013, p. 3‑40. 42 Nienke GROSSMAN, « Sex on the Bench: Do Women Judges Matter to the Legitimacy of International Courts? », Chicago Journal of International Law, 12, 2012, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1773015 ; N. GROSSMAN, « Sex Representation on the Bench and the Legitimacy of International Criminal Courts », International Criminal Law Review, 11, 2011, p. 643‑653. 43 Stéphanie Hennette VAUCHEZ, « More Women–But Which Women? The Rule and the Politics of Gender Balance at the European Court of Human Rights », European Journal of International Law, 26-‐1, 2015, p. 195‑221 ; Fionnuala Ní AOLAIN, « More Women – But Which Women? A Reply to Stéphanie Hennette Vauchez », European Journal of International Law, 26-‐1, 1 février 2015, p. 229‑236. 44 Olivera SIMIC, « Does the presence of women really matter? Towards combating male sexual violence in peacekeeping operations », International Peacekeeping, 17-‐2, 2010, p. 188‑199.
11
On reconnaîtra ici une critique qui est également typique des TWAIL, déplorant, avec plus de recul, l’absorption par le droit international du discours de l’auto-‐détermination et de la décolonisation mais confrontée à la pérennité du phénomène post-‐colonial. On pense également à la critique qu’a fait d’une manière plus générale Martti Koskenniemi du « mainstreaming »45. Le mainstreaming consiste en effet à fondre un discours à l’intérieur des catégories d’un autre. Il en résulte un transfert de pouvoir car, désormais, un autre locuteur est investi de l’autorité pour parler « au nom » d’une cause. Par exemple, pour Koskenniemi l’agenda de « mainstreamisation » des droits humains aboutit à ce que ceux-‐ci soient largement absorbés par un ordre de priorité onusien. Or le locuteur en question est souvent l’expert, le juriste ou encore le technocrate, figures inamovibles (et souvent genrées) de l’exercice du pouvoir, maniant avec habileté un discours où se mêlent formalisme, instrumentalisme (pondération des intérêts, rationalité économique, etc) et même autoritarisme. En quelque sorte, en confiant le sort des femmes aux organisations internationales, les féministes n’auraient fait que renforcer le statut de « ceux » qui veillent sur elles. Ce sont en outre les catégories mêmes du droit international qui tendent à désamorcer la critique. Peut-‐être un des exemples les plus éclatant est l’acceptation parfois inconditionnelle par certaines défenseuses de la cause des femmes du langage des « droits humains », notamment dans sa variante juridique internationale. Pour les féministes critiques, en effet, l’accumulation de traités et de lois ne saurait à elle seule être un gage de progrès, et pourrait même se retourner parfois contre celles auxquelles elle est censée bénéficier46. Le discours des droits est indissociablement lié et reproduit un biais universaliste particulièrement puissant lequel est « part of the problem »47 car il n’aide pas à prendre en compte les spécificités de la condition féminine. De même, un paradigme de la justice transitionnelle trop libéral et axé sur l’égalité ne permet guère à la pensée féministe de s’attacher à la constitution de sites culturels, matériels ou géopolitiques aux implications majeures pour les femmes48. Enfin, le discours de la participation et de l’inclusion des femmes aux efforts de paix laisse entièrement hors de son espace critique l’ensemble de l’architecture internationale de sécurité qui fait que la violence est perçue comme légitimée, notamment lorsqu’elle est pratiquée par certains. Or le féminisme se désarmerait analytiquement lui-‐même en adoptant une attitude humanitaire et juridicisante qui considère la problématique de la violence faite contre les femmes en conflit armé uniquement à travers le prisme de la protection des victimes ou d’un déficit de participation aux instances décisionnelles, et non pas à travers la contestation de le guerre même49. 45 Martti KOSKENNIEMI, « Human Rights Mainstreaming as a Strategy for Institutional Power », Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development, 1-‐1, 2010, p. 47‑58. Egalement H. CHARLESWORTH, « Not Waving but Drowning »..., op. cit., p. 17‑19. 46 Ratna KAPUR, « Revisioning the role of law in women’s human rights struggles », in Saladin MECKLED-‐GARCIA et Basak ÇALI (éd.), The Legalization of Human Rights: Multidisciplinary Perspectives on Human Rights and Human Rights Law, Routledge, 2006, . 47 D. KENNEDY, « International Human Rights Movement: Part of the Problem? », Harv. Hum. Rts. J., 15, 2002, p. 101‑125. 48 Fionnuala Ní AOLAIN, « Advancing Feminist Positioning in the Field of Transitional Justice », International Journal of Transitional Justice, 29 mai 2012, p. ijs013. 49 Carol COHN, « Mainstreaming Gender in UN Security Policy: A Path to Political Transformation? », in Shirin M. RAI et Georgina WAYLEN (éd.), Global Governance: Feminist Perspectives, New York, Palgrave Macmillan, 2008, .
12
Il ne serait pas possible, donc, de faire fondamentalement avancer la condition de la femme avec des outils juridiques forgés dans le libéralisme internationaliste à dominante androcentrique. C’est là tout le danger de se concentrer sur la cause (disons, le statut des femmes) sans se prévaloir pleinement de la critique théorique (disons, le caractère andro-‐centré du droit). Le reproche de la futilité d’une inclusion des femmes qui ne serait pas doublée d’une révolution en profondeur du droit international est, il est vrai, déjà l’intuition majeure des féministes de seconde génération50, centrée sur le biais structurel. La différence est peut être que là où les féministes de seconde génération entrevoient la possibilité de s’emparer du bastion internationaliste par la critique et la reconstruction du droit international, celles de troisième et quatrième génération ont toutes les raisons d’être encore plus dubitative, à l’aune de leur analyse de la reproduction des biais structurels au travers de pratiques discursives sans cesse reconstituées. La relative inefficacité de la réforme féministe du droit international, en réalité, importe moins en elle même ou par ce qu’elle suggère de force de résistance du droit, que pour ce qu’elle trahit de tiraillements au sein du féminisme lui-‐même.
II. Le danger de la mé-‐représentation et de la réinscription Un des principaux axes de sensibilité de la pensée féministe révisionniste est la dimension culturelle et symbolique du droit, et le risque de reproduire, par le biais discursif, des topoi patriarcaux au nom de la « protection des femmes ». Là où la pensée libérale privilégie l’effectivité et l’instrumentalité, la pensée critique, pour faire simple, est sensible à l’impact global, y-‐compris en termes d’une subtile économie de la représentation, d’initiatives féministes sur la question du genre51. En grande partie, les mouvements féministes dits de « deuxième génération » ont voulu sortir la femme de l’« invisibilité » à laquelle la reléguait la sphère privée. Mais cette représentation comporte ses risques, surtout si l’accent est mis sur la dimension quantitative plus que qualitative et les subtiles manières dont la représentation de « celles » au nom de qui on parle peut saper certains objectifs féministes. Par exemple, l’objectif « productiviste » de faire inclure le plus d’accusations possibles en matière de violence sexuelle devant les tribunaux pénaux internationaux peut se retourner contre lui-‐même si les représentations qui en résultent donnent de la femme une vision particulièrement problématique. Or à n’en point douter, derrière l’apparence du changement des discours, se glissent de subtiles équivoques terminologiques. D’une manière générale, le droit international tend à représenter ce qui doit être considéré comme le plus problématique dans le destin des femmes. Le droit international pénal, notamment, fait partie intégrante d’une « politics of knowledge » mettant en avant les souffrances les plus dignes d’une attention prioritaire (une « grammar of pain » pour utiliser l’expression de Fiona Ross52), ainsi que les raisons qui
50 Hilary CHARLESWORTH, « Feminist Methods in International Law », The American Journal of International Law, 93-‐2, avril 1999, p. 379‑394. 51 C. COHN, « Mainstreaming Gender in UN Security Policy: A Path to Political Transformation? »..., op. cit. 52 Fiona C. ROSS, Bearing witness: women and the truth and Reconciliation Commission in South Africa, Pluto Press, 2003.
13
ont provoqué ces souffrances53. L’attention unique portée aux violences sexuelles pourra ainsi tendre à masquer d’autres types de violence ou d’autres problèmes de discrimination dont pâtissent les femmes ; le fait de se concentrer sur les responsabilités individuelles pourra avoir l’effet de conduire à sous-‐estimer le caractère structurel de la violence sexuelle ; enfin, la justice pénale internationale n’offrirait guère aux femmes victimes de perspective thérapeutique et pourrait même dans certains cas les laisser dans de pires conditions qu’elle ne les a trouvées54. Tout cela ne devrait à la limite n’être qu’un appel à plus de réformes bien conçues. Mais si l’on dénonce le droit international comme modalité de savoir/pouvoir, c’est peut être aussi qu’il faut être près à envisager le féminisme internationaliste lui-‐même comme manière de construire le monde, à commencer par le sujet colonial ou la femme « orientale »55. Car un certain type de féminisme universaliste du moins n’est ni plus ni moins une manière de « produire » un sujet opprimé « au nom duquel » on prétend parler, au risque de reproduire un tropisme colonial56. A un niveau extrême, le féminisme internationaliste semble accoucher en permanence de victimes prototypiques (la femme de couleur victime de violences sexuelles du fait d’archaïsmes culturalo-‐confessionnels en étant la meilleure illustration) lesquelles font le lit tant d’un féminisme du Nord industrialisé que d’un droit international à la vocation impérialiste jamais entièrement démentie57. En outre, ce n’est pas la moindre des ironies que l’adoption du langage du « genre » par les instances officielles internationales masque en réalité une pensée extrêmement sexualisée, où le terme est simplement un code pour exprimer « la femme »58. Que cela se fasse au mépris justement de toute l’analyse féministe montrant le caractère construit socialement et culturellement et surtout relationnel de la notion de genre aboutit au risque que la femme soit « re-‐essentialisée » sous le prisme d’un genre univoque. Le danger est dès lors que le discours féministe lorsqu’il est peu réflexif, en arrive à chaque instant à légitimer son contraire59. Une équivoque diabolique se niche en effet au cœur de la rencontre entre féminisme et droit international. Faire avancer la cause des femmes, c’est d’abord et avant tout attirer l’attention sur les violences et victimisations dont elles font l’objet. Comme le souligne Karen Engle, « A focus on women’s victimization and marginalization from political and military centers of power might, ironically, be the best way to save women’s lives »60. Or voilà qui met le féminisme pour 53 Doris E. BUSS, « Knowing Women Translating Patriarchy in International Criminal Law », Social & Legal Studies, 23-‐1, 1 mars 2014, p. 73‑92. Voir également sur la question de l’autorité et de qui peut “penser” et dans quells termes le role des femmes Laura J. SHEPHERD, « Power and authority in the production of United Nations Security Council Resolution 1325 », International Studies Quarterly, 52-‐2, 2008, p. 383‑404. 54 Julie MERTUS, « Shouting from the Bottom of the Well The Impact of International Trials for Wartime Rape on Women’s Agency », International Feminist Journal of Politics, 6-‐1, 1 janvier 2004, p. 110‑128. 55 56 Chandra Talpade MOHANTY, « Under Western eyes: Feminist scholarship and colonial discourses », Feminist review, 1988, p. 61‑88. 57 Anne ORFORD, « Feminism, imperialism and the mission of international law », Nordic Journal of International Law, 71-‐2, 2002, p. 275‑296. 58 H. CHARLESWORTH, « Not Waving but Drowning »..., op. cit. 59 Nicola HENRY, « The Fixation on Wartime Rape Feminist Critique and International Criminal Law », Social & Legal Studies, 23-‐1, 1 mars 2014, p. 93‑111. 60 K. ENGLE, « Feminism and its (dis) contents: Criminalizing wartime rape in Bosnia and Herzegovina », The American Journal of International Law, 99-‐4, 2005, p. 778‑816.
14
le moins dans une position difficile, celle d’une tension possible entre objectifs tactiques et stratégiques. Tout l’effort pour traiter la situation des femmes comme victimes de trafics ou de conflits armé consiste à attirer l’attention sur leur vulnérabilité… mais aussi peut être dès lors sur leur insignifiance comme acteurs de la scène internationale. Même si cette démarche revêt un aspect instrumental (il faut savoir « intéresser » le protecteur, fut-‐ce à travers l’exploitation d’un fond de clichés) à force de répéter cette antienne de la victimisation, on en finirait presque par cautionner une image de la femme comme victime absolue. C’est ce que reprochent Ratna Kapur ou Jo Doezema, par exemple, à la rhétorique qui tend à faire des femmes des victimes par nature de divers trafics, au mépris de la possibilité qu’elles aient pu émigrer dans certains cas en connaissance de cause61. De même plusieurs auteurs ont exprimé leur ambivalence par rapport à la manière dont la poursuite des violences sexuelles en situation de conflit armé aboutit à donner une image de la femme comme pure victime incapable de consentir à des rapports sexuels62. Karen Engle, par exemple, a suggéré que « feminist advocates, perhaps unwittingly and even in their disagreements, denied much of women’s sexual and political agency »63 à force de recourir à une rhétorique assimilant femmes et enfants largement reprise par le TPY. En faisant du viol un sort « pire que la mort », en outre, on tendrait à réintroduire une vision de la femme définie par son honneur et comme incapable de dépasser la violence sexuelle qu’elle a subi car la définissant toute entière64. Enfin, Ann Orford et Dianne Otto ont analysé la manière dont le discours onusien en matière de résolution des conflits et de maintien de la paix ne donne guère d’autre image de la femme que celle de victimes65. Il y a là un constant paradoxe entre la mise sur un piédestal juridique de la victime et sa réification à des fins de domination66. Or par ce biais, on en arrive à puissamment légitimer des discours de « protection » à forte connotation masculine qui, loin de ne s’exercer que par la force brute, comportent souvent une forte et a priori séduisante dimension esthétique. Ann Orford a bien montré par exemple comment le débat sur l’intervention humanitaire était structuré bien plus que par des débats juridico-‐formalistes sur sa licéité (par exemple au Kosovo), par toute une économie du désir, de l’émotion, et de l’identification où la communauté internationale s’imagine comme le héro masculin venant au secours de la victime
61 Rarna KAPUR, « Tragedy of Victimization Rhetoric: Ressurecting the“ Native” Subject in International/Post-‐Colonial Feminist Legal Politics, The », Harv. Hum. Rts. J., 15, 2002, p. 1 ; Jo DOEZEMA, « Who gets to choose? Coercion, consent, and the UN Trafficking Protocol », Gender & Development, 10-‐1, 1 mars 2002, p. 20‑27. Egalement, Robert UY, « Blinded by Red Lights: Why Trafficking Discourse Should Shift Away from Sex and the Perfect Victim Paradigm », Berkeley J. Gender L. & Just., 26, 2011, p. 204 ; Sule TOMKINSON, « THE MULTIPLICITY OF TRUTHS ABOUT HUMAN TRAFFICKING: BEYOND “THE SEX SLAVE” DISCOURSE », CEU Political Science Journal, 01, 2012, p. 50‑67. 62 K. ENGLE, « Feminism and its (dis) contents: Criminalizing wartime rape in Bosnia and Herzegovina »..., op. cit. 63 Ibid., p. 780. 64 Karen ENGLE, « Judging Sex in War », Michigan Law Review, 106-‐6, 1 avril 2008, p. 941‑961. 65 A. ORFORD, « Feminism, imperialism and the mission of international law »..., op. cit. ; D. OTTO, « Making sense of zero tolerance policies in peacekeeping sexual economies », Sexuality and the Law, 2007, p. 259‑282. 66 D’une manière générale, le décalage entre les victimes « juridiques » et les victimes « réelles » est un des motifs émergents de critique de la justice pénale internationale. Voir Sara KENDALL et Sarah NOUWEN, « Representational Practices at the International Criminal Court: The Gap between Juridified and Abstract Victimhood », Law & Contemp. Probs., 76, 2013, p. 235.
15
féminine67. Plus prosaïquement, on aurait affaire à ce que certaines féministes ont appelé le « protection racket » par lequel le pouvoir androcentré, sous couvert de galanterie et de noblesse oblige, fournit sécurité à des femmes dont il attend en échange d’être dociles et reconnaissantes68. Le régime sécuritaire post-‐11 septembre 2001 a par exemple été décrit en ces termes69. Dans le cadre des opérations de maintien de la paix, on met les femmes victimes de violences sexuelles sous la protection des casques bleus, quitte à ce que ces derniers soient eux-‐mêmes des artisans de cette violence70. La boucle est bouclée en quelque sorte et, au motif de faire avancer la protection effective des femmes, la pensée féministe se renierait (ou en tous les cas la cause de la lutte pour les droits des femmes se couperait de la pensée féministe critique). Cette tendance à représenter la femme comme victime passive résulte en même temps de stratégies engagées « au profit » des femmes (la notion de « global sisterhood »), de la tendance du droit à penser en termes de catégories universalisantes, et du vieux fond impérialiste de la communauté internationale. Quitte à ce qu’il n’y ait, en quelque sorte, qu’une « sorte » de femme, alors les besoins de la lutte enjoindraient que celle-‐ci dusse être victime et désireuse d’être « sauvée » au mépris de toute nuance sur son vécu71. Au gré d’une curieuse substitution des effets de domination, le risque est désormais que « it is not men’s perception of women’s hysteria that traps women, but women’s own obsession with victimhood »72. C’est à travers la thématique de la victime et de la civlisation que l’on se rend compte qu’un certain féminisme partage en définitive avec le droit international un fond universaliste et occidental difficile à dépasser. Une des réponses à la stéréotypification négative des femmes est bien entendu typiquement la stéréotypification positive de celles-‐ci, avec la caution de certaines féministes, dans la tradition du féminisme culturel73. On attirera par exemple d’autant mieux l’attention du Conseil de sécurité que l’on sait « vendre » la participation des femmes dans les processus de paix comme apportant une « plus value » pacifiante74. Pour les féministes critiques, dans la mesure où c’est toute essentialisation qui est problématique car intrinsèquement oppressive, un tel remède est pire que le mal. Par exemple, face au risque de l’essentialisation victimaire des femmes, certains collectifs féministes comme le NGO Working Group ont milité pendant des années pour que la contribution positive des femmes à la paix soit mieux prise en compte. Leurs efforts
67 Anne ORFORD, « Muscular humanitarianism: reading the narratives of the new interventionism », European Journal of International Law, 10-‐4, 1999, p. 679‑711. 68 Laura SJOBERG et Jessica PEET, « A(nother) Dark Side of the Protection Racket », International Feminist Journal of Politics, 13-‐2, 1 juin 2011, p. 163‑182. 69 Iris Marion YOUNG, « Feminist Reactions to the Contemporary Security Regime », Hypatia, 18-‐1, 1 février 2003, p. 223‑231. 70 N. PRATT, « Reconceptualizing Gender, Reinscribing Racial–Sexual Boundaries in International Security: The Case of UN Security Council Resolution 1325 on “Women, Peace and Security” 1 »..., op. cit. 71 P. JOHNSON et Leslye Amede OBIORA, « How Does the Universal Declaration of Human Rights Protect African Women!(1999) », Syracuse Journal of International Law and Commerce, 26, p. 195, 207. 72 Darren ROSENBLUM, « Beyond victimisation and misandry », International Journal of Law in Context, 6-‐01, mars 2010, p. 114‑116. 73 Il existe relativement peu d’exemples influencés par le féminisme culturel dans la litérature universitaire et l’un des seuls a été écrit par deux hommes au milieu des années 90. C.C. JOYNER et G.E. LITTLE, « It’s Not Nice to Fool Mother Nature-‐ The Mystique of Feminist Approaches to International Environmental Law »..., op. cit. En revanche, les stéréotypes sur le « ethics of care » abondent dans la production normative et technocratique onusienne. 74 C. COHN, H. KINSELLA et S. GIBBINGS, « Women, Peace and Security Resolution 1325 »..., op. cit., p. 137‑138.
16
culminèrent avec l’adoption de la fameuse résolution 1325 laquelle insiste sur l’importance des femmes parmi les personnels de maintien de la paix. Si cette résolution complexifie singulièrement l’image de la femme au-‐delà de la référence victimaire, elle tend aussi à offrir une vision faisant volontiers des femmes des « faiseuses de paix » naturelles, vision en même temps angélique, réductrice et inique75. Dans un autre ordre d’idée mais qui met également en jeu la problématique de la représentation, l’attention internationale au viol uniquement en ce qu’il constitue un facteur de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, ou une « menace à la paix et la sécurité internationales » et la réussite des opérations de maintien de la paix, même si elle semble prendre les violences sexuelles au sérieux, aurait pour effet de masquer la prévalence de ces violences telles qu’elles affectent d’autres femmes (typiquement associée au groupe « fautif ») en période de guerre76, certaines femmes vulnérables en général,77 et y-‐compris les femmes au quotidien en dehors des hypothèses extrêmes que connaissent les tribunaux pénaux internationaux78, sans parler des enfants issus des viols79. Elle serait à ce titre une manifestation éclatante de la tendance du droit international à de constituer comme une « discipline de crise »80, incapable de prendre en compte le quotidien du vécu des femmes, là où la méthodologie féministe entend au contraire partir de la subjectivité concrète. En confinant la question des violences sexuelles dans le rôle de l’exception pathologique, on empêcherait une prise de conscience plus profonde du caractère productivement genré du droit international81. On aurait aussi tendance à propager une vision « instrumentale » du viol où celui-‐ci n’est pas avant tout une manifestation de la violence masculine, mais bien de la violence raciste ou nationaliste (il s’agit d’humilier le groupe ennemi, de lui faire engendrer des enfants qui auront l’ethnicité du violeur), le corps des femmes n’étant perçu que comme un « terrain de bataille » entre ennemis82. On concèderait ainsi par la même occasion un des supposés implicites de la violence masculine (et nationaliste), à savoir que le corps des femmes ne devrait jamais autant être protégé que lorsqu’il remet en question l’honneur des hommes (et de la nation). De fait, le triste bilan des solidarités féminines inter-‐communautaires pendant les guerres de l’ex-‐Yougoslavie montre que même certaines femmes (et féministes) n’ont pas été insensibles à une lecture, sans doute parfois justifiée, de la violence sexuelle comme s’exerçant avant tout d’un groupe à un autre plutôt qu’avant tout contre des femmes « dont il se trouve » qu’elles appartiennent à tel ou tel groupe83.
75 76 Pascale R. BOS, « Feminists Interpreting the Politics of Wartime Rape: Berlin, 1945; Yugoslavia, 1992–1993 », Signs, 31-‐4, 1 juin 2006, p. 995‑1025. 77 Jaya RAMJI-‐NOGALES, « Questioning Hierarchies of Harm: Women, Forced Migration, and International Criminal Law », International Criminal Law Review, 11-‐3, 1 juillet 2011, p. 463‑476. 78 Rhonda COPELON, « Surfacing gender: reconceptualizing crimes against women in time of war », Mass rape: The war against women in Bosnia-‐Herzegovina, 1994, p. 197‑218. 79 Robyn CARPENTER, « Surfacing Children: Limitations of Genocidal Rape Discourse », Human Rights Quarterly, 22-‐2, 2000, p. 428‑477. 80 H. CHARLESWORTH, « International Law: A Discipline of Crisis », The Modern Law Review, 65-‐3, 2002, p. 377‑392. 81 J.G. GARDAM et H. CHARLESWORTH, « Protection of women in armed conflict »..., op. cit. 82 D.E. BUSS, « Rethinking ‘rape as a weapon of war’ »..., op. cit. 83 Pour une discussion de ces controverses, voir K. ENGLE, « Feminism and its (dis) contents: Criminalizing wartime rape in Bosnia and Herzegovina »..., op. cit.
17
Enfin, l’un des effets de la construction univoque de la femme, et notamment de la femme « bosniaque », « tutsi » ou « musulmane », est de renforcer, par ricochet, l’imaginaire latent du droit international pour lequel ces catégories nationales sont largement inamovibles, constantes et irréductibles. Par exemple, si le TPY endosse l’idée que le groupe musulman bosniaque risquait d’être détruit comme tel parce que ses femmes perçues comme pieuses et chastes auraient été particulièrement humiliées en tant que musulmanes par la violence sexuelle commise contre elles ou parce que les enfants issus du viol sont considérés comme serbes, ne risque-‐t-‐on pas ou bien de ratifier certains aspects intrinsèquement oppressifs du groupe victime s’exerçant à l’encontre de leurs propres femmes, ou bien tout simplement de les inventer (l’Islam « patriarcal et fondamentaliste » ou « sensuel et hypersexué »), perpétuant par là même des stéréotypes ethniques ? En outre, en refusant toute défense de consentement, le Tribunal semble nier la possibilité que des femmes bosniaques musulmanes par exemple aient pu consentir à des rapports sexuels avec des hommes serbes, alors même que l’histoire montre que les relations sexuelles consensuelles entre membres de différents groupes ont une longue histoire dans les territoires de l’ex-‐Yougoslavie84. De même, l’idée que le groupe tutsi est détruit en tant que tel parce que les femmes tutsi violées sont marginalisées par leurs propres hommes semble largement enclin à réifier (et donc absoudre) une caractéristique mysogine du groupe victime, qui donne une vision très différente de la production du génocide par la violence sexeulle. D’une manière générale, la « genrisation » et la « sexualisation » de la violence vont permettre de désigner « l’autre » et de renforcer la stabilité de certaines catégories oppressives85. Ce sont jusqu’aux notions de « civilisation » ou de « tiers monde » qui sont lourdement tributaires de constructions genrées, ce dernier étant imaginé par une partie de la mouvance féministe internationale comme « a backdrop, with a cast of nameless extras imagined as playing a part they have never written »86. Le réveil théorique est ici brutal, puisqu’il est question non seulement d’inefficacité mais désormais de réinscription de biais de genre peu profitables voir franchement préjudiciables à celles-‐là même que l’élan féministe tendait à vouloir protéger. Ce risque, et la critique qui en ressort, est particulièrement pénible pour la pensée féministe car il expose également certaines des lignes de fracture qui ont tiraillé les mouvances féministes « du Nord » et « du Sud » depuis plusieurs décennies, ou encore entre femmes « blanches » et « racialisées » et qui prennent le féminisme libéral au piège de ses propres exclusions87. Et si l’hégémonie d’un féminisme des « femmes blanches du Nord » qui ne se sait pas tel est problématique, il ne lui est pas loisible de se dédouaner facilement en produisant de manière également problématique la catégorie « femme du tiers monde » ou « femme de couleur »88. Le féminisme de deuxième génération s’était élevé contre l’hégémonie 84 Ibid., p. 808. 85 Poulami ROYCHOWDHURY, « “The Delhi Gang Rape”: The Making of International Causes », Feminist Studies, 39-‐1, 1 janvier 2013, p. 282‑292. 86 A. ORFORD, « Feminism, imperialism and the mission of international law »..., op. cit., p. 285. 87 Valerie AMOS et Pratibha PARMAR, « Challenging Imperial Feminism », Feminist Review, 17, 1 octobre 1984, p. 3‑19 ; Vasuki NESIAH, « Toward a feminist internationality: A critique of US feminist legal scholarship », Harv. Women’s LJ, 16, 1993, p. 189. 88 A. HOWE, « White Western Feminism Meets International Law »..., op. cit.
18
androcentrique pour, semble t il se constituer à son tour en hégémonie universalisante. Ce n’est pas la moindre ironie, donc, qu’une certaine pensée féministe puisse aboutir à légitimer le type même de domination contre lequel elle s’était élevée.
III. Le danger de la cooptation et de l’instrumentalisation Le succès d’une certaine pensée féministe en droit international, enfin, pourrait se payer de sa cooptation et de son instrumentalisation à des fins douteuses. En réalité, la clef du succès du féminisme en droit international pourrait être dans certains cas sa remarquable capacité à cautionner certaines structures dominantes du droit international en « connaissant sa place » et en ne perturbant pas l’ordre établi89. En ce sens, un certain féminisme était paradoxalement attendu par le droit international, et son influence aurait été beaucoup moins révolutionnaire que le mouvement ne le suggère90. Certes, et c’est un point crucial, c’est une partie du mouvement féministe qui est allée elle-‐même à la rencontre des relais dont elle avait besoin. Que serait la pensée féministe si elle n’était pas au moins réformatrice ? Or les structures à réformer sont bien avant tout celles du pouvoir. On vit donc les féministes fréquenter – assidument et avec talent – les allées du pouvoir, là plus précisément où se construit le droit international : conférences internationales, tribunaux internationaux, mais aussi bien sûr Conseil de sécurité. La nomination de Catharine McKinnon comme conseillère de la CPI en matière de violences sexuelles marque peut être la consécration d’une pensée universitaire féministe faite conseillère du Prince. Cet entrisme féministe marque une certaine apogée d’une pensée qui était demeurée exclue – c’était bien d’ailleurs un des objets de sa critique – du cénacle. Mais il est assez évident que ces structures non seulement n’ont pas retenu de la pensée féministe ce qu’elle avait de plus radical mais qu’il est possible qu’elles aient parfois retourné la pensée féministe contre elle-‐même. Car à y bien penser, l’association entre droit international et statut des femmes n’est pas, et même à certains égards pas du tout, une nouveauté. Ici, il convient d’évoquer la manière dont la « protection » des femmes a de longue date été invoquée, littéralement ou métaphoriquement, pour justifier l’utilisation de la violence nationaliste ou impérialiste. Lorsque Laura Bush s’inquiète soudainement de la condition des femmes en Afghanistan à la veille de l’invasion de ce pays par les Etats Unis91, elle n’est que l’un des ultimes avatars de la longue histoire du « féminisme impérial » : le temps où les hommes blancs mais aussi les femmes blanches tentaient, selon l’expression impérissable de G. Spivak, de « save brown women from brown men »92 n’est pas si révolu93. Dans la ré-‐activation vengeresse de ces thématiques
89 Anne ORFORD, « Contesting globalization: a feminist perspective on the future of human rights », Transnat’l L. & Contemp. Probs., 8, 1998, p. 171. 90 Cette idée est notamment avancée dans K. ENGLE, « Feminism and its (dis) contents: Criminalizing wartime rape in Bosnia and Herzegovina »..., op. cit., p. 779‑780. 91 Krista HUNT, « The strategic co-‐optation of women’s rights », International Feminist Journal of Politics, 4-‐1, 2002, p. 116‑121. 92 Gayatri Chakravorty SPIVAK, « Can the subaltern speak? », 1988. Voir également dans le contexte afghan Miriam COOKE, « Saving brown women », Signs: Journal of Women in Culture and Society, 28-‐1, 2002, p. 468‑470.
19
coloniale, on retrouve une imagerie complexe alliant clash des civilisations, paternalisme pseudo-‐féministe, sauvetage humanitaire, et rédemption par une modernité violente et conquérante94. Où l’on découvre donc que la pensée de la « femme » -‐ à défaut nécessairement du féminisme au sens strict – a sans doute eu un rôle quasi-‐constitutif pour le droit international. Comme l’a souligné Helen Kinsella, par exemple, la propension à protéger ou violer les femmes distinguait déjà dans la pensée de Grotius les nations chrétiennes, civilisées ou barbares95. La constitution même de la souveraineté est puissamment redevable de concepts genrés qui reproduisent la notion d’une sphère « privée ». Même le féminisme n’est pas arrivé tardivement au droit international, et s’était déjà organisé sur une base transnationale à la fin du XIXème96, constituant à ce titre une des fibres matricielles et pourtant méconnue de l’internationalisme. Historiquement, la pensée féministe entretient d’ailleurs dès ses débuts de troublantes associations avec le projet impérial, sous la forme d’un « white woman’s burden » visant à protéger les femmes indigènes, et qui par là même renforce les catégories de la pensée impériale et raciste97. Il est frappant de voir que même aujourd’hui dans l’univers post-‐colonial, les meilleures intentions féministes peinent à ne pas reproduire des clichés de genre lorsqu’il s’agit de l’Orient98. Si le droit international fait donc mine de découvrir la question des femmes et renforce ainsi sa prétention à être une doctrine progressiste, en réalité toute une obscure économie du désir et du fantasme de genre façonne son devenir de longue date : on est bien là en terrain connu, ou en tous les cas dans celui d’un refoulé omniprésent. Le droit international, grâce au féminisme contemporain, redécouvre peut être la « femme » en « lui », mais il ne fait en réalité à cette occasion que se redécouvrir lui-‐même. Une attention à l’histoire de la représentation des femmes en droit international, celle justement à laquelle certains des meilleurs écrits féministes critiques veulent nous convier, fait ressortir que la femme est même à certains égards sur-‐représentée dans certains discours genrés à forte connotation orientaliste et colonisatrice. La mécanique colonisatrice est à l’œuvre dans l’acte même de penser la femme subalterne à sa place, ou encore dans la recherche de « native informants » ou autres cautions orientales
93 Gargi BHATTACHARYYA, Dangerous Brown Men: Exploiting Sex, Violence and Feminism in the « War on the Terror », Zed Books, 2008. 94 Dana L. CLOUD, « “To veil the threat of terror”: Afghan women and the ⟨clash of civilizations⟩ in the imagery of the U.S. war on terrorism », Quarterly Journal of Speech, 90-‐3, 1 août 2004, p. 285‑306 ; Ms Kim RYGIEL et Ms Krista HUNT, (En)Gendering the War on Terror: War Stories and Camouflaged Politics, Ashgate Publishing, Ltd., 2013. 95 Helen M. KINSELLA, « Gendering Grotius Sex and Sex Difference in the Laws of War », Political Theory, 34-‐2, 2006, p. 161‑191. 96 Leila J. RUPP, « Constructing Internationalism: The Case of Transnational Women’s Organizations, 1888-‐1945 », The American Historical Review, 99-‐5, 1 décembre 1994, p. 1571‑1600. 97 Antoinette BURTON, « Some trajectories of ‘feminism’and ‘imperialism’ », Gender & History, 10-‐3, 1998, p. 558‑568 ; Stephen LEGG, « An intimate and imperial feminism: Meliscent Shephard and the regulation of prostitution in colonial India », Environment and planning. D, Society and space, 28-‐1, 2010, p. 68 ; Ruth WATTS, « Breaking the boundaries of Victorian imperialism or extending a reformed ‘paternalism’? Mary Carpenter and India », History of Education, 29-‐5, 1 septembre 2000, p. 443‑456 ; Jawad SYED et Faiza ALI, « The White Woman’s Burden: from colonial civilisation to Third World development », Third World Quarterly, 32-‐2, 2011, p. 349‑365 ; Antoinette M. BURTON, « The white woman’s burden: British feminists and the Indian woman, 1865–1915 », Elsevier, 1990, vol.13. 98 Melanie BUTLER, « Canadian women and the (re)production of women in Afghanistan », Cambridge Review of International Affairs, 22-‐2, 1 juin 2009, p. 217‑234.
20
accréditant parfois bien malgré elles l’œuvre impériale et sa violence99, ou encore dans l’exclusion des femmes se refusant à jouer le simple rôle qu’on entend leur faire jouer100. On aurait pu penser que les militantes de la cause des femmes auraient été les premières à déceler cette continuité qu’avait mis en évidence, précisément, la théorie féministe, mais il n’en fut pas toujours ainsi. Tant et si bien qu’il est désormais acquis, notamment grâce aux travaux de Ann Orford101, que la relégitimation de la notion d’intervention humanitaire – et tout ce qu’elle charrie de bagage post-‐colonial et de résurgence de la violence dans les relations internationales – a été profondément travaillée par des stéréotypes de genre. La femme objetisée, privée de subjectivité, est une femme qui réclame toujours d’être sauvée par l’Occident qui l’a imaginée et qui « autorise » puissamment les femmes qui parlent en son nom. La question serait donc moins à ce titre de retracer les étapes d’une « conquête » du droit international par le féminisme que d’attirer l’attention sur la « captation » discrète et largement antérieure du féminin par le droit international. Ce « féminisme impérial » connaît plusieurs mutations mais une de ses caractéristiques est l’investissement simultané dans un projet sécuritaire – national, transnational et supranational -‐ illustré tant par la militarisation croissante des sociétés que par un véritable tournant répressif. C’est ainsi par exemple que certaines féministes critiques ont mis l’accent sur la notion de « féminisme carcéral », soit un féminisme de gouvernance obnubilé par la répression pénale des infractions sexuelles et de ce fait incapable, simultanément, de développer tout discours critique par rapport à l’institution pénale elle-‐même, voir tout discours « sex positive ». Aux Etats-‐Unis, la critique consiste à montrer en quoi le féminisme s’est petit à petit laissé gagner par une tentation du tout-‐pénal, stratégie coûteuse et potentiellement destructrice102. En Inde, l’indignation internationale au sujet du viol de Jyoti Singh Pandey prend un tournant inquiétant lorsqu’elle épouse des demandes pour la réintroduction de la peine de mort, la lapidation ou la castration. Devant les tribunaux pénaux internationaux, une certaine approche « productiviste » de la répression des crimes sexuels mesure souvent la réussite du mouvement pour les femmes au nombre d’hommes condamnés et la longueur de leur peine, au prix de tensions certaine même avec les principes d’une justice pénale libérale103.
99 Shahnaz KHAN, « Reconfiguring the Native Informant: Positionality in the Global Age », Signs, 30-‐4, 1 juin 2005, p. 2017‑2037. 100 Comme par exemple lorsque des femmes irakiennes dénonçant l’invasion américaine créent un « froid » parmi leur auditoire onusien. Sheri Lynn GIBBINGS, « No angry women at the United Nations: political dreams and the cultural politics of United Nations Security Council Resolution 1325 », International feminist journal of politics, 13-‐4, 2011, p. 522‑538. 101 K. ENGLE, « Calling in the Troops: The Uneasy Relationship among Women’s Rights, Human Rights, and Humanitarian Intervention », Harv. Hum. Rts. J., 20, 2007, p. 189 ; Anne ORFORD, Reading humanitarian intervention, Cambridge University Press, 2003. 102 Aya GRUBER, « Rape, feminism, and the war on crime », Washington Law Review, Forthcoming, 2009, p. 09‑46. 103 Par exemple, la recherché de responsabilités pénales pour viol a vraisemblablement eu un role dans l’expansion dramatique des modes d’imputation de la responsabilité. Pour un argument dans ce sens R. P. BARRETT et L. LITTLE, « Lessons of Yugoslav Rape Trials: A Role for Conspiracy Law in International Tribunals », Minnesota Law Review, Vol. 88, p. 30, 2003, 2003. Elle est également souvent associée à des modes d’interprétation dynamiques à la limite du principe de légalité pénale. William A. SCHABAS, « Interpreting the statutes of the ad hoc tribunals », Man’s Inhumanity to Man, 848, 2003. ou encore à la limitation des défenses, notamment celle de consentement Janet HALLEY, « Rape in Berlin: Reconsidering the criminalisation of rape in the international law of armed conflict », Melb. J. Int’l L., 9, 2008, p. 78..
21
Au-‐delà, c’est sur la thématique des « strange bedfellows » que s’est épanchée la pensée féministe critique, qui s’inquiète du virage à droite pris par certaines féministes et des rencontres – ainsi que des alliances – qu’elles y font avec certains courants conservateurs. Elizabeth Bernstein par exemple a montré la forte convergence, cimentée par une adhésion commune à l’agenda carcéral, entre féministes abolitionnistes et mouvements évangéliques chrétiens – mouvements que l’on aurait pourtant pu croire tout à fait opposés -‐ autour de la question de la répression des trafiquants et des usagers de la prostitution comme réponse s’imposant de manière dominante dans tout agenda de lutte contre le trafic des femmes104. De même, les troublantes affinités entre la campagne pour la fin du « gender Apartheid » en Afghanistan menée par la Feminist Majority Foundation et la rhétorique orientaliste et a-‐historique de l’administration Bush ont été relevées105. En Inde, le parti qu’a pu tirer le BJP (parti nationaliste Hindu) du viol de Singh Pandey et la manière dont celui-‐ci a pu se porter garant de la « vertu » de la femme hindou inquiètent fondamentalement certaines féministes indiennes critiques106. Il en résulte une crainte lancinante que le féminisme pourrait servir à asseoir certaines formes de pouvoir associées au droit international. On pense notamment à la manière dont l’investissement dans le pouvoir normatif du Conseil de sécurité par des réseaux féministes transnationaux aboutit d’une certaine manière à réifier et renforcer le pouvoir – pourtant largement problématique – de cet organe107. Derrière la légitimation du Conseil de sécurité, c’est bien la reproduction de l’idée que l’usage de la force est crucial pour la protection des femmes qui revient constamment au devant de la scène, alors même que l’on sait que les femmes sont historiquement les grandes perdantes de la guerre. C’est ainsi que l’on pourra reprocher à toute une pensée féministe post 11 septembre 2011 de justifier l’usage de la violence préemptive et de s’acclimater avec une grande célérité au régime hyper-‐sécuritaire que cet épisode a renforcé108. Enfin, derrière la légitimation des institutions et de leur violence propre, c’est aussi un autre danger encore plus pernicieux qui insécurise profondément la pensée féministe : la possibilité que même certaines approches critiques fondées sur le biais structurel aient, à trop privilégier une version universaliste du genre calquée sur la vision-‐monde de « femmes blanches souvent anglophones issues du monde développé », en réalité abouti à produire une version internationale du féminisme fort peu apte à « empower » (le terme se traduit mal) les femmes « minoritaires » -‐ ou ce que Karen Engle a appelé
104 Hope LEWIS, « Between Irua and’Female Genital Mutilation’: Feminist Human Rights Discourse and the Cultural Divide », Harvard Human Rights Journal, 8-‐1, 1995, p. 1‑55. 105 Ann RUSSO, « The Feminist Majority Foundation’s Campaign to Stop Gender Apartheid », International Feminist Journal of Politics, 8-‐4, 1 décembre 2006, p. 557‑580. 106 Ratna KAPUR, « Gender, Sovereignty and the Rise of Sexual Security Regime in International Law and Postcolonial India », Melbourne Journal of International Law, 14, 2013, p. 317. 107 Dianne OTTO, « Exile of Inclusion: Reflections on Gender Issues in International Law over the Last Decade, The », Melb. J. Int’l L., 10, 2009, p. 11 ; L.J. SHEPHERD, « Power and authority in the production of United Nations Security Council Resolution 1325 »..., op. cit. De fait, une partie de la production féministe semble ni plus ni moins se concevoir comme le « handmaiden » du Conseil de sécurité. Letitia ANDERSON, « Politics by Other Means: When does Sexual Violence Threaten International Peace and Security? », International Peacekeeping, 17-‐2, 1 avril 2010, p. 244‑260. 108 http://opiniojuris.org/2011/05/17/a-‐response-‐to-‐gina-‐heathcote-‐by-‐dianne-‐otto/
22
« the exotic other female »109. En réalité, la critique des biais systémique aboutit à culpabiliser la « culture » et notamment les cultures du Sud souvent associées aux pires formes du patriarcat. D’où un engagement dans toute une série de causes emblématiques mais s’exerçant souvent de manière unidirectionnelle du Nord vers le Sud et parmi lesquelles figurent bien entendu les mutilations génitales féminines ou encore la question du port du voile ; d’où aussi une tendance plus ou moins subtile à envisager la femme « exotique » sous l’angle de l’aliénation et de la fausse conscience, au risque bien sûr de réveiller le topos colonial.
Conclusion : Vers une transformation du droit international au contact du féminisme, et du féminisme au contact du droit international? Au contact l’un de l’autre, tant la pensée féministe que le droit international sont appelés à changer. Du côté du droit international, la promesse des approches féministes du droit international a toujours été plus significative que le simple avancement du statut des femmes, même si cet avancement est un baromètre historiquement crucial de leur succès. Dissocier le projet d’égalité des sexes de la critique plus générale dont est porteuse la pensée féministe était sans doute une cause perdue110. C’est à l’aune de la transformation du droit international que devrait donc s’évaluer le réel succès de cette pensée. En même temps, la critique féministe la plus révisionniste en appellerait presque à dépasser le droit, ou en tous les cas à ne pas en escompter trop111. En définitive, cette position est logique avec les postulats du féminisme critique : il ne pourra jamais s’agir, précisément, de reconstruire un universel féministe capable de remplacer l’universel andro-‐centré qu’a incarné le droit international. Le cosmopolitisme inhérent au droit international demeure suspect112. Du côté des théories féministes, l’expérience de la juridicité et, au-‐delà, du pouvoir sont parfois amères et renvoient une image complexe au mouvement car elle expose ses tensions internes. Le féminisme présente en effet la spécificité d’être critique du droit international de deux manières potentiellement incompatibles: lui reprochant de ne point faire suffisamment pour inclure les femmes, mais lui reprochant également d’être ce qu’il est. Au minimum, c’est l’investissement exclusif dans une stratégie juridique qui est mis en question113. Mais Janet Halley en a aussi appelé récemment, dans un ouvrage qui fit grand bruit, à dépasser le féminisme lui-‐même, ou en tous cas à assumer son « désir de pouvoir » de manière plus « féroce », c’est-‐à-‐dire également à être éminemment conscient des violences qu’impose une pensée féministe utopique et peu
109 Karen ENGLE, « Female Subjects of Public International Law: Human Rights and the Exotic Other Female », New England Law Review, 26, 1992 1991, p. 1509. 110 D. Q. THOMAS, « Conclusion », in Julie PETERS et Andrea WOLPER (éd.), Women’s Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives, Psychology Press, 1995, . 111 J. MERTUS, « Shouting from the Bottom of the Well The Impact of International Trials for Wartime Rape on Women’s Agency »..., op. cit. 112 R. BUCHANAN et S. PAHUJA, « Collaboration, cosmopolitanism and complicity »..., op. cit. 113 Richa SHARMA et Susan BAZILLI, « Violence Against Women: What’s Law Got to Do With It? A Reflection on Gang Rape in India », International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 3-‐3, 29 octobre 2014, p. 4‑21.
23
réflexive114. La critique évoque celle de Martti Koskenniemi ou de David Kennedy à l’égard du mouvement des droits humains, accusé de vouloir faire de la politique tout en donnant l’impression de ne pas en faire115. Quoiqu’il en soit, ce chapitre espère avoir montré que ces mutations intellectuelles ont été préparées patiemment depuis une décennie par les critiques de celles que l’on pourrait appeler « juristes féministes inquiètes »116. Il n’est pas dit, à ce titre, que toute lutte pour les femmes dusse se présenter sous la bannière d’une internationale féministe (aussi séduisante soit cette idée surtout pour celles qui ont les moyens de participer à sa promotion), et de multiples rationalités politiques peuvent se manifester sous une enseigne très large117, au-‐delà de l’appel potentiellement hégémonique à un « sisterhood » global qui ferait de toutes les femmes les alliées de toutes les autres femmes. Il n’est pas dit non plus, d’ailleurs, que la pensée féministe critique en droit international débouche sur de vraies visées programmatiques : cela est moins sa raison d’être que de coexister avec les efforts existants en introduisant un soupçon de doute. Dans ce contexte, certains des objectifs des féminismes de première et deuxième génération demeurent de toute évidence d’actualité118, même s’il paraît de plus en plus difficile de les envisager avec l’enthousiasme qui caractérise souvent le mouvement. En particulier, la critique genrée du droit international est un effort imparfaitement accompli et il semble plus urgent que jamais de réhabiliter l’approche féministe du droit international dans ce qu’elle a de plus profond. Plutôt que de s’intéresser uniquement à la question des violences sexuelles contre les femmes en temps de guerre, par exemple, on s’intéressera à la manière dont la pratique même de la guerre est genrée119 et dont toute une série de représentations structurent la violence politique, jusqu’à certains grands débats doctrinaux en apparence très conceptuels120. Quant à la critique de troisième ou quatrième génération tend surtout à infliger une leçon de doute et d’humilité par rapport à des pratiques et des interventions théoriques féministes qui en finissent par oublier qu’une femme n’est jamais que « femme » et que son vécu est structuré par une constellation d’identifications concurrentes dont certaines peuvent être tout aussi définissantes. Il n’en demeure pas moins que de manière tactique le droit international et les droits humains continuent de receler des potentialités pour la cause des femmes121.
114 Janet HALLEY, Split decisions: How and why to take a break from feminism, Princeton University Press, 2008. 115 M. KOSKENNIEMI, « The effect of rights on political culture », in The EU and Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 99‑116 ; D. KENNEDY, « International Human Rights Movement: Part of the Problem? », Harv. Hum. Rts. J., 15, 2002, p. 101. 116 L’expression est empruntée à Marie-‐Claire BELLEAU, « Juristes Inquiets: Legal Classicism and Criticism in Early Twentieth-‐Century France, The », Utah Law Review, 1997, 1997, p. 379. 117 Aihwa ONG, « Strategic Sisterhood or Sisters in Solidarity? Questions of Communitarianism and Citizenship in Asia », Indiana Journal of Global Legal Studies, 4-‐1, 1 octobre 1996, p. 107‑135. 118 Aruna RAO et David KELLEHER, « Is there life after gender mainstreaming? », Gender & Development, 13-‐2, 2005, p. 57‑69 ; Amy BARROW, « ‘[It’s] like a rubber band.’ Assessing UNSCR 1325 as a gender mainstreaming process », International Journal of Law in Context, 5-‐01, mars 2009, p. 51‑68. 119 L. SJOBERG et J. PEET, « A(nother) Dark Side of the Protection Racket »..., op. cit. 120 M. A. HANSEN, « Preventing the Emasculation of Warfare: Halting the Expansion of Human Rights Law into Armed Conflict », Mil. L. Rev., 194, 2007, p. 1. 121 Barbara STARK, « International Human Rights Law, Feminist Jurisprudence, and Nietzsche’s Eternal Return: Turning the Wheel », Harvard Women’s Law Journal, 19, 1996, p. 169 ; Barbara STARK, « Women and globalization: The failure and postmodern possibilities of international law », Vand. J. Transnat’l L., 33, 2000, p. 503.
24
Au-‐delà du simple approfondissement des efforts existants, trois stratégies plus radicales semblent prometteuses. La première consiste à réhabiliter systématiquement le caractère d’« agent » des femmes y-‐compris dans les situations où les théories du biais structurel peinent à imaginer une quelconque liberté, au risque de substituer leur hégémonie « émancipatrice » à l’hégémonie « oppressive » de la culture patriarcale par exemple. Au risque, également, de vouloir « sauver » les femmes contre leur gré et surtout être sourdes aux infinies variations de la condition féminine, mais aussi racialisée, économique ou confessionnelle122. On mettra ainsi en valeur la capacité de résistance et d’autonomie des femmes y-‐compris dans les pires situations d’oppression, qu’elle soit héroïque ou criminelle d’ailleurs123. On aboutira également à des interprétations de la violence plus fines que celle de la simple « domination masculine », mettant en avant la complexité du « passage à l’acte » et seules à même, en définitive, d’aboutir à une véritable étiologie de la violence124. C’est peut être Janet Halley, encore une fois, qui est allée le plus loin dans cette direction lorsqu’elle s’attache à montrer la manière dont même dans un Berlin occupé il était possible d’envisager qu’une femme accepterait d’avoir des relations sexuelles avec un officier soviétique125. L’idée que même dans la pire misère subsiste un espace pour une théorie « sex positive » pousse la notion d’« agency » à l’extrême au point de la dénaturer et a de quoi choquer certain(es). Quoique l’on pense de cette thèse, le fait d’avoir des relations sexuelles avec un membre du groupe « ennemi » pourrait être dans certains cas (mais pas forcément, bien sûr, celui de Berlin 45 ou de Foca 93126) une manière de transgresser certains interdits nationalistes et de genres qui font que les hommes disciplinent les corps des femmes de leur propre groupe et traitent leurs relations exogamiques comme une forme de trahison127, ou encore de s’élever contre des formes de pubidonderie gouvernementales ou intergouvernemtales autoritaires dans des contextes économiques marqués par la précarité extrême128. Plutôt que de tirer partie des violences faites aux femmes pour mieux contrôler leurs corps, on s’interrogera au contraire sur les conditions de possibilité de cette violence.
122 L. ABU-‐LUGHOD, « Do Muslim women really need saving? Anthropological reflections on cultural relativism and its others », American Anthropologist, 104-‐3, 2002, p. 783‑790. 123 Paige Whaley EAGER, From freedom fighters to terrorists: women and political violence, Ashgate Publishing, Ltd., 2008. 124 Mark A. DRUMBL, « She Makes Me Ashamed to Be a Woman: The Genocide Conviction of Pauline Nyiramasuhuko, 2011 », Mich. J. Int’l L., 34, 2012, p. 559. 125 J. HALLEY, « Rape in Berlin: Reconsidering the criminalisation of rape in the international law of armed conflict »..., op. cit. ; Janet HALLEY, « Rape at Rome: Feminist interventions in the criminalization of sex-‐related violence in positive international criminal law », Mich. J. Int’l L., 30, 2008, p. 1. 126 Pour une critique vigoureuse de la thèse de Janet Halley, voir Maria GRAHN-‐FARLEY, « The politics of inevitability: an examination of Janet Halley’s critique of the criminalisation of rape as torture », in Sari KOUVO et Zoe PEARSON (éd.), Feminist Perspectives on Contemporary International Law: Between Resistance and Compliance?, Bloomsbury Publishing, 2014, . 127 Fabrice VIRGILI, France « virile » : Des femmes tondues à la libération, Paris, Payot, 2004 ; Alexander Perry BIDDISCOMBE, « Dangerous Liaisons: The Anti-‐Fraternization Movement in the U.S. Occupation Zones of Germany and Austria, 1945-‐1948 », Journal of Social History, 34-‐3, 2001, p. 611‑647. 128 Giora GOODMAN, « ‘Only the Best British Brides’: Regulating the Relationship between US Servicemen and British Women in the Early Cold War », Contemporary European History, 17-‐04, novembre 2008, p. 483‑503 ; D. OTTO, « Making sense of zero tolerance policies in peacekeeping sexual economies »..., op. cit.
25
D’ailleurs si les femmes sont prises pour cible c’est certes souvent parce qu’elles sont femmes mais aussi souvent parce qu’elles sont agentes et activistes: comme le souligne Mark Drumbl « unremitting portrayals of women as victims nourish prejudicial stereotypes of helplessness and, thereby, gloss over the reality that some women are victimized because they exercise the agency of resistance and, thereby, threaten the normalization of massacre”129. Il paraît à ce titre important d’insister sur les rôles politiques et combattants des femmes en situation de conflits armés130 y-‐compris comme auteurs131 ou « cheer leaders » de violences criminelles dont des violences à caractère sexuel132, et comme soutien à des politiques extrémistes d’une manière générale133 (d’une manière assez paradoxale, même le fait de montrer que les femmes peuvent être à l’origine -‐ y-‐compris de manières « ordinaires » et non seulement pathologiques134 -‐ d’atrocités recèle un potentiel émancipateur135). Les rapports complexes qu’entretiennent les femmes avec le patriarcat, d’ailleurs, peuvent « empower » au moins celles d’entre elles – et il y en eut jusque dans l’Allemagne Nazie -‐ qui sont prêtes à forger une alliance avec lui136. Ceci étant dit, il sera important de demeurer alerte à la possibilité que l’appareil sécuritaire androcentré ne coopte des femmes (notamment « du Nord » ou « blanches ») dans le « racket de la protection », par exemple à travers la féminisation d’opérations de maintien de la paix – mais aussi des opérations anti-‐insurrections137 -‐ qui demeurent définies par leur « masculinité militarisée »138. On est là à la limite d’un douteux « gender-‐washing » (à travers des
129 M.A. DRUMBL, « She Makes Me Ashamed to Be a Woman: The Genocide Conviction of Pauline Nyiramasuhuko, 2011 »..., op. cit., p. 601. 130 Luisa Maria DIETRICH ORTEGA, Transitional justice and female ex-‐combatants: Lessons learned from international experience, 2010 ; Caroline N. O. MOSER et Fiona CLARK, Victims, Perpetrators Or Actors?: Gender, Armed Conflict and Political Violence, Palgrave Macmillan, 2001. 131 Dara Kay COHEN, « Female Combatants and the Perpetration of Violence: Wartime Rape in the Sierra Leone Civil War », World Politics, 65-‐03, juillet 2013, p. 383‑415 ; Annette WIEVIORKA, « À propos des femmes dans les procès du nazisme », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 39, 1 juin 2014, p. 151‑156. Coline CARDI et Geneviève PRUVOST, « La violence des femmes : un champ de recherche en plein essor », Champ pénal/Penal field, Vol. VIII, 11 juin 2011, https://champpenal.revues.org/8102?lang=en. 132 Atina GROSSMANN, « Feminist debates about women and National Socialism », Gender & History, 3-‐3, 1991, p. 350‑358. 133 Paola BACCHETTA et Margaret POWER, Right-‐wing women: From conservatives to extremists around the world, Routledge, 2013 ; Joyce Marie MUSHABEN, « The rise of Femi-‐Nazis? Female participation in right-‐extremist movements in unified Germany », German Politics, 5-‐2, 1996, p. 240‑261. 134 Alette SMEULERS, « Female Perpetrators: Ordinary or Extra-‐ordinary Women? », International Criminal Law Review, 15-‐2, 2015, p. 207‑253. Il est vrai que pour une partie du féminisme la participation des femmes à la violence est toujours le résultat d’une forme de victimisation, ce qui réduit significativement leur dimension d’agent. Amy CAIAZZA, Why gender matters in understanding September 11: women, militarism and violence, IWPR, 2001. 135 Carrie SPERLING, « Mother of atrocities: Pauline Nyiramasuhuko’s role in the Rwandan Genocide », Fordham Urban Law Journal, 33, 2006, p. 637. 136 Ralph LECK, « Conservative Empowerment and the Gender of Nazism: Paradigms of Power and Complicity in German Women’s History », Journal of Women’s History, 12-‐2, 2000, p. 147‑169 ; Maarten VAN GINDERACHTER, « Gender, the extreme right and Flemish nationalist women’s organisations in interwar Belgium », Nations and nationalism, 11-‐2, 2005, p. 265‑284. 137 Laleh KHALILI, « Gendered practices of counterinsurgency », Review of International Studies, 37-‐04, 2011, p. 1471‑1491. 138 N. PRATT, « Reconceptualizing Gender, Reinscribing Racial–Sexual Boundaries in International Security: The Case of UN Security Council Resolution 1325 on “Women, Peace and Security” 1 »..., op. cit.
26
« gender decoys »139) bien compris, où certaines pratiques masculines se perpétuent par l’incorporation de participantes féminines. Ecouter les femmes les plus « subordonnées » implique de ne pas les prendre pour otages de projections conceptuelles et généralisantes n’ayant que peu de rapport avec leur vécu, un abus commis par des penseurs et penseuses de droite140 comme de « gauche »141. On pourra même inverser certaines des catégories du « biais structurel » en montrant comment la sphère privée (que ce soit celle de l’autonomie personnelle d’une femme ou de la souveraineté d’un Etat d’ailleurs) peut aussi être une sphère de protection et de renégociation des libertés ; ou encore comment la « culture » ou la « religion » peuvent aussi receler des potentiels émancipateurs propres142 et irréductibles les uns aux autres. Il s’agit peut-‐être à ce titre, assez paradoxalement, de faire un pas en retour vers une dimension du libéralisme, celle-‐qui place la subjectivité des individus au cœur de sa théologie, mais à condition bien sûr de prendre sérieusement ce que disent les « individus » et de ne pas le dissoudre dans une abstraction commune. En réinvestissant la pensée féministe de sa multiplicité, on contribuera peut être aussi à montrer le rôle que la femme peut avoir y-‐compris dans la contestation de discours de protection engagés en son nom (une sorte de « not in my name » féministe). La seconde stratégie consiste à transcender le féminin par le genre (ou refuser la sexualisation rampante du genre) afin de donner aux luttes féministes un sens plus large que celui, historique et bien entendu dominant, de défense gynocentrique. Daren Rosenblum en a appelé par exemple à la nécessité de « unsex CEDAW »143. Sans dénier à la question de l’inégalité des femmes et de la domination historique des hommes toute sa pertinence dans nombre de sociétés et de situations, la critique de l’intersectionnalité a fait voler en éclat l’idée qui constituait pourtant le socle du féminisme internationaliste, à savoir qu’il existe une figure de la femme plus ou moins unique et dont l’expérience se reproduit à l’infini partout dans le monde144. Il paraît intéressant de repenser la question des droits des femmes comme la partie sans doute la plus significative de phénomènes d’oppression liés au genre et dont par exemple les
139 C’est le terme utilisé par Zillah Eisenstein pour décrire les femmes ayant rejoint et servi de caution au projet de l’administration Bush de guerre civilisationnelle contre le terrorisme. Zillah EISENSTEIN, Sexual Decoys: Gender, Race and War in Imperial Democracy, Zed Books, 2007. 140 Aziza AHMED et Meena SESHU, « “We have the right not to be ‘rescued’…”: When Anti-‐Trafficking Programmes Undermine the Health and Well-‐Being of Sex Workers », Anti-‐Trafficking Review, 1-‐103, 2012, p. 149‑168. 141 Voir M. GRAHN-‐FARLEY, « The politics of inevitability: an examination of Janet Halley’s critique of the criminalisation of rape as torture »..., op. cit. 142Rebecca FOLEY, « Muslim Women’s Challenges to Islamic Law The Case of Malaysia », International Feminist Journal of Politics, 6-‐1, 2004, p. 53‑84 ; Jasmin ZINE, « Between orientalism and fundamentalism: The politics of Muslim women’s feminist engagement », Muslim World Journal of Human Rights, 3-‐1, 2006. 143 Darren ROSENBLUM, « Unsex CEDAW, or What’s Wrong with Women’s Rights », Columbia Journal of Gender and Law, 20, 2011. Voir également Kathryn MCNEILLY, « Gendered Violence and International Human Rights: Thinking Non-‐discrimination Beyond the Sex Binary », Feminist Legal Studies, 22-‐3, 2014, p. 263‑283 ; Julie GOLDSCHEID, « Gender Neutrality, the’Violence Against Women’Frame, and Transformative Reform », 2013. 144 Ce dépassement est précédé par des travaux théoriques remettant en question la construction du sujet « femme ». Judith BUTLER, « Contingent foundations: Feminism and the question of “postmodernism” », The postmodern turn: New perspectives on social theory, 1994, p. 153‑170. Pour une réponse à l’article de Darren Rosenblum centrée sur la pertinence de la catégorie « femme » voir Berta Esperanza HERNANDEZ-‐TRUYOL, « Unsex Cedaw -‐ No -‐ Super-‐Sex It », Columbia Journal of Gender and Law, 20, 2011, p. 195.
27
homosexuels et les transexuels – mais aussi les hommes, y-‐compris hétérosexuels145 – peuvent être victimes, et les femmes auteurs, d’une manière qui interroge la pensée féministe146. En mettant au cœur de la réflexion la question du genre et de la séxualité, comme appellent à le faire surtout certains penseurs du « queer », on s’éloignerait aussi sans doute de la reproduction de stéréotypes victimaires au sujet des femmes. Le genre permettrait de penser l’oppression comme résultant moins en soi de la qualité de femme que de la construction genrée d’une certaine idée de la femme et de l’homme (et de leurs sexualités). Le « queering » du droit international pourrait à ce titre être le projet le plus radical qui soit, une manière de contester sa constitution même en termes de dichotomies problématiques (droit international contre droit national ; droit international public contre droit international privé, etc). La problématique du genre permettrait aussi de penser de manière critique non seulement la construction de la féminité, mais également celle de la ou plutôt des masculinités147. En effet, le masculin est bien souvent le grand impensé de la pensée féministe, sans même parler de la pensée politique et juridique générale. Sexe neutre ou de référence par rapport auquel se construit le féminin, il paraît vital aujourd’hui de déconstruire la masculinité, de la repenser comme elle-‐même tout aussi contingente et construite que ne l’est la féminité (voir par analogie les théories du « whiteness » en matière raciale) et peut-‐être, de ce fait, déconstruire le droit international lui-‐même148. A cette occasion, l’on fera également ressortir la manière dont –certes dans des proportions bien moindres mais néanmoins complexes et instructives – l’homme est également construit/prisonnier/victime de conceptions de genre, et certains hommes dominent d’autres hommes par le truchement de catégories de genre (hétérosexuel/homosexuel, viril/efféminé), elles-‐mêmes renforcées par toute sorte de catégorisations sociale ou raciales. On fera également ressortir la manière dont, pas plus que la femme est unique l’homme ne l’est, et qu’au gré de troublantes « intersectionnalités oppressives » une « femme blanche » peut bien être à l’origine de la persécution d’un « homme marron » (entendre : musulman). C’est ce qu’a bien montre comme l’exemple d’Abu-‐Ghraib et la manière dont genre et sexualité y ont été utilisés comme de véritables armes de guerre et de torture149.
145 La “découverte” de la question de la violence sexuelle contre les hommes en temps de conflit armé ou dans les prisons fait partie des nouvelles orientations. Lara STEMPLE, « Male rape and human rights », Hastings LJ, 60, 2008, p. 605 ; Sandesh SIVAKUMARAN, « Sexual violence against men in armed conflict », European Journal of International Law, 18-‐2, 2007, p. 253‑276 ; Bennett CAPERS, « Real rape too », California law review, 2011, p. 1259‑1307 ; Sarah SOLANGON et Preeti PATEL, « Sexual violence against men in countries affected by armed conflict », Conflict, Security & Development, 12-‐4, 2012, p. 417‑442 ; Philip NS RUMNEY, « Gay male rape victims: law enforcement, social attitudes and barriers to recognition », The International Journal of Human Rights, 13-‐2-‐3, 2009, p. 233‑250 ; Chloé LEWIS, « Systemic Silencing: Addressing Sexual Violence against Men and Boys in Armed Conflict and its Aftermath », Rethinking Peacekeeping, Gender Equality and Collective Security, 2014, p. 203 ; Anjali MANIVANNAN, « Seeking Justice for Male Victims of Sexual Violence in Armed Conflict », NYUJ Int’l L. & Pol., 46, 2013, p. 635. 146 Miranda ALISON, « Wartime sexual violence: women’s human rights and questions of masculinity », Review of International Studies, 33-‐01, janvier 2007, p. 75‑90. 147 Dianne OTTO, « Disconcerting’masculinities’: Reinventing the gendered subject (s) of international human rights law », 2005 ; P. HIGATE, « Peacekeepers, masculinities, and sexual exploitation », Men and Masculinities, 10-‐1, 2007, p. 99‑119. 148 Voir par exemple Carol COHN et Cynthia ENLOE, « A conversation with Cynthia Enloe: Feminists look at masculinity and the men who wage war », Signs, 40-‐1, 2014. 149 Aziza AHMED, « When Men Are Harmed: Feminism, Queer Theory, and Torture at Abu Ghraib », UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, 11, 2012 2011, p. 1 ; Barbara EHRENREICH, « Feminism’s Assumptions Upended », South Central Review, 24-‐1, 2007, p. 170‑173 ; Isis NUSAIR, « Gendered, racialized and sexualized torture at Abu-‐Ghraib », in
28
La masculinité peut certes être hégémonique, mais elle est aussi adaptable, modulable et évolutive150. Ne serait-‐ce qu’à titre politique, cette réflexion permettra sans doute de mieux imaginer la lutte contre l’oppression et la domination comme résultant moins d’une improbable lutte des sexes (un peu à la manière dont la pensée marxiste pensa la lutte des classes) que d’un travail commun sur la conception sociale du sexe et et du genre. En découplant sexe, genre et préférences politiques elle pourrait aussi permettre de résoudre le mystère des « femmes anti-‐féministes »151. On pourra également tenter à cette occasion de dépasser le seul registre de la solidarité masculine avec les luttes des femmes (les « compagnons de route », en quelque sorte), pour penser des modalités d’action fondée sur une communauté d’intérêt à réagir socialement et juridiquement contre le genre oppressif, c’est-‐à-‐dire le genre qui se dissimule sous les atours du biologique, du naturel et de l’inévitable152. La troisième stratégie consiste à tenter de décoloniser la pensée féministe internationaliste et par ce biais de contribuer à la décolonisation du droit international. Ceci implique incontestablement un retour critique sur l’alliance « féminisme »-‐droit international et certains de ses abus, retour critique qui sera avant tout historique, tant les troublantes continuité avec le passé sont sans doute seules à même de perturber la myopie du temps présent. Ceci implique également une véritable compréhension du rôle qu’a le droit international dans l’oppression des femmes et des minorités plus généralement (ici les théories féministes, dans la mesure où elles ont fait leur auto-‐critique153, sont les alliées naturelles, les « sœurs » intellectuelles des théories post-‐coloniales, raciales critiques, etc154). Enfin, il importe sans doute de dépasser l’attention aux sphères culturelles et confessionnelles, trop souvent l’objet d’une attention exclusive et facile, et peut être également au-‐delà des questions de violences sexuelles auxquelles la pensée féministe internationaliste ne saurait se réduire155. On restituera ainsi mieux la manière dont les discriminations et les violences faites aux femmes résultent d’une constellation de facteurs ayant trait au caractère andro-‐occidentalo-‐centré du droit international et des droits humains156 et non seulement des actes de « barbares » à la périphérie du droit. On pourra ainsi véritablement s’atteler à la
Robin L. RILEY, Chandra Talpade MOHANTY et Minnie BRUCE PRATT (éd.), Feminism and war: confronting US imperialism, London, Zed, 2008, . 150 Claire DUNCANSON, « Hegemonic Masculinity and the Possibility of Change in Gender Relations », Men and Masculinities, 18-‐2, 1 juin 2015, p. 231‑248. 151 Erin STEUTER, « Women against feminism: an examination of feminist social movements and anti-‐feminist countermovements », Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie, 29-‐3, 1992, p. 288‑306. 152 Robert W. CONNELL, « Change among the gatekeepers: Men, masculinities, and gender equality in the global arena », Signs, 40-‐1, 2014. 153 Pour de beaux exemples de réflexivité, voir Isabelle R. GUNNING, « Arrogant Perception, World-‐Travelling and Multicultural Feminism: The Case of Female Genital Surgeries », Columbia Human Rights Law Review, 23, 1992 1991, p. 189 ; H. LEWIS, « Between Irua and’Female Genital Mutilation’: Feminist Human Rights Discourse and the Cultural Divide »..., op. cit. 154 De fait, plusieurs appels insistent sur la nécessité d’une communication accrue entre ces théories. D. OTTO, « The Gastronomics of TWAIL’s Feminist Flavourings: Some Lunch-‐Time Offerings »..., op. cit. ; E. BREMS, « Enemies or Allies-‐Feminism and Cultural Relativism as Dissident Voices in Human Rights Discourse », Hum. Rts. Q., 19, 1997, p. 136. 155 Julieta LEMAITRE et Kristin Bergtora SANDVIK, « Beyond Sexual Violence in Transitional Justice: Political Insecurity as a Gendered Harm », Feminist Legal Studies, 22-‐3, 2014, p. 243‑261. 156 Hope LEWIS, « Embracing complexity: Human rights in critical race feminist perspective », Columbia Journal of Gender and Law, 12-‐3, 2003, p. 510.
29
manière dont ce sont les concepts centraux de ce droit qui doivent faire l’objet d’un effort de réimagination157. Que reste-‐t-‐il du féminisme internationaliste à l’heure de l’intersectionnalité, du genre et de la critique des universels? Sans doute beaucoup plus qu’il n’y paraît pour les féministes critiques (lesquelles dans leur grande majorité continuent de se définir comme féministes), à condition de redéployer son attention. Plutôt que de se préoccuper uniquement du tchador de la femme afghane, de la femme indienne victime de viol, ou des organes génitaux de la femme malienne (avec tout ce que ces obsessions charrient de concepts connotés sur les rapports entre cultures, etc), on s’intéressera à la femme afghane victime des bombardements américains, la femme indienne produit d’une vie urbaine en pleine mutation du fait de vastes reconfigurations migratoires, ou la femme malienne victime d’une société profondément appauvrie par l’exploitation des sols, afin de mettre en exergue les véritables « chaînes de production » de l’inégalité de genre, au-‐delà de la « mentalité de crise » internationaliste qui ne fait percevoir les problèmes que lorsqu’ils ne peuvent plus être « résolus » que par la violence158. On portera attention au potentiel d’obfuscation de certaines constructions hyper-‐genrées, telle que la « guerre contre le terrorisme »159. La méthodologie féministe se doit d’être disciplinairement transgressive, ce qui implique notamment d’incessants allers retours entre le local et le global, l’interne et l’international. A ce titre, le droit international s’est trop longtemps donné le beau rôle d’apporter des remèdes libéraux (participation, transparence, remèdes, responsabilité) à des injustices qu’il a structurellement concocté et continue de soutenir160. C’est donc les rapports entre la condition des femmes d’une part, et la conception dominante de l’économie politique internationale161, de la démocratie(sation), de la reconstruction de l’Etat et de la justice transitionnelle162, ou encore de l’auto-‐détermination163 et de la guerre et de la
157 Charlotte BUNCH, « Transforming human rights from a feminist perspective », Women’s Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives, 11, 1995. 158 H. CHARLESWORTH, « International Law: A Discipline of Crisis »..., op. cit. ; Dianne OTTO, « Remapping crisis through a feminist lens », in Sari KOUVO et Zoe PEARSON (éd.), Feminist Perspectives on Contemporary International Law: Between Resistance and Compliance?, Bloomsbury Publishing, 2014, . 159 Laura J. SHEPHERD, « Veiled references: Constructions of gender in the Bush administration discourse on the attacks on Afghanistan post-‐9/11 », International Feminist Journal of Politics, 8-‐1, 1 mars 2006, p. 19‑41. 160 Hilary CHARLESWORTH, Christine CHINKIN et S. WRIGHT, « Feminist Approaches to International Law: Reflections from Another Century », in Doris BUSS et Ambreena MANJI (éd.), International Law: Modern Feminist Approaches, Portland, Hart Publishing Ltd., 2005, p. 126. 161 Voir notamment Zillah EISENSTEIN, « Stop stomping on the rest of us: retrieving publicness from the privatization of the globe », Indiana Journal of Global Legal Studies, 1996, p. 59‑95 ; Saskia SASSEN, « Toward a feminist analytics of the global economy », Indiana Journal of Global Legal Studies, 1996, p. 7‑41 ; Suzanne LAFONT, « One step forward, two steps back: women in the post-‐communist states », Communist and post-‐communist studies, 34-‐2, 2001, p. 203‑220 ; B. STARK, « Women and globalization: The failure and postmodern possibilities of international law »..., op. cit. ; Marianne H. MARCHAND et Anne Sisson RUNYAN, Gender and Global Restructuring: Sightings, Sites and Resistances, Routledge, 2005. 162 Fionnuala Ní AOLAIN, « Political violence and gender during times of transition », Colum. J. Gender & L., 15, 2006, p. 829 ; Dina Francesca HAYNES, « Lessons from Bosnia’s Arizona Market: Harm to women in a neoliberalized postconflict reconstruction process », University of Pennsylvania Law Review, 2010, p. 1779‑1829 ; Julie MERTUS, « Human Rights of Women in Central and Eastern Europe », American University Journal of Gender and the Law, 6, 1998 1997, p. 369 ; Christine CHINKIN et Kate PARADINE, « Vision and reality: democracy and citizenship of women in the Dayton Peace Accords », Yale J. Int’l L., 26, 2001, p. 103 ; Rosemary NAGY, « Transitional Justice as Global Project: critical reflections », Third World Quarterly, 29-‐2, 1 février 2008, p. 275‑289. 163 Karen KNOP, Diversity and Self-‐Determination in International Law, Cambridge University Press, 2002, p. -‐.
30
paix164 d’autre part, qui doivent permettre d’aboutir à une vision beaucoup moins superficielle de la nature de l’oppression que subissent les femmes. Le féminisme, remarquons le, ne saurait être un îlot critique isolé, et doit au contraire se penser comme faisant partie d’un archipel critique plus large. Le moment est peut être venu d’ailleurs de redécouvrir la manière dont le féminisme, notamment à ses tous débuts, a été fortement associé à des projets radicaux, que ce soit celui de l’anti-‐esclavagisme165, de la paix internationale166, de l’anti-‐nationalisme167, ou de l’anti-‐impérialisme168 et, plus proche de nous, de l’anti-‐mondialisation169, à l’opposé de certaines associations dominantes contemporaines. C’est à travers ces associations transnationales corrosives plutôt que dans l’investissement exclusif et périlleux des lieux de pouvoir supranationaux que résident sans doute encore les plus belles potentialités du féminisme. Peut être que dans certains cas le discours du droit international peut être subverti et « retourné » contre lui-‐même170. 30 ans après l’article de Charlesworth, Chinkin et Wright il pourrait y avoir pire destin pour la pensée féministe appliquée au droit international que d’être devenu un « féminisme de gouvernance », mais le danger d’être happé par le pouvoir que l’on cherche à conquérir demeure une leçon à garder à l’esprit, et qui vaut pour d’autres171.
164 Beth VAN SCHAACK, « Grass That Gets Trampled When Elephants Fight: Will the Codification of the Crime of Aggression Protect Women, The », UCLA J. Int’l L. Foreign Aff., 15, 2010, p. 327. 165 Clare MIDGLEY, Women Against Slavery: The British Campaigns, 1780-‐1870, Taylor & Francis, 1995. 166 Jo VELLACOTT, « A place for pacifism and transnationalism in feminist theory: the early work of the women’s international league for peace and freedom », Women’History Review, 2-‐1, 1993, p. 23‑56 ; Lela B. COSTIN, « Feminism, pacifism, internationalism and the 1915 International Congress of Women », Elsevier, 1982, vol.5 ; Catia Cecilia CONFORTINI, « Doing Feminist Peace », International Feminist Journal of Politics, 13-‐3, 1 septembre 2011, p. 349‑370. 167 Louise RYAN, « Traditions and double moral standards: the Irish suffragists’ critique of nationalism [1] », women’sHistory Review, 4-‐4, 1995, p. 487‑503. 168 L.J. RUPP, « Constructing Internationalism »..., op. cit. 169 Chandra Talpade MOHANTY, « “Under Western Eyes” Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles », Signs, 28-‐2, 1 janvier 2003, p. 499‑535. 170 Khanyisela MOYO, « Feminism, Postcolonial Legal Theory and Transitional Justice: A Critique of Current Trends », International Human Rights Law Review, 1-‐2, 1 janvier 2012, p. 237‑275. Pour une vision plus sceptique, R. BUCHANAN et S. PAHUJA, « Collaboration, cosmopolitanism and complicity »..., op. cit. 171 Frédéric MEGRET, « The Apology of Utopia: Reflections on Some Koskenniemian Themes with Particular Emphasis on Massively Institutionalized Human Rights Law », Temple International and Comparative Law Journal, 2014.