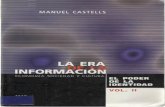Fortificaciones de la Guerra Civil en la sierra de la Comunidad de Madrid
Etude de l'occupation ancienne de la Côte viticole et de la plaine de la Saône au travers de...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Etude de l'occupation ancienne de la Côte viticole et de la plaine de la Saône au travers de...
Mémoire de Master 2 Recherche AGES
Etude de l’occupation ancienne de la Côte viticole et de la plaine de la Saône au travers de traces parcellaires et culturales révélées en
microtopographie LiDAR
Guery, JulienSous la direction de Jean-Pierre Garcia, Professeur des Universités
2012-2013
Remerciements
Ce mémoire conclut un an et demi de travail sur la technologie LiDAR et les archéo-terroirs de la région dijonnaise. Je tiens en premier lieu à remercier Jean-Pierre Garcia, professeur des universités, à l’initiative de cette étude et tuteur attentif, pour sa confiance et son soutien constant. Je tiens également à remercier Etienne Ducasse, avec qui j’ai effectué la première partie de cette étude en 2012, pour sa présence et ses conseils avisés.
Mes remerciements vont ensuite à Yves Pautrat, conservateur en chef du patrimoine (SRA), pour le vif intérêt qu’il a toujours porté à nos travaux et pour nous avoir permis d’effectuer les opérations de prospections et de sondages nécessaires, avec l’accord de Michel Prestreau, conservateur du patrimoine, et de Jean-François Armbruster, maire d’Epernay-sous-Gevrey extrêmement enthousiaste à propos de nos recherches.
Cette étude n’aurait évidemment pas été possible sans le concours de Laure Saligny et Ludovic Granjon (MSH Dijon) et d’Aldo Gravotta (Service Aménagement et Patrimoine, RFF) qui ont mis à notre disposition les jeux de données nécessaires.
Merci également à Marion Foucher (Artehis), Pierre Morlon (Agrosup) et André Dendiével pour la documentation fournie et le temps accordé, Ronan Steinmann pour son soutien, ainsi qu’à Nicole Guery pour ses traductions depuis l’allemand et pour ses relectures et corrections.Enfin mes remerciements à Raphaël Hautefort (société Captair) et Samuel Nahmani (IGN) pour leur soutien et la réalisation du relevé orthophotographique haute résolution de la tranchée réalisée à Epernay-sous-Gevrey.
Sommaire
Introduction 4Contexte géo-environnemental 5Contexte historique 10
I) Technologie et méthodes de reconnaissance 16A) Technique LiDAR et traitements 16
a) Acquisition des données 16b) Premiers traitements des MNT 16c) Génération d’ombrages 17
Fragmentation des données 17Choix des azimuts 17
d) Vectorisation des structures 18Modalités de vectorisation 18Vectorisation des structures PPH2S 18Analyse statistique 19
e) Problématiques 19B) Champs bombés : ambiguïté du terme 21
a) Qu’est-ce qu’un champ bombé ? 21b) La terminologie française 21c) Un seul terme pour des pratiques différentes 22d) Un champ bombé ou des champs bombés ? 23e) Confusion des termes 23
C) Reconnaissance des « champs bombés » en microtopographie LiDAR 25a) Variabilité de forme 25
les surfaces couvertes 25le type de préservation 25la localisation des vestiges 26
b) Définition d’une nouvelle terminologie 26D) Reconnaissance sur le terrain des structures en arêtes et sillons 28
II) Etude des structures parcellaires et agraires observées en microtopographie 32A) Structures en arêtes et sillons (« champs bombés ») 32
a) Analyse statistique : comparaison des ensembles de données LGV et CV 32Analyse de l’orientation des sillons (comprise entre 0 et 180°N) 32Analyse de la longueur des sillons 33Analyse de l’amplitude et de la fréquence des sillons 34
b) Secteur de la Côte viticole (plaine et plateau) 38Description des ensembles 38Sondage d’Epernay-sous-Gevrey 43
c) Secteur de Genlis 46Descrption des ensembles 46Description des anomalies microtopographiques repérées 49Lien avec le site de Bressey-sur-Tille 51
B) Structures de type « grand parcellaire » 53a) Caractérisation sur l’ensemble du plateau et de la plaine 53
Analyse en terme de surface 53Analyse en terme d’orientations 53
b) Lien avec les constructions du secteur d’Entre-deux-Monts 55C) Structures de type « petit parcellaire » 56
a) Ensemble de Chambolle-Musigny (Vougeot) 56b) Ensembles de Gevrey-Chambertin 57c) Conclusions 57
III) Discussion 60A) Chronologie des parcellaires 60B) Les archéo-terroirs : compréhension des espaces sur le temps long 61C) L’espace dijonnais : un espace en mouvement 61
Conclusions 63
Références bibliographiques 65Ouvrages et articles 65Sites internet 69Cartes 69
4 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
Au cours des dernières années la technologie LiDAR s’est développée considérablement et les prospections se sont multipliées. Cette technologie fournit un outil puissant qui peut être mis au service de nombreuses disciplines comme la géomorphologie ou l’archéologie.Sa particularité est de fournir une information dense et précise sur de très grandes surfaces. Son utilisation s’intègre parfaitement dans des problématiques géoarchéologiques, c’est à dire visant une approche multidisciplinaire et synoptique. Par la richesse des données fournies et les contextes extrêmement variés pouvant être abordés lors d’une prospection LiDAR, l’utilisation de cette technologie appelle à repousser les limites entre les différentes disciplines, « sciences dures » et « sciences humaines ». Pour comprendre au mieux la complexité des réalités révélées, il s’agit alors de dépasser les clivages, de se tourner vers des cadres spatio-temporels beaucoup plus larges que d’ordinaire, et, en évitant l’écueil d’une accumulation de données indigestes, de porter une réflexion profonde sur les enjeux liés à ces réalités. Ainsi la prospection LiDAR conduite sur la Côte viticole de Nuits en mars 2010 a été commandée par l’UMR ArTeHiS (Resp. J.-P. Garcia, Université de Bourgogne) et la MSH Dijon (Resp. L. Saligny) avait pour but l’étude des processus d’érosion sur les parcelles viticoles et la mise en évidence de structures archéologiques, notamment parcellaires. Inédite sur la région, cette prospection a permis d’aborder sur 86 km2 les milieux très diversifiés qui font la richesse du paysage de la Côte viticole : le plateau calcaire en grande partie couvert de forêts, les versants secs que colonise la vigne, entaillés de combes abruptes et de falaises, et enfin la plaine de la Saône partagée entre forêts, cultures céréalières et prés.
En 2012, le stage de master 1 AGE a été l’occasion d’effectuer un traitement exploratoire des Modèles Numériques de Terrain (MNT) produits. Ce traitement visait à identifier les anomalies microtopographiques (irrégularités, fossés, murs, tertres…) et à en faire l’inventaire. Plus de 1200 structures, archéologiques et géomorphologiques, ont ainsi été intégrées à une nouvelle base de données (Base de Données LiDAR de la Côte – BDLC) et se sont vues attribuer un code ; d’après une classification permettant d’identifier, via un dendrogramme, des anomalies visibles en imagerie géophysique (Ducasse et Guery, 2012, p. 29). Parmi elles on a constaté la présence d’un grand nombre de structures de type parcellaire : des reliefs linéaires, hectométriques, plus ou moins arasés mais préservés sur l’intégralité du secteur. Ces structures formaient ce que nous avons qualifié de « trame parcellaire complexe » révélant, au mépris des parcelles modernes, une organisation du territoire et un paysage radicalement différents de ce que nous observons aujourd’hui. La découverte majeure de cette prospection était la présence de structures connues sous le nom de « champs bombés » sur une surface d’environ 5 km2 sous forêts. Ces traces culturales anciennes (à la datation pour l’instant indéterminée) ont été également repérées beaucoup plus à l’Est dans la plaine de la Saône lors de la prospection LiDAR conduite sur le tracé de la LGV, à proximité de Genlis. Nous concluions cette première étude en insistant sur l’importance du facteur humain dans la construction et l’évolution d’un environnement, et sur la probable sous-estimation de l’occupation ancienne du territoire dijonnais. Ceci nous amène donc aujourd’hui à ouvrir une réflexion sur cette « trame parcellaire » et sur les enjeux qui gravitent autour de la découverte de ces structures. Cette réflexion arrive dans un contexte de recherche sur les archéo-terroirs et sur la construction de la Côte viticole à travers ses climats, candidats au patrimoine mondial de l’Unesco. On notera également les études en cours sur les secteurs du Val Suzon et du Chatillonnais, essentiels dans l’histoire de l’espace dijonnais. La dynamique d’évolution de la région de Dijon est donc au centre de nombreuses études portant sur des secteurs fondamentaux à sa construction.
La problématique portera ici sur l’impact de la découverte des traces parcellaires observée en microtopographie LiDAR : Comment et quand ont-elles organisé le sud du dijonnais ; et comment ont-elle participé à l’évolution et à la construction du paysage tel qu’il est visible aujourd’hui ? On s’interrogera également sur ce qu’implique l’utilisation de la technologie LiDAR : Quel est l’apport de la microtopographie à la compréhension de l’organisation, et de l’évolution, d’un espace ; et en quoi la réalité observée en microtopographie conduit-elle à une nouvelle approche de l’archéogéographie ?
5 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Contexte géo-environnemental
La région dijonnaise se situe à l’extrémité nord-ouest du fossé Bressan (Fig. 1). Elle s’insère ainsi entre les plateaux calcaires du Jurassique et la plaine de la Saône. Celle-ci est irriguée par de nombreux affluents prenant leur source dans les plateaux ou à leurs pieds. Les principaux dans la région dijonnaise sont l’Ouche, le Suzon, la Tille, la Norges ou encore la Vouge. Le bord ouest du fossé d’effondrement bressan est caractérisé par l’un des grands ensembles géologiques français : la Côte viticole. Elle forme un relief en gradins, descendant vers la plaine de la Saône, formé par la combinaison des contraintes lithologiques et tectoniques (Rat, 1986). La limite très nette marquée par le pied de la Côte viticole correspond ainsi à une immense faille normale et ses versants sont parcourus par de nombreuses failles satellites avec des rejets de plusieurs dizaines de mètres. Ces failles, liées à l’orogenèse varisque, ont une orientation N10-N20. Elles sont recoupées par un système de failles subméridiennes (Garcia, 2011, p. 99).Cette multitude de failles juxtapose des terrains de nature et d’âge différents, mettant ainsi à l’affleurement quasi toute la série sédimentaire du Jurassique. La Côte n’est ainsi pas seulement viticole ; c’est aussi un bassin carrier majeur, exploité de tous temps. Le calcaire de Comblanchien, les pierres de Prémaux, de Ladoix ou de Dijon-Corton ont ainsi été utilisés pour nombre de construction (on retrouve le calcaire de Comblanchien dans de nombreux monuments dijonnais et parisiens). Ces formations sédimentaires appartiennent au Dogger. Elles précèdent dans la série sédimentaire bourguignonne un niveau d’oolithe ferrugineuse et des niveaux marno-calcaires oxfordiens marquant le plateau.L’identification de ces matériaux permet de localiser l’origine des blocs utilisés dans les constructions, et ainsi de dater les carrières qui maculent la Côte. La datation de ces carrières est un élément de compréhension de l’occupation des versants, aujourd’hui colonisés par une viticulture prestigieuse. C’est en effet au pied des falaises de Calcaire de Comblanchien, parfois même dans d’anciennes carrières, que se sont développés les climats de la Côte de Nuits. L’alternance de marnes et de calcaires (calcaires à entroques du Bajocien, marnes à Ostrea acuminata…) donne ainsi aux versants de Gevrey Chambertin, de Morey-Saint-Denis ou encore de Chambolle-Musigny un profil concave tout à fait caractéristique (Garcia, 2011, p. 99). Les formations sédimentaires de la série bourguignonne sont ainsi à elles-seules à l’origine de nombreux traits emblématiques des paysages dijonnais.
Ces formations sédimentaires abritent également un réseau karstique complexe, à l’origine d’un large réseau hydrographique. L’ensemble du plateau est entaillé par des vallées actives (l’Ouche, le Suzon) et des vallées sèches (la combe Lavaux, la combe Valton, la combe à la serpent…) creusées lors des transitions glaciaire-interglaciaire du Quaternaire. Le pied de la Côte et la faille normale principale de la région sont couverts par les dépôts d’alluvions et de colluvions provenant de ces vallées. La microtopographie LiDAR a révélé d’immenses paléochenaux prolongeant le tracé des combes de la Côte viticole jusque dans la plaine de la Saône (Ducasse et Guery, 2012, p. 48-49). Ces paléochenaux connectent en fait entre eux le réseau hydrographique des combes et celui des affluents de la Saône. De nombreux cours d’eau naissent en effet au pied de la Côte et entaillent les dépôts plio-pléistocènes de la plaine (à l’exemple de la Sans-Fond, affluent de la Vouge, prenant sa source à Fénay). Cet immense réseau hydrographique irriguant la plaine de la Saône résulterait d’écoulements torrentiels sur le permafrost de la Côte lors des transitions glaciaire-interglaciaire du Quaternaire. La Côte était en effet une zone périglaciaire, à proximité des glaciers jurassiens, et possédaient un épais permafrost imperméable sur lequel les eaux de fonte ruisselaient. Ces écoulements torrentiels auraient poursuivi leurs trajectoires depuis les combes jusque dans la plaine de la Saône, creusant les dépôts sédimentaires du fossé bressan et mettant à l’affleurement de nombreuses nappes d’eau. Lors de la dernière transition glaciaire-interglaciaire, ce grand réseau hydrographique périglaciaire a laissé la place à un nouveau réseau issu de ces nappes d’eau et prenant sources dans la plaine elle-même. Ce nouveau réseau a continué de surcreuser les dépôts plio-pléistocènes de la plaine, tandis que les chenaux d’origine devenaient en amont des vallées sèches.Ces paléochenaux sont partiellement comblés par des barres graveleuses d’âge éburonien ou waalien (Garcia, 2009). Sur la carte géologique (Fig. 1, Feuilles de Beaune, Dijon et Gevrey-Chambertin) on retrouve tant au niveau des paléochenaux que des chenaux des cours d’eaux actuels la formation sédimentaire « SC » correspondant aux « limons et cailloutis des vallées sèches ».
6 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Ce vaste réseau hydrographique est au cœur de nombreux enjeux. Si la Côte est un secteur particulièrement sec, par l’action drainante du réseau karstique, la plaine qui s’étend à ses pieds est très humide, voire marécageuse.En 312 ap. J.-C., dans le Panégyrique à Constantin, le Pagus Arebrignus, situé entre la Saône et la Côte, est décrit comme une plaine humide et abandonnée :« Or, cette fameuse plaine qui est à leurs pieds et qui s’étend jusqu’à la Saône, fut, à ce que j’entends dire, certes charmante autrefois, quand l’évacuation des eaux était assurée par l’entretien continu des fossés ouverts qui drainaient les limites de chaque domaine. Mais maintenant, en raison des canaux obstrués par les dégradations, même si une terre située dans le bas est fertile, elle est transformée en mares et en marécages. » (nouvelle traduction ; Garcia, 2010). Cette forte humidité des terrains, par exemple vers Epernay-sous-Gevrey ou Saint Philibert, est à mettre en relation avec la forte teneur en argiles des formations géologiques qui composent le secteur (Légende de la carte géologique 1/50 000 – Feuilles de Gevrey, Dijon (BRGM) : « P » : Argiles et marnes à lentilles de sables fins et à minerai de fer (couverture argileuse se prolongeant du nord par K) (Villafranchien ? Pliocène ?) ; « K » : « limons rouges » de la plaine à éclats de chailles et dragées de quartz albiennes (Solifluxion würmienne ?) ; « Fz » : Terrasse de 1-4 m argilo-limoneuse ; « Fx » : Terrasse de 15-17 m argilo-limoneuse (Pléistocène moyen) ; « Fw » : Terrasse de 27-32 m argilo-limoneuse ; Fig. 2).
L’organisation du territoire et la dynamique d’évolution du secteur sont intimement liées à ce contexte géoenvironnemental. Ce sont dans ces terrains marécageux que la majorité des traces culturales nommées « champs bombés » dans la littérature sont retrouvées (Ducasse et Guery, 2012, p. 76-80).Plus à l’Est dans la plaine de la Saône (toujours sur la Feuille de Dijon de la carte géologique), on retrouve dans les mêmes terrains les mêmes traces culturales (sur le trajet de la LGV Rhin-Rhône, branche est, phase 2, données LiDAR RFF). Plus près de la Côte, les voies de communication principales, et avec elles les différents villages, semblent s’aligner selon l’axe N10-N20 du relief. Les combes, elles, guident un réseau de voies secondaires vers les villages du plateau (Chamboeuf par la combe Lavaux par exemple). En s’éloignant vers l’Est, l’influence du relief de la Côte sur la disposition des villages diminue tandis que ceux-ci semblent s’organiser par rapport au réseau hydrographique (proximité de cours d’eau secondaires, d’affluents de la Saône tels que la Vouge, l’Ouche ou encore la Tille). Cette différence d’organisation marque la limite entre les villages viticoles (comme Gevrey-Chambertin) et les villages de la plaine de la Saône (comme Epernay-sous-Gevrey), limite grossièrement dessinée par l’autoroute A311. Cette différence d’organisation et l’importance donnée aux cours d’eau doivent aussi certainement être mises en relation avec le rôle des cisterciens dans le développement de ces villages. Initialement installés dans les terrains boisés et humides de la plaine, ceux-ci étendront progressivement leur influence vers la Côte, notamment le long de la Vouge jusqu’à Gilly-lès-Cîteaux et Vougeot (Moniot, 1955).
Le territoire est donc le fruit de l’interaction entre les facteurs géoenvironnementaux et les facteurs humains qui modèlent les paysages. Les contraintes géologiques d’une part, les contraintes anthropiques de l’autre, constituent un cadre dans lequel se développe un espace en permanente évolution. A l’interface, comme prenant l’empreinte de ces contraintes géologiques et anthropiques, se trouvent les sols et les processus de pédogenèse. Profondément liés à la nature du substrat géologique, ils ne cessent également d’enregistrer l’activité humaine. Si on peut associer les propriétés d’un horizon pédologique à la roche mère dont il est issu, on sait également que ces propriétés peuvent être radicalement modifiées, et sur le long terme, par l’occupation humaine. Travaux agricoles, activités pastorales, constructions, aménagements, pollutions, sélection des essences végétales… altèreront la composition chimique et la structure d’un sol. Ces transformations seront lisibles des siècles plus tard par l’accumulation de certains éléments chimiques (phosphates, nitrates…) associée à des assemblages végétaux caractéristiquement différents des assemblages végétaux dits « naturels » (Nuninger et al., 2010). Les principales espèces végétales caractérisant la région (plaines et plateaux) sont les chênes pédonculés (dominants), sessiles (fréquents) et pubescents (Quercus pedunculata, Quercus petraea, Quercus pubescens), les hêtres (Fagus), l’érable champêtre (Acer campestre), les frênes (Fraxinus) et le noisetier commun (Corylus avellana). Cet assemblage végétal est caractéristique d’un peuplement relativement récent (Curmi et al., 2008).
7 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Les versants et les combes seront eux couverts par trois types de végétation : - rase et essentiellement constituée de buis commun (Buxus sempervirens) et de genévrier commun (Juniperus communis), caractéristique des sols calcaires secs couvrant la Dalle Nacrée et le calcaire de Comblanchien - composée de résineux et liée à l’exploitation forestière avec des sapins Douglas (Pseudotsuga menziesii), des pins sylvestres (Pinus sylvestris) et plus rarement des pins noirs (Pinus nigra) - très jeune avec en grande proportion le noisetier commun (Corylus avellana), le charme (Carpinus) et le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea).
Une fois encore, cette végétation à l’implantation relativement récente témoigne de l’importance et de l’ancienneté de l’impact de l’activité humaine sur des paysages que nous voulons parfois voir comme entièrement « naturels ». Si les facteurs anthropiques marquent tellement le géoenvironnement, au moins autant que les facteurs géologiques, leur impact ne doit pas forcément être perçu comme négatif. Ils font partie d’un ensemble de facteurs modelant un paysage en perpétuelle évolution. L’étude du contexte archéologique et l’évaluation de cette activité humaine sont ainsi une suite logique à ces considérations géoenvironnementales.
8 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Fig.
1 : C
arte
géo
logi
que
de la
Côt
e de
Nui
ts e
t de
la h
aute
pla
ine
de la
Saô
neFe
uille
s de
Beau
ne, D
ijon
et G
evre
y--C
ham
bert
in (S
ourc
e : B
RGM
- In
fote
rre)
9 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Fig. 2 : Légende de la carte géologique de la Côte de Nuits et de la haute plaine de la SaôneFeuilles de Beaune, Dijon et Gevrey-Chambertin (Source : BRGM - Infoterre)
10 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Contexte historique
Unité à part entière de la géographie bourguignonne, le secteur de la Côte viticole et de la plaine qui s’étend à ses pieds recèle une Histoire riche et complexe. A l’interface entre l’Europe septentrionale et le monde méditerranéen, puis à la frange des territoires éduens et lingons, territoire des burgondes, enfin siège de la royauté puis du Duché de Bourgogne et berceau du pouvoir cistercien, l’espace dijonnais est au cœur de nombreux enjeux.
Comme l’ont montré les premiers traitements effectués sur les prospections LiDAR conduites sur le secteur de la Côte de Nuits (Ducasse et Guery, 2012) et le secteur de Genlis (tracé de la LGV ; Lecornué, 2012) l’occupation humaine ancienne documentée à ce jour semble parfois sous-estimée. Les découvertes de la Motte Castrale du Bois de Mondragon (Lecornué, 2012) ou du site de Charme Rousse (Ducasse et Guery, 2012, p. 68-70), tous deux associés à des modelés agraires de type « champs bombés » en sont les exemples les plus marquants.
La chronologie fournie ci-après est non-exhaustive et se base tant sur la Carte Archéologique Régionale de Bourgogne (SRA Dijon ; Ducasse et Guery, 2012 ; Fig. 3) que sur des ouvrages tels que La vie rurale en Bourgogne (Deléage, 1942) ou L’Histoire de la Bourgogne (Richard, 1984). Les sites archéologiques mentionnés en exemples et référencés dans la Carte Archéologique Régionale de Bourgogne sont suivis du numéro qui leur est attribué commune par commune dans les archives du SRA (Service Régional d’Archéologie).
Les vestiges archéologiques les plus anciens sur le secteur remontent au Paléolithique avec la collecte en surface de silex moustériens à Gevrey-Chambertin (site n°29) et à Couchey (n°63). Les premières implantations humaines sont répertoriées au Néolithique avec les éperons barrés de Château Renard à Gevrey-Chambertin (n°17) et de Chambolle-Musigny (n°1). Le peuplement néolithique est également attesté par la découverte de très nombreuses fosses d’extraction et de rejet, très riches en matériaux lithiques et en restes osseux, probablement chasséennes sur la commune de Brochon (Rapport de fouilles M2 AGES, 2012), et par la découverte de mobilier lithique à Fénay (n°5, 10, 11 et 12), toutes deux attestant de la présence d’habitats dans la plaine de la Saône.
La Carte Archéologique fait ensuite état d’un grand nombre de tumuli à la datation parfois incertaine (entre le néolithique et la période hallstattienne) auxquels s’ajoutent ceux découverts lors du traitement exploratoire des données LiDAR de la Côte (Ducasse et Guery, 2012). De l’Âge du Bronze au premier Âge du Fer, le secteur deviendra un espace de circulation majeur, à la frontière occidentale du monde hallstattien, avec le développement de la métallurgie et du commerce qui lui est associé (Mordant, 2009). On voit alors se multiplier les tumuli sur les hauteurs de la Côte (Tristan, 2009) comme à Chamboeuf (n°2, 5 et 6), à Couchey (n°1 à 6, 19, 22 et 40) ou encore à Gevrey-Chambertin (n°18, 32, 33 et 55). Des habitats et des monuments funéraires sont ensuite connus dans la plaine à l’Âge du Bronze, comme à Fénay sur le site fouillé de la Pièce Rouge (n°24), puis à l’Âge du Fer et notamment à la période laténienne, comme à Perrigny-lès-Dijon (n°3 et 16). De nombreux sites potentiels se présentant sous la forme d’enclos ont également été repérés en vue aérienne (essentiellement à travers les prospections de M. Goguey) sur les communes de Gevrey-Chambertin (n°9, 40 et 52), Fixin (n°14) ou encore Fénay (n°6 et 7). Avec d’une part un développement important des sites fortifiés et des tumuli sur les plateaux (la Tène A et B), et d’autre part dans un second temps le développement d’enclos funéraires et d’habitats dans la plaine (la Tène C et D), la région dijonnaise s’inscrit dans une grande aire culturelle dominant l’Est de la Bourgogne et la Franche-Comté occidentale. Cette singularité semble liée à la position frontalière du dijonnais, en marge du territoire lingon et à proximité des territoires éduens et séquanes, sujet donc à de nombreuses influences extérieures (Barral, 2009). Cette Bourgogne en devenir devient progressivement une unité de culture et d’échanges économiques entre des peuples qui sont à la fois en contact avec les régions productrices de métaux et le monde méditerranéen (Martin, 1984, p. 47-48).
La fin de la période laténienne est marquée par la fulgurante conquête des Gaules. Il est à noter que la région dijonnaise pourrait avoir été le théâtre de violents affrontements opposant les armées de Vercingétorix et
11 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
de César en 52 av. J.-C. (Constans d’après César, 1926, p. 304). Celui-ci raconte dans le Livre VII de la Guerre des Gaules (66. Défaite de la cavalerie gauloise) une bataille qui aurait lieue après la défaite de Gergovie et le soulèvement des Eduens, alors qu’il rejoignait la Province. « … César faisait route vers le pays des Séquanes en traversant l’extrémité du territoire des Lingons, afin de pouvoir plus aisément secourir la Province… »Bien que très débattue, la localisation de cette « fameuse «bataille de cavalerie» » (Martin, 1984, p. 51) pourrait se trouver à proximité du Suzon, entre Asnières-lès-Dijon et Bellefond, ou entre Norges et Varois (au Nord de Dijon) selon les auteurs. « Enfin les Germains, sur la droite, avisant une hauteur qui dominait le pays, bousculent les ennemis qui s’y trouvaient ; ils les poursuivent jusqu’à la rivière, où Vercingétorix avait pris position avec son infanterie, et en font un grand carnage. » D’après les notes de P. Fabre dans l’édition de 1950 (traduction de 1926 par L-A. Constans), la « hauteur qui domine le pays » pourrait correspondre aux hauteurs d’Asnières, tandis que « la rivière » serait le Suzon. P.-M. Duval y ajoute pour l’édition de 1981 une carte (Fig. 4) précisant 6 emplacements possibles, dont l’emplacement dijonnais. Au-delà du caractère épique du combat et du débat sur la localisation précise du site, on peut noter l’absence totale de mention d’une quelconque agglomération d’importance à proximité.Le contexte politique et militaire de l’époque permet de voir se dessiner l’évolution ultérieure de la région, « comprise entre les trois capitales des Eduens, des Sénons et des Lingons, soit Bibracte, Sens et Langres, alors que ce territoire n’avait lui-même aucun centre dominant. » (Martin, 1984, p. 46).
S’ensuit la période gallo-romaine, marquée par une forte occupation humaine au pied de la Côte de Nuits, une concentration exceptionnelle de villas et de fermes et le développement d’un imposant réseau routier. On note ainsi la voie Lyon-Trèves, itinéraire majeur, la voie reliant Nuits-Saint-Georges et Dijon et une multitude de voies secondaires, dont la voie de la Ferme de Sathenay qui relie les deux voies principales sur la commune de Gevrey-Chambertin (n°16). Toujours sur la commune de Gevrey-Chambertin, où l’on répertorie le plus de vestiges gallo-romains, on identifie de nombreuses nécropoles associées aux voies (n°8, 11, 19 et 41) ainsi que des villas (n°3, 4, 21, 30, 35 et 59). C’est également sur la commune de Gevrey-Chambertin (n°82) qu’ont été découverts 1,14 ha d’un vignoble gallo-romain (339 fosses de plantations) daté entre la fin du Ier siècle et le IIIème siècle (Chevrier et Garcia et coll., 2010).
La période gallo-romaine permettra un développement important de la région, sur les bases fortes de plusieurs siècles d’échanges, avant la grave période de crise du IIIème siècle. Fragilisée par l’anarchie dans l’organisation impériale après le règne des Sévères (197-235), la Gaule du Nord-Est connaît les premières attaques germaniques (Alamans et Francs). Des auteurs inconnus, longtemps assimilés au rhéteur Eumène, dressent dans les années qui suivent le tableau de la région dévastée, s’adressant en 297 à Constance-Chlore, puis en 312 à Constantin dans un des célèbres Panégyriques latins, rédigé depuis Autun pour la venue de L’Empereur.S’adressant à Constance-Chlore il décrit des campagnes désertées et la présence de populations germaniques pour remettre en culture ces terres : « … et tous ces êtres, répartis entre les habitants de vos provinces, pour servir chez eux, attendent d’être conduits sur les terres désolées dont ils doivent assurer la culture. Il me plaît, par Hercule, d’exulter au nom de toutes les Gaules et, avec votre permission, d’imputer le triomphe précisément au compte de ces provinces. C’est donc pour moi que labourent à cette heure le Chamave et le Frison, que ce vagabond et ce pillard peine à travailler sans relâche mes terres en friche, peuple mon marché du bétail qu’il vient vendre et que le laboureur barbare fait baisser le pris des denrées. » (Galletier, 1949, p. 89) Ce bel exemple de panégyrique, à la gloire de l’Empereur, laisse transparaître la situation dramatique d’où sort la région d’Autun qui se relève à peine (Hostein, 2012, p. 75). Les Chamaves et les Frisons, probablement parmi d’autres populations germaniques, sont présentes dans la région et travaillent la terre, apportant peut-être leur savoir-faire et leurs techniques. Le secteur reste relativement désolé : « … toute la contrée, y compris la vallée de la Saône et le pays entre Saône et Morvan, autrefois si bien mise en culture […] grâce à l’emploi judicieux de la chaux pour assainir et réchauffer les terres de cultures, redevenait le domaine des marécages, des buissons et des fourrés impénétrables, offrant des retraites inabordables aux bêtes fauves. Les vignobles eux-mêmes sont si mal soignés et taillés qu’ils redeviennent sauvages et ne fournissent plus de récolte. » (Martin, 1984, p.58).
12 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Cet abandon à la friche des terres semble se généraliser à la fin de l’époque impériale avec la multiplication des agri deserti (Bloch, 1931, p. 53). Cette description fournie sans sources par Roland Martin semble correspondre au tableau dépeint à Constantin en 312. Le Pagus Arebrignus, localisé entre la Saône (Arar) et le relief de la Côte, y est décrit en ces termes : « Bien plus ce fameux « Pagus Arebrignus » lui-même est bien vainement jalousé puisqu’on n’y voit de cultures de vignes qu’en une seule situation; en arrière, d’autre part, ce ne sont que lieux impraticables de forêts et de grottes, sûres tanières de bêtes sauvages. Or, cette fameuse plaine qui est à leurs pieds et qui s’étend jusqu’à la Saône, fut, à ce que j’entends dire, certes charmante autrefois, quand l’évacuation des eaux était assurée par l’entretien continu des fossés ouverts qui drainaient les limites de chaque domaine. Mais maintenant, en raison des canaux obstrués par les dégradations, même si une terre située dans le bas est fertile, elle est transformée en mares et en marécages. Ainsi les vignes mêmes, qui sont admirées par ceux qui ne connaissent pas ce qu’elles étaient, sont à ce point amoindries par la vieillesse qu’elles ont maintenant du mal à profiter des soins qu’on leur prodigue. En effet les racines des ceps, dont nous ne savons presque plus l’âge, empêchent de donner aux fosses une profondeur normale à cause de leurs multiples et énormes replis. En conséquence, les provins se trouvent à découvert, lavés par les pluies, brûlés par le soleil. Et nous ne pouvons pas, comme c’est courant en Aquitaine et dans d’autres provinces, allouer n’importe où un terrain à une nouvelle vigne, car sur la partie supérieure ce n’est qu’une suite de rochers, et dans la partie basse, une terre de maigre qualité exposée aux gelées. » (Garcia, 2010 ; nouvelle traduction, Panégyriques latins VI, 4-8)
Ces textes décrivant le paysage ancien dans le secteur fournissent des éléments clés à la compréhension des archéo-terroirs. La position du vignoble, l’abandon aux bêtes sauvages des versants et des bois, et la transformation en marécages des zones fertiles sont autant d’éléments qui permettent d’imaginer la façon dont les grands parcellaires et les modelés agraires, repérés lors du traitement exploratoire des données LiDAR de la Côte, ont pu se mettre en place sur le secteur (Ducasse et Guery, 2012).
Complétant le silence des archives textuelles à propos des agglomérations voisines d’Autun, les vestiges archéologiques témoignent de l’instabilité de l’époque avec l’édification des fortifications du castrum de Dijon. Agglomération secondaire liée au réseau viaire, Dijon est probablement fondée pendant la période de prospérité gallo-romaine. La construction de ses fortifications, faites « des blocs arrachés aux édifices ou des stèles extraites des nécropoles », autour d’un noyau urbain réduit semble indiquer une forte réduction de la population et « la nécessité d’une défense rapide contre des incursions imprévues dans un pays jusqu’alors largement ouvert. » (Martin, 1984, p. 58). L’Histoire et l’urbanisme de la ville avant cette période de crise, tout au long du Haut Empire, reste assez mal documentée. Au cours des siècles suivants, sous la domination des Burgondes convertis au christianisme, et sous l’influence de l’Evêque de Langres (qui y réside, depuis Urbain, Vème siècle) un groupe cathédral est construit ainsi que plusieurs basiliques et églises (Escher, 2006, p. 154). C’est à cette période qu’apparaît ce qui deviendra le Royaume de Bourgogne. Dijon fait alors partie du Deuxième Royaume des Burgondes, la Sapaudia, qui leur est donné en 443 par Aétius (représentant du pouvoir impérial d’Occident de Valentinien III, dernier des Théodosiens) (Guichard, 1965, p. 211) suite à la destruction de leur Premier Royaume localisé vers Mayence et Francfort (Escher, 2006, p. 65). La Sapaudia deviendra le Royaume de Bourgogne, ou Burgondie. En 480 Dijon est mentionné par Grégoire de Tours racontant la fuite de l’Evêque de Langres Aproncule (Aprunculus) qui craint une alliance entre Burgondes et Francs. Vers 500, la bataille de Dijon (aux portes de la ville, probablement vers l’actuel Saint-Apollinaire) oppose Clovis et Gondebaud, roi burgonde (Escher, 2006, p. 102-109). C’est la première des 3 campagnes franques, qui se solderont par la fin du Royaume burgonde en 534, sous le commandement de Clotaire et Childebert, fils de Clovis qui s’opposent à Godomar, dernier des rois burgondes (Escher, 2006, p. 140). La Burgondie mérovingienne puis carolingienne, désormais partie intégrante du Royaume franc puis du Royaume de France, cédera la place près de 4 siècles plus tard au Duché de Bourgogne lorsque Boson de Provence est fait roi et rétablit le Royaume de Bourgogne, après la mort de Louis II le Bègue. Le frère de Boson, Richard le Justicier sera fait par le Roi de France (Eudes Ier) Marquis de Bourgogne en 898 et deviendra en 918 le premier Duc de Bourgogne, ouvrant ainsi la dynastie des Bosonides, première dynastie du Duché (Marilier et Richard, 1984, p. 110).
13 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Le Haut Moyen-Âge, sous la domination franque et les prémisses de la royauté française, est une période de forte évolution de la région dijonnaise, et de développement des terroirs (Deléage, 1942, p. 115). On localise des nécropoles mérovingiennes à Gevrey-Chambertin (n°7 et 46) et à Brochon (n°5) le long de la RN74, tandis que le vignoble remonte progressivement sur les versants, autour de villages dont les premières mentions s’échelonnent du VIIème siècle pour Gevrey-Chambertin (première trace en 630 sous la forme de Gibriacus) au IXème siècle pour Gilly-lès-Cîteaux (première trace en 815 sous la forme de Giliacus), indiquant une implantation probablement antérieure (Roserot, 1924). On voit alors se développer des finages particuliers basés sur la polyculture alliant élevage, culture céréalière et maraichère, et viticulture (Garcia, 2011). Les petites seigneuries se multiplient et se partagent les terres, tels que nous l’enseignent les testaments mérovingiens et carolingiens qui nous sont parvenus (Deléage, 1942, p. 231-238). Portée par les communautés paysannes (Deléage, 1942, p. 361), les seigneuries et le Duché de Bourgogne, la viticulture connaît un essor important, commençant à modifier durablement le paysage de la Côte. L’extension de la viticulture aux versants fera apparaître les premiers meurgers (tas d’épierrement des parcelles, ayant aussi pour fonction de limiter l’érosion des sols) et les premiers clos (Garcia, 2011, p. 100). Le développement de la viticulture sur les plateaux n’est pas le seul bouleversement que connaît l’agriculture bourguignonne. Soumis aux influences germaniques, la gestion des sols et de la propriété des exploitations est profondément modifiée avec le développement de l’open field et de la pratique de l’assolement (Bloch, 1931, p. 75-76). L’exploitation en communauté et la pratique de la rotation des cultures, système extrêmement égalitariste répartissant des parcelles laniérées étroites à chaque exploitant (Bloch, 1931, p. 85 ; Callot, 1980, p. 174-175) vient se juxtaposer aux larges domaines viticoles à propriétaires uniques (Garcia, 2011, p. 104-105). Il y a à l’intérieur des finages des villages viticoles, chevauchant le plateau, les versants et la plaine, une diversité de production tout à fait singulière. C’est dans ce contexte que se développe l’économie cistercienne dès le XIème siècle. Arrivant de Molesme en 1098, les premiers Cisterciens s’installent dans la contrée boisée et désertée de Cîteaux, vivant selon les principes strictes de leur ordre et bénéficiant de « donations pieuses » (Moniot, 1955, p. 10-12). Dans les siècles suivants, ils feront cependant preuve d’un appétit féroce dans leurs acquisitions, augmentant leurs possessions jusqu’à la Côte viticole et Vougeot, au détriment des seigneurs et du Duché. Les Cisterciens trouvent dans les terres parfois encore désertées aux limites des finages un terrain tout trouvé pour développer une économie forte qui modifiera profondément la région (Moniot, 1955, p. 17). Exploitants viticoles et producteurs de vin, ils développent également une production piscicole d’envergure, créent un grand nombre d’étangs et acquièrent une quarantaine de kilomètres de cours d’eau (Berthier, 2006). Cette acquisition massive de terres entre le XIème et le XIVème siècle est régulièrement la source de conflits et de procès, qui permettent de suivre l’évolution du secteur. Pour exemple, un document de 1221 nous apprend que l’aménagement d’un étang (peut-être l’étang d’Arbuère, devenu étang de la Bussière) empiète sur les terres des tenanciers de Saint Germain, obligeant les Cisterciens à un dédommagement (Moniot, 1955, p. 18).
L’an mil est un pivot dans l’Histoire de la région dijonnaise. Le développement des pouvoirs ducaux et cisterciens principalement s’accompagne d’un fort développement économique et démographique. De grands défrichements ont lieu faisant reculer les forêts au profit des champs cultivés. La forêt reste cependant un lieu vital pour la société médiévale, fournissant matières premières et lieux de pâturage pour les troupeaux (Beck, 2008, p. 175). La pression démographique densifie l’occupation humaine de la Côte de Nuits, partagée entre les différents pouvoirs qui dominent le secteur. Les relations entre ces pouvoirs sont parfois tendues et on les voit asseoir leur autorité à travers la construction de châteaux et de maisons fortes comme à Concoeur-et-Corboin avec le Château d’Entre-Deux-Monts (n°6), à Gilly-lès-Cîteaux avec le Château de Montbis (n°13), ou encore à Brochon (n°2) et Gevrey-Chambertin (n°15 et 24) avec leurs maisons fortes. Les aménagements sont également nombreux dans la plaine. On notera par exemple au XIIIème l’étang des moines blancs aménagé sur la Sans-Fond (ou Cent Fonts) à Fénay (Laine et al., 2010), où l’on localise un moulin dès 1164 (n°19). Les étangs ducaux sont également nombreux, avec par exemple les étangs de Satenay utilisés pour l’alevinage (Beck, 2008, p. 335). Enfin aux alentours de Collonges-lès-Premières, près de Genlis, on identifie plusieurs exemples de sites féodaux (Lecornué, 2012) : la motte de la Fourey, la motte de Premières, la maison de Longchamp ou la motte castrale du bois de Mondragon, bordée d’un étang que l’on pouvait encore observer au XIXème siècle (cadastre napoléonien, secteur C1, Collonges-lès-Premières).
14 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Cette période s’achèvera avec la grande épidémie de Peste du XIVème siècle et la Guerre de Cent Ans, entrainant une forte chute démographique et une nouvelle phase de désertion des terres. La forêt regagne de nombreux terrains, fossilisant les modelés agraires et les parcellaires abandonnés (Ducasse et Guery, 2012, p. 60-62). Ce n’est qu’à partir du XVIIIème siècle que les défrichements reprennent, avec l’appui de l’autorité royale (Bloch, 1931, p.66-67). Ces défrichements resteront limités et la vraie révolution agricole consiste au cours du XIXème puis du XXème siècle à l’abandon des anciennes techniques (par exemple la jachère) et au développement de nouveaux outils (labour à plat, mécanisation) pour l’augmentation du rendement (Trochet, 2008, p. 65). Les sols les plus pauvres sont abandonnés au profit des terres fertiles et accessibles aux machines. Ainsi parmi les zones défrichées au XVIIIème siècle sur le plateau calcaire, beaucoup seront rapidement laissées à l’abandon (comme la rente de la Fortelle à Fixin ; Ducasse et Guery, 2012, p. 63-65). Ces fermes à l’installation tardive répondaient au besoin d’augmenter les surfaces cultivables, et on les repère encore aisément grâce aux auréoles de défrichement qui les entourent (Ferme de la Buère, Chambolle-Musigny). Dans le même temps, le développement des vignoble pousse à aller toujours plus loin sur les versant, allant jusqu’à transformer d’anciennes carrières en parcelles viticoles. Alors que la valeur du vin était jusque là attribuée en fonction du prestige du propriétaire terrien (les vins du dijonnois sur les terres du Duc étaient les plus chers), la libéralisation de l’économie permet le développement des grands vins de la Côte viticole, telle qu’on la connaît aujourd’hui (Garcia et Labbé, 2011, p. 169-173). La notion de « grands crus », s’associant à l’ancienneté des climats, correspond alors à une valorisation du terrain, du terroir, appuyée par la pensée naturaliste moderne. Les grands vignobles, anoblis par le prestige du terroir et de l’Histoire, sont alors devenus emblématiques de la région dijonnaise.
15 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Fig. 3 : Carte archéologie du secteur de la Côte viticole (Ducasse et Guery, 2012)
Fig.
4 : C
arte
des
lieu
x po
ssib
les d
e la
« ba
taill
e de
cav
aler
ie »
oppo
sant
Cés
ar à
Ver
cing
étor
ix e
n 52
av.
J.-C
.(P
.-M. D
uval
, 198
1)
16 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
I) Technologie et méthodes de reconnaissance
A) Technique LiDAR et traitements
La technologie LiDAR (Light Detection And Ranging) aéroportée révolutionne depuis quelques années l’approche de la microtopographie en produisant des modèles numériques (de Terrain MNT, et d’élévation MNE) d’une très grande précision (de l’ordre de la dizaine de centimètres en x, y et z). Fonctionnant à la manière d’un scanner, envoyant des impulsions LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) dont la fréquence et l’angle d’incidence sont paramétrés, elle s’illustre notamment par sa capacité à générer des MNT y compris sous couvert forestier.
a) Acquisition des données
Chaque impulsion LASER renvoyant un « écho » à chaque obstacle rencontré (Fig. 5), les données obtenues sont visualisées sous la forme d’un nuage de points et il est possible de distinguer le sol des éléments en élévation. Les premiers traitements effectués sur le nuage de points visent à générer des surfaces à partir de points corrélés entre eux et à « lisser » ces surfaces pour en éliminer le bruit. L’enjeu est évidemment de ne pas faire disparaître d’anomalies microtopographiques pendant ces traitements. Le nombre de points au sol est alors essentiel. Il dépend des conditions d’acquisition des données, mais aussi de la bonne préparation de la prospection. En fonction du terrain et des objets recherchés, l’altitude de vol, la vitesse et les paramètres des impulsions LASER doivent être adaptés afin d’obtenir le meilleur rendu. On préférera ainsi donner un angle faible aux impulsions LASER (0 étant la verticale) en milieux ouverts et un angle fort (45° par exemple) en milieu forestier pour augmenter le nombre de points au sol (Nuninger et al., 2008). Lors du vol, les données sont géoréférencées grâce à un système de géolocalisation type GPS (Global Positioning System) combinant des informations satellitaires et les signaux de relais au sol. Une centrale inertielle (IMU, Inertiel Measurment Unit) permet de corriger les effets de roulis et d’accélération de l’aéronef.
b) Premiers traitements des MNT
L’étude porte ici sur deux MNT produits en 2010 : - le MNT produit pour le secteur de la Côte viticole (CV) couvre une surface de 86 km2, soit environ 9 km sur 9,5 km des limites de Chamboeuf sur le plateau à la commune de Fénay dans la plaine, et du sud de Couchey jusqu’à la commune de Vougeot. La densité de points au sol varie de 3 à 10 points/m2. - le MNT produit sur le trajet de la Ligne à Grande Vitesse Est phase 2 (LGV) couvre une surface de 14,6 km2 prenant la forme d’une bande d’environ 1 km de large, s’étendant de Genlis à Villers-lès-Pots.
Les précédents traitements effectués sur ces MNT (MNT CV : Ducasse et Guery, 2012 ; MNT LGV : Lecornué, 2012) ont révélé de nombreuses structures, ou anomalies, microtopographiques linéaires : ces structures ne correspondant à aucun élément actuellement connu sur le secteur ont motivé cette nouvelle étude. Dans la classification de reconnaissance des anomalies microtopographique, établie lors du traitement exploratoire des données LiDAR de la Côte viticole (Ducasse et Guery, 2012, p. 28-30), ces structures sont nommées RPH pour Relief Polygonaux Hectométriques. Elles forment en effet de grandes structures géométriques, dont l’agencement a poussé à les interpréter comme des structures parcellaires et agraires anciennes. Suite à ces travaux et à la création de cette première classification, il a paru plus approprié de remplacer le terme de « Relief » (mis en opposition à celui de « Creux »), par celui de « Signal positif, ou négatif ». Inscrite dans un dendrogramme ou arbre de décision, cette première clé de détermination permet d’étendre le champ d’application de cette classification à d’autre types d’imagerie : imagerie électrique, magnétique, infrarouge…En microtopographie, un signal positif correspond à une anomalie microtopographique dont l’altitude est supérieure au niveau de sol environnant, et un signal négatif est une anomalie microtopographique dont l’altitude est inférieure au niveau de sol environnant. Comme présenté donc dans la nouvelle mouture de cette classification (Fig. 7), le code attribué aux structures étudiées sera PPH pour signal Positif Polygonal Hectométrique. On distinguera parmi ces structures
17 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
celles qui présentent un signal fort (1) de celles qui ont un signal faible (2), ainsi que les structures visibles car elle recouvrent une surface (S) et celles délimitant un périmètre (P) : PPH1P et PPH2P, comme présenté en 2012 (Ducasse et Guery 2012, p. 60-62) correspondent à des limites parcellaires, souvent en continuité, mais ne présentant pas le même taux d’arasement (signal fort ou faible, fonction notamment de la présence ou non d’un couvert forestier) ; PPH1S correspond à un type de structure parcellaire ou agraire observé sur le plateau (Etude de cas : la Fortelle ; Ducasse et Guery, 2012, p. 63-65) et PPH2S correspond à un modelé agraire ancien, communément appelé « champs bombés » (Callot, 1980, p. 20-21). Ces dernières structures de type PPH2S sont présentes sur de très grandes surfaces sur les deux MNT étudiés et feront l’objet d’une étude approfondie.
c) Génération d’ombragesFragmentation des données
Afin de visualiser et d’étudier les structures de type PPH, il a déjà été choisi de générer des ombrages permettant une visualisation optimale. Un ombrage est le résultat de la création d’une source lumineuse virtuelle éclairant le MNT. En raison du poids des MNT produits, ceux-ci ont été fournis découpés en dalles selon une maille de 1 km sur le secteur de la Côte et de 500 m sur le secteur de la LGV (deux opérateurs différents, et donc deux méthodes différentes). Cette fragmentation des données, si elle est nécessaire à leur manipulation sur des calculateurs de capacité moyenne, a pour effet de multiplier les opérations (obligeant à toujours contrôler le numéro de la dalle sur laquelle on travaille) et de donner un aspect « en damier » aux ombrages lorsqu’ils sont visualisés tous ensembles. En effet, en raison de la fragmentation des données, chaque dalle se voit attribuer sa propre source lumineuse virtuelle, ce qui aboutit à des « éclairages » parfois incompatibles avec la réalité. En fait, la création des ombrages correspond à la génération d’images raster où les valeurs d’altitude sont associées à une courbe tonale (ici des tons des gris). Afin d’augmenter les contrastes et mieux mettre en évidence les anomalies microtopographiques, on applique un « étirement selon l’écart-type » à cette courbe tonale, ce qui a pour effet de répartir les tonalités de gris selon la variance des données d’altitude. Ainsi lorsque deux dalles possèdent des valeurs d’altitude similaires, les courbes tonales des ombrages correspondants seront sensiblement identiques ; mais dans le cas ou deux dalles voisines présentent des variations d’altitudes très différentes, à altitude égale on n’obtiendra pas la même nuance de gris d’un ombrage à l’autre. Ce phénomène est essentiellement observé au niveau des versants de la Côte viticole aux fortes déclivités, voisins de zones extrêmement plates (Fig. 6) : pour une même altitude, les zones au pied de la Côte, mais situées sur les dalles couvrant les versants, se voient attribuer une nuance de gris plus claire que les zones voisines, situées sur des dalles ne couvrant que la plaine. D’autres traitements de la courbe tonale permettent d’éviter ce phénomène (par exemple l’étirement « minimum maximum »), mais ils ne permettent par de visualiser nettement les anomalies microtopographiques de faible signal. Pour éviter ce problème, il est possible après un premier traitement, de manipuler manuellement la courbe tonale afin d’unifier l’image visualisée et supprimer l’effet « en damier ».
Choix des azimuts
Lors de la génération d’ombrages à partir d’un MNT, deux paramètres principaux doivent être définis : - l’angle : il correspond à l’angle d’incidence des rayons lumineux provenant de la source d’éclairage virtuel, il permettra d’obtenir un éclairage zénithal (peu favorable à l’observation du relief) ou un effet « lumière rasante » faisant apparaître des anomalies de très faible signal. - l’azimut : il correspond à la position par rapport au Nord de la source d’éclairage virtuel
Des ombrages d’azimut 315 et des ombrages d’azimut 225 ont été générés pour l’ensemble des dalles des deux MNT (110 dalles pour le MNT CV, et 103 dalles pour le MNT LGV). L’azimut 315, ainsi que l’angle 45°, est défini par défaut par ArcMap ® lors de la génération d’ombrages (ArcToolBox > Outils Spatial Analyst > Surface). Il permet un premier repérage des structures, éclairant de façon oblique (depuis le Nord-Nord-Ouest) les structures linéaires. Celles-ci étant essentiellement orientées N10 et N100 (Ducasse et Guery, 2012, p. 61), cet éclairage virtuel par défaut est suffisant pour repérer l’essentiel des structures. L’azimut 225, perpendiculaire à l’azimut 315, permet de mieux visualiser les structures linéaires N100 de faible relief et les éventuelles
18 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
structures orientées parallèlement à l’azimut 315 (N135). L’angle de 45° a été conservé par défaut lors des deux séries d’ombrages, fournissant un bon compromis entre le besoin d’éclairer des structures de faible signal, et la nécessité de s’adapter à un relief parfois important (falaises, combes…).
d) Vectorisation des structuresModalités de vectorisation
Comme initiée lors du traitement exploratoire des données LiDAR de la Côte (Ducasse et Guery, 2012), la vectorisation (limites et surfaces) des structures de type PPH a été entreprise sur l’ensemble des deux secteurs traités. C’est la méthode la plus pertinente pour marquer et étudier ces structures car elle permet à la fois de les repérer, de les isoler et de les intégrer à des couches spécifiques indépendamment des données LiDAR, et enfin d’effectuer un certain nombre de mesures pour les caractériser (longueurs, surfaces, orientations). La vectorisation n’a pas été systématisée car les outils pour repérer automatiquement des reliefs de ce type n’existent pas encore. De plus les tentatives effectuées pour d’autres études se sont soldées par un échec, les algorithmes de traitement créés se trouvant dans l’impossibilité de distinguer des reliefs linéaires faibles au milieu des reliefs linéaires forts car récents (routes, fossés ; Nuninger et al. 2008, p. 36).
La nature des structures à étudier a fortement influencé les choix sur la manière de les vectoriser : - les structures de type PPHP ont été vectorisées dans un premier temps grâce à des fichiers de formes de type « polyligne », sous ArcGis ®. Les polygones formés par le parcellaire sont parfois incomplets, et il est plus prudent de ne marquer que les reliefs réellement visibles. Dans les cas de bonne préservation, on pourra effectuer une nouvelle vectorisation en utilisant un fichier de forme de type « polygone » (permettant notamment le calcul des surfaces. Dans le cas des PPHP, c’est donc le relief délimitant le périmètre qui est vectorisé. - Les structures de type PPH2S avaient été marquées selon le même principe (Ducasse et Guery, 2012). On avait délimité des ensembles dont on avait défini les limites en fonction des variations d’aspect du modelé observé. Mais pour une lecture plus fine, et pour confirmer ou infirmer les limites précédemment définies, il a paru judicieux de vectoriser le modelé lui-même. Ce modelé est caractérisé par une alternance d’arêtes et de sillons. Toujours dans l’optique de ne vectoriser que ce qui était concrètement visible, il a été choisi de se concentrer sur les sillons de ce modelé. Ces derniers sont généralement mieux préservés que les arêtes auxquelles ils sont associés, et permettent donc de repérer avec exactitude l’extension réelle de ces structures. Dans ce cas ce sont donc les creusements qui entourent le relief qui ont été vectorisés.
Ce choix n’est pas anodin, car il constitue la base des analyses qui seront ensuite conduites. L’objectif est ici d’avoir une démarche purement objective d’observation, départie de toute forme d’interprétation. C’est la forme microtopographique qui est vectorisée en vue d’être analysée, avec tous les biais liés à la préservation des structures que cela inclut. Ces biais seront pris en compte a posteriori lors de l’interprétation. Ainsi par exemple, les calculs de longueurs qui sont effectués se basent sur des structures parfois incomplètes : on préférera vectoriser un par un les fragments d’un sillon de grande dimension, quitte à reconnaître après coup qu’il s’agit d’une seule et même structure, plutôt que de relier en un seul vecteur plusieurs fragments, en indiquant ainsi la présence du sillon à des endroits où il n’est plus du tout visible aujourd’hui.
Vectorisation des structures PPH2S
La vectorisation des structures de type PPH2S a constitué l’essentiel du travail de vectorisation, ces structures représentant, à la fois sur le secteur de la Côte viticole et de la LGV, un enjeu majeur dans la compréhension de l’occupation ancienne de la plaine de la Saône. Une grande partie de ces structures avaient déjà été repérée lors du traitement exploratoire des données LiDAR de la Côte (Ducasse et Guery, 2012). Sur le secteur de la LGV, ces structures bien que très visibles, n’avaient pas été étudiées (Lecornué, 2012).Le travail de vectorisation a consisté à marquer dans un fichier de forme polyligne tous les sillons visibles dans les zones comportant des PPH2S, soit plus de 3900 entités sur le secteur de la Côte viticole et plus de 2100 sur le secteur de la LGV.
19 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Des calculs de longueurs et d’orientations ont ensuite été effectués pour chacun d’entre eux. Dans les tables attributaires des fichiers de forme polyligne créés pour les MNT CV et MNT LGV, un champ « longueur » a été ajouté. La fonction « calcul de géométrie » a ensuite permis de calculer les valeurs pour chaque sillon. Pour calculer les orientations, le même outil a permis de définir les coordonnées X et Y de début et de fin de ligne pour chaque sillon. Ces coordonnées ont permis de calculer la pente de chaque vecteur (variation de y/variation de x), qui une fois convertie en degrés donne l‘angle des sillons par rapport au Nord. La valeur de 180° a été ajoutée à toutes les valeurs négatives pour n’obtenir que des orientations, dont la valeur est comprise entre N0 et N180. Cette méthode de calcul (Arty, 2010 d’après Deweirdt, 2009) peut être automatisée par le développement d’un script adapté à la version d’ArcGis utilisée. Les scripts précédemment développés sont cependant incompatibles avec les nouvelles versions d’ArcGis (10.0 et 10.1), sans qu’il ait été possible de trouver pourquoi (changement des normes de rédaction du script).
La vectorisation des sillons et la création des ombrages d’azimut 225 a permis de repérer de nouvelles structures de PPH2S, ou de mieux définir les limites des structures précédemment repérées. Pour compléter l’analyse, les surfaces de préservation de ces structures ont été vectorisées selon la couverture actuelle : forêt, prés, champs labourés. Pour ce faire, des fichiers de forme de type « polygone » ont été créés pour chaque type de couverture et des polygones ont été définis en fonction des limites d’extension des sillons vectorisés. Cette vectorisation permet ainsi de définir les surfaces couvertes par ces structures et le type de milieu de préservation le plus souvent rencontré.
Analyse statistique
Pour toutes les vectorisations effectuées, les données des tables attributaires ont été exportées au format database (.dbf) et exploitées sous Excel ®. Grace aux fonctions disponibles les moyennes, médianes, valeurs maximales et minimales ainsi que les écarts-types ont été calculés. La fonction FREQUENCE a également permis de définir des intervalles et de calculer pour les longueurs comme pour les orientations les fréquences et fréquences cumulées sur les jeux de données issus de la vectorisation des sillons de PPH2S.
e) Problématiques
Ces traitements et l’analyse statistique rapide qui s’en suivait avaient pour but de répondre à plusieurs questions, ouvertes suite au traitement exploratoire des données LiDAR de la Côte (Ducasse et Guery, 2012) :Les PPHP et les PPHS appartiennent-ils à un même ensemble en terme d’orientation ? En terme de surface ? S’agit-il donc d’un seul et même type de vestiges, préservé de manières différentes (tantôt par ses limites parcellaires, tantôt par son modelé agraire) ? Existe-il des sous-ensembles dans ces catégories de vestiges ?
A ces questions on rajoutera celle de savoir si les structures de type PPH2S observées sur le MNT CV et sur le MNT LGV sont comparables ou non : correspondent-elle à la même phase et à la même pratique ou présentent-elles des différences morphologiques significatives ?
21 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
B) Champs bombés : ambiguïté du terme
En parallèle de l’étude, disons purement « technique » et « morphologique », conduite sur les structures de type PPH2S observés sur les deux MNT produits, il a fallu conduire une réflexion sur la terminologie employée pour décrire ces structures. Ce type de structure est communément appelé « champs bombés » dans la littérature française. On s’aperçoit cependant très vite en consultant cette littérature, que d’auteur en auteur, et de discipline en discipline (archéologie, géographie, agronomie), la nature des structures appelées « champs bombés » varie du tout au tout.
a) Qu’est-ce qu’un champ bombé ?
Le terme de « champs bombés » a été jusque là utilisé pour décrire des structures microtopographique correspondant aux traces anciennes d’une activité culturale caractérisées par un aspect de tôle ondulée. On y observe ainsi une alternance plus ou moins régulière d’arêtes et de sillons, rectilignes ou curvilignes, s’étendant sur des surfaces très variables. La pratique agricole générant ces traces reste le sujet de nombreuses hypothèses ; et pour cause si les auteurs ne se réfèrent pas toujours aux mêmes types de structures. Il pourrait s’agir de pratiques de labour ou d’assainissement des terres. Ces structures sont souvent trouvées dans des zones humides ou marécageuses. La question de l’outil utilisé reste problématique. L’une des hypothèses est celle de l’utilisation d’une charrue à versoir fixe, dont le passage répété provoquerait l’accumulation de terre en monticule. La taille des monticules extrêmement importante (5 à 20 m d’après Sittler et Hauger, 2007 et d’après Callot, 1980, p. 20-21) et la quantité de terre déplacée peuvent paraître incohérentes avec l’utilisation d’une charrue.
Cependant c’est bien l’utilisation d’une charrue à versoir fixe qui est à l’origine de ce que l’on nomme « billons » (Blaising, 2010) et des fameux ridges and furrows britanniques (Hall, 1998 ; Demidowicz, 2005). Ces structures sont rigoureusement identiques et correspondent apparemment aux mêmes pratiques culturales. Elles recouvrent aussi la même variabilité et les mêmes incertitudes quant à leur mise en place. Le terme de billon défini précisément (Rey, 2010) depuis 1835 correspond à la pratique du labour avec une charrue à versoir fixe formant un monticule allongé, ressemblant à une baguette (analogie de forme avec les billes de bois), et creusant des sillons de part et d’autre (Fig. 8). Les nombreuses études sur les ridges and furrows, qui sont très bien préservés sous les prés britanniques, concluent à un fonctionnement similaire. Elles constatent cependant une variabilité de forme : d’une part des structures très longues (jusqu’à 1000 et même 1500 m) et courbées ; d’autre part des structures plus courtes, plus rectilignes et toujours parallèles (Hall, 1998). Les premières correspondraient à un système de culture en open field où chaque billon ou ridge correspond à une parcelle en lanière (land ou field strip ; Demidowicz, 2005) cultivée par un exploitant avec une rotation des cultures (Hall, 1998). Les secondes correspondraient à un système de parcelles fermées (enclosed) où les billons sont définis en fonction du parcellaire, lui-même délimité par des fossés (Hall, 1998). Dans les deux cas les ridges and furrows seraient à la fois le fruit de l’utilisation d’un outil particulier (la charrue à versoir fixe, single-sided plough) et la réponse au besoin de drainer les terrains. Les mêmes observations et les mêmes conclusions sont portées sur ces structures en Allemagne, où le terme principalement utilisé pour les définir est wölbacker, c’est à dire « champ voûté » (Callot, 1980, p. 20-21 ; comm. pers. et traduction N. Guery et J.-P. Garcia, 2013).
b) La terminologie française
Ces structures sont beaucoup moins référencées en France, non pas qu’elles ne soient pas préservées, mais peut-être car elles sont moins visibles, ou parce qu’elles suscitent moins d’intérêt chez les archéologues français. A titre d’exemple, le moteur de recherche Google ® livrait au 2 avril 2013 639 résultats pour « champ bombé », 2030 résultats pour « wölbacker » et 195 000 résultats pour « ridges and furrows ». S’ils sont particulièrement négligés en France, ils font l’objet de programmes de protection et de nombreuses études en Allemagne et au Royaume-Uni (Anderson et Went, 2002). Si les prés conservant des ridges and furrows sont très fréquents au Royaume-Uni, ils semblent l’être beaucoup moins en France. Essentiellement préservées sous forêt sur le
22 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
continent (Allemagne, France), ces structures sont plus difficilement observées et c’est la technologie LiDAR qui les remet en avant aujourd’hui (Sittler et Hauger, 2007).
Le terme français répandu dans la littérature est donc celui de « champ bombé », et non celui de « billon ». Il vient probablement partiellement d’une traduction de l’allemand wölbacker, où le terme de « voûté » peut être remplacé par celui de « bombé » en fonction du traducteur. D’autre part le terme de billon, sous son utilisation agricole actuelle, fait plutôt penser à de petits monticules de terre de l’ordre de la dizaine de centimètre de large et que l’on observe régulièrement pour la culture surélevée des pommes de terres par exemple (comm. pers. P. Morlon, agronome à l’INRA-AGROSUP). On trouve malgré tout les termes de « champs bombés » et de « billons » associés occasionnellement (Callot, 1980, p. 176).
Or ce terme de « champ bombé » reste relativement ambigu et est notamment absent des dictionnaires. Le terme de « champ bombé » correspond à des périodes récentes (Beyaert, 2006 ; Boulmier, 1951 ; www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr : Paysages de la plaine de la Lys) à une pratique d’assainissement des terrains sujets aux inondations. Cette pratique consistait à creuser des fossés profonds sur les bords d’une parcelle polygonale de dimensions modestes et à accumuler la terre ainsi récupérée au centre pour former un dôme. La partie centrale de la parcelle se trouvait ainsi surélevée par rapport à la nappe phréatique et les fossés facilitaient le drainage. Cette pratique est également signalée aux Pays-Bas (Legros, 2007, p. 85-86 ; Fig. 10). Le terme de « champ bombé » décrit alors parfaitement l’aspect de la parcelle, bombée en son centre. Cette forme bombée n’est pas sans rappeler les celtic fields (Pigott et Thirsk, 1981).
Mais là est la première ambiguïté car un bombement, toujours d’après le dictionnaire peut-être tant isotrope (comme dans le cas des celtic fields, ou des champs bombés que décrit M. Beyaert en Belgique) que de forme allongée (comme dans le cas des billons). De plus le terme de « champ » correspond à une notion très précise, et déjà interprétative, à savoir « une étendue de terrain propre à la culture » (Rey, 2010). Le problème revient donc à savoir si par « champ bombé » on entend « une parcelle en lanière bombée » (Callot, 1980, p. 174-175), « une parcelle polygonale bombée en son centre » (Legros, 2007, p. 86) ou « la juxtaposition de plusieurs lanières bombées, c’est à dire plusieurs billons ». Ainsi la notion de « champ bombé » devient plus compliquée à manier puisqu’elle n’a pas de définition précise. D’autre part, les auteurs ne précisant pas forcément d’où leur vient le terme de « champ bombé », et ne décrivant pas forcément de façon rigoureuse les structures citées sous ce nom, il est parfois parfaitement impossible de savoir à quelle forme de « champ bombé » il est fait référence.
c) Un seul terme pour des pratiques différentes
On notera que le terme de « champs bombé » est aussi attribué à des structures actuelles, apparemment semblables aux ridges and furrows (Chouquer, 2011). Ces structures sont observables en vues aériennes (GoogleEarth au Kazakhstan : 45°46’14.29»N - 62° 0’33.68»E). Les structures observables au Kazakhstan semblent très régulières en terme de surface et d’orientation. On observe également que les arêtes et les sillons y sont moins larges (environ 2 m) que les ridges and furrows connus. Ces structures pourraient correspondre à un type de labour à la charrue du XIXème siècle observé autour de Manchester (Hall, 1998). L’aspect plus large des ridges and furrows pourrait aussi être expliqué par un simple phénomène d’arasement et d’émoussement du relief.
Enfin le terme de « champ bombé », cette fois associé au terme « ados », est employé pour décrire des structures agraires précolombiennes, observés depuis plusieurs années sur l’Altiplano amazonien et en Guyane (Garaycochea, Morlon et Ramos, 1992 ; Rostain, 1995). Ces structures liés à un système de drainage et d’irrigation complexe (amener l’eau en saison sèche, drainer en saison humide) ne correspondent en aucun cas à l’utilisation d’une charrue (comm. pers. P. Morlon). Lorsqu’elles sont très arasées, elles ressemblent cependant tout à fait aux ridges and furrows ou aux wölbacker (observation personnelle d’après les photos de P. Morlon). Le terme « ados » est également utilisé, en traduction du terme espagnol « camellones ». L’idée de cette traduction assez libre est que ces structures sont en forme de
23 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
dos de chameaux (camellones). D’après le dictionnaire de la langue française, le terme « ados » correspond à la pratique d’adossement de la terre à des murs pour améliorer l’ensoleillement des plantes cultivées (utilisation en horticulture en 1697) ; puis par abus de langage et par extension « à la terre élevée entre les lignes d’un champ labouré » (Rey, 2010 ; Fig. 13). L’utilisation du terme « ados », comme celle de « billons » et de « champ bombé », est là encore sujette à de nombreuses variations et couvre des réalités très différentes.
d) Un champ bombé ou des champs bombés ?
L’utilisation du terme de « champ bombé » pour nos structures en tôle ondulée paraît assez peu logique. Il ne permet en tout cas pas de visualiser l’aspect de ces champs dans l’espace. Le terme anglais de ridges and furrows a le mérite de rester exclusivement descriptif et d’éviter les confusions. Le terme de « champ bombé » ne prend sens que si l’on considère chaque ondulation, chaque billon, comme un champ indépendant des autres, bien qu’il ne prenne en compte que l’aspect en coupe transversale et fasse abstraction de l’évolution de cette forme dans l’espace. Or l’indépendance de chaque billon vis à vis de ses voisins reste à prouver puisqu’on observe clairement de grands ensemble adoptant les mêmes orientations, les mêmes incurvations et les mêmes longueurs (Ducasse et Guery, 2012, p. 76-78 ; Callot, 1980, p. 179). L’idée que chaque billon serait indépendant de ses voisins vient de la théorie selon laquelle chaque parcelle laniérée appartiendrait à un exploitant différent (Hall, 1998 ; Callot, 1980, p. 174). Ce système de répartition des terres est directement lié aux systèmes d’open fields et d’assolement (Callot, 1980, p.195-196 ; Bloch, 1931, p. 75-76) auxquels ces structures sont régulièrement associées. Mais devant la grande variabilité qu’elles présentent, tant dans leur forme que dans leur milieu de mise en place (Callot, 1980, p. 193-194 ; Ducasse et Guery, 2012, p. 60-62), il est permis de s’interroger. Tous les ridges and furrows appartiennent-ils au système de l’open field (Hall, 1998) ? Les sillons entourant les billons sont-ils systématiquement une limite de parcelle (Callot, 1980, p. 174) ? Cette dernière question renvoie directement à la problématique de la fonction des sillons, source d’un profond désaccord dans la communauté scientifique. Les sillons sont-ils des limites de parcelles, des structures de drainage, le résultat involontaire de l’utilisation de la charrue à versoir fixe ? La réponse et la cause de l’incertitude est probablement que de cas en cas, ces fonctions peuvent se combiner entre elles (Callot, 1980, p. 182-183).
e) Confusion des termes
La confusion entre les différentes formes de « champs bombés » vient probablement d’un glissement basé sur une analogie assez simple : toutes les pratiques décrites précédemment semblent répondre à un besoin d’assainissement dans un terrain humide, et se traduisent par le creusement de fossés et la création de monticules. Sans prendre en compte les différences de forme flagrantes (tant dans l’espace qu’en coupe) on a alors commencé à utiliser le terme de « champ bombé », structure encore observable récemment (Beyaert, 2006 ; Boulmier, 1951 ; Legros, 2007, p. 86), pour parler de pratiques culturales différentes et parfois très anciennes.
Face à la confusion et à la multiplication des termes (champs bombés, billons, wölbacker, ridges and furrows) il est nécessaire d’établir une méthodologie pour reconnaître ces structures et de définir des termes appropriés à leur définition.
24 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
ED450
ED268
ED012
ED037
ED544
ED426
JG533
JG291
JG020
JG088
JG699
JG062
ED433
ED053
ED419
ED122
JG032
ED184
ED215
ED029
JG031
JG232
JG001
JG627
JG428
ED320
JG623
JG050
JG003
Exemple typeNCM1O
NCM1
NCM2
NP2
NLMM
NLMH
NIM1
NIM2A
NIM2B
NID1
NID2
PCMA
PCMB
PCD1
PCD2
PCH
PPD1
PPD2A
PPD2B
PPH1S
PPH1P
PPH2S
PPH2P
PLM1
PLM2
PLD
PIM
PID
PIH
NIH
Classe
NCD
NP1
Avec bourrelet O
Sans bourrelet
Longueur métrique M
Longueur hectométrique H
Compact A
Isolé B
Compact A
Isolé B
Compact A
Isolé B
Surface S
Périmètre P
Surface S
Périmètre P
Caractéristiques
Faible 2
Fort 1
Faible 2
Fort 1
Faible 2
Fort 1
Faible 2
Fort 1
Faible 2
Fort 1
Faible 2
Fort 1
Faible 2
Fort 1
Contraste
Fort 1
Faible 2
Largeur métrique M
Métrique M
Décamétrique D
Hectométrique H
Métrique M
Décamétrique D
Largeur métrique M
Largeur décamétrique D
Hectométrique H
Métrique M
Décamétrique D
Hectométrique H
Décamétrique D
Hectométrique H
Dimensions
Métrique M
Décamétrique D
Polygonal P
Linéaire L
Irrégulier I
Circulaire C
Polygonal P
Linéaire L
Irrégulier I
Circulaire C
Forme
Négatif N
Positif P
Relief
Fig. 7 : Classification descriptive des anomalies microtopographiques, établie en 2012 par Ducasse et GueryMise à jour d’après nos recherches respectives, 2013
Fig.
8 : L
a fo
rmat
ion
du b
illon
dans
les e
nviro
ns d
e D
inan
(Côt
e d’
Arm
or),
vers
184
0(T
roch
et, 2
008)
Duc
asse
et G
uery
, 201
3
25 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
C) Reconnaissance des « champs bombés » en microtopographie LiDARa) Variabilité de forme
Lors du traitement exploratoire des données LiDAR de la Côte des « champs bombés » (selon la définition de Sittler et Hauger, 2007 et Callot, 1980, p. 20-21) ont donc été reconnus en microtopographie LiDAR (Ducasse et Guery, 2012, p. 60-62) grâce à leur aspect tout à fait caractéristique de tôle ondulée alternant bosses et creux (ridges and furrows dans la littérature anglo-saxonne ; Hall, 1998 ; McOmish, 2011). La classification alors établie pour faciliter la reconnaissance visuelle et la description des très nombreuses structures observées a permis de leur attribuer une appellation purement descriptive. Cette classification, comme expliqué précédemment, se présente sous la forme d’un arbre de décision permettant de définir par une série de caractères simples toute structure observée en imagerie (LiDAR, magnétique, électrique). Comme expliqué dans la partie « Technique LiDAR et traitements », les « champs bombés » sont rentrés dans la catégorie des PPH2S : signal (relief) Positif Polygonal Hectométrique faiblement contrasté (2) et représenté par une Surface (en opposition aux structures seulement visualisées par leur périmètre, PPHP : probablement d‘anciennes limites parcellaires). Or on comprend que cette classification purement descriptive peut recouvrir des structures de natures différentes. On a ainsi associé à ces « champs bombés » une grande variabilité de forme (variation de dimensions, d’espacement, d’amplitude du relief). Cette variabilité est-elle le reflet de pratiques agraires différentes (le modèle des « champs bombés » regroupe de nombreuses formes, et éventuellement une variabilité lié à l’outil, l’exploitant…), d’une préservation différentielle ou est-on face à une grande diversité de structures aux fonctions différentes laissant des traces similaires ? Cette variabilité parmi les PPH2S vient se surajouter à celle constatée parmi les ridges and furrows (Hall, 1998) et à celle liée à l’ambiguïté du terme « champ bombé ». Face à une telle complexité, il devient difficile de s’y retrouver.
La variabilité observée parmi les PPH2S peut-être reliée à trois grands facteurs :
les surfaces couvertes
On s’aperçoit tout d’abord que les surfaces couvertes par les PPH2S varient sur une grande amplitude (de moins d’1 ha à plus de 50 ha). On distingue alors immédiatement les très grandes zones et les très petites. Ces dernières pourraient d’ailleurs recouper les plus grandes. Ces différences sont visibles à travers la longueur des sillons (voir plus bas les analyses statistiques). Mais l’analyse en terme de surface est-elle pertinente ? En effet ces structures sont essentiellement préservées par la présence de forêt. Il ne s’agit donc que d’une préservation partielle. De plus les pratiques d’entretien et d’exploitation des forêts ont parfois largement détruit la trace des PPH2S, les rendant à peine devinable en microtopographie LiDAR (Fig. 26). Les surfaces calculées pour les zones couvertes (et notamment les plus grandes) sont donc potentiellement incorrectes. Il s’agit à proprement parler de surfaces préservées, et non des surfaces d’extension initiale. De même il est assez difficile, lorsque l’on observe les sillons vectorisés, de savoir si ces derniers sont complets ou non. Seuls quelques cas localisés permettent cette détermination.
le type de préservation
Ici se présente une première interrogation. Les « champs bombés » semblent jusqu’ici n’être préservés que par la présence de forêt ou de prés. Cet élément est essentiel car il permet notamment d’établir une chronologie relative, les « champs bombés » fonctionnant apparemment avant la reconquête des milieux forestiers. Cependant la microtopographie LiDAR met aussi en évidence des continuités planimétriques entre les reliefs préservés sous forêt et les reliefs préservés sous les champs aujourd’hui labourés. Ceci semblerait indiquer la subsistance de ces vestiges malgré le labour actuel. On a déjà vu le phénomène de la résilience des taux d’érosion aux traces parcellaires anciennes (Brenot et al., 2008) qui mettait en évidence la résistance des traces parcellaires anciennes aux labours actuels.
En prenant en compte les dimensions des traces culturales de type « champs bombés » il est envisageable qu’elles aient pu résister ponctuellement au labour sur des périodes longues. Il semblerait ainsi que les
26 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
« champs bombés » soient préservés parfois sous les champs actuellement labourés, mais avec peut-être un relief plus « émoussé ».
la localisation des vestiges
Les « champs bombés » sont observés en général en plaine, en contexte humide (Sittler et Hauger, 2007 ; Hall, 1998). Cependant les PPH2S ont également été repérés sur le plateau calcaire de la Côte viticole. Les exemples sont moins nombreux qu’en plaine, mais leur seule présence interpelle sur la nature même des « champs bombés » décrits dans la littérature. Cette présence sur le plateau calcaire, s’il s’agit bien de « champs bombés » contredit-elle l’hypothèse d’une fonction de drainage de ces structures ? Elle est également mentionnée en Alsace (Callot, 1980, p. 190-192). Cette différence de localisation pourra éventuellement influencer l’amplitude des reliefs (taux d’érosion plus important sur le plateau que dans la plaine).
b) Définition d’une nouvelle terminologie
Afin de prendre en compte cette variabilité et pour donner un cadre précis à l’étude de ces structures de nouveaux termes sont donc nécessaires. La structure, à proprement parler, qui est le plus souvent observée correspond à la juxtaposition de fossés ou sillons et de monticules formant une arête ou une crête. Dans la littérature anglo-saxonne c’est le terme de ridges and furrows qui est le plus souvent utilisé. On pourra donc parler en français de structures en « arêtes et sillons », traduction littérale de l’expression anglaise, et parfaitement descriptive. Ces structures en arêtes et sillons peuvent parfois s’intégrer dans des parcelles de différentes dimensions. Les limites parcellaires nous parviennent aujourd’hui en microtopographie y compris sous les champs labourés (PPH2P). Elles prennent la forme de reliefs linéaires imposants mais très émoussés (Ducasse et Guery, 2012, p. 60, p. 81). Lorsque l’on trouve associées les structures en arêtes et sillons et des limites parcellaires dans lesquelles celles-ci s’intègrent, on peut alors parler de « champ ». Ces parcelles regroupant plusieurs arêtes et sillons, toujours rectilignes et parallèles, semblent correspondre à une pratique différente de celle des grandes zones d’arêtes et sillons (Hall, 1998 ; voir « Champ bombés : ambiguïté du terme »). On peut alors proposer un nouveau terme, descriptif et évitant la confusion entre les deux formes. Le terme de « champ peigné » semble approprié. Il permet de décrire une unité, le champ, et l’aspect que celui-ci prend de façon imagée. Le « champ peigné » correspond donc à la préservation à la fois d’une trace parcellaire nette et d’une trace culturale dépendante de ce parcellaire. Ce modelé agraire pourrait ainsi correspondre à la pratique du billonnage dans une parcelle délimitée. On pourrait également parler de « champ billonné ». Les grandes zones d’arêtes et sillons, qui pourraient correspondre à la pratique des open fields, où chaque billon appartiendrait à un exploitant pourraient être appelé « billons et sillons ». Ce dernier terme porte un caractère plus interprétatif, lié à la pratique du labour avec une charrue à versoir fixe, tout en évitant la confusion avec d’autres structures. Le terme de « champ bombé » sera réservé lui à la pratique signalée en Belgique (Beyaert, 2006) et aux Pays-Bas (Legros, 2007, p. 85-86) et consistant à créer un dôme de terre, d’un seul mouvement, dans une parcelle afin d’isoler les cultures de la nappe d’eau. Une fois ces termes définis il est possible d’envisager des hypothèses quant au fonctionnement de ces différentes structures. La fonction de drainage, liée à la pratique agricole des billons, semble la plus probable. Les systèmes en arêtes et sillons peuvent ensuite être associés, à un niveau interprétatif, à d’autres pratiques culturales sans qu’il y ait confusion. Le tableau suivant résume les similitudes et les divergences entre les différentes pratiques agricoles de milieu humide évoquées précédemment (Fig. 9).
27 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Fig. 10 : Mise en place des « ados » et « champs bombés »selon la terminologie employée par Jean-Paul Legros (Legros, 2007)
Fig. 9 : Proposition d’une nouvelle terminologie pour les modelés agraires
Guery, 2013
28 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
D) Reconnaissance sur le terrain des structures en arêtes et sillons
Des structures de type « arêtes et sillons » (billons) ont été repérés au sol à différents endroits dans la plaine de la Saône : - aux abord de l’étang de la Bussière, anciennement étang d’Arbuère (Fig. 14) - sur la commune de Premières, vers le bois de Mondragon (Fig. 15) - autour de la commune d’Izier, voisine de Magny-sur-Tille et de Bressey-sur-Tille (Fig. 16)
Ces structures sont parfaitement similaires au ridges and furrows britanniques (Fig. 11 et 12).
Ces structures se présentent sur le terrain sous la forme d’une légère ondulation du sol, lui donnant l’aspect caractéristique d’une grande tôle ondulée. Elles ne sont visibles que lorsque la couverture végétale est rase (herbe dans le cas d’un pré, jeunes pousses dans un champ cultivé). Les reliefs et les creux sont alors visibles grâces aux variations de couleur de la végétation rase (différence d’absorbance de la lumière du jour en fonction de l’orientation). La lumière rasante facilite énormément le repérage de ses structures de faible relief (Fig. 14, 15 et 16). La présence de neige permet également de souligner le contraste entre arêtes et sillons. En fonction de l’exposition du terrain et de son humidité, la neige fondra préférentiellement sur les arêtes (soleil) ou dans les creux (présence d’eau), faisant ainsi ressortir le relief. Sur le même principe la présence de neige a permis de repérer depuis le sol les structures de type grand parcellaire arasé sous champs labourés (PPH2P) tant dans la plaine (au nord d’Epernay-sous-Gevrey) que sur le plateau, au sud du Château d’Entre-Deux-Monts. Ces reliefs (grands parcellaires et arêtes et sillons) sont visibles sur les photos suivantes (Fig. 17 et 18). Certains d’entre eux sont sous couverture LiDAR, permettant de relier directement la réalité du terrain à l’imagerie microtopographique.
Ces conditions de reconnaissance sur le terrain sont essentiellement valables pour les cas de préservation sous prés ou sous champs labourés (25% des cas sur le secteur de la côte viticole). La présence de neige favorise également le repérage sous forêt (toujours sur le même principe). On notera également que la présence d’eau dans les sillons est assez fréquente dans les secteurs sous forêt (Bois de la Vieille Morte, Epernay-sous-Gevrey), donnant un aspect assez marécageux à ces bois (Fig. 19 et 20). Ce paramètre permet donc de repérer assez facilement les structures en arêtes et sillons, et semble confirmer le rôle drainant de ces sillons.
29 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Fig. 11 : Structures en arêtes et sillons (ridges and furrows) vues près de Brailes, Warwickshire(http://www.flickriver.com/photos/hamishfenton/4119551795/)
Fig. 12 : Structures en arêtes et sillons (ridges and furrows) observées en microtopographie LiDARsur le site d’Epiacum (Whitley Castle près d’Alston, Northumberland, R-U) (www.epiacumheritage.org)
Structures en arêtes et sillons
Voie romaine« Maiden Way »
Fort romaind’Epiacum
Echellenon-fournie
30 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Fig.
13
: Str
uctu
res a
ctue
lles e
n ad
osà
Ruffe
y-lè
s-Ec
hire
y (D
ijon-
Nor
d), l
e 17
avr
il 20
13
Fig.
14
: Str
uctu
res e
n ar
êtes
et s
illon
s aux
abo
rds d
e l’é
tang
de
la B
ussiè
re,
à G
illy-
lès-
Cîte
aux,
le 1
1 m
ars 2
013
Fig.
16
: Str
uctu
res e
n ar
êtes
et s
illon
s, à
Izie
r, le
10
avril
201
3Fi
g. 1
5 : S
truc
ture
s en
arêt
es e
t sill
ons,
à Pr
emiè
res,
le 2
9 m
ars 2
013
Gue
ry, 2
013
Gue
ry, 2
013
Gue
ry, 2
013
Gue
ry, 2
013
31 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Fig.
17
: Str
uctu
res e
n ar
êtes
et s
illon
s vue
s le
long
des
foss
és d
e la
rout
e D
25gr
âce
à la
pré
senc
e de
la n
eige
, Epe
rnay
-sou
s-G
erve
y, le
20
janv
eir 2
013
Fig.
18
: Str
uctu
res d
e ty
pe g
rand
par
cella
ire (P
PH2P
),Ch
âtea
u d’
Entr
e-de
ux-M
onts
, le
20 ja
nvei
r 201
3
Gue
ry, 2
013
Gue
ry, 2
013
Fig.
19
: Str
uctu
res e
n ar
êtes
et s
illon
s vue
laté
rate
men
t et
repé
rées
grâ
ce à
la p
rése
nce
d’ea
u re
mpl
issan
t les
sillo
ns, E
pern
ay-s
ous-
Gev
rey,
le 1
1 m
ars 2
013
Fig.
20
: Str
uctu
res e
n ar
êtes
et s
illon
s vue
tran
sver
sale
men
t et
repé
rées
grâ
ce à
la p
rése
nce
d’ea
u re
mpl
issan
t les
sillo
ns, E
pern
ay-s
ous-
Gev
rey,
le 1
1 m
ars 2
013
Gue
ry, 2
013
Gue
ry, 2
013
32 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
II) Etude des structures parcellaires et agraires observées en microtopographie
A) Structures en arêtes et sillons (« champs bombés »)a) Analyse statistique : comparaison des ensembles de données LGV et CV
Afin de répondre à la question « les sillons mesurés sur le secteur de la Côte viticole appartiennent-ils au même ensemble que ceux mesurés sur le secteur de Genlis ? » il a fallu procéder à quelques tests statistiques simples sur R. Le premier de ces tests est un test de Shapiro-Wilk (shapiro.test sur R) pour déterminer si la distribution des valeurs (d’orientations, puis de longueurs) suit une loi normale ou non. Le premier obstacle a été le nombre de données : le jeu de données du secteur de la Côte (CV) comporte 3922 entrées et le jeu de données de Genlis (LGV) en compte 2157. En effet R requiert un échantillon dont la taille est comprise entre 3 et 5000 valeurs pour le test de Shapiro-Wilk. Avec 6079 valeurs, il a donc fallu échantillonner aléatoirement dans le jeu de données pour effectuer les tests (fonction sample de R). Trois tests de Shapiro-Wilk ont donc été effectués, en échantillonnant 5000 valeurs à chaque fois sur l’ensemble des données.
L’hypothèse nulle testée (H0) est « La distribution est normale ». L’hypothèse alternative (H1) est « la GLVWULEXWLRQ�Q·HVW�SDV�QRUPDOH��OHV�GRQQpHV�VRQW�QRQ�SDUDPpWULTXHV�ª��/D�YDOHXU�GH�O·HUUHXU�Ơ�HVW�FKRLVLH�j�����Si la valeur de p obtenue lors du test est proche de 1, la distribution est normale. Si la valeur de p est très faible, très éloignée de 1, la distribution ne suit pas une loi normale et il faut utiliser des tests non-paramétriques.De la même manière, si la valeur de W calculée lors du test est trop petite, il faudra rejeter H0.
Analyse de l’orientation des sillons (comprise entre 0 et 180°N)
Voici les résultats fournis par R : Echantillonnage n°1 : W = 0.9042, p-value < 2.2e-16 Echantillonnage n°2 : W = 0.9033, p-value < 2.2e-16 Echantillonnage n°3 : W = 0.9035, p-value < 2.2e-16 Les résultats confirment donc lors des trois tests que la distribution ne suit pas une loi normale. On choisira donc par la suite des test non-paramétriques. Un histogramme de fréquence permet en effet de constater que la distribution ne suit pas une loi normale (Fig. 21). Si on analyse indépendamment les données de la Côte (CV) et de Genlis (LGV) on obtient des résultats similaires. Il n’y a cette fois-ci pas besoin d’échantillonner parmi les données car la taille de l’ensemble est inférieure à 5000 valeurs. On obtient ainsi pour les données CV : W = 0.8388, p-value < 2.2e-16 On obtient pour les données LGV : W = 0.9695, p-value < 2.2e-16Ces résultats confirment bien que les valeurs des orientations des sillons ne suivent pas une loi normale.
La question initiale était de savoir si les sillons du secteur de la Côte étaient de même orientation que ceux du secteur de la LGV. Il s’agit donc statistiquement de déterminer si deux populations sont identiques ou non : le test de Mann-Whitney-Wilcoxon (MWW) permet de tester l’hypothèse nulle H0 « les populations sont identiques » sur des données non-paramétriques. L’hypothèse alternative H1 est que l’une des populations est VLJQLILFDWLYHPHQW�GLIIpUHQWH�GH�OD�VHFRQGH��/·HUUHXU�Ơ�HVW�FKRLVLH�j���� Effectué sur les 6079 valeurs, le test MWW (wilcox.test sur R) fournit les résultats suivants : V = 18159351, p-value < 2.2e-16, alternative hypothesis: true location is not equal to 0. Il y a donc une différence significative entre les orientations des sillons du secteur de la Côte et celles du secteur de la LGV. Les structures en arêtes et sillons ne sont donc pas orientées de la même manière sur les deux secteurs étudiés. Sur le secteur de la Côte, l’orientation principale est N10-N20, et son pendant N100-N110. Cette orientation correspond à l’orientation du relief de la Côte viticole. Sur le secteur de la LGV, l’orientation principale est N120. Cette orientation est proche de celle des affluents de la Saône que sont la Tille ou la Norges. Cette observation semble aller dans le sens de l’hypothèse formulée en introduction (voir partie Contexte
33 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
géoenvironnemental) : la topographie a une forte influence sur l’orientation des parcellaires et des villages ; sur le secteur viticole c’est le relief de la Côte qui a la plus forte influence, tandis que dans la plaine ce sont les bassins versants qui influencent le plus la disposition des villages et des parcellaires.
Il est important de préciser que si l’on considère que les orientations perpendiculaires entre elles constituent un ensemble morphologique (Deweirdt, 2009), et qu’ainsi on conduit l’analyse statistique sur ces « faisceaux » d’orientations, et non plus sur les orientations elles-mêmes, les résultats obtenus sont similaires.Pour effectuer cette analyse il a fallu retrancher 90 à toutes les valeurs d’orientations supérieures à 90°.En procédant de la même manière que précédemment on a testé la normalité puis l’identité des données grâce au test de Shapiro-Wilk, puis au test de Mann-Whitney-Wilcoxon. Les résultats sont les suivants : Test de Shapiro-Wilk (échantillonnage sur 5000 individus) : Echantillonnage n°1 : W = 0.8436, p-value < 2.2e-16 Echantillonnage n°2 : W = 0.8455, p-value < 2.2e-16 Echantillonnage n°3 : W = 0.8491, p-value < 2.2e-16
Sur le jeu de données du secteur de la Côte les résultats donnent W = 0.7648, p-value < 2.2e-16 ; sur le secteur de Genlis on obtient W = 0.9251, p-value < 2.2e-16. Les jeux de données est donc non-paramétriques. Le test non-paramétrique MWW fournit le résultat : V = 18159351, p-value < 2.2e-16, alternative hypothesis: true location is not equal to 0. Les faisceaux de sillons du secteur de la Côte et de Genlis sont donc bien significativement différents, comme l’indiquaient les résultats précédents. Les diagrammes suivants confirment ces résultats (Fig. 22)
Analyse de la longueur des sillons
On procède de la même manière que précédemment. Il s’agit donc d’abord de déterminer si la distribution des données (celles de la Côte, celle de la LGV, les deux ensembles réunis) suit une loi normale, puis de déterminer si les longueurs mesurées sur le secteur de la Côte et sur le secteur de la LGV appartiennent à un même ensemble.
Comme précédemment, on échantillonne 3 fois 5000 données parmi les 6079 valeurs de longueurs, et on teste à chaque fois la normalité de la distribution grâce à un test de Shapiro-Wilk (shapiro.test).
Voici les résultats fournis par R : Echantillonnage n°1 : W = 0.8488, p-value < 2.2e-16 Echantillonnage n°2 : W = 0.8523, p-value < 2.2e-16 Echantillonnage n°3 : W = 0.8482, p-value < 2.2e-16
Avec à chaque fois des valeurs faibles et identiques pour W, et pour p, on conclut que les données ne sont pas paramétriques et que leur distribution ne suit pas une loi normale, comme le montre bien l’histogramme de distribuions des fréquences (Fig. 23)On peut ensuite tester séparément les données issues du secteur de la Côte et celle de la LGV. On obtient pour les sillons de la Côte W = 0.8492, p-value < 2.2e-16, indiquant que les données sont non-paramétriques. Le résultat pour les sillons de la LGV sont similaires avec W = 0.8978, p-value < 2.2e-16, indiquant également des données non-paramétriques. Les histogrammes de fréquences confirment ces résultats.
Afin de répondre à la question initiale, portant sur l’identité des deux jeux de données, on effectue le test non-SDUDPpWULTXH�GH�0DQQ�:KLWQH\�:LOFR[RQ��ZLORF�WHVW��FRPPH�SUpFpGHPPHQW��/·HUUHXU�Ơ�HVW�FKRLVLH�j�����+��fait l’hypothèse de l’identité des deux populations statistiques, H1 est l’hypothèse alternative d’une différence significative entre les deux jeux de données. On obtient pour l’ensemble des valeurs traitées (6079 entrées) le résultat suivant : V = 18480160, p-value < 2.2e-16, alternative hypothesis: true location is not equal to 0
On rejette donc l’hypothèse H0 d’identité : il existe une différence significative entre les deux populations statistiques. Les sillons du secteur de la Côte viticole semblent être donc statistiquement plus longs que ceux du secteur de la LGV.
34 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Comme formulés dans la partie « Reconnaissance des champs bombés en microtopographie LiDAR », certains doutes peuvent être avancés quant à la pertinence de l’analyse en terme de longueur des sillons. Le biais de préservation est en effet très important et il est souvent difficile de déterminer si un sillon est complet. Doit-on considérer que les valeurs extrêmes que présentent certains sillons (valeur maximale de 677 m sur le secteur de la Côte pour une moyenne de 133 m et une médiane de 110 m, 552 m sur le secteur de la LGV pour une moyenne de 111 m et une médiane de 95 m) sont des anomalies ? Ou bien est-il raisonnable de penser qu’elles représentent les meilleurs états de conservation, et qu’en conséquence une grande partie des autres sillons de « petites » dimensions sont le produit de la fragmentation liée à une mauvaise préservation ? Comment alors faire la différence entre des sillons dont la taille initiale est « petite » (de l’ordre de la centaine de mètres) de ceux qui ont été fragmentés ?
Si on considère que les longueurs mesurées sont pertinentes, quelle peut être l’explication pour ces différences de longueurs ? Un terrain plus humide nécessitant des sillons plus courts pour un meilleur drainage ? Un partage de la terre différent ? Des finages plus petits ?
Analyse de l’amplitude et de la fréquence des sillons
La méthode d’acquisition des données a été sensiblement différente ici. Le premier traitement a consisté à générer des profils topographiques transversaux aux structures en arêtes et sillons (Fig. 26). Au total 16 profils ont été tracés sur 16 zones différentes, à chaque fois dans des ensembles d’arêtes et sillons cohérents (une seule orientation, longueurs similaires). Parmi ces 16 profils, 8 ont été choisis pour l’analyse dans 2 secteurs qui ont particulièrement attiré notre attention : 4 dans le bois de la Vieille Morte à Epernay-sous-Gevrey (où un sondage a été effectué dans le cadre de l’étude) et 4 en lisière et à l’intérieur du bois de Mondragon (où une motte castrale recoupant ces structures a été découverte par l’Inrap). Ces profils sont créés grâce à l’outil 3D Analyst (Option « Diagramme de profil »). Les données issues de ce profil sont extraites au format Excel. Les informations en X et en Y fournies sont précises au centimètre, voire au dixième de centimètre (on rappellera alors que cette précision est à relativiser, le MNT ayant fait l’objet de nombreux traitements lissant et modifiant sa résolution). Y correspond à l’altitude réelle, X est donné par rapport au point de départ du profil (valeur arbitraire ayant peu de valeur en soi). Pour une meilleure lecture, les valeurs de Y sont visualisées en fonction de X dans un histogramme (Fig. 25A). On rentre ensuite dans une nouvelle base de données les informations suivantes : nom du site, rang de l’ensemble sillon-arête-sillon mesuré (par rapport au point de départ), valeur Y la plus basse du premier puis du second sillon, valeur Y la plus élevée de l’arête, valeurs X correspondantes. Y et X sont donnés en mètres. Pour chaque rang, le sillon n°2 est le sillon n°1 du rang suivant. Ces informations permettent de calculer l’amplitude de chaque arête relativement aux deux sillons qui l’entourent (Yarête-(Ysillon1+Ysillon2)/2), la longueur d’onde (Xsillon2-Xsillon1) et enfin la fréquence associée (Longueur G·RQGH�ƪ����
Au total l’analyse en terme d’amplitude et de fréquence porte sur 93 rangs (sillon-arête-sillon). Sur l’ensemble des rangs, l’amplitude moyenne est de 17,5 cm et la médiane est à 17,2 cm. La longueur d’onde moyenne est de 10,11 m et la médiane est à 10,23 m, soit une fréquence moyenne de 0,10 et une fréquence médiane de 0,12. Les valeurs médianes et moyennes restent extrêmement proches, indiquant une grande homogénéité du jeu de données. La valeur de fréquence elle permet de se détacher des valeurs de longueur d’onde brutes et de comparer des ensembles sensiblement différents entre eux.
Dans le détail, les analyses effectuées sur le secteur de la Veille Morte à Epernay-sous-Gevrey (MNT CV) et sur le secteur de Mondragon à Premières/Collonges-lès-Premières (MNT LGV) montrent une légère différence en terme d’amplitude. Le secteur de la Vieille Morte présente une amplitude moyenne de 16,6 cm et une amplitude médiane de 15,5 cm, une longueur d’onde moyenne de 10,02 m et une longueur d’onde médiane de 9,48 m, soit une fréquence (moyenne et médiane) de 0,11. Le secteur de Mondragon présente une amplitude moyenne de 18,1 cm et une amplitude médiane de 17,9 cm, une longueur d’onde moyenne de 10,17 m et une longueur d’onde médiane de 10,98 m, soit une fréquence moyenne de 0,13 et une fréquence médiane de 0,09.
35 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
L’analyse en détail, site par site, permet de comprendre cette différence d’amplitude (Fig. 25). Elle est liée d’une part au très fort arasement (amplitude très faible) du site n°3 du bois de la Vieille Morte, et d’autre part à la bonne préservation (fortes amplitudes) du site n°8 du bois de Mondragon. Les résultats sont les suivants (les profils topographiques et la localisation précise de chaque site est disponible en Annexes) : - Site n°1 : Bois de la Vieille Morte (zone sondée)L’amplitude moyenne est de 18,3 cm et l’amplitude médiane de 18,9 cm, la longueur d’onde (moyenne et médiane) est de 9,48 m, soit une fréquence (moyenne et médiane) de 0,11.
- Site n°2 : Bois de la Vieille Morte (nord de la route)L’amplitude moyenne est de 14,8 cm et l’amplitude médiane de 15,3 cm, la longueur d’onde moyenne est de 10,74 m et la longueur d’onde médiane est de 10,45 m, soit une fréquence (moyenne et médiane) de 0,10.
- Site n°3 : Bois de la Vieille Morte (nord de la route, premier layon)L’amplitude moyenne est de 12,7 cm et l’amplitude médiane de 10,2 cm, la longueur d’onde moyenne est de 10,31 m et la longueur d’onde médiane est de 9,47 m, soit une fréquence moyenne de 0,10 et une fréquence médiane de 0,11.
- Site n°4 : Bois de la Vieille Morte (lisière de forêt)L’amplitude moyenne est de 19,9 cm et l’amplitude médiane de 19,1 cm, la longueur d’onde (moyenne et médiane) est de 10,18 m, soit une fréquence (moyenne et médiane) de 0,10.
- Site n°5 : Pré sud de la commune de Premières (lisière du bois de Mondragon)L’amplitude moyenne est de 17,5 cm et l’amplitude médiane de 17,9 cm, la longueur d’onde moyenne de 11,05 et la longueur d’onde médiane est de 11,37 m, soit une fréquence (moyenne et médiane) de 0,09.
- Site n°6 : Pré nord de la commune de Premières (lisière du bois de Mondragon)L’amplitude moyenne est de 16,3 cm et l’amplitude médiane de 17,9 cm, la longueur d’onde moyenne de 15,73 et la longueur d’onde médiane est de 15,23 m, soit une fréquence (moyenne et médiane) de 0,07.
- Site n°7 : Motte Castrale de MondragonL’amplitude moyenne est de 15,5 cm et l’amplitude médiane de 14,2 cm, la longueur d’onde moyenne de 6,25 m et la longueur d’onde médiane est de 4,74 m, soit une fréquence (moyenne et médiane) de 0,21.
- Site n°8 : Ancien étang de Larsingue (Bois de Mondragon)L’amplitude moyenne est de 27,3 cm et l’amplitude médiane de 27,1 cm, la longueur d’onde moyenne de 11,73 m et la longueur d’onde médiane est de 11,48 m, soit une fréquence (moyenne et médiane) de 0,09.
On remarque que la présence de prés sur les structures en arêtes et sillons ne semble pas influencer la préservation de ces structures par rapport à la présence d’un couvert forestier. Les valeurs d’amplitude étant même légèrement supérieures à la moyenne, on pourrait supposer que ces structures (d’ailleurs plus rectilignes que d’ordinaire) sont plus récentes, ou du moins ont persisté plus longtemps. Sur le site de la motte castrale, les amplitudes sont nettement diminuées et les longueurs d’ondes sont beaucoup plus faibles que dans les autres sites, ce qui peut s’expliquer par la présence d’autres tracés linéaires ayant pu être confondus avec des sillons (tracés liés à la motte castrale probablement). La très bonne préservation des arêtes et sillons du site n°8, elle, est probablement liée à la présence de l’étang de Larsingue, aménagé autour de la motte castrale de Mondragon, et qui les a probablement protégés tout au long de son fonctionnement (jusqu’au XIXème siècle environ).
Les profils topographique tranversaux et longitudinaux effectués sur les 8 sites sont consultables en annexes, ainsi que la base de données constituée à partir de leurs valeurs.
36 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Fig.
21
: Dist
ribut
ion
des v
aleu
rs d
’orie
ntat
ions
des s
illon
sFi
g. 2
2 : D
istrib
utio
n de
s fai
scea
ux d
e sil
lons
Fig.
23
: Dist
ribut
ion
des v
aleu
rs d
e lo
ngue
urs
des s
illon
s
A :
CV
et
LGV
en d
egré
sen
deg
rés
en m
ètre
s
B :
CV
en d
egré
sen
deg
rés
en m
ètre
s
C :
LGV
A :
CV
et
LGV
B :
CV
C :
LGV
A :
CV
et
LGV
B :
CV
C :
LGV
en d
egré
sen
deg
rés
en m
ètre
s
38 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
b) Secteur de la Côte viticole (plaine et plateau)
Le MNT CV couvre une surface rectangulaire de 9,9 sur 8,7 km couvrant à la fois le plateau (jusqu’à la limite est de la commune de Chamboeuf), les versants viticoles (Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis, Vougeot...) et le début de la plaine de la Saône (jusqu’à la bordure ouest des finages de Fénay et Saulon-la-Rue).Ce secteur a été « exploré » en 2012 et les données LiDAR, pour la première fois exploitées, avaient permis de recenser un grand nombre de structures en arêtes et sillons, couvrant une surface de 5,18 km2. C’est sur la base de ce premier repérage que les sillons des structures en arêtes et sillons ont pu être vectorisés lors de cette étude. De nouvelles zones ont été découvertes et sont venues compléter les surfaces déjà repérées (notamment sur le plateau). Au total 9 grands ensembles (Fig. 27, chaque ensemble est consultable en annexes) concentrant ces structures on été définis. Certains ensembles sont évidemment étroitement liés et la définition des ensembles ne correspond qu’à une proximité géographique et à des continuités évidentes. Nous ne reviendrons que de façon ponctuelle, au cours de la description des ensembles, sur les découvertes qu’avait permis de faire le relevé LiDAR sur le secteur. Plus de 1200 structures avaient été repérées, parmi lesquelles moins de 10% étaient connues par le SRA (Ducasse et Guery, 2012, p. 28).
La vectorisation a permis de repérer 3922 sillons. On distingue alors des exemples très rectilignes et parfaitement parallèles côtoyant d’autres plus curvilignes et parfois convergents. Les sillons y sont en moyenne plus long que sur le secteur de la LGV (voir partie Analyse statistique) et on y trouve notamment le record de longueur avec un sillon mesurant 677 m (il ne s’agit par d’un cas isolé ou d’une valeur aberrante puisque ce sillon est entouré de sillons compris entre 500 et 670 m de longueur, voir Ensemble des bois de Buisson Rond-Champ Roué (St-Philibert et Broindon)).
Description des ensembles
Ensemble d’Epernay-sous-Gevrey
L’ensemble d’Epernay-sous-Gevrey a déjà fait l’objet d’une étude de cas, au cours de laquelle une première chronologie relative avait été établie (Ducasse et Guery, 2012, p. 76-80). Cette dernière établissait notamment l’antériorité des structures en arêtes et sillons (« champs bombés » dans la littérature) à la voie reliant Epernay-sous-Gevrey à Gilly-lès-Cîteaux (route D25 actuellement). Bien que la jonction de cette route avec l’ancienne voie romaine (mention IGN) ait été modifiée depuis le XIXème siècle (Fig. 28), le reste de son tracé semble relativement stable. Aucune autre trace de voie n’a en tout cas été repérée en microtopographie, ni à proximité de la D25, ni à proximité de la voie romaine, suggérant que pour ce secteur ces deux voies ne se sont pas ou peu déplacées. On observait également que les structures en arêtes et sillons semblaient venir « s’appuyer » sur la voie romaine ne la recoupant pas et ne semblant pas être recoupée par elle. On observe de surcroît un parallélisme ou une perpendicularité des structures au tracé de la voie. Cette voie semble d’autre part marquer une limite puisque les structures en arêtes et sillons ne sont pas retrouvées directement de l’autre côté de la voie. Cette voie romaine marque aujourd’hui la limite ouest du territoire de la commune, et l’absence de structures en arêtes et sillons à l’Ouest de la voie pourrait suggérer qu’elle marquait déjà à l’époque de l’établissement de ces structures une limite de finage. La pérennité de cette voie aurait donc été assurée entre autre par son rôle de limite de finage. On peut donc avancer avec assez d’assurance que les structures en arêtes et sillons sont postérieures à l’établissement de la voie, qui structure l’environnement local.
Cet élément de datation relative est particulièrement important pour la compréhension de ces structures. La position et la pérennité de la voie romaine sont également essentielles. On observe en effet ailleurs des exemples de voies romaines arasées et recouvertes par des modelés agraires de type arêtes et sillons. Le cas le plus frappant est celui de la « Maiden Way » rejoignant le fort romain d’Epiacum (Whitley Castle, Alston, Northumberland, Royaume-Uni ; Fig. 12). L’occupation de ce fort romain est comprise entre 100 et 410 ap. J.-C. et il semble être le seul fort construit aux abord de la « Maiden Way ». Les structures en arêtes et sillons (ridges and furrows) viennent donc se mettre en place après l’occupation romaine, à une époque
39 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
où la voie romaine n’est plus utilisée (www.epiacumheritage.org). On observait également lors du traitement exploratoire des données LiDAR de la Côte une ancienne voie, recouverte par les structures en arêtes et sillons de Sathenay (voir Ensemble de Sathenay), a priori datée de l’époque gallo-romaine (information SRA ; Ducasse et Guery, 2012, p. 66).
L’ensemble d’Epernay-sous-Gevrey, essentiellement constitué de structures préservées sous forêt, montre aussi de nombreux exemples de préservation sous labour actuel avec de belles continuités entre les structures sous forêt et les structures sous champs (à la lisière est du bois de la Vieille Morte, au sud de la D25, lieu-dit « Le Jardin »). Seule la microtopographie permet alors de repérer ces modelés dont l’arasement est extrêmement important, comme en témoignent les profils topographiques générés (Fig. 26). La microtopographie nous apprend également que tous les sillons vectorisés sur ce secteur présentent une pente (Fig. 24), permettant le drainage vers des zones basses et humides, à l’instar de la zone ayant été sondée (voir plus bas le bilan de l’opération de terrain).
Enfin, l’ensemble d’Epernay-sous-Gevrey se distingue des autres par la présence de structures de type « ackerberg » ou « crêtes de labour », dont la formation est directement liée à la pratique du labour à la charrue (Callot, 1980, p. 9-11). Leur association avec des structures en arêtes et sillons est parfaitement connue, et cohérente, puisque ces crêtes de labour sont formées involontairement par le dégagement de terre lors des demi-tours de la charrue, en bout de champ. On repère également leur présence sur l’ensemble de Mondragon, sur la commune de Collonges-lès-Premières, où comme à Epernay-sous-Gevrey, leur position en sommet de pente ne semble pas gêner la fonction de drainage des sillons (voir Ensemble de Mondragon).
Ensemble de Gilly-lès-Cîteaux
L’ensemble de Gilly-lès-Cîteaux se trouve au nord du finage, entre la Rente d’Arbuère, la Ferme de la Bussière, l’étang de la Bussière et le lieu-dit « les Grandes Corvées ». Il est essentiellement constitué de structures préservées sous prés. Outre la différence de préservation avec les ensembles voisins, plutôt conservés sous forêt, l’ensemble de Gilly-lès-Cîteaux est constitué de structures très rectilignes, à l’exception de celles observées le long du Saviot, dans le lieu-dit « les Grandes Corvées ». L’élément essentiel de chronologie relative est la présence de l’étang de la Bussière recoupant certaines structures en arêtes et sillons. Cet étang était dénommé « Etang d’Arbuère », probablement en lien avec la rente du même nom. Un règlement de paix de 1221 retrouvé dans les archives cisterciennes décrit l’aménagement d’un étang sur ce secteur. Sans qu’il ait été possible de le localiser avec précision, il paraît probable que cet étang soit l’Etang d’Arbuère (Moniot, 1955, p. 18). On trouve également mention du Bois de Vichard qui présente quelques exemples très arasés de structures en arêtes et sillons, toutes orientées perpendiculairement au Saviot, affluent de la Vouge qui traverse le bois après avoir alimenté l’Etang d’Arbuère.
Ce secteur pourrait faire l’objet d’une étude approfondie, notamment pour restituer l’histoire précise de l’étang d’Arbuère et des changements de propriétaire qu’indique probablement la toponymie.
Ensemble des bois de Buisson Rond-Champ Roué (St-Philibert et Broindon)
L’ensemble des bois de Buisson Rond-Champ Roué se trouve à cheval sur les communes de Broindon et Saint-Philibert, au Nord de la ferme de la Bussière. Les sillons des deux bois sont séparés par une bande de terre cultivée autour de la Manssouse, ruisseau sous-affluent de la Sans-Fond.
Il s’agit des sillons les plus longs observés sur le secteur, avec une soixantaine d’entre eux mesurant entre 500 et 700 m. Les profils topographiques n’indiquent pas de pente dans les sillons. Ces derniers présentent des convergences et sont relativement curvilignes. La totalité des sillons vectorisés se trouvent sous couvert forestier.
40 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Ensemble des bois de Baillard-la Couelle (Morey-st-Denis et Gevrey-Chambertin)
Cet ensemble extrêmement proche des deux précédents est également préservé exclusivement sous couvert forestier. Le Bois Baillard se situe à limite est du finage de Morey-Saint-Denis et le Bois de la Couelle à la limite sud-est du finage de Gevrey-Chambertin. Les sillons y sont très rectilignes et de taille moyenne (la moyenne sur le secteur est de 133 m, voir partie « Analyse statistique »). Les deux bois sont là encore séparés par la Manssouse, qui prend sa source au pied de la Côte, à l’Est de la route des Grands Crus. Comme les deux ensembles de Buisson Rond-Champ Roué et de Gilly-lès-Cîteaux, les structures se trouvent en limite de finages, dans des zones relativement laissées à l’abandon loin des habitats. La présence des structures en arêtes et sillons témoigne d’une organisation du territoire différente, où ces zones marginales avaient leur importance.
Ensemble de Sathenay
L’ensemble de Sathenay, essentiellement sur la commune de Gevrey-Chambertin est réparti au Nord-Ouest de la Ferme de Sathenay autour des étangs du même nom. Les sillons y sont très rectilignes et une partie d’entre eux est très clairement recoupée par le Grand Etang de Sathenay. Ces étangs sont des pièces d’eaux artificielles dédiées à l’alevinage (Beck, 2008) et les premières carpes y sont importées en 1345 (Berthier, 2006). Là encore les structures sont exclusivement préservées sous forêt. Cet ensemble est extrêmement proche des lieux-dits de « La Caillée-Pennecière » et « Au-dessus de Bergis » où ont été retrouvées respectivement des traces de culture maraichère (Billoin et Dufour, 2005) et les plus anciennes traces de viticulture gallo-romaine (Chevrier et Garcia et coll., 2010). Ces sites sont actuellement à l’emplacement de l’aire de service de Gevrey-Chambertin au bord de l’A31 et d’un lotissement de Gevrey. Aucun lien n’a pu être établi entre ces sites et les structures en arêtes et sillons observés à proximité.
Ensemble de Charme Rousse
L’ensemble de Charme Rousse est un petit ensemble dans le bois du même nom, sur la commune de Fixin, à l’extrémité est du finage. Il est complété, sur le bord ouest de la Gare de Triage de Gevrey-Chambertin, par des structures observées dans le bois dit « le Suchot » et sous labour actuel au lieu-dit « sur les Essarts » (en continuité avec les structures du bois).
La particularité du Bois de Charme Rousse est de présenter une série d’enclos délimités par des fossés de taille conséquente (amplitude de plus d’1 m ; Ducasse et Guery, 2012, p. 69). La nature exacte de ces enclos reste à déterminer mais on a clairement identifié des éléments construits au milieu du premier enclos (Ducasse et Guery, 2012, p. 68). Les enclos suivants semblent venir compléter ce premier enclos, à la manière d’auréoles de défrichement (au moins deux phases successives). Les structures en arêtes et sillons en contact direct avec le plus grand enclos (le dernier chronologiquement ?) semblent contourner le fossé, ce qui pourrait éventuellement suggérer qu’elle lui sont contemporaines.
Aucune datation n’a pour l’instant été fournie pour les enclos de Charme Rousse, mais la forêt qui les recouvre est déjà signalée sur cadastre napoléonien. L’absence de toute mention dans les archives d’un tel site laisse supposer d’une certaine ancienneté et de l’oubli général qui l’accompagne.
Ensemble de la Sans-Fond (Cents-Fonts, Fénay)
L’ensemble de la Sans-Fond est un très petit ensemble préservé à la fois dans le Bois de la Sainte Chapelle et sous labour actuel à côté du hameau de Sansfond (se situant à la source de la rivière du même nom). On remarquera la fluctuence de la toponymie. Initialement orthographié « Cents-Fonts » sur le cadastre napoléonien, suggérant la présence de nombreuses sources (fonts ; Laine et al, 2010), le toponyme est devenu « Sans-Fond » par homophonie et « Sansfond » sur la carte IGN. Le hameau, la rivière, et le marais qui lui est
41 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
associé se trouvent sur le territoire de Chevigny, sur la commune de Fénay. Ce secteur a fait l’objet d’une étude géoarchéologique et de stages de terrain (Master GBS et AGES, université de Bourgogne) visant à comprendre le fonctionnement et les modalités de formation du marais. On sait ainsi que le marais est créé au XIIème siècle par les moines cisterciens (Laine et al, 2010). Relativement rectilignes et de faibles dimensions, les sillons observés sont majoritairement perpendiculaires au cours de la Sans-Fond et présentent une pente cohérente avec une fonction de drainage.
Ensemble de la Fortelle
L’ensemble de la Fortelle est séparé en deux zones à la tête des combes Gourmand et St-Martin, à cheval sur les communes de Fixin et Brochon. Les sillons observés sont préservés sous le couvert forestier. Il s’agit d’un des rares exemples de structures en arêtes et sillons sur plateau. Les sillons présentent un tracé plus variable, on observe des recoupements et des convergences, et leur reconnaissance est moins aisée à cause de la présence de ressauts topographiques et d’un arasement plus important. Les structures signalées ici semblent parfois entourées « d’enclos » délimitant des lanières. Ces structures ont parfois été classées dans une autre catégorie lors du traitement exploratoire des données, du fait de la confusion que peuvent créer ces enclos (Ducasse et Guery, 2012, p. 63-65). Ces modelés se trouvent au-delà des auréoles de défrichement associées à la ferme de la Fortelle, et pourraient donc lui être antérieurs. La mise en place de la Fortelle n’est pas datée avec précision, mais elle pourrait correspondre à la mise en culture des plateaux entre le XVIII et le XIXème siècle. Ces structures sont recoupées par des structures de type zone d’extraction et par des fours à chaux dont l’analyse et la datation fournirait des éléments clés à la compréhension de l’ensemble.
Ensemble de la Buère
L’ensemble de la Buère se trouve sous forêt entre les communes de Morey-Saint-Denis, de Gevrey-Chambertin et de Curley. Comme pour l’ensemble précédent, toutes les structures observées se trouvent au-delà de l’auréole de défrichement associée à la Ferme de la Buère, dans le même contexte que pour la Fortelle. Les sillons repérés sont relativement rectilignes, avec quelques ruptures d’orientation et des recoupements. C’est la topographie, et notamment à proximité des combes, qui semble guider l’orientation des sillons. Ici comme à la Fortelle on n’observe pas de pente dans la plupart des sillons et la fonction de drainage semble peu évidente. Ces structures n’avaient pas été repérées lors de la précédente étude, probablement à cause de leur arasement très important. C’est la combinaison des ombrages d’azimut 225 et 315 qui a permis de les mettre en évidence. Cet ensemble est le plus important observé sur plateau. La présence de structures en arêtes et sillons vient semer le doute sur la fonction de drainage qu’on leur attribue jusque là. Il ne s’agit cependant pas d’un cas isolé, puisque leur présence sur plateau calcaire est signalée en Alsace (Callot, 1980, p. 190-192). Cette présence sur les plateaux et de surcroit au milieu du réseau dense des grands parcellaires (voir plus bas) vient par contre renforcer l’hypothèse d’un fonctionnement simultané des deux types de structures (Ducasse et Guery, 2012, p. 82).
43 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Sondage d’Epernay-sous-Gevrey
Une tranchée a été creusée dans le Bois de la Vieille Morte (ou Vieille Motte, information SRA) sur la commune d’Epernay-sous-Gevrey, dans la Parcelle 168 (Fig. 28, voir autorisations en annexes). Le site a été choisi d’une part pour son accessibilité (à proximité de la route D25, accessible grâce à deux layons dans la forêt) et d’autre part car il avait fait l’objet d’une première étude visant à obtenir une datation par chronologie relative (Ducasse et Guery, 2012, p. 76-80). L’opération a été conduite grâce à une pelleteuse 8 tonnes. La tranchée a été creusée perpendiculairement aux structures en arêtes et sillons, sur une longueur de 22 m, une largeur d‘1,50 m et une profondeur de 60 cm. Elle a été précédée d’un décapage de la terre végétale sur la même longueur et une largeur de 2,50 m. Elle recoupait ainsi 1 arête complète entourée de 2 sillons. Les déblais avait été déposés au Nord afin de faciliter l’observation de la coupe et l’éclairage naturel.
Les conditions météorologiques n’ont pas permis d’exploiter immédiatement le sondage. Les premières observations au cours de l’opération ont permis de repérer très nettement une différence de couleur entre les arêtes et les sillons, cette différence de couleur traduisant un enrichissement en matière organique dans les sillons. Les arêtes quant à elles semblent constituées du même matériau argileux jaune que le substrat. On observe aussi que la structure du substrat semble altérée dans les arêtes, qui sont les premières zones à s’effondrer le long de la coupe. Plus en profondeur le substrat est plus compact et sa structure semble plus uniforme.
Ces observations succinctes n’ont pas pu être approfondies. Dès la fin du sondage, la nappe d’eau a commencé à apparaitre au fond de la tranchée, et de fortes précipitations ont empêché la poursuite des observations. La tranchée a été creusée le mercredi 15 mai 2013 entre 14 et 16h. Le jeudi 16 mai à 10h la tranchée s’était remplie de plus de 20 cm d’eau, soit près de 7 m3. Les précipitations se sont poursuivies presque sans discontinuer au cours des jours suivants. Le mercredi 22 mai 2013 la tranchée était remplie à raz bord, ce qui représente environ 20 m3 d’eau (Fig. 29). Devant la persistance du mauvais temps et l’impossibilité de pomper et d’évacuer cette quantité d’eau ailleurs, les opérations de relevé n’ont pas pu être effectuées.
En se basant sur les photos prises systématiquement le long de la coupe avant l’inondation, une restitution de la coupe a été tentée par la technique d’Orthophotographie Haute Résolution (OHR) développée par la société Captair. Il est à noter que ces photos ont été prises sur la tranchée juste après que celle-ci ait été creusée, et donc avant que la coupe n’ait pu être redressée et nettoyée. C’est cependant le seul enregistrement disponible (Fig. 30).
La méthode OHR est basée sur les principes classiques de photogrammétrie, consistant à associer entre eux les pixels communs de différentes photographies. Cette technique développée au XIXème siècle vise à reproduire la vision stéréoscopique humaine. En corrélant les pixels communs de différentes photos prises sur un même objet, il est ainsi possible de repositionner les pixels les uns par rapport aux autres et de corriger les déformations liées à l’optique de l’appareil photo utilisé. L’enjeu essentiel est donc d’obtenir assez de recouvrement entre chaque photographie tout en prenant des angles de prise de vue différents. La photogrammétrie permet la modélisation 3D tandis que l’orthophographie se limite à corriger la déformation des images dans un repère orthonormé. Les orthophotographies réalisées par Captair sont produites à partir de clichés haute résolution pris avec des optiques à focale fixe calibrées. Après l’acquisition, la seconde étape est l’aérotriangulation, c’est à dire le repositionnement dans l’espace de chaque pixel, et des photographies qui lui sont associées. Ce repositionnement est possible grâce au logiciel MicMac développé par l’IGN. Celui-ci génère des faisceaux passant par le centroïde de chaque pixel. Les points d’intersections de ces faisceaux permettent le repositionnement des pixels et des photographies d’origine. Les premiers pixels communs détectés lors du processus dessinent une trame sur laquelle les clichés d’origines seront assemblés et redressés. Dans le cas de la production d’un modèle 3D, le même processus sera complété par une étape de corrélation dense, générant plusieurs millions de points à partir des pixels communs des clichés d’origines. Cette étape de corrélation dense pourra être suivie ou non d’une étape de texturage. La résolution obtenue est alors millimétrique à centimétrique et le résultat fourni est un nuage de points extrêmement dense, en vraies couleurs, ou chaque point est associé à un pixel réel (Documentation Captair, 2013).
44 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Les conditions météorologiques empêchant de vider la tranchée, d’observer en détail la coupe et d’échantillonner, il a été choisi de procéder différemment. Plusieurs tentatives de carottages et une tentative de prélèvement par bloc ont été réalisées à proximité de la tranchée. Le prélèvement par bloc consistait à « découper » un bloc à l’aide d’une bêche coupante sur le bord de la coupe, afin de prélever en son cœur de la matière organique non-contaminée par les mouvements de fluides et l’opération. Mais la combinaison de la fragilité des berges de la tranchée, de la nature très compacte du substrat au-delà de 25 cm de profondeur, et de la présence de racines n’a pas permis d’obtenir un résultat satisfaisant. Le bloc prélevé était essentiellement constitué des niveaux supérieurs de remplissage et l’échantillonnage effectué sur ce bloc était peu qualitatif. Ce prélèvement a été effectué dans le deuxième sillon à 21 m du bord Ouest de la tranchée (à 1 m du bord Est), directement depuis la coupe. Il s’agissait d’un pavé de 25 cm de hauteur et 40 cm de côté.
5 carottages ont ensuite été effectués dans le premier sillon, à 11 m du bord Ouest de la coupe. Le premier a été effectué à 1 m du bord Sud de la tranchée, à l’aide d’une gouge de 50 cm. Le terrain étant complètement inondé et gorgé d’eau, l’essentiel de la carotte (C1) n’est pas remonté lorsque l’on a retiré la gouge. Un deuxième essai a été effectué dans l’alignement, à 1,5 m du bord Sud de la tranchée. La carotte (C2) remontée a permis d’échantillonner de la matière organique à 20 cm de profondeur, des fragments de charbon et ce qui semble être une petite graine (indéterminée) à 40 cm de profondeur.
Deux nouveaux essais ont ensuite été effectués à proximité du bord Nord de la tranchée. Le premier à la gouge n’a pas permis de remonter une carotte. Le second à la tarière (T1) n’a pas permis d’échantillonner. En raison du manque de place (présence des déblais), ces deux essais ont été fait à 30 cm du bord de la coupe. Les forages se sont immédiatement remplis d’eau et il a été impossible de poursuivre les carottages, le but étant de récupérer des matériaux non-contaminés.
Un cinquième essai a été effectué sur le bord Sud de la tranchée, à proximité du carottage à la gouge (C2). On a cette fois-ci utilisé la tarière, en deux fois, le premier prélèvement sur 20 cm correspondant au remplissage et à l’humus actuel (T2a), le second se trouvant à la limite entre le remplissage et le « fond » du sillon (T2b). Deux échantillonnages de matière organique ont été effectués, l’un à 18 cm (dans T2a), le second à 35 cm de profondeur (dans T2b).
Les échantillons prélevés sur C2 et T2b semblant les plus intéressants et les plus susceptibles de fournir une date de fonctionnement des structures en arêtes et sillons, ils ont été immédiatement envoyés pour datation en Floride. Les résultats n’ont pas encore été communiqués à l’heure de la rédaction de ce mémoire.
45 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Fig.
30
: Rel
evé
OH
R (O
rtho
phot
ogra
phie
Hau
te R
ésol
utio
n) d
e la
cou
pe N
ord
dans
la tr
anch
ée, a
vant
les i
ntem
périe
s
Fig. 29 : Sondage sous la forme d’une tranchéede 22 m de long et 1,5 m de large pour 60 cm de profondeur,
avant et après une semaine de précipitations intenses
Gue
ry, 2
013
Guery, 2013
Guery, 2013
46 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
c) Secteur de Genlis
Le MNT LGV couvre une bande d’environ 1 km de large traversant d’Est en Ouest les communes de Fauvernay, Magny-sur-Tille, Izier et Cessey-sur-Tille (couvertes très partiellement), Genlis, Labergement-Foigney, Beire-le-Fort, Premières, Collonges-lès-Premières, Soirans, Athée et Villers-lès-Pots. Suite à la vectorisation des sillons des structures en arêtes et sillons on a pu définir 5 grands ensembles (voir plus bas et en Annexes) là où ces structures sont concentrées (Fig. 31, chaque ensemble est consultable en annexes). Les études archéogéographiques et archéologiques précédemment effectuées sur le secteur ne mentionnent aucunement ces structures, bien qu’elles soient en de nombreux endroits visibles à l’œil nu dans les prés. Plus embarrassant, certaines structures signalées dans la Carte Archéologique de la Côte-d’Or grâce à des campagnes de photographie aérienne ne sont tout simplement pas visibles en microtopographie. Ainsi à Premières, au lieu-dit Mousseau, G. Chouquer repère en 1990 un « camp quadrangulaire et des fossés » (site 001 de la commune) (Chouquer in Provost et coll., 2009, p. 81). Le site a pu être complètement détruit par le labour actuel, cependant on n’observe sur ce lieu-dit que des structures en arêtes et sillons et aucuns fossés délimitant un camp quadrangulaire. On notera par contre sur la commune de Genlis, à la Borde, que la voie romaine venant d’Arc-sur-Tille (site n°68) est parfaitement visible. On retrouve sa trace en orthophotographie, mais elle est complètement absente de la carte IGN actuelle ou de la minute d’Etat-major de 1838.
La vectorisation a permis de repérer 2157 sillons. Ceux-ci ont un aspect très rectiligne, peut-être plus régulier que ne le sont les sillons sur le secteur de la Côte. La particularité du secteur de Genlis est de présenter des auréoles totalement dépourvues de structures en arêtes et sillons dans les zones de forêts. Ces auréoles sont entourées de zones en arêtes et sillons, indiquant probablement d’anciennes limites de défrichements (voir plus bas la description de l’ensemble de Mondragon).
Descrption des ensembles
Ensemble de Mondragon/Villers-lès-Pots
Cet ensemble se trouve à cheval sur la lisière ouest du bois de Mondragon, au nord du village de Villers-lès-Pots. Cet ensemble est limité à l’Est, dans le bois de Mondragon par une zone vierge de toutes structures en arêtes et sillons. Cette « limite d’occupation » pourrait marquer l’expansion maximale de la zone cultivée en billons et sillons, et par extension la lisière du bois de Mondragon lors de son défrichement maximal.Les sillons vectorisés sont relativement rectilignes mais on observe ponctuellement des changements « brusques » de direction, et certains tracés sont curvilignes. On n’observe aucune différence significative (orientation, longueur, espacement...) entre les structures en arêtes et sillons sous couvert forestier et celles sous prés dans la zone proche de la lisière.
Ensemble de Mondragon
L’ensemble de Mondragon est à coup sûr le plus riche et le plus intéressant à analyser. Les structures en arêtes et sillons y sont à la fois visibles sous prés et sous forêt. On y observe comme précédemment dans l’ensemble de Mondragon/Villers-lès-Pots une limite d’expansion marquant probablement le défrichement maximal. On y observe également une ancienne motte castrale accompagnée d’un ancien étang, et plus à l’Ouest d’un étang toujours en eau. Les étangs et les fossés de la motte castrale recoupent à l’évidence les structures en arêtes et sillons, attestant de leur antériorité. Aucun élément de datation n’a été fourni pour la motte castrale, cependant on en trouve la première mention dès le XIIIème siècle (Lecornué, 2012). Les structures en arêtes et sillons sont donc, sinon du haut moyen âge, au moins antérieures au XIIIème siècle. La construction d’un tel édifice (entre le XI et le XIIIème siècle) ignorant complètement les structures en arêtes et sillons suggère un oubli total de ces structures et de l’exploitation du lieu. On peut donc supposer un fonctionnement très antérieur, au début ou au cours du haut moyen âge. Les sillons tracés sont extrêmement rectilignes et on observe des continuités possibles de part et d’autre de certains fossés actuels. Tous les sillons observés semblent d’ailleurs se diriger vers des fossés, des zones
47 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
basses, ou des cours d’eau (sur les communes de Premières et de Collonges-lès-Premières, l’Arnisson, affluent de la Tille). Les profils topographiques ont confirmé que ces sillons présentaient des pentes, parfois importantes (comme dans le cas d’Epernay-sous-Gevrey, au bois de la Vieille Morte). Cette pente semble attester la fonction de drainage de ces structures (Fig. 24). Enfin l’ensemble de Mondragon permet de distinguer des structures peu observées dans la région, et généralement associées aux structures en arêtes et sillons (les « champs bombés/ridges and furrows » d’après la littérature ; Callot, 1980, p. 9-11) : les ackerberg ou « crêtes de labour ». Ces crêtes sont associées au labour et résultent du dépôt involontaire de mottes de terre lors des demi-tours de la charrue. Elles sont fréquemment observées dans la plaine d’Alsace (Callot, 1980). Leur présence conforte l’interprétation selon laquelle les structures en arêtes et sillons sont des structures de labour. Leur présence à la perpendiculaire des sillons peut cependant être contradictoire avec la fonction de drainage, puisqu’elles empêcheraient très logiquement l’écoulement. On pourra cependant avancer qu’on n’en observe que très peu sur le secteur (détruites dans le but de faciliter le drainage ?) et que celles qu’on observe le mieux se trouve en hauteur, à la tête de deux zones en arêtes et sillons ayant des pentes opposées (près de la lisière du bois, à 230 m au Nord-Est de l’Arnisson, perpendiculairement à la voie menant de Collonges à Sommière).
Le dernier grand intérêt de cet ensemble réside dans l’observation du cadastre napoléonien. La feuille B1 de la commune de Collonges-lès-Premières présente des parcelles laniérées qui semblent parfaitement correspondre aux arêtes et sillons vues en imagerie LiDAR. Ces parcelles sont actuellement des prés. S’agit-il d’un cas de préservation exceptionnelle de ce parcellaire ancien, qui aurait alors perduré en ce point jusqu’à l’établissement du cadastre napoléonien ? Cette observation pose de nombreuses questions, puisque les parcelles voisines, de forme polygonales, contiennent elles aussi des structures en arêtes et sillons, parallèles ou perpendiculaires à celles visibles sur le cadastre. L’ensemble de ces parcelles, polygonales et laniérées est regroupée sous le toponyme « Bungey ». Il y a donc probablement eu un premier phénomène de remembrement, antérieur à la création du cadastre napoléonien. Ce remembrement a épargné ces quelques parcelles, pour une raison inconnue pour l’instant. Le déplacement de la lisière du bois est également en jeu dans l’évolution du parcellaire. La présence d’arêtes et sillons marque apparemment le défrichement maximal subi par le bois. Mais la préservation ponctuelle des parcelles dans le cadastre et la forme des parcelles suggère d’autres phases d’évolution. En effet les parcelles les plus proches de la rivière, voisines des parcelles laniérées gardent une forme très rectangulaire, et les arêtes et sillons qu’on y observe sont parallèles aux parcelles laniérées. Les parcelles les plus proches de la lisière ont des formes plus compliquées et les arêtes et sillons y sont perpendiculaires aux parcelles laniérées du cadastre napoléonien. D’autre part ces arêtes et sillons se prolongent sous la forêt actuelle. Ici la limite actuelle du bois est la même que sur le cadastre napoléonien. On sait qu’elle a pu avancer sur les champs depuis en d’autres endroits du bois (lieu-dit du Patis de la Fortelle, sur la commune de Collonges-lès-Premières, par exemple). Cette différence de forme des parcelles et des arêtes et sillons pourrait suggérer une reprise importante de la forêt entre la période de fonctionnement des arêtes et sillons d’origine et le XVIIIème siècle. Le remembrement qui précède l’établissement du cadastre napoléonien pourrait alors s’accompagner d’une seconde phase de défrichement, ignorant la présence des arêtes et sillons, et créant des formes parcellaires différentes.
Le scénario serait le suivant :
Un défrichement massif (au Haut Moyen Âge ?) permet l’installation des structures de labour en arêtes et sillons. Le bois de Mondragon est alors largement réduit en superficie. Au cours d’une forte déprise démographique et/ou économique ces terres sont abandonnées à la forêt qui les recouvre en grande partie, laissant peut-être certaines d’entre elles à l’exploitation (proche de la rivière). Alors que le terrain est abandonné et reconquis par la forêt une motte castrale est installée et un étang est créé artificiellement pour la protéger. Cette construction ignore complètement la présence des champs. On pourrait aussi envisager que l’installation de la motte castrale a lieu avant la reprise de la forêt, et que les arêtes et sillons sont encore en exploitation autour (on changerait alors volontairement la fonction de certains terrains). La motte est ensuite abandonnée et l’étang perdure jusqu’au XIXème siècle (indiqué sur le cadastre napoléonien). C’est à cette époque qu’un deuxième défrichement a lieu, faisant reculer la lisière du bois jusqu’à son emplacement
48 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
actuel. On peut envisager que les parcelles n’ayant pas connu la reprise de la forêt ont perduré, peut-être avec un système de labour identique (billonnage). Cette dernière hypothèse expliquerait la très bonne conservation des arêtes et sillons. Mais les exemples britanniques montrent que la simple présence de pâtures permet aussi une très bonne conservation de ces structures (Fig. 32).
Ensemble de Premières
L’ensemble de Premières est en continuité directe avec l’ensemble de Mondragon. Il concerne tout particulièrement plusieurs zones d’arêtes et sillons préservées cette fois exclusivement sous prés et sous champs labourés actuels. Associé à l’ensemble de Mondragon il permet d’imaginer un grand ensemble d’exploitation en arêtes et sillons, peut-être lié à la présence du village de Collonges-lès-Premières. La commune de Premières est mentionnée pour la première fois en 1042 selon Alphonse Roserot sous le nom de Aldo de Prunerüs (Roserot, 1924) et en 869 sous le nom de Prunivum d’après le rapport de diagnostic Inrap de la motte de Mondragon (Lecornué, 2012). Collonges est mentionné pour la première fois en 1245 sous le nom de Coulonges in parrochia de Prunerüs (Roserot, 1924), parrochia ou parochia qui désigne de manière générale la paroisse (attesté depuis le IVème siècle dans le vocabulaire chrétien, le terme reste très polysémique et recouvre une réalité bien plus large ; Lauwers, 2005), et le toponyme « Collonges » pourrait être dérivé de colonicus, c’est à dire la colonie (comm. pers. Jean-Pierre Garcia). Coulonges in parrochia des Prunerüs pourrait donc être lu comme étant une colonie sur le territoire de Premières. Cette hypothèse serait cohérente avec la présence d’une grande zone de défrichement et des modelés agraires de type arêtes et sillons, liés à l’usage de la charrue. Toujours d’après le rapport de diagnostic Inrap de la motte de Mondragon, le site de Collonges-lès-Premières correspondrait au tiers d’une colonie romaine, donnée à un groupe de Burgondes lors des grandes invasions de la région (Lecornué, 2012). La source de cette information n’étant pas clairement identifiée, on restera prudent à propos de ce fait. Cet élément vient quand même appuyer l’hypothèse avançant que les structures en arêtes et sillons sont liées à l’usage de la charrue dans un système de culture très lié au monde germanique. Tous les éléments de datation relative semblent nous rapprocher en effet de la période de domination des Burgondes sur la région.
Là comme dans l’ensemble de Mondragon les sillons présentent une pente (ici essentiellement descendant vers l’Arnisson qui traverse le territoire de la commune avant de se jeter dans la Tille à Champdôtre).
Ensemble de Longchamp
L’ensemble de Longchamp se caractérise par la stricte présence des structures en arêtes et sillons sous couvert forestier, qui comme dans les ensembles boisés précédents sont majoritairement rectilignes, parfois avec des ruptures d’orientation et des convergences. Seul le lieu-dit de « l’Aige Marigot » présente des structures en arêtes et sillons sous pré. Ces structures sont d’ailleurs un parfait exemple de continuité entre des structures préservées sous pré et sous forêt. Prolongeant le Bois de Longchamp, on notera le toponyme du « Bois défendu », présentant lui aussi des structures en arêtes et sillons, et donnant son nom à l’aire d’autoroute la plus proche.Les structures en arêtes et sillons ne semblent pas impactées par la dissociation toponymique qui est faite entre les deux zones boisées, argument supplémentaire pour avancer qu’elles sont très largement antérieures à la reconquête de la forêt. Lors du partage des bois entre les différents propriétaires terriens, conduisant à des toponymes différents, la disposition des anciennes parcelles agricoles de type arêtes et sillons est complètement oubliée et n’a aucun rôle sur le partage des terres. L’étude toponymique constituera l’une des prochaines étapes majeures pour la compréhension de ces structures. Que ce soit sur cet ensemble avec des toponymes comme « l’Aige Marigot » ou « le Bois défendu », ou sur les ensembles voisins avec par exemple le toponyme « Bungey » (sur l’ensemble de Mondragon), l’étude toponymique apportera de nouveaux éléments de chronologie relative, et permettra de mieux caractériser les milieux où ont été implantées les structures en arêtes et sillons.
49 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Ensemble de Chassagne (Ferme de Chassagne - Fauvernay)
L’ensemble de Chassagne est pour ainsi dire un micro-ensemble, en fait tout à fait différent des précédents. Outre deux exemples difficiles à repérer d’arêtes et sillons sous champ labourés (extrêmement arasés et espacés), les seules structures visibles se situent dans le parc de la Ferme de Chassagne, sous les jardins et sous le petit bois qu’il contient.La particularité de cet ensemble est de présenter les structures les plus rectilignes qu’il ait été donné d’observer tant sur le secteur de la LGV que sur le secteur de la Côte viticole. Il est plus que probable que ces structures soient liées à la mise en place du parc. Ils sont en effet parallèles ou perpendiculaires aux allées, et ne dépassent pas les limites du parc. Cet exemple a surtout vocation à montrer l’utilité de dissocier dans une terminologie précise les termes descriptifs et interprétatifs. Ces structures présentent en effet des caractéristiques communes avec les autres structures en arêtes et sillons. On peut donc les appeler ainsi. Cependant il ne s’agit certainement pas des structures d’open field que l’on dénomme ici « billons et sillons ». Il paraît plus approprié de les classer parmi les « champs billonnés ou peignés ». Une recherche en archives sur la Ferme de Chassagne permettrait d’en apprendre plus sur l’établissement de ce site, les conditions de mise en place du parc, et permettrait peut-être de documenter la technique du billonnage sur ce dernier.
Description des anomalies microtopographiques repérées
Bien que le but de cette étude n’ait pas été le traitement exploratoire des données LiDAR acquises sur le tracé de la LGV, certaines anomalies microtopographiques ont été repérées (Fig. 33) et il a paru important de les mentionner rapidement ici. Le recensement de ces anomalies pourra éventuellement conduire à une étude plus poussée et à l’ajout de nouveaux sites à la carte archéologique.
Reliefs de type PPH2P à Labergement-FoigneyOn observe au lieu-dit « les Prés Bas » une série de reliefs linéaires (accompagnés de fossés) formant des rectangles d’environ 200 par 100 m (Fig. 33A). Il s’agit probablement d’un ancien parcellaire, quasi imperceptible sur la vue aérienne actuelle.
Reliefs de type NP2 (reliefs négatifs polygonaux de faible contraste) à PremièresAu lieu-dit « Bungey », sous les structures en arêtes et sillons, on observe trois « creusements » de forme carrée, de très faible amplitude (Fig. 33B). Ces anomalies microtopographiques sont invisibles en vue aérienne et ne sont pas référencées dans la carte archéologique. Il pourrait s’agir de zones d’extraction ou d’un ensemble de fossés (liés à un habitat ?). L’agencement des trois « carrés », perpendiculairement les uns aux autres, est particulièrement intrigante.
Reliefs de type NIH (reliefs négatifs irréguliers hectométriques) et PLD (relief positif de largeur décamétrique)
Le relief de type PLD est la voie romaine venant d’Arc-sur-Tille (site n°68, au lieu-dit « La Borde », Genlis).Les reliefs de type NIH sont des paléochenaux situés entre la Norges et la Tille canalisées, environ 3 kilomètres au Nord-Ouest de leur confluence (Fig. 33C). La zone est particulièrement complexe et très irriguée avec l’Ouche, la Norges et la Tille courant presque parallèlement sur une bande de 2,5 km. Ces paléochenaux sont particulièrement bien visibles en vue aérienne.
Reliefs de type PLD et PPH2S, entre Genlis et FauvernayOn observe au lieu-dit « le Grand Pré » des reliefs et des fossés pouvant correspondre à un ancien parcellaire et à une voie le desservant, au mépris du parcellaire actuel. La voie, particulièrement visible en vue aérienne (Fig. 33D), forme un coude vers l’Est avant de disparaître. Elle semble recoupée par les paléochenaux mentionnés précédemment. Ces parcellaires et cette voie ont très certainement été repérés, ils sont cependant en dehors de la zone de l’étude archéogéographique développée par G. Chouquer dans la Carte Archéologique de la Côte-d’Or et ne semblent mentionnés nulle part (Chouquer, 2009).
50 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Fig. 31 : Localisation des ensembles de structures en arêtes et sillons, secteur de la LGV
Fig. 32 : Proposition de restitution chronologique pour l’Ensemble de Mondragon
51 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Lien avec le site de Bressey-sur-Tille
Lors de la construction de la ZAC du Clair Bois, à Bressey-sur-Tille sur le lieu-dit de la « Contrée du Breuil », l’Inrap a mis au jour des occupations agro-pastorales datant de l’Antiquité au Moyen-Âge (Devevey, 2011). L’intérêt de ce site pour cette étude, outre sa proximité avec le secteur traité, réside dans la singulière découverte de traces de labours datées du Haut-Empire par l’Inrap (Fig. 34). Bien que le mobilier archéologique trouvé n’ait pas permis de définir une chronologie fine du site, la présence d’une mare datée du Bas Empire et recoupant ces traces a permis d’avancer ces premiers éléments de datation (Devevey, 2011, p. 60).Elles seraient donc en définitive attribuées à une période comprise entre la fin du IIème siècle est le début du IVème siècle. Ces traces de labour n’ont pas été vues immédiatement du fait de leur aspect très ténu. Elles présentent une orientation Est-Ouest et un espacement moyen de 8 m (soit environ 26 pieds romains), sans que cette valeur ne semble caractéristique d’un type de culture antique particulière (Devevey, 2011, p. 117-122). Chaque trace de labour est constituée de plusieurs raies de labour chacune séparées d’environ 12 cm, suggérant plusieurs passage lors du labour. L’analyse des traces, le manque de régularité des raies et l’absence totale de parallélisme des raies ont poussé à conclure à l’utilisation d’une araire qui provoque des saignées dans la terre, contrairement à la charrue équipée de roues et d’un versoir qui retourne le sol.
Dans la recherche de sites à traces de labour antique trouvés à proximité, un diagnostic Inrap de 2002 faisant état de cultures maraichères est cité par l’auteur du rapport. Ce site situé a Gevrey-Chambertin, au lieu-dit « La Caillée Pennecière » présente un ensemble de fossés parallèles sur une parcelle de 35 par 26 mètres (Billoin et Dufour, 2005). Attribué à l’Antiquité tardive malgré l’absence de mobilier archéologique, ce site pourrait laisser à penser qu’il s’agit d’un exemple analogue si les dimensions des fossés (environ 50 cm de large) n’interdisait toute comparaison avec les traces de labour de Bressey-sur-Tille. D’autre part si ces structures pourraient effectivement être classées parmi les « arêtes et sillons », on les associera aux cultures en ados et non au billons et sillons ou aux champs peignés dont les dimensions sont considérablement plus importantes. Mais qu’en est-il des traces de labour de Bressey-sur-Tille ? Sont-elles rapprochables des structures en arêtes et sillons ?
Bien que ces traces suggèrent un parcellaire laniéré et que l’espacement des traces de labour rappelle énormément l’aspect des structures en arêtes et sillons étudiées à proximité, les conclusions du rapport vont à l’encontre de cette hypothèse. L’utilisation de l’araire, et plus simplement la seule présence de raies de labour irrégulières au fond de ce qui s’apparenterait aux sillons des structures en arêtes et sillons, n’est pas compatible avec le fonctionnement et le mode de formation des arêtes et sillons. En effet, si l’hypothèse de la formation des structures en arêtes et sillons par l’utilisation d’une charrue à versoir fixe s’avère juste, on n’observerait pas plusieurs raies de labour au fond des sillons, mais plutôt un rainurage régulier partant du centre des arêtes vers les sillons et correspondant à la rotation régulière de la charrue depuis le centre vers l’extérieur de la parcelle, amoncelant par son passage la terre qu’elle retourne vers l’intérieur.
53 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
B) Structures de type « grand parcellaire »
L’ensemble du secteur de la Côte viticole, outre les modelés agraires de type arêtes et sillons (« champs bombés » dans la littérature), présente de nombreuses traces parcellaires (ou du moins interprétées comme telles) dont l’étude est essentielle pour la bonne compréhension de l’organisation du territoire dijonnais au cours de l’Histoire. Ces vestiges sont intrigants tant pour leurs dimensions et leur géométrie (d’où la dénomination « grand parcellaire »), que pour leur total mépris des limites territoriales ou cadastrales connues (Ducasse et Guery, 2012, p. 81-83). Elles ignorent en effet aussi bien les limites cadastrales récentes que napoléoniennes, les territoires de communes actuelles que les limites historiques des diocèses (vestiges des territoires de cités gallo-romaines), posant ainsi la question évidente et pour l’instant sans réponse de leur datation.
a) Caractérisation sur l’ensemble du plateau et de la plaineAnalyse en terme de surface
L’analyse présentée ici porte sur des surfaces vectorisées d’après des reliefs linéaires visibles en microtopographie LiDAR. Ces reliefs linéaires ont été vectorisés lors du traitement exploratoire des données LiDAR de la Côte viticole (Ducasse et Guery, 2012). Avant de présenter les résultats il est important de faire mention des limites que présente cette étude. Tout d’abord, comme expliqué dans le mémoire précédent (Ducasse et Guery, 2012, p. 60-62), la nature exacte de ces reliefs linéaires (PPHP d’après la classification, pour relief Positif Polygonal Hectométrique définissant un Périmètre) n’est pas connue avec certitude. Il est même plus que probable que cette classe regroupe plusieurs objets de natures différentes : limites parcellaires modernes (précédant les remembrements), chemins agricoles récents, limites parcellaires et voies anciennes (médiévales ? gallo-romaines ? laténiennes ?)… Difficile de trancher. Le fait est qu’associés aux structures en arêtes et sillons, ces vestiges dessinent une trame couvrant tout le secteur de la Côte viticole. Il paraît donc important de les étudier de façon plus approfondie. Une étude plus poussée devra bien entendue être conduite dans les années à venir pour différencier les objets regroupés sous cette classe.
L’analyse faite ici est basée sur un travail qui reste interprétatif, non pas dans le tracé des reliefs linéaires qui sont une réalité, mais dans la délimitation des parcelles qui pourraient leur être associées. Certains reliefs linéaires dessinent des formes géométriques complètes (des polygones, des rectangles), d’autres n’en forment que la moitié (deux côtés, pas forcément sécants). Les reliefs linéaires isolés ont été laissés de côté pour cette analyse. Les polygones vectorisés pour calculer les surfaces correspondent à la forme dictée par la position des reliefs linéaires, se contentant de les relier entre eux, ou dans le cas de formes rectangulaire restaurant les côtés opposés disparus (par symétrie). Ce travail est évidemment lié à une certaine subjectivité et doit être discuté et revisité. Il ne fournit en aucun cas une réponse définitive mais propose des éléments d’analyse qu’il faudra perfectionner.
La surface minimale calculée est de 827 m2 et la surface maximale est de 191249 m2 (19,1 ha). La surface moyenne est de 19152 m2 (1,9 ha) et la médiane est de 13338 m2 (1,4 ha). 67% des parcelles vectorisées font moins de 2 ha, 37% font moins d’1 ha et 24% sont comprises entre 0,5 et 1 ha (Fig. 35) Ces parcellaires, s’ils en sont tous, couvrent au total une surface de 1043,8 ha, soit 10,4 km2.
Analyse en terme d’orientations
Mais si l’analyse en terme de surface reste relativement accessoire, celle en terme d’orientation des reliefs linéaires PPHP semble beaucoup plus pertinente. L’analyse est effectuée sur un jeu de 1026 vecteurs dont les coordonnées X et Y sont calculées sur ArcGis dans la table attributaire du fichier de forme polyligne où ils ont été regroupés.Cette opération de calcul des orientations est expliquée dans la partie d’analyse statistique des structures en arêtes et sillons (Deweirdt, 2009).
54 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Deux diagrammes de fréquence sont produits (Fig. 35), l’un portant sur les orientations (entre 0 et 180°), l’autre sur les « faisceaux » d’orientation, c’est à dire en considérant que les reliefs perpendiculaires appartiennent à un seul et même système d’orientation (on retire donc 90 à toutes les orientations supérieures à 90° pour que les résultats soient compris entre 0 et 90°, et on analyse la répartition des « faisceaux »).
On constate que les orientations les plus représentées sont comprises entre 10 et 30°, puis entre 100 et 120°, ce qui comme le confirme le diagramme de fréquences des faisceaux d’orientation correspond à un faisceau principal centré sur la valeur de 20° N. Cette orientation principale, déjà évoquée lors du traitement exploratoire sans avoir été clairement mesurée, correspond à l’orientation principale des structures en arêtes et sillons et des voies de communication majeures. Ce constat semble renforcer l’idée que c’est le relief de la Côte (la faille produisant se relief est orientée N10-N20) qui influence l’orientation des parcellaires et des routes, organisant le paysage local.
Ainsi, présents à la fois sur le plateau et sur la plaine, les « grands parcellaires » comme on les a dénommés, forment une trame complète et cohérente avec les structures en arêtes et sillons. Présentant des orientations similaires et des continuités, l’hypothèse selon laquelle ils appartiendraient à un seul et même système organisant le territoire sud-dijonnais semble de plus en plus solide. On pourra cependant objecter que, si c’est l’orientation de la Côte qui influence l’orientation des parcellaires, cette influence peut intervenir à différentes époques et provoquer le même résultat : l’argument d’une orientation commune impliquant un fonctionnement simultané ne tiendrait alors plus.
Reste à identifier la fonction, ou plutôt la nature, de ces parcellaires. Les reliefs linéaires tracés peuvent parfois avoir la double fonction de voie et de limite parcellaire. Parmi tout ceux tracés, certains sont probablement des voies de desserte (agricole ?) inconnus jusqu’alors et qui mériteront une étude plus poussée. Les parcellaires observés, eux, présentent parfois des continuités avec les structures en arêtes et sillons. Après analyse, il est même presque certain que quelques uns d’entre eux sont des structures en arêtes et sillons extrêmement arasés. Ils prennent alors la forme de lanières, ou délimitent un ensemble d’arêtes et sillons de très faible amplitude. D’autres définissent des polygones plus difficiles à associer aux structures en arêtes et sillons (souvent sur le plateau). Ces parcellaires peuvent ainsi être en continuité avec des structures sous forêt très bien conservées dans lesquelles le relief linéaires sont en fait des pierriers imposants (PPH2P – 2 pour relief faible, arasé – en continuité avec des PPH1P – 1 pour relief fort ; Ducasse et Guery, 2012, p. 60).
Ces parcellaires n’ont clairement pas la même fonction que les structures en arêtes et sillons. Les limites sous la forme de pierriers sont probablement issues de l’épierrement des parcelles. Mais dans quel but ?
En s’intéressant aux travaux effectués sur les plateaux du Chatillonnais, géomorphologiquement comparables, et notamment sur le secteur de Saint-Martin-du-Mont, dans le haut Val Suzon, au Nord-Ouest de Dijon, on constate que les plateaux sont utilisés notamment pour les activités pastorales. Associées à ces activités pastorales, on trouve un certain nombre de fermes isolées (bordes, dans le dialecte local ; Beck et coll., 2012). Or on trouve également sur les plateaux de la Côte des fermes isolées (La Fortelle, La Buère) et certaines constructions isolées aujourd’hui recouvertes par la forêt (secteur du Château d’Entre-Deux-Monts ; Ducasse et Guery, 2012, p. 81). Les « grands parcellaires » du plateaux sont à proximité ou autour de ces constructions isolées, autour desquels on trouve parfois encore aujourd’hui des auréoles de défrichement (Ferme de la Buère ; Ducasse et Guery, 2012, p. 84). On peut alors avancer l’hypothèse que ces constructions et ces « grands parcellaires » sur le plateau sont liés à une activité pastorale, activité qu’il reste à dater.
55 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
b) Lien avec les constructions du secteur d’Entre-deux-Monts
Le secteur du Château d’Entre-deux-Monts fait ici l’objet d’une attention toute particulière (Fig. 37). On y a effectivement identifié en 2012 une construction dont la fonction et la datation restent pour l’instant inconnues (Ducasse et Guery, 2012, p. 81). Une seconde construction est visible 500 m au Nord. Ces deux constructions, découvertes en 2012, s’enchâssent dans le « grand parcellaire » et semblent orientées de la même manière que ce dernier. La première a été numérotée JG010 et la seconde JG056 (initiales du découvreur et ordre de découverte).
JG010 semble voir l’un de ces murs recouper légèrement une des grandes limites parcellaires. Ce recoupement reste incertain sur l’imagerie, les deux axes étant quasi confondus. Cette construction est composée d’un grand ensemble rectangulaire de 25 par 50 m et d’un ensemble de 15 par 30 m subdivisé en pièces. JG056 est composé d’un seul ensemble de 15 par 30 m subdivisé en au moins 2 parties (elles-mêmes subdivisées ?) évoquant au sol le plan d’une petite chapelle (supposition proposée sur le terrain, comm. pers. Ronan Steinmann). Pour une meilleure compréhension de ces vestiges, la fouille sera nécessaire. En raison de la densité de la végétation sur place et de l’état extrêmement effondré (aspect de pierriers) des structures (lié à la gélifraction d’après les observations faites sur le terrain), seule la fouille permettra d’identifier des éléments de datations et éventuellement architecturaux préservés sous les décombres.
S’il s’avérait que ces constructions sont bien liées au grand parcellaire observé tout autour, dans une maille assez complexe, on pourrait avancer l’hypothèse d’une exploitation agro-pastorale, isolée sur le plateau. JG010 constituerait alors le corps principal de l’exploitation, au centre des parcelles, tandis que JG056 pourrait correspondre à un bâtiment secondaire (dimensions plus modestes) ou pourquoi pas à une forme de chapelle (cette interprétation n’a pour justification que la forme au sol et l’aspect assez monumental des pierriers sur place, elle implique alors une datation médiévale des structures avec une influence assez importante de la religion chrétienne pour qu’on implante une structure de culte en un lieu reculé).
La datation de ces vestiges et du parcellaire qui les entoure est absolument essentielle à la compréhension de l’organisation de la région dijonnaise. Ces structures n’étaient pas du tout soupçonnées à cet endroit. En effet, bien qu’elles soient à à peine plus de 500 m du Château d’Entre-deux-Monts, aucune mention n’en est faite dans les archives privées de ce dernier (comm. pers. Jean-Pierre Garcia). Beaucoup de questions se posent alors : Quand fonctionnent ces constructions et le parcellaire qui les entoure ? Existe-t-il un lien entre ces structures et le Château ? S’il n’y en a pas, ces structures sont elles extrêmement anciennes et très antérieures au Château, ou remettent-elles en cause la datation qui est attribuée à ce dernier (XIème siècle ; Mouillebouche, 2002) ?
56 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
C) Structures de type « petit parcellaire »
Lors du traitement exploratoire des données LiDAR un troisième type de parcellaire est apparu : ce « petit parcellaire » apparaît sous la forme d’enclos juxtaposés les uns aux autres, en général dans les versants, et à proximité des parcelles viticoles actuelles. Ce « petit parcellaire » est notamment concentré sur les communes de Gevrey-Chambertin et de Chambolle-Musigny (à la limite de la commune de Vougeot). L’étude de ce dernier parcellaire, au lieu-dit actuel de « la Taupe », a été entamée permettant de constater que ce dernier n’était mentionné sur aucuns des relevés anciens consultés (par exemple absent du cadastre napoléonien) bien qu’il ait encore été visible sur les photographies aériennes de l’IGN en 1940 (Ducasse et Guery, 2012, p. 89). Le toponyme lui-même, « La Taupe », pourrait dériver de « la toppe » désignant localement des zones désertées et sèches. La parcelle actuelle correspondant à ce lieu-dit est d’ailleurs une vaste parcelle couvrant l’essentiel du versant, colonisé par un « maquis » épais de buis et de genévrier (observation de terrain, 2012).
La proximité de ce parcellaire avec les parcelles viticoles actuelles, et de surcroît sur des communes de renom (Gevrey-Chambertin, Vougeot) a conduit à l’hypothèse que ces parcellaires pourraient être d’anciennes parcelles viticoles, abandonnées à une époque indéterminée. On trouve notamment la mention de toppes à proximité du Clos Vougeot dans les archives cisterciennes des années 1470-1474 (Moniot, 1955, p. 52) avant une période de revalorisation de ces terres abandonnées. Le parcellaire observé aujourd’hui pourrait ainsi dater de ces périodes, mais l’imprécision des localisations ne permet pas d’être affirmatif.
Ces parcellaires avait été vectorisés sous la forme de polyligne lors de la précédente étude. Ces vectorisations ont été reprises sous la forme de polygones afin de calculer les surfaces couvertes. Les calculs de fréquence ont été effectués sur les deux ensembles étudiés pour un total de 63 parcelles potentielles. La surface moyenne calculée est de 1344 m2, la médiane est de 942 m2. La valeur maximale est de 7982 m2 et la valeur minimale est de 123 m2 (Fig. 36). Sur les deux ensembles confondus, 35% des parcelles ont une surface comprise entre 250 et 750 m2. Ces dimensions paraissent assez faibles sachant que la surface moyenne d’une exploitation viticole en Côte d’Or est de 6,2 ha. Cependant il faut noter que 27% de ces exploitations mesurent moins d’1 ha et qu’elles sont caractérisées par un très grand morcellement (Bourdon, Pichery et Vincent, 2011, p. 67-78). L’hypothèse de parcelles viticole n’est donc pas forcément contrariée par la petitesse des surfaces couvertes, d’autant que les statistiques ici fournies concernent les parcelles viticoles actuelles, et que le parcellaire ici étudié n’est pour l’instant pas daté.
a) Ensemble de Chambolle-Musigny (Vougeot)
Ce premier ensemble, premier découvert (Ducasse et Guery, 2012, p. 89-90), se situe donc en bordure d’une large parcelle limitrophe de la commune de Vougeot (Fig. 38). Les enclos observés se présentent sur le terrain sous la forme de terrassements limités par des pierriers. Chaque enclos mesure 20 à 50 m de côté. Ils sont répartis sur deux rangées séparées par un ressaut topographique (probablement lié au substrat rocheux, ici le calcaire de Comblanchien). Au milieu des pierriers, et notamment au niveau du ressaut topographique on observe des structures circulaires construites (sans maçonneries), en élévation sur 50 cm. Dans l’hypothèse de parcelles viticoles, il pourrait s’agir d’abris aménagés au milieu des parcelles (il ne s’agit que d’une hypothèse).
15 parcelles ont été vectorisées au total. La parcelle la plus grande vectorisée mesure 4297 m2, la plus petite mesure 638 m2. La surface moyenne est de 1777 m2 et la médiane est de 638 m2. 7 (46%) des parcelles de cet ensemble ont une surface comprise entre 500 et 1250 m2, dont 3 (20%) ont une surface comprise entre 1000 et 1250 m2. 2 (13%) des parcelles de cet ensemble sont nettement plus grandes que les autres, comprises entre 3000 et 3250 m2.
57 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
b) Ensembles de Gevrey-Chambertin
La commune de Gevrey-Chambertin compte trois ensembles, le premier à l’entrée de la combe Lavaux, sur le versant sud, le second autour du « Clos de Bèze » et le troisième au lieu dit « Chambertin » plus au sud.Comme l’ensemble de Chambolle ils se trouvent en bas de versant, juste à côté des parcelles viticoles actuelles. Ces trois ensembles sont recouverts par une forêt de conifères et de feuillus, apparemment déjà en cours de développement en 1940 (vues aériennes IGN). Ces trois ensembles sont éloignés d’environ 400 m les uns des autres et il est tout à fait probable qu’ils aient été contigus. Les deux zones qui séparent pour l’un l’ensemble de la combe Lavaux (le plus au Nord) de l’ensemble du clos de Bèze, pour l’autre l’ensemble du clos de Bèze de l’ensemble de Chambertin (le plus au Sud) sont particulièrement perturbés par un réseau de « chemins » plus ou moins parallèles et de toute évidence liés à l’exploitation de la forêt de conifères. Si le « petit parcellaire » y a été présent, la microtopographie ne le laisse plus percevoir (Fig. 38). Ces trois ensembles, ou sous-ensembles, ont ainsi été analysés comme un seul ensemble.
48 parcelles potentielles ont ainsi été vectorisées. La plus grande mesure 7982 m2 et la plus petite 123 m2. La surface moyenne est de 1208 m2 et la médiane est de 710 m2. 20 (42%) de ces parcelles mesurent entre 250 et 750 m2.
Elles semblent donc statistiquement plus petites que les parcelles de l’ensemble de Chambolle-Musigny. On ne s’avancera cependant pas sur la comparaison des deux ensembles, l’ensemble de Chambolle-Musigny étant trois fois plus petit que celui de Gevrey-Chambertin. Dans le détail, on s’aperçoit en effet que si l’ensemble de la combe Lavaux semble effectivement constitué de petites parcelles (10 d’entres elles, soit 45%, mesurent entre 250 et 500 m2), l’ensemble du Clos de Bèze se rapproche de l’ensemble de Chambolle-Musigny (8 des parcelles, soit 72%, mesurent entre 500 et 1250 m2). L’ensemble de Chambertin est clairement plus hétéroclite, avec notamment la plus grande parcelle de l’ensemble (7982 m2). La valeur de la surface de cette parcelle peut-être considérée comme une valeur aberrante. Il s’agit en fait d’une zone délimitée par un relief linéaire bien net, et s’il a existé des subdivisions dans cette parcelle, elles n’ont pas pu être repérées en microtopographie LiDAR. On ajoutera à ces observations que les ensembles de la combe Lavaux et de Chambertin, en plus de différer en terme de surface de l’ensemble de Chambolle-Musigny, présentent aussi des formes plus allongées et plus tortueuses.
c) Conclusions
Ces « petits parcellaires » semblent recéler une histoire assez complexe, traduite par forme tortueuse de leurs parcelles. Elles témoignent également d’une mise en culture avancée des versants, sur des terrains hostiles que la très forte croissance du domaine viticole actuel n’a pas encore poussé à conquérir. La question reste évidemment celle de la datation. Les éléments de toponymie vus précédemment pour le parcellaire de la Taupe semblent indiquer que ces terres sont inexploitées au XVème siècle. Le parcellaire visible est-il alors antérieur ou postérieur à ce toponyme ? S’il est antérieur, la chronologie de ce « petit parcellaire » pourrait se rapprocher de celle des modelés agraires de type arêtes et sillons et de celle des grands parcellaires évoqués précédemment. Ils complèteraient alors un schéma d’organisation du territoire sud-dijonnais bien différent de celui jusque là imaginé.
58 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
en m2
en degrés en degrés
en m2
Fig. 35 : Résultats statistiques de l’analyse des « grands parcellaires »
Fig.
36
: Rés
ulta
ts st
atist
ique
s de
l’ana
lyse
des
« pe
tits p
arce
llaire
s »
A : Diagramme de fréquence des surfaces des grands parcellaires
A :
Dia
gra
mm
e d
e fr
équ
ence
des
su
rfac
es d
es «
pet
its
par
cella
ires
»,
to
us
ense
mb
les
con
fon
du
s
B :
Dia
gra
mm
e d
e fr
équ
ence
des
su
rfac
es d
es «
pet
its
par
cella
ires
»,
ense
mb
le d
e C
ham
bo
lle-M
usi
gn
y (V
ou
geo
t)
C :
Dia
gra
mm
e d
e fr
équ
ence
des
su
rfac
es d
es «
pet
its
par
cella
ires
»,
ense
mb
les
de
Gev
rey-
Ch
amb
erti
n
D :
Dia
gra
mm
e d
e fr
équ
ence
des
su
rfac
es d
es «
pet
its
par
cella
ires
»,
ense
mb
le d
e la
co
mb
e La
vau
x (G
evre
y-C
ham
ber
tin
)
E : D
iag
ram
me
de
fréq
uen
ce d
es s
urf
aces
des
« p
etit
s p
arce
llair
es »
,en
sem
ble
du
Clo
s d
e B
èze
(Gev
rey-
Ch
amb
erti
n)
F : D
iag
ram
me
de
fréq
uen
ce d
es s
urf
aces
des
« p
etit
s p
arce
llair
es »
,en
sem
ble
de
Ch
amb
erti
n (G
evre
y-C
ham
ber
tin
)
B : Diagramme de fréquence des surfaces des grands parcellaires inférieurs à 8 ha
C : Diagramme de fréquence des orientations des PPHP D : Diagramme de fréquence des faisceaux d’orientation des PPHP
en m
2
en m
2
en m
2
en m
2
en m
2
en m
2
60 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
III) DiscussionA) Chronologie des parcellaires
Au cours de l’étude des modelés agraires de type arête et sillons et des traces parcellaires de petites et de très grandes dimensions, il a été évoqué à plusieurs reprises l’hypothèse que ces vestiges soient contemporains les uns des autres. La trame parcellaire alors dessinée est impressionnante par sa densité et sa complexité. Elle recouvre en effet la quasi totalité des deux secteurs étudiés (autour de Genlis, et sur et autour de la Côte viticole dijonnaise) au mépris le plus total des limites territoriales et parcellaires connues.
L’élément majeur de cette chronologie relative reste évidemment le couvert forestier, extrêmement présent dans la région, à la fois sur les plateaux et dans la plaine avec la célèbre forêt de Cîteaux. Il est donc acquis que cette forêt, longtemps considérée comme particulièrement ancienne, est en fait le produit d’une reconquête du milieu forestier sur des terres cultivées. L’enjeu essentiel devient alors la datation de cette reconquête et la compréhension des évènements qui la précèdent. La trame parcellaire que la forêt recouvre s’étend ainsi, au-delà des zones de forêt, sur une surface considérable et laisse entrevoir un paysage complètement ouvert et cultivé.
D’après les éléments de chronologie relative avancés jusqu’ici, cette trame parcellaire remonterait à une période située entre la fin de l’époque gallo-romaine et l’an mil. Elle s’appuie en effet sur des éléments stables de la géographie locales, telle que l’ancienne voie romaine joignant Dijon à Nuits-Saint-Georges, et précède l’arrivée des Cisterciens.
Les indices permettant d’avancer que ces vestiges agraires sont contemporains sont multiples. On note déjà un grand nombre de continuités entre les structures de type arêtes et sillons et grand parcellaire. Seules les petits parcellaires se trouvent isolés et peuvent appartenir à une phase différente. Ces continuités planimétriques sont l’argument le plus fort pour la contemporanéité des vestiges. On pourra cependant arguer que le caractère très descriptif de la classification établie pour reconnaitre ces structures peut introduire un biais conséquent, en associant entre elles par leur forme des structures de nature et d’âge différents. Certaines continuités entre le grand parcellaires et les structures en arêtes et sillons perdraient alors de leur sens et la théorie d’une grande trame parcellaire s’en retrouverait affaiblie.
Vient ensuite l’argument de la couverture unique par le couvert forestier, mais les phases de déprise et de reprise que connaît la forêt ne garantit aucunement que ces vestiges soient contemporains et profitent de la même phase de pression anthropique pour s’installer. Ce n’est que combiné à l’argument des continuités que ce paramètre fait foi. Associé à cette notion de couvert forestier, on remarque que les zones de défrichements récents (auréoles de défrichement sur le plateau, recul de la lisière sur certains bois de la plaine comme le bois de Mondragon) semblent toujours postérieures aux vestiges étudiés. En résumé, ces vestiges agraires correspondraient à une grande phase de défrichement, à une période encore incertaine (au Haut Moyen Âge ?). Ils seraient ensuite majoritairement recouverts et ainsi préservés par de grandes forêts, dont la forêt de Cîteaux ; forêts qui connaîtront d’autres phases de défrichements, n’atteignant jamais l’intensité de la première.
Le dernier argument vient de la présence de voies, a priori contemporaines de l’établissement des villages, et recoupant souvent les vestiges étudiés ici, comme à Epernay-sous-Gevrey avec l’actuelle D25, ou aux abords du Château d’Entre-deux-Monts (Ducasse et Guery, 2012, p. 81-83). La datation de ces voies reste cependant imprécise.Cet argument pose aussi la question du lien entre ces vestiges parcellaires et agraires et le développement des finages observés actuellement, intimement connectés au réseau viaire.
61 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
B) Les archéo-terroirs : compréhension des espaces sur le temps long
Comment concilier en effet la trame suggérée par ces vestiges et les finages, notamment du sud-dijonnais ? D’une part les parcellaires découverts ne respectent pas les limites des finages, ou très peu ; d’autre part, souvent associés aux bois, ces vestiges et notamment les structures en arêtes et sillons sont souvent concentrés aux marges des finages actuels. Le report des zones forestières aux extrémités des finages correspond de manière générale à des phases de défrichements concentriques depuis le village vers les limites du territoire de la commune (Maigrot, 2009).Le lien entre le parcellaire découvert et les finages actuels n’est pas clairement établi. L’analyse sur les orientations des structures (sillons, grands parcellaires) n’indique en tout cas pas de lien direct : les orientations ne semblent pas varier de finage en finage.
Si cette trame parcellaire définit un autre schéma que celui des finages actuellement observables, comment s’intègre-t-elle dans l’histoire de la construction de l’espace dijonnais ; et quel paysage dessinaient alors ces archéo-terroirs ? De nombreuses questions s’ouvrent alors, notamment à propos d’une éventuelle « filiation » entre ces archéo-terroirs, et les terroirs que notre société valorise à l’heure actuelle, mais aussi à propos de la cohabitation dans un même espace de parcellaires aussi différents que les grands vignobles privés et les systèmes en open fields.
Avec cette notion d’archéo-terroirs, c’est une autre géographie de la région dijonnaise qui se profile : la contemporanéité des grands parcellaires et des structures en arêtes et sillons couplée à l’ancienneté de la viticulture dans la région laisse supposer un modèle de polyculture réparti dans l’espace. On trouverait alors dans la plaine de la Saône des cultures de type céréalières, en open field, basées sur le partage de la terre au sein des communautés paysannes (Bloch, 1931, p. 82), sur les versants de la Côte et à son pied une viticulture ancienne et à l’importance croissante au fil des siècles (Garcia et Labbé, 2011), et sur les plateaux des activités d’élevage (Beck et coll., 2012).
Cette stratification de l’espace rural serait alors en quelque sorte calquée par le contexte géoenvironnemental de la région dijonnaise, au bord du fossé d’effondrement bressan, mettant en vis à vis les terrains humides de la plaine de la Saône et les terrains secs des plateaux jurassiques. On retrouverait en effet pour chaque terrain une culture adaptée permettant l’exploitation optimale des ressources de la région dijonnaise. La richesse des techniques employées, la combinaison de modes de partage de la terre culturellement différents sur un espace relativement restreint, seraient elles directement liées au statut de carrefour commercial et culturel qu’a obtenu la région au fil de l’Histoire. Pour ces archéo-terroirs, a priori datés de la fin de l’époque gallo-romaine et du Haut-Moyen Âge, on pensera notamment à la cohabitation de populations germaniques (Burgondes, Frisons...) avec les peuples éduens ou lingons, eux-même sous influence méditerranéenne depuis plusieurs siècles. Quel est l’impact de ces populations germaniques arrivantes sur leurs nouveaux voisins ? Peut-on voir dans l’évolution des techniques agraires une forme de mimétisme des foules (Le Bon, 1895, p. 9-16), faisant des traces agraires un marqueur des évolutions sociétales ? Le monde rural recèle a coup sûr les clés de lecture de cette grande période de transition entre le monde romain et le monde médiéval. Sur cette base, l’espace dijonnais apparaît comme un espace cosmopolite ou chaque ressource est intensément exploitée.
C) L’espace dijonnais : un espace en mouvement
Cette idée d’un espace exploité et cultivé de façon intense et complète fait écho aux problématiques écologistes actuelles : les sociétés humaines modifient, réorganisent et exploitent leurs environnements. Les détruisent-elles de façon irrémédiable pour autant ? L’Homme est un facteur géoenvironnemental comme les autres, à la différence qu’il prend conscience de son action.
Les surfaces défrichées pour l’installation de cette grande trame parcellaire, si on pouvait les calculer, seraient sans doute vertigineuses. Pourtant la forêt de Cîteaux est dans les esprits presque ancestrale, présente de tout temps et naturelle.
62 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Alors quel est l’impact environnemental réel ? Quelle est la nature des sols analysés en forêt ? S’il s’agit de sols issus de l’agriculture et non purement forestiers, quel impact cela a-t-il sur nos connaissances en pédologie ? Comment et dans quelle mesure la reconquête des milieux forestiers se fait-elle ? Comment ces « espaces naturels » se reconstruisent-ils ? Il y a une véritable réflexion à porter sur ces questions dans un contexte de prise de conscience écologiste. La découverte de ces structures met en avant une grande méconnaissance de l’histoire du territoire dijonnais, puisque c’est un pan entier de son évolution qui nous est révélé par la microtopographie LiDAR. Cet espace, souvent décrit comme hostile (« un repère de bêtes sauvages » dans le panégyrique latin de 312, ou « une petite montagne bien laide et bien sèche » dans les Mémoires d’un touriste (Stendhal, 1838)) a été presque intégralement mis en culture et a retrouvé à plusieurs reprise un état jugé « naturel ».
Une fois cette réalité admise, il reste à comprendre le modèle qui régissait cette trame parcellaire. L’archéogéographie recherche souvent la centuriation, modèle gallo-romain, structurant et géométrique (Chouquer, 2009). Or ces centuriations sont pour l’instant absentes du secteur dijonnais. Le problème principal de la recherche des cadastrations gallo-romaines est qu’elle se base sur la cartographie moderne et se trouve soumise à un biais interprétatif extrêmement fort. Ainsi la recherche d’une maille régulière basée sur des mesures gallo-romaines (Arty, 2010), a fourni un résultat peu convaincant sur le secteur de la Côte viticole. Il est particulièrement difficile d’affirmer que les tracés des chemins et parcellaires actuels sont directement hérités de cadastrations gallo-romaines : bien sûr cette hypothèse ponctuellement n’est pas improbable, mais les éléments nous manquent pour la généraliser et la prouver (Callot, 1980, p.223-230) A l’inverse les reliefs linéaires et polygonaux repérés en microtopographie, et particulièrement ceux sous forêts, sont indépendants de toute activité récente d’aménagement du territoire. Ils appartiennent sans ambigüité à une phase de fonctionnement différente et témoigne donc sans biais d’un état ancien de la région. En plus de cette réalité microtopographique, il y a l’accès aux zones sous couvert forestier qui sont majoritairement exclues de la plupart des études archéogéographiques conduites. La recherche des centuriations notamment, des cadastrations romaines en général, et tous les travaux de photo-interprétation, touchent à des milieux ouverts, oblitérant donc l’occupation qu’ont connue les milieux forestiers actuels.
Finalement si cette trame parcellaire ne correspond pas au modèle gallo-romain connu, s’agit-il d’un particularisme régional, ou cette trame vient-elle s’y superposer et s’y substituer progressivement sous l’influence d’une nouvelle autorité ? En effet face aux dimensions particulièrement impressionnantes des parcellaires du plateau (notamment aux abords du Château d’Entre-Deux-Monts), la question du monumentalisme des structures et de l’autorité nécessaire à leur mise en place s’était posée (Ducasse et Guery, 2012, p. 82). La chronologie relative établie et le caractère communautaire, très germanique, des structures en arêtes et sillons orienterait alors plutôt la recherche de cette autorité chez les populations burgondes qui s’installent sur la région. On a finalement assez peu d’éléments sur la structuration de l’espace rural sous la domination burgonde. La définition des limites réelles de leur second royaume (la Sapaudia, voir Contexte historique) reste elle-même sujette au débat.
Attribuer cette trame parcellaire à la période de domination burgonde permettrait entre autre d’expliquer la rupture qui semble exister avec le modèle gallo-romain (la trame parcellaire, par exemple, ne semble pas respecter les limites des territoires lingons et éduens), tout comme celle qui existe apparemment avec les finages médiévaux. La période de domination burgonde, et la trame parcellaire à son image, semble en effet quelque peu déconnectée, créant comme un parenthèse dans l’histoire de l’occupation du dijonnais. Elle rompt avec la culture gallo-romaine et sera progressivement dissoute dans la culture franque après la victoire de Clotaire et Childebert sur Godomar en 534. Il est évidemment peu probable que la parenthèse ait eu des limites si nettes, et l’établissement de cette trame a sûrement été progressif avec l’arrivée de populations germaniques dès la fin du IIIème siècle (comme nous l’indique les panégyriques latins). De même, il faut envisager que la transition vers les finages médiévaux n’ait pas été brutale.
63 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Conclusions
Cette étude se conclut donc sur un double constat. Le premier est que la microtopographie permet d’aborder la géo-histoire avec un nouvel angle et fournit un outil indéniablement efficace. Ancré sur une réalité 3D (par opposition aux relevés purement planimétriques), cette étude fournit de nouveaux éléments de compréhension des espaces sur le temps long, non pas en remplacement des anciennes clés de lecture, mais en complément. Comme on s’est attaché à le mentionner tout au long de ce mémoire, le relevé microtopographique n’est qu’un relevé. Sa nature exclusivement descriptive, et quasi exhaustive, est alors à la fois sa force et sa faiblesse. Les objets qu’on y identifie sont des réalités physiques, mais l’exhaustivité du relevé et la vision synoptique qu’il fournit peut parfois en brouiller la lecture.
Si la technologie nous apprend une chose, c’est à mettre une limite nette entre la description et l’interprétation d’une structure. Il faut en effet faire une distinction claire entre ce qui est observable objectivement et ce que l’on peut en déduire. De très nombreuses structures laissent des traces et des vestiges d’apparences semblables et les méthodes d’imagerie (photographie aérienne, infrarouge, modèles numériques…) ne fournissent pas les éléments suffisants à leur compréhension complète, ou à leur datation. L’utilisation de la microtopographie ouvre un nouveau champ à l’archéogéographie, différent de ceux explorés par G. Chouquer ou J-L Maigrot (Chouquer, 2008 ; Chouquer, 2010 ; Maigrot, 2009). Les objets d’études sont en effet des vestiges préservés de l’activité humaine depuis plusieurs siècles. Ils permettent de lire la trame parcellaire telle qu’elle était, sans le filtre des cadastres et remembrements parcellaires modernes. L’utilisation de relevés tels que les relevés microtopographiques nécessite finalement une approche multidiciplinaire, parfaitement en accord avec les prescriptions de la géoarchéologie. Dépassant les clivages classiques entre sciences dures et sciences humaines (Toubert, 1998), la lecture d’un relevé microtopographique amène à associer dans une même réflexion des explications naturalistes et des explications plus anthropocentriques.Ainsi nous avons abouti à une hypothèse combinant l’influence prépondérante du géoenvironnement de la Côte dijonnaise et la position de carrefour commercial et culturel de la région pour expliquer le développement d’une trame parcellaire complexe (Fig. 39).
Ceci nous amène au deuxième constat concluant cette étude. Car si les relevés microtopographiques étudiés ici se « limitent » à quelques 110 km2 au Sud et à l’Est de Dijon, les conclusions auxquelles ils nous amènent renvoient à l’évolution de toute la région dijonnaise. Il serait ainsi extrêmement intéressant de connecter l’étude conduite sur les plateaux du Châtillonnais (Beck et coll., 2012) et le futur relevé LiDAR qui sera acquis sur le bassin versant du Val Suzon à l’étude conclue ici. Le lien entre les plateaux calcaires du Val Suzon, du Châtillonais et de la Côte a déjà été évoqué (voir étude sur le grands parcellaire), mais on peut pousser la comparaison entre les deux espaces plus loin. La basse vallée du Val Suzon (au-delà de Messigny-et-Vantoux) a connu une viticulture équivalente à celle de la Côte entre le XVIème et le XVIIème siècle, comme l’indique l’indice des prix du vin par commune. Ainsi en 1558 les vins sont vendus à des prix équivalents à Gevrey-Chambertin et à Messigny-et-Vantoux (Garcia et Labbé, 2011, p. 160-163). S’ajoute à ces faits l’observation sur le terrain de reliefs linéaires semblables aux grands parcellaires et aux structures en arêtes et sillons dans la plaine d’inondation du Suzon et éventuellement sur les plateaux vers Etaules (observations ponctuelles de terrain, 2013). S’il s’avérait que l’on retrouve les mêmes structures parcellaires et modelés agraires dans le secteur du Val Suzon, au Nord-Est de Dijon, secteur clé dans l’évolution de la ville, on pourrait alors établir un parallèle entre la Côte viticole et le bassin versant du Val Suzon. Aujourd’hui entièrement recouvert de forêt, ce dernier pourrait être le pendant de la Côte dijonnaise, abandonné à la forêt tandis que la Côte profitait d’un développement économique fulgurant. Comme pour la forêt de Cîteaux, il faudrait alors s’interroger sur la manière dont la forêt du Val Suzon a reconquis l’espace, jusqu’à apparaitre comme éminemment naturelle. L’étude du secteur du Val Suzon offrirait alors l’opportunité de comprendre l’évolution différenciée de deux espaces essentiels au développement du dijonnais. Au-delà, c’est un véritable questionnement sur la gestion des espaces sur le temps long et sur la relation Homme-environnement qui se profile. En arrière-plan, il faut probablement comprendre cette relation comme une cohabitation et non comme un combat. L’Homme n’est pas forcément destructeur de son environnement, il ne se bat pas contre « la nature », mais il y évolue dans un schéma d’influences mutuelles.
65 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Références bibliographiques
Ouvrages et articles
Anderson M. et Went D. (2002) – Turning the Plough, Loss of a landscape legacy, Conservation Bulletin 42, www.english-heritage.org.uk
Arty J.-P. (2010) – Analyse parcellaire de la Côte viticole de Côte-d’Or, exemple de la commune de Beaune et de Gevrey-Chambertin. Mémoire de Master 2 sous la direction de Favory F. et Petit C.
Barral P. (2009) – Le second Âge du fer en Côte D’or (Vème-Ier siecle av. J.-C.), In Provost et coll. (2009) La Côte d’Or : 21/1 Alésia (d’Argencourt à Alise-Sainte-Reine) – Carte Archéologique de la Gaule : pré-inventaire archéologique, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 559 p., p. 183-264
Beck C. (2008) – Les eaux et forêts en Bourgogne ducale (vers 1350 – vers 1480). Sociétés et biodiversité, Éditions L’Harmattan, Paris, 479 p
Beck P. et coll. (2012) – La mémoire du sol. Habitats et pratiques agraires autour de l’Abbaye de Saint Seine, du Moyen Âge à nos jours. Les bordes du Bois de Cestres, Saint-Martin-du-Mont (Côte-d’Or), rapport annuel d’activité 2012
Berthier K. (2006) – La gestion des étangs de l’abbaye de Cîteaux aux XIVème et XVème siècles, Cîteaux, vol. 57, p. 281-293
Beyaert M. (2006) – La Belgique en cartes : L’évolution du paysage à travers trois siècles de cartographie – Bazel-Kruibeke, le pays de Waes : Un paysage de champs bombés peu à peu urbanisé, Lannoo Uitgeverij, 248 p., p. 45-46
Billoin D. et Dufour J.-Y. (2005) – La reconnaissance archéologique des cultures maraîchères anciennes : l’exemple des aspergeries, Archéopages, n°15, p. 12-15
Blaising J.-M. (2010) – La charrue, outil de modelage du paysage durant le dernier millénaire, 4ème Cahier du Conseil national des parcs et jardins - Le jardinier et ses outils, p. 9-10
Bloch M. (1931) – Les caractères originaux de l’Histoire rurale française, Armand Colin (édition 1988), 316 p.
Boulmier A. (1951) – L’outillage des champs dans le département de la Saône-et-Loire, Revue de géographie de Lyon, Vol. 26 n°1, p. 1-32
Bourdon F., Pichery M. C. et Vincent E. (2011) – Les climats de bourgogne aujourd’hui, In Garcia J.-P. (dir.) (2011) – Les climats du vignoble de Bourgogne comme patrimoine mondial de l’humanité. Editions Universitaires de Dijon, 357 p., 65-93
Brenot J., Quiquerez A., Petit C., Garcia J.-P., (2008) – Erosion rates and sediment budgets in vineyards at 1meter-scale resolution using stock unearthing, Geomorphology, vol. 100, (3-4), pp. 345-355.
Callot H.-J. (1980) – La Plaine d’Alsace, modelé agraire et parcellaire, Publications Université Nancy II, 338 p.
Chevrier S. et Garcia J.-P. et coll. (2010) – Le vignoble gallo-romain de Gevrey-Chambertin, Côte-d’Or (Ier-IIème s. ap. J.-C.) : modes de plantation et de conduite de vignes antiques en Bourgogne. Revue Archéologique de l’Est, t. 59, p. 505-537
66 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Chouquer G. (2008) – Traité d’archéogéographie. La crise des récits géohistoriques. Editions Errances, 200 p.
Chouquer G. (2009) – Archéogéographie des trames planimétriques en Côte-d’Or, In Provost et coll. (2009) La Côte d’Or : 21/1 Alésia (d’Argencourt à Alise-Sainte-Reine) – Carte Archéologique de la Gaule : pré-inventaire archéologique, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 559 p., p. 183-264
Chouquer G. in Provost M. et coll. (2009) – La Côte-d’Or : 21/3 : de Nuits-Saint-Gorges à Voulaines-les-Templiers – Carte Archéologique de la Gaule : pré-inventaire archéologique, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 463 p., p. 81
Chouquer G. (2010) – La Terre dans le monde romain ; anthropologie, droit, géographie. Editions Errances, 355 p.
Chouquer G. (2011) – Les systèmes parcellaires sociaux en situation d’hybridation physique : 3- les réseaux des milieux humides
Constans L-A. d’après César (1926) – Guerre des Gaules, Gallimard (édition 1981), 480 p.
Deléage A. (1942) – La vie rurale en Bourgogne jusqu’au début du onzième siècle, Mâcon : Protat Frères, 698 p.
Demidowicz G. (2005) – Ridge and Furrow Survey (King’s Norton), Birmingham and Warwickshire Archaeology Society, www.riverreatrail.org.uk
Devevey F. (dir.) (2011) – Occupation agro-pastorale de l’Antiquité au Moyen Âge – Rapport final d’opération Inrap (Bressey-sur-Tille, Côte d’Or, la Contrée du Breuil)
Deweirdt E. (2009) – De l’analyse spatiale à la caractérisation de sites de la fin de l’âge du fer et du début de l’époque gallo-romaine dans le nord et l’est de la Gaule, Thèse sous la direction de Jean Bourgeois et Patrice Méniel, 2009-2010, 410 p.
Ducasse E. et Guery J. (2012) – Prospection archéologique aérienne LiDAR sur et autour de la Côte viticole de Dijon. Mémoire de Master 1 sous la direction de Garcia J.-P., Université de Bourgogne
Escher K. (2006) – Les Burgondes : Ier-VIème siècles apr. J.-C., Editions Errance, 283 p.
Galletier E. (1949) – Panégyriques latins – Tome 1 (I-V), Société d’édition « Les Belles Lettres », 140 p.
Garaycochea I., Morlon P., Ramos C. (1992) – L’archéologie appliquée au développement agricole : la reconstitution des ados précolombiens sur l’Altiplano, In Morlon P. (dir.) (1992) - Comprendre l’agriculture paysanne dans les Andes Centrales (Pérou - Bolivie), 522 p., p. 243-255
Garcia J.-P. (2009) – Géomorphologie du site de Bergis, In Chevrier et coll. (2009) - Gevrey-Chambertin « Au-dessus de Bergis », une occupation diachronique au pied de la Côte de Nuits, Rapport final d’opération, Inrap, Dijon, p. 30
Garcia J.-P. (2010) – Données nouvelles pour l’histoire de la construction des terroirs viticoles de Bourgogne, cinquante ans après l’œuvre de Roger Dion, in : Pitte J.-R. éd., Actes du colloque Roger Dion - Cinquantenaire de l’Histoire de la vigne et du vin - Le bon vin entre terroir, savoir-faire et savoir-boire, Paris, 29-31 janv. 2009, p. 287-303.
Garcia J.-P. (2011) – La construction géo-historique des climats de Bourgogne, In Garcia J.-P. (dir.) (2011) – Les climats du vignoble de Bourgogne comme patrimoine mondial de l’humanité. Editions Universitaires de Dijon, 357 p., p. 97-105
67 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Garcia J.-P. et Labbé T. (2011) – Vers la géographie des climats actuels : processus de différenciation des crus viticoles dans le baillage de Dijon du XVIème au XVIIIème siècle, In Garcia J.-P. (dir.) (2011) – Les climats du vignoble de Bourgogne comme patrimoine mondial de l’humanité. Editions Universitaires de Dijon, 357 p., p. 159-176
Guichard R. (1965) – Essai sur l’Histoire du peuple burgonde, de Bornholm (Burgundarholm) vers la Bourgogne et les Bourguignons, Editions A. et J. Picard et Cie, 395 p.
Hall D. (1998) – Medieval fields in their many forms, British Archaeology, issue N°33
Hostein A. (2012) – La cité et l’empereur. Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins, Paris : Publications de la Sorbonne, 543 p.
Laine A., Gauthier E., Garcia J.-P., Petit C., Cruz F., Richard H. (2010) – A three-thousand-year history of vegetation and human impact in Burgundy (France) reconstructed from pollen and non-pollen palynomophs analysis, Comptes-Rendus Biologie, vol.333, p. 850-857
Lauwers M. (2005) – Paroisse, paroissiens et territoire. Remarques sur parochia dans les textes latins du Moyen Âge, Médiévales, n° 49, p. 11-32.
Le Bon G. (1895) – Psychologie des foules, Quadrige, Nouvelle Edition, 1963, 133 p.
Lecornué J. (dir) (2012) – La motte castrale du bois de Mondragon. Rapport intermédiaire de diagnostic Inrap (LGV Rhin-Rhône, branche Est, 2ème phase)
Legros J.-P. (2007) – Les grands sols du monde, PPUR Presses Polytechniques, 574 p, p. 85-86
Maigrot J.-L. (2009) – Archéogéographie du finage de la commune de Saint-Martin-du-Mont (Côte-d’Or). Laboratoire Artehis, 100 p.
Marilier J. et Richard J. (1984) – La Bourgogne du Haut Moyen Âge, In Richard J. (dir.) (1984) – Histoire de la Bourgogne, Nouvelle édition, Privat, 491 p., p. 89-130
Martin R. (1984) – La Bourgogne gallo-romaine, In Richard J. (dir.) (1984) Histoire de la Bourgogne, Nouvelle édition, Privat, 491 p., p. 45-80
McOmish D. (2011) – Introductions to Heritage Assets, Field Systems, English Heritage, May 2011
Moniot H. (1955) – Recherches sur Gilly-lès-Vougeot et sa seigneurie cistercienne au Moyen-Âge. Mémoire pour diplôme d’études supérieures. Université de Dijon, 77 p.
Mordant C. (2009) – L’Âge du Bronze en Côte d’Or, In Provost et coll. (2009) La Côte d’Or : 21/1 Alésia (d’Argencourt à Alise-Sainte-Reine) – Carte Archéologique de la Gaule : pré-inventaire archéologique, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 559 p, p. 134-142
Mouillebouche H. (2002) – Les maisons fortes en Bourgogne du nord, du XIIIème au XVIème siècle, Editions Universitaires de Dijon, 486 p., 2 CD-Rom.
Nuninger L., Oštir K., Kokalj Z., Marsetic A. (2008) – Lidor. Acquisition, traitement et analyse d’images LiDAR pour la modélisation des paléo-reliefs de la plaine littorale du Languedoc orient, Rapport d’ATIP jeunes chercheurs.
68 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Nuninger L., Fruchart C., Opitz R. (2010) – LiDAR : quel apport pour l’analyse des paysages ?, AGER, n°20, p. 34-43
Pigott et Thirsk (1981) – Agrarian history of England and Whales – Vol.1: Prehistory, p. 270-274
Rey A. (2010) – Dictionnaire historique de la langue française : contenant les mots français en usage et quelques autres délaissés, avec leur origine proche et lointaine..., Le Robert
Richard J. (dir.) (1984) – Histoire de la Bourgogne, Nouvelle édition, Privat, 491 p.
Roserot A. (1924) – Dictionnaire topographique du département de la Côte-d’Or, Imprimerie Nationale, Paris.
Rostain S. (1995) – La mise en culture des marécages littoraux de Guyane à la période précolombienne récente. In A. Marliac (dir), Milieux, sociétés et archéologie. ORSTOM / Karthala, Paris : pp. 119-160
Sittler B. et Hauger K. (2007) – Les apports du laser aéroporté à la documentation de parcellaires anciens fossilisés par la forêt : l’exemple des champs bombés de Rastatt en Pays de Bade – La mémoire des forêts, actes du colloque « Forêt, archéologie et environnement », 14-16 décembre 2004, p.155-161
Stendhal (1838) – Mémoires d’un touriste, vol.1, Editions M. Lévy Frères, 362 p., p. 93
Toubert P. (1998) – Histoire de l’occupation du sol et archéologie des terroirs médiévaux : la référence allemande, Journal des savants. 1998, N°1. pp. 55-77.
Tristant C. (2009) – Contexte Archéologique, In Chevrier et coll. (2009) - Gevrey-Chambertin « Au-dessus de Bergis », une occupation diachronique au pied de la Côte de Nuits, Rapport final d’opération, Inrap, Dijon, p. 30
Trochet J.-R. (2008) – Les campagnes en France et en Europe : outils, techniques et sociétés du Moyen Âge au XXème siècle, Paris : Presses de l’Université Paris-Sorbonne , DL 2008, 298 p.
Ressources complémentaires non publiées :
Rapport de Fouilles « Brochon 2012 », M2 AGES (Automne 2012) ; responsable : Jean-Pierre Garcia
Documentation Captair, 2013, Méthodes d’acquisition OHR (Orthophotographie Haute Résolution) et PHR (Photogrammétrie Haute Résolution), www.captair.net
69 / 69
�ƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�ǀŝƟĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƀŶĞĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ƌĠǀĠůĠĞƐ�ĞŶ�ŵŝĐƌŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�>ŝ��Z
2013
Sites internet
www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr : Paysages de la plaine de la Lys, consulté le 20 mars 2013
www.epiacumheritage.org : Epiacum roman fort, Whitley Castle, consulté le 12 mars 2013
http://www.flickriver.com/photos/hamishfenton/4119551795/ : consulté le 18 mars 2013
Cartes
Bureau de recherches géologiques et minières (1968), Carte Géologique au 1/50000, feuille de Dijon. BRGM édition
Bureau de recherches géologiques et minières (1972), Carte Géologique au 1/50000, feuille de Gevrey-Chambertin. BRGM édition
Bureau de recherches géologiques et minières (1984), Carte Géologique au 1/50000, feuille de Beaune. BRGM édition
Cadastre Napoléonien (1828) des communes situées entre Couchey et Vougeot, Archives départementales de la Côte d’Or
Minute d’Etat Major (1838) des communes situées entre Couchey et Vougeot, IGN Paris. Carte IGN (2002) au 1/25000 (SCAN 25® BD Carto), IGN Paris
Carte des lieux possibles de la « bataille de cavalerie » opposant César à Vercingétorix en 52 av. J.-C., P.-M. Duval pour les notes de l’édition 1981 de la Guerre des Gaules (Constans L-A. d’après César (1926))