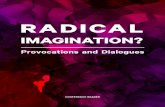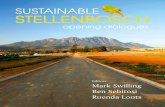Dialogues entre sphère publique
-
Upload
univ-brest -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Dialogues entre sphère publique
Alexandra Dardenayest maître de conférences à l’Université de Toulouse II - Le Mirail et membre du Laboratoire TRACES.
Emmanuelle Rossoest maître de conférences à l’Université de Paris IV-Sorbonne.
Ausonius Éditions— Scripta Antiqua 56 —
Dialogues entre sphère publique et sphère privée dans l’espace
de la cité romaine
Vecteurs, acteurs, signi!cations
textes réunis par Alexandra DARDENAY & Emmanuelle ROSSO
Di"usion De Boccard 11 rue de Médicis F - 75006 Paris— Bordeaux 2013 —
Notice catalographique :Dardenay, A. et E. Rosso, éd. (2013) : Dialogues entre sphère publique et sphère privée dans l’espace
de la cité romaine. Vecteurs, acteurs, signi!cations, Ausonius Scripta Antiqua 56, Bordeaux.
AUSONIUSMaison de l’ArchéologieF - 33607 Pessac cedexhttp://ausoniuseditions.u-bordeaux3.fr
Di!usion De Boccard11 rue de Médicis75006 Parishttp://www.deboccard.com
Directeur des Publications : Olivier DevillersSecrétaire des Publications : Nathalie PexotoGraphisme de Couverture : Stéphanie Vincent© AUSONIUS 2013ISSN : 1298-1990ISBN : 978-2-35613-097-6
Achevé d’imprimer sur les pressesde l’imprimerie BMZ.I. de Canéjan14, rue Pierre Paul de RiquetF - 33610 Canéjan
Décembre 2013
Illustration de couverture : Oplontis, villa de Poppée, atrium : détail du décor pariétal de deuxième style. Photographie de L. Romano parue dans D. Mazzoleni et U. Pappalardo, Fresques des villas romaines, Paris, 2004, p.142.
Sommaire
Alexandra Dardenay et Emmanuelle Rosso, Introduction 9
1. Ambiguïté des espaces
Gilles Sauron, Le théâtre de Pompée et le deuxième style pompéien 19Valérie Huet, Des banquets sur les reliefs funéraires romains : publics ou privés ? 35Sylvia Estienne, Penser le patrimoine des dieux, entre privé et public 55Emmanuelle Rosso, Secundum dignitatem municipi : les édi!ces collégiaux et leur programme !guratif, entre public et privé 67Francisco Marco Simón, Imagen pública e iconografía privada en las ciudades de la celtiberia en época republicana 123
2. Interactions : réciprocité et complémentarité des échanges
Nicolas Tran, Les collèges dans les espaces civiques de l’Occident romain : diverses formes de dialogue entre sphère publique et sphère privée 143Nicolas Monteix, Espace commercial et puissance publique à Pompéi 161Trinidad Nogales Basarrate, Augusta Emerita. Centro de interacción de los modelos metropolitanos en las esferas públicas y privadas de Lusitania 185Gaëlle Herbert de la Portbarré-Viard, Le munus aquarum dans le carmen 21 de Paulin de Nole : un témoignage exceptionnel sur l’évergétisme chrétien des eaux au début du Ve siècle 207
3. Du public au privé : transfert et appropriation de formes
Renaud Robert, Arte et amore captus. Les collections : une appropriation controversée des opera publica et la perception du décor privé 235Hélène Eristov, Échos et signes de la sphère publique dans le décor pariétal privé en Campanie 251Jean-Charles Balty, Interactions entre la sphère publique et la sphère privée : types iconographiques et types statuaires, (Umbildungen, Zeitgesicht et Privatapotheose) 275Alexandra Dardenay, Virtus et pietas du défunt. Quelques hypothèses de lecture de l’iconographie o"cielle en contexte funéraire 297
Index des lieux 315Index des noms 319
Des banquets sur les reliefs funéraires romains!: publics ou privés!?1
Valérie Huet
À Rome, de nombreux banquets sont publics. Néanmoins, la frontière “public”/“privé” y est di!érente de celle qui existe de nos jours, les deux sphères étant loin d’être "gées dans des espaces hétérogènes, imperméables, voire opposés. Cette évidence a été démontrée ces trois dernières décennies par des études privilégiant comme angles d’attaque le point de vue des Romains et l’analyse des dynamiques politiques et sociales qui se déroulaient dans des espaces aussi divers que celui du forum, de la schola (siège d’un collège), de la domus, de la villa ou encore des routes longeant les tombeaux et nécropoles2. Les critères pour dé"nir ce qui relève d’un “banquet public” à Rome et pour le repérer pourraient paraître simples, et pourtant, si l’on analyse les acceptions di!érentes proposées par les chercheurs, on s’aperçoit que tel n’est pas le cas. Car un “banquet public” peut être o!ert par une cité, par une communauté tel un collège, comme par un seul individu#; a contrario, un “banquet privé” peut intégrer une partie importante de la population. De plus, les manières de participer à un “banquet public” varient, non seulement suivant les circonstances, mais aussi suivant le statut que chacun occupe dans la communauté#: les magistrats et prêtres peuvent manger, par exemple, dans une salle attenante à un sanctuaire ou dans la maison du “président” suivant les rites prescrits, alors que le peuple béné"cie d’une distribution ou achète sa part chez le boucher#; le peuple peut aussi y participer en sortant des tables et des lits dans la rue devant sa maison3.
À ces di$cultés d’appréhender un “banquet public”, s’ajoute celle du medium considéré, l’image, ici l’image funéraire# : celle-ci permet-elle de dé"nir l’espace et le rituel représentés comme relevant du “public” ou du “privé”4#? Quels sont les signes dans l’image qui indiquent le caractère “public” du repas commémoré#? Est-ce le nombre de convives#? Est-ce la multiplication des tables et la juxtaposition des banqueteurs#? Est-ce la distinction entre un espace extérieur et un espace intérieur# ? La représentation d’un espace extérieur sur un relief révèle-t-elle nécessairement que le banquet s’o!re aux yeux de tous, et qu’il est, dans ce sens-là, et non dans un sens juridique, “public”#? Un monument “privé” tel qu’un autel funéraire, une urne cinéraire ou un sarcophage peut-il commémorer un “banquet public”#?
Cette dernière question est la seule qui semble aisée à résoudre, non grâce à l’analyse interne des images, mais grâce à un passage souvent exploité du banquet de Trimalcion dans lequel
1 Je tiens à remercier vivement les deux organisatrices du colloque à Madrid, Alexandra Dardenay et Emmanuelle Rosso que j’ai connues à cette occasion et avec qui, au "l des années, j’ai “banqueté” en “public” comme en “privé”, tout en partageant des “nourritures intellectuelles”…
2 Entre autres, Scheid 1984 et 1990, 2005a#; Hesberg & Zanker 1987#; Sauron 1994#; Zaccaria Ruggiu 1995.
3 Voir Scheid 1985, 1988, 1990, 2005a, 2005b# ; Rüpke 1998 et 2005# ; D’Arms 1998, 1999 et 2000# ; Estienne & Huet 2004#; Estienne & Huet 2012.
4 Françoise Frontisi et François Lissarrague (Frontisi & Lissarrague 1998) posent cette question à un autre corpus d’images, les peintures des vases attiques représentant le loutérion, vasque ou lavabo, qui est un marqueur spatial, avant d’ouvrir la perspective en considérant des reliefs. Ils en concluent que “L’opposition entre ces deux ensembles d’images, vases et reliefs, n’est donc pas tant de l’ordre du public et du privé que dans la nature même de leur lieu d’insertion”.
36Va
léri
e H
uet
celui-ci commande à Habinnas, un sévir marbrier qui est son invité5, son propre tombeau parce que “rien n’est plus absurde que d’avoir de son vivant des maisons bien garnies, et de ne pas soigner celles où nous devons demeurer bien plus longtemps”6. Trimalcion prévoit la grandeur de l’espace dans lequel le monument doit s’implanter a"n qu’il soit entouré de fruits et de vignes7, qu’il ne soit utilisé que par lui-même8 et bien gardé. Il choisit soigneusement les représentations qui doivent orner son monument# : doivent "gurer sa statue, sa chienne, des couronnes et des parfums, les combats de Pétraitès, une horloge, ainsi que les images suivantes#: “Je te prie encore de sculpter sur .... de mon monument funéraire des vaisseaux voguant à pleines voiles, et moi-même siégeant sur un tribunal vêtu de la prétexte, avec cinq anneaux d’or, et distribuant en public de la monnaie d’un sac#: car tu sais en e!et que j’ai donné un banquet de deux deniers. Et sculpte, si bon te semble, les triclinia. Et tu sculptes tout le peuple en pro"tant avec délices”9. Suit la commande de la statue de Fortunata tenant une colombe et une chienne, de la représentation de son amant et d’amphores cachetées, d’une horloge, d’une urne brisée sur laquelle pleure un enfant. En"n, Trimalcion dicte son épitaphe qui, comme de bien entendu, ne correspond pas aux images développées, mais énonce son nom, sa “carrière”, ses qualités et sa fortune avant de s’adresser au spectateur, à celui forcé de lire son nom s’il veut lire l’heure#: “C. Pompeius Trimalchio Maecenatianus repose ici. Le sévirat lui fut décerné en son absence. Il pouvait être de toutes les décuries à Rome, mais ne le voulut pas. Pieux, vaillant, "dèle, il est parti de peu#; il a laissé trente millions de sesterces, et jamais ne suivit les leçons d’un philosophe. Porte-toi bien. – Toi aussi”10. Forfanterie et exagération, voire tromperie sont de mise#; l’absence de mention explicite de son a!ranchissement ne le rend pas pour autant chevalier, comme les noms qu’il porte le montrent parfaitement.
Dans le choix non anodin des images, il est intéressant que l’a!ranchi Trimalcion veuille évoquer un banquet public, mettant en avant sa générosité et une certaine réussite et reconnaissance sociales, à défaut d’être politiques. La juxtaposition de la scène de distribution d’argent et de la représentation du banquet est alors l’équivalent de l’énoncé de son “cursus”, tandis que l’image du navire voguant sur les %ots correspond à la mention de sa fortune et de son origine. L’épitaphe et les images sont censées donner du personnage des informations
5 Le métier d’Habinnas et sa réputation pour faire les plus beaux monuments funéraires sont énoncés lors de l’arrivée tardive de celui-ci#: Petr., Sat., 65.5 (Ernout 1923).
6 Petr., Sat., 71.7 (Ernout 1923)#: Valde enim falsum est uiuo quidem domos cultas esse, non curari eas, ubi diutius nobis habitandum est.
7 À moins qu’il ne s’agisse de la grandeur démesurée du monument, et dans ce cas fruits et vignes seraient représentés. Petr., Sat. 71.6-8. Sur les tombeaux de cette époque, lire Gros 2001, 440-467.
8 Contrairement à nombre d’épitaphes inscrites à côté des images de banquet et qui énoncent ceux qui peuvent être accueillis dans le monument funéraire, Trimalcion dit (71.7)# : “Ce monument ne doit pas revenir à mon héritier” (Hoc monumentum heredem non sequatur). On connaît quelques exemples épigraphiques aussi restrictifs# : cf. Wol! 2000, 25-26. On verra plus loin un relief qui énonce dans l’inscription la restriction de l’usage au commanditaire et à sa femme.
9 Petr., Sat., 71.9-10#: Te rogo, ut naues etiam... monumenti mei facias plenis uelis euntes, et me in tribunali sedentem praetextatum cum anulis aureis quinque et nummos in publico de sacculo e!undentem"; scis enim, quod epulum dedi binos denarios. Faciatur, si tibi uidetur, et triclinia. Facies et totum populum sibi suauiter facientem. (Ernout 1923, trad. V. Huet).
10 Petr., Sat., 71.12# : C. Pompeius Trimalchio Maecenatianus hic requiescit. Huic seuiratus absenti decretus est. Cum posset in omnibus decuriis Romae esse, tamen noluit. Pius, fortis, #delis, ex paruo creuit, sestertium reliquit trecenties, nec unquam philosophum audiuit. Vale. – Et tu.
37D
es banquets sur les reliefs funéraires romains!: publics ou privés!?
équivalentes, mais leurs formules synthétiques ne livrent pas les mêmes détails. On regrette évidemment, mais à tort, de ne pas avoir de précisions sur la façon dont le banquet était sculpté et l’on peut se demander, exercice toutefois inutile, si le quidam qui lisait l’heure le regardait seulement et s’il était capable d’identi"er la nature de celui-ci. Car en l’absence d’indications écrites, comment reconnaître avec certitude un banquet public#? Tout paraît “réel”, même si nous sommes dans une satire, même si nous sommes bien en mal de reconstruire le monument à partir de cette source littéraire (par exemple, les statues sont-elles indépendantes, mises à l’extérieur ou à l’intérieur du tombeau# ? où était représenté le banquet# ?)11. Le monument semble un bon résumé des tombeaux retrouvés archéologiquement12, émanant de personnes considérées pour la plupart jusqu’à maintenant comme appartenant à la plebs media13, une plèbe su$samment riche pour pouvoir s’o!rir des tombeaux sculptés, plus tard des sarcophages, à laquelle se mêlent les nouveaux riches, les a!ranchis qui n’hésitent pas à usurper les insignes o$ciels des magistratures. Mais bien sûr, nous sommes confrontés à l’intérieur d’un banquet imaginaire “littéraire”, celui de Trimalcion imaginé par Pétrone, un banquet “privé” qui %irte avec le “logos sympotikos”, les “Propos de table” ou leur genre, à l’image d’un second banquet, celui-là “public”, une image commémorative imaginée par le même Trimalcion qui nous en fait une sorte d’ekphrasis et qui doit être "xée sur un monument commandé, mais non encore réalisé. Il s’agit d’un double banquet de vivants avec emboîtement d’images, sans aucune allusion a priori aux banquets funéraires. Malgré tous les dangers de prendre au pied de la lettre Le Satiricon, il est tentant de déduire que oui, une scène de banquet public, un banquet de vivants, peut orner le tombeau d’un homme.
Sortons de l’imaginaire du Satiricon et examinons les realia. En e!et, je me propose maintenant de regarder quelques images de banquet sur des reliefs funéraires provenant de Rome et d’Italie. Ma ré%exion découle d’une part de la constitution d’un corpus de 274 documents
11 Bien sûr ce sont de fausses questions. Sur la lecture des a!ranchis dans le texte de Pétrone, voir entre autres D’Arms 1981, 97-120# ; Andreau 1992. Contre l’utilisation abusive du texte de Pétrone par les historiens qui, tout en reconnaissant la nature caricaturale du texte, cherchent une description de la société de l’époque, notamment des a!ranchis de Néron, lire Dupont [1977] 2002. Sur la valeur de l’énoncé performatif de Trimalcion lors de sa lecture de l’épitaphe, cf. Dupont [1977] 2002, 117-119. Sur l’analyse du décor de Trimalcion, cf. Dumont 1990.
12 Sur Pétrone et le discours de Trimalcion sur son monument funéraire, lire entre autres Whitehead 1993#; Clarke 2003, 145-152 et 185-203, Dunbabin 2003, 88-89# : tout en montrant la distance entre le jeu littéraire, la déformation satirique, et la “réalité”, ils établissent un parallèle avec des monuments existants, parmi lesquels au palmarès de tête sont notés les monuments d’Eurysacès et des Haterii, le tombeau sculpté de C. Lusius Storax et celui de C. Vestorius Priscus dont les peintures internes renvoient au passage précis qui nous intéresse ici.
13 Cette désignation courante de plebs media dans le sens de plèbe “moyenne” vient essentiellement de l’utilisation de Veyne 1990, Veyne 2000 et Veyne 2005, 117-162. Toutefois, avec la publication prochaine de la thèse de Cyril Courrier dans la BEFAR, La Plèbe de Rome et sa culture (#n du IIe siècle av. J.-C. – #n du Ier s. ap. J.-C.), il sera probablement nécessaire de réviser cette appellation, ou du moins de la nuancer, puisque l’auteur démontre, après entre autres une étude "ne du vocabulaire, que la plebs media correspond à l’élite de la plèbe.
38Va
léri
e H
uet
et de son analyse que j’ai réalisée dans le dessein d’un livre14, d’autre part des travaux d’autres chercheurs15. Peut-on (et comment) identi"er de façon certaine sur des reliefs funéraires des banquets publics et des banquets privés#? Je partirai des images identi"ées généralement comme le re%et de “grands banquets” à défaut de “banquets publics”, avant d’analyser d’autres images considérées comme plus privées.
Quels sont les critères principaux qu’ont retenu les chercheurs pour identi"er des banquets publics sur des images#? Il est évident que tous les chercheurs ne s’entendent pas sur l’acception des termes “banquet public”, comme je l’ai déjà dit. Néanmoins le premier critère énoncé par les historiens d’art est le nombre des convives. Le second la solennité du banquet exprimée notamment par la multiplication ou la juxtaposition des banquets représentés, ainsi que par les habits portés#; le troisième la typologie du banquet, de préférence un banquet à sigma#; le quatrième critère est l’espace représenté, en plein air ou non, c’est-à-dire visible par tous. La combinaison des divers critères est bien sûre idéale. Ce sont toujours les mêmes reliefs qui sont invoqués par les chercheurs, et je ne dérogerai pas à la règle16, mais dans le détail leur interprétation pose problème. Je m’attacherai à une petite série de reliefs provenant du nord-ouest et centre de l’Italie.
Trois reliefs du milieu du &er s. p.C. mettent en scène de nombreux convives. Si leur description est à peu près similaire chez divers chercheurs, leur interprétation a donné lieu à des points de vue divergents. L’autel d’Este ("g.#1)17 présente autour d’une table des convives allongés sur des lits18#; malgré l’état de détérioration, on s’accorde pour reconnaître douze ou treize banqueteurs
14 Le livre est en cours de préparation. Il s’appuie sur le mémoire inédit qui a été présenté en vue de l’obtention de l’HDR, en 2009 à l’EPHE, section Sciences religieuses. Il est intitulé Les gestes du banquet à Rome sur les reliefs funéraires italiens. Le corpus lui-même a été constitué à partir de nombreux catalogues réalisés essentiellement par des archéologues allemands#: il comporte des autels funéraires, des urnes, des stèles, quelques plaques de loculus provenant de l’Isola Sacra à Ostie, et de nombreux sarcophages. Les documents s’étalent du &er s., plutôt de la période Flavienne, au début du &'e#s.#p.C. Nous pouvons repérer divers ateliers et pratiques, manières de représenter, comme des évolutions typologiques et d’utilisation de supports di!érents suivant la chronologie. Toutefois, cet article n’en est pas le lieu.
15 Principalement sur cette ré%exion sur le banquet public/privé# : Jastrzebowska 1979 ; Ghedini 1990 ; Amedick 1991 ; Compostella 1992 ; Dunbabin 2003.
16 Je restreins bien sûr le corpus aux reliefs funéraires. Dans un article écrit avec Sylvia Estienne à propos du relief du banquet des Vestales appartenant à un monument public, certains de ces reliefs ont déjà été abordés et commentés dans des termes presque équivalents#; toutefois leur utilisation résidait moins dans la nature publique du banquet que dans l’identi"cation de banquets sacerdotaux accomplis dans le cadre de collèges#: Estienne & Huet 2012.
17 Autel, marbre blanc, H. 0,86 m, L. 0,93 m, Este, Musée National 1347. Il proviendrait peut-être d’Aquilée. Cf. Estienne & Huet 2004, n°#146, 295-296.
18 Pour moi, la composition correspond à celle dite à sigma et non à kliné, dans le sens où l’angle de vue en partie de dessus ne permet pas de distinguer trois lits di!érents et insiste sur la disposition en un sigma rectangulaire. Pourtant, comme l’énonce Katherine Dunbabin (Dunbabin 2003, 74 et 77), il s’agit de la disposition typique des lits dans un triclinium, même si elle note que le sculpteur a choisi une composition di!érente des scènes appelées “Totenmahl”, c’est à dire à kliné.
39D
es banquets sur les reliefs funéraires romains!: publics ou privés!?
qui se distinguent peu entre eux19, si ce n’est par les gestes qu’e!ectuent certains, tel celui d’élever une coupe. L’espace extérieur est indiqué par un grand arbre dont les branches supérieures surplombent une éto!e, qu’on appelle parapetasma. Les faces latérales sont ornées d’objets qui renvoient, l’une à l’artisanat lié au travail du métal, l’autre à l’univers féminin. Pour certains20, c’est la représentation d’un banquet funéraire familial (lors des funérailles ou lors des Parentalia)#: l’argumentaire de Francesca Ghedini repose sur la draperie, l’arc formé par l’arbre, et l’attitude du serviteur de droite qui esquisserait un geste typiquement funéraire# ; il s’agirait donc d’un banquet auprès d’une tombe, mais d’un banquet de vivants puisque les défunts ne peuvent être à la même table que les vivants21. Pour d’autres22, il s’agit d’un banquet évergétique o!ert à ou par des personnages o$ciels, comme des sévirs, ce qui n’exclut pas pour autant l’interprétation d’un banquet commémoratif funéraire. Les références aux seuiri et Augustales proviennent de la comparaison avec des inscriptions23. Sur le lit d’honneur (lectus medius) ont été reconnues une24 ou deux femmes25 (personnellement, je ne les distingue pas des autres personnages)#: la
19 Pour Elisabeth Jastrzebowska (Jastrzebowska 1979, n° 110, p. 59, pl. 8.2), les convives porteraient tous des tuniques et des pallia. Il est toutefois di$cile de distinguer le pallium de la toge dans l’iconographie.
20 Fogolari 1956, 39-50#; Ghedini 1990, 38.21 Sur les pratiques funéraires et les banquets rituels qui y sont liés, voir Belayche 1995# ; Lindsay 1998# ;
Scheid 1984#; Scheid 2005a, 161-209.22 Giuliano 1966, 35, 41#; Compostella 1992, 664-670 "g. 6-8#; Dunbabin 2003, 74-79.23 Principalement avec une provenant de Cures (CIL, IX, 4971) et une autre de Cor"nium (CIL, IX, 3160).
Concernant les seuiri Augustales comme les défunts et/ou les commanditaires de monuments funéraires, voir l’étude d’Emmanuelle Rosso#: Rosso 2006.
24 Compostella 1992, op."cit.25 Ghedini 1990, op."cit.
Fig. 1. Autel d’Este, Musée national. D-DAI-ROM-84.3100, photographie Schwanke.
40Va
léri
e H
uet
femme (ou l’une d’entre elles) est soit la donatrice du banquet26, soit un membre de la famille au banquet funéraire27, mais ne serait en aucun cas la représentation de la défunte. Ainsi pour Carla Compostella, le banquet aurait été o!ert par la femme centrale aux collèges des seuiri ou Augustales peut-être en souvenir de son mari dont le métier serait évoqué par les instruments de la face latérale gauche. Selon Katherine Dunbabin28, l’autel funéraire pourrait être autant celui de l’homme que de la femme, ce qui expliquerait les faces latérales. L’aspect public commémoratif du banquet serait renforcé par la sculpture du haut d’une couronne qui apparaît en-dessous du banquet#; l’auteur rappelle que cette couronne surmonte, sur d’autres monuments funéraires, un bisellium, à savoir un siège décerné à titre honori"que aux hommes importants tels que les décurions et les Augustales29. Le banquet représenté serait alors celui du bisellarius à l’occasion de la réception du bisellium"; il était peut-être un seuir Augustalis ou un Augustalis. L’aspect public du banquet serait renforcé par la présence de l’arbre et du parapetasma, qui fournissent bien sûr de l’ombre aux convives, mais permettent surtout de planter le décor à l’extérieur tout en cadrant l’espace du banquet, c’est à dire l’espace du champ imagé.
Cet autel est immanquablement comparé à un relief conservé au musée d’Ancône provenant de Sentinum ("g.#2)30 qui présente douze convives allongés sur trois lits distincts disposés autour
26 Compostella 1992, op."cit.27 Ghedini 1990, op."cit.28 Dunbabin 2003, op."cit.29 Cf. aussi Schäfer 1989 et 1990.30 Relief d’un monument funéraire#; Ancône, Musée National 123. Cf. Estienne & Huet 2004, n°#147, 296.
Fig. 2. Relief de Sentinum. Ancône, Musée national. D-DAI-ROM-81.2247,
photographie Schwanke.
Fig. 3. Relief d’Amiternum, mur de l’église de San Stefano à S. Vittorino. D-DAI-ROM-84VW.935A, photographie
Fittschen.
41D
es banquets sur les reliefs funéraires romains!: publics ou privés!?
d’une table vue de dessus#; les faces latérales attesteraient de scènes identiques, ce qui amènerait à un total de trente-six convives, à supposer bien sûr qu’ils aient tous participé au même banquet. Le banquet a été identi"é comme un banquet évergétique31, o!ert peut-être sur la volonté du testateur32. Aucun indice ne permet de dire si le banquet se déroulait dans un espace intérieur ou extérieur. Seuls le nombre de convives et sa proximité iconique avec l’autel d’Este incitent à l’identi"er comme un banquet public33.
Le relief d’Amiternum ("g.#3)34 adopte une autre composition, en répartissant les douze convives autour de deux tables et en représentant les uns allongés tandis que les autres sont assis#; l’interaction entre convives est marquée par la diversité des gestes, même s’ils sont répétitifs, et par les jeux de têtes#; tous les banqueteurs sont vêtus de manière identique, d’une tunique et d’une toge. La facture et le style di!èrent aussi, témoignant de sa fabrication dans un autre atelier, situé probablement non plus au nord-ouest, mais au centre de l’Italie. Là encore, aucun indice ne révèle si le banquet se passe en plein air ou non. La juxtaposition du banquet couché et du banquet assis, reliés dans l’image par les serviteurs, a donné lieu à plusieurs hypothèses. Certains ont interprété l’image comme la représentation du banquet funéraire qui se déroulait à la "n des funérailles en famille et avec les amis du défunt35, d’autres comme un banquet évergétique36 o!ert selon la volonté du testateur37, réunissant peut-être les décurions et les seuiri38 comme le mentionne l’inscription de Cures39. Katherine Dunbabin40 met en parallèle cette image avec une inscription de Cor"nium41 exaltant la muni"cence du donateur qui institue une fondation de 50 000 sesterces a"n que chaque année, le jour de son anniversaire, toute la cité banquette en son honneur#: les décurions et leurs enfants reçoivent 30 sesterces et dînent allongés (discumbentibus), les seuiri Augustales, 20 sesterces, mais ils dînent di!éremment (vescentibus) et la plèbe festoie (epulantibus) pour 8 sesterces# : si les termes latins ne sont pas très clairs, ils mettent cependant en parallèle la di!érence de statut et la manière divergente de banqueter. Aussi, selon Katherine Dunbabin, faut-il interpréter le banquet comme un seul banquet mettant en scène deux groupes sociaux di!érents#: ceux qui dînent allongés correspondraient aux décurions, ceux assis aux Augustales, la plèbe n’étant pas représentée# ; ou encore, et elle préfère cette solution, les décurions ou Augustales seraient allongés, la plèbe serait assise. La table centrale autour de laquelle s’a!airent les esclaves renverrait peut-être aussi à un don de la part du défunt de mobilier, o!ert précisément pour servir aux banquets commémoratifs institués.
31 Ghedini 1990, 38#; Compostella 1992, 673-675.32 C’est certain pour Francesca Ghedini, possible, mais non obligatoire selon Carla Compostella.33 Lire aussi Dunbabin 2003, 75-79.34 Relief d’un monument funéraire, probablement un autel#; calcaire#; H. 0,49 m, L. 1,12 m ; mur de l’église
de S.#Stefano à S. Vittorino#; provenance précise inconnue#: Amiternum (Pizzoli). Cf. Estienne & Huet 2004, n°#148, p.#296. Sur la face latérale droite, on voit une aile qui est signalée comme celle d’un aigle, mais qui pourrait être celle d’un personnage tel une Victoire.
35 Persichetti 1908, 24-25.36 Ghedini 1990, 38-39#; Compostella 1992, 670-673.37 Ghedini, op. cit.38 Giuliano 1966, 35.39 CIL, IX, 4971.40 Dunbabin 2003, 79-85.41 CIL, IX, 3160 = ILS, 6530.
42Va
léri
e H
uet
Le dernier relief témoignant de nombreux convives appartient à une autre série d’images puisqu’il date de la "n du &&&e s. et orne le couvercle d’un sarcophage d’enfant ("g.#4)42. Un banquet à sigma est %anqué de deux banquets assis#; il comprend trois convives tout comme le banquet assis sur la partie gauche du relief. On peut présumer, malgré la cassure, que l’autre banquet assis comportait le même nombre de banqueteurs, ce qui ferait un total de neuf convives. Dans le cas du banquet à sigma, la table trépied est de taille peu imposante par rapport aux tables des banquets assis, ce qui est logique car l’espace est circonscrit par le puluinus et il ne s’agit pas du même type de tables#; les trois hommes tiennent de la main gauche une coupe ou un gobelet, et étendent leur bras droit sur le coussin, le personnage central allant toucher, semble-t-il, le plat posé sur la table. Les convives assis, sculptés sur la partie gauche du relief, font des gestes équivalents de leur main droite, c’est à dire qu’ils touchent la table, les plats#; le personnage central tient un gobelet de la même main, alors que le personnage de droite porte devant lui le gobelet, de l’autre main. Le personnage central et celui de gauche ont le corps en partie de pro"l et leur main gauche est posée sur l’épaule de la personne à côté. Les personnages sont donc reliés les uns aux autres et forment un groupe. Si l’on ajoute que le personnage de gauche est une femme, comme le signale son chignon, que le personnage médian est un homme qui tourne la tête vers la femme et que le deuxième homme a une tête plus petite, une tunique plus courte et pas de manteau, il est aisé d’interpréter le groupe comme un couple et leur "ls. Les serviteurs s’a!airent et font le lien entre les di!érentes tablées. En raison du nombre des convives, ce relief est classé par certains dans les banquets évergétiques43#; en raison des liens familiaux exposés, il est considéré par d’autres comme une scène de la vie privée44. Ce qui est sûr, c’est que ce document est unique dans la série des reliefs de banquet du &&&e s.
On le comprend, pour séduisantes que soient les diverses hypothèses, il n’est guère possible de trancher entre elles#; seules des inscriptions explicatives accompagnant ces images révèleraient les circonstances précises des banquets et le statut des convives. Les interprétations de banquet funéraire ne trouvent leur origine que dans la nature du monument que l’image orne# ; or, l’adéquation entre le support de l’image et une symbolique funéraire est loin d’être évidente. Ce qui est clair, c’est que les commanditaires ont voulu porter l’accent sur la participation à de grands banquets. L’égalité apparente des convives qui se manifeste dans la similitude des vêtements et le manque de caractérisation des personnages ne cache pas l’inégalité provoquée par la place qu’on y occupe et par la manière de banqueter. Les principes d’harmonie et de partage, forcément inégalitaire, ne
42 Couvercle de sarcophage fragmentaire sur la partie droite, L. 1,49 m# ; H. 0,18 m# ; Vatican, Musée Chiaramonti, inv. 2165. Cf. Himmelmann 1973, 65-66, n° 55#; Andreae 1995, pl. 832-833, LIX 6.
43 Dunbabin 2003, 89-91.44 Amedick 1991, 166-167, n° 280, pl. 32.1-5.
Fig. 4. Couvercle d’un sarcophage d’enfant, Vatican, Musée Chiaramonti, inv. 2165. Photographie d’après R. Amedick, Die Sarkophage mit Darstellungen aus den Menschenleben, 4. Vita Privata, 1991, pl. 32.1.
43D
es banquets sur les reliefs funéraires romains!: publics ou privés!?
gomment pas les hiérarchies45. Dans ces reliefs, hormis celui du &&&e s., il est di$cile de repérer des femmes. La communauté mise en avant est une société d’hommes, celle des amis, celle des réseaux de patrons et de clients, celle du tissu politique et urbain.
Et c’est bien la communauté des “amis”, exclusivement des hommes, qui est montrée sur les banquets à sigma des &&&e et &'e s. p.C. Le motif dérive des banquets de Méléagre et des banquets dionysiaques développés depuis le &&e s. sur les monuments funéraires. Sur le couvercle de sarcophage conservé au musée de la catacombe S. Sébastien à Rome ("g.#5)46, la scène de banquet prend place devant un parapetasma, et est délimitée à gauche par une œnochœ47 surdimensionnée juchée sur une table et un homme portant un vase, et à droite par un personnage apportant un plat contenant une forme qui correspond à celle d’un poisson. Les convives sont assis, au moins dans deux cas, à même le sol et certains sont accoudés à un grand coussin –#puluinus"– disposé en un U retourné qui entoure ce qui ressemble à un petit tabouret ou un plateau sur trois pieds. Sur ce “plateau”, "gure la tête d’un cochon#; de chaque côté, deux formes rondes vues de dessus comportant un motif incisé sont interprétées comme des pains. De l’autre côté de l’espace réservé à l’inscription (laissé vide), est représentée une scène liée à la chasse#: une battue. Une chasse au lion orne la cuve.
Ce couvercle est bien représentatif de l’ensemble des scènes de banquets à sigma de cette époque qui sont sculptés sur une plaque de loculus et des sarcophages, principalement des couvercles. Même si l’on ne retrouve jamais deux scènes identiques, la scène est générique, seuls quelques signes iconiques varient. Elle exhibe une autre commensalité#: les convives sont entre trois et six, ils sont assis ou accoudés à un coussin, puluinus, arrangé en sigma. Ce sont tous des hommes. Ils sont
45 Cf. D’Arms 1984#; D’Arms 1990#; Morton Braund 1996.46 L. 2,19 m ; H. 0,41 m#; l. 0,97 m. Rome, S. Sébastien, Museo I, provenant du cubiculum 47d.#; il est daté
c.#290-300#p.C. Cf. Himmelmann 1973, 62 n° 33#; Jastrzebowska 1979, 52 n° 49#; Andreae 1980, 84-86, 169 n° 149, pl. 52.2, 58. 1-2 et 4, 59, 1-3#; Amedick 1991, 148 n° 168, pl. 31, 1#; Dunbabin 2003, 148. Ce n’est pas un sarcophage chrétien.
47 Je l’interprète comme une authepsa.
Fig. 5. Détail du couvercle de sarcophage, Musée I de la catacombe S. Sébastien à Rome. Photographie d’après R. Amedick, Die Sarkophage mit Darstellungen aus den
Menschenleben, 4. Vita Privata, 1991, pl. 31.1.
44Va
léri
e H
uet
tous habillés de la même façon, de préférence d’une tunique. Parfois, le port de la barbe distingue au sein du même repas les hommes mûrs des jeunes hommes, mais la plupart sont imberbes. Le cadre se situe à l’extérieur# ; c’est ce que révèle la représentation d’arbres et/ou d’un rideau suspendu, le parapestama. Les plats exhibés devant eux ou qu’on leur apporte sont identiques à ceux qui apparaissent dans les banquets se déroulant sur une kliné de la même époque, montrant principalement la tête de cochon, le poisson et le pain. Leurs serviteurs ressemblent étrangement aux convives#: même coupe de cheveux courte, parfois bouclée, même tunique resserrée sur les hanches. Seuls se distinguent d’eux, et encore pas toujours, sur certains reliefs, les hommes chargés d’entretenir le feu et de verser un liquide dans un large récipient. La convivialité est déployée par les gestes variés et larges des divers acteurs, mettant en avant l’interaction entre les convives eux-mêmes et entre les convives et les serviteurs.
Le message porté est celui d’un dynamisme des échanges favorisé par la consommation de vin et de nourriture#; il s’agit sans conteste d’un repas entre amis#; son animation certi"e sa réussite. La bonne compagnie, le bon air et de bons produits à partager sont les clés de cette convivialité et du plaisir éprouvé. Cette atmosphère joyeuse de “pique-nique”48 renvoie le spectateur à des images bucoliques et à des repas après la chasse, chasse qui pouvait être représentée à côté, comme ici de l’autre côté du titulus sur le couvercle et sur la cuve du sarcophage49. L’image véhiculée de la gaieté du repas partagé est donc double#: d’une part, une simplicité agreste rappelant un certain âge d’or, d’autre part le goût pour des chasses “aristocratiques” renouvelé depuis les Antonins50 transmis dans l’art par le modèle des banquets de Méléagre. S’il est vrai que le stibadium est alors plus d’actualité dans les demeures romaines que les repas sur kliné, à en croire l’étude des realia51, s’il est exact que des banquets sont organisés, au moins depuis César, sous des pergola dans des domus, des uillae et dans des horti52, et que l’on en voit des re%ets dans la peinture domestique53, néanmoins ce n’est pas ce qui prime. Par l’indistinction physique des hommes et l’exclusion des femmes, sont mises en avant la commensalité et la convivialité entre citoyens#; les rapports hiérarchiques sont alors relégués à l’arrière-plan. Ces repas sont-ils alors privés ou publics#? Certains re%êtent probablement des banquets privés qui étaient o!erts parfois à la vue de tous. Peuvent-ils témoigner de banquets publics#? Et renvoient-ils à des banquets “réels”, comme cela a été souvent a$rmé#?
Contournons l’obstacle et retournons la problématique#: à défaut de l’identi"cation certaine sur les reliefs de “banquets publics”, peut-on reconnaître des banquets indiscutablement “privés”#? Or quoi de plus “privé” a priori que de se faire représenter banquetant seul sur sa kliné ou plutôt sur son lectus#? L’urne cinéraire de T. Titulenus Isauricus ("g.#6)54, datée de l’époque %avienne,
48 Je renvoie ici à l’appellation proposée par Ghedini#: Ghedini 1990.49 Toutefois, l’état de conservation ne nous permet que dans ce cas et un autre d’assurer de la représentation
d’une chasse au lion, alors que celle-ci et d’autres chasses ornent les monuments montrant des banquets à kliné.
50 Sur la chasse, lire entre autres Trinquier & Vendries 2009. Sur les reliefs de chasse#: Andreae 1980#; Baratte 2009. Sur les rapports complexes entre chasse et banquet#: Ghedini 1992.
51 Sur les di!érences entre triclinium et stibadia, et les utilisations de stibadia dans l’antiquité tardive#: Bek 1983#; Dunbabin 1991 et 2003, 36-50#; Rossiter 1991.
52 Soprano 1950#; Dunbabin 1996#; D’Arms 1998.53 Amedick 1993#; Sauron 1994.54 H.#0,343 m#; L.#0,345 m. Londres, British Museum, 2377. Sinn 1987, 162 n° 282 pl. 50e#; Roller 2006,
38, 40 "g.#6.
45D
es banquets sur les reliefs funéraires romains!: publics ou privés!?
met en scène un homme torse nu aux jambes recouvertes d’un drapé, à demi-allongé sur une banquette à haut dossier, qui tient un vase ou coupe de la main gauche. La scène prend place entre deux torches et est couronnée d’un fronton qui est orné d’une couronne de laurier d’où partent des rubans.
En dessous est gravée l’inscription suivante#: Dis Manibus / T(iti) Tituleni Isaurici, / Iulia Tyche, / coniugi bene merenti55. Elle nous renseigne sur le nom du défunt auquel est o!ert l’urne, et sur le nom et le statut du dédicant, sa femme. L’inscription ne mentionne pas le banquet, mais il est tentant de voir dans le banqueteur le défunt, d’autant plus que la nudité partielle peut renvoyer à un statut héroïque. L’économie des signes iconiques comme de la formule épigraphique n’empêchent pas d’identi"er la scène comme celle d’un banquet. Sur d’autres monuments, le banqueteur n’exhibe pas un torse nu mais porte une tunique sous la toge lâche. L’image du banqueteur isolé n’est pas réservée aux hommes, comme le montre l’autel érigé en l’honneur d’Attia Agele ("g.#7)56 datant de Néron ou du début des Flaviens. Dans une sorte de niche, une femme est allongée sur une banquette à haut dossier. Elle tient de la main gauche une coupe et de la droite une guirlande. Devant elle, une table trépied sur laquelle sont disposés quatre ustensiles du service à vin. L’inscription57 ne nous révèle pas ici le nom du dédicant. Sur ces deux reliefs ainsi que sur ceux du &er au &&&e s. p.C.58, le fait d’isoler le banqueteur, quel que soit le sexe, et de le présenter
55 CIL, VI, 27537.56 Autel d’Attia Agele, L. 0,61 m#; H. 0,88 m#; l. 0,395 m. Vatican, Museo Chiaramonti. Altmann 1905, 191
n°#255 "g. 153#; Boschung 1987, 8#; Andreae 1995, pl. 422-423#; Roller 2006, 124-126 "g. 12.57 CIL, VI, 12758#: Diis Manibus / Attiae Agele.58 Pour d’autres exemples, voir notamment Dunbabin 2003 et Roller 2006. Aux &&e et &&&e s. p.C., le
banqueteur isolé n’apparaît que dans la série des reliefs des equites singulares.
Fig. 6. Urne de T. Titulenus Isauricus, époque
© Copyright the Trustees of
Fig. 7. Autel d’Attia Agele, Vatican, Museo Chiaramonti. D’après Andreae 1995, pl. 422-423.
46Va
léri
e H
uet
frontalement instaure une distance entre le personnage et le spectateur, ce qui le distingue comme la représentation du défunt, même s’il est présenté en tant que vivant, qu’il soit plus ou moins dévêtu. L’image du banquet est toujours polysémique# : elle peut renvoyer autant à un banquet funéraire, un banquet dans l’au-delà qu’à la commémoration d’un banquet du monde des vivants.
En parallèle, le banqueteur (homme ou femme) peut être allongé seul sur un lit tout en étant entouré de personnages#: ce peut être des serviteurs debout, ou des membres de la famille (épouse, "ls, "lle) assis au pied du lit ou dans un fauteuil séparé. Aux &&&e et &'e s. p.C., quand le banqueteur est unique, le luxe se porte sur la multiplication des serviteurs et la profusion du banquet, ce que montre parfaitement le relief célèbre de P. Caecilius Vallianus ("g.#8)59. La scène de la cuve du sarcophage est organisée autour d’un homme (la "gure originelle était celle d’une femme) représenté banquetant sur une kliné"; des putti virevoltent autour de l’homme tout en maintenant une guirlande au-dessus de lui. Devant lui, une table-tripode où "gure un poisson. Autour de la table, des personnages en miniature#: deux enfants jouent avec un chien#; une souris grignote#; une autre "gure avance. À gauche de la kliné, une femme jouant de la musique, de la pandura, est assise dans un fauteuil en osier#; sa position dans le relief évoque l’épouse. Derrière elle, debout, apparaît une autre femme#: ses cheveux dénoués et le vase qu’elle porte l’assimilent à une servante. Elle est suivie par un tibicen. De part et d’autre de l’ensemble décrit, des jeunes hommes aux longs cheveux, c’est à dire des serviteurs de luxe, apportent des plats remplis, un vase et une patère, ou bien tiennent des animaux vivants (un paon et un lièvre). L’ampleur de la familia servile urbaine est donc bien mise en valeur. Notons toutefois que le cadre du banquet est délimité de chaque côté par un arbre et une grande corbeille de roses ("g.#9). Nous sommes donc devant l’image d’un banquet luxueux se déroulant à l’extérieur. De fait, l’image est bien polysémique puisqu’elle peut renvoyer d’une part au faste des banquets qui peuvent être privés comme publics, d’autre part à un banquet idéal et éternel auquel goûterait le défunt représenté en tant que vivant. L’image, si elle pouvait être vue – et pour un sarcophage, c’est loin d’être évident –, pouvait à la fois exprimer un encouragement à banqueter de son vivant et inciter la famille à ne pas négliger ses devoirs envers le mort.
Une autre façon de présenter les couples consiste à les allonger ensemble sur le lit#: le premier exemple datant de la "n de l’époque %avienne est l’autel de Q. Socconius Felix ("g.#10)60. Sur le lit, à droite, l’homme tient une coupe#; à gauche, la femme tient de la main droite une guirlande et de la gauche peut-être une coupe. Mais cette description ne correspond pas parfaitement à ce dont rend compte l’image, ni à la manière dont les Romains énonçaient leur emplacement sur le lit. En e!et, la femme est “au-dessous” (infra) de l’homme qui, lui, occupe la place “au-dessus” (supra).
59 L. 2,05 m ; H. 0,93 m#; l. 0,73 m. Vatican, Museo Gregorio Profano 9538/9539. Il a été trouvé entre Fornello et Scrofano, puis a été conservé au Palazzo Altieri, Rome. Il est daté c.#270 p.C. Sur l’arrière de la cuve, a été rajoutée une chasse au lion, en très bas relief. Sur le couvercle, des scènes de marché avec achat de poisson, pain et viande encadrent l’inscription (CIL, XI, 3800) : D(is) M(anibus) s(acrum) / P(ubli) Caecili / Valliani, /a militi(i)s,/ uixit ann(os) /LXIIII. Notons que ce couvercle n’allait peut-être pas de pair avec la cuve. Cf. Himmelmann 1973, 47-48 n° 3#; Amedick 1991, 167-168, n° 286, pl. 15.2-4, 16-17, 108#; Dunbabin 2003, 120-122 "g. 68-69#; Zanker-Ewald 2004, 177 n° 161#; Estienne & Huet 2004, 294-295 n° 140, pl. 62.
60 L. 1,30 m#; H. 1,50 m#; l. 0,70 m. Rome, anciennement via Quattro Fontane 13-18#; trouvé à côté de la via Triumphalis#; collection privée. L’arrière de l’autel met en scène un marchand de textile#; les faces latérales montrent une patère et un vase au-dessus d’une guirlande. Cf. Dunbabin 2003, 114-116 "g. 64#; Zanker-Ewald 2004, 190-191 n° 174#; Roller 2006, 149-153 "g. 17.
47
Fig. 8. Sarcophage de P. Caecilius Vallianus, Vatican, Museo Gregorio Profano 9538/9539.
Fig. 9. Détail du sarcophage de P. Caecilius Vallianus, Vatican, Museo Gregorio Profano inv. 8538/8539.
DAI Rome 90.413, photographie Anger.Fig. 10. Autel de Socconius Felix, Rome,
DAI, neg. 63.755, photo Felbermeyer.
48Va
léri
e H
uet
La femme lui est donc subordonnée tout en partageant sa couche. L’appropriation de la femme par l’homme est explicitée par son geste de la main droite qui entoure le cou de la femme et par la promiscuité à consonance nécessairement érotique ou sexuelle dont on trouve l’écho dans les poèmes d’Ovide quand il enrage par exemple de voir sa maîtresse dîner au-dessous de son mari. Sur le relief, la tunique de la femme a glissé et laisse découverts son épaule et le début de son sein#; le drapé “mouillé” montre en transparence son autre sein, les courbes de son ventre et de son bassin. Pour accentuer l’allusion à l’amour, un petit éros vole au-dessus d’elle. La femme se rapproche des images de l’épouse qui dévoilait son pouvoir de séduction quand elle était représentée seule sur le lit. Devant la kliné, la table est entourée de trois petits assistants, parmi lesquels celui de gauche a une taille inférieure. Les trois serviteurs rentrent dans une seconde hiérarchie, celle existant entre le dominus et les esclaves de la domus. Ce qui est donc valorisé ici, ce sont les liens d’amour entre le couple, évoquant avec les accessoires du banquet, dont font partie les assistants, le plaisir assumé d’un banquet luxueux et joyeux, donc d’un banquet réussi. La bonne entente conjugale est exposée aux yeux de tous. L’inscription61 toutefois est très courte et ne renvoie qu’aux Mânes du mari, du dominus. Cette manière de représenter un banquet “familial” ou plutôt “domestique” connaît une postérité jusqu’au début du &'e s. p.C.
La pertinence de l’image du banquet exaltant les rapports au sein de la familia, entre époux, entre parents et enfants, entre le dominus ou la domina et les esclaves, même réduite à la représentation d’un banqueteur et d’un seul serviteur, s’explique aisément par le fait que ces monuments sont pour la plupart érigés par des membres de la famille, parfois par le mort pour lui-même et les siens, et par le constat que seuls eux avaient accès à la tombe, constituant alors les spectateurs privilégiés des reliefs.
Mais revenons à la confrontation image/épigraphie. Un certain nombre de reliefs du corpus est accompagné d’inscriptions. Celles-ci nous donnent tout un ensemble d’informations, mais ce qui est frappant, c’est qu’elles ne mentionnent pas le banquet. Or le nombre d’inscriptions funéraires mentionnant le banquet est très important. Qu’en déduire#? Que les deux sont exclusives#? Je pense plutôt que les deux sont complémentaires, c’est à dire que si le banquet est représenté, nul n’est besoin de le mentionner#; par contre, s’il ne l’est pas, alors il est bien de l’énoncer ou de faire allusion à une libation. En fait, il existe à ma connaissance deux exceptions dans la documentation et une troisième sur un autre type de monument, les monuments à kliné. La première est un panneau de sarcophage ("g.#11) conservé à la villa Getty62. C’est un relief très complexe. Un homme, habillé d’une tunique et d’un drapé, accoudé directement sur le matelas du lit (kliné ou lectus) tient de la main gauche un gobelet ou coupe, de la droite une grappe de raisin63#; à ses pieds, un coq. Sous le lit, une table-tripode et une bouteille insérée dans son étui avec le couvercle ouvert. À gauche, une femme debout brandit un gobelet plus petit vers l’homme allongé, tandis que sa main gauche tient une guirlande ou couronne lâche repliée#; à ses pieds, une chèvre#; derrière, une chaise sur laquelle est posée une grosse pelote de laine. De part et d’autre du panneau, un homme assis sur un tabouret préparant des écheveaux de laine. Prolongeant la tête du lit, sur une ligne de rochers
61 CIL, VI 38916#: D(is) M(anibus) / Q(uinti) Socconi Felicis.62 L. 1, 75 m ; H. 0,465 m. Malibu, Getty Museum, 86.AA.701#; c. 180-190 p.C. Cf.#Koch 1988, 24-27
n°#9 ; Amedick 1991, 133, n° 68, pl. 1.2, 2.1, 3.3, 116.2# ; Schmidt 1993, pl. 88# ; Whitehead 1993# ; Estienne & Huet 2004, 294 n°#138, pl. 62.
63 Cette dernière est soulevée au-dessus du genou, dans un geste similaire à celui e!ectué par les equites singulares quand ils tiennent une couronne ou guirlande.
49D
es banquets sur les reliefs funéraires romains!: publics ou privés!?
ascendante, une petite scène montre un homme coi!é d’un bonnet phrygien tirant sous un arc un animal, tout en regardant derrière lui un autre personnage habillé et coi!é à l’identique qui semble danser#; devant, une femme se retourne64. Le banqueteur et la femme debout sont clairement en interaction. Comment faut-il interpréter le rôle de la femme#? Comme celui d’une assistante, ou d’une personne buvant avec l’homme qui pourrait être son épouse#? Les inscriptions65 peuvent nous aider à répondre à ces questions. En e!et deux noms sont cités#: Gaudenia Nice et T. Aelius Evangelicus et il est aisé de les attribuer aux deux "gures représentées et de les penser mariés. Le vin est aussi évoqué dans l’inscription puisque le mot merum apparaît. Comme l’inscription est di$cile à comprendre du fait de sa grammaire approximative et d’un re-martelage66, j’en donne ici la lecture que m’a proposée John Scheid et que j’agrée. À la première ligne, “il n’aura après moi et Gaudenia Nice personne d’autre, je l’interdis”#; à la seconde ligne, “je l’ai en e!et créée (la tombe) pour moi et elle”. La seconde partie de l’inscription commence à la "n de la première ligne et se poursuit sous le lit du banqueteur. Elle donne une deuxième injonction au lecteur de l’inscription#: “celui, quel qu’il soit, qui lira cette inscription, qu’il verse du vin pur à Titus Aelius Evangelus, homme qui endure (patiens)”. C’est le seul exemple d’inscription qui mentionne le vin dans l’ensemble de mon corpus. Pourtant ailleurs, beaucoup d’inscriptions enjoignent au spectateur de verser du vin ou d’en boire, mais soit les images qui les accompagnaient ont disparu, soit elles ne mettent pas en scène de banquet. La seule exception que je connaisse, à part le sarcophage du
64 Cela évoquerait des rites célébrés en l’honneur de Cybèle selon Rita Amedick (Amedick 1991), ou encore une allusion à Homère avec l’introduction du cheval de Troie d’après Margot Schmidt (Schmidt 1993). Les autres éléments évoquent le métier du défunt, lié au travail et/ou commerce de la laine.
65 AE, 1990, 1044#: Une inscription court au-dessus du panneau : Fuerit post me et post Gaudenia Nicene / ueto alium quisquis hunc titulum legerit / mi et illei feci"; une seconde est insérée sous le lit : T. Aelio Euangelo / homini patienti / merum profundat.
66 Le re-martelage avec une nouvelle inscription correspond aux mots ueto alium quisquis qui se continuent avec des mots qui ne devaient pas recouvrir une ancienne inscription# : hunc titulum legerit. Voir aussi Schmidt 1993, 193, n. 35 et Whitehead 1993.
Fig. 11. Sarcophage de T. Aelius Euangelus, Villa Getty, Malibu. (photographie du Getty : 8G.AA.701).
50Va
léri
e H
uet
Getty, est le monument à kliné de Flavius Agricola67. L’inscription "gurant sur la base n’existe plus puisqu’elle a été détruite sur l’ordre du pape Urbain VIII#; néanmoins on en a gardé la mémoire68. À deux reprises, le vin, Lyaeus, est mentionné, la première fois pour dire que de son vivant, Flavius Agricola n’en a jamais manqué, la seconde pour inciter les lecteurs à le mélanger et à le boire tant qu’il en est encore temps. Il y a donc une adéquation entre l’image et le texte, l’homme présenté au banquet en tant que vivant, une coupe à la main, et invitant les spectateurs à en faire autant. Pour le relief du Getty, l’adéquation existe aussi entre l’image et le texte, mais l’invitation a glissé du monde exclusif des vivants à celui des morts, puisque le spectateur est invité à honorer les mânes de Titus Aelius Evangelicus en lui versant du vin non coupé, celui réservé aux divinités, c’est-à-dire du merum. La dernière exception, mais qui ne mentionne pas le vin, est le relief de C.#Rubrius Urbanus provenant de Rome que je connais uniquement par un dessin de la collection de Cassiano dal Pozzo conservé au British Museum ("g. 12)69. L’épitaphe expose les raisons qui ont poussé le commanditaire à se faire représenter au banquet, juste en-dessous de l’image même du banquet#:
“Lui qui, dans la vie, vivait toujours en avare,épargnant pour son héritier, odieux envers lui-même,a demandé que la main d’un artiste le représente,après son trépas, prenant joyeusement part à un banquet,pour qu’au moins, étendu dans la mort, il puisse se reposeret jouir d’un paisible repos.À sa droite est son "ls qui, ayant choisi le métier de soldat,a péri avant le malheureux décès de son père.Mais que sert à des défunts une image de joie#?C’est plutôt de cette manière qu’ils auraient dû vivre.”70
67 Indianapolis Museum of Art#; provenant de la nécropole du Vatican#; c. 160 p.C. Lire Dunbabin 2003, 103-104, 110, "g. 54#; Davies 2007, 46-49. Je ne l’ai pas intégré dans le corpus, car celui que j’ai constitué ne concernait que les reliefs et non les éléments sculptés en partie en ronde-bosse. Mais il appartient bien sûr à une série de monuments qui exposent en guise de couvercle le banqueteur allongé sur une kliné, tenant une coupe de la main gauche. Sur ces monuments, lire Wrede 1977 et Dunbabin 2003, 110-114.
68 CIL, VI, 17985a = CIL, VI, 34112 = AE, 1972, 10#: Tibur mihi patria, Agricola sum uocitatus, / Flauius idem, ego sum discumbens ut me uidetis. / sic et aput superos annis quibus fata dedere / animulam colui, nec defuit umqua Lyaeus. / praecessitque prior Primitiua gratissima coniunxs,/ Flauia et ipsa, cultrix deae Phariaes casta / sedulaque et forma decore repleta, / cum qua ter denos dulcissimos egerim annos. / solaciumque sui generis Aurelium Primitiuum / tradidit qui pietate sua coleret fastigia nostra / hospitiumque mihi secura seruauit in aeuum. / amici qui legetis, moneo, miscete Lyaeum / et potate procul redimiti tempora $ore / et uenereos coitus formosis ne denegate puellis": / cetera post obitum terra consumit et ignis.
69 Rome, Palazzo Barberini. Le relief serait de la "n du &er s. ou du début du &&e s. p.C. Je me "e à Katherine Dunbabin#: Dunbabin 2003, 1-4.
70 CLE, 1106 = CIL, VI, 25531# : Qui dum vita data (e)st, semper viuebat auarus,/ heredi parcens, inuidus ipse sibi,/ hic accumbentem sculpi genialiter arte/ se iussit docta post sua fata manu,/ ut saltem recubans in morte quiescere posset/ securaque iacens ille quiete frui./ #lius a dextra residet, qui castra secutus/ occidit ante patris funera maesta sui./ sed quid defunctis prodest genialis imago"?/ hos potius ritu vivere debuerant./ C(aius) Rubrius Urbanus sibi et Antoniae / Domesticae coniugi suae et Cn(aeo) Domitio / Urbico Rubriano #lio suo et libertis / libertabusque posteri(s)que eorum et M(arco) / Antonio Daphno fecit. Je donne ici la traduction des premiers vers proposée par Étienne Wol!#: Wol! 2000, 138. Paul Veyne en donne une autre traduction#: Veyne 2005, 133 n. 59.
51D
es banquets sur les reliefs funéraires romains!: publics ou privés!?
Suit le nom du commanditaire, C. Rubrius Urbanus, qui a fait ériger le tombeau pour lui-même, sa femme, son "ls, ses a!ranchis et leur postérité, ainsi que pour un autre personnage. À en croire le dessin, le père, vêtu d’une tunique et de la toge, est allongé sur le lit et regarde le spectateur, une coupe dans la main gauche, une guirlande dans la droite que tient aussi son "ls de la main droite#; ce dernier est représenté de pro"l assis sur un tabouret plein#; il est vêtu d’un manteau court à capuche qui l’enveloppe, porte sur le côté un glaive#; de la main gauche, il tient une longue baguette. Une table trépied présente de la vaisselle à boire. L’image du banquet correspond aux autres images de banquet à kliné sur lesquelles nous nous sommes interrogé#: elle semble “réelle”, mais elle correspond à un banquet impossible, sauf dans un au-delà qui permettrait de faire rejoindre le père et le "ls, qui leur permettrait de banqueter ensemble#; leur lien est la guirlande, renvoyant à la fois aux guirlandes et couronnes du banquet et à celles ornant les tombeaux. Toutefois la croyance en un banquet dans l’au-delà semble niée par un vers de l’épitaphe. Il ne s’agit donc pas d’une image commémorative, mais de l’expression d’un regret, d’un banquet de vivants idéal mais inexistant.
Ce monument nous rappelle que les images ne présentent pas des banquets “réels”. Certains chercheurs ont voulu voir dans les images de banquets à sigma, entre amis, des banquets plus “réels” que ceux se passant sur des klinai. Ils sont di!érents, mais pas plus “réels”. Toutes les images de banquet sont polysémiques, pouvant commémorer des banquets ayant été donnés ou auxquels le défunt aurait participé, ou encore auquel le défunt aurait aimé participer de son vivant. Elles rappellent aussi aux spectateurs leurs devoirs de libations, de leur vivant, et pour les morts. Mais les choix de composition ne révèlent pas nécessairement le caractère “public” ou “privé”#: ils mettent par contre en avant la volonté du commanditaire d’insister soit sur les relations dissymétriques et hiérarchiques existant au sein de la familia et valorisant le pater familias ou le dominus, parfois la domina, soit sur la communauté des “amis”, voire sur celle des
Fig. 12. Dessin du relief de C. Rubrius Urbanus, collection de Cassiano dal
Museum.
52Va
léri
e H
uet
citoyens. C’est pourquoi, plutôt que de parler de “banquet public”, il est plus juste de parler de banquets communautaires, la communauté pouvant désigner celle de la cité, celle d’un collège, ou encore celle de la famille élargie.
En guise de conclusion, j’aimerai insister sur le fait que l’image de banquets sur des monuments funéraires est en même temps générique et spéci"que#; elle ne nous indique pas si le banquet est privé ou public, mais elle renvoie à tous les banquets#; bien sûr, dans les détails elle peut mettre en avant des signes plus ou moins publics, plus ou moins privés, plus ou moins funéraires. Mais en même temps la polysémie de l’image de banquet permet d’évoquer les banquets publics comme privés, les banquets de collèges, les banquets de fondation, les banquets familiaux, etc. Notre di$culté à identi"er le caractère public ou privé du banquet représenté n’est pas due simplement à un manque de référents de notre part, nous modernes, mais probablement à la volonté des commanditaires et des sculpteurs d’évoquer les banquets dans leur ensemble. Ceci d’ailleurs explique certainement la faveur et le nombre de ces scènes sur les monuments funéraires dans le monde romain. Ceci explique aussi pourquoi le défunt ne peut généralement pas être représenté sous la forme de squelette dans l’espace funéraire, alors que l’image des squelettes peut être présente dans l’espace des maisons71.
Références bibliographiques
Andreae, B. (1980)#: Die Sarkophagen mit Darstellungen aus dem Menschenleben. Die römischen Jagdsarkophage, ASR 1.2, Berlin.
—, éd. (1995)#: Bildkatalog der Skulpturen des Vatikanischen Museums I. Museo Chiaramonti 1.2.3, Berlin-New York.Andreau, J. (1992) : “L’a!ranchi”, in#: Giardina 1992, 219-246. Amedick, R. (1991)#: Die Sarkophage mit Darstellungen aus dem Menschenleben, Vierter Teil : Vita Privata, ASR 1.4,
Berlin.Azoulay, V., F. Gherchanoc et S. Lalanne, éd. (2012)#: Le banquet de Pauline Schmitt Pantel. Genre, Mœurs et politique
dans l’Antiquité grecque et romaine, Paris.Baratte, F. (2009)#: “La chasse dans l’iconographie des sarcophages. Signe social ou valeur funéraire#?”, in#: Trinquier
& Vendries 2009, 53-64.Bek, L. (1983)# : “Questiones Conuiuales. (e Idea of the Triclinium and the Staging of Convivial Ceremony from
Rome to Byzantium”, Analecta romana, 12, 81-107.Belayche, N. (1995)#: “La neuvaine funéraire à Rome ou‘la mort impossible’”, in : Hinard 1995, 155-169.Bergmann, B. et C. Kondoleon, éd. (1999)#: %e Art of Ancient Spectacle, Studies in the History of Art 56, Washington.Boschung, D. (1987)#: Antike Grabaltäre aus den Nekropolen Roms, Acta Bernensia 10, Bern.Cima, M. et E. La Rocca, éd., (1998)#: Horti Romani, Atti del Convegno Internazionale, Roma, 4-6 maggio 1995, Rome.Clarke, J. R. (2003)# : Art in the Lives of Ordinary Romans. Visual Representation and Non-elite Viewers in Italy, 100
B.C.-A.D. 315, Berkeley-Los-Angeles-Londres.Compostella, C. (1992)#: “Banchetti pubblici e banchetti privati nell’iconogra"a funeraria romana del I secolo d.C.”,
MEFRA, 104, 659-689.Davies, G. (2007)#: “Idem ego sum discumbens, ut me videtis": Inscription and Image on Roman Ash Chests”, in#: Newby
& Leader-Newby 2007, 38-59. D’Arms, J. H. (1981)#: Commerce and Social Standing in Ancient Rome, Cambridge.
71 Il n’existe que de rares exceptions, comme l’autel d’Antonia Panace daté de la "n du &er s. p.C., conservé au Musée national de Naples#: Dunbabin 2003, 135-136, "g.#79.
53D
es banquets sur les reliefs funéraires romains!: publics ou privés!?
— (1984)#: “Control, Companionship, and Clientela. Some Social Functions of the Roman Communal Meal”, Échos du monde classique 3 (1984), 327-348.
— (1990)#: “(e Roman Convivium and the Idea of Equality”, in#: Murray 1990, 308-320.— (1998)#: “Between Public and Private#: (e epulum publicum and Caesar’s Horti Trans Tiberim”, in#: Cima & La
Rocca 1998, 33-43.— (1999)#: “Performing Culture#: Roman Spectacle and the Banquets of the Powerful”, in#: Bergmann & Kondoleon
1999, 301-319.— (2000)#: “P. Lucilius Gamala’s Feasts for Ostians and their Roman Models”, JRA, 13, 192-200.Dumont, J. C. (1990)#: “Le décor de Trimalcion”, MEFRA, 102, 2, 959-981.Dunbabin, K. M. D. (1991)#: “Triclinium and stibadium”, in#: Slater 1991, 121-148.— (1996)#: “Convivial Spaces#: Dining and Entertainment in the Roman Villa”, JRA, 9, 66-80.— (2003)#: %e Roman Banquet, Images of Conviviality, Cambridge.Dupont, F. [1977] (2002)#: Le plaisir et la loi. Du Banquet de Platon au Satiricon, Paris.Ernout, A., éd. (1923)#: Pétrone, Le Satiricon, Belles Lettres, CUF, Paris.Estienne, S. et V.#Huet avec la collaboration de N. Gilles, S. Wyler, (2004)#: “Le banquet à Rome”, in#: Lissarrague &
Schmitt Pantel 2004, 268-297. — (2012)#: “Autour d’un banquet des Vestales. Sociabilité et ritualité des banquets sacerdotaux à Rome”, in#: Azoulay
et al. 2012, 483-500.Fogolari, G. (1956)#: “Ara con scena di convito”, Aquileia Nostra, 27, 39-50.Frontisi, F. et F. Lissarrague, (1998)#: “Signe, objet, support#: regard privé, regard public”, in#: Polignac & Schmitt-
Pantel 1998, 137-144.Georgoudi, S., R. Koch Piettre et F. Schmidt, éd. (2005)#: La cuisine et l’autel. Les sacri#ces en questions dans les sociétés
de la Méditerranée ancienne, Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences Religieuses, 124, Turnhout.Ghedini, F. (1990)#: “Ra$gurazioni conviviali nei monumenti funerari romani”, RdA, 14, 35-62.— (1992)#: “Caccia e banchetto#: un rapporto di$cile”, RdA, 16, 72-88.Giardina, A., éd. (1992) : L’homme romain, Paris.Giuliano, A. (1966)#: “Rilievo con scena di banchetto a Pizzoli”, Studi Miscellanei, 10, 1963-1964, 33-38. Gros, P. (2001)#: L’architecture romaine du début du IIIe s. av. J.-C. à la #n du Haut-Empire, t. 2#: Maisons, palais, villas
et tombeaux, Paris.Grottanelli, C. et N. F. Parise, éd. (1988)#: Sacri#cio e società nel mondo antico, Rome-Bari.Hesberg, H. von et P. Zanker, éd. (1987)#: Römische Gräberstrassen. Selbstdarstellung-Status-Standard. Kolloquium in
München vom 28. bis 30. Oktober 1985, Munich.Himmelmann, N. (1973)# : Typologische Untersuchungen an römischen Sarkophagreliefs des 3. und 4. Jahrhunderts n.
Chr., Mayence.Hinard, F., éd. (1995)#: La mort au quotidien dans le monde romain, Actes du colloque de l’université Paris IV (7-9 oct.
1993), Paris.Holliday, P. J., éd., (1993) : Narrative and Event in Ancient Art, Cambridge.Jastrzebowska, E. (1979)#: “Les scènes de banquet dans les peintures et sculptures chrétiennes des &&&e et &'e siècles”,
Recherches Augustiniennes, 4, 3-90.Koch, G. (1988)#: Roman funerary Sculpture. Catalogue of the Collections, Malibu.—, éd. (1993)#: Grabeskunst der römische Kaiserzeit, Mayence.
Lindsay, H. (1998)#: “Eating with the Dead#: the Roman Funerary Banquet”, in#: Nielsen & Nielsen 1998, 67-80.Lissarrague, F. et P. Schmitt Pantel, éd. (2004) : “Banquet”, %esCRA, 2, Los Angeles, 215-297.Moretti, J.-C. et D. Tardy (2006) : L’architecture funéraire monumentale": la Gaule dans l’Empire romain, Paris.Morton Braund, S. (1996)#: “(e Solitary Feast#: a Contradiction in Terms#?”, Bulletin of the Institute of Classical Studies
of the University of London, 41, 37-52. Murray, O., éd. (1990)#: Sympotica. A Symposium on the Symposion, Actes du colloque d’Oxford, 4-8 Septembre 1984,
Oxford.Newby, Z. et R. Leader-Newby, éd. (2007) : Art and Inscriptions in the Ancient World, Cambridge.Nielsen, I. et H. S. Nielsen, éd. (1998)#: Meals in a Social Context. Aspects of the Communal Meal in the Hellenistic and
Roman World, Aarhus.Persichetti, N. (1908)#: “Due rilievi amiternini”, RM, 23, 15-25. Polignac, F. de et P. Schmitt-Pantel, éd. (1998) : Public et Privé en Grèce ancienne": lieux, conduites, pratiques, Actes du
colloque organisé à Paris par le centre Louis Gernet les 15-17 mars 1995, Ktéma, 23.Roller, M.#B. (2006)#: Dining Posture in Ancient Rome : Bodies, Values, and Status, Princeton.Rossiter, J. (1991)#: “Convivium and Villa in Late Antiquity”, in#: Slater 1991, 199-214.Rosso, E. (2006)#: “Le décor sculpté des mausolées de Narbonne#: problèmes d’interprétation. À propos de l’auto-
représentation des ‘élites’ narbonnaises sous les Julio-Claudiens”, in : Moretti & Tardy 2006.
54Va
léri
e H
uet
Rüpke, J. (1998)#: “Kommensalität und Gesellschaftsstruktur : Tafelfreu(n)de im alten Rom”, Saeculum, 49, 193-215.— (2005)#: “Gäste der Götter – Götter als Gäste#: zur Konstruktion des römischen Opferbanketts”, in#: Georgoudi
et al. 2005, 227-239.Sauron, G. (1994)#: Quis Deum"? L’expression plastique des idéologies politiques et religieuses à Rome, BEFAR 285, Rome.Schäfer, T. (1989)#: Imperii insignia. Sella curulis und fasces. Zur Repräsentation römischer Magistrate, Mayence.— (1990)#: “Der Honor Bisellii”, RM, 97, 1990, 307-346.Scheid, J. (1984)#: “Contraria facere#: renversements et déplacements dans les rites funéraires”, AION, 5, 127-139.— (1988)#: “La spartizione sacri"cale a Roma”, in#: Grotanelli & Parise 1988, 267-292.— (1990)#: Romulus et ses frères. Le collège des frères Arvales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs, BEFAR
275, Rome.— (2005a)#: Quand faire c’est croire. Les rites sacri#ciels des Romains, Paris.— (2005b)#: “Manger avec les dieux. Partage sacri"ciel et commensalité dans la Rome antique”, in#: Georgoudi et al.
2005, 273-287.Schmidt, M. (1993)#: “Zur Sarkophagfront des Titus Aelius Euangelus im J. Paul Getty Museum in Malibu. Fullones
ululamque cano, non arma virumque...”, in#: Koch 1993, 187-193.Sinn, F. (1987)#: Stadtrömische Marmorurnen, Mayence.Slater, W. J., éd. (1991)#: Dining in a Classical Context, Ann Arbor.Soprano, P. (1950)#: “I Triclini all’aperto di Pompei”, Pompeiana 1, 288-310.Trinquier, J. et C.#Vendries (2009)#: Chasses antiques. Pratiques et représentations dans le monde gréco-romain (IIIe siècle
av.-IVe siècle apr. J.-C.), Rennes.Veyne, P. (1961)#: “Vie de Trimalcion”, Annales ESC, 16.2, 213-247#; repris dans Veyne 1990, 13-56.— (1990)#: La société romaine, Paris. — (2000)#: “La ‘plèbe moyenne’ sous le haut-empire romain”, Annales Histoire, Sciences Sociales, 6, 1169-1199.— (2005)#: L’empire gréco-romain, Paris.Whitehead, J. (1993)# : “(e ‘Cena Trimalchionis’ and Biographical Narration in Roman Middle-Class Art”, in# :
Holliday 1993, 299-325.Wrede, H. (1977)# : “Stadtrömische Monumente, Urnen und Sarkophage des Klinentypus in den beiden ersten
Jahrhunderten n. Chr.”, AA 92, 395-431.Zaccaria Ruggiu, A. (1995)#: Spazio privato e spazio pubblico nella città romana, Coll. EfR 210, Rome.Zanker, P. et B. C. Ewald (2004)#: Mit Mythen leben. Die Bilderwelt der römischen Sarkophage, Munich.